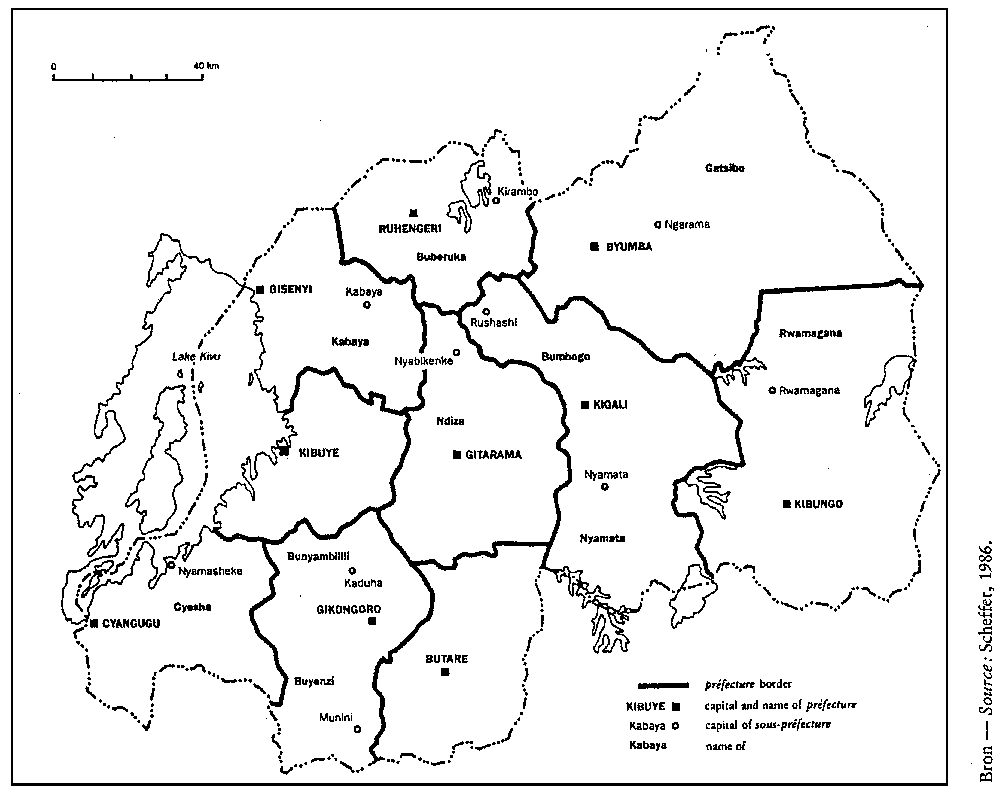
1-611/7 | 1-611/7 |
6 DÉCEMBRE 1997
Dans le cadre de l'évaluation de la politique du Gouvernement face aux événements du Rwanda (1993-1994), la Commission des Affaires étrangères du Sénat a examiné notamment la proposition visant à instituer une commission d'enquête parlementaire chargée d'enquêter sur les facteurs ayant déterminé la politique de la Belgique dans les mois qui ont précédé le génocide au Rwanda, lors de celui-ci et pendant son exécution (1) et la proposition visant à instituer une commission d'enquête parlementaire sur l'assassinat de dix Casques bleus belges et sur la préparation du génocide au Rwanda (2).
À cette occasion, la commission a écrit au ministre des Affaires étrangères et au ministre de la Défense nationale pour leur demander de lui transmettre « les notes d'information qui sont parvenues à leur département ou à leur cabinet pendant les mois qui ont précédé l'assassinat des dix Casques bleus belges et le génocide au Rwanda ». Cette requête a été accueillie avec des réserves par le Gouvernement, qui a invoqué la confidentialité de l'information et la nécessité de protéger ses sources. Les dossiers contiennent en effet des pièces qui proviennent des services de renseignements et mentionnent des « informations émanant de tiers dont il n'est pas possible ou souhaitable de divulguer l'identité » .
Au cours du printemps et de l'été 1996, une pétition a circulé dans le public et a recueilli plus de 200 000 signatures.
Le 27 juin 1996, les deux ministres ont fait un exposé sur les informations reçues pendant la période visée, mais sans remettre de documents.
La commission ne se contentant pas de cette solution, le problème fut soumis au bureau du Sénat qui, en concertation avec le Gouvernement, élabora une proposition de compromis respectant à la fois le principe de l'obligation de rendre des comptes au Parlement et le principe de la confidentialité de certains documents.
La Commission des Affaires étrangères adopta la proposition à l'unanimité, après l'avoir légèrement amendée.
Le texte de la décision unanime prise par la Commission des Affaires étrangères le 24 juillet 1996 est libellé comme suit :
« de mettre en place un groupe ad hoc pour consulter les documents aux départements des Affaires étrangères et de la Défense concernant les événements qui se sont déroulés au Rwanda entre la conclusion des accords d'Arusha en août 1993 et le déclenchement du génocide en avril 1994;
de charger MM. André et Delva, présidents émérites de la Cour d'arbitrage, et M. Swaelen, président du Sénat, MM. Mahoux et Verhofstadt, vice-présidents du Sénat, et M. De Decker, sénateur et président du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, de consulter les documents et informations susvisés, d'établir un rapport sur les informations contenues dans les documents relatifs à la période susvisée, de déposer leur rapport devant la commission dans un délai raisonnable et au plus tard le 15 octobre 1996 et de se présenter devant la commission pour lui fournir tous éclaircissements utiles;
de requérir des membres du groupe ad hoc le respect d'une obligation de discrétion en ce qui concerne les informations recueillies à l'occasion de l'accomplissement de leur mission;
jusqu'au dépôt du rapport du groupe ad hoc, de suspendre les travaux de la commission sur le même sujet. »
Les réunions plénières du groupe ad hoc ont eu lieu les 12 août 1996, 3 et 17 septembre 1996, 11 et 25 octobre 1996, 8, 22 et 29 novembre 1996, 4, 6, 9, 10, 13, 18 et 19 décembre 1996.
Il est rapidement apparu que le volume des documents à examiner était considérable et qu'il faudrait en outre recueillir des informations complémentaires. En conséquence, la Commission des Affaires étrangères a accepté de prolonger le mandat du groupe de travail jusqu'au début du mois de décembre 1996, et, par la suite, jusqu'au début du mois de janvier 1997.
La mission du groupe ad hoc était d'établir de quelles informations relatives au Rwanda les autorités civiles et militaires belges ont disposé pendant la période comprise entre les accord d'Arusha (4 août 1993) et le déclenchement du génocide (avril 1994). Cette connaissance devait permettre à la Commission des Affaires étrangères du Sénat de déterminer si ces mêmes autorités ont assumé correctement leurs responsabilités en la matière.
Pour définir sa mission, le groupe de travail est parti du principe que les responsabilités concernaient la politique suivie par la Belgique vis-à-vis du Rwanda durant la période qui a précédé le meurtre des paras belges et le déclenchement du génocide; la participation d'un détachement belge à la MINUAR avec notamment les problèmes relatifs au statut, à la mission, aux « règles d'engagement », aux moyens mis à disposition, etc.; la décision de retirer le détachement; les démarches entreprises auprès de l'Organisation des Nations unies en vue de renforcer le mandat et les moyens de la MINUAR. Cette responsabilité du Gouvernement belge ne s'étend ni aux décisions de l'ONU elle-même, ni aux décisions qui ont été prises par la filière de commandement de la MINUAR.
Le groupe de travail a convenu, étant donné que sa mission avait été définie de manière très vague et dans des termes très généraux, de s'en tenir strictement à noter les faits, à effectuer des constatations et, éventuellement, à évaluer la valeur de certaines informations.
Le 7 janvier 1997, le groupe ad hoc a présenté son rapport (3) à la Commission des Affaires étrangères. La presse en a été informée le même jour.
Les 9 et 14 janvier 1997, la Commission des Affaires étrangères a procédé à un échange de vues à propos du rapport du groupe ad hoc .
Le 17 janvier 1997, le Bureau du Sénat a proposé, en séance plénière du Sénat, la création d'une commission spéciale Rwanda. La commission se composerait du Président du Sénat et d'un représentant des groupes politiques représentés au sein du Bureau du Sénat. Les groupes politiques qui ne seraient pas représentés au sein du Bureau pourraient désigner un membre ayant voix consultative.
Le 28 janvier 1997 a vu la composition du Bureau de la commission spéciale Rwanda. M. Swaelen, président du Sénat, étant président de plein droit, MM. Mahoux et Verhofstadt ont été désignés respectivement en tant que premier vice-président et deuxième vice-président, et M. Destexhe a été désigné en tant que secrétaire. La commission spéciale était composée en outre de MM. Caluwé et Hostekint, Mme Willame-Boonen, M. Ceder, M. Anciaux (avec voix consultative), M. Jonckheer (avec voix consultative), Mme Dua (avec voix consultative).
La commission spéciale a reçu un mandat de cinq mois, de manière que le rapport puisse être présenté en séance plénière au cours de la deuxième quinzaine du mois de juin.
La mission de la commission était de poursuivre le travail, à partir du rapport du groupe ad hoc concernant les événements du Rwanda, d'examiner quelle politique les autorités belges et internationales avaient menée, plus particulièrement quelles actions elles avaient entreprises, et de formuler éventuellement des conclusions relatives aux responsabilités et à propos des mesures qu'il y aurait lieu de prendre dans le futur.
Les premières réunions de travail, qui ont débuté le 5 janvier 1997, ont été consacrées à la rédaction d'une division thématique à suivre dans l'enquête, de listes de témoins à entendre et du règlement d'ordre intérieur de la commission.
Au cours de ces premières réunions, l'on a également décidé de se faire assister par des spécialistes, à savoir par deux experts en droit international (en particulier en ce qui concerne les institutions de l'ONU), MM. Suy et David, respectivement professeur ordinaire à la K.U.L. et professeur ordinaire à l'U.L.B., et par deux experts militaires, le général-major Duchâtelet, commandant militaire du Palais de la Nation, et le colonel e.r. Malherbe, ancien commandant du Régiment paracommando et du contingent belge de l'UNPROFOR.
Le 19 février 1997, la série d'auditions a débuté par des auditions et des entretiens avec les familles des victimes des événements du Rwanda (voir point 1.3.3.1).
Au cours de la première partie de ses travaux, la commission spéciale a été confrontée à un problème particulier concernant les modalités selon lesquelles les membres de la commission spéciale qui n'avaient pas participé aux travaux du groupe ad hoc pourraient consulter les documents qui avaient été mis à la disposition de celui-ci aux termes d'un accord avec le Gouvernement. L'on a obtenu que tous les membres de la commission spéciale et ensuite également tous les membres de la commission d'enquête parlementaire aient accès aux documents du ministère des Affaires étrangères. Les documents provenant du ministère de la Défense nationale ont toutefois été mis, en principe, à quelques exceptions près, à la disposition des membres du groupe ad hoc .
Pour certain nombre de documents que la commission désirait se voir communiquer ont manqué, notamment les documents Nees et De Cuyper ainsi que les procès-verbaux des réunions de coordination des Affaires étrangères. La constatation s'imposait également qu'un certain nombre de témoignages contenaient des contradictions manifestes, tant en eux-mêmes qu'entre eux. Enfin, la commission s'est vue confrontée à l'impossibilité d'interroger dans ses fonctions le juge d'instruction qui menait les enquêtes judiciaires parallèles. En raison de tous ces arguments, qui allaient pousser de plus en plus à la transformation en commission d'enquête, on a prévu une réunion d'évaluation à bref délai.
Le 19 mars 1997, une proposition qui tendait à demander au Sénat de transformer la commission spéciale en une commission d'enquête, fut rejetée. Un consensus put néanmoins être dégagé concernant la non-communication des documents Nees et De Cuyper : la commission allait pouvoir faire usage des compétences d'une commission d'enquête si, le 16 avril 1997, ces documents n'avaient pas été mis à sa disposition. Le 19 mars 1997, la commission décida également, à l'unanimité, d'évaluer son fonctionnement et son statut.
Le fonctionnement de la commission fut longtemps entravé par l'absence de réponse à l'invitation qu'elle avait adressée aux témoins des Nations unies. Cet élément a joué un rôle décisif dans la discussion relative à la question de savoir s'il fallait transformer ou non la commission spéciale en une véritable commission d'enquête. Le 16 avril 1997, le Président communiqua à la commission la réponse négative de l'actuel secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, et un des principaux arguments contre la création d'une commission d'enquête parlementaire avait, dès lors, disparu.
La commission s'étant vue mise dans l'impossibilité d'entendre des personnalités des Nations unies, l'on décida de demander à Mme Suhrke, chercheur en chef au Chr. Michelsen Institute à Bergen (Norvège) et auteur du Rapport II « The Joint Evaluation of Emergency Assistance to Ruanda », qui avait été autorisée, antérieurement, à interroger des fonctionnaires des Nations unies, d'intervenir en tant qu'intermédiaire pour questionner les intéressés. Au cours du mois d'octobre, Mme Suhrke devait toutefois déclarer qu'il lui était impossible de remplir cette mission. Ensuite, la commission d'enquête parlementaire Rwanda prit contact avec la représentation permanente belge auprès des Nations unies afin d'obtenir des éclaircissements sur certains points.
Le 23 avril, le Président du Sénat déposa au Bureau du Sénat une proposition visant à instituer une commission d'enquête parlementaire à part entière qui comprendrait quinze membres et qui remplacerait la commission spéciale composée, elle, de huit membres. Les trois membres ayant voix consultative feraient partie de la commission d'enquête et conserveraient leur statut.
M. Jonckheer et Mme Dua déposèrent une proposition d'amendement de la proposition du Président visant à instituer une commission d'enquête parlementaire concernant les événements du Rwanda (4) pour rendre possible une éventuelle prolongation du mandat de celle-ci (5).
La proposition d'instituer une commission d'enquête parlementaire concernant les événements du Rwanda fut adoptée, sans amendement, par le Sénat, le 24 avril 1997 (6).
La réunion d'installation de la commission d'enquête parlementaire Rwanda eut lieu le 30 avril 1997. Le bureau de la commission fut composé comme suit : aux côtés du président du Sénat, M. Swaelen, président de commission de droit, l'on désigna M. Mahoux en tant que premier vice-président et M. Verhofstadt en tant que deuxième vice-président. MM. Mahoux et Verhofstadt furent également désignés en tant que rapporteurs. La commission comprenait au total quinze membres. Outre les membres du bureau, la commission d'enquête comprenait M. Caluwé, Mme Thijs, M. Hotyat, Mme Lizin, MM. Goris, Hostekint, Moens, De Decker, Destexhe, Mme Bribosia-Picard, Mme Willame-Boonen, M. Ceder, M. Anciaux (avec voix consultative), M. Jonckheer (avec voix consultative) et Mme Dua (avec voix consultative). Le règlement interne fut adopté.
C'est également le 30 avril qu'eut lieu la première réunion préparatoire à la rédaction du rapport de la commission. Les rapporteurs proposèrent un projet de plan du rapport.
Au cours de sa réunion du 13 mai, la commission décida de recourir à la coopération juridique experte de Mme Roggen, assistante à l'U.L.B. et avocate au barreau de Bruxelles.
Dans le cadre du dossier relatif à la R.T.L.M., la commission décida, le 13 mai, dans le cadre de la compétence qu'elle a reçue en application de l'article 4, § 2, de la loi de 1880 sur les enquêtes parlementaires, de demander au premier président de la cour d'appel de désigner un magistrat chargé des devoirs d'instruction nécessaires pour que la commission d'enquête puisse exercer sa mission spécifique. Le juge d'instruction devait examiner un certain nombre de transactions financières relatives au financement de l'émetteur radio rwandais R.T.L.M.
Le 21 mai, les membres de la commission d'enquête visitèrent le S.G.R. et le C Ops à Evere, à l'invitation du ministre de la Défense. Ce même jour eut lieu également un échange de vues particulier avec les experts militaires de la commission.
L'Assemblée nationale du Rwanda adressa au Sénat de Belgique une lettre pour l'inviter à envoyer au Rwanda une délégation qui pourrait y consulter les archives. La question de l'opportunité politique ou autre d'une visite au Rwanda d'une délégation de la commission donna lieu à un large débat. À la demande de la commission, M. Mahoux se rendit sur place afin de vérifier les archives. Son rapport se trouve à l'annexe nº 3 du rapport.
Au cours de la réunion du 11 juin 1997, le président fit savoir que M. Nahimana avait introduit une demande en récusation du commissaire Destexhe. Le président décida que la demande était toutefois irrecevable. La commission toute entière conclura elle aussi à l'irrecevabilité de la demande en récusation, après avoir été saisie d'un recours en appel.
L'on constata, au cours de la réunion du 24 juin, que la durée du mandat existant ne suffirait pas. Le 26 juin 1997, le Sénat, dont le Bureau avait déposé une proposition (7), décida que la commission d'enquête parlementaire concernant les événements du Rwanda devrait déposer son rapport avant la fin du mois d'octobre 1997. Pour la rédaction de son rapport, la commission pourrait continuer à exercer les compétences légales qui sont celles d'une commission d'enquête parlementaire (8). En raison du grand volume de travaux, le Sénat a prolongé deux fois le mandat de la commission, tout d'abord jusqu'au 2 décembre 1997 et ensuite jusqu'au 6 décembre 1997.
Conformément à la décision du Sénat du 24 avril 1997, la commission d'enquête parlementaire concernant les événements du Rwanda avait pour mission, « à partir du rapport du groupe ad hoc Rwanda, créé par décision de la commission des Affaires étrangères du Sénat du 24 juillet 1996, de poursuivre le travail de la commission spéciale Rwanda instituée par le Sénat le 23 janvier 1997.
La commission examine quelle politique les autorités belges et internationales ont menée, plus particulièrement quelles actions elles ont entreprises, et formule éventuellement des conclusions concernant les responsabilités et les mesures qui devraient être prises dans le futur » (9).
Cette mission était la même que celle qui avait été confiée à la commission spéciale Rwanda. La transformation de la commission spéciale en commission d'enquête n'a donc entraîné aucune modification de la mission matérielle de la commission, mais elle a modifié les compétences techniques qui lui avaient été attribuées pour qu'elle puisse s'acquitter de sa mission.
La commission d'enquête disposait, pour remplir sa mission, de toutes les compétences visées à l'article 56 de la Constitution et dans la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires.
1.3.1.1. Auditions des familles des victimes
(1) Commission spéciale Rwanda
La commission spéciale a estimé prioritaire de faire précéder les interrogatoires de témoins par un entretien avec les familles des victimes. Comme celles-ci sont les premières concernées, la commission leur devait, par respect, de les informer sur sa mission et sur ses objectifs. La commission leur a demandé de réagir et de lui transmettre éventuellement un message. La commission leur a également demandé des renseignements concrets sur certains points spécifiques du dossier.
Les auditions et entretiens introductifs avec les familles des victimes ont eu lieu le 19 février 1997. L'attention spéciale qui a été accordée aux familles des victimes concernait à la fois les familles des 10 Casques bleus belges, celles des victimes civiles et celles des victimes rwandaises du génocide.
Pour ce qui est des dix paracommandos tombés à Kigali, l'on a demandé à trois proches, à savoir Mme Lotin, M. Leroy et Mme Dupont, de venir témoigner. D'autres membres des familles qui souhaitaient être entendus l'ont été (10).
Comme il n'existe aucun lien direct entre le sort des diverses victimes civiles, les divers témoins ont dû être entendus séparément. M. et Mme Godfriaux, Mme Beckers et Mme Mugwaneza ont pris tour à tour la parole (11) à propos du sort des victimes civiles.
Pour ce qui est du troisième volet, l'on a choisi d'entendre d'abord le CRDDR (Comité pour le respect des droits de l'homme au Rwanda), qui est une organisation représentative des victimes rwandaises en Belgique. M. J. Gasana, qui a représenté le comité devant la commission, a laissé, après son exposé, la parole à deux témoins du génocide, à savoir Mmes Nyirazaninka et Mukeshimana. L'on a entendu ensuite un représentant du CLADHO (Collectif des ligues et associations de défense des droits de l'homme), M. Nsanzuwera. CLADHO est l'organisation de coordination des organisations rwandaises de défense des droits de l'homme (12).
(2) Commission d'enquête parlementaire Rwanda
Juste avant de terminer la série d'auditions, l'on a à nouveau donné la parole aux familles des Casques bleus belges décédés, pour leur permettre de faire part de leurs impressions concernant les travaux de la commission. Mme Debatty, Mme Dupont, M. Leroy, M. Lhoir et Mme Bassine ont pris la parole (13).
Au cours de la séance en question, le président a souligné qu'une lettre avait été adressée aux familles des victimes civiles belges. Comme une instruction était en cours concernant les circonstances du décès de ces victimes, la commission d'enquête était tenue à une discrétion totale en la matière. En outre, comme une instruction était en cours, la commission d'enquête a été obligée d'observer une grande discrétion dans le dossier en question pour ne pas porter atteinte aux dispositions constitutionnelles et légales qui règlent le rapport entre les enquêtes des commissions parlementaires et les instructions judiciaires.
La liste des témoins qui ont comparu devant la commission respecte l'ordre chronologique des comparutions. Elle indique également en quelle qualité les témoins ont été entendus par la commission.
(1) Commission spéciale concernant
les événements du Rwanda
| Date | Témoin(s) | Qualité en laquelle le témoin a été entendu |
| 19/2/1997 | Mme Lotin, M. Leroy, Mme Dupont, M. Méaux, Mme Bassine, Mme Debatty, M. Plescia | Représentants des familles et apparentés des dix paracommandos assassinés |
| 19/2/1997 | M. et Mme Godfriaux, M. Dulieu, Mme Beckers, M. Mugwaneza | Représentants des membres des familles et apparentés des victimes civiles belges |
| 19/2/1997 | M. J. Gasana Mme Nyirazaninka, Mme Mukeshimana | Représentants du CRDDR (Comité pour le respect des droits de l'homme au Rwanda) |
| 19/2/1997 | M. Nsanzuwera | Représentant du CLADHO (Collectif des ligues et associations de défense des droits de l'homme) |
| 26/2/1997 | Le professeur Reyntjens | Professeur ordinaire à l'« Universitaire Instelling Antwerpen » et spécialiste de l'Afrique centrale |
| 26/2/1997 | Mme A. Desforges | Représentante de Human Rights Watch; Représentante de la commission internationale pour la constatation de la violation des droits de l'homme au Rwanda |
| 26/2/1997 | M. W. Martens, ministre d'État | Premier ministre |
| 28/2/1997 | MM. Brouhns et Cools | M. Brouhns : représentant permanent adjoint de la Belgique auprès des Nations unies. M. Cools : premier secrétaire de la représentation permanente de la Belgique auprès des Nations unies |
| 28/2/1997 | Le colonel BEM Flament et le lieutenant-colonel Kesteloot | Colonel BEM Flament : chef de la section « Plans de défense » à l'état-major général, chef de la mission de reconnaissance au Rwanda en préparation de la MINUAR Lieutenant-colonel Kesteloot : membre de cette mission de reconnaissance |
| 28/2/1997 | Le lieutenant-colonel BEM Briot | Chef de la sous-section planification des opérations à l'état-major général |
| 28/2/1997 | Le lieutenant général Charlier | Chef d'état-major général des Forces armées |
| 5/3/1997 | M. W. Claes, ministre d'État | Ministre des Affaires étrangères |
| 5/3/1997 | M. L. Delcroix | Ministre de la Défense nationale |
| 5/3/1997 | M. J.-L. Dehaene | Premier ministre |
| 7/3/1997 | Le colonel BEM Marchal | Commandant du secteur Kigali pour la MINUAR |
| 7/3/1997 | Le lieutenant Nees | Officier de « Renseignements » (S2) de KIBAT I |
| 7/3/1997 | Le major Podevijn | Officier d'état-major au niveau du Force Commander |
| 7/3/1997 | Le colonel BEM Vincent | Chef de la CTM au Rwanda |
| 11/3/1997 | Le professeur Suy et le professeur David | Professeur Suy, expert en droit international, professeur ordinaire à la « Katholieke Universiteit Leuven » (KUL) Professeur David, expert en droit international, professeur ordinaire à l'Université Libre de Bruxelles (ULB) |
| 12/3/1997 | M. Swinnen | Ambassadeur de Belgique au Rwanda |
| 12/3/1997 | Le général-major Verschoore | Adjoint au chef du service de renseignement militaire (SGR) |
| 12/3/1997 | Le général-major Schellemans | Chef de cabinet du ministre de la Défense nationale |
| 14/3/1997 | M. W. Kuijpers | Sénateur |
| 14/3/1997 | Mme N. Maes | Sénatrice |
| 14/3/1997 | M. C. Bougard | Sénateur |
| 14/3/1997 | Le capitaine De Cuyper | Officier de « Renseignements » de KIBAT II |
| 14/3/1997 | Le colonel BEM Marchal | Commandant du secteur de Kigali pour la MINUAR |
| 18/3/1997 | M. L. Willems | Chef de cabinet du ministre des Affaires étrangères |
| 19/3/1997 | M. Gillet | Avocat au barreau de Bruxelles, coprésident de la commission d'enquête internationale relative aux violations des droits de l'homme au Burundi à la suite de l'assassinat du président Ndadaye |
| 19/3/1997 | Le colonel BEM Marchal | Commandant du secteur de Kigali pour la MINUAR |
| 21/3/1997 | Le général-major Delhotte | Chef du service de renseignement militaire (SGR) |
| 21/3/1997 | Mme Braeckman | Journaliste au quotidien « Le Soir » |
| 21/3/1997 | Le major Hock | Officier du SGR, analyste en charge de l'Afrique centrale |
| 21/3/1997 | M. Swinnen | Ambassadeur de Belgique au Rwanda |
| 24/3/1997 | Le lieutenant-colonel Leroy | Commandant du KIBAT I |
| 26/3/1997 | M. J.-P. Chrétien | Historien, directeur du CNRS (Centre National de Recherche Scientifique) à Paris |
| 26/3/1997 | M. Derycke | Secrétaire d'État à la coopération au développement, adjoint au ministre des Affaires étrangères |
| 26/3/1997 | M. L. Delcroix | Ministre de la Défense nationale |
| 28/3/1997 | Le lieutenant général Charlier | Chef d'état-major général des Forces armées |
| 16/4/1997 | M. Ndiaye | Avocat, rapporteur spécial de la commission des droits de l'homme aux Nations unies |
| 16/4/1997 | Le colonel BEM Engelen | Conseiller militaire de la Mission permanente belge auprès de l'ONU à New York |
| 16/4/1997 | Le colonel BEM Dewez | Commandant du bataillon KIBAT II |
| 18/4/1997 | M. W. Claes, ministre d'État | Ministre des Affaires étrangères |
| 21/4/1997 | Le lieutenant général Charlier | Chef d'état-major général des Forces armées |
| 21/4/1997 | Confrontation entre M. L. Delcroix et le lieutenant général Charlier | M. L. Delcroix, ministre de la Défense nationale Lieutenant général Charlier, chef d'état-major général des Forces armées |
| 22/4/1997 | M. Nsanzuwera | Procureur de la République rwandaise |
| 22/4/1997 | Mme Suhrke | Enquêteur principal adjoint au Chr. Michelsen Institute de Bergen, Norvège (spécialisé en droits de l'homme), membre du conseil consultatif du Haut Commissariat aux Réfugiés de l'ONU et rapporteuse du Rapport II concernant « The Joint Evaluation of Emergency Assistance to Rwanda » |
| 23/4/1997 | M. Jaenen | Responsable de la cellule « Afrique » au ministère des Affaires étrangères |
| 23/4/1997 | L'amiral Verhulst | Chef de la division opérations (JSO) à l'état-major général |
| 23/4/1997 | Le professeur Suy et M. Vandaele | Le Professeur Suy, expert en droit international, professeur ordinaire à la « Katholieke Universiteit Leuven » (KUL) M. Vandaele, directeur général de la direction générale de la politique du ministère des Affaires étrangères |
| 25/4/1997 | Le lieutenant général Uytterhoeven | Adjoint à l'état-major de la Force terrestre |
| 25/4/1997 | Le général-major Roman | Commandant de la brigade paracommando |
| 29/4/1997 | M. Rusatira | Général de brigade du FAR, commandant ESM |
| 29/4/1997 | Le lieutenant général Berhin | Chef d'état-major de la Force terrestre |
| 29/4/1997 | M. Cools | Premier secrétaire de la représentation permanente de la Belgique auprès des Nations unies |
(2) Commission d'enquête parlementaire
concernant les événements du Rwanda
| Date | Témoin(s) | Qualité en laquelle le témoin a été entendu |
| 6/5/1997 | M. Van Winsen | Auditeur militaire à Bruxelles |
| 6/5/1997 | M. Vandermeersch | Juge d'instruction associé au tribunal de première instance de Bruxelles |
| 7/5/1997 | Le lieutenant Lecomte | Commandant en second de compagnie de KIBAT II |
| 7/5/1997 | Le capitaine Lemaire | Commandant de compagnie de KIBAT II |
| 7/5/1997 | M. Quertemont | Aumônier militaire à KIBAT II |
| 7/5/1997 | Le Major Maggen | Officier de l'état-major du Force Commander |
| 13/5/1997 | Le capitaine Marchal | Commandant de compagnie du KIBAT II |
| 13/5/1997 | Le commandant Choffray | Officier « Opérations » à l'état-major de KIBAT II |
| 13/5/1997 | Le commandant Claeys | Military Information Officer (MIO) à l'état-major du commandant de la MINUAR |
| 13/5/1997 | Le commandant Noens | Conseiller en droit des conflits armés, KIBAT I |
| 13/5/1997 | Le Major Bodart | Conseiller en droit des conflits armés, KIBAT II |
| 14/5/1997 | Le Professeur Reyntjens | Professeur ordinaire à l'« Universitaire Instelling Antwerpen » et spécialiste en questions d'Afrique centrale |
| 14/5/1997 | Mme De Backer | Conseillère de l'« Afrikastichting », présidente ACT |
| 14/5/1997 | M. Eugène Nahimana | Attaché de presse du MRND en Belgique |
| 14/5/1997 | M. Scheers | Avocat au barreau de Bruxelles |
| 16/5/1997 | M. Galand | Président du forum « Nord-Sud » et président du Centre de coopération au développement (CNCD) |
| 16/5/1997 | Mme A. Desforges | Représentante de « Human Rights Watch », représentante de la commission internationale pour la recherche des actes de violation des droits de l'homme au Rwanda |
| 16/5/1997 | M. Terras | Directeur du magazine GOLIAS |
| 28/5/1997 | M. Greindl | Directeur de l'« Institut supérieur de pédagogie appliqué » au Rwanda |
| 28/5/1997 | Mme De Temmerman | Journaliste pour le journal de la BRTN |
| 29/5/1997 | Le lieutenant-colonel De Loecker | Officier d'état-major au commandement du secteur Kigali (MINUAR) |
| 29/5/1997 | Le colonel Balis | Officier adjoint « opérations » à l'état-major du Force Commander |
| 29/5/1997 | Le commandant De Troy | Officier adjoint au centre opérationnel de l'état-major général à Evere (C Ops) |
| 30/5/1997 | M. Twagiramungu | Président du MDR et ancien premier ministre du Rwanda |
| 30/5/1997 | M. Saur | Secrétaire général du PSC, responsable des relations internationales |
| 3/6/1997 | M. Theunis | Prêtre et journaliste, présent à la mission des missionnaires africains à Kigali |
| 3/6/1997 | M. Louis | Secrétaire général et ensuite vice-président de l'Internationale démocrate-chrétienne (IDC) |
| 3/6/1997 | M. Houtmans | Directeur de l'émetteur radio libre Radio Contact |
| 6/6/1997 | Le capitaine Theunissen | Commandant en second de compagnie de KIBAT II |
| 10/6/1997 | Le colonel BEM Dewez | Commandant du bataillon belge KIBAT II |
| 10/6/1997 | Le colonel BEM Marchal | Commandant du secteur Kigali (MINUAR) |
| 11/6/1997 | M. Nzamzimfura | Major de la gendarmerie rwandaise, G4 |
| 11/6/1997 | Le professeur Prunier | Historien, chercheur en chef auprès du Centre national de recherche scientifique (CNRS) à Paris |
| 13/6/1997 | Confrontation entre le lieutenant-colonel BEM Briot et le colonel BEM Flament | Lieutenant-colonel Briot : chef de la sous-section planification des opérations à l'état-major général Colonel BEM Flament : chef de la section « plans de défense » à l'état-major général et chef de la mission de reconnaissance au Rwanda en préparation de la MINUAR |
| 13/6/1997 | Confrontation entre le lieutenant-colonel BEM Briot et le colonel BEM Marchal | Lieutenant-colonel Briot : chef de la sous-section planification des opérations à l'état-major général Colonel BEM Marchal : commandant du secteur Kigali (MINUAR) |
| 17/6/1997 | M. Matata | Secrétaire de l'« Association rwandaise pour la défense des droits de l'homme » (ARDHO) |
| 17/6/1997 | M. Eugène Nahimana | Attaché de presse du MRND en Belgique. |
| 17/6/1997 | M. Degni-Segui | Rapporteur spécial de la commission des droits de l'homme des Nations unies et auteur d'un rapport concernant la situation des droits de l'homme au Rwanda |
| 18/6/1997 | M. Nsengyaremye | Ancien premier ministre du Rwanda |
| 18/6/1997 | M. L. Delcroix | Ministre de la Défense nationale |
| 20/6/1997 | M. Swinnen | Ambassadeur de Belgique au Rwanda |
| 20/6/1997 | M. Tallier | Secrétaire à la Sûreté de l'État, chargé des questions africaines |
| 24/6/1997 | M. Scheers | Avocat au barreau de Bruxelles |
| 24/6/1997 | M. Willy Claes ministre d'État |
Ministre des Affaires étrangères |
| 25/6/1997 | M. Brouhns | Représentant permanent adjoint de la Belgique auprès des Nations unies |
| 25/6/1997 | M. Poncelet | Ministre de la Défense nationale |
| 26/6/1997 | M. J.-L. Dehaene | Premier ministre |
| 27/6/1997 | Adjudant Boequelloen, premier caporal-chef Pirard et caporal Kinkin | Membres du bataillon KIBAT II |
| 27/6/1997 | Mme Debatty, Mme Dupont, M. Leroy, M. Plescia, Mme Lhoir, Mme Bassine | Membres des familles et apparentés des dix paracommandos assassinés |
| 30/6/1997 | M. Murayi | Président du « Mouvement républicain national pour la démocratie et le développement » (MRND) |
| 30/6/1997 | Confrontation entre le colonel BEM Dewez et le capitaine Theunissen | Colonel Dewez : commandant du bataillon belge KIBAT II (MINUAR) Capitaine Theunissen : commandant en second de compagnie à KIBAT II |
Toutes les auditions ont eu lieu en séance publique, à l'exception des auditions suivantes :
Réunions qui furent partiellement publiques et qui furent tenues partiellement à huis clos :
21/3/1997 : Général-major Delhotte
28/3/1997 : Lieutenant-général Charlier
29/4/1997 : M. Rusatira
6/5/1997 : M. Vandermeersch
7/5/1997 : M. Quertemont
14/5/1997 : Mme De Backer
28/5/1997 : M. Greindl
28/5/1997 : Mme De Temmerman
30/5/1997 : M. Twagiramungu
30/5/1997 : M. Saur
3/6/1997 : M. Theunis
11/6/1997 : le Professeur Prunier
17/6/1997 : M. Matata
17/6/1997 : M. Degni-Segui
20/6/1997 : M. Swinnen
24/6/1997 : M. Scheers
Réunions qui ont été tenues entièrement à huis clos :
11/3/1997 : Les professeurs Suy et David
11/3/1997 : Colonel Ix
19/3/1997 : Colonel Marchal
21/4/1997 : Confrontation entre M. Delcroix et le lieutenant général Charlier
23/4/1997 : le professeur Suy et M. Van Daele
14/5/1997 : M. Nahimana
14/5/1997 : M. Scheers
17/6/1997 : M. Nahimana
20/6/1997 : M. Tallier
1.3.1.3. Échange de vues avec les experts de la commission
Comme susmentionné, la commission a bénéficié des conseils de deux experts militaires, le général-major Duchâtelet et le colonel Malherbe, et de deux experts en droit international, les professeurs Suy et David. Elle a également pu s'entourer des avis de maître Roggen sur les implications juridiques de ses travaux.
Les confrontations suivantes ont eu lieu dans le cadre des travaux de la commission :
(1) Commission spéciale Rwanda
Confrontation entre M. Delcroix et le lieutenant général Charlier le 21 avril 1997.
(2) Commission d'enquête parlementaire concernant les événements du Rwanda
Confrontation entre le lieutenant-colonel Briot et le colonel Flament le 13 juin 1997.
Confrontation entre le colonel Marchal et le lieutenant-colonel Briot le 13 juin 1997.
Confrontation entre le colonel Dewez et le capitaine Theunissen le 30 juin 1997.
1.3.1.5. Réunions de travail de la commission
L'on a systématiquement organisé de brèves discussions relatives à l'ordre du jour avant les auditions. Au cours de ces discussions, l'on a examiné le curriculum et les questions introductives des témoins. De plus, l'on a organisé diverses réunions de travail dans le cadre des travaux de la commission. Dans le cadre de la rédaction du rapport, des réunions de travail résidentielles ont été tenues à Ostende (15-16 juillet 1997), à Gesves (30 septembre, 1-2 août 1997) et à Bruges (25-27 novembre 1997).
1.3.1.6. Réunions du Bureau de la commission
Le Bureau, composé du président et des deux vice-présidents rapporteurs, s'est réuni à plusieurs reprises en vue de l'organisation des réunions de la commission.
1.3.1.7. Visite au C Ops S.G.R.
Les membres de la commission ont, à l'invitation du ministre de la Défense nationale, fait une visite de travail au service général des renseignements et de sécurité (S.G.R.) et au centre opérationnel (C Ops), qui sont situés dans le quartier général des Forces armées belges à Evere. Cette visite a eu lieu le 21 mai 1997.
Les membres se sont vu présenter les deux services et ont assisté à un briefing opérationnel. Enfin, les membres ont pu examiner l'armement dont disposèrent les hommes de KIBAT au cours de leur mission de 1993 et de 1994.
M. Mahoux et Verhofstadt, membres du groupe ad hoc, se sont rendus à Kigali afin d'avoir une vision précise des lieux et permettre ainsi d'apprécier l'itinéraire des dix paras le 7 avril 1994 et les circonstances exactes de leur assassinat.
(2) Commission d'enquête parlementaire
Dans sa lettre du 22 avril 1997, le président de l'Assemblée nationale rwandaise a invité au Rwanda une délégation de la commission, « afin de rencontrer les témoins potentiels, de visiter les sites et éventuellement de consulter les archives ».
Dans le cadre de la commission d'enquête parlementaire, il a été décidé que M. Mahoux, en sa qualité de rapporteur, se rendrait au Rwanda. La visite a eu lieu du 23 au 30 août 1997. Son objet était de consulter sur place les archives mentionnées dans l'invitation du Parlement rwandais. M. Mahoux était accompagné de M. Vandeginste, chercheur au Centre d'études de la région des grands lacs d'Afrique (14).
(1) Les documents examinés par le groupe ad hoc
A. Documents Défense nationale
I. Documents SGR
1. Classeurs 1 à 16 :
Informations générales provenant de sources publiques.
Période : août 1993 à avril 1994.
2. Classeurs 17 et 18 :
Informations traitées par SGR devenues des renseignements et transmis à différents destinataires.
3. Notes sur la situation au Rwanda (un classeur) :
Documents secrets concernant les situations politiques, militaires, de crises.
Période : octobre 1993 à avril 1994.
4. Bulletins hebdomadaires des services de renseignements (un classeur) :
situation au Rwanda;
film des événements;
évolution de la situation.
Période : janvier 1993 à avril 1994.
5. Farde complément d'informations (un classeur) :
Informations provenant de diverses sources concernant la situation et le déroulement des événements au Rwanda.
Période : janvier 1993 à mai 1994.
6. Farde « IN » SGR OPS Rwanda 1994 :
Informations provenant de certains services de renseignement étrangers.
II. Documents J.S.
Concernant divers renseignements sur les opérations humanitaires (MINUAR, BELBAT, UNOSOM, ...).
1. Classeur J.S. 1 :
Compte rendu des réunions C Ops d'août 1993 à décembre 1993 inclus.
2. Classeur J.S. 2 :
Idem de janvier 1994 à avril 1994 inclus.
III. Documents C Ops concernant les munitions : (Sitrep 103)
IV. Documents de 1 Para
Informations relatives à l'opération MINUAR I.
B. Documents Conseil des ministres
Deux notes (et deux avis de l'Inspection des Finances) en préparation des réunions des 26 novembre et 3 décembre 1993 du Conseil des Ministres.
C. Documents Affaires étrangères
1. Notes de l'Ambassadeur à Kigali au Ministre des Affaires étrangères : 4 août 1994 6 avril 1994;
2. Télex Ambabel Kigali à Belext BRX : août 1993 6 avril 1994;
3. Télex Bruxelles à Ambabel Kigali : 10 avril 1993 6 avril 1994;
4. Fax Ambabel Kigali à Belext (août 1993 avril 1994);
5. Rapports annuels 1993 et 1994;
6. Procès-verbaux des réunions de coordination hebdomadaires Affaires étrangères-Défense nationale : 2 décembre 1993 28 juillet 1994.
D. Documents MINUAR
1. ROE UNAMIR : Règles d'engagement.
2. Ordre d'opération MINUAR
E. Documents Nations unies (DELBELONU)
1. Télégrammes ambassadeur Noterdaeme à Belext concernant le Rwanda : août 1993 avril 1994;
2. Télégrammes ambassadeur Noterdaeme à Belext concernant MINUAR : août 1993 avril 1994;
3. Correspondance DELBELONU et ministère des Affaires étrangères (7 avril 30 avril 1994).
F. Documents Cour militaire
Procès Luc Marchal : 31 classeurs + 1 farde première instance et Cassation.
G. Rapport confidentiel du colonel Marchal
Considérations relatives aux conditions dans lesquelles j'ai exercé ma fonction de Commandant du secteur KIGALI au sein du MINUAR du 4 décembre 1993 au 19 avril 1994.
H. Comité permanent de contrôle des services de renseignements
Rapport de l'enquête de contrôle sur l'efficacité et la collaboration des services de renseignements à propos des événements au Rwanda
I. Documents Nations unies
1. Accords d'Arusha;
2. Rapports des Nations unies :
(E/CN.4/1994/7/Add.1) : Report by the special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions on his mission to Rwanda, 8-17 April 1993, including as annex II the Statement of 7 April 1993 of the Governement of Rwanda concerning the final report of the Independent International Commission of Inquiry on human rights violations in Rwanda since 1 October 1990.
S/1994/360, 30 mars 1994 : Second progress report of the Secretary-General on UNAMIR for the period from 30 December 1993 to 30 March 1994, requesting an extension of its mandate for a period of six months.
J. Autres Documents
The United Nations and Rwanda, 1993-1996, Department of Public Information, The United Nations Blue Book Series, Volume X.
Sellström, T., The International Response to Conflict and Genocide : Lessons from the Rwanda Experience, Study 1, Historical Perspective : Some Explanatory Factors, Joint Evaluation of Emergency Assistance to Rwanda.
Adelman, H. et Suhrke, A., The International Response to Conflict and Genocide : Lessons from the Rwanda experience, Study 2, Early Warning and Conflict Management, Joint Evaluation of Emergency Assistance to Rwanda.
Rapport d'ensemble enseignements tirés de la mission des Nations unies pour l'assistance au Rwanda (MINUAR), octobre 1993-avril 1996, décembre 1996.
(2) Documents obtenus par la commission spéciale Rwanda
Réponses aux questions du général-major Dallaire par le juge-avocat général de la Cour militaire.
Présentation du rapport sur les exécutions extrajudiciaires, sommaire des arbitraires à la 53ème session de la Commission des droits de l'homme des Nations unies par M. Ndiaye, Rapporteur spécial, Genève, le 9 avril 1997.
Rapport de la Commission internationale d'enquête sur les violations des droits de l'homme au Rwanda depuis le 1er octobre 1990 (7-21 janvier 1993). Rapport final. Africa Watch, Fédération internationale des droits de l'homme, Union interafricaine des Droits de l'Homme et des Peuples, Centre international des droits de la personne et du développement démocratique.
Rapport présenté par M. Bacre Waly Ndiaye, Rapporteur spécial, conformément à la résolution 1996/74 de la Commission des droits de l'homme. Nations unies, Conseil économique et social, E/CN.4/1997/60 et Add 1 24 décembre 1996.
Télex du 20 janvier 1994 de DelbelONU à Minafet.
Lettre de M. J.L. Dehaene, premier ministre concernant les documents d'Affaires étrangères, du 25 mars 1997.
Lettre de M. E. Derycke, ministre des Affaires étrangères concernant les PV des réunions Affaires étrangères Défense nationale (avec annexe) 26 mars 1997.
PV des réunions de coördination du 28 octobre 1993, 26 novembre 1993, 2 décembre 1993, 9 décembre 1993, 16 décembre 1993, 23 décembre 1993, 6 janvier 1994, 13 janvier 1994, 3 février 1994, 3 mars 1994 et 17 mars 1994.
Lettre de M. J. De Bock, chef de cabinet du ministre des Affaires étrangères du 24 mars 1997, avec annexes.
1. Opening remarks by M. Kofi Annan, Lessons learned Seminar on Rwanda;
2. « Non-paper » of the Comprehensive Seminar on UNAMIR, 12-14 June 1996;
3. Copie du télex 127 de Bujumbura avec instructions du ministre Claes, 23.02.1994;
4. Copie des réponses de deux postes diplomatiques (de Washington du 24.02.1994 et de New York du 24.02.1994.
Note du ministre d'État, M. W. Claes : « Démarches entreprises par la Belgique à New York afin d'obtenir une action plus décidée de la MINUAR » : réponse au rapport du groupe ad hoc, pp. 85 à 94 incluse.
Note du ministre d'État, M. Claes : « Le soi-disant « climat antibelge . Observations et corrections concernant les points 4.1 et 4.2 du rapport du groupe ad hoc de la commission spéciale Rwanda du Sénat. »
Note du Premier ministre transmise à M. Leo Delcroix, qui donne un aperçu des notes informelles du Conseil des ministres (rédigées par le secrétaire du Conseil des ministres et/ou par le conseiller diplomatique du Premier ministre).
Communication du Conseil des ministres du 19 novembre 1993 concernant la MINUAR.
Composition cabinet ministère de la Défense nationale Rwanda pour la période juin 1993-décembre 1993. Composition cabinet ministère de la Défense nationale Rwanda, situation avril 1994.
Lettre transmise par le capitaine De Cuyper : Brief vanwege de landmacht Divisie gevechtssteun van 10 maart 1997.
P.V. du 06.12.1995 du capitaine De Cuyper dossier d'instruction Marchal à l'auditorat général de la Cour militaire.
Documents distribués suite à l'audition à huis clos du colonel Marchal le 19 mars 1997 :
1. exposé introductif, audition à huis clos du 19 mars 1997;
Operatie Haiti :
2. Ops Columbus Sitrep op 5.11.1994, Sitrep 1.12.1994, Sitrep 2.12.1994, Sitrep 15.12.1994, Sitrep 19.4.1994, Sitrep 21.12.1994, Sitrep 24.12.1994;
3. Confidentiel : Ontwerp van het evacuatieplan « Yellow Bird », 9.12.1994.
Documents du lieutenant-colonel Leroy transmis aux membres de la commission lors de son témoignage du 24.3.1997.
Documents remis par le colonel BEM Dewez aux membres de la commission:
1. Briefing général UNAMIR et Règles d'engagement;
2. Safe City Directives KIBAT, 26.3.1994;
3. Programme de la semaine du 4 au 10 avril 1994;
4. Rapport confidentiel de KIBAT S2, 24.3.1994
annexe A : communiqué de presse de Charles Ruvugabigwi : L'angoisse du Dr. Booh-Booh, La Relève 18.3.1994;
annexe B : partis principaux au Rwanda
annexe C : Communiqué « sauve qui peut » nº 10, 23.3.1994;
5. Rapport secret de KIBAT S2, 29.3.1994;
6. Rapport secret de KIBAT S2, 26.3.1994;
7. Rapport secret de KIBAT S2, 2.4.1994
annexe : déclaration du premier ministre désigné F. Twagiramungu, 1.4.1994;
8. Rapport secret de KIBAT S2, 1.4.1994
annexe : Communiqué « Sauve qui peut » nº 11, 27.3.1994;
9. Copie extraits du carnet personnel :
notes prises pendant briefing au COps, 3.2.1994
communication à l' Ogp Bn, 4.2.1994
notes de base pour le briefing aux compagnies;
10. Rapport du Lt. Nees du 17.3.1994.
Historiek van November 92 tot maart 93 M. P. Vandeputte. UNPROFOR Bosnia Herzegovina 1 (BE) DET TPT Moving Star.
Lettre de M. Elsoucht Forces armées état-major, Divisie Operaties, Sectie Plannen en Defensie, 11.04.1997.
Onderwerp : Lessen BELBAT II
Hoofdstuk 1 : Personeel
Hoofdstuk 2 : Inlichtingen
Hoofdstuk 3 : Operaties
Hoofdstuk 4 : Logistiek en Med.
Hoofdstuk 5 : SCV. Pers en Vip.
Note du Lieutenant-Général, Aide de Camp du Roi, J. Charlier, au Ministre de la Défense nationale du 3 novembre 1993. (avec une lettre du Brigadier général, Commandant de la Force et Chef de mission R.A. Dallaire au Colonel J. Flament, Chef de la mission de Reconnaissance des Forces armées de la Belgique à Kigali du 29 octobre 1993).
Lettre du Colonel M. Malherbe UNPROFOR Sector East : Rapport de mission au Sector EAST UNPROFOR du 13 mars 92 à fin août 92, 2.9.1992.
Annexe : Org. QG Force.
Lettre du Colonel M. Malherbe UNPROFOR Sector East : Rapport Part (BE) UNPROFOR.
Document de M. Alain De Brouwer à l'attention du Sénateur Destexhe, contribution personelle aux travaux de la future Commission parlementaire d'enquête sur le Rwanda, 25.10.1996.
Lettre de l'avocat Luc De Temmerman concernant la famille Habyarimana, 4 mars 1997.
Document transmis par Mme Willame : Note de Mme Marie-Madeleine Nibelle-Bicamumpaka : « Le MDR Mouvement démocratique républicain, premier parti d'opposition au Rwanda; fut-t-il victime de sa victoire électorale annoncée ? ».
« Le cas rwandais » par M. Servilien M. Sebasoni, article dans La Revue générale, décembre 1994, nº 12.
Documents transmis par Mme Maes à l'occasion de son audition :
1. Programme de la visite officielle du ministre de la Défense, M. Leo Delcroix, aux militaires belges au Rwanda, 10 au 13 mars 1994.
2. Lettre adressée au secrétaire général des Nations unies : « À propos des troupes belges au Rwanda », novembre 1993.
Documents transmis par M. W. Kuijpers à l'occasion de son audition :
1. Exemplaire de la revue Dialogue, nº 190, avril-mai 1996.
2. Dossier concernant l'assassinat de M. Olivier Dulieu, le 7 avril 1994, à Rambura, transmis par M. P. Dulieu dans le cadre de son audition devant la commission du 19.2.1997.
Documents transmis par le sénateur Destexhe au Président :
1. Déclaration du 7 avril 1994 relative à l'assassinat de leurs excellences le chef de l'état rwandais, le général-major Juvenal Habyarimana, et le chef de l'État burundais, M. Cyprien Ntaryamira, et les membres de leurs délégation;
2. Lettre du docteur MURAYI Paulin, président du MRND Section belge au ministre Delcroix, 08.03.1994;
3. Fax de M. Alain De Brouwer, conseiller politique de l'IDC à M. P. Ngaboyamahina, président du MRND Section Belgique, 05.01.1992.
Lettre du secrétaire d'État à la Coopération au développement, M. R. Moreels en réponse à une question écrite de la commission du 12 mars, d.d. 3 avril 1997, avec annexes suivantes :
1. 1a ODA-cijfers 1990-1994;
2. 1b lijst van de 84 projecten in het kader van de directe bilaterale samenwerking;
3. 2a Lijst van NGO-projecten. Uitgevoerd met financiële ABOS tussenkomst;
4. 3a et 3 b : enige informatie inzake de financiële samenwerking met Rwanda 1990-1994.
Lettre et annexes de M. Gasana Ndoba, membre du Groupe de coordination du CRDDR, ancien coordinateur du comité (1990-1995) :
Document 1 : Audition devant la Commission spéciale Rwanda le 19 février 1997.
Document 2 : Témoignage de Mme Marguerite Lens Nyirazaninka.
Document 3 : Témoignage de Mme Mukeshimana Florida. Épouse de M. Ngulinzira, ancien ministre rwandais des Affaires étrangères 16.02.1996.
Document 4 : Liste indicative faite par le CRDDR de responsables présumés du génocide et de massacres politiques perpétrés au Rwanda résidant ou ayant récemment résidé en Belgique (17.04.1997).
Annexes au document 4 :
Annexe 1 : Appel à la conscience des Bahutu.
Annexe 2 : Pro justitia du Tribunal de première instance de Bruxelles (22.07.96)
Annexe 3 : Versement d'un montant de 500 000 fr. de M. Rwabukumba Seraphin en date du 06.07.1993
Annexe 4 : Lettre de la Kredietbank, attestation concernant Mr. Rwabukumba en date du 24.05.1994.
Annexe 5 : Sommaire du Journal officiel de la République rwandaise en date du 30.11.1996.
Annexe 6 : 1994 Hachette : Observatoire géopolitique des drogues. État des drogues, drogue des états (p. 113 p. 115).
Annexe 7 : Controverse criminel ou courageux Questions sur le rôle de l'ancien chef de la gendarmerie rwandaise, témoin clef de la tragédie de 1994. Il vit aujourd'hui en Belgique. Les silences du général, Le Vif l'Express 07.03.1997.
Annexe 8 : Lettre de la Radio Télévision Libre des Mille Collines (RTLM) à Kigali Situation du compte RTLM au 15.08.1993, en date du 01.09.1993.
Annexe 8 a : Liste des actionnaires B.A.C.A.R., en date du 25.08.1993.
Annexe 8 b/1 : Liste des actionnaires B.C.R. en date du 25.08.1993.
Annexe 8 b/2 : Liste des actionnaires B.C.R. Agences en date du 25.08.1993.
Annexe 8 c : Liste des actionnaires Banque de Kigali (BK) en date du 25.08.1993.
Annexe 9 a : Communiqué de presse nº 93/32 : Comité pour le respect des droits de l'homme et la démocratie au Rwanda, en date du 10.08.1993.
Annexe 9 b : Communiqué de presse nº 93/33 : Comité pour le respect des droits de l'homme et la démocratie au Rwanda, en date du 27.08.1993.
Annexe 9 c : Communiqué de presse nº 93/35 : Comité pour le respect des droits de l'homme et la démocratie au Rwanda, en date du 09.12.1993.
Annexe 9 d : Communiqué de presse nº 94/36 : Comité pour le respect des droits de l'homme et la démocratie au Rwanda, en date du 12.01.1994.
Annexe 9 e : Communiqué de presse nº 94/37 : Comité pour le respect des droits de l'homme et la démocratie au Rwanda, en date du 14.01.1994.
Annexe 9 f : Communiqué de presse nº 94/38 : Comité pour le respect des droits de l'homme et la démocratie au Rwanda, en date du 25.02.1994.
Annexe 9 g : Communiqué de presse nº 94/39 : Comité pour le respect des droits de l'homme et la démocratie au Rwanda, en date du 25.02.1994.
Annexe 9 h : Communiqué de presse nº 94/40 : Comité pour le respect des droits de l'homme et la démocratie au Rwanda en date du 5 et 7 mars 1994.
Annexe 9 i : Déclaration du Comité sur les violences qui secouent le Rwanda depuis l'annonce de la mort des présidents Habyarimana du Rwanda et Ntaryamira du Burundi : Comité pour le respect des droits de l'homme et la démocratie au Rwanda, 10.04.1994.
Annexe 9 j : Communiqué de presse nº 94/41 : Comité pour le respect des droits de l'homme et la démocratie au Rwanda en date du 16.04.1994.
Annexe 9 k : Communiqué de presse nº 94/42 : Comité pour le respect des droits de l'homme et la démocratie au Rwanda en date du 24.04.1994.
Annexe 9 l : Lettre du Comité pour le respect des droits de l'homme et la démocratie au Rwanda de M. Gasana Ndoba à M. Ibrahim Gambari, ambassadeur du Nigéria auprès des Nations unies Demande de renforcement de la MINUAR au Rwanda, 02.05.1994.
Annexe 9 m : Lettre de M. Iqbal Riza, Assistant Secretary-general for Peace-keeping Operations for the United Nations à M. Gasana, Coordinateur du CRDDR. (05.05.1994).
Annexe 9 n : Massacres Un complot bien orchestré, Le Vif l'Express, 15.05.1994.
Annexe 10 : Deuxième et douloureux anniversaire du génocide et des massacres au Rwanda (7 avril à début juillet 1994) ainsi que de la perte de nombreux membres de notre famille. Invitation à la commémoration.
Annexe 11 : Rwanda : M. Kuypers dénonce l'entourage du Président La libre Belgique, 3-4/10/92.
Annexe 12 : Rwanda : négocier le départ des Casques bleus belges Le Soir, 16-17.04.1994.
Leçons « Winter Lodge » , 08 oct. au 5 févr. 93.
Document de M. Ndindiliyimana, Témoignage écrit sur les événements du Rwanda, 21.04.1994.
Lettre de M. A.M. Kavaruganda, M. A.N. Gafaranga et M. M.F. Ngulinzira, objet : témoignage des rescapées des événements tragiques du Rwanda d'avril 1994, 26.04.1997.
(3) Documents obtenus par la commission d'enquête parlementaire Rwanda
a) Documents distribués aux membres
Document du Conseil de sécurité des Nations unies : Lettre de Boutros Boutros-Ghali au président du Conseil de sécurité, 4.4.1994. Rapport préliminaire de la commission d'experts indépendants établie conformément à la résolution 935 (1994) du Conseil de sécurité.
Document du Conseil économique et social des Nations unies, 28.6.1994 : Rapport sur la situation des droits de l'homme au Rwanda, soumis par M. R. Degni-Ségui en date du 25 mai 1994.
Liste d'interviews du général Dallaire, 30.5.1997.
Notifications et décisions du conseil des ministres et du cabinet restreint :
1. notificatie ministerraad 7.4.1994;
2. beslissingen ministeriële vergadering 8.4.1994;
3. beslissingen van het kernkabinet van 10.4.1994, 11.4.1994, 12.4.1994, 13.4.1994, 14.4.1994 en 16.4.1994;
4. notificatie van de ministerraad van 15.4.1994;
5. documenten Buitenlandse Zaken.
Documents des Affaires étrangères transmis suite à la question du Président du Sénat du 2 juin 1997 :
1. réunions;
2. télex, communications et instructions;
3. documents.
Document transmis par le ministre Poncelet lors de son audition du 25.6.1997.
Réponses du cabinet de la Défense nationale aux questions de la commission lors de l'audition du lieutenant-colonel Briot :
1. Nota voor JSO-P betreffende Operatie SILVER BACK, 19.6.1997;
2. Vergadering OPSC 15 maart 1994;
3. situatie ex-Joegoslavië van 15 maart 1994;
4. Vergadering OPSC, 17 maart 1994;
5. situation en ex-Yougoslavie à la date du 17 mars 1994;
6. Unamir, KIBAT : Material KIBAT asked by Unamir for BYUBAT, 19.4.1994.
Documents transmis par M. Delcroix :
1. Bezoek van de minister van Landsverdediging aan de Belgische militairen in Rwanda, 10-13 maart 1994;
2. UNAMIR Force HQ, introductory brief, 11 maart 1994;
3. Briefings betreffende UNAMIR;
4. Reis minister Claes aan Rwanda, 28.2.1994;
5. dossier pour monsieur le ministre concernant les opérations en Afrique de la part du Chef de l'État-major général, 12.7.1994;
6. le problème ethnique au Rwanda et au Burundi, exposé par SGR SDRI B3, 10.1.1992;
7. Rwanda, service général du renseignement et de la sécurité, 15.4.1993;
8. Rwanda, evolutie van de toestand sinds november 92, 15.3.1993;
9. Rwanda, situation politique, service général du renseignement et de la sécurité, 7.10.1993.
Documents transmis par le Premier ministre Dehaene:
1. notificaties van de ministerraden, 8.10.1993;
2. nota betreffende het kernkabinet van 10.11.1993;
3. notificaties van de ministerraad van 19.11.1993.
Textes des déclarations de M. Claes, M. Dehaene, M. Delcroix, M. Charlier et de M. Marchal devant les caméras du Journal télévisé de la RTBF.
Lettre du colonel Marchal aux membres de la commission concernant l'arrêt de la Cour militaire du 4.7.1996 à son égard, en date du 11.4.1997.
Document transmis par le major Maggen suite à son audition devant la commission du 7.5.1997.
Documents transmis par le commandant Noens :
1. fax du lieutenant-colonel A. Leroy au C Ops : maintien et rétablissement de l'ordre public (MROP) du 1.3.1994;
2. fax du lieutenant-colonel A. Leroy au C Ops : Drafts Ops instructions du 1.3.1994;
3. Lettre de GSM Hamidur Rahman Major pour le Sector Commander : Draft Ops instructions for review and comment du 28.2.1994;
4. operational directive nº 9 du général Dallaire, mars 1994;
5. operational directive nº 10 du général Dallaire, février 1994.
Lettre du général-major Jacqmin, fax van 15de Wing luchttransport aan generale staf vanwege lieutenant-colonel Malaise betreffende de installatie van een detectiesysteem op C130's, 14.5.1997.
Document transmis par le colonel Leclercq :
1. Les opérations de maintien de la paix, la dimension politique, avril 1997;
2. Peacekeeping operations, an evolving concept, 4.12.1995.
Fax du lieutenant-colonel Malaise, inlichtingen voor de Rwanda-commissie, 9.4.1997.
Annexe : document EMG C Ops au KIBAT d'avril 1994 concernant les C130.
Lettre du capitaine Theunissen à l'attention des membres de la commission en préparation de son audition du 6.6.1997, 18.5.1997.
Documents transmis lors de l'audition du capitaine Theunissen le 6.6.1997 :
1. Lettre concernant F. Twagiramungu, 1.4.1994.
2. Plan du camp Kigali.
Extrait « Éléments de réponse aux questions de JS », transmis par le lieutenant-colonel Briot lors de l'audition du 13.6.1997.
Document transmis par le capitaine Theunissen lors de son audition du 6.6.1997 : Documents de travail personnels du capitaine Theunissen.
Réponses du lieutenant6colonel E. Van Put concernant les « code cables » de H.K. MINUAR, 13.6.1997:
1. Rapport-UNMO concernant le massacre des paracommandos belges du 7.4.1994;
2. Note du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération au développement au SG, 11.4.1994;
3. Lettre de M. Booh-Booh au chef d'État-major des Forces armées rwandaises, 14.4.1994;
4. Accord entre FPR, FGR et MINUAR, janvier 1994;
5. Draft letter UNAMIR from Force Commander, subject : disengagement, demobilization and integration of both armies and the gendarmerie budget and personnel plan, february 1994, demobilization calender;
6. Note sur le financement de la mission du chef de la planification, février 1994, liste des nºs de téléphone.
Lettre du colonel Balis au président de la commission concernant renseignements sur les événements au Rwanda, 12.6.1997.
Annexes :
1. préconditions à une éventuelle rencontre de discussion d'un cessez-le-feu (FPR), 15.4.1994;
2. aanvraag tot evacuatie van RPF-leden;
3. informatiebriefing 30.12.1993;
4. operatie-order UNO.
« Aide-Mémoire », pour la mission UNTAES (juillet 1996), avant-propos par colonel BEM W. Heyvaert.
Documents remis par le colonel BEM Marchal lors de son témoignage devant la commission le 10.6.1997 :
Journal de campagne : Récapitulatif des événements qui se sont déroulés à Kigali du 6 avril 1994 à 20 h 30 jusqu'au départ de la capitale rwandaise du dernier homme de KIBAT le 19 avril 1994.
Discours de l'abbé André Sibomana du 10 décembre 1993 prononcé à l'occasion du 45e anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme.
Exemplaire du quotidien Golias Magazine, été 1996, nº 48-49.
Sommaire de « L'usage de la dette extérieure du Rwanda (1990.1994), La responsabilité des bailleurs de fonds ». Analyse et recommandations, M. Pierre Galand et M. Michel Chossudovsky, novembre 1996.
Communiqué de presse de la part de M. Eugène Nahimana:
Sujet : comment un arrêt de la Cour de cassation peut transformer un innocent en coupable présumé
Qui a confondu Nahimana ET Nahimana? 7.5.1997.
Témoignage de M. Shyrambere : réflexions et témoignages sur les événements du Rwanda en date du 26.4.1997.
Chronique d'un génocide annoncé, un film de Mme Danièle Lacourse et M. Yvan Patry.
Documents transmis par Mme De Backer :
1. brief van de heer Willy Claes : Belgische initiatieven t.o.v. Rwanda, 4.5.1997;
2. lettre de M. Murayi Paulin, attaché de presse pour le MRND Belgique, adressée à MRND Kigali : visite du Ministre Delcroix au Rwanda, 9.3.1994.
Lettre de M. Gérin, complément de réflexions sur l'assassinat du président Habyarimana, 15.5.1997.
Documents transmis par le sénateur Hostekint, réunion à huis clos du 16 mai 1997.
Sujet : chronologie événements Rwanda, avril 1994.
Documents transmis par le sénateur Anciaux :
1. non aux massacres au Rwanda, communiqué de presse, 6.10.90, communauté rwandaise en Belgique
2. nouvelles étapes vers la démocratie, M. André Louis, 1.8.91
3. lettre de M. Munyazesa à MM. Delcroix et Saur concernant le MRND
4. résumé de la loi sur les partis, F. Nahimana, 10.6.91 programmation de la nouvelle constitution, 12.6.91
5. lettre à André Louis de la part de la Nonciature Apostolique au Rwanda, 17.2.1992
6. lettre de M. G. Ruggiu, M. W. Nzasalirwa et M. P. Murayi, 30.3.1993
7. programme de visite de Mme De Backer au Rwanda du 9 au 15 mai 1992
8. correspondance de M. De Brouwer, Conseiller de l'IDC :
lettre à M. Leo Delcroix, 14.6.1991
proposition de M. F. Munyazesa, 22.4.1991
lettre au Premier ministre Martens, 28.1.1991
lettre au ministre Eyskens, 28.1.1991
lettre au ministre Nkundabagenzi, 5.3.1992
lettre au dr. P. Murayi, 12.1.1993
lettre au cabinet du Premier ministre, Kigali, 19.1.1993
lettre à M. Ngirumpatse, secrétaire général du MRND, 20.1.1993
note à M. André Louis, 8.3.1993
lettre à M. Thuysbaert, chef de cabinet du ministre Delcroix, 9.3.1994
lettre à M. Van Hecke, 10.6.1994
rapport succinct concernant la rencontre de Bukavu sur le thème crucial du retour des réfugiés rwandais, 2.11.1994
lettre au rédacteur en chef du Soir, 2.11.1994
lettre à M. W. Martens, 14.3.1995
lettre à M. W. Martens, 14.3.1995
9. Correspondance de M. André Louis, vice-président IDC.
lettre à M. Gérard Deprez, président du PSC, 28.11.1994
lettre à M. Gérard Deprez, président du PSC, 1.9.1994
Quel avenir pour quel Rwanda?, 21.11.1994
Rwanda, genèse d'un drame, le pire est-il pour demain?, 4.8.1994
lettre à MM. Saur et Willems, 30.5.1994
Rwanda, la stratégie du FPR, note interne, 13.4.1993
L'IDC exige la reprise du processus de démocratisation au Rwanda, 14.2.1993
la situation au Rwanda, note interne, 28.1.1993
la démocratisation du Rwanda, 8.2.1992
lettre à M. Nsabimana, représentant du MDR, Benelux, 17.1.1992
lettre à M. Gérard Deprez, 14.11.1994
10. lettre de M. Léon Saur, à M. Ruperez, secrétaire général de l'IDC 16.6.1995.
Documents transmis par le sénateur Caluwé :
1. articles de journal : Golias condamné pour diffamation, Libération, 26.4.1997 en La Croix, 27.4.1997;
2. CMI voorzitter de heer Serge Desouter neemt het op voor de verloren eer van de missionarissen, 31.7.1996;
3. brief aan de heer Gouteux, onderzoeker Golias magazine vanwege de h. Desouter, eis tot recht van antwoord van 7.8.1995;
4. brief aan de heer Terras vanwege pater Theunis, eis tot recht van antwoord, 10.7.1995;
5. affirmations et erreurs manifestes de Golias, datum en auteur onbekend;
6. les Pères Blancs et les Soeurs Blanches, Golias, juli-augustus 1995, J.P. Gouteux;
7. Heeft de kerk in Rwanda gezwegen? Serge Desouter, juni 1994;
8. note de travail, juillet 1994;
9. éléments d'une esquisse historique de la tragédie rwandaise, de heer Serge Desouter, september 1994;
10. CMI Voorzitter de heer Desouter : Rwandese leugens moeten ontmaskerd worden, juni 1995.
Documents de la part de maître Luc De Temmerman :
1. lettre à la commission « betreffende het oproepen van getuigen, tegensprekelijkheid van het debat en juridische manipulatie », 27.5.1997;
2. lettre à Mme Arbour, procureur du tribunal pénal int. pour le Rwanda, « betreffende Rutaganda. Procureur ICTR 96-3-7, 27.5.1997 »;
3. fax au président, correspondance et « déclaration à la presse » de M. Barahinyura.
Lettre de M. Nsanzuwera au ministre de la Justice du Rwanda, 20.5.1997.
Lettre de M. Philippe Claeys au président de la commission du 16.5.97 concernant Eugène Nahimana.
Annexe : communiqué de presse, action en justice contre le sénateur A. Destexhe.
Lettre de M. Ngulinzira, réaction au témoignage du capitaine Lemaire, 25.5.1997.
Document transmis suite à l'audition de Mme De Temmerman en date du 28.5.97 :
Verblijf in Rwanda 1991-1997.
Lettre de M. Rwabukumba Séraphin au président de la commission, 22.5.97;
Lettre de M. Rwabukumba Séraphin à la commission de recours des réfugiés concernant le recours contre la décision du commissaire général de lui refuser la qualité de réfugié.
Bijlage : document van EMG C Ops aan KIBAT van april 1994 betreffende C 130's.
Documents transmis par le sénateur Destexhe lors de la réunion du 28.5.97:
1. interview du Père Greindl, novembre 1996;
2. Le chaudron de l'Afrique centrale, ANB BIAN 257, 25.4.1994.
Documents transmis par M. Léon Saur aux membres de la commission suite à son audition du 30.5.1997 :
1. Documents IDC;
2. Documents PSC;
3. Convertissons-nous pour vivre ensemble dans la paix, Diocèse de Kabgayi, Rwanda, 1.12.1991;
4. La guerre et la paix au Rwanda, M. Nsabimana Alexis, décembre 1992;
5. Analyse de la situation politique au Rwanda à la lumière des accords d'Arusha, M. Sperancie Mutwe, 14.1.1993;
6. Communauté des étudiants rwandais en Belgique, Rwanda : Violation des droits de l'homme. D'autres vérités, 23.2.1993;
7. Documents Front Patriotique Rwandais;
8. Documents Mouvement Démocratique Républicain, section Benelux.
Document transmis par M. Twagiramungu lors de son audition du 30.5.1997;
Forces de résistance pour la démocratie FRD, plate-forme politique, mars 1996, document transmis par M. Twagiramungu.
Textes transmis par Mme Els De Temmerman lors de son audition du 28.5.1997.
Documents transmis par M. André Louis lors de son audition du 3.6.1997 :
1. Rwanda, la stratégie du FPR, 13.4.1993;
2. Rwanda, aggravation prévisible de la crise après les négociations d'Arusha, 17.7.1992.
Documents transmis par M. Theunis lors de son audition du 3.6.97 :
1. extraits des statuts de RTLM;
2. lettre à M. Christian Terras, 4.12.1994;
3. lettre à M. Christian Terras, 10.7.1995.
Document de M. Saur : Rwanda, le soutien belge aux génocidaires et l'éclatement possible d'affaires Touvier en Belgique, en date du 16 mars 1997.
Texte transmis à la commission par M. Godfriaux le 19.2.1997.
Lettre de M. Pierre Galand à l'attention du président de la commission, lettre en date du 9 juin 1997 :
Annexes :
1. tableau de la configuration de la dette extérieure du Rwanda;
2. tableau des dépenses ordinaires de l'État en matière de Défense nationale;
3. tableaux synthétiques 1991-1994 des importations définitives du Rwanda;
4. tableaux des importations d'armes blanches réalisées en 1993;
5. « Explications III », importation des armes, munitions et équipements militaires par le gouvernement rwandais 1990-1993;
6. prélèvements sur compte de la Banque nationale du Rwanda, période 7.4 - 28.10.1994;
7. lettre de M. Maystadt à M. Sandstrom de la Banque mondiale;
8. lettres échangées entre le directeur de la Défense nationale belge et l'Ambassadeur du Rwanda en 1991;
9. communication du CLADHO de M. Nkubito;
10. budget.
Lettre au président de la commission, M. Swaelen de la part de M. Joseph Michel, Doyen de l'Ordre national des avocats concernant : Déposition des avocats devant une commission d'enquête parlementaire, en date du 10.6.1997.
Documents transmis par M. Matata lors de son témoignage devant la commission du 17.6.1997 :
1. exposé introductif de M. Matata;
2. rapport d'activités ARDHO 1993,1992, octobre 1990-décembre 1991;
3. les massacres planifiés de civils hutus dans la préfecture de la ville de Kigali (P.V.K.);
4. massacres de civils hutus en commune Mugina-Gitarama;
5. la paralysie du système judiciaire par l'armée;
6. colloque international tenu à Montréal du 4 au 5 avril 1997;
7. centre de lutte contre l'impunité et l'injustice au Rwanda :
Communiqué nº 13/97, 29/5/1997;
Les syndicats de délateurs, mai 1997;
L'Armée Patriotique Rwandaise est-elle en guerre contre la population civile? Volume I, mai 1997;
Que sont devenus les militaires des ex-forces Armées Rwandaises « Intégrés » dans l'Armée Patriotique Rwandaise ou récemment « rapatriés » des camps de réfugiés? Dossier nº 1, mai 1997;
Communiqués nº 1 du 8 mai 1996 au nº 12 du 25 mars 1997;
Notes pour information à nos partenaires, avril 1997;
Épuration ethnique de la magistrature rwandaise, avril 1997.
Rapport sur la situation des droits de l'homme au Rwanda, Ier trimestre 1996;
Rapport sur la situation des droits de l'homme au Rwanda, IIIe Trimestre 1996.
9. Communiqué final du deuxième congres ordinaire de la LDGL (Mbaraba 19-20 décembre 1995).
Lettre au président de la commission de la part de M. Gasana Ndoba, membre du CRDDR concernant la transmission de documents relatifs à Eugène Nahimana en date du 17.6.1997.
Document de M. Dismas Nsengiyaremye :
Rwanda, Mouvement démocratique républicain (MDR) :
Pour le respect des accords de paix d'Arusha et le succès du processus démocratique au Rwanda, 10.9.1993.
Documents transmis par M. Twagiramungu le 17.6.1997 :
1. la transition, l'accord de paix et le MDR, M. F. Twagiramungu, 23.9.1993;
2. position du parti MDR sur les grands problèmes actuels du Rwanda, adoptée par le bureau du MDR le 6.11.1994;
3. le FPR serait responsable du massacre d'au moins 500 000 Rwandais, hutu pour la plupart; Force de Résistance pour la Démocratie, mai 1996;
4. éléments relatifs à l'attentat contre l'avion présidentiel, note de 1995 à M. Twagiramungu.
Lettre au ministre Delcroix de la part de Mme Monique Mujawamaliya, secrétaire de la LDGL, concernant la coopération militaire belgo-rwandaise, 11.3.1994.
Documents transmis par M. Destexhe :
1. lettre de M. Léon Saur concernant demande d'aide du MNRD, 29.4.1991;
2. communiqué de presse, de la poudre aux yeux a la commission Rwanda, M. Eugène Nahimana, 18.6.1997;
3. overzicht reis minister Claes naar Rwanda, 28.2.1994;
4. fax du colonel Marchal, références des Doc relatifs à la chronologie des événements, 18.6.1997;
5. outgoing code cable from Booh Booh to Kofi Annan , 8 avril 1994;
6. Vlamingen laten Rwanda niet vallen , enquête Het Volk, 19.4.1994;
7. lettre de Jacques Collet au président de la commission, 8.6.1997;
8. réponse de la commission à la note remise par le conseil de M. E. Nahimana, 17.6.1997.
Transcriptions des interventions antenne période 6.4.1994-20.4 1994 : RTBF, journal parlé.
Note de synthèse transmis par le sénateur Destexhe concernant une lettre à M. Swinnen et au ministre Claes : liste de membres de l'état-major secret chargé de l'extermination des Tutsis, 27.3.1992.
Documents de M. Tallier :
1. Rwanda, informations générales d'office, 20.1.1994;
2. werkdocument Veiligheid van de Staat, Rwanda.
Documents de M. Scheers :
1. persoonlijke documenten van Meester Scheers;
2. lettre de M. Scheers au président Habyarimana en date du 22.12.1993.
Document transmis par M. Brouhns lors de son témoignage du 25.6.1997 : Special Report of the Secretary-General on the United Nations Assistance Mission for Rwanda, 20.4.1994.
Lettre aux membres de la commission de M. Philip Verwimp « betreffende zijn doctoraatsvoorstel over de Rwandese genocide » , 20.6.1997.
Questions et réponses du général-major Schellemans, transmises aux membres de la commission le 26.6.1997.
Demande d'audition de la part du CRDDR, M. Gasane Ndoba, 26.6.1997.
Conférence de presse, témoignage plus annexes de M. Augustin Ndindiliyimana, 21.4.1997.
Explications de M. Swinnen sur son rapport du 27 mars 1994 au ministre Claes, 23.6.1997.
Mise au point adressée à la commission Rwanda par M. Eugène Nahimana, 1.7.1997.
Lettre à l'attention du président de la commission de la part de l'organisation Citoyens pour un Rwanda démocratique, 4.7.1997.
Documents de l'ambassade de Belgique à Kigali :
1. document confidentiel de M. Swinnen au Ministre Claes, Rapport politique annuel 1993, 30.12.1993;
2. document vanwege de h. De Coninck aan minister Derycke, politiek jaarverslag 1994, 23.5.1995.
« Les commissions parlementaires belges, Que peut-on en attendre? », M. Spiridon Shyrambere, juillet 1997.
Documents transmis par le sénateur Destexhe :
1. lettre de la part du « Groupe de réflexion rwando-belge », signé par M. Georges Ruggiu, M. Paulin Murayi et M. W.Nzabalirwa à M. Alain De Brouwer en date du 7 septembre 1993;
2. Message de la part du « Groupe de réflexion rwando-belge », signé par M. Georges Ruggiu et M. Paulin Murayi en date du 10 janvier 1993;
3. lettre de M. Alain De Brouwer à M. Paulin Murayi, reponse du message du 10.1.1993, 12.1.1993.
Rapport d'ensemble enseignements tirés de la mission des Nations unies pour l'assistance au Rwanda (MINUAR), octobre 1993-avril 1996. Groupe des enseignements tirés des missions. Département des opérations de maintien de la paix, décembre 1996.
Rapport Van Hecke. Militaire Studie Rwanda « Kritische Analyse van het verslag van de Ad-hoc groep Rwanda »
(4) Documents dont les membres de la commission ont pu prendre connaissance
Deux fardes concernant M. Eugène Nahimana du commissariat général aux réfugiés et aux apatrides.
Parties I, II et III de l'enquête du juge d'instruction Lemmens concernant les installations radio vendues par la firme Van Rompaey-Devaro au profit de RTLM.
Télex de notre ambassade à Nairobi concernant un témoignage sur l'implication du général Dallaire et des Casques bleus belges dans l'assassinat du président Habyarimana.
Dossier Nahimana/RTLM-Houtmans transmis par le ministre de la Justice le 12 août 1997.
Procès-verbaux des réunions des commissions mixtes Belgique-Rwanda (période 1990-1994).
Documents transmis par le secrétaire d'État à la Coopération au développement :
Liste des ONG qui étaient présentes au Rwanda depuis 1990 à ce jour;
Liste des ordonnancements par année et par ONG des projets et actions ONG cofinancés au Rwanda jusqu'à ce jour;
4 dossiers Nord-Sud Coopération;
commission mixte Belgique-Rwanda août 1991 document préparatoire de la section coopération (Ambassade de Belgique à Kigali Section coopération, 19/7/91);
« Commission mixte de la coopération au développement entre la Belgique et le Rwanda Document de travail : Mémorandum de la Coopération au développement entre la République rwandaise et le Royaume de Belgique » (République rwandaise, Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération au développement, Kigali, août 1991)
« Commission mixte belgo-rwandaise Document de travail à l'usage de la délégation belge interventions en cours et en préparation gérées par DG2(AGCD, D2, Bruxelles)
« Commission mixte de la coopération au développement entre la Belgique et le Rwanda : procès-verbal, Kigali, 26-30 août 1991 »
« Procès-verbal de la réunion d'évaluation à mi-parcours du programme de coopération au développement entre la Belgique et le Rwanda pour la période 1992-1993; Kigali 2-6.10.92 »
Procès-verbal de la réunion de concertation sur la coopération belgo-rwandaise; Kigali 29.06-07.07.93
Synthesenota betreffende de financiële samenwerking met Rwanda met bijlagen : Bijlage 1 tot 12 : akkoorden en uitwisselingen van brieven i.v.m. deze samenwerking; Bijlage 13 tot 19 : overzicht van de uitvoering van de financiële akkoorden met Rwanda, inclusief het gebruik van de rekeningen bij de Nationale Bank van België
Landennota november 1990, juni 1991 en februari 1994, beleidsnota augustus 1993, synthesenota april 1992.
1.3.1.10. Devoirs d'instruction
En vertu de l'article 4 de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires, la commission ainsi que son président, pour autant qu'il y soit habilité, peuvent prendre toutes les mesures d'instruction prévues par le Code d'instruction criminelle (15).
La commission peut adresser une requête au premier président de la cour d'appel, qui désigne un ou plusieurs conseillers à la cour d'appel, ou un ou plusieurs juges du tribunal de première instance, d'accomplir des devoirs d'instruction spécifiques(16).
La commission est tenue, pour certaines mesures d'instruction, de demander la désignation d'un magistrat(17).
La commission peut également, conformément à la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements, charger les Comités permanents P et R d'effectuer les enquêtes nécessaires(18). La commission n'a pas fait usage de cette compétence.
Lorsque des renseignements doivent être demandés en matière criminelle, correctionnelle, policière ou disciplinaire, la commission doit adresser une demande au parquet ou à l'auditorat général(19).
Pour ce qui est des renseignements d'ordre administratif, la demande doit être adressée au ministre ou au secrétaire d'État compétent(20).
(2) Devoirs d'instruction effectués par la commission d'enquête
Auditions de témoins et confrontations
a) Liste des témoins et des confrontations
Voir 1.3.3.2. et 1.3.3.4.
b) Principe de la convocation par lettre ordinaire
Conformément à l'article 4 du règlement de la commission d'enquête, les témoins ont été convoqués en principe aux auditions par lettre ordinaire.
Il a toutefois été nécessaire de faire une exception en ce qui concerne la convocation de M. E. Nahimana.
M. E. Nahimana a déclaré spontanément, au cours de l'audition du 14 mai 1997 avec Mme de Backer, qu'il ne voulait pas témoigner en présence de M. Destexhe, membre de la commission. Cette déclaration a dû être comprise comme constituant un refus de témoigner.
En exécution de l'article précité du règlement d'ordre intérieur, M. Nahimana a par conséquent été cité à comparaître par le ministère d'un huissier de justice. En l'occurrence, la commission a appliqué l'article 5 de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires, qui fixe le délai de la citation à deux jours au moins.
Demandes d'informations
En application de l'article 4, § 6, de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires, la commission a, principalement, adressé des demandes d'information notamment au Premier ministre et aux ministres de la Défense nationale, des Affaires étrangères et de l'Intérieur, ainsi qu'au secrétaire d'État à la Coopération au développement.
Les documents qui ont été obtenus par cette voie sont mentionnés dans la liste de documents qui figure au point 1.3.3.8.
Perquisition Saisie de biens
L'enquête de la commission n'a donné lieu à aucune perquisition au sens d'une mesure d'instruction unilatérale.
Dans le seul cas où une perquisition a été envisagée, la possibilité a été donnée à l'intéressé, en l'espèce maître Scheers, avocat près du barreau de Bruxelles, de recevoir un membre de la commission en ses bureaux en présence d'un juge d'instruction désigné par le premier président de la Cour d'appel de Bruxelles.
La commission a donc jugé qu'il n'était pas nécessaire de procéder à une perquisition unilatérale. Elle a cependant demandé au premier président de la Cour d'appel de Bruxelles de prendre les mesures nécessaires pour permettre d'exécuter sans délai une décision éventuelle de procéder à une telle perquisition.
La visite au bureau de Me Scheers a été effectuée par le vice-président G. Verhofstadt, en présence du juge d'instruction Vlogaert.
Le bâtonnier Mme Boliau s'est opposée à la saisie des documents que le juge d'instruction avait emportés à l'occasion de cette perquisition. Elle a argué du fait que ceux-ci étaient couverts par le secret professionnel. Le juge d'instruction a conservé les documents en attendant que l'incident soit clos.
Désignation d'un magistrat pour l'accomplissement de devoirs d'instruction
(application de l'article 4, § 2, de la loi de la loi de 1880 sur les enquêtes parlementaires)
a) RTLM financement
En exécution de l'article 4, 2e alinéa, de la décision du Sénat du 23 janvier 1997 visant à instituer une commission spéciale Rwanda(21), la commission spéciale a décidé, à l'unanimité, à la demande d'un tiers de ses membres, de faire usage des compétences prévues à l'article 56 de la Constitution et dans la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires.
La commission a notamment fait usage de ces compétences pour s'enquérir des mouvements de fonds qui ont eu lieu sur un certain nombre de comptes bancaires.
La mesure d'instruction devait permettre de dire si la radio rwandaise RTLM avait été financée à partir de comptes en banque belges et, si oui, comment et dans quelle mesure.
C'est le juge d'instruction-conseiller Vlogaert, qui fut désigné par le premier président en exercice de la Cour d'appel de Bruxelles, M. Ph. Cerckel, qui réalisa cette enquête.
b) RTLM achat de studios
À propos de l'audition de M. Houtmans, qui eut lieu le 3 juin 1997, il a été vérifié si les studios de RTLM avaient pu être achetés auprès de la société Van Rompaey-Devaro de Putte.
La commission d'enquête demanda qu'un magistrat soit chargé d'identifier la personne qui a payé la commande de ces studios et de déterminer le mode de paiement utilisé.
C'est le conseiller E. Lemmens, qui avait été désigné par le premier président de la Cour d'appel d'Anvers, M. L. Janssens, qui réalisé cette enquête.
Dans son rapport concernant l'achat des studios auprès de la société Van Rompaey-Devaro de Putte (voir point 2), le conseiller Lemmens, qui fut désigné en application de l'article 4, § 2, de la loi sur les enquêtes parlementaires, a cité les noms de Mme J. De Jongh, de M. B. Fred et de M. S. Musengimana.
L'on a alors demandé au premier président de la Cour d'appel d'Anvers d'inviter le conseiller Lemmens à entendre Mme De Jongh et M. Fred, et à vérifier qui était M. Musengimana et quels liens il pouvait y avoir entre celui-ci et la radio RTLM.
Demande de renseignements en matière criminelle, correctionnelle, policière et disciplinaire
(application de l'article 4, § 5, de la loi de 1880 sur les enquêtes parlementaires)
a) Les rapports Nees et De Cuyper
Les rapports Nees sont ceux que le lieutenant Nees, officier de renseignements de KIBAT I de novembre 1993 à mars 1994, a transmis régulièrement à son chef de corps, le lieutenant-colonel Leroy. La commission d'enquête ne possédait qu'une dizaine des 29 rapports.
Les rapports De Cuyper sont les cinq rapports que le capitaine De Cuyper, officier de renseignements de KIBAT II en mars-avril 1994, a transmis à son chef de corps, le lieutenant-colonel Dewez.
Ces deux séries de documents se trouvaient entre les mains du juge d'instruction Vandermeersch qui les détenait dans le cadre de son enquête judiciaire relative à certains dossiers concernant les événements qui se sont déroulés au Rwanda en 1993 et 1994.
L'on a réclamé ces documents auprès du procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles, M. Van Oudenhove, qui a décidé de les transmettre sur l'avis du procureur du Roi et du juge d'instruction concerné.
b) Documents du service Afrique du Ministère des Affaires étrangères
Dans son témoignage du 6 mai 1997 devant la commission d'enquête, le juge d'instruction Vandermeersch a évoqué la perquisition qu'il a effectuée au service Afrique du Ministère des Affaires étrangères et au cours de laquelle l'on a saisi certains documents. Au cours de cette perquisition, le juge d'instruction a procédé en personne à certains interrogatoires.
Les documents saisis ainsi que les procès-verbaux des interrogatoires ont été réclamés au procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles, M. Van Oudenhove, qui les a mis à la disposition.
c) Cassette vidéo Marchal
Dans le cadre du procès Marchal, l'auditorat général près la cour militaire a détenu, pendant tout un temps, une cassette vidéo portant des enregistrements que le colonel Marchal avait réalisés en avril 1994.
Comme cette cassette avait déjà été transmise au greffe du Tribunal de première instance de Bruxelles, on l'a réclamée au procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles, M. Van Oudenhove, qui l'a mise à la disposition.
d) Renseignements relatifs à des perquisitions que l'on aurait effectuées éventuellement dans l'affaire des boîtes de collecte sélective Hermes Communications
L'on a invité le procureur général près la Cour d'appel d'Anvers, M. Van Camp, à indiquer à la commission d'enquête quels sont les dossiers judiciaires qui sont liés à l'affaire des boîtes de collecte sélective Hermes Communications et, en particulier, à désigner ceux qui auraient fait l'objet de perquisitions ayant permis de mettre à jour des éléments liés de près ou de loin aux événements du Rwanda.
Par lettre du 20 octobre 1997 du procureur général M. Dekkers, la commission a été informée de l'existence de deux instructions parallèles. Des perquisitions ont déjà été effectuées dans le cadre des deux dossiers, mais elles n'ont mis à jour aucun élément lié de près ou de loin aux événements du Rwanda.
Dossiers transmis
a) Le dossier Nahimana
L'on a transmis le dossier Nahimana au juge d'instruction Vandermeersch, étant donné que l'on a bien dû convenir qu'il contenait des éléments pouvant avoir quelque importance pour les enquêtes judiciaires.
M. Vandermeersch a mis les documents en question à la disposition du procureur du Roi de Bruxelles en application de l'article 10 de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires. Sur la base de ces documents, le procureur du Roi a ouvert une information dans l'affaire Nahimana pour vérifier s'il n'y avait pas eu d'infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949 et aux Protocoles additionnels I et II du 8 juin 1977.
b) Le dossier Maggen
Au cours de l'audition par la commission d'enquête du major Maggen, le 7 mai 1997, l'on a constaté des contradictions entre plusieurs déclarations sous serment. Aussi a-t-on transmis le dossier, en application de l'article 10 de la loi de 1880 sur les enquêtes parlementaires, à l'auditorat général près la Cour militaire, pour qu'il y soit donné suite à telle fin que de droit.
Commissions rogatoires
a) Le dossier Ruggiu
Au cours d'un entretien avec la commission d'enquête, le juge d'instruction D. Vandermeersch a signalé qu'il avait l'intention d'envoyer une commission rogatoire au Tribunal pénal international pour le Rwanda en vue d'interroger plusieurs détenus, dont M. Ruggiu. Le juge d'instruction s'est dit disposé à inclure des questions éventuelles de la Commission d'enquête parlementaire dans son interrogatoire. En vue du respect de la saisine, ces questions ont été transmises au procureur du Roi.
b) Le dossier Dallaire
Le général Dallaire ayant déclaré publiquement, fin septembre 1997, être disposé à répondre aux questions des membres de la commission d'enquête par le biais de la même procédure écrite que celle qui a été utilisée dans le cadre du procès Marchal, l'on a invité le premier président de la cour d'appel de Bruxelles à mettre sur pied une commission rogatoire. Le conseiller Laffineur a été désigné pour cette mission d'instruction le 30 octobre 1997.
Voir aussi : Les restrictions auxquelles la commission a été confrontée; restrictions en raison du refus de coopérer des instances de l'ONU.
Pendant sa première réunion du 30 avril 1997, la commission a adopté son règlement d'ordre.
(1) Les réunions de la commission d'enquête
La commission se réunira en principe le mercredi et le vendredi de 10 heures à 12h30 et de 14 heures à 17h30. Des réunions supplémentaires peuvent être tenues si cela s'avère nécessaire.
Si nécessaire, les réunions publiques seront précédées, à 9h30, d'une courte réunion à huis clos, afin de se mettre d'accord sur l'ordre des travaux. Toutefois, d'autres réunions pourront aussi être réservées à l'ordre des travaux.
Conformément à l'article 3, troisième alinéa, de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires, tel que modifié par la loi du 30 juin 1996, les réunions de la commission sont publiques, à moins que la commission n'en décide autrement.
Les délibérations ont toujours lieu à huis clos.
Tout membre du Sénat peut assister aux réunions publiques de la commission sans toutefois pouvoir y prendre la parole.
Les collaborateurs des groupes politiques peuvent assister aux réunions, à moins que la commission n'en décide autrement.
Un seul collaborateur par membre de la commission peut assister aux réunions, à condition d'être accompagné du membre concerné.
Les chefs de groupe communiquent au début des travaux le nom des collaborateurs qui assisteront aux réunions.
La commission peut à tout moment déroger à ces règles.
Afin d'assurer le bon fonctionnement de la commission, chacun est tenu au secret en ce qui concerne les informations recueillies à l'occasion des réunions tenues à huis clos.
Toute personne autre que les sénateurs qui, à un titre quelconque, assiste ou participe aux réunions non publiques de la commission, est tenue, préalablement, de prêter le serment de respecter le secret des travaux.
§ 1. Les témoins et experts seront convoqués par lettre ordinaire.
Si les témoins ne répondent pas à cette convocation, ils seront cités par ministère d'huissier de justice. S'ils refusent de comparaître après citation, un procès-verbal sera dressé, conformément à l'article 10 de la loi précitée. Celui-ci sera transmis au procureur général près la cour d'appel, pour qu'il soit donné telle suite que de droit.
§ 2. S'ils y sont invités, les témoins prêtent le serment de dire toute la vérité et rien que la vérité. Les témoins sont avertis qu'ils ont le droit de garder le silence s'ils craignent de s'accuser en faisant des déclarations.
§ 3. Le témoin ou l'expert sont invités à confirmer qu'ils persistent dans leurs déclarations.
§ 4. Le procès-verbal des témoignages est signé, soit immédiatement, soit au plus tard quinze jours à date de la fin de l'audition par le président et par le témoin, après que lecture lui en a été faite et qu'il a déclaré persister en ses déclarations. Si le témoin refuse de signer ses dépositions, il en sera fait mention au procès-verbal.
(5) Compte rendu des auditions
Il est établi un compte rendu analytique (CRA/BV) et un compte rendu sténographique des auditions.
Chaque membre du Sénat reçoit, le jour ouvrable suivant, le compte rendu analytique (CRA/BV) des auditions publiques. Le compte rendu sténographique ainsi que le compte rendu analytique des auditions au parties d'auditions se déroulant à huis clos ne sont fournis qu'aux membres de la commission. Si la commission d'enquête le décide, il ne sera pas communiqué de comptes rendus, lesquels ne pourront alors qu'être consultés par les membres de la commission au secrétariat de celle-ci.
Le procès-verbal est conservé au secrétariat de la commission, où il pourra être consulté par les membres. Il n'en sera pas délivré de copie. Le secrétaire tiendra un registre des personnes qui viendront le consulter.
Chaque membre de la commission recevra une copie des comptes rendus des auditions publiques.
Les travaux de la commission, en ce compris les déclarations des témoins et des experts, seront enregistrés sur bandes magnétiques. Celles-ci seront, sous la responsabilité du président et du secrétaire, conservées sous clé au secrétariat de la commission. Seuls les membres de celle-ci pourront en prendre connaissance. En aucun cas les bandes ne pourront être reproduites. Le secrétaire tiendra un registre des personnes qui viendront les écouter.
La commission d'enquête dresse, pour chaque témoin ou expert, la liste des questions qui seront posées en premier lieu. Ces questions sont communiquées préalablement à l'intéressé. Elles sont posées par le président ou, le cas échéant, par un autre membre du bureau, au cours de l'audition.
Après la réponse de l'intéressé, tout membre peut poser d'autres questions suivant un ordre fixé par la commission et dans le respect du temps de parole éventuellement impartie par le président.
Au cours des auditions, les membres se bornent à poser des questions. Ils n'engagent pas de discussion avec la personne interrogée ni avec les autres commissaires.
La commission d'enquête peut faire appel à des spécialistes pour ses travaux.
À l'issue de chaque réunion, le commission décide s'il y a lieu de faire une communication de presse. Le cas échéant, le président et les autres membres du bureau prendront contact avec la presse.
Les vice-présidents rédigent, à propos des travaux, constatations et conclusions de la commission, un projet de rapport, qui lui est soumis pour discussion et approbation.
1.3.1.12. Données statistiques
Nombre de témoins :95
Nombre d'auditions :
Commission spéciale Rwanda :57
Commission d'enquête parlementaire
Rwanda :52
109
Nombre d'heures des auditions :
Commission spéciale Rwanda :165 h.
Commission d'enquête parlementaire
Rwanda :174 h.
339 h.
Nombre d'heures de réunion de travail :
Commission spéciale Rwanda :50 h.
Commission d'enquête parlementaire
Rwanda :249 h.
299 h.
Nombre d'heures des réunions du bureau :
Commission spéciale Rwanda 14 h.
Commission d'enquête parlementaire
Rwanda :38 h.
52 h.
Nombre d'heures de réunion
du groupe ad hoc
Rwanda :40 heures.
(1) Restrictions dues à l'inviolabilité absolue du Roi
Un certain nombre de commissaires ont suggéré que la commission devrait aussi entendre les collaborateurs du Roi, c'est-à-dire les membres du cabinet civil ou de la maison militaire du Roi.
Comme cette question concerne un principe fondamental du droit constitutionnel l'on a, pour pouvoir apprécier si ladite proposition était recevable ou non, demandé l'avis des professeurs A. Alen (K.U.L.) et J. C. Scholsem (U.Lg) ainsi que celui du service Affaires juridiques et Documentation du Sénat(22).
Les divers avis convergeaient en ce sens qu'ils soulignaient qu'en raison de leur position particulière, les collaborateurs du Roi ne peuvent pas être interrogés ni par une commission parlementaire ordinaire ni par une commission parlementaire d'enquête à propos de l'exercice de leur fonction spécifique. Les interroger à ce propos reviendrait à interroger le Roi lui-même, ce qui porterait atteinte aux principes constitutionnels de la séparation des pouvoirs, de l'inviolabilité absolue du Roi, de l'unité entre le Roi et le Gouvernement et du « colloque secret », c'est-à-dire à l'interdiction de dévoiler la part du Roi dans les décisions prises sous la responsabilité des ministres.
L'on a décidé, sur la base des avis précités, de n'interroger aucun membre du cabinet civil ou de la maison militaire du Roi.
(2) Restrictions en raison du refus de coopérer des instances de l'ONU
La commission a toujours accordé une importance principale aux décisions que les instances de l'ONU ont prises dans le cadre des événements du Rwanda et au contexte concret dans lequel elles ont été prises.
I. Aussi y a-t-il eu un consensus général selon lequel la commission devait, pour pouvoir atteindre pleinement ses objectifs, entendre le témoignage de M. Booh-Booh, qui était à l'époque représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, de M. I. Riza, qui était adjoint de l'adjoint du secrétaire général (DPKO), et de M. Annady, le chef du département Afrique.
L'on a demandé à M. Kofi Annan, le secrétaire général qui était à l'époque secrétaire général adjoint de l'Onu, d'autoriser toutes les personnes concernées à témoigner devant la commission.
L'on a également demandé au gouvernement canadien l'autorisation d'entendre les généraux Dallaire et Barril, qui ne sont plus actifs dans le cadre de l'ONU et qui font partie de l'armée canadienne.
Dans le cadre de l'invitation à témoigner qui date de mars 1997, l'on avait souligné que la commission spéciale n'était pas plus à l'époque qu'une simple commission parlementaire et qu'il ne s'agissait absolument pas d'un organe d'enquête disposant d'une quelconque compétence judiciaire ou pseudo-judiciaire.
Le Gouvernement belge et les ambassades belges auprès des Nations unies et du Canada furent invités à prendre les mesures diplomatiques nécessaires pour convaincre les personnalités onusiennes concernées de collaborer aux travaux de la commission.
Dans sa réponse, le secrétaire général a renvoyé tout d'abord à la Section 18 de la Convention de 1946 sur les privilèges et immunités des Nations unies, en vertu de laquelle tous les fonctionnaires, actuels et anciens, des Nations unies, jouiront de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle. En vertu de cette disposition, ils ne peuvent être forcés de témoigner en justice sans l'autorisation du secrétaire général.
Le secrétaire général déduit de l'UN Staff Regulation 1.5. une interdiction de témoigner pour les cadres, anciens et actuels :
« Aside from the question of immunity, pursuant to United Nations Staff Regulation 1.5. neither current nor former staff members may even voluntarily give information on their official activities and on the activities and performance of UNAMIR Operation without an authorization by the Secretary-General. The long standing policy of the United Nations with regard to invitations of United Nations officials to appear before national parliamentary committees or congressional bodies has been that formal testimony before such fora may only be provided upon a specific authorization of the Secretary-General, which is granted if in his opinion such authorization is in the interest of the Organization. »
In casu , le secrétaire général n'a pas accordé l'autorisation de témoigner.
Or, force est de constater que, si l'on a refusé, pendant un certain temps, de transformer la commission spéciale en commission d'enquête, c'est essentiellement parce que les témoignages des personnalités « onusiennes » concernées auraient eu une importance déterminante.
Pour écarter certaines objections, la commission d'enquête décida alors de faire appel à Mme Suhrke, qui avait déjà témoigné devant la commission spéciale et qui avait déjà une expérience spéciale en ce qui concerne la consultation de sources onusiennes.
L'on a demandé à Mme Suhrke de bien vouloir jouer le rôle d'intermédiaire afin de soumettre au général Dallaire des questions spécifiques, formulées par la commission d'enquête.
Mme Suhrke a acquiescé à cette demande.
Fin septembre, le général Dallaire a déclaré publiquement être disposé à répondre aux questions des membres de la commission d'enquête. Il a proposé lui-même cette procédure écrite, avec intervention des Nations unies, qui a été utilisée à l'époque dans le cadre du procès Marchal(23).
À la suite de cette déclaration, la commission d'enquête a invité le premier président de la cour d'appel, en vertu de l'article 4, § 2, de la loi du 3 mai 1880, à mettre sur pied une commission rogatoire destinée à recueillir le témoignage écrit du général.
Mme Suhrke ayant fait savoir, fin octobre, qu'elle souhaitait se voir décharger de sa mission de médiation, l'on a encore fait appel au représentant permanent de la Belgique auprès des Nations unies pour transmettre, par voie diplomatique, une liste de questions écrites aux Nations unies.
Aux questions posées au général Dallaire ont été jointes des questions adressées à l'ancien secrétaire général M. Boutros Boutros-Ghali et au représentant spécial du secrétaire général M. Booh-Booh.
II. À la demande que lui avait adressée la commission spéciale Rwanda en vue d'entendre le lieutenant-colonel Leclercq, à l'époque officier Sit. Room des Nations unies, le ministre de la Défense a répondu en renvoyant au point de vue du secrétaire général des Nations unies. En effet, en 1994, le lieutenant-colonel Leclercq avait été officiellement détaché au service des Nations unies.
Par conséquent, la règle à appliquer serait que ni les fonctionnaires ou anciens fonctionnaires des Nations unies, ni les militaires qui sont ou ont été détachés auprès des Nations unies, ne peuvent comparaître devant une commission parlementaire sans l'autorisation du secrétaire général des Nations unies. Le fait que l'intéressé soit éventuellement prêt à témoigner spontanément ne changerait rien à cette règle.
En ce qui concerne la demande de comparution du major Delporte, à l'époque officier de l'UNCIVPOL, le ministre de la Défense s'est également fondé sur les restrictions imposées par le secrétaire général de l'ONU.
L'on fait référence, en particulier, à la déclaration signée par le major Delporte, dans laquelle il s'est engagé une fois son détachement auprès de l'ONU terminé à ne fournir aucune information portant spécifiquement sur les activités qu'il a eues pendant son service.
La commission a signalé au ministre qu'elle ne souhaitait absolument pas interroger le major à propos d'éléments stratégiques ou de plans opérationnels, ce qui fait qu'un témoignage éventuel ne serait pas contraire à l'engagement pris par les anciens officiers de l'UNCIVPOL de ne pas diffuser d'informations de service. En outre, en vertu de l'accord du 5 novembre 1993 conclu entre les Nations unies et le gouvernement du Rwanda, notamment l'article 47 b, les militaires qui participent à la MINUAR sont soumis, pour ce qui est des infractions pénales, à la juridiction exclusive des États participants. A posteriori , l'autorité juridictionnelle nationale vaut également pour les simples invitations à témoigner en tant qu'anciens membres de la MINUAR.
Dans une lettre ultérieure, le ministre de la Défense a reconnu qu'en tant que membre du pouvoir exécutif, il ne pouvait pas s'opposer à ce qu'une commission d'enquête parlementaire invite un officier à témoigner, quelles que soient les objections des Nations unies.
Vu la restriction imposée par le secrétaire général des Nations unies, les intéressés n'ont pas été entendus sur les activités de service spécifiques qu'ils ont eues à l'époque des événements du Rwanda.
(3) Restrictions en raison du lien entre l'enquête parlementaire et l'enquête judiciaire
Les prescriptions internationales, constitutionnelles et légales qui régissent directement ou indirectement le lien entre l'enquête parlementaire et l'enquête judiciaire ont considérablement limité l'enquête de la commission Rwanda. L'on vise en particulier l'article 6, deuxième alinéa, C.E.D.H., l'article 14.3.g., C.I.D.C.P., les dispositions constitutionnelles concernant le rapport entre les différents pouvoirs, ainsi que les articles 2, 8 et 9 de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires telle que modifiée par la loi du 30 juin 1996. Il convient de diviser la problématique en deux volets.
Tout d'abord, il fallait respecter les principes constitutionnels de la séparation des pouvoirs ainsi que l'article 1er, § 2, de la loi de 1880 qui les concrétise. Conformément à cette dernière disposition, les enquêtes menées par les Chambres ne se substituent pas à celles du pouvoir judiciaire « avec lesquelles elles peuvent entrer en concours, sans toutefois en entraver le déroulement ». En application de cette disposition, l'on a pris contact, chaque fois qu'il y avait un doute, avec le juge d'instruction Vandermeersch, qui mène une dizaine d'instructions concernant les événements du Rwanda. En outre, la commission a organisé une audition du juge d'instruction Vandermeersch en vue de discuter des dossiers judiciaires en cours. Enfin, la commission d'enquête, toujours pour ne pas entraver des enquêtes judiciaires en cours, n'a pas traité quant au fond, à la demande du juge d'instruction Vandermeersch, un dossier bien précis qui concernait le sort des victimes civiles.
Une autre restriction de l'enquête découlait de l'obligation pour la commission Rwanda d'éviter que des démarches de procédure inconvenantes ne perturbent le cours normal de l'instruction. Il fallait éviter en particulier qu'un témoin soit obligé directement ou indirectement de faire des déclarations par lesquelles il s'accuserait lui-même, de telle façon qu'il pourrait compromettre son droit fondamental à un procès équitable.
Tous s'accordent à dire qu'en ce qui concerne la procédure pénale belge, un tel incident est en principe exclu car l'on a inséré, dans la loi de 1880, une disposition selon laquelle, sans préjudice de l'invocation du secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal, tout témoin qui, en faisant une déclaration conforme à la vérité, pourrait s'exposer à des poursuites pénales, peut refuser de témoigner. En outre, à chaque audition, le président a fait remarquer à chaque témoin, après que celui-ci eut prêté serment, mais avant qu'il ne témoigne, qu'il ne devait faire aucune déclaration par laquelle il s'accuserait lui-même.
Par ailleurs, la commission a pris en considération les éléments suivants, qui l'ont obligée à faire preuve de la prudence requise :
Tout d'abord, le témoin n'est censé avoir le droit de garder le silence que pour les questions spécifiques qui pourraient l'amener à s'accuser lui-même. Pour ce qui est de toutes les autres questions, le refus de témoigner est passible de peines pénales en vertu de l'article 9 de la loi de 1880 (24). Le témoin est donc obligé d'évaluer au moment même où la question est posée si celle-ci peut l'amener ou non à s'accuser lui-même. Une mauvaise appréciation peut conduire à une condamnation.
Deuxièmement, l'on s'accorde à dire que de son droit de garder le silence ne découle pas le droit, pour le témoin, de faire des déclarations mensongères. Dès lors, il doit explicitement invoquer son droit de garder le silence lorsqu'il risque de s'accuser lui-même, même lorsque la question posée est tellement spécifique que le fait même d'invoquer ce droit indique que le témoin risque de s'accuser.
Troisièmement, la commission d'enquête est tenue de transmettre au procureur général près de la cour d'appel les procès-verbaux constatant des indices ou des présomptions d'infractions pour y être donnée telle suite que de droit, et ce, en application de l'article 10 de la loi du 6 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires.
Quatrièmement, il y a le contrôle supranational de la Cour européenne des droits de l'homme, qui peut toujours décider en dernière instance que, malgré la nouvelle version de la loi de 1880 et vu les éléments spécifiques d'un cas spécifique, le témoin a été obligé de fournir des indices relatifs à des données qui l'exposent à des poursuites pénales.
En l'espèce, la problématique se pose d'autant plus que parallèlement à l'enquête parlementaire en question, des enquêtes judiciaires sont en cours (ou peuvent encore être entamées) en Belgique, mais qu'il faut également tenir compte de l'instruction judiciaire en cours devant le tribunal de l'Onu à Arusha. Même le respect le plus rigoureux des normes en matière de sauvegarde des droits de la défense, tels qu'ils sont consacrés par la Constitution belge ainsi que par la Convention européenne des droits de l'homme, ne peut garantir que le tribunal international en question n'utilisera pas des normes plus strictes en la matière.
Dès lors, s'imposant volontairement une restriction, la commission d'enquête a estimé nécessaire de ne pas appeler certains témoins, ou de ne pas leur faire prêter serment.
(4) Restrictions en raison du refus des services de renseignements étrangers de communiquer des renseignements
La commission Rwanda a constaté qu'elle ne pouvait obtenir aucune information des services de renseignements étrangers, en particulier des services français et américains. Vu l'implication des puissances en question dans les événements du Rwanda sur lesquels la commission enquête, il est évident qu'elle n'a pas pu prendre connaissance de certaines informations, qui sont pourtant essentielles.
En outre, les documents que les instances militaires belges ont mis à la disposition de la commission ont été sélectionnés dans le même but, afin qu'ils ne contiennent aucune donnée empruntée aux services de renseignements précités.
Cette introduction a pour seul objet de fournir au lecteur non averti quelques éléments d'information de nature historique, géographique, sociale, démographique et économique sur le cadre général dans lequel s'inscrivent les événements dont la commission a à connaître. Elle n'est bien sûr pas exhaustive. Les analyses et appréciations de l'histoire du Rwanda sont controversées. Aussi la commission a-t-elle estimé devoir intégrer dans cette introduction de larges extraits du Rapport « Joint evaluation of emergency assistance to Rwanda; study 1. Historical perspective » (pp. 14-49) et du livre du professeur Prunier « The Rwanda Crisis-History of a Genocide » (pp. 74 à 90).
Le Rwanda est situé dans la région des Grands Lacs africains, entre l'Afrique centrale et l'Afrique orientale, sous l'équateur. Il s'étend entre les parallèles 1º 20' et 3º 50'de latitude sud et entre les méridiens 28º 50' et 30º 55' de longitude est. C'est un petit pays de 26 338 km2 , c'est-à-dire un peu moins que la Belgique. Il est dominé par des étendues montagneuses et des hauts plateaux continentaux. La partie centrale, la plus peuplée, se trouve à 1 500 à 2 000 mètres au dessus du niveau de la mer. Les collines aux flancs escarpées sont recouvertes d'un sol pauvre, fin et fragile. Elles sont séparées par des vallées profondes, souvent marécageuses. Le Nord du pays est couvert par une chaîne de volcans; l'altitude moyenne y est de 2 500 mètres.
Le climat est tropical, mais tempéré par l'altitude. La température annuelle moyenne de la capitale, Kigali, est de 19º C, et il y tombe en moyenne 1 000 mm de pluie par an. Ces conditions sont favorables à l'agriculture, et autorisent plusieurs récoltes par an, là où la qualité du sol le permet.
C'est un pays enclavé, sans accès à la mer. Il est séparé de plus de 2 000 kilomètres de l'océan Atlantique à l'ouest et de 1 500 kilomètres de l'océan Indien à l'est.
Lors du recensement de 1991 et de celui de 1994, le Rwanda comptait respectivement 7,15 et 7,6 millions d'habitants. La densité démographique était donc respectivement de 271 et 292 habitants par km2 . C'est la densité la plus élevée du continent africain. Et en ramenant ce chiffre absolu au sol cultivable (17 600 km2 ), on obtient une densité réelle de 406 personnes par km2 . Dans un pays dont 95 % de la population vit directement de l'agriculture, cette très importante densité de population est un élément essentiel, on le verra. Pour certains auteurs, cette « question de la terre » a joué un rôle important dans les événements de 1994; le sentiment se serait développé « that there were too many people on too little land, and that with a few less there would be more for survivors » (25).
Avant les événements de 1994, on estime que la population se composait de 85 à 90 % de Hutu, de 8 à 14 % de Tutsi et de 0,4 à 1 % de Twa (26).
Les langues officielles sont le français et le kinyarwanda. Le swahili est aussi pratiqué, et certaines populations revenues de Tanzanie et d'Ouganda parlent anglais.
L'évolution de l'économie du Rwanda suit de près celle de son secteur principal, l'agriculture, qui occupe et assure la subsistance de 95 % de la population. Elle participe directement pour un tiers environ à la production intérieure brute. Le café représente près de 75 % des recettes d'exportation, complétées par 10 % provenant du thé et 8 % d'autres produits du secteur primaire. Le Rwanda est donc monoproducteur et est à la merci des fluctuations des cours du café sur le marché international.
Son économie est peu diversifiée. La production du secteur secondaire est dominée par la fabrication de bières artisanales, qui sont des produits agricoles transformés. Le nombre d'entreprises formelles se limite à une petite centaine orientées vers le marché intérieur. La part relative du secteur tertiaire des services a augmenté dans l'ensemble de la production intérieure du pays, grâce notamment à l'expansion du commerce (27).
Au cours des années 80, des changements structurels s'amorcent dans le secteur agricole. Jusqu'en 1983, la production agricole s'est accrue au rythme de la population, dans une faible mesure grâce à l'intensification de la production et principalement grâce à l'accroissement des terres mises en culture, qui a fait suite au démantèlement du système ubuhake, acquis de la révolution sociale. Les années 84-85 marquent le début de la baisse des rendements (28). Le modèle agricole atteint ses limites. En 1989, une famine s'abat dans le sud du pays mettant en évidence une nouvelle fois les limites du système d'exploitation des terres. Le pays, à peine autosuffisant au niveau alimentaire, subit de nouvelles pertes de production agricole lorsque la guerre déclenchée par le FPR à partir du mois d'octobre 1990 provoque des déplacements importants de la population, surtout des paysans fermiers du Nord. C'est ainsi qu'en octobre 1990, l'on déplace au moins 300 000 personnes et, à partir de février 1993, encore une fois 1 million de personnes (29).
La balance commerciale, déficitaire depuis le début des années 80 se détériore encore davantage à partir de 1985 lorsque chute le cours mondial de l'étain, et son déficit s'accroît lorsque les prix du thé et du café baissent de 35 % et 40 % entre 1985 et la fin des années 80 (30). Le montant des exportations diminue régulièrement à partir de 1986 pour atteindre en 1991 la moitié de son niveau de 1986; cette baisse se poursuit jusqu'en 1994. Les importations montent en flèche en 1987 et 1988 pour baisser ensuite, puis reprendre leur envolée à partir de 1991. Entre 1991 et 1994, le montant des importations croît de 61 %.
La balance des comptes courants devient également déficitaire à partir du début des années 80 et son déficit s'accentue entre 1987 et 1990. En 1991, la balance des paiements n'est positive que grâce à la hausse des transferts.
Le PIB croît régulièrement mais semble plafonner à partir de 1989. En fait, sa croissance réelle, largement inférieure au taux de croissance moyen de 3,1 % estimé par les démographes, se réduit tout au long des années 80 pour devenir quasi nulle à partir de la sécheresse de 1989.
Au cours des années 80, le revenu par tête baisse de 2,3 % par an (31). En 1989, le niveau de revenu agricole par actif ne représentait plus que 70 % de son niveau en 1980 (32). La proportion de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté est passé de 40 % en 1985 à 53 % en 1992.
Mesuré simplement en termes d'augmentation de PNB par tête, le Rwanda s'en sortait assez bien, surtout si nous tenons compte de ses handicaps inhérents (nature fermée, pression démographique, manque de matières premières), et certainement en comparaison avec ses voisins (33). En comparaison avec ses pays voisins (Burundi, Zaïre, Ouganda et Tanzanie), le Rwanda occupait au niveau du PNB par habitant la dernière place en 1976 et la première en 1990. Les progrès étaient également remarquables dans d'autres domaines, comme par exemple l'infrastructure, avec un système routier qui peut être considéré comme l'un des meilleurs d'Afrique, une poste et un système de télécommunications sûrs, un approvisionnement en eau adéquat, une expansion du réseau électrique, etc.
Pendant les années 80, le Rwanda était considéré par la Banque mondiale et par d'autres comme une économie africaine réussie, avec une dette modérée comparée à celle de la plupart des autres pays du continent, au moins jusqu'à la seconde moitié de la décennie. (En 1987, la dette du Rwanda se montait à 28 % du PNB l'un des taux les plus bas d'Afrique). L'économie était équilibrée et la monnaie était assez stable, dans la mesure où elle servait de devise forte dans la région (34).
2.2.3.1. Mise en place du Programme d'ajustement structurel (PAS)
Pour tenter de redresser l'économie et de stimuler certaines restructurations, le Rwanda accepte en 1990 un Plan d'ajustement structurel de la Banque mondiale et du FMI. Il vise à stabiliser l'économie et à la rendre plus compétitive vis-à-vis de l'extérieur. Pour réaliser ces objectifs, le PAS implique une dévaluation du franc rwandais, jusqu'alors surévalué, il supprime les taxes à l'exportation (exceptées les taxes sur le café que le gouvernement rwandais maintient jusqu'en 1992) et, fixe des quotas d'importation.
Deux dévaluations du franc se succèdent (40 % en novembre 1990 et 15 % en juin 1992) pour stimuler la production intérieure à l'exportation et freiner les importations pour stimuler la production locale de produits de substitution aux importations.
Contrairement aux attentes, la dévaluation ne joue pas son rôle de stimulant au niveau du secteur productif et n'induit pas la hausse attendue du prix du café pour les producteurs car les mesures mises en place sont contrariées par la chute du cours du café.
En 1992, le cours du café est au plus bas : il atteint un plancher équivalent environ à 50 % de son montant en 1987 (35).
Le PAS impose des quotas d'importation. Mais, loin de freiner, les importations augmentent après le déclenchement de la guerre en octobre 1990. Le déficit externe s'aggrave.
La dette extérieure passe de 158 millions en 1980 à 1 milliard de dollars en 1996.
Au niveau interne, le déficit budgétaire de l'État, contenu jusqu'en 1986, s'accroît. De 21,4 milliards de francs rwandais en 1990 il double en trois ans et il atteint 41,3 milliards en 1993 (36). Le déficit résulte à la fois d'une diminution des recette fiscales et d'une flambée des dépenses. Lorsque chute le cours du café, les recettes provenant des taxes à l'exportation se réduisent. Les dépenses s'envolent : le Rwanda augmente notamment la taille de son armée, restreinte jusqu'alors.
La communauté internationale finance le déficit budgétaire. Certaines dépenses courantes ou en capital sont financées sous forme d'emprunts plutôt que sous forme de dons. La dette extérieure envers les principaux créditeurs (Banque mondiale et FMI) s'accroît à partir à partir de 1986 (37).
Le taux d'investissement productif passe de 23 % du PIB en 1980 à 12 % en 1990 (38). En moyenne, l'investissement n'est financé qu'environ pour un tiers (39) par l'épargne domestique, tandis que l'autre partie est financée par l'aide étrangère.
Le taux d'inflation atteint près de 20 % en 1991 puis baisse aux alentours des 10 % en 1992 et 1993 alors que sa moyenne durant les années 80 et jusqu'en 1990 est restée relativement basse (4,7 %/an). Les dévaluations ont eu des effets positifs pour la production de substituts aux importations (comme le riz) (40), mais ces effets restent locaux et restreints.
Le programme d'ajustement structurel imposé au Rwanda, qui n'est pas sans conséquence au niveau social, échoue, notamment face aux obstacles successifs de la conjoncture internationale et de l'inflation de dépenses d'armement.
Selon Maton, le processus de libération de l'économie rwandaise a été réalisé trop rapidement et le gouvernement n'a pas pu contrôler ses instruments pour protéger les paysans et éviter les conséquences sociales des dévaluations brutales successives et de la hausse des prix à la consommation (41).
2.2.3.2. Appauvrissement, inégalités croissantes et violence
Globalement le Rwanda s'est appauvri. Tous les revenus baissent, mais la crise de l'économie rwandaise s'est fait sentir de manière plus forte sur les revenus du secteur agricole que sur ceux du secteur non agricole. Les déficits alimentaires se sont accrus d'année en année et un ajustement de type malthusien était annoncé par les experts depuis de nombreuses années (42). Une première famine sévit en 1989, une seconde menaçait au cours du premier trimestre 1994 (43).
Ces famines reflètent les limites du modèle de gestion et d'exploitation des terres. Mais la rareté des terres peut-elle générer des violences ?
M. Degni-Segui a dénombré trois autres causes de violence :
le refus de l'alternance politique et du partage du pouvoir par le gouvernement en place;
l'incitation à la haine ethnique;
l'impunité (44).
Selon Maton, la rareté croissante des terres produit des violences à partir d'un certain seuil (45). Celui-ci aurait été dépassé malgré l'adaptation du monde paysan au contexte de forte pression démographique par l'adoption d'innovations techniques qui lui permettent de repousser les limites du système agricole et la découverte de ressources alternatives en dehors de celui-ci (46).
Selon d'autres économistes et démographes, la rareté des terres considérée comme telle n'est pas le facteur unique de violence mais, dans ce contexte de pression croissante sur les terres et d'appauvrissement grandissant, les inégalités de redistribution des rares ressources économiques peuvent être aussi sources et causes de tensions sociales croissantes (47). La paysannerie s'appauvrit au détriment d'une classe urbaine de fonctionnaires et commerçants, le dixième de la population le plus riche. Les termes de l'échange ville campagne se dégradent (48). Au sein du monde rural apparaît également une classe plus riche, jouissant de revenus extra-agricoles. Les inégalités croissantes engendrent des tensions sociales. La rareté croissante des terres et le développement du marché foncier engendre un processus de marginalisation et d'exclusion à la terre de certaines catégories de la population (49). Sans développement de secteurs formels et informels susceptibles d'absorber le surplus de main-d'oeuvre de l'agriculture, les tensions risquent de perdurer dans le secteur agricole.
La question des terres a donc, pour tous les observateurs, un rôle essentiel au Rwanda. Des efforts ont été menés pour faire baisser la pression sur les terres en ralentissant le taux de croissance de la population laissant entrevoir un abaissement du taux de fécondité. Mais les mesures de régulation des naissances n'ont pas été faciles à implanter dans ce pays. Selon le Joint evaluation Report, « the strong influence of the catholic church against population control measures, as well as the traditional position of women, are important explanatory factors for the high population growth » (50). L'opposition de l'Église catholique rwandaise à ces mesures s'est encore renforcée lors du voyage du pape Jean-Paul II en 1990, qui a condamné l'usage des techniques anti-conceptionnelles modernes à plusieurs reprises.
Cette opposition n'est pas sans poids. En effet, l'Église catholique a joué un rôle majeur dans l'histoire du Rwanda, et son influence a longtemps été prépondérante. Elle fut d'abord la pionnière de la colonisation, et travailla « main dans la main » avec les autorités allemandes puis belges. Après l'indépendance, son poids politique fut déterminant, l'interpénétration entre l'Église et l'État étant remarquable. Cette influence n'était pas qu'institutionnelle, elle reposait aussi sur le fait que l'élite politique était formée par les écoles catholiques et les séminaires. Un exemple flagrant de confusion entre l'Église et l'État rwandais est l'accession, au milieu des années 1970, de l'archevêque de Kigali, confesseur « officiel » de la femme du président Habyarimana et proche de l'AKAZU, au comité central du MRND (51). Il ne démissionera qu'en 1990, sous la pression de la hiérarchie romaine (51). C'est aussi en 1990 qu'une certaine prise de distance a eu lieu de la part d'une partie de l'Église, à l'initiative du bas-clergé, qui, dans un document rendu public, a mis en cause le système politique, et l'Église, « inféodée outre mesure aux autorités politiques »(53). En outre, le nonce apostolique était l'un des moteurs de la démocratisation. Mais les autorités tant de l'Église anglicane que de l'Église catholique sont restés étroitement liées au président et à son gouvernement pendant toute cette période (54).
2.2.3.3. Une économie de guerre à partir de 1990
Étant donné la pauvreté du pays, les experts ont toujours conseillé aux Rwandais de restreindre à un strict minimum les dépenses militaires, ce que le régime a fait (55). Jusqu'en 1989, le pourcentage de dépenses militaires du Rwanda était l'un des plus bas du continent africain. Au début de la guerre en octobre 1990, le Rwanda ne disposait que d'une troupe de quatre à huit mille hommes (56).
En 1994, les effectifs de l'année sont passés à 30 000 ou 40 000 hommes (les chiffres précis sont inconnus).
L'importance de cet effort de guerre se reflète dans le budget.
Le budget du ministère de la Défense nationale passe de 3 155 millions de francs rwandais en 1990 à 8 885 millions en 1992, soit une augmentation de 181%.
L'entièreté de l'accroissement de la dette publique (qui est passée de 6 678 millions en 1990 à 13 702 millions en 1992), est donc imputable aux dépenses militaires.
À la veille de la guerre, le Rwanda était confronté à un appauvrissement structurel de son agriculture. Le Programme d'ajustement structurel n'a pas envisagé l'ensemble du problème et les conséquences économiques de ses mesures : il a dérapé.
C'est sur ce terrain économique et social difficile que l'incitation à la violence ethnique s'est développé.
Plusieurs thèses cohabitent quant à l'histoire du peuplement du Rwanda.
Pour certains scientifiques, les Twas (aujourd'hui 1% de la population) étaient les premiers habitants du Rwanda (57). Ils vivaient de la chasse, de la cueillette et de la poterie. Les Hutus (aujourd'hui environ 85% de la population) se seraient installés plus tard à une époque indéterminée. Agriculteurs, ils défrichèrent une grande partie du pays (58), et refoulèrent les Twas dans les zones forestières subsistantes. Enfin, les Tutsis (aujourd'hui environ 14% de la population) , pasteurs, auraient immigré en vagues successives dès avant le XVe siècle de notre ère.
D'autres auteurs, dont J.P Chrétien, avancent l'hypothèse selon laquelle les Hutus et les Tutsis seraient arrivés en même temps.
Ces différentes hypothèses ne peuvent être vérifiées puisque la plus grande partie de la littérature ethno-historique « comprend des interprétations de sources, des ré-interprétations de celles-ci ou des ré-interprétations de ré-interprétations » (59). Quoiqu'il en soit, les Tutsis, qu'ils soient arrivés avec les Hutus ou après eux, parvinrent à asseoir de manière pacifique leur autorité sur les Hutus, dont ils partagent la langue et la culture. Possédant du bétail et une organisation politique très efficace, l'élite tutsie put consolider son autorité sur le Rwanda central, par le contrôle des richesses (terres et bétail) et des moyens de coercition (administration, justice, armée).
Le processus d'unification du Rwanda, composé de petits royaumes, s'est fait en une centaine d'années (60). Si le Royaume avait plus ou moins adopté les frontières du Rwanda actuel à la fin du règne de Kigeri IV Rwabugiri (plus ou moins 1860-1895), l'autorité du pouvoir monarchique central est différente suivant les régions. Elle est exercée de manière très indirecte dans les régions du nord et de l'ouest de la crête Zaïre. Le Rwanda était divisé en 80 provinces ou districts administratifs; ceux-ci comprenaient un nombre de collines administratives. L'administration d'un district était en principe confiée à deux fonctionnaires indépendants. Leurs autorités se reportaient à des matières différentes : le chef du sol (Umunyabutaka) s'occupait des redevances agricoles, et agissaient comme juge en matière de droit foncier; le chef du bétail (Umunyamukenke) percevait les taxes dues par les pasteurs.
L'organisation sociale était, dans le Rwanda central, basé entres autres sur le contrat d'ubuhake. Cette relation de clientélisme incluait des échanges réciproques de biens et de services. Le « patron » était la plupart du temps tutsi, mais le client pouvait être hutu ou tutsi de condition sociale inférieure. Une même personne pouvait être client ou « patron », suivant le rapport qu'elle entretenait avec d'autres (61). Dans les régions du nord et du sud-ouest dominées par les Hutus, différents systèmes coexistaient, la plupart dominés par des contrats fonciers ou des donations de produits agricoles. Les « patrons » étaient cette fois-ci essentiellement Hutus (62). Le Mwami, chef suprême, était le propriétaire éminent du sol, du bétail, des récoltes et de ses sujets. En cette qualité, ses pouvoirs, d'origine sacrée, étaient en théorie illimités. C'est dans ce contexte social et politique que les Européens pénétrèrent sur le territoire vers la fin du XIXe siècle.
Ce n'est qu'à partir de 1894 que des explorateurs, surtout allemands, se mirent à circuler dans le pays avec l'autorisation du Mwami. En 1894, le Mwami Yuyi Misinminga se plaça sous protectorat allemand. En 1900, la première mission catholique était fondée. En 1907, la résidence du Rwanda fut créée par les Allemands.
Lorsque les Belges prirent la relève en 1916, le bilan de l'occupation allemande se limitait à des mesures de pacification et de sécurité. Après la première guerre mondiale, l'occupation de la Belgique sur le « Ruanda-Urundi » est officialisée par un mandat de la SDN de type B. La décision des « principales puissances alliées et associées » de confier le mandat sur le Rwanda à la Belgique fut entérinée le 20 juillet 1922 par le Conseil de la SDN. La Belgique, en tant que puissance mandataire, utilisera, à l'instar des britanniques, l'administration indirecte comme méthode de politique coloniale. L'administration indirecte a été définie comme un système d'administration coloniale exercée par le biais d'institutions indigènes adaptées aux besoins des temps modernes (63). Le Gouvernement belge partait d'une idée assez générale : respecter les institutions politiques indigènes, mais les adapter et les utiliser dans la voie de la « civilisation ».
Dans cette politique, s'appuyant sur « l'hypothèse hamitique », l'administration coloniale belge privilégiera les notables tutsis, qui de par leurs caractéristiques physiques, n'avaient, pour les Européens, « du nègre que la couleur » (64). À l'époque coloniale, l'hypothèse selon laquelle les Tutsis étaient des Hamites était très répandue dans la littérature. L'« hypothèse hamitique » soutenait que « everything of value found in Africa was brought by the Hamites, alledgedly a branch of the Caucasian race » (65).
Dans l'enseignement, ce traitement discriminatoire vis-à-vis des Hutus était très visible, surtout dans les écoles secondaires qui formaient les cadres administratifs et politiques (Nyanza, Astrida). L'enseignement, devant mener à des fonctions dans l'administration, tant indigène que coloniale, admettait en majorité des enfants de notables tutsis (66).
En matière d'enseignement, l'église a joué, comme dans d'autres domaines, un rôle déterminant. Si elle a soutenu le principe de l'administration indirecte qui eut pour conséquence de favoriser la classe dirigeante, elle a permis à un nombre croissant de Hutus de poursuivre leurs études dans des petits et grands séminaires.
Néanmoins, une fois leurs études terminées, les Hutus qui ne voulaient ou ne pouvaient devenir prêtre retournaient à la vie laïque pour se heurter à un système politique et administratif incapable de les absorber.
Parallèlement, l'élite tutsie, formée par l'administration coloniale belge, commençait à s'organiser politiquement. En 1955, le Mouvement démocratique progressiste fut créé alors qu'en 1957 le mouvement social Muhutu fut fondé.
En février 1959, en la personne de Mgr. Perraudin, l'Église soutient les revendications hutues.
La révolution de 1959-1961, quelque peu assistée par « l'administration coloniale belge » (67), ébouchera sur l'éviction de la monarchie et de toute la structure politico-administrative tutsie, sur lesquelles la Belgique avait basé sa politique d'administration indirecte pendant toute la période coloniale. La mise en place définitive des institutions issues de la révolution eut lieu le 1er juillet 1962, date de l'indépendance du Rwanda (68).
Cette révolution rwandaise de 1959-1961, durant de nombreuses années, constituait un point de référence central dans la vie politique du Rwanda (69). Un grand nombre de Tutsis ont quitté le Rwanda lors d'une succession de crises et de périodes de tensions : en 1959-1961, en 1963-1964 et en 1973. Le nombre total des réfugiés et de leurs descendants jusqu'en 1990 a été estimé par Guichaoua à 600 000 (70). Cependant, la problématique des réfugiés ne sera jamais traitée réellement par le régime en place.
Par ailleurs, les Tutsis ont été exclus de la vie publique. Cette exclusion s'est opérée de deux manières différentes. D'une part, les partis tutsis ont subi le même sort que les autres partis d'opposition : ils ont été peu à peu éliminés. D'autre part, les Tutsis ont fait l'objet de discriminations et de nombreuses violations des droits de l'Homme. La « jacquerie de novembre 1959 » n'avait constitué qu'un début de violence à l'encontre des Tutsis (les événements de fin 59 ont fait des centaines de morts), mais ce bilan va s'alourdir progressivement au fil des crises successives. Les premières victimes ont été les chefs et sous-chefs tutsis. Par exemple, des 43 chefs et 549 sous-chefs tutsi en fonction, au début de novembre 1959, 21 et 314 respectivement ont été éliminés physiquement, destitués ou exilés (71). À l'issue des élections communales de juin-juillet 1961, les partis tutsis obtiennent 289 sièges de conseillers communaux sur un total de 3 125, c'est-à-dire 9,2 %. L'élimination physique continue au cours des grands événements politiques comme les élections communales de 1960 ou les élections législatives de septembre 1961.
La chasse « aux boucs émissaires » (72) tutsis continue en janvier 1964, suite à une attaque des réfugiés tutsi au Bugesera. Dans la seule préfecture de Gikongoro, on estime le nombre de victimes tutsis de 5 000 à 8 000 : entre 10 et 12 % de la population tutsi de la préfecture. En 1973, cette chasse recommencera.
Une troisième conséquence de la révolution sera la concentration du pouvoir entre les mains d'une minorité et l'instauration d'un autoritarisme croissant. Dès le début, le PARMEHUTU a activement poursuivi une politique visant à la marginalisation et à l'élimination des autres partis. Dans une allocution adressée à l'occasion du premier anniversaire de l'indépendance, le président Kayibanda a exprimé sa préférence pour « un parti majoritaire » flanqué d'une opposition très minoritaire (73). De fait, en 1965, le MDR-PARMEHUTU sera le seul parti à proposer des candidats aux élections législatives et présidentielles. Après l'élimination de l'opposition, la concentration du pouvoir se poursuit à l'intérieur du parti. À partir de 1968, les contradictions d'un régime forcé à un repli sur lui-même se multiplient. En 1972, l'usurpation du pouvoir par un petit groupe de politiciens hutus de Gitarama, la région du président Kayibanda, est complète (74).
À la fin des années 80, la « deuxième république », mise en place en 1973 à la suite d'un coup d'État militaire mené par le général-major Juvenal Habyarimana, semble à son tour s'essouffler. Les tensions montent dans ce pays présenté pourtant le plus souvent comme « un modèle de développement et un havre de paix » (75). Ces tensions ne sont pas uniquement ethniques. Le régime de Habyarimana a connu les mêmes dérives régionalistes que le gouvernement de son prédécesseur. C'est maintenant les préfectures de Gisenyi et de Ruhengeri qui sont favorisées dans l'accès au pouvoir. À l'aube des années 1990, on constate que, même s'il n'a pas disparu, le conflit ethnique est dépassé par un conflit à caractère régional nord-centre. Et à l'intérieur de la région dominante, des antagonismes sous-régionaux se font jour (notamment, dans le Nord, entre Gisenyi et Ruhengeri) (76).
À de nombreux égards, la Deuxième République contrastait fortement avec la première. Pour commencer, nous assistons à une période de modernisation nette, se manifestant dans une ouverture vers le monde extérieur, une croissance urbaine, des investissements, ainsi que dans les affaires. Alors que le régime de la Première République était tourné vers l'intérieur, celui de la Deuxième République adhérait à une politique d'ouverture du pays... Bien que loin d'être acceptable, la situation des droits de l'homme s'améliorait également. Par exemple, le nombre des prisonniers politiques était réduit et des efforts étaient faits pour limiter et contrôler l'usage injustifié et excessif de réglementations sur l'emprisonnement préventif et sur la limitation de la liberté de mouvement. Il faudrait en outre observer qu'aucune violence ethnique majeure n'a eu lieu entre l'ascension au pouvoir du général Habyarimana et la guerre d'octobre 1990. On oublie souvent aujourd'hui que le président Habyarimana était plutôt populaire parmi les Tutsis de l'intérieur et qu'il avait même été accusé par certains Hutus de favoriser les Tutsis (77).
Le professeur Reyntjens a également affirmé : « Vers la fin des années 1980, la corruption était limitée, les droits de l'homme étaient plus ou moins respectés et le pays disposait d'une vaste infrastructure. Contrairement à d'autres pays africains, le PNB du Rwanda ne cessait d'augmenter pendant la période de 1975 à 1990. Tous ces faits constituaient des raisons de travailler avec le régime. Vers la fin des années 80, l'usure du régime se fit sentir et on fit mention des pratiques zaïroises. » (78).
Le 1er octobre 1990, des Tutsis rwandais émigrés attaquent le nord-est du pays à partir de l'Ouganda. Les assaillants progressent rapidement à travers la région peu peuplée du Mutara dans le parc national de l'Akagera. La majorité des rebelles sont des déserteurs ougandais et se présentent comme la branche militaire du Front Patriotique Rwandais (FPR).
Certains observateurs s'interrogent sur la sagesse du RPF à entreprendre une action militaire à ce moment particulier (Prunier, 1993). L'invasion survenue seulement deux mois après les discussions supervisées par l'UNHCR et l'OUA sur le problème des réfugiés avait conduit à un troisième accord ministériel entre le Rwanda et l'Ouganda, qui aurait pu conduire à des résultats concrets, pendant un processus de libéralisation politique se développant graduellement au Rwanda. Il semble toutefois que si les négociations avaient pu conduire à une percée, le FPR n'était cependant pas prêt à attendre davantage; il était apparemment fatigué du blocage continu opposé par le gouvernement rwandais. Il est toutefois prouvé que le FPR a attaqué à ce moment-là car une éventuelle percée dans les domaines de la démocratisation, des droits de l'homme et du rapatriement des réfugiés aurait réduit la légitimité d'une attaque (79). Le professeur Reyntjens a également défendu cette même position pendant sa séance d'audition devant notre commission (80).
Pour faire face à cette situation, le 4 octobre 1990, la Belgique et la France décident d'envoyer des militaires dans le cadre d'une action qualifiée d'humanitaire et qui vise à protéger les ressortissants étrangers et permettre leur évacuation si nécessaire. Indirectement, il s'agit d'un soutien à la République, plus psychologique que militaire, vu les moyens réduits utilisés.
En Belgique, des informations sur l'arrestation de nombreuses personnes issues de l'opposition et sur la militarisation du régime rwandais sont publiées dans la presse et des oppositions à la présence militaire belge se manifestent rapidement, tant du côté libéral que du côté socialiste francophone. Un mois plus tard, le Gouvernement belge décide de retirer ses troupes. La Belgique se prononce alors en faveur d'une démocratisation du pays et une paix négociée.
Peu avant le conflit d'octobre 1990, le chef de l'État rwandais s'était efforcé d'adapter progressivement le régime aux nouvelles exigences de la politique internationale. Dans son discours du 5 juillet 1990, il annonce la création d'une commission nationale de synthèse, chargée d'organiser un dialogue national tout azimut, avec toutes les forces unies du pays. La commission est effectivement mise en place le 24 septembre 1990. La guerre éclate quelques jours avant le début des travaux de la commission. Son travail effectif ne commencera que le 23 octobre 1990. Le conflit accélérera considérablement ses activités. Alors qu'initialement le mandat de la commission devait s'étendre sur deux ans, le président Habyarimana lui demande de finir son travail avant la fin de l'année, et annonce qu'après un débat national, une charte politique sera soumise à référendum avant le 4 juin 1991.
Fin décembre 1990, la commission nationale de synthèse publie un avant-projet de la charte politique nationale (81). Il s'ensuit un large débat, qui débouche sur la publication d'un projet de charte à la fin du mois de mars 1991 (82). La Commission propose également un avant-projet de Constitution et deux lois sur les partis politiques.
Entre-temps, les fondateurs de nouveaux partis politiques commencent à s'organiser. Plusieurs groupes semblent se constituer et des réunions ont lieu durant les premiers mois de 1991. Mais les contacts politiques se déroulent dans une atmosphère de méfiance. C'est le mouvement démocratique républicain (MDR) qui se décidera le premier à avoir une activité politique ouverte. Dans un numéro de mars 1991, le journal Le Démocrate publie un « appel à la relance et à la rénovation du MDR » signé par 232 personnes. Dans les six mois qui suivent, d'autres formations vont se manifester : le Parti Social Démocrate (PSD), qui semble avoir sa base de soutien dans le sud; le Parti Libéral (PL) qui rassemble essentiellement des d'hommes d'affaires; le Parti Démocratique Chrétien (PDC), de taille plutôt réduite. Parallèlement à la reconnaissance formelle du multipartisme, l'ex-mouvement révolutionnaire national pour le développement (ex-Parti unique du Rwanda), rebaptisé Mouvement républicain national pour la démocratie et le développement (MRND) tente également de s'adapter à la nouvelle réalité en faisant peau neuve.
Dès le lendemain de la promulgation de la Constitution, un cartel de partis d'opposition se dessine. Dans un communiqué commun daté du 11 juin 1991, le PSD, le MDR et le PDC formulent l'ensemble des revendications qui formeront l'essentiel de leurs exigences politiques dans les mois qui suivent. Le 31 juillet 1991, la constitution du cartel est officialisée, et le PL, nouvellement créé, le rejoint. Les quatre partis décident la mise sur pied d'un « conseil de concertation des partis politiques démocratiques ». Le 13 octobre 1991, le président Habyarimana charge le ministre de la Justice, Sylvestre Nsanzimana, de la formation d'un gouvernement, sans tenir compte des exigences politiques des nouveaux partis de l'opposition. En effet, à part un ministre issu du PDC, le gouvernement est homogène MRND. Après une période tumultueuse où les manifestations de l'opposition se multiplient, un accord est négocié entre les partis d'opposition et le MRND. Le 2 avril 1992, le président Habyarimana désigne Dismas Nsengiyaremye comme formateur. Le 16 avril 1992, deux semaines après sa nomination, D. Nsengiyaremye annonce la formation de son gouvernement de transition. Le gouvernement de coalition sera composé du MRND, du MDR, du PSD, du PL et du PDC.
Si le gouvernement de transition semble marquer quelques points dans un premier temps, notamment le démarrage réel des négociations avec le FPR, le gouvernement est victime de profonds blocages. C'est dans ce contexte de guerre avec le FPR et d'opposition interne que la situation militaire se transforme graduellement en une démarche politique, incluant des négociations entre principalement le régime Habyarimana et le FPR. Dans cette perspective, l'opposition politique intérieure n'aura pas un poids considérable, étant donné sa profonde division au moment de la signature de l'accord d'Arusha.
Un mois environ après l'inauguration du nouveau gouvernement, des discussions préliminaires ont eu lieu à Bruxelles et Paris (mai et juin 1992) entre, d'une part, le MDR, le PSD et le LD et, d'autre part, le FPR. Les parties en présence ont convenu d'entamer des négociations de paix (à Arusha) non seulement pour réinstaurer le cessez-le-feu de N'sele, mais aussi pour débattre d'une avancée dans la voie de la démocratisation, de l'intégration du FPR dans le gouvernement et de réformes militaires.
Les négociations de paix entre le gouvernement rwandais et le FPR ont débuté le 10 août 1992. Elles ont été grandement facilitées par la Tanzanie, son président Ali Hassan Mwinyi ainsi que son ambassadeur, M. Ami Mpungwe. Les pays voisins du Rwanda, le Burundi et le Zaïre, ainsi que la Belgique, la France, l'Allemagne, les États-Unis, le Sénégal et l'OUA ont accepté d'envoyer des observateurs aux négociations d'Arusha qui s'ensuivraient.
Les négociations continueront pendant une année, pour aboutir le 4 août 1993. Pour rappel, l'accord d'Arusha est en fait une enveloppe qui contient de nombreux protocoles et accords :
l'accord de cessez-le-feu de N'sele (83); cet accord de cessez-le-feu est amendé à Gbadolite le 16 septembre 1991 (84);
le protocole d'accord sur l'État de droit signé le 18 août 1992;
les protocoles d'accords sur le partage du pouvoir dans le cadre d'un gouvernement de transition à base élargie, signés à Arusha, le 30 octobre 1992 et le 9 janvier 1993;
le protocole d'accord sur le rapatriement des réfugiés et la réinstallation des personnes déplacées, signé à Arusha le 9 juin 1993;
le protocole d'accord relatif à l'intégration des forces armées des deux parties, signé à Arusha le 3 août 1993;
enfin, le protocole d'accord portant sur les dispositions finales, signé à Arusha le 3 août 1993 (85).
Tous ces textes font donc partie intégrante de l'accord de paix d'Arusha.
L'article 3 de l'accord final prévoit que la Constitution de mars 1991 et l'accord de paix constitue « indissolublement » la loi fondamentale qui préside la période de transition. Cependant, la Constitution est hiérarchiquement inférieure à l'accord de paix. Non seulement 47 articles de la Constitution sont remplacés par des dispositions de l'accord de paix relative aux mêmes matières, mais encore il est prévu qu'en cas de conflit entre les autres dispositions de la Constitution et l'accord de paix, ces derniers prévalent. De fait, la Constitution est remplacée par l'accord de paix.
En ce qui concerne la personnalité du président de la République, celui-ci est « déshabillé », c'est-à-dire réduit à être un chef d'État cérémonial, disposant de pouvoirs moins étendus que la plupart des monarchies constitutionnelles. Par exemple, le gouvernement de transition à base élargie (le GTBE) n'est pas nommé par le chef de l'État mais par les partis politiques participant au gouvernement de coalition mis en place dès le 16 avril 1992 et le FPR.
Les pouvoirs du GTBE sont extrêmement étendus. Il combine en pratique les pouvoirs d'un chef d'État et d'un chef de gouvernement. Néanmoins, une relation de type de régime parlementaire existe avec l'assemblé nationale de transition (ANT). Tout comme le GTBE, la répartition numérique des sièges à l'ANT est fixée : le MRND, le FPR, le MDR, le PSD, le PL obtiennent onze sièges chacun, le PDC, quatre et les autres partis agréés (une dizaine) auront un siège chacun.
L'intégration des forces armées des deux parties est également traitée : la nouvelle armée nationale contiendra 9 000 hommes, dont les forces gouvernementales fourniront 60 % des effectifs et celles du FPR 40 % à tous les niveaux, sauf aux postes de commandements. Dans ce dernier niveau, de l'état-major jusqu'au bataillon, chaque partie est représentée par 50 %, conformément au principe de l'alternance.
Dans le protocole d'agrément entre le gouvernement de la République du Rwanda et le FPR concernant l'intégration des forces armées des deux parties, il est également précisé à l'article 72 que l'établissement des institutions de transition prendront place après le déploiement de la force international neutre. Cette condition n'a pas été appliquée puisqu'il a été impossible de déployer un contingent de quelques casques bleus en 37 jours. Nous verrons par la suite que ces institutions de transition, ne seront jamais mises en place, faute d'accord entre les parties...
La durée de transition est divisée en deux phases. Dans un premier temps, les institutions de transition seront mises en place dans les 37 jours qui suivent la signature de l'accord de paix, c'est-à-dire le 10 septembre 1993 au plus tard. La durée de transition est de 22 mois, à compter de la date de la mise en place du Gouvernement de transition à base élargie (GTBE) avec la possibilité d'une prolongation déterminée dans les circonstances exceptionnelles par l'Assemblée nationale de transition (ANT) à la majorité des trois cinquièmes de ses membres.
Sous forme de documentation, il est utile de reprendre quelques extraits de la première étude du « Joint evaluation of emergency assistance to Rwanda » et du livre du professeur G. Prunier « The Rwanda Crisis 1959-1994 ».
Environnement physique
Avec une superficie d'un peu plus de 26 000 km2 , le Rwanda est un des plus petits pays d'Afrique, comparable en taille à son voisin du sud, le Burundi, et à son ancien colonisateur, la Belgique. Situé juste au sud de l'équateur, il est enclavé entre le Zaïre, l'Ouganda, la Tanzanie et le Burundi. Souvent appelé le « Pays des Mille Collines » ou la « Suisse africaine », le Rwanda est dominé par des chaînes montagneuses et les hauts-plateaux de la grande ligne de partage des eaux entre le bassin du Nil et celui du Zaïre (ligne de partage des eaux Congo-Nil). La partie centrale fort peuplée qui s'étend de Ruhengeri au nord à Butare au sud est située entre 1 500 et 2 000 m au-dessus du niveau de la mer. À l'ouest du plateau central, la ligne de démarcation Congo-Nil atteint des altitudes pouvant dépasser 2 500 m, les points culminants étant situés dans la chaîne volcanique de Virunga au nord-ouest du pays. À cet endroit, le Karasimbi culmine à 4 507 m. Situé à une altitude de 1 460 m au-dessus du niveau de la mer, le lac Kivu, qui sépare le Rwanda du Zaïre, est le lac le plus élevé d'Afrique. À l'est du plateau central, plus précisément de la capitale, Kigali, jusqu'à la frontière tanzanienne, le relief s'adoucit progressivement mais atteint encore malgré tout 1 000 à 1 500 m dans bon nombre de zones plus élevées.
Division administrative
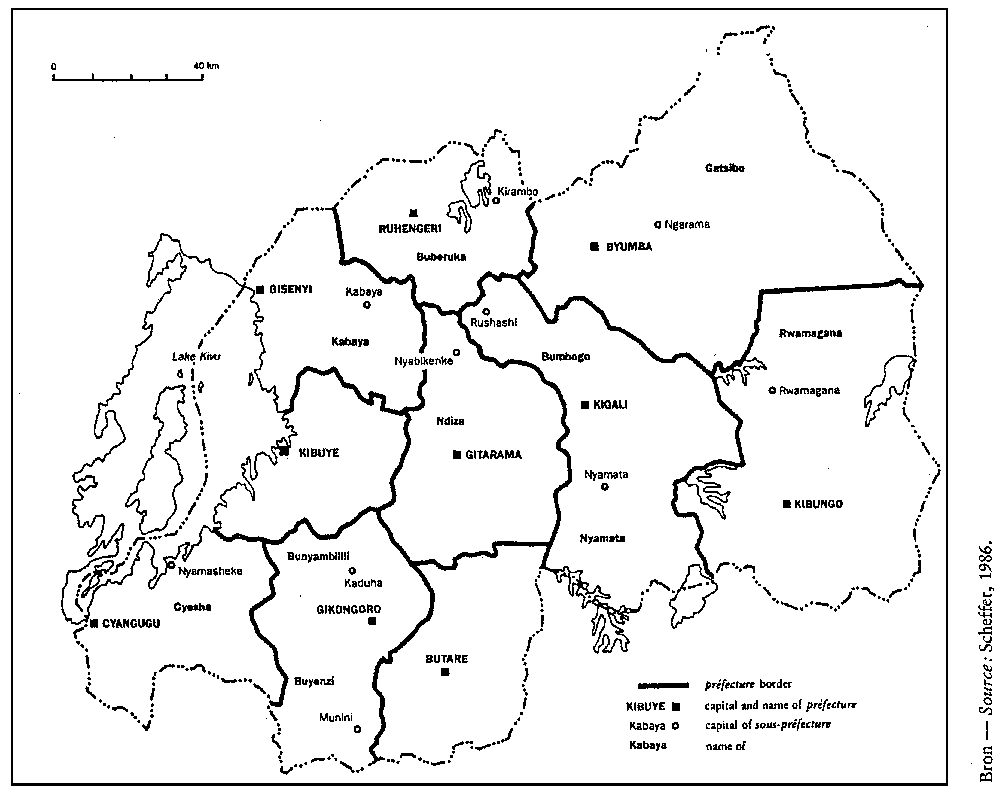
Bron Source : Scheffer, 1986.
Bien que le Rwanda soit situé juste sous l'équateur, ce pays jouit d'un climat modéré grâce à son altitude. La température moyenne annuelle à Kigali est de 19 degrés Celsius et ne fluctue que modérément entre la saison des pluies et la saison sèche. Le Rwanda bénéficie de précipitations abondantes d'octobre à juin, suivies d'une courte saison sèche qui s'étend de juillet à septembre. Les précipitations moyennes mensuelles sur le plateau central atteignent 85 millimètres, ce qui permet des cultures diversifiées sur chaque lopin de terre disponible. Le climat tropical modéré permet deux à trois récoltes par an, ce qui a donné à certaines parties du pays un potentiel de production agricole inégalé dans la plupart des pays africains.
Le Rwanda est un pays enclavé dont l'économie est dépendante d'un axe de communication coûteux et vulnérable traversant la Tanzanie ou l'Ouganda et le Kenya vers l'océan Indien situé à environ 1 500 km ou le Zaïre vers la côte atlantique située à environ 2 000 km.
Quelque 10 % du territoire rwandais a fait l'objet d'une mesure de protection comme parc naturel ou réserve forestière. Ce pourcentage est nettement plus élevé que dans les autres pays africains. Les parcs les plus connus sont Virunga à la frontière zaïroise au nord-ouest et Akagera à la frontière tanzanienne à l'est. Le parc Virunga, rendu célèbre par le film « Gorilles dans la Brume » abrite les derniers gorilles des montagnes tandis que les savanes de l'Akagera constituent le biotope d'une faune aussi variée que celle des parcs à gibier plus connus du Kenya ou de Tanzanie.
Sur le plan de l'organisation administrative, le Rwanda a été divisé en 10 préfectures dirigées chacune par un préfet nommé par le président de la République. Les préfectures sont elles-mêmes subdivisées en 143 communes dirigées par un bourgmestre. Les bourgmestres sont également désignés par le président.
Densité de la population
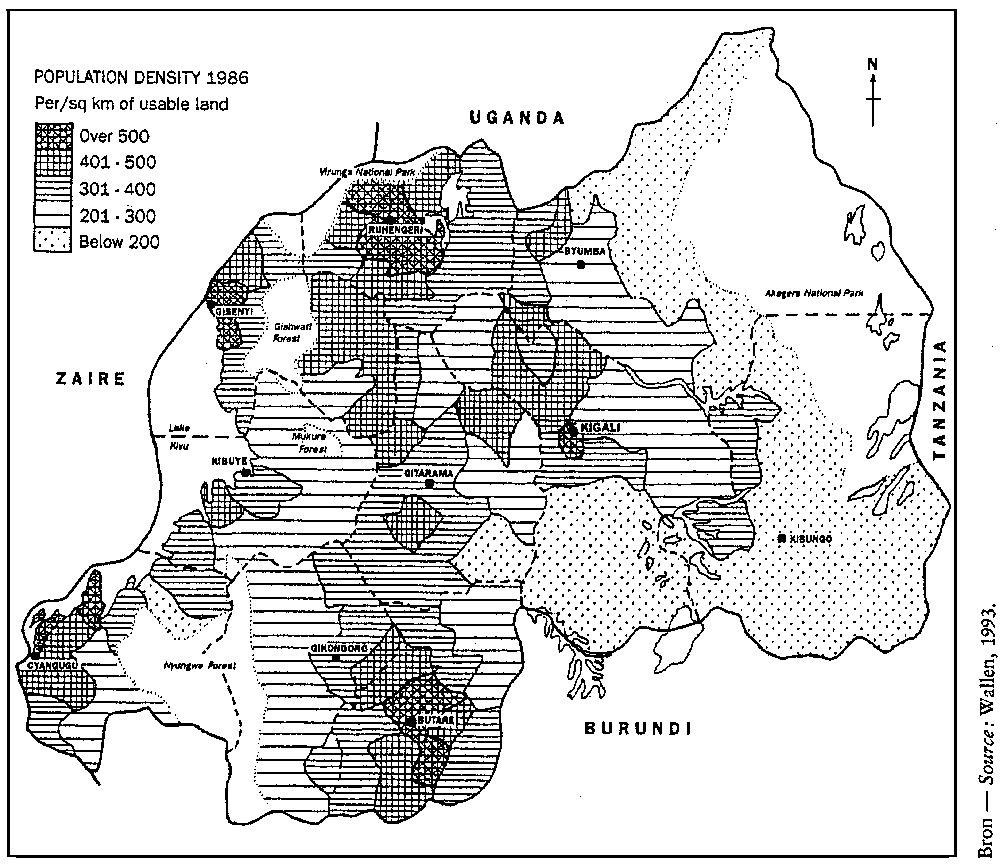
Bron Source : Wallen, 1993.
Caractéristiques socio-démographiques
Selon le recensement de 1991 organisé en août de cette même année, le Rwanda compte une population totale de 7,15 millions d'habitants qui évolue selon un taux d'augmentation annuel de 3,1 %. Ceci se traduit par une densité de population très élevée. En fait, avec 271 habitants au km2 , le Rwanda arrive en tête des pays d'Afrique continentale. Si l'on faisait abstraction des lacs, des parcs nationaux et des réserves forestières, ce chiffre serait beaucoup plus élevé. La superficie réelle de terres arables (environ 17 600 km2 sur une superficie totale de 26 300 km2) doit donc nourrir en moyenne 406 habitants au km2 dans l'ensemble du pays. La zone la plus peuplée est la région de Ruhondo dans la préfecture de Ruhengeri, qui compte quelque 820 personnes au km2 utile. À l'autre extrémité de l'échelle, on trouve Rusomo (Kibungo) qui ne compte que 62 habitants au km2 utile (République Rwandaise, 1993, II).
Les raisons historiques qui expliquent la densité de population élevée du Rwanda sont légion. La terre est fertile, le climat agréable. De plus, la zone montagneuse offre une excellente protection. La forteresse naturelle formée par les hauts plateaux a servi de bouclier contre les envahisseurs hostiles tels que les marchands d'esclaves swahilis venus au XIXe siècle de la côte de l'océan Indien. Ajoutons à cela des structures militaires d'une grande efficacité et l'on comprend pourquoi la société rwandaise a été une des rares en Afrique à avoir été épargnée par les ravages du commerce d'esclaves par les Arabes et les Européens. La traite des esclaves n'a donc pas affecté sa population qui a en fait augmenté sous la pression des autres peuples venant y chercher refuge (Waller, 1993; Prunier, 1995). De plus, l'influence considérable de l'Église catholique opposée aux mesures de contrôle de la population ainsi que le statut traditionnel de la femme sont des facteurs importants permettant d'expliquer la forte poussée démographique.
Le Rwanda est un pays de fermiers cultivateurs ou plutôt de jardiniers à grande échelle. La question cruciale des terres sera exposée ci-dessous. Mais il convient déjà de noter que nombre d'observateurs lient la tragédie de 1994 à la forte pression démographique et à la compétition croissante pour disposer des moyens de subsistance. Pour reprendre les mots de Prunier (1995) :
« La décision de tuer a bien sûr été prise par les politiciens pour des raisons politiques. Mais une des raisons pour lesquelles les paysans ont pris part aux massacres (...) est notamment le sentiment que la population était trop nombreuse sur un territoire trop exigu et qu'ils seraient plus nombreux à survivre avec moins de bouches à nourrir... » (Prunier 1995).
Selon le recensement de 1991, la population résidente du Rwanda se composait de 90,4 % de Hutus (soit 6,5 millions d'habitants), 8, % de Tutsis (soit 0,6 million d'habitants) et 0,4 % de Twas (soit environ 30 000 habitants). En règle générale, les commentateurs s'accordent à dire (à quelques exceptions près) que ces chiffres reflètent la réalité. Ils correspondent également aux résultats obtenus en extrapolant les chiffres sur la base du recensement précédent et des chiffres d'immigration. L'historique des rapports entre Hutus et Tutsis est abordé ci-après. Il convient de noter ici que la minorité marginalisée des pygmées Twas se compose en fait de deux groupes : ceux vivant de la vente de leurs poteries et ceux vivant du produit de la chasse et de la cueillette. Ce dernier groupe, également connu sous le nom Impunyu, compte moins de 5 000 personnes et est concentré dans les préfectures de Ruhengeri et Gisenyi. Ils sont souvent exploités et méprisés par leurs concitoyens rwandais.
En 1991, le Rwanda comptait environ 1,5 million de ménages composés en moyenne de 4,7 membres. La prédominance de l'agriculture et d'un mode de vie traditionnel est soulignée par le fait que pas moins de 94,6 % de la population vit dans les campagnes tandis que près des deux tiers de la population urbaine sont concentrés à Kigali. Le Rwanda est donc un pays rural dont les habitants vivent en majorité de l'agriculture dans les collines (musozi en kinyarwanda). Ces agriculteurs forment la base de la société rwandaise. Il en a résulté une forme très précise et particulière d'implantation : le paysan rwandais Hutu ou Tutsi fait partie d'un rugo qui peut se traduire approximativement par enceinte, enclos, maisonnée (dans un ménage polygame, chaque femme occupe son propre rugo ). Chaque colline se compose de plusieurs ingo (pluriel de rugo ) où Tutsis et Hutus cohabitent traditionnellement sur les mêmes pentes, « pour le meilleur et pour le pire; les mariages mixtes et les massacres » (Prunier, 1995).
Le recensement de 1991 a montré que 48 % de la population était âgée de moins de 15 ans et que l'espérance moyenne de vie était de 53,1 ans. Parallèlement c'est-à-dire avant les massacres et les bouleversements démographiques de 1994/1995 plus de 20 % de la population adulte sexuellement active dans les zones urbaines était infecté par le virus HIV (The Economist Intelligence Unit, 1995). Les femmes sont contaminées à un âge plus jeune et en plus grand nombre que les hommes. Selon les estimations, 100 000 à 200 000 Rwandais en bas âge mourront du sida avant l'an 2000.
Une grande partie de la population rurale souffre de maladies endémiques telles que la bilharziose, la diarrhée, la dysenterie et des infections respiratoires. Les maladies liées à l'eau sont la principale cause de mortalité infantile. Selon les estimations de la Banque mondiale, le taux de mortalité infantile a chuté de 142 pour 1 000 en 1970 à 117 pour 1 000 en 1992. En 1992, quelque 1,5 million de Rwandais n'avaient pas accès aux services sanitaires; 2,6 millions n'avaient pas l'eau potable et 3,2 millions étaient privés de sanitaires (The Economist Intelligence Unit, 1995).
La langue officielle de l'administration est le français mais la population communique dans le langage véhiculaire national qu'est le kinyarwanda et le swahili qui est la lingua franca des commerçants (les réfugiés originaires d'Ouganda et de Tanzanie parlent également l'anglais). Selon le recensement de 1991, 44 % de la population était analphabète, le taux d'illettrisme étant plus élevé chez les femmes (50 %) que chez les hommes (37 %). Selon les estimations de la Banque mondiale, 71 % des Rwandais en bas âge fréquentaient l'école en 1991 contre 68 % en 1970. Mais seulement 8 % ont un diplôme secondaire et moins d'1 % un diplôme supérieur.
L'Église catholique a joué un rôle crucial dans l'histoire du Rwanda. En un certain sens, il serait plus approprié de qualifier la colonisation du Rwanda d'entreprise des « Pères Blancs » de l'Église catholique française plutôt que de l'Empire germanique. Ils débarquent au Rwanda en 1899 et en quelques années installent plusieurs missions aux quatre coins du pays. Durant la période coloniale, l'Église catholique a travaillé main dans la main avec les autorités allemandes et belges et, après l'indépendance, la situation politique a été caractérisée par un degré élevé d'interpénétration entre l'Église et l'État.
Les fondateurs du nationalisme hutu moderne au nombre desquels figurait le futur président Grégoire Kayibanda, faisaient tous partie de la petite élite des « évolués » sortis des écoles catholiques et du séminaire. Vers la moitié des années '70, l'archevêque de l'Église catholique romaine, Vincent Nsengiyumwa, devint membre du comité central du parti MRND au pouvoir, confesseur officiel de l'épouse du président Habyarimana et proche de l'akazu , le noyau dur des nationalistes hutus.
La forte présence du christianisme au Rwanda doit être vue sous cet angle. Selon le recensement de 1991, 90 % de la population était d'obédience chrétienne, dont 63 % de catholiques, 19 % de protestants et 8 % d'adventistes. L'Islam remporte un certain succès à Kigali et dans d'autres centres urbains, mais son importance marginale à l'échelle du pays représente à peine plus de 1 % de la population.
Enfin, les données sur l'emploi sont incomplètes puisque seulement 4 % de la population rwandaise vit dans l'économie monétaire. Les statistiques de la Banque mondiale pour l'année 1985 suggèrent que 93 % de la force de travail travaille dans le secteur agricole (chiffre nettement supérieur à la moyenne subsaharienne), 3 % dans l'industrie et 4 % dans le secteur des services. Au début des années '90, le principal employeur dans le secteur officiel était l'administration publique qui occupait alors environ 7 000 employés dans l'administration centrale et 43 000 agents dans les administrations locales, sans tenir compte du personnel des forces armées.
L'immense majorité des paysans-cultivateurs travaillent pour leur propre compte; ni l'administration, ni le timide secteur industriel ne peuvent absorber l'augmentation annuelle de la population active. C'est donc le secteur agricole qui a dû supporter la croissance démographique rapide qui a dépassé dans de nombreuses régions la progression du rendement agricole. Rares sont donc les ménages ruraux à survivre uniquement de l'agriculture. En 1990, le gouvernement a estimé que 81 % d'entre eux avaient une activité lucrative d'appoint telle que la fabrication de briques, la menuiserie et la couture. De plus, presque tout le monde avait un pied dans l'économie parallèle ou « le marché noir », ne fût-ce qu'occasionnellement. Sont visés ici le commerce et le troc transfrontaliers ou la contrebande avec les pays voisins (The Economist Intelligence Unit, 1995).
La distribution des terres
Déjà en 1984, 57 % des ménages ruraux du Rwanda exploitaient une parcelle de moins d'un hectare et 25 % une parcelle de moins d'un demi-hectare, ce qui devait leur permettre de nourrir une famille moyenne de cinq personnes. Sous l'effet de la croissance démographique, les lois en matière de succession divisant entre les fils restants les droits de la famille d'utiliser le sol, ne firent que contribuer davantage à réduire la taille des parcelles de plus en plus fragmentées en parcelles minuscules disséminées dans des zones plus vastes. Au début des années '90, le ménage rwandais moyen exploitait donc au moins cinq parcelles possédant des caractéristiques variables en termes de fertilité, d'accessibilité et de forme de propriété.
Le ménage doit produire sur ces diverses parcelles une réserve de nourriture constante tout au long de l'année, ce qui nécessite parfois des décisions très complexes. Il est préférable de ne pas se limiter à un seul type de culture, afin que, par exemple, des cultures riches en substances hydrocarbonées, comme les pommes de terre, viennent compléter des cultures riches en protéines, telles que les haricots. De plus, le fermier doit tenir compte de la fertilité requise pour chaque culture, des cultures résistant à des sols plus pauvres, etc. Une étude (citée par Waller, 1993) a ainsi démontré que, pour préserver la fertilité du sol, des fermiers établis dans le sud du Rwanda ont cultivé 14 légumes différents selon environ 50 rotations.
Sous la pression démographique, un système d'une telle complexité est difficile à maintenir et, au cours des années '80, un nombre croissant de familles n'ont plus pu se permettre de laisser leurs parcelles se régénérer par des périodes de jachère. Il en a résulté une baisse de fertilité du sol et des stratégies de survie à court terme, telles que l'utilisation des pentes les plus abruptes tout en sachant pertinemment que ces pratiques n'étaient pas viables. Au début des années '90, la moitié de l'agriculture rwandaise était située sur des pentes de plus de 10 % d'inclinaison où les précipitations emportaient souvent le sol et les plantations. Ceci entraîna à son tour un regain de malnutrition et de pauvreté chez une partie croissante des paysans. Un rapport du Ministère de l'Agriculture de 1984 dénombrait 5,5 millions d'agriculteurs au Rwanda. Chaque personne consomme en moyenne 49 grammes de protéines par jour (à comparer à la norme minimale de 59 grammes recommandée au niveau international). En 1989, la population agricole atteignait 6,5 millions mais la prise quotidienne moyenne de protéines était retombée à 36 grammes par personne (Waller, 1993).
Le statut de la femme
Comme dans d'autres pays africains, le statut légal de la femme au Rwanda est ambigu. La Constitution de 1991 dispose que tous les citoyens sont égaux tout en reconnaissant la validité de la loi traditionnelle dans les zones dépourvues de codification écrite. Cette loi traditionnelle comprend la question importante des successions. Le principal problème, c'est que la loi ne considère pas la femme comme légalement « compétente » mais qu'elle ne reconnaît que l'homme comme chef du ménage. Une femme peut acquérir l'usufruit d'un terrain en vertu d'une donation de ses parents ou par voie d'héritage si elle n'a pas de frère, mais une fois qu'elle se marie, ses avoirs deviennent la propriété du mari et si le mariage s'achève par un divorce, elle n'a aucun moyen de les récupérer. Si son mari vient à décéder, la femme n'hérite de rien. En effet, la femme ne peut légalement rien posséder, ni maison, ni outils, ni bétail, ni cultures. Cette absence de statut légal pose des problèmes particuliers dans les ménages ruraux dirigés par des femmes célibataires (22 % en 1984). Dans le secteur moderne de l'économie, l'incapacité légale de la femme signifie qu'elle ne peut ouvrir un compte en banque sans le consentement de son mari ou si elle n'est pas mariée d'un parent mâle. Si l'on ajoute à cela l'incapacité de posséder un avoir, il lui est quasiment impossible d'obtenir un prêt.
Dans le domaine du gouvernement et de l'administration, il n'y a pas eu de femme ministre jusqu'au gouvernement de coalition en 1992. Il n'y a pas eu non plus de femmes préfets ou bourgmestres; 97 % des femmes économiquement actives sont des agricultrices qui ont la responsabilité de nourrir leur famille et de gérer la quasi-totalité des aspects du ménage, y compris des activités telles que la couture, le sarclage et la récolte en plus des corvées eau et bois. Au début des années '90, les femmes accomplissaient 54 % des tâches agricoles et avaient en moyenne 20 % de temps libre en moins que les hommes. Malgré cela, 38 % des femmes rurales n'avaient jamais eu aucun contact avec un agent gouvernemental d'extension agricole (Waller, 1993).
Ces derniers temps, les femmes rwandaises ont pris de plus en plus conscience de l'injustice de leur statut social. Des associations de femmes travaillant ensemble dans les zones rurales ont donc gagné en force au cours des années '80. Au sein de ces associations, les femmes ont acquis un statut légal de facto leur permettant d'avoir accès au crédit et de posséder des terres. Mais les femmes n'ont pas eu d'influence modératrice dans la culture conservatrice à domination mâle pendant les périodes d'agitation politique et de bouleversements comme en 1994.
Économie
Exception faite des sites hydroélectriques sous-exploités, les ressources naturelles du Rwanda sont assez limitées et l'économie s'est développée presque exclusivement autour de deux cultures rémunératrices : le café et le thé. Le secteur manufacturier a pris de l'importance depuis l'indépendance en partant quasiment de zéro pour atteindre environ 16 % du produit intérieur brut (PIB) en 1992. Avant les troubles de 1994 qui ont fortement touché l'infrastructure industrielle, le management et la force de travail, les principales branches couvraient la production de boissons et de denrées alimentaires, de détergents, de produits textiles et d'outils agricoles tels que des houes et des machettes.
Selon les chiffres de la Banque mondiale, le PIB du Rwanda a connu une croissance annuelle moyenne impressionnante en termes réels de 4,7 % entre 1970 et 1979, croissance suivie d'un ralentissement qui l'a fait retomber à 2,2 % de 1980 à 1988. En 1989, le PIB a enregistré une baisse marquée due à la chute des recettes de la vente de café. Le déclin s'est poursuivi en 1991, 1992 et 1993 et a été particulièrement marqué en 1994 pour les terribles raisons que l'on sait. Le PIB par habitant était estimé à USD 200 en 1993 contre USD 330 en 1989, soit une baisse de l'ordre d'environ 40 % en seulement quatre ans (The Economist Intelligence Unit, 1995).
Le café est la principale ressource du Rwanda. La principale variété cultivée, l'arabica , est classée dans la catégorie « autres légers » sur le marché mondial. C'est l'administration belge qui a introduit le café au Rwanda dans les années 1920. Les Belges ont planté du café en abondance et ont décrété que les taxes étaient payables en espèces plutôt qu'en nature afin de forcer le développement de cette culture. Par la suite, les autorités coloniales ont rendu la culture du café obligatoire en de nombreux endroits, cette loi étant demeurée virtuellement inchangée jusqu'à ce jour (The Economist Intelligence Unit, 1995). Depuis son introduction dans le pays, la production de café se développa jusqu'à dépasser les 42 000 tonnes en 1986, atteignant ainsi 82% des recettes totales d'exportation du Rwanda. Mais en raison de l'effondrement des prix du café en 1989 et de la guerre d'octobre 1990, cette part n'a fait que régresser. Elle n'était plus que de 51 % en 1992 et sera sans doute nettement moindre après la tragédie de 1994 qui a laissé les cultures de café dévastées, délaissées et malades dans tout le pays. On estime qu'il faudra trois ans pour les remettre en état.
Tous les producteurs de café du Rwanda sont des petits cultivateurs qui sont obligés de faire pousser du café sur leurs parcelles. [Au Rwanda, les terres appartiennent à l'État. Les paysans n'ont que le droit d'utiliser la terre, sans droit de propriété, et l'État peut la récupérer pour son propre usage, sans devoir aucune compensation pour les pertes occasionnées (Waller, 1993)]. En 1989, le Rwanda comptait près de 700 000 cultivateurs de café, soit environ 60 % de l'ensemble des petits cultivateurs, chacun cultivant 150 caféiers en moyenne. Pendant la plus grande partie des années '80, le gouvernement leur a assuré un prix garanti de 125 francs Rwanda (RWF) au kilo, ce qui veut dire que jusqu'en 1987, le prix payé aux producteurs était moins élevé que les prix élevés pratiqués sur le marché mondial, ce qui a permis au gouvernement de faire des gains plantureux sur le commerce du café. Or, le cours mondial du café se mit à baisser et, en 1989, le Rwanda, à l'instar d'autres petits pays producteurs de café, fut gravement affecté par l'effondrement de l'accord international sur le café qui entraîna à son tour une chute des cours sur le marché londonien, ramenant le prix du café à son cours de la moitié des années '80. C'est dans ce contexte que le gouvernement rwandais réduisit le prix payé aux producteurs à 115 RWF le kilo. De plus, dans le cadre du programme d'ajustement structurel imposé en 1990 par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI), la monnaie nationale dut dévaluer de 40 %. Une nouvelle dévaluation de 15 % fut opérée en juin 1992.
Bien que la restructuration fût inévitable, elle a eu pour effet, du point de vue du paysan rwandais, de rendre la culture du café encore moins attrayante qu'auparavant. En un an de 1989 à 1990 le paysan moyen réagit à la crise en augmentant considérablement sa production pour finalement se retrouver avec un manque à gagner de 20 %. Comme la récolte de café à l'hectare rapportait en monnaie locale nettement moins que, par exemple, les bananes ou les haricots, nombre de paysans rwandais arrachèrent leurs caféiers par désespoir pour se tourner vers d'autres cultures (Waller, 1993).
Outre le café, le thé est devenu lui aussi une source importante de devises étrangères, passant de 9 % des recettes d'exportation en 1986 à 30 % en 1992. À l'inverse du café, le thé se cultive essentiellement dans les grands domaines qui, à une exception près, sont tous la propriété du gouvernement. Les plantations de thé couvrent ensemble 1 % du territoire cultivé. À certains endroits tels que Nkuli (Ruhengeri), les cultures de thé ont été introduites dans des zones précédemment occupées par des paysans locaux. Les récoltes annuelles entre 1988 et 1992 ont oscillé autour de 13 000 tonnes. Toutefois, à l'instar des récoltes de café, les récoltes de thé ont été gravement affectées par la guerre qui a éclaté en octobre 1990.
Globalement, les années '80 ont été marquées par le déclin spectaculaire de l'économie rwandaise et, à la fin de cette décennie, l'économie avait régressé dans chaque secteur-clé : croissance du PIB, balance des paiements, ratio échanges commerciaux/endettement. La stagnation du PIB a déjà été commentée ci-dessus. La balance des paiements s'est également détériorée à partir de 1985 et en 1989 la valeur des biens importés était 3,5 fois supérieure à la valeur des exportations. Cette situation s'explique largement par le déclin des termes de l'échange du Rwanda ou de son pouvoir d'achat international, qui a reculé de 47 % entre 1980 et 1987. Rares sont les pays à avoir connu un recul aussi prononcé au cours de la même période. Enfin, la dette externe (USD 189 millions en 1980) a augmenté d'une manière quasi constante tout au long des années '80 pour grimper en 1992 jusqu'à USD 873 millions (Waller, 1993; Vassall-Adams, 1994 et The Economist Intelligence Unit, 1995).
Les programmes d'ajustement structurel de 1990 et 1992 ont coïncidé avec la guerre qui débuta par l'invasion du Front patriotique rwandais en octobre 1990. Il est donc difficile d'évaluer leur impact macro-économique. Indépendamment des déboires des paysans producteurs de café, tout indique que l'introduction de coûts élevés notamment pour les soins de santé et l'éducation n'a fait qu'alourdir les charges déjà écrasantes des pauvres au Rwanda (Vassall-Adams, 1994; Marysse, 1993 et 1994).
La guerre a eu un effet dévastateur sur l'économie rwandaise. D'abord, elle a provoqué le déplacement de milliers de paysans vers le nord du Rwanda, avec des répercussions dramatiques pour la production de café et de denrées alimentaires. Ensuite, elle a coupé la route vers le port kenyan de Mombasa, le principal axe de communication entre le Rwanda et le reste du monde. De plus, elle a détruit l'industrie touristique naissante du pays, qui était devenue la troisième source de devises étrangères du pays. Enfin, elle amena le gouvernement à développer considérablement ses forces armées, réduisant ainsi les ressources nationales disponibles à d'autres fins (Vassall-Adams, 1994).
Ce chapitre, basé sur la documentation recueillie par des historiens concernant le développement du Rwanda pré-colonial, va dans plusieurs directions. D'une part, il souligne la diversité « ethnique » fondée en partie sur le statut professionnel et en partie sur la relation patron/dépendant, mais aussi sur l'ascendance Hutu/Tutsi. D'autre part, il rappelle que jusqu'à l'apparition des descriptions écrites réalisées par les premiers voyageurs européens, l'individu s'identifiait par rapport à son clan plutôt que par son appartenance ethnique et que cette description des groupes dits ethniques est le fait de ces voyageurs. Comme dans bon nombre de régions d'Afrique, en l'absence de sources écrites, de vestiges archéologiques, etc., les données historiques fiables antérieures au milieu du XIXe siècle sont chose rare.
La plupart des historiens s'accordent à dire que les premiers habitants du Rwanda vivaient de la chasse et de la cueillette et habitaient les forêts. Leurs descendants modernes sont les Twas qui ne constituent plus aujourd'hui qu'une faible minorité. Leur arrivée remonte à 2000 avant J.-C. Outre la chasse, ils pratiquent la poterie et la vannerie. Vers l'an 1000 après J.-C., l'arrivée de paysans, les Hutus, les contraignit à se déplacer. Cette migration s'inscrivait dans le cadre de l'expansion bantoue qui, dans le cas du Rwanda, peut être située des savanes du Cameroun actuel jusqu'à la région des Grands Lacs. Ces paysans ont défriché les forêts et cultivé le sol volcanique sombre et fertile (Vansina, 1962 et de Heusch, 1966).
Les agriculteurs immigrés d'expression bantoue cultivaient le sorgho, élevaient du bétail et des abeilles, chassaient et développèrent des industries villageoises. Ils portaient des peaux de chèvre et des vêtements tannés. Ils s'organisèrent en lignages et en clans placés sous le commandement de chefs de lignage et de chefs de clans (d'Hertefelt, 1962). Les Hutus ont cohabité avec les Twas et ont troqué des peaux et de la viande contre du sel et des objets en fer.
Au XVe siècle, une grande partie des Hutus étaient organisés en mini-États contrôlés chacun par un clan dominant et composés de plusieurs lignages sous l'autorité d'un lignage dirigeant (qui, au fil du temps, devint une dynastie) avec à sa tête un mwami (chef ou roi) qui était un chef temporel et spirituel chargé de faire tomber la pluie (Vansina, 1962). Il semblerait que certains lignages avaient déjà acquis du bétail à cette époque et que l'on avait assisté à l'émergence de plusieurs États avant l'immigration des Tutsis (principalement le clan Nyiginya ). Kagame (1972) estime qu'à ce stade, sept grands clans avaient un statut pré-Nyiginya .
Le Rwanda actuel, considéré comme une entité géopolitique composée de plusieurs mini-États, émergea d'après les historiens entre le XIe et le XVe siècle, en grande partie sous l'effet de l'immigration et l'implantation d'éleveurs tutsis. À partir du XVe siècle environ, le nombre d'éleveurs augmenta considérablement dans les États existants.
Les Tutsis semblent appartenir à un mouvement migratoire plus vaste d'éleveurs vers le sud dans la région des Grands Lacs (Bauman, 1948; d'Hertefelt, 1962). Les avis divergent sur la question de savoir si l'immigration vers le Rwanda a été graduelle ou soudaine. Mais au fil du temps, les Tutsis s'implantèrent à la fois par voie de conquête et d'assimilation (Lemarchand, 1970; d'Hertefelt, 1962; Kagame, 1972; Vansina, 1962; Ogot, 1984 et Reyntjens, 1985).
Il convient de distinguer deux phases d'interaction entre Hutus et Tutsis. L'immigration des Tutsis dans les zones hutues aurait commencé, selon les descriptions, par une infiltration graduelle et pacifique. Des têtes de bétail étaient échangées contre des produits agricoles et ces échanges constituèrent la base des échanges sociaux. Cependant, la coexistence pacifique était généralement suivie de conquêtes qui débouchaient sur le placement des territoires conquis sous l'administration directe et le régime militaire des Tutsis (Lemarchand, 1966; Vansina, 1962). Cette phase a été suivie d'un processus visant à acquérir le contrôle direct des facteurs de production, en ce compris la restriction graduelle de l'accès au sol, au bétail et au travail (C. Newbury, 1974; d'Hertefelt, 1962 et Vidal, 1969).
Pendant une période de 400 ans, toute une série d'unités politiques hutues ont donc été réduites au rang d'entités administratives et les Hutus se sont transformés en ce qui serait décrit plus tard comme une catégorie « ethnique » (Lema, 1993). L'on entend souvent dire qu'il y a environ 20 générations, l'est du Rwanda était sous la domination politique d'un clan tutsi, le clan Nyiginya . Au fil des siècles, ce clan forma un noyau étatique qui s'élargit vers l'ouest jusqu'à couvrir la plupart du territoire actuel (D. Newbury, 1987). L'histoire des territoires périphériques diffère dès lors de celle du centre du pays. Le Rwanda est donc un pays caractérisé par de fortes variations régionales. Ce sont surtout les régions du nord, les actuelles préfectures de Gisenyi et Ruhengeri, ainsi que certaines parties du sud-ouest qui se situent hors du noyau étatique rwandais.
Dans la foulée, les Hutus ont assimilé les Tutsis qui ont repris à leur compte la langue parlée par les Hutus (kinyarwanda) et intégré les traditions et les cultes hutus. De plus, ils partagent les mêmes collines il n'y avait pas de ségrégation , les mariages interethniques étaient fréquents et les membres des deux ethnies portaient les mêmes noms (Lemarchand, 1970; Rennie, 1972; Oliver, 1977 et Reyntjens, 1985).
Durant la période pré-coloniale ou avant le XIXe siècle, les Tutsis, les Hutus et les Twas correspondaient globalement aux catégories professionnelles. Les éleveurs de bétail, les soldats et l'administration étaient majoritairement aux mains des Tutsis tandis que les Hutus étaient les paysans. Les Twas ont été marginalisés et souvent maltraités par les autres ethnies. Les Hutus et les Tutsis sont plus difficiles à distinguer et les individus pouvaient changer de catégorie au gré de leur bonne fortune. Bien que la domination des premiers Tutsis Nyiginya soit indéniable, une série d'institutions ont fait office de médiateur dans les relations sociales, en particulier le système des clans qui sous-tendait l'ensemble de la société rwandaise. Dix-neuf clans comprenaient les membres des trois groupes ethniques. D'aucuns affirment que jusqu'environ la moitié du XIXe siècle, l'appartenance au clan a en fait primé l'appartenance au groupe ethnique (tutsi, hutu, twa) (d'Hertefelt, 1971; D. Newbury, 1980; C. Newbury, 1978).
Les premiers voyageurs européens qui arrivèrent dans le centre du Rwanda observèrent une stratification socio-économique et « ethnique » entre Tutsis, Hutus et Twas. Les Tutsis étaient décrits comme une ethnie distincte par son origine, ses activités économiques, son statut social et son apparence physique, bien que partageant le même langage, la même religion et les mêmes lieux d'implantation que les Hutus (von Götzen, 1895; Kandt, 1921). Cette description des « groupes ethniques » rwandais basée en partie sur la méthodologie indigène , soutenue et diffusée par les étrangers, agents coloniaux, ethnologues, anthropologues, historiens, etc., finit par représenter la vision qu'a l'Occident du peuple rwandais. Or, il s'avère que les Rwandais s'identifient plus volontiers en fonction de leur identité personnelle qu'en fonction de leur appartenance au clan. Plusieurs études de David Newbury ont montré que si les termes « Hutu » et « Tutsi » existaient durant la période pré-coloniale, ils n'avaient toutefois pas la même signification qu'aujourd'hui et que le sens de l'identité « ethnique » varie d'un endroit à l'autre et d'une époque à l'autre. Il n'existe aucune définition universelle de l'identité ethnique qui puisse s'appliquer à toutes les régions à la fois (D. Newbury, 1979, 1980; C. Newbury, 1988).
Le processus de fusion des mini-États en un Rwanda unifié a duré plusieurs centaines d'années. L'État Nyiginya dans l'est du Rwanda commença une lente expansion par voie de conquête et en monnayant sa protection contre un tribut. Il faut attendre la seconde moitié du XIXe siècle pour voir apparaître le Rwanda comme pays unifié sous le mwami Kigeri Rwabugiri. Sous son règne, le mwami était la source et le symbole de toute autorité dans un État politiquement centralisé. Certains États plus petits conservèrent leur autonomie jusqu'en 1910-1920. Tel fut par exemple le cas de la région septentrionale à proximité de Ruhengeri, qui n'a été intégrée dans la monarchie rwandaise que sous le régime colonial allemand. Il a fallu plusieurs expéditions militaires des Schutztruppe allemandes assistées de Tutsis du centre du Rwanda entre 1910 et 1912 pour défaire les Hutus du nord connus sous le nom de Kiga , causant ainsi un fort ressentiment envers les Tutsis et les Hutus du sud, appelés Banyanduga , qui les avaient accompagnés (Dorsey, 1994; Waller, 1993). Aujourd'hui, les Rwandais du nord constituent donc une sous-culture distincte dans laquelle les contacts avec les Tutsis ont été moins fréquents et la conscience d'un passé pré-tutsi plus aiguë que dans les autres parties du Rwanda (Lemarchand, 1970 et 1995).
Le règne de Rwaburigi ou Kigeri IV dura de 1860 à 1895, soit juste avant l'arrivée du colonialisme européen, et marque un grand tournant dans l'histoire du Rwanda. Rwabugiri passa outre des contraintes traditionnelles et accrut les prérogatives du trône. Il est considéré comme le dernier grand réformateur et souvent qualifié de grand roi guerrier. Sa politique intérieure poursuivait un double objectif, à savoir la centralisation du pouvoir et l'extension des structures politiques centrales vers la périphérie du royaume. Dans le domaine de la politique extérieure, il mena une série de campagnes militaires dirigées contre les mini-États hutus dans l'ouest et dans l'est du Rwanda qu'il finit par annexer à son royaume. Les parties situées au nord et au sud-ouest conservèrent par contre un large degré d'autonomie. Pour saper le pouvoir héréditaire détenu par les anciennes familles tutsies, Rwabugiri limogea les officiels en place et nomma des hommes qui dépendaient directement de lui, notamment dans les régions qui avaient joui d'une certaine indépendance, renforçant ainsi les ressources matérielles à la disposition de la monarchie (Dorsey, 1994).
Ce qu'il faut retenir des efforts de développement de l'État sous le règne de Rwabugiri, c'est qu'ils ont renforcé la conscience des différences « ethniques » au Rwanda. C. Newbury explique :
« Avec l'arrivée d'autorités centrales, les critères de distinction ont été modifiés et accentués, dès lors que les catégories hutues et tutsies ont admis les nouveaux accents hiérarchiques associés à la proximité de la cour centrale, la proximité du pouvoir. Plus tard, lorsque l'arène politique s'est élargie et que l'activité politique a gagné en intensité, ces classifications se sont de plus en plus stratifiées et rigidifiées. Plus qu'un véhicule dénotant la différence culturelle par rapport aux Tutsis, l'identité hutue finit par être associée puis assimilée à un statut inférieur » (C. Newbury, 1988).
Relations patron/dépendant
Le ciment qui a uni la population est l'institution du ubuhake une relation fortement personnalisée entre deux individus de statut social différent (Maquet, 1954). Cette relation patron/dépendant implique des liens réciproques de loyauté et d'échange de biens et services. Elle fournissait une place, un statut, dans un système hiérarchique. Le patron était généralement Tutsi, mais le dépendant pouvait être un Hutu ou un Tutsi de statut social inférieur. Une même personne pouvait être à la fois patron et dépendant. Même les patrons Tutsis de Hutus pouvaient être dépendants d'un autre Tutsi. En théorie, la seule personne qui n'était pas un dépendant dans ce système était le mwami lui-même. Donc, la plupart des Tutsis étaient dépendants et certains Hutus étaient patrons. Au sommet de la pyramide, il y avait toujours un Tutsi et au bas de la pyramide un Hutu et/ou un Twa. Cette relation institutionnalisée a été renforcée sous le régime colonial et n'a été abolie qu'à la fin des années '50 (Saucier, 1974; C. Newbury, 1988).
Le système ubuhake et l'ordre social qui va de pair ont prédominé dans le centre du Rwanda où l'influence tutsie était la plus forte. Dans les régions à domination hutue dans le nord et le sud-ouest, plusieurs systèmes se sont développés, basés pour la plupart sur des baux à ferme ou sur la donation de produits agricoles. Les patrons étaient souvent Hutus; dans le nord, tous les patrons étaient Hutus (d'Hertefelt, 1962; Vansina, 1962). Cependant, la prédominance du bétail comme forme de richesse utilisable signifiait que les chefs de bétail sont parvenus à dominer le centre du Rwanda. Mobiliser une armée nécessitait du capital, qui se présentait uniquement sous la forme de têtes de bétail; or les Tutsis contrôlaient le bétail. Dans ces régions, les Hutus avaient presque tous le statut de dépendant.
L'ubuhake (et d'autres formes de relation patron/dépendant telles que l'uburetwa ) a eu des effets importants : 1) en institutionnalisant les différences économiques entre les Hutus en majorité cultivateurs et les Tutsis éleveurs de bétail; 2) en servant d'instrument de contrôle qui a fait des Hutus des dépendants socio-économiques et politiques et des Tutsis des patrons; et 3) en conduisant à un processus d'amalgame « ethnique », en particulier chez les Hutus. Il en a résulté une dichotomie « ethnique » hutue-tutsie qui s'inscrivait dans le prolongement du processus socio-économique et politique engendré par l'extension et l'occupation tutsies (Lema, 1993).
Plusieurs historiens mettent cependant en doute que la relation patron/dépendant ait été une pierre angulaire de la formation sociale traditionnelle hutue-tutsie, étant donné que les clans rwandais se composaient de plusieurs castes et ethnies. Ils font remarquer que les 19 clans les plus importants comprennent aussi bien des Hutus que des Tutsis (Vidal, 1985; d'Hertefelt, 1971; C. Newbury, 1987; D. Newbury, 1980). Par exemple, les Hutus ne partageaient pas le sentiment d'appartenance à un peuple ou une identité. À cet égard, le système a plutôt débouché sur une différenciation et une stratification économique entre les différentes professions.
Groupes ethniques dans le Rwanda pré-colonial
À la fin du XIXe siècle, le mwami , dirigeant de l'État rwandais, possédait l'ensemble des terres et du bétail. Il régnait en despote mais s'entourait d'un conseil politique de grands chefs et d'un conseil permanent appelé abiru (spécialistes du rite) qui le conseillait sur les obligations divines liées à sa charge (Vansina, 1962). Selon les 500 ans de la chronologie mwami , tous les bami (pluriel de mwami ) étaient Tutsis (Kagame, 1957; Vansina, 1962). Aucun d'eux n'était marié à une femme Hutue, ce qui a toute son importance puisque la reine mère jouait un rôle capital dans la société traditionnelle. Il semblerait que les grands chefs aient également été Tutsis (Lema, 1993) tandis que les spécialistes du rite qui composaient l'abiru étaient des Hutus s'inspirant des anciens rites hutus (de Lacger, 1939; Vansina, 1962).
Le mwami faisait office de juge et de cour suprême dans la société rwandaise traditionnelle. Les cours inférieures étaient la cour administrative et la cour militaire. La cour administrative tranchait les litiges relatifs à l'occupation du sol et était dirigée par le chef de terre tandis que la cour militaire, présidée par le chef de l'armée, tranchait les litiges relatifs au bétail. Le mwami et tous les chefs d'armée étaient Tutsis, de même que la quasi-totalité des chefs de bétail (Vanhove, 1941). Quant à l'armée, bien que composée sur une base multi-« ethnique », elle était clairement stratifiée de manière à ce que tous les postes soient attribués par ordre décroissant d'importance aux Tutsis, aux Hutus et enfin aux Twas pour les grades inférieurs. Il n'y avait donc pas de partage du pouvoir dans les activités de l'armée : le commandement, comme la plupart des autres institutions de l'État, était mono- ou uni-ethnique tutsi (Lema, 1993; Adekanye, 1995).
Vers la fin du XIXe siècle, plusieurs régions du royaume rwandais avaient développé une structure administrative complexe et hautement organisée englobant les provinces, les districts, les collines et les quartiers (Vansina, 1962). Les provinces étaient normalement administrées par les hauts chefs ou les commandants d'armée qui étaient toujours des Tutsis. Les districts étaient administrés par deux chefs désignés par le mwami : un chef du bétail ayant la charge de collecter les impôts auprès des pasteurs et un chef de terre ayant la charge de collecter les impôts auprès des agriculteurs (Pagès, 1933; de Lacger, 1939; Kagame, 1952 et Maquet, 1961). Les chefs de bétail étaient normalement Tutsis et les chefs de terre Hutus (Kagame, 1957 et 1975). Les districts étaient divisés en collines administrées par des chefs chargés de transmettre les taxes aux deux chefs de district. Le Rwanda n'avait pas et n'a toujours pas de villages au sens de concentration d'habitat (C. Newbury, 1978). La colline était l'unité administrative de base et comptait non pas un mais trois chefs, à savoir :
le chef des pâturages (toujours un Tutsi) chargé de délimiter les droits de pâturage;
le chef de terre (presque toujours un Hutu) chargé des problèmes d'agriculture et des taxes foncières; et
le chef des hommes (généralement un Tutsi) qui collectait les impôts et qui était une espèce d'agent de recensement pour les abagaba , les recruteurs de l'armée du mwami (Kagame, 1975).
Les trois fonctions étaient souvent enchevêtrées : une même personne pouvait remplir les trois fonctions mais sur des collines différentes. Ou elle pouvait n'en remplir qu'une seule ou deux. (Les paysans jouaient sur les rivalités entre chefs, caractéristique essentielle de la survie des paysans, qui disparut à la suite des réformes du gouverneur Voisin à la fin des années 1920. Depuis ces réformes, chaque colline doit être administrée par un seul chef) (Prunier, 1995).
Il s'ensuit que l'État rwandais se transforma en structure dominée par les Tutsis, construite pour asseoir leur pouvoir politique. Les Hutus ne participaient à l'administration qu'aux niveaux intermédiaire et inférieur. Ils recevaient les ordres et les normes, ils n'arrêtaient pas les normes. Il n'y a donc guère de marge d'intégration « ethnique » dans les échelons supérieurs de l'appareil de l'État (Lema, 1993).
Lorsqu'en 1916, la Belgique occupa le Rwanda-Urundi à la suite de sa campagne est-africaine contre l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale, les deux royaumes du Rwanda et du Burundi n'avaient fait l'objet que d'une administration marginale par Berlin depuis 1899. En 1914, il y avait en tout et pour tout six fonctionnaires allemands au Burundi et cinq au Rwanda, soit un total de onze fonctionnaires pour administrer un territoire qui fait le double de la Belgique. S'étant rendu compte que les royaumes mwami existants fonctionnaient comme des nations à part entière avant l'arrivée des Européens et, sans aucun doute, guidés par une pénurie de personnel colonial, les Allemands décidèrent dès le début de favoriser une politique de régime indirect. L'occupation se traduisit par des « traités » de protectorat négociés entre les Allemands et les mwami (Reyntjens, 1994). Le système politique existant qui était beaucoup plus fort et plus centralisé au Rwanda qu'au Burundi, allait donc jouer à plein (Louis, 1963).
La Belgique poursuivit cette politique : un décret du 6 avril 1917 disposait que « sous l'autorité du commissaire résident, les sultans (bami ) exercent leur pouvoir politique et judiciaire dans la mesure où il reste en accord avec les coutumes indigènes et avec les instructions du Commissaire royal » (Rumiya, 1992).
Après la Première Guerre mondiale, la Belgique reçut le Rwanda en mandat de la Société des Nations et, en 1946, ce pays devint un territoire belge sous tutelle des Nations Unies. Pendant les 40 années d'administration belge, comme dans la plupart des régimes coloniaux, on observe une désintégration, une distorsion ou une corruption des structures sociales et politiques indigènes avec toutes les conséquences qui en découlent. Par exemple, alors que la relation pré-coloniale indigène patron/dépendant était flexible et contenait un élément important de réciprocité, le colonisateur belge a en fait rigidifié le système en supprimant les obligations réciproques. En « renforçant » une institution rwandaise, le colonisateur a ainsi introduit le travail forcé et renforcé les divisions socio-économiques entre Tutsis et Hutus. On peut citer des exemples similaires de détournement d'autres institutions pré-coloniales. Balandier décrit ce phénomène comme suit : la tombée en désuétude des entités politiques traditionnelles, la détérioration générale consécutive à la dépolitisation, l'effondrement des systèmes traditionnels de contrôle du pouvoir, l'incompatibilité entre le système de pouvoir et l'autorité et, enfin, les abus de pouvoir (Balandier, 1978). L'intéressant ici, c'est la mesure dans laquelle ces développements ont affecté les relations inter-ethniques au Rwanda.
La thèse hamitique se généralisa parmi les fonctionnaires et les missionnaires européens actifs dans la région des Grands Lacs au début du siècle. Selon cette thèse, « tout ce qui a de la valeur en Afrique a été introduit par les Hamites, branche supposée de la race caucasienne » (Sanders, 1969). Lorsque le célèbre explorateur britannique John Speke arriva dans le royaume de Buganda (aujourd'hui l'Ouganda) qui était doté d'une organisation politique élaborée, il attribua cette civilisation à une race indigène de nomades pasteurs apparentés aux « Hamites » Galla (éthiopiens). L'attrait de cette hypothèse pour les Européens réside dans le fait qu'elle permet d'établir un lien entre les caractéristiques physiques et les capacités mentales : les « Hamites » étaient supposés être des leaders nés et avaient, en principe, droit à une histoire et à un futur presque aussi nobles que ceux de leurs « cousins » européens (Linden, 1977). Au Rwanda, les Hamites étaient les Tutsis : « ils ne ressemblent aux nègres que par leur couleur de peau » (Jamoulle, 1927); « avant de devenir des noirs, ils avaient le teint hâlé » (de Lacger, 1961); « sa stature est plus proche de celle d'un blanc que de celle d'un nègre en fait, il ne serait pas exagéré d'affirmer que c'est un Européen qui a la peau noire... » (Gahama, 1983). Cette thèse raciste a été déclinée sur d'innombrables registres mais elle se résume à considérer les Tutsis comme apparentés aux Européens, si bien que les Européens pourront facilement travailler avec eux. Cette thèse servait donc également la politique coloniale du diviser pour régner (Adekanye, 1995).
Vers la fin des années 1920, la thèse hamitique connut une utilisation qui allait modifier radicalement les relations interethniques au Rwanda. Dans le cadre d'un processus de réformes administratives (qui connut son apogée avec le Programme Voisin en 1926-1931), consistant notamment à regrouper et à agrandir le territoire des chefs (il ne restait plus dans le nouveau système que 40 chefs sur 200), il fut décidé d'accorder un traitement préférentiel aux Tutsis dans le recrutement des autorités politiques indigènes. Il semblerait que la position tranchée adoptée sur la question par Monseigneur Leon-Paul Classe, vicaire apostolique au Rwanda, eut une influence considérable. Dans une lettre datée du 21 septembre 1927, il écrivait à Georges Mortehan, le Commissaire belge résident, en ces termes :
« Si nous voulons être pratiques et défendre l'intérêt réel du pays, nous trouverons un élément remarquable de progrès en la personne des jeunes Mututsis [...] Demandez au Bahutu s'il préfère recevoir des ordres de personnes frustes ou de la bouche de nobles et la réponse sera claire : ils préféreront les Batutsis, et avec raison. Chefs nés, ils sont faits pour commander. [...] Voilà le secret qui leur a permis de s'implanter dans ce pays et de le tenir sous leur emprise » (de Lacger, 1961).
Face à ce qu'il considère comme des « hésitations et des atermoiements de l'administration coloniale concernant l'hégémonie traditionnelle des Batutsis bien-nés », Monseigneur Classe adresse en 1930 une mise en garde sévère rédigée en ces termes :
« Le plus grand tort que le gouvernement pourrait se causer à lui-même et infliger au pays serait de supprimer la caste mututsie. Une telle révolution conduirait le pays tout droit à l'anarchie et à un communisme vicieusement anti-européen. Loin d'être un vecteur de progrès, ceci annihilerait toute action du gouvernement dès lors que ce dernier serait privé d'auxiliaires capables de compréhension et d'obéissance de par leur naissance. [...] Nous ne saurions avoir de chefs meilleurs, plus intelligents, plus actifs, plus capables de comprendre l'idée du progrès et plus susceptibles d'être acceptés par la population que les Batutsis » (Classe, 1930).
Le message du vicaire apostolique fut compris comme un fervent plaidoyer en faveur d'un monopole tutsi, du moins en principe. Son intervention mit fin aux « hésitations » et aux « atermoiements » de l'administration. Les chefs et assistants-chefs hutus furent démis de leurs fonctions et remplacés par des Tutsis. De plus, le pouvoir mena une politique vigoureuse protégeant et renforçant l'hégémonie tutsie. De ce fait, bien que les Hutus et même les Twas exerçaient traditionnellement une partie du pouvoir, fût-ce à des niveaux inférieurs, la « tutsification » des années 1930 conféra aux Tutsis un monopole du pouvoir politique et administratif. Conjuguée à l'abolition de la triple hiérarchie des chefs (chef d'armée, chef de bétail et chef de terre), cette politique ne fit qu'accentuer les divisions ethniques (Reyntjens, 1985). L'introduction de la carte d'identité en 1933 vint encore ajouter un peu d'huile sur le feu : chaque Rwandais était désormais enregistré (sur la base de critères assez arbitraires) comme Tutsi, Hutu ou Twa (Reyntjens, 1985).
Enfin, les possibilités des Hutus furent encore limitées davantage par la discrimination introduite dans les écoles catholiques, qui représentaient le système scolaire dominant pendant toute la période coloniale. Les Tutsis qui avaient résisté à la conversion furent inscrits de plus en plus nombreux dans les écoles des missions catholiques. Pour adapter et encourager davantage ce processus, l'Église ajusta sa politique d'enseignement en favorisant ouvertement les Tutsis et en discriminant les Hutus. À quelques exceptions près, les Hutus ne recevaient que l'éducation requise pour le travail à la mine et dans l'industrie (C. Newbury, 1988).
Bref, la monopolisation du pouvoir entre les mains des Tutsis constitua un facteur crucial et indiscutable de l'enracinement (« structuration ») du clivage ethnique. Cette intervention coloniale transforma les groupes en catégories politiques distinctes. Dans un certain sens, nous avons affaire ici à un cas d'ethnogenèse (Roosens, 1989) qui, dans le cas du Rwanda, allait immanquablement entraîner une réaction de la part des Hutus exclus du pouvoir. Le discours tutsi a tiré des conclusions démesurées des allégations d'ethnogenèse en soutenant qu'avant l'arrivée des Européens, le peuple du Rwanda (et du Burundi) était assez homogène et que par leur politique du diviser pour régner, les autorités coloniales ont délibérément introduit des clivages ethniques. Or, les groupes ethniques existaient avant la colonisation. La politique coloniale n'a fait que se greffer sur une fondation qui contenait déjà en elle les germes de conflits potentiels (Reyntjens, 1994).
À partir de la moitié des années 1950, les exigences politiques commencent à être formulées en termes ethniques au Rwanda. Des thèses opposées furent exprimées de manière assez stéréotypée dans trois documents principaux : d'une part, le Manifeste des Bahutus du 24 mars 1957 et, d'autre part, deux lettres des grands chefs tutsis (« Abagaragu b'ibwami bakuru ») (Nkundabagenzi, 1961). Replaçant le problème ethnique dans un contexte social, le Manifeste des Bahutus revendique l'émancipation des Hutus ainsi qu'un processus de démocratisation. Partant de la thèse colonialiste selon laquelle les Tutsis sont des étrangers et revendiquant que les Hutus (en majorité) sont les véritables citoyens du Rwanda et donc les dirigeants légitimes du Rwanda, le manifeste est une déclaration importante tant pour la révolution sociale de 1959 que pour l'accentuation du clivage ethnique. Ce document capital publié au départ sous le titre « Notes sur l'aspect social et le problème racial indigène au Rwanda » et destiné à influencer une mission des Nations Unies en visite dans le pays, a été rédigé par neuf intellectuels hutus. Parmi les signataires, Grégoire Kayibanda, le futur président. Ce manifeste s'attaquait à tout le concept de l'administration belge et soutenait que le problème fondamental du Rwanda est un conflit entre Hutus et Tutsis d'origine hamitique, donc étrangère (Dorsey, 1994; Prunier, 1995). Les deux lettres écrites par les grands chefs conservateurs (et qui n'exprimaient pas forcément le point de vue de l'ensemble de l'élite politique tutsie) rejetaient la participation hutue « parce que nos rois ont conquis le pays des Bahutus, tué leurs `petits' rois et donc assujetti les Bahutus; comment peuvent-ils alors se prétendre nos frères ? » (Reyntjens, 1994).
Lors de la création des partis politiques à la fin des années 1950, les structures politiques étaient déjà établies selon le clivage ethnique : le Parmehutu (Parti du mouvement de l'émancipation des Bahutus) et l'APROSOMA (Association pour la promotion sociale des masses) étaient principalement hutus tandis que l'UNAR (Union nationale rwandaise) et le RADER (Rassemblement démocratique rwandais) étaient essentiellement tutsis. Lors des élections législatives de septembre 1961, ce clivage fut confirmé : les partis hutus obtinrent environ 83 % des suffrages, ce qui correspond à peu près à la proportion de Hutus dans la population. En d'autres termes, une majorité démographique se doublait d'une majorité politique. À partir de 1965, consécutivement à l'élimination de l'opposition (élimination en partie physique, en partie par des moyens politiques), le Rwanda devient de facto un État dirigé par un parti unique monoethnique (hutu) par essence (Reyntjens, 1985).
Du règne du mwami Rwabugiri jusqu'à l'abolition de la monarchie en 1961, le royaume du Rwanda a été un État hautement organisé et stratifié. Les réformes communales de la période coloniale ne firent que renforcer cette situation. La dernière grande réforme communale qui remonte à 1960, confirmait une nouvelle fois la structure hyperorganisée de l'État rwandais. Le pays fut divisé en 10 préfectures elles-mêmes subdivisées en un certain nombre de communes. Celles-ci, au nombre de 143 au total, formaient la base du développement. Les communes étaient divisées chacune en 4 à 5 secteurs, eux-mêmes subdivisés en « cellules » (10 cellules par secteur). S'inspirant du modèle tanzanien, l'unité organisationnelle finale est la cellule de 10 ménages comprenant 80 personnes. Rares sont les pays africains à être aussi bien organisés et à utiliser leurs structures de manière aussi intensive que le Rwanda (Reyntjens, 1985).
Transition vers l'indépendance
La révolution de 1959-1961 soutenue par l'administration belge (Harroy, 1984; Logiest, 1988) conduit à l'abolition de la monarchie et à la suppression de toutes les structures politiques et administratives tutsies sur lesquelles la Belgique avait, pendant des décennies, basé sa politique d'administration indirecte. La révolte des paysans (Hutus) a été largement provoquée par l'intransigeance d'un parti conservateur et de l'élite administrative qui refusa platement toute démocratisation pourtant réclamée par une élite hutue émergente et par une contre-élite tutsie, nettement plus progressive que celle au pouvoir (Reyntjens, 1994). Bien qu'au départ, le nombre de victimes soit resté assez limité, les tentatives de l'élite tutsie traditionnelle au pouvoir visant à maintenir un règne autoritaire conduisirent à des chocs violents. Les Belges ont soutenu la révolte. L'abolition de la monarchie et l'émergence d'une élite hutue devinrent définitives en septembre 1961 lorsque 80% des électeurs se prononcèrent en faveur d'une république à l'occasion d'un référendum. Les résultats des élections législatives désignaient aussi clairement les partis à domination hutue comme les grands vainqueurs du scrutin.
Les événements de 1959-62 : renversement de situation et confrontation
La plupart des observateurs s'accordent à dire que la transition révolutionnaire de la monarchie à domination tutsie vers la République dirigée par les Hutus, qui a duré de novembre 1959 à septembre 1961 et qui a connu son apogée le 1er juillet 1962 avec la déclaration d'indépendance, constitue une période cruciale pour comprendre la division ethnique du pays qui a suivi (Reyntjens, 1985; Lema, 1993; C. Newbury, 1988). Cette courte période de l'histoire, qui commença par la jacquerie de 1959, amena un renversement des rôles. Sous la pression de la vague de changement démocratique déferlant sur l'Afrique, les autorités belges cessèrent de soutenir l'aristocratie tutsie et accordèrent leur appui à la majorité hutue, retirèrent leur soutien au mwami , abandonnèrent leur politique d'administration indirecte et conduisirent en hâte le Rwanda (et le Burundi) à l'indépendance nationale. Ce processus, remarque Linden (1995), marque le début d'un cycle de turbulences du pouvoir dans lesquelles « la capture de l'État rwandais d'entre les mains des opposants politiques a été un jeu blanc violent dans lequel le vainqueur emporte tout ». La lutte pour le pouvoir dans une arène abandonnée par la puissance coloniale et son ancien allié, la monarchie traditionnelle, explique l'exacerbation des tensions ethniques. Alors que les Tutsis se considéraient déjà comme un groupe par leur position dominante dans la société coloniale, l'élite hutue émergente jugea nécessaire de susciter une conscience hutue des sous-privilégiés afin de réussir à battre en brèche le leadership indigène, de s'emparer de l'État vacant et de redresser les injustices résultant de l'histoire.
Vers la fin des années 50, les autorités belges s'intéressèrent subitement à la situation de la majorité constituée par les paysans hutus. L'Église catholique fit un changement de cap tout aussi radical comme en atteste la lettre pastorale de Monseigneur André Perraudin écrite à la fin des années 50, dans laquelle il adopte une attitude pro-hutue en affirmant que la discrimination sociale subie par les Hutus n'était plus compatible avec une saine organisation de la société rwandaise (Reyntjens, 1994).
Le 1er novembre 1959, des violences ethniques éclatent après que le leader du parti Parmehutu eut été molesté par des jeunes Tutsis. Les émeutes qui s'en suivirent menèrent à une vaste révolte des Hutus au cours de laquelle des centaines de Tutsis perdirent la vie. Le gouvernement belge réagit en envoyant des troupes belges. Contrairement à ce que l'on aurait pu attendre, les troupes belges ne tentèrent pas d'écraser la révolte hutue mais adoptèrent une politique pro-hutue dans les faits en installant une administration militaire et en désignant plus de 300 chefs et sous-chefs hutus pour remplacer les Tutsis renversés, tués ou en fuite depuis le début de la rébellion (C. Newbury, 1988; Prunier, 1995). Peu après, en mai 1960, les autorités belges confirmèrent leur nouvelle politique en créant une garde militaire territoriale indigène composée de 650 hommes et basée sur la répartition ethnique, à savoir 85 % de Hutus et 15 % de Tutsis.
Comme nous l'avons déjà dit, les rôles se sont inversés. Une nouvelle confirmation du changement fut donnée par les élections locales de juin-juillet 1960 qui créditèrent les partis politiques à domination tutsie de seulement 16 % des suffrages, traduisant ainsi une victoire hutue écrasante. Après les élections, 211 des 229 bourgmestres allaient être Hutus (C. Newbury, 1988). Dans cette situation et dans un contexte de chocs ethniques continuels, le mwami Kigeri V décida de quitter le Rwanda le 29 juin 1960, officiellement pour assister aux fêtes d'indépendance au Congo. Il n'allait cependant jamais regagner son pays.
La politique rwandaise de la Belgique a valu à cette dernière des critiques acerbes de la part de l'Assemblée générale des Nations Unies qui, de décembre 1960 à juin 1962, en appela à plusieurs reprises à une réconciliation avec le mwami et les représentants tutsis emprisonnés, tout en pressant la Belgique de préserver l'unité entre le Rwanda et le Burundi, mais en vain. Au contraire, les autorités belges renforcèrent le processus d'indépendance du Rwanda en lui accordant l'autonomie interne sous un gouvernement transitoire dirigé par le fondateur du Parmehutu , Grégoire Kayibanda, leader hutu de la région de Gitarama dans le centre du Rwanda. Pendant toute cette période, la confrontation entre Hutus et Tutsis continua mais ce fut l'escalade avec des morts, des expulsions ou des exils, surtout dans les rangs tutsis.
La transition entre la domination politique tutsie et la domination hutue a été scellée par les élections législatives du 25 septembre 1961 qui ont débouché sur une victoire écrasante des partis hutus. Le Parmehutu obtint pas moins de 78 % des suffrages, décrochant ainsi 35 sièges sur 44, tandis que l'UNAR (parti dominé par les Tutsis) n'obtenait que 17 % des suffrages et sept sièges. Un référendum simultané entraîna un rejet tout aussi massif de la monarchie pour lui préférer un système républicain de gouvernement. Après les élections, Grégoire Kayibanda fut élu président du nouveau parlement le 26 octobre 1961. Ce dernier nomma un gouvernement composé initialement de membres du Parmehutu , de l'UNAR et d'APROSOMA. Huit mois plus tard, le 1er juillet 1962, le Rwanda et le Burundi finirent par obtenir formellement leur indépendance en tant qu'États souverains, indépendance que l'Assemblée générale des Nations Unies n'approuva que du bout des lèvres.
Pendant les trois décennies suivantes, la jacquerie hutue de 1959 et les événements qui conduisirent à l'indépendance en 1962, constituèrent les principaux points de référence de la vie politique du Rwanda, positifs ou négatifs selon les craintes ou les espoirs des personnes concernées.
Pour quelle raison ces développements politiques ont-ils revêtu la forme d'une confrontation violente entre Hutus et Tutsi? C. Newbury apporte un élément de réponse :
« le fait saillant est que la quasi-totalité de ceux qui contrôlaient l'État (avant 1959), les chefs et les sous-chefs, étaient Tutsis et c'est ici que le facteur ethnique prend toute son importance [...] Pour les leaders hutus, l'appel à la solidarité hutue devint le point de ralliement le plus efficace pour l'activité révolutionnaire. Bien que les Hutus fussent en mesure de distinguer et l'aient apparemment fait les différents types de Tutsis et leurs attitudes, le fait que les chefs et les autres agents africains de l'État étaient considérés comme des exploiteurs et que ceux-ci étaient très majoritairement Tutsis, fit la force de l'appel à la solidarité ethnique là où un appel à « tous les pauvres » aurait été moins écouté. La politique coloniale ayant à moult reprises pris pour cible la caste inférieure des Hutus au statut d'exclus, même les pauvres Tutsis n'ont pas subi les mêmes formes de discrimination que celles infligées aux Hutus. » (C . Newbury, 1988)
Trois conséquences de ce tournant crucial ont déterminé et continuent à déterminer les développements politiques au Rwanda.
1. Exil d'un grand nombre de Tutsis. Le nombre exact de réfugiés a fait l'objet de nombreux débats et a été utilisé à des fins de propagande. Tel fut le cas en particulier durant la crise d'octobre 1990 qui suivit l'incursion du FPR (Front patriotique rwandais) au départ de l'Ouganda. En fait, les réfugiés tutsis ont quitté le Rwanda lors des crises successives, plus spécialement en 1959-1961, 1963-1964 et en 1973. Au début des années 1990, leur nombre s'élevait à environ 600 000, y compris les descendants des premiers réfugiés (Guichaoua, 1992). Ce chiffre est contesté par de nombreuses personnes. Prunier établit cependant que ce chiffre est la meilleure estimation dont on dispose (Prunier, 1995). Ce chiffre est impressionnant puisqu'il correspond à environ 9 % de la population totale estimée du pays, soit la moitié de la population tutsie. Ils constituent un élément d'insécurité structurelle, d'autant que les communautés de réfugiés tutsis n'ont jamais accepté l'exil comme un fait accompli. Au contraire, ils ont toujours revendiqué leur appartenance au Rwanda et leur droit d'y retourner. Avant même l'indépendance, des groupes de réfugiés commencèrent à faire des incursions armées visant à tenter de récupérer leur ancienne position. Ces incursions étaient faciles à réaliser puisque la majorité des réfugiés résidaient dans les quatre pays voisins. Ces activités imputables à des groupes de réfugiés tutsis, les inyenzi (cafards) ne prirent fin qu'en 1967 (Reyntjens, 1994).
L'attitude officielle des gouvernements rwandais par rapport à ce problème a changé considérablement au fil des années. Au début des années 60, le gouvernement provisoire avait exprimé sa préoccupation en créant un Secrétariat d'État aux Réfugiés. Sous la Ière république (1962-1973), les réfugiés ont été invités à plusieurs reprises à regagner le Rwanda. Cet objectif n'a toutefois jamais été atteint. D'une part, les réfugiés tutsis n'ont jamais cru à la sincérité des changements d'attitude du gouvernement. D'autre part, les inyenzi faisaient des incursions à intervalles réguliers. Fin 1963, début 1964, une nouvelle vague de réfugiés quitta le Rwanda.
Sous la seconde république (à partir de 1973), la situation changea quelque peu (mais sans jamais disparaître) par suite d'une politique de pacification ethnique. Mais le régime en place dressa un nouvel obstacle en prétextant que le pays était surpeuplé et incapable de réintégrer un grand nombre de réfugiés. Les rapatriements massifs étaient donc exclus. Cette position fut soutenue par une déclaration du Comité central du MRND (Mouvement révolutionnaire national pour le développement) datée du 26 juillet 1986. De plus, le retour des réfugiés individuels était soumis à certaines conditions prêtant à de multiples interprétations. Il était par exemple prévu que le candidat au rapatriement devait « apporter la preuve qu'à son retour au pays, il serait capable de se prendre en charge » (Ndagijimana, 1990). Cette position, qui devint la position « définitive », entraîna pour la première fois la tenue par les réfugiés d'une conférence internationale à Washington en août 1988. La position du gouvernement fut rejetée et l'on réaffirma le plein droit de retour au pays. À ce stade, on assistait, sans doute sans s'en rendre compte, à la genèse d'une confrontation imminente. La crise d'octobre 1990 fut donc essentiellement une crise des réfugiés, plongeant ses racines dans les événements de 1959-1962, renforcée par les développements politiques qui ont suivi au Rwanda et dans les États voisins, en particulier en Ouganda.
2. L'exclusion virtuelle de tous les Tutsis de la vie publique. Cette exclusion a deux origines : 1) les partis tutsis ont subi le même sort que les autres partis d'opposition (voir ci-dessous) et 2) les citoyens tutsis devinrent les victimes d'abus en tous genres. En fait, la révolte de novembre 1959 n'était que le début d'une série d'actions violentes dirigées contre les Tutsis. Les événements de 1959 causèrent plusieurs centaines de morts et ce nombre ne fit qu'augmenter graduellement au cours des crises successives. Les premières victimes politiques furent les chefs et les sous-chefs tutsis. Quelque 21 et 314 des 43 chefs et des 549 sous-chefs tutsis en poste début décembre 1959, furent éliminés par meurtre, explosion ou exil. Ils furent remplacés par les autorités hutues temporaires qui, six mois après la révolte, occupaient environ la moitié des postes. Aux élections municipales de juin-juillet 1960, les partis tutsis obtinrent 289 conseillers municipaux sur un total de 3 125, soit environ 9 % des sièges. Il convient toutefois d'observer que l'UNAR avait appelé ses membres à boycotter ces élections, ce qui risque d'avoir influencé les résultats en faveur des partis hutus.
L'élimination physique resta monnaie courante, surtout dans les périodes de tension politique, comme avant et pendant les élections municipales de 1960 et les élections législatives de septembre 1961. Mais l'estocade fut donnée fin 1963. Une attaque des inyenzi à Bugesera déclencha une nouvelle explosion de violence. Le nombre de Tutsis tués est estimé entre 5 000 et 8 000 rien que dans la préfecture de Gikongoro, soit 10 à 20 % de la population totale de Tutsis dans cette préfecture. La majorité des leaders tutsis restés au Rwanda ont été éliminés : 15 des principaux dirigeants ont été exécutés sur le champ sans aucune autre forme de procès. Ce fut la fin des deux partis tutsis, UNAR et RADER, et la fin de toute participation tutsie à la vie publique. Des crises moins graves allaient continuer à affecter la minorité ethnique. La dernière d'entre elles avant 1990 survint début 1973 et préluda au coup d'État du 5 juillet 1973 (Reyntjens, 1994).
3. Concentration de pouvoir et autoritarisme croissant. Comme dans bon nombre de pays africains, le Rwanda, après une période initiale de multipartisme, devint de facto un État à parti unique. L'opposition fut éliminée par une combinaison de diverses techniques telles que l'intimidation, les arrestations, la violence physique et, parfois, les négociations. La politique du Parmehutu avait pour but l'extinction des autres partis, tant hutus que tutsis. Dans un discours prononcé à l'occasion du premier anniversaire de l'indépendance, le président Grégoire Kayibanda indique déjà sa préférence pour « un parti majoritaire une majorité écrasante avec sur le côté une opposition mineure ». Il affirmait qu'une « prolifération des partis politiques distrairait la population, rendrait le progrès du pays incohérent et conduirait à une stagnation néfaste de la nation » (Chronique de politique étrangère , 1963).
Résultat : en 1965, le MDR-Parmehutu était le seul parti à présenter des candidats aux élections législatives et présidentielles. Sans être entièrement constitutionnalisé, ce parti se donna le nom de « Parti national ». Ayant éliminé l'opposition, la concentration du pouvoir au sein du parti commença à augmenter. C'est surtout à partir de 1968 que les nombreux conflits ou divisions au sein du gouvernement forcèrent le régime à se replier de plus en plus sur lui-même. En 1972, l'usurpation du pouvoir par un petit groupe de politiciens originaires de Gitarama, la région natale du président Grégoire Kayibanda dans le centre du Rwanda, était consommée (Reyntjens, 1985).
La II e République
Face au mécontentement exprimé surtout par les politiciens et les militaires du nord, le gouvernement de Grégoire Kayibanda finit par recourir à la tactique « ethnique ». En 1973, une vague de violence initialement à caractère ethnique éclate dans les écoles, dans l'administration et dans les entreprises. Psychologiquement, ces développements ont certainement été influencés (et facilités) par les événements sanglants de 1972 au Burundi où les Hutus ont été victimes d'un génocide (Commission des Droits de l'homme des Nations Unies, 1972). Il faut cependant rappeler que l'impulsion visant à expulser les Tutsis trouve son origine dans les cénacles du pouvoir qui ont essayé de détourner ainsi l'attention d'autres problèmes (Reyntjens, 1985). Pourtant, les politiciens de Gitarama perdirent de vue la dynamique qu'une telle politique pouvait engendrer dans une situation de contrôle précaire. La population commença donc à s'en prendre aux riches (pas uniquement aux Tutsis); les Hutus du nord commencèrent à pourchasser ceux du centre; les politiciens du nord se détournèrent des écoles où tout avait commencé pour braquer leur attention sur les ministères et les entreprises où ils se sentaient sous-estimés ou frappés d'ostracisme. Comme certains politiciens du nord et en particulier le ministre de la Défense nationale, le général-major Juvénal Habyarimana, sentaient planer le risque d'une élimination physique, ce dernier décida une intervention armée avec une armée dans laquelle le nord a toujours, historiquement, occupé une position prédominante. Le régime de Grégoire Kayibanda fut renversé par le coup d'État du 5 juillet 1973 qui eut lieu sans aucune violence et qui fut accueilli avec satisfaction par la population (Reyntjens, 1994). Cette date marque le début de la IIe République sous le président Habyarimana.
Après une procédure judiciaire organisée dans le plus grand secret, une cour martiale prononça en juin 1974 la peine de mort à l'encontre de l'ancien président Grégoire Kayibanda et de sept autres dignitaires de l'ancien régime. Les autres furent condamnés à de longues peines d'emprisonnement.
La clémence accordée dans certains cas n'eut qu'une signification symbolique. En fait, pendant les années 1970, d'innombrables dignitaires de la Ire République périrent dans la tristement célèbre « section spéciale » de la prison de Ruhengeri alors que Grégoire Kayibanda, qui était assigné à résidence à Kavumu, mourut en 1976 après s'être vu refuser les soins médicaux nécessaires. Après la « révolution morale » de 1973, les militants de la « révolution sociale » de 1959 avaient disparu certains par la voie politique, d'autres par des moyens physiques. Le régime de la IIe République se réclamait cependant de l'ancien régime : « Soucieux de préserver les acquis de la Révolution sociale de 1959, le MRND a l'intention de mobiliser l'ensemble du peuple rwandais sous la bannière de la paix et de l'harmonie nationale en restaurant un climat de confiance entre les fils et les filles de la Nation » (MRND, 1985). Pourtant, la rupture avec la Ire République était nette.
À maints égards, la IIe République contrastait fortement avec la précédente. Pour commencer, nous assistons à une période de modernisation prononcée qui se manifeste par une ouverture sur le monde extérieur, une croissance urbaine, des investissements et la reprise des affaires. Alors que le régime de la Ire République vivait replié sur lui-même, celui de la IIe République adopta une politique d'ouverture du pays. On constate une augmentation soudaine du nombre de postes diplomatiques rwandais à l'étranger et de postes diplomatiques étrangers à Kigali. Le président Habyarimana fait des voyages fréquents et séduit. En 1979, Kigali accueille la sixième Conférence franco-africaine. Le Rwanda est cofondateur de la Communauté économique des Pays des Grands Lacs (CEPGL) en 1976 et de l'Organisation pour l'aménagement et le développement de la rivière Akagera (OBK) en 1977. D'importants investissements sont consentis au niveau de l'infrastructure (réseau routier et télécommunications). Avec une population de 15 000 habitants en 1965, Kigali est devenue une métropole comptant 250 000 habitants au début des années '90 et nombre de petits centres se sont graduellement urbanisés grâce à l'extension du réseau électrique. Le développement de la mobilité lié à l'amélioration des investissements, des communications et de la formation n'est cependant pas toujours vecteur d'une ambition de contrôle social, de maintien de l'ordre et de « moralité » ni de lutte contre l'exode rural (Reyntjens, 1994).
En ce qui concerne le monde des affaires, l'austérité particulière de la Ire République a cédé la place à une éthique différente. Par exemple, tous les fonctionnaires sont autorisés sans restriction à participer à des entreprises privées. Sont également permises : la propriété d'habitations louées, l'acquisition de véhicules loués et les prises d'intérêts dans les entreprises économiques mixtes et commerciales (Instruction présidentielle nº C 556101 du 11 juin 1975). Ce phénomène fut moins marqué au Rwanda que partout ailleurs, mais le fait que le Rwanda n'était en définitive pas si différent entraîna un changement dans l'image que certains se faisaient du pays depuis la moitié des années '80.
« Le mythe d'une « république égalitaire » s'était évaporé : une bourgeoisie quaternaire (militaires, administrations, affaires et technocratie) détourne à son profit une part importante du revenu national » (Bezy, 1990).
Graduellement, le lien entre la ville et les campagnes (qui avait toujours constitué un élément important d'équilibre et de cohésion) commença à s'effriter. Une personne interrogée par Hanssens décrit la situation comme suit :
« Alors que les dirigeants actuels sont toujours des « paysans » dans l'âme, les enfants des cadres ou des dignitaires vivent selon un modèle urbain et, lorsqu'ils seront au pouvoir, ils auront perdu tout contact avec la réalité. D'où un phénomène de zaïrisation du Rwanda, avec une élite contrainte de négliger les infrastructures sociales afin d'accroître son propre bien-être » (Hanssens, 1989).
Le processus de rupture entre une minorité citadine et la majorité rurale était déjà bien avancé au cours des années '80. Newbury observe que les changements économiques des années '80 ont eu pour résultat de creuser le fossé entre le riche et le pauvre mais aussi d'affirmer les intérêts de la classe au pouvoir (C. Newbury, 1991).
Enfin, il faut observer que l'accès au pouvoir et à la connaissance était réservé à de rares groupes régionaux du pays, à savoir ceux des préfectures de Gisenyi et de Ruhengeri au nord. Cette concentration naquit en quelques années et se focalisa sur ces deux préfectures à la fin des années '80. Bien que cela se constate à tous les niveaux, nous nous bornerons à citer trois exemples. Vers la moitié des années '80, la préfecture de Gisenyi s'arrogea près d'un tiers des 85 postes les plus importants de la république ainsi que le leadership quasi exclusif de l'armée et des services de sécurité. Selon une étude remontant au début des années '90, 33 institutions publiques sur un total de 68 étaient sous la direction de personnes originaires de Gisenyi (19 postes) et Ruhengeri (14 postes). Au cours de la période 1979-1986, les « indices de disparité » en matière de bourse d'études à l'étranger étaient de 1,83 en faveur de Gisenyi et 1,44 en faveur de Ruhengeri (la préfecture la plus délaissée étant Kibungo à l'est, avec un indice de 0,67). En 1990, le conflit ethnique était éclipsé ou même transcendé par un conflit régional et, au sein de la région dominante, par des antagonismes à petite échelle (par exemple, les préfectures de Gisenyi et de Ruhengeri étaient à couteaux tirés dans le nord, tandis qu'à Gisenyi même, Bushiru, patrie de Habyarimana, se livrait à une concurrence sans merci avec Bugoyi) (Reyntjens, 1994).
Malgré toutes les difficultés rencontrées sous la IIe République, une série de développements positifs ont vu le jour. En se basant uniquement sur l'augmentation du PIB par habitant, les performances économiques du Rwanda étaient plutôt bonnes si l'on tient compte de ses handicaps inhérents (pays enclavé, pression démographique, manque de matières premières) et certainement en comparaison avec ses voisins. Le tableau 1 représente la progression du Rwanda et celle de ses voisins dans les classements réalisés pour les rapports sur le développement mondial publiés par la Banque mondiale au cours de la période qui coïncide avec la IIe République.
Tableau 1. PIB par habitant au Rwanda et dans les pays voisins
| Jaar Année |
Ranglijst Classement |
||||
| Rwanda | Burundi | Zaïre | Oeganda Ouganda |
Tanzania Tanzanie |
|
| 1976 | 7 | 11 | 16 | 33 | 25 |
| 1981 | 16 | 14 | 12 | 13 | 19 |
| 1985 | 18 | 11 | 9 | niet besch. inconnu |
21 |
| 1990 | 19 | 11 | 12 | 13 | 2 |
| Verschil. Différence | +12 | 0 | -4 | -20 | -23 |
Source : Banque mondiale, Rapport sur le développement mondial, dans Reyntjens (1994)
En 15 ans, le Rwanda a donc amélioré sa position relative en passant de la dernière à la première position du classement tandis que le Burundi est resté stationnaire et que les autres pays voisins se sont appauvris, certains même fort. En d'autres termes, le Rwanda est passé de la position d'État le plus pauvre des 5 en 1976 à la position d'État le moins pauvre en 1990. Dans d'autres domaines tels que, par exemple, l'infrastructure, les progrès enregistrés sont tout aussi remarquables, avec un réseau routier qui peut être considéré comme un des meilleurs d'Afrique, un service postal fiable et des télécommunications fiables, un réseau de distribution d'eau correct, l'extension du réseau électrique, etc.
Au cours des années '80, le Rwanda était considéré par la Banque mondiale et par d'autres instances comme une économie africaine florissante avec une dette modérée en comparaison avec celle des autres pays de ce continent, du moins jusqu'à la deuxième moitié de la décennie (en 1987, la dette du Rwanda s'élevait à 28 % du PIB, ce qui correspond à un des pourcentages les plus faibles d'Afrique). L'économie était en équilibre et la monnaie jouissait d'une assez grande stabilité dans la mesure où elle faisait office de monnaie forte dans la région.
Bien que loin d'être acceptable, la situation des droits de l'homme s'est également améliorée. Par exemple, le nombre de prisonniers politiques a diminué et des efforts ont été faits pour limiter et contrôler l'utilisation abusive et excessive des règles de prévention détentive et de restriction de la liberté de mouvement. De plus, il convient d'observer qu'entre la prise de pouvoir du général Habyarimana et la guerre d'octobre 1990, le pays n'a été la proie d'aucune violence ethnique majeure. On a souvent tendance à oublier aujourd'hui que le président Habyarimana était assez populaire chez les Tutsis de l'intérieur du pays et qu'il a même été accusé par certains Hutus de privilégier les Tutsis (Chrétien, 1993).
Aperçu général : principaux acteurs/principaux facteurs
Le 1er octobre 1990, le Front patriotique rwandais (FPR) et plus particulièrement son aile militaire, l'APR (Armée patriotique rwandaise), commença à envahir le nord du Rwanda au départ de l'Ouganda. C'est finalement une troupe de 7 000 hommes (Tutsis) qui traversa la frontière. Environ quatre ans plus tard, le 6 juillet 1994, un gouvernement dominé par le FPR prend Kigali, la capitale du Rwanda.
L'invasion du pays par le FPR a déclenché une crise continue et une escalade dramatique après que l'avion qui ramenait le président Habyarimana (et son homologue burundais) d'une conférence de paix à Dar-es-Salaam (Tanzanie) eut été abattu en avril 1994. Avant d'entrer plus en détail dans la période qui a suivi l'invasion du Rwanda par le FPR et les négociations d'Arusha, nous commencerons par décrire les principaux acteurs et facteurs de la crise rwandaise des années '90. Les principaux acteurs sont le régime Habyarimana défié, le FPR, l'opposition politique interne et la communauté internationale. Les principaux facteurs sont les réfugiés et la crise économique doublée d'une crise politique. La dimension régionale de toute cette crise fera l'objet d'un chapitre distinct.
Le FPR : la crise des réfugiés
La création du FPR au début de l'année 1988 à Kampala, capitale de l'Ouganda (marquant ainsi l'aboutissement de discussions menées fin 1987), doit être considérée à la lumière de l'importante participation des Tutsis dans l'armée ougandaise (NRA) du président Yoweri Museveni. Le général-major Fred Rwigyema, qui fit pénétrer le FPR au Rwanda le 1er octobre 1990, était vice-ministre de la Défense sous Museveni. Le major Paul Kagame, l'actuel vice-président du Rwanda, était sous-directeur dans l'intelligence militaire en Ouganda (Prunier, 1995).
Les réfugiés rwandais et les citoyens ougandais contribuèrent dans une large mesure à la victoire de Museveni en 1986. Sur le plan ethnique, ils constituaient le troisième groupe de la NRA (Prunier, 1992). Il est prouvé que Museveni a soutenu le FPR (Prunier, 1992 et 1995; Human Rights Watch/Arms Project, 1994). Le FPR était une force hypermotivée et bien entraînée. Environ 2 500 soldats du FPR avaient appartenu à l'armée ougandaise (Prunier, 1995). Le 3 octobre 1990, l'offensive du FPR fut momentanément bloquée par les forces armées rwandaises (FAR) (Reyntjens, 1994; Prunier, 1995).
Le FPR est l'émanation des réfugiés tutsis qui ont fui le Rwanda surtout entre 1959 et 1966. Au fil des ans, les 600 000 réfugiés stationnés en Ouganda, au Burundi, au Zaïre et en Tanzanie (et leurs descendants) désiraient toujours ardemment regagner leur pays d'origine (Guichaoua, 1992; Watson, 1991). Le changement politique en Ouganda après 1986 et la participation des Tutsis au processus de consolidation a fourni un contexte favorable à la planification d'une invasion militaire. Un autre facteur a été le soutien à sa cause reçu par le FPR au congrès sur les réfugiés organisé en août 1988 à Washington.
Bien que la motivation première du FPR ait été de régler la crise des réfugiés, le Front élabora également un programme politique en huit points dans l'intention de modifier structurellement la culture politique rwandaise. Ce programme accusait le gouvernement rwandais de pratiques antidémocratiques, de corruption et de discrimination ethnique. Le FPR donna sciemment de lui-même une image multi-ethnique. Néanmoins, la grande majorité de ses dirigeants et de ses membres sont Tutsis.
Certains observateurs doutent qu'il ait été sage de la part du FPR d'entreprendre une action militaire à ce moment précis (Prunier, 1993). L'invasion survint deux mois seulement après la conclusion d'un (troisième) accord ministériel entre le Rwanda et l'Ouganda à l'issue de trente mois de pourparlers supervisés par le HCR et l'OUA sur la question des réfugiés. Or, cet accord aurait pu donner des résultats concrets. De plus, un processus de libéralisation politique était en train de se développer au Rwanda. Bien que tout porte à croire que les négociations auraient pu déboucher sur une avancée, le FPR n'avait plus la patience d'attendre, apparemment las des blocages continuels avec le gouvernement rwandais. D'aucuns affirment cependant que le FPR a attaqué à ce moment précis parce qu'une avancée possible dans le domaine de la démocratisation, des droits de l'homme et du rapatriement des réfugiés aurait réduit la légitimité d'une attaque (Reyntjens, 1994).
Le régime défié
Le régime Habyarimana, dont les deux principaux piliers sont le parti MRND et l'armée, n'avait jamais été véritablement défié au cours de ses 17 années d'existence, jusqu'à l'invasion orchestrée par le FPR. Cela ne veut pas dire pour autant que le régime n'avait jamais été exposé aux critiques. Certaines personnes hostiles ou devenues hostiles au régime Habyarimana pendant les années '70 et '80, avec dans leurs rangs des radicaux hutus tels qu'Alexis Kanyarengwe et Jean Barahinyura, devinrent au début des années '90 des personnalités du FPR (Reyntjens, 1994). D'autres ont rejoint l'opposition nationale dont allaient émerger des partis politiques en 1990.
En règle générale, Habyarimana jouissait pourtant d'une popularité considérable tant chez les Hutus que dans la communauté tutsie. À partir de 1985, cette popularité commença à s'éroder à la suite de la crise politique et économique générale. À mesure que le conflit évoluait, le président fit l'objet d'un nombre de critiques croissant, même au sein de son propre parti. Il était pris entre les demandes de libéralisation politique émanant de l'opposition et de la communauté internationale, d'une part, et le refus de ses partisans d'abandonner des positions politico-économiques, d'autre part. La formation de milices de parti (Interahamwe ) et d'un parti extrémiste pro-hutu (Coalition pour la Défense de la République, CDR ) en particulier, et l'affirmation de l'identité ethnique en général, sont des indicateurs de son opposition au processus de réforme.
« Les extrémistes du MRND créent le CDR » officiellement en mars 1992 « avec un programme explicite d'extrémisme hutu » (African Rights, 1994). Bien que le CDR n'ait probablement jamais compté de nombreux partisans, il a exercé une influence importante sur l'attitude ethnique et politique du MRND (Reyntjens, 1994). Ses idées étaient diffusées par les médias (le journal Kangura depuis 1989, et la radio RTLMC depuis juillet 1993). « Kangura utilisait ses liens étroits avec les cénacles les plus élevés des services de sécurité militaire et du CDR pour faire filtrer des informations importantes dans le grand public, dans l'intention avouée de provoquer la crainte et l'espoir. » « Plus proche des idéologues les plus extrémistes du CDR que de Habyarimana, il n'hésita pas à critiquer le président sur les concessions qu'il avait été forcé de faire à Arusha » (African Rights, 1994).
La plupart des observateurs s'accordent à reconnaître l'idée et la possibilité que Habyarimana ait à payer de sa vie le 6 avril 1994 le fait de ne pas avoir consenti à un boycott total du processus de libéralisation politique résultant des négociations de paix avec le FPR et l'opposition nationale à Arusha entre juillet 1992 et août 1993 (Reyntjens, 1994; Prunier, 1995; Lemarchand, 1995).
La crise économique
Le conflit décrit ci-dessus peut être considéré comme une lutte entre un régime de plus en plus usé et ses prétendants. Ces derniers ne pouvaient se réconcilier avec un gouvernement à parti unique qu'ils considéraient comme autoritariste, antidémocratique et donc inadapté à la nouvelle situation politique. Cette opposition était alimentée par les nouvelles dans la presse faisant état de corruption au sein du régime. Le régime Habyarimana était en outre vu comme un obstacle au redressement économique. En effet, on aperçoit un lien entre la crise économique qui frappait durement le Rwanda depuis 1985 et l'opposition grandissante émanant de différents pans de la société civile rwandaise (Chrétien, 1991). Jusqu'à la fin des années '80, le Rwanda était décrit comme un pays petit et pauvre mais économiquement sain et autosuffisant. Le taux d'inflation moyen au cours des années '80 ne dépassait pas 4 % par an contre un taux moyen de 20 % pour l'Afrique subsaharienne. De 1965 à 1980, le taux de croissance du PIB par habitant dépassa d'un point celui de l'Afrique subsaharienne.
Un appui substantiel fourni par les agences multilatérales, les donateurs bilatéraux (Belgique, France, Allemagne, États-Unis) et les ONG a contribué à son développement. En 1991 par exemple, l'appui des donateurs bilatéraux et multilatéraux représentait 21,5 % (BIRD, 1993) du PIB du Rwanda et 60 % des dépenses publiques en matière de développement, ce qui est au-dessus de la moyenne subsaharienne sans être le plus élevé de la région. Le Rwanda a attiré l'attention internationale en raison de son faible taux d'exode rural, sa politique monétaire saine et la participation active du gouvernement et de la société civile dans les activités de lutte contre l'érosion et de reconstitution des forêts, l'éducation et les services de soins de santé. L'aide internationale en faveur du Rwanda passa rapidement d'un montant annuel de USD 35 millions en 1971-1974 à USD 343 millions en 1990-1993. Ce dernier chiffre représente quasiment USD 50 par habitant (Statistiques de l'OCDE).
Par contre, les problèmes se développèrent. Un problème majeur était la rareté des terres. L'accroissement de la population dans un pays qui connaissait déjà une forte densité de population avait conduit à une situation dans laquelle la famille paysanne moyenne ne possédait pas plus de 0,7 hectare de terres. Compte tenu de l'organisation des cultures qui prévalait, les familles ont eu de plus en plus de difficultés à avoir une production suffisante pour subvenir à leurs besoins. Alors qu'en 1982, 9 % de la population consommait moins de 1 000 calories par jour (niveau de pauvreté extrême), ce chiffre passa à 15 % en 1989 (avec une famine partielle dans le sud) pour atteindre 31 % en 1993 (Maton, 1994). En 1993, le pays était donc devenu de plus en plus dépendant de l'aide alimentaire. Cette détérioration de la situation était bien sûr le résultat de la guerre civile. Une grande attaque lancée par l'APR dans la partie la plus fertile du pays en janvier et février 1993 provoqua un déplacement massif de 13 % de la population totale du pays et une chute de 15 % de la production agricole mise annuellement sur le marché (Marysse & de Herdt, 1993). Tous ces problèmes formèrent le substrat de l'extrémisme et du conflit ethnique.
Outre les limitations économiques internes, de grands chocs économiques externes vinrent également frapper le Rwanda de plein fouet vers la fin des années '80. Pour commencer, le Rwanda perdit sa dernière mine d'étain en 1985 en raison de l'augmentation des coûts, de l'effondrement des cours mondiaux et d'une mauvaise gestion (Reyntjens, 1994). L'étain représentait 15 % des recettes d'exportation du Rwanda. Un autre événement encore plus dramatique fut la baisse des prix du café sur les marchés internationaux. Le café représentait habituellement plus des deux tiers des recettes extérieures du Rwanda. Entre 1986 et 1992, les cours du café enregistrèrent une chute de 75 % qui provoqua à son tour un quadruplement du ratio du service de la dette.
D'autres facteurs jouèrent également un rôle : une grave sécheresse en 1989-1990 (qui frappa à nouveau en 1991 et 1993) et des maladies s'attaquant aux deux principales cultures, le manioc et les patates douces, qui se traduisirent par un demi-million de personnes victimes de pénurie alimentaire et de malnutrition, la corruption de plus en plus flagrante et généralisée du gouvernement et l'affectation des ressources budgétaires aux dépenses militaires qui grimpèrent en flèche après l'invasion d'octobre 1990 par les forces de l'APR au départ de l'Ouganda. Les trois années suivantes furent marquées par plusieurs incursions de l'APR, par les efforts de l'armée gouvernementale de repousser l'APR, par les représailles à l'encontre des Tutsis et, surtout, par des déplacements de population internes massifs touchant un million de personnes dans la partie nord du pays en 1993. La conjugaison de ces éléments porta un coup fatal à l'économie.
La communauté internationale répondit avec générosité à l'aggravation de la crise économique au Rwanda. Les montants versés au titre de l'aide officielle augmentèrent de presque 60 % en deux ans, passant de USD 242 millions en 1989 à un record historique de USD 375 millions en 1991. Ils furent maintenus à peu près à ce niveau jusqu'en 1993. Un élément capital dans l'aide fournie au Rwanda est l'accord de septembre 1990 concernant le programme d'ajustement structurel élaboré par la Banque mondiale et le FMI. Ce programme, combiné à un cofinancement par sept donateurs bilatéraux plus la Banque africaine de développement et l'Union européenne, se chiffrait à USD 216 millions. Après s'être opposé à tout ajustement structurel pendant de nombreuses années, le gouvernement rwandais décida d'entamer des discussions dans ce sens, le compte commercial et le budget fiscal étant mis sous pression notamment à la suite de l'effondrement des prix du café. Le lien entre le prix du café et le budget du gouvernement rwandais découle d'une politique menée de longue date et consistant à garantir un prix fixe aux producteurs par l'intermédiaire d'un Fonds d'égalisation du café, qui servait en fait de subvention lorsque le prix mondial du café (hors frais de marketing et de transport) tombait en dessous du prix garanti. Avec l'érosion constante des cours mondiaux, les subventions budgétaires nécessaires pour garantir le prix augmentèrent de manière dramatique à partir de 1987 (Marysse, 1994; BIRD, 1993; Banque mondiale, 1991).
La liste présentée ci-dessous contient certains des éléments du programme approuvé en juin 1991 et donne une idée de l'éventail de mesures politiques dont était assorti le programme d'ajustement structurel :
* stabilisation macro-économique et amélioration de la compétitivité au plan international :
en maintenant un taux de change compétitif (le franc Rwanda, RWF, avait déjà été dévalué de 40% en 1990 et subit une nouvelle dévaluation de 15% en 1992);
en ramenant le déficit budgétaire du gouvernement de 12% du PIB en 1990 à 5% en 1993 grâce à une meilleure affectation des ressources disponibles et à une réduction des dépenses;
en libéralisant les importations et en supprimant progressivement le contrôle des prix nationaux ainsi que d'autres mécanismes de régulation touchant le secteur privé; et
en améliorant la politique monétaire, en ce compris la libéralisation de la structure des taux d'intérêts.
* réduction du rôle de l'État dans l'économie :
par une réduction du prix garanti aux producteurs de café et par l'élimination du mécanisme de subventionnement; et
par une accélération du calendrier de réforme de 12 des 86 entreprises publiques à privatiser, à mettre en liquidation ou à réorganiser.
* protection des moins favorisés par la mise en place d'un « réseau de sécurité sociale » par le biais d'un « Programme d'action sociale » comprenant :
(i) des programmes à forte intensité de main-d'oeuvre de construction de routes rurales et de protection contre l'érosion des sols;
(ii) un programme de sécurité alimentaire pour les zones frappées par la sécheresse;
(iii) un programme de développement pour les petits entrepreneurs;
(iv) le financement de la quote-part parentale dans les frais d'éducation des 10% les plus pauvres de la population; et
(v) un fonds de redéploiement des agents sans emploi du secteur public (les trois premiers éléments de ce plan furent intégrés dans le « Projet de sécurité alimentaire et d'action sociale » de 1992 financé par la Banque mondiale, qui amplifiait le soutien à plusieurs initiatives sponsorisées par une agence des Nations Unies).
La mise en oeuvre de ces mesures connut des fortunes variables. Deux mesures clés qui ne furent pas mises en oeuvre sont l'élimination des subventions aux producteurs de café et la réalisation de l'objectif en termes de déficit budgétaire. Au lieu de diminuer, ce déficit passa à 18% du PIB en 1992 et même 19% en 1993. Les conditions n'étant pas réunies, la seconde tranche du crédit de la Banque mondiale destiné à la réalisation de l'ajustement structurel ne fut pas versée (Marysse, 1994; Banque mondiale, 1995).
Les questions suivantes ne sont pas sans pertinence quand il s'agit d'établir l'influence exercée sur les causes directes du génocide :
* dans quelle mesure les dispositions du programme d'ajustement structurel ont-elles conduit à une accentuation de la pauvreté de la population rurale hutue, rendant ainsi quantité de gens sensibles à la propagande de haine les incitant à rejoindre les rangs des milices et à participer au génocide ?
* dans quelle mesure certaines dispositions ont-elles créé un ressentiment chez les fonctionnaires et les autres salariés n'appartenant pas au monde agricole, rendant ainsi ces derniers plus sensibles à la propagande de haine et plus ouverts à une participation active ou tacite au génocide ?
Pour ce qui est de la première question, il faut tenir compte de l'impact de la dévaluation et des changements intervenus dans le prix garanti aux producteurs de café. Le gouvernement rwandais a réduit ce prix garanti de RWF 125 le kilo à RWF 100 en 1990, mais au lieu de continuer à faire baisser ce prix, conformément aux exigences du programme d'ajustement structurel, le gouvernement décida unilatéralement de le relever à RWF 115 en 1991, préoccupé de l'impact d'un prix plus bas sur les recettes d'exportations ainsi que sur le pouvoir d'achat et sur le soutien politique de la population rurale. En tout état de cause, les « bienfaits » de la dévaluation ne furent pas répercutés sur les producteurs de café dont le revenu chuta indéniablement sous l'effet de la baisse relativement faible du prix producteur du café mais surtout à cause d'une inflation galopante combinée à une dévaluation et au financement du déficit au début des années '90 (Marysse, 1994; Banque mondiale, 1992; Banque mondiale, 1995). Cependant, la principale cause de la dégradation des conditions de vie de la population rurale durant cette période était la diminution de la production alimentaire, provoquée par une sécheresse prolongée, des récoltes malades et un déplacement massif de population (Maton, 1994).
Le bien-être des populations citadines et rurales a également été affecté par la manière dont le gouvernement rwandais a profité de l'« aubaine » résultant de la dévaluation, qui n'a pas été répercutée sur les paysans. Un des principaux motifs qui ont justifié la dévaluation était de permettre au gouvernement rwandais de réduire son déficit budgétaire tout en maintenant simultanément les dépenses essentielles dans le secteur social, plus précisément la santé et l'éducation. Alors que le programme d'ajustement structurel prônait une augmentation des honoraires et de la quote-part à charge des « utilisateurs » dans le domaine de la santé et de l'éducation, il y avait également des dispositions visant à maintenir les dépenses sociales du secteur public et à lancer des programmes ayant pour finalité de protéger les plus pauvres. Mais ce schéma était basé sur l'hypothèse d'une maîtrise des dépenses militaires. Or en fait, les dépenses militaires quadruplèrent de 1989 à 1992, passant de 1,9 % à 7,8 % du PIB, alors que les subventions au secteur du café s'élevaient en 1992 à 46 % des recettes d'exportation. Ces pressions portèrent gravement atteinte au « réseau de sécurité sociale »; pour prendre un exemple : les dépenses consacrées aux médicaments essentiels destinés aux plus pauvres ne représentaient que 25 % du budget alloué (Marysse, 1994; Banque mondiale, 1995).
Alors que le programme d'ajustement structurel ne nécessitait nullement de réduire le niveau de l'emploi dans la fonction publique, le gouvernement décréta le gel des salaires des agents de l'État. Certains fonctionnaires réussirent à compenser le manque à gagner par une participation à l'activité croissante du secteur privé associée à un processus de libéralisation et à l'accroissement de l'aide extérieure. Pour les autres, le gel des salaires aggrava leurs craintes pour l'avenir, attisées par la détérioration marquée de leur pouvoir d'achat après deux dévaluations, la détérioration générale de la situation économique et la spirale de la guerre civile et de la violence.
Les donateurs disposaient d'un moyen de pression assez efficace sur le Rwanda, compte tenu du niveau très substantiel et en hausse de l'aide fournie. Comme l'indiquent les développements de l'Étude II, alors que les principaux donateurs liaient en principe l'aide économique à la situation des droits de l'homme et plusieurs pays donateurs et représentants diplomatiques entreprirent des démarches en ce sens auprès du gouvernement rwandais , aucun donateur ne diminua son aide en invoquant le motif spécifique et exclusif des violations de plus en plus nombreuses des droits de l'homme au début des années '90.
Au contraire, en réponse à l'escalade de la violence civile, les donateurs pratiquèrent la « conditionalité positive » pour promouvoir la démocratisation par le biais d'un soutien du système judiciaire, de la liberté de la presse et des organisations locales de défense des droits de l'homme. Il fallut attendre une nouvelle dégradation de la situation économique et de la sécurité interne fin 1993, début 1994, pour voir plusieurs donateurs réduire sérieusement ou même suspendre l'aide au développement. Mais ce revirement d'attitude, loin d'être inspiré par une préoccupation concernant la violence civile et les violations des droits de l'homme, était plutôt motivé (1) par le besoin d'augmenter l'aide humanitaire, dont une partie provenait de l'aide-projet restructurée, afin de répondre aux besoins du nombre sans cesse croissant de personnes déplacées à l'intérieur du pays et (2) par l'érosion de la responsabilité de projet et de l'efficacité de la mise en oeuvre dès lors que la situation du pays se dégradait rapidement.
L'opposition interne; la crise politique
L'État à parti unique était de plus en plus considéré comme l'obstacle plutôt que la route du développement. Ce point de vue fut largement propagé par les politiciens citadins de l'opposition et par le FPR. À partir de 1985, les rumeurs de corruption au sein du régime se firent plus insistantes (l'économie officielle en déclin ne pouvait plus offrir les mêmes avantages qu'auparavant). L'opposition politique à Habyarimana avait également le vent en poupe. Bien qu'officiellement, Habyarimana ait été réélu pour un septennat à la présidence avec 99,98 % des suffrages lors du scrutin du 19 décembre 1988, l'opposition interne commença à se faire de plus en plus entendre.
À l'instar d'autres régions d'Afrique au début des années '90, le Rwanda fut le théâtre en 1990 de plusieurs manifestations de protestation. Une grève fut réprimée par la police le 4 juillet 1990 et une lettre dénonçant le système du parti unique fut publiée et mise en circulation le 1er septembre. Autre événement important : la démission de l'archevêque catholique Vincent Nsengiyumva, du Comité central du MRND (sur la demande insistante du Pape). Jusqu'à ce jour, l'Église catholique et l'archevêque avaient été les alliés traditionnels du MRND. En avril 1990 et en septembre de la même année, à l'occasion d'une visite du Pape, l'église exprima son insatisfaction quant à la situation politique et économique du pays. Le mécontentement émanait cependant des échelons inférieurs de l'église. Les dirigeants des Églises catholique et anglicane continuèrent à entretenir des contacts étroits avec le président et son gouvernement pendant toute cette période (Reyntjens, 1994; African Rights, 1994).
Alors qu'en janvier 1989, le président Habyarimana considérait que le changement politique n'était possible que dans un système à parti unique, un an et demi plus tard, le 5 juillet 1990, il reconnut la nécessité d'une séparation entre le parti et l'État. Le 24 septembre 1990 (donc avant le conflit armé avec le FPR), une commission nationale d'experts fut créée dans le but d'élaborer une charte nationale qui permettrait la création de plusieurs partis politiques (Reyntjens, 1994). Il est difficile d'évaluer la sincérité du président au sujet des réformes. En tout état de cause, l'invasion du Rwanda par le FPR accéléra le processus de démocratisation.
Au départ, la commission d'experts avait un mandat de deux ans. La nouvelle situation politico-militaire après l'invasion du 1er octobre amena l'acceptation du système multipartite par Habyarimana dans un discours prononcé le 13 novembre, qui conduisit à la création de nouveaux partis politiques. En mars 1991, on assista au lancement public du Mouvement démocratique républicain (MDR) qui se veut le successeur du MDR-Parmehutu du premier président Grégoire Kayibanda. Environ la moitié des fondateurs du « nouveau » parti étaient originaires de Gitarama-Ruhengeri, fief traditionnel de Grégoire Kayibanda (Reyntjens, 1994). On vit également apparaître d'autres partis plus modestes qui allaient jouer un rôle dans le futur immédiat. Il s'agissait du Parti social démocrate (PSD) des « intellectuels » qui avait une certaine popularité dans le sud, du Parti libéral (PL) qui jouissait du soutien du secteur privé et, partant, du groupe tutsi, et enfin du Parti démocrate chrétien (PDC).
Mis à part leur opposition au régime d'Habyarimana, il n'y avait guère de différences idéologiques entre le programme de ces différents partis (Reyntjens, 1994).
Le système du parti unique fut officiellement aboli par l'adoption d'une nouvelle constitution le 10 juin 1991 et de la loi sur les partis politiques, une semaine plus tard. La place du Premier ministre fut institutionnalisée et des élections parlementaires furent prévues dans un futur proche par le président. Seulement six semaines plus tard, le 31 juillet 1991, les principaux « nouveaux » partis (MDR, PDC, PL et PSD) signaient une déclaration commune dénonçant le caractère prématuré des élections projetées. Des élections immédiates ne profiteraient qu'au seul MRND au pouvoir depuis deux décennies. En lieu et place, ils demandèrent la tenue d'une convention nationale pour discuter en détail la réforme des institutions et l'appel à des élections démocratiques.
Habyarimana rejeta l'idée d'une convention nationale. Seul le petit parti du PDC était disposé à faire partie d'un gouvernement de transition. Il n'y eut donc pas d'élections. Les autres partis de l'opposition montrèrent leur mécontentement en organisant des manifestations les 17 novembre 1991 et 8 janvier 1992 (Chrétien, 1992). Ce fut un revers majeur pour les velléités présidentielles de construire un front uni des partis hutus contre le FPR. Cela signifiait aussi l'introduction d'une politique de plus en plus violente de la part du régime Habyarimana envers l'opposition hutue et tutsie.
Le 6 avril 1992, sous la forte pression nationale et internationale, on assista à la mise en place d'un nouveau gouvernement de transition qui réunissait tous les principaux partis d'opposition et qui avait à sa tête le président Habyarimana et un Premier ministre de l'opposition (Dismas Nsengiyaremye, MDR). Mais les rapports entre Habyarimana et le MRND, d'une part, et les partis d'opposition, d'autre part, restèrent tendus pendant toute la durée du conflit avec le FPR. L'opposition interne était accusée avec véhémence de collaborer avec le FPR et les Tutsis qui étaient de plus en plus dépeints comme des ennemis ethniques.
La communauté internationale
La communauté internationale, et en particulier les deux grands donateurs bilatéraux, la Belgique et la France, ont joué un rôle prédominant tout au long du conflit. La Belgique s'est abstenue de toute intervention militaire. Son gouvernement retira ses troupes un mois après le début du conflit. Le gouvernement belge voulait donner une chance au processus de démocratisation et prônait une paix négociée, pour laquelle il ne ménagea pas ses efforts. L'ambassadeur de Belgique joua un rôle capital durant les pourparlers qui ont conduit à la mise en place d'un gouvernement de transition dirigé par Dismas Nsengiyaremye.
La France envoya 370 hommes au Rwanda en octobre 1990 et, après une réduction d'effectifs en mars 1991, fit passer ce nombre à environ 670 en février 1993, après une attaque à grande échelle menée par le FPR. Certaines sources accusent la France de soutien actif tant en 1990 qu'en 1993 (African Rights, 1994; Human Rights Watch/Arms Project, 1994; Prunier, 1995). Pendant ces derniers heurts, les Français furent aperçus « en train d'assister l'armée rwandaise pour bombarder au mortier des positions du FPR » (African Rights, 1994). « Des soldats français étaient déployés au moins à 40 km au nord de la capitale sur la route de Byumba, juste au sud de la zone de contrôle reconnue du FPR. Aucun ressortissant français ni expatrié occidental ne vivait à cet endroit. » (Human Rights Watch/Arms Project, 1994). D'aucuns affirment donc que les Français ont apporté un soutien important en plaçant des hommes aux points de contrôle et en conseillant les officiers des FAR; en donnant un entraînement militaire après le début du conflit; en envoyant un armement d'une valeur d'au moins USD 6 millions en 1991-92 et en fournissant des garanties financières à concurrence du même montant pour du matériel de guerre fourni par des tiers (Human Rights Watch/Arms Project, 1994). Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que le FPR ait exigé le départ des Français dès le début du conflit. Le gouvernement français a pourtant toujours nié toute participation active dans le conflit.
En ce qui concerne les pays africains, le rôle de l'Ouganda a déjà été abordé ci-dessus. Le président tanzanien a joué un rôle important en amenant les parties en conflit à la table des négociations à Arusha, ainsi que durant tout le processus de négociation. Le président zaïrois Mobutu Sese Seko participa également aux négociations de cessez-le-feu immédiatement après le début des hostilités. Le Zaïre n'a plus joué ensuite qu'un rôle secondaire. Lorsque le conflit éclata en octobre 1990, le Zaïre envoya 500 hommes au Rwanda pour aider les FAR à repousser l'invasion du FPR. Plusieurs semaines après leur arrivée, ces troupes furent retirées sous prétexte de manque de discipline et de maltraitance de civils rwandais (Human Rights Watch/Arms Project, 1994).
À la suite de l'accord d'Arusha du 4 août 1993, les Nations Unies devinrent un des grands acteurs du conflit. En marge des gouvernements et des institutions internationales, les groupes de défense des droits de l'homme jouèrent un rôle important de 1990 à 1994 en émettant régulièrement des rapports dénonçant les violations des droits de l'homme par le régime d'Habyarimana.
L'influence réelle de la communauté internationale est difficilement mesurable. Cependant, la menace proférée en mars 1993 de mettre fin à l'aide, en réaction à une publication d'un rapport sur les droits de l'homme accusant Habyarimana de la mort d'au moins 2 000 civils, est généralement considérée comme l'élément qui a incité le président rwandais à reprendre les pourparlers de paix avec le FPR (Reyntjens, 1994).
Les bonnes années. À présent que l'on sait dans quelle horreur le régime Habyarimana s'est terminé, on a tendance à le diaboliser de A à Z. Cette réaction est compréhensible puisque l'esprit a tendance à passer l'histoire au crible d'une recherche de cohérence et de signification, quitte à commettre des anachronismes. Mais l'histoire est à la fois l'étude des discontinuités (« pourquoi les choses ne restent-elles pas toujours les mêmes » ?) et une réflexion sur la cohérence des choses. Les tyrans ne se comportent pas toujours de manière répugnante et, que ce soit à juste titre ou à tort, plusieurs d'entre eux jouissent d'une certaine popularité même si cela ne dure pas toujours. Sans même devoir quitter l'Est de l'Afrique, nous nous rappelons que la population de Kampala dansait et chantait dans les rues en janvier 1971 lorsque Amin Dada prit le pouvoir, qu'avant de replonger son pays dans la guerre civile et les querelles religieuses, le président Jaafar al-Nimeiry du Soudan jouissait d'une popularité énorme pendant plusieurs années et qu'en dépit des événements horribles qui ont marqué la fin de son règne en Somalie, Jaalle (le camarade) Siad Barre bénéficiait du soutien de tout son pays pendant les huit premières années de son régime. Des exemples similaires peuvent être cités presque à l'infini.
Le cas d'Habyarimana est similaire en quelque sorte. Lorsqu'il prit le pouvoir en juillet 1973, l'immobilisme politique et les luttes régionalistes intestines du régime Kayibanda avaient conduit l'élite dans un état de frustration contenue. Le retour artificiel, relevant du calcul politique, des persécutions d'antan dirigées contre les Tutsis effraya tant la communauté tutsie que les Hutus modérés. L'isolement international du pays avait mis ce dernier dans une situation délicate sur le plan diplomatique et même économique. Le coup d'État du général Habyarimana fut accueilli avec soulagement par les habitants des villes et avec indifférence par les masses rurales qui n'avaient que faire de la lutte pour le pouvoir à Kigali.
Les années suivantes, jusqu'en 1980, ne posèrent aucun problème particulier. Le pays restait petit, enclavé et pauvre, comme il l'avait toujours été, mais le nouveau pouvoir semblait assez modéré. Bien sûr, il insistait sur la réitération quasi rituelle des slogans idéologiques du « rubanda nyamwinshi » assimilant démographie et démocratie et les Tutsis étaient politiquement marginalisés. Pendant toute l'ère Habyarimana, il n'y eut aucun bourgmestre ni préfet Tutsi (86), il n'y eut qu'un seul officier Tutsi dans toute l'armée et deux élus au parlement sur septante représentants; il n'y eut qu'un seul ministre Tutsi dans un gouvernement composé de vingt-cinq à trente membres. La politique des quotas qui avait cours sous le président Kayibanda, fut maintenue, bien qu'appliquée peu strictement, et les proportions de Tutsis dans les écoles et les universités étaient souvent un peu supérieures aux 9 % requis. Il en allait de même dans la fonction publique, encore que sachant qu'ils risquaient à tout moment de devenir les victimes d'une discrimination officielle prônée par le régime, les Tutsis préféraient, lorsqu'ils en avaient le choix, travailler dans le secteur privé. L'armée était naturellement l'organe étatique le plus strict et ses membres se virent même interdire d'épouser une femme tutsie. L'église, bien que sous domination hutue, resta plus ouverte et une mesure d'égalité institutionnelle était de mise dans le clergé; dans les années 1980, trois des huit évêques rwandais étaient Tutsis. En ce qui concerne l'emploi dans le secteur privé, leur niveau d'éducation et un certain savoir-faire avec les étrangers permirent aux Tutsis de prendre un certain ascendant sur les Hutus (87).
L'un dans l'autre, les Tutsis n'avaient pas la vie facile étant donné qu'ils étaient victimes d'une discrimination institutionnelle (88), mais dans la vie quotidienne, la situation restait tolérable. En comparaison avec les années Kayibanda, les choses s'étaient améliorées au point même que certains hommes d'affaires tutsis réputés avaient fait fortune et étaient en très bons termes avec le régime. L'accord tacite était « Ne vous mêlez pas de politique, c'est la prérogative des Hutus ». Tant que les Tutsis respectaient ce principe, on les laissait généralement en paix.
Le général Habyarimana avait apporté la paix et la stabilité au Rwanda. Mais comme toujours, il y avait un prix à payer. Immédiatement après sa prise de pouvoir, il déclara hors-la-loi les partis politiques avant de créer, environ un an plus tard, en 1974, son propre parti, le Mouvement Révolutionnaire National pour le Développement (MRND). Le président défendit sa décision avec aplomb : « Je sais que certains sont en faveur du multipartisme mais en ce qui me concerne, je n'ai jamais eu la moindre hésitation en optant pour le système à parti unique ». (89) En 1978, l'article 7 de la Constitution consacra la règle du parti unique comme valeur fondamentale du régime. Le MRND était un parti véritablement totalitaire : tout citoyen rwandais devait en être membre, du plus jeune au plus vieux. Tous les bourgmestres et les préfets étaient choisis dans les cadres du parti. Le parti était omniprésent : chaque colline avait sa cellule et des fanatiques en quête de promotion et d'avancement passaient leur temps à espionner tous ceux qu'on leur disait de surveiller et même d'autres. Lorsque l'on regarde le Rwanda, il faut oublier les images d'une confusion tropicale bon enfant. La carte d'identité mentionnait le lieu de résidence de chaque habitant. Les voyages étaient tolérés mais pas les changements d'adresse sans motif valable. Il fallait demander l'autorisation de déménager. Sans motif valable comme s'inscrire dans une école ou trouver un travail, l'autorisation de changement de résidence n'était pas accordée, sauf si l'on avait des amis haut-placés. Le contrôle administratif était sans doute le plus strict du monde à l'exception des pays communistes. Au début des années 1980, cette législation fut utilisée pour arrêter des « femmes libres » qui vivaient à Kigali sans autorisation la plupart d'entre elles étaient, comme par hasard, les compagnes tutsies d'Européens.
Bien que le MRND fut le cadre administratif de référence incontournable de la vie publique dans le pays, il n'était pas supposé être un parti « politique ». En effet, le mot « politique » était quasiment une grossièreté dans le monde vertueux et travailleur du Habyarimanisme. D'importants efforts étaient déployés pour faire oublier du moins officiellement que la politique existait. Lorsque le régime décida finalement, en novembre 1981, après huit années de pouvoir, de créer un « parlement », celui-ci fut baptisé Conseil National du Développement. Le Rwanda était pauvre, propre et sérieux; il n'avait pas de temps à perdre à des frivolités telles que le débat politique. Il devint donc ce que le pasteur allemand Herbert Keiner, partisan de longue date du régime à l'instar de bon nombre de ses frères, qualifie de « ein Entwicklungsdiktatur (90) » (une dictature du développement). Reprenant des thèses qui rappellent quelque peu les théories européennes du XVIIIe siècle du « despotisme bienveillant », le président Habyarimana avait décidé de porter sur ses épaules le lourd fardeau de l'État afin que ses sujets puissent se consacrer entièrement à l'agriculture. Vu la pénurie de terres arables conjuguée à un accroissement démographique de 3,7 % par an, l'argument ne manquait pas de poids. Dans ce système, Habyarimana, seul candidat à l'élection présidentielle, fut triomphalement réélu en décembre 1983 et une nouvelle fois en décembre 1988, avec 99,98 % des suffrages. Les activistes du MRND qui avaient espéré « Ijana kw'ijana » (cent pour-cent) furent déçus (91).
Le système, bien qu'autoritaire, était quelque peu débonnaire et il fonctionnait sur le plan économique. En 1962, seuls deux pays au monde avaient un revenu par habitant inférieur à celui du Rwanda. En 1987, ils étaient dix-huit et, avec un revenu par habitant de USD 300, le Rwanda était à peu près comparable à la République populaire de Chine (USD 310). En fait, la dynamique de l'économie rwandaise dépassait celle d'autres pays de la région :
Évolution du revenu par habitant du Rwanda par rapport aux pays voisins
| Rwanda | Burundi | Zaïre | Oeganda Ouganda |
Tanzanië Tanzanie |
|
| 1976 | 7 | 11 | 16 | 33 | 25 |
| 1981 | 16 | 14 | 12 | 13 | 19 |
| 1985 | 18 | 11 | 9 | onbek. incon. | 21 |
| 1990 | 19 | 11 | 12 | 13 | 2 |
| Variation | |||||
| 1976-90 | +12 | | -4 | -20 | -23 |
Source : Banque mondiale, Rapports annuels sur le développement, compilé par Filip Reyntjens dans « L'Afrique des Grands Lacs en crise », Paris : Karthala, 1994, p. 35.
L'évolution sectorielle était encourageante. Le secteur primaire (cultures vivrières) qui représentait 80 % du PIB en 1962 était retombé à 48 % en 1986 tandis que le secteur secondaire était passé de 8 % à 21 % et les services de 12 % à 31 %. Le taux de mortalité était en baisse, les indicateurs de santé et d'hygiène s'amélioraient et l'éducation, bien que coûteuse et difficile à organiser compte tenu de la structure très dispersée de l'habitat, progressait. La proportion d'enfants scolarisés est passée de 49,5 % en 1978 à 61,8 % en 1986, malgré une croissance démographique énorme (92).
Sur le plan régional, le Rwanda jouait à la fois la carte francophone de l'Afrique centrale en devenant un membre clé de la Communauté économique des Pays des Grands Lacs (CEPGL) soutenue par Paris, créée en septembre 1976, tout en jouant la carte de l'ouverture au monde anglophone plus international lié à l'Est de l'Afrique, en participant à l'Organisation pour l'aménagement et le développement de la rivière Akagera (KBO), projet sponsorisé par la Banque mondiale en septembre 1977. Kigali espérait que sa participation à la CEPGL lui permettrait de trouver de nouveaux axes de transport vers Dar-es-Salaam et vers le Lac Victoria, tandis que sa participation au KBO ouvrait des perspectives de développement hydroélectrique.
Cette image modérément positive avait cependant des zones d'ombre. L'umuganda , travail de développement communal, auquel les paysans étaient supposés consacrer deux jours de leur temps, durait souvent quatre jours ou plus. Et contrairement à la description enthousiaste donnée par les cadres du parti, le travail était loin d'être volontaire. Dans certains cas, il s'apparentait davantage aux travaux forcés. Les critiques paternalistes de l'OIT condamnant ces pratiques tombèrent dans l'oreille d'un sourd, au Rwanda comme à l'étranger (93). A un autre niveau, la dépendance par rapport à l'aide étrangère, d'abord faible, devint significative vers la fin des années 1970 et prit des proportions énormes vers la fin des années 1980. Comme ironisait un ancien expatrié, le Rwanda n'était pas seulement le pays des 1000 collines, mais aussi le pays des mille coopérants (94). Selon l'OCDE, l'aide étrangère qui représentait moins de 5 % du PIB en 1973, était passée à 11 % en 1986 pour atteindre 22 % en 1991.
L'atmosphère du régime. Il n'est pas possible d'évaluer le Rwanda de la même manière que l'on évaluerait la République centrafricaine ou la Gambie. Le Rwanda était un pays mystique. Toutes proportions gardées, il peut être mis sur le même pied que des pays comme Cuba, Israël, la Corée du nord et le Vatican. Il s'agit à la fois d'un État idéologique où le pouvoir est un moyen de réaliser une série d'idées et d'une structure administrative de fait gouvernant un territoire géographique donné.
Nous avons vu au chapitre précédent comment les Belges ont mélangé opportunisme et fascination raciale pseudo-scientifique pour reconstruire un Rwanda néo-traditionnaliste plus réel en 1945 que le Rwanda découvert par le Comte von Götzen en 1894. Ce qui est intéressant, c'est que la « révolution démocratique » hutue de 1959 n'a pas changé les principaux traits de cette construction idéologique, mais s'est borné à en inverser les signes. Les Tutsis étaient toujours des « envahisseurs étrangers » venus de loin, mais cela voulait dire à présent qu'ils ne pouvaient pas être considérés comme de véritables citoyens. Leur gouvernement avait été grandiose et puissant : dans la nouvelle version de l'idéologie rwandaise, il était considéré comme une tyrannie cruelle et homogènement oppressante. Les Hutus étaient les « paysans indigènes » exploités par les envahisseurs aristocratiques : c'était à présent eux les habitants légitimes du pays. Les Hutus étaient la majorité démographique silencieuse, ce qui voulait dire qu'un gouvernement à domination hutue était automatiquement légitime et, qui plus est, par essence démocratique.
Autant la première version de l'idéologie rwandaise était une construction parfaite légitimant la domination exercée par quelques lignages tutsies sur l'ensemble de la société, petits Tutsis et Hutus confondus, autant la nouvelle version était un outil formidable permettant à la nouvelle élite de diriger les paysans hutus et la communauté tutsie, privée de tout droit de représentation. Les parallélismes sont frappants. Dans la version néo-traditionnaliste de 1931-1959, les petits Tutsis étaient fiers d'appartenir à l'« aristocratie ethnique » bien que cela ne leur rapporte pas grand-chose de plus que ce sentiment de supériorité. À présent, c'était au tour des Hutus de commettre la même erreur en se persuadant que comme le gouvernement était hutu, les humbles paysans des collines partageaient en quelque sorte ce pouvoir. Dans les deux cas, les élites ethniques ont approuvé et renforcé les fantasmes de leurs adeptes. Les Belges qui ont participé à la création de la version aristocratique du mythe, finirent par y croire et par admirer leur propre création. À leur tour, les coopérants contribuèrent à renforcer l'idée du « règne démocratique de la majorité » et finirent par admirer leur vertu consistant à aider des Africains si méritants. Le lien entre ces deux versions du mythe n'est autre que l'Église catholique qui admirait les Tutsis et les aida à gouverner. Maintenant, elle admirait les Hutus et les aidait à leur tour à gouverner. Dans les deux cas, ce rôle de l'église fut perçu (et abondamment expliqué) comme étant l'oeuvre de la divine providence et comme un grand pas en avant vers l'édification d'une société chrétienne au Rwanda (95).
Le pays vivait et respirait dans cette atmosphère. Tout était soigneusement contrôlé, propre et bien en ordre. Les paysans travaillaient dur, vivaient sainement et faisaient preuve de la reconnaissance voulue à leurs supérieurs sociaux ainsi qu'aux bénévoles expatriés qui les aidaient. La criminalité était pour ainsi dire inexistante, les quelques prostituées étaient périodiquement envoyées en rééducation et l'église s'opposait avec succès à toute tentative de contrôle des naissances en dépit de la poussée démographique. Bien que la Belgique soit restée le principal donateur d'aide étrangère, le Rwanda attirait également l'Allemagne, les États-Unis, le Canada et la Suisse (96), tous satisfaits de l'attitude du gouvernement envers les donateurs étrangers et de l'ordre général qui régnait dans le pays. Dans un sens, cette attitude des pays donateurs était compréhensible. Parson Keiner fait cette observation pertinente : « Au début des années 1980, on comparait la situation presque idyllique du Rwanda au chaos qui fit suite au règne d'Idi Amin en Ouganda, à l'apartheid Tutsi au Burundi, au socialisme africain à la mode tanzanienne et à la cleptocratie de Mobutu au Zaïre. Le régime rwandais avait donc beaucoup de points positifs . » (97)
Mais le problème, c'est que cette façade avenante reposait sur des fondations idéologiques extrêmement dangereuses. La version hutu de la mythologie culturelle rwandaise qui avait provoqué les accès de violence de 1959 et 1964 était toujours vivante. Et la paix ne pouvait être maintenue que par une lubrification financière suffisante de l'élite. Tout reposait sur une mécanique d'hypocrisie minutieusement contrôlée dans laquelle l'église jouait le rôle d'ingénieur en chef. On pouvait entendre la violence gronder juste en dessous de la surface. L'ex-président Kayibanda mourut en détention en 1976, sans doute affamé par ses geôliers (98). De 1974 à 1977, le chef de la sécurité, Théoneste Lizinde, et ses sbires tuèrent cinquante-six personnes, pour la plupart d'anciens dignitaires du régime Kayibanda, mais aussi d'inoffensifs hommes de loi ou d'affaires pris en grippe pour une raison ou l'autre (99).
L'ancien ministre de la coopération, Augustin Muyaneza (qui avait déclaré à un journaliste français durant les derniers mois du régime Kayibanda : « Nos partenaires français devraient comprendre une chose : notre pays est entièrement exempt de tout gaspillage et de toute corruption ») (100) est au nombre des prisonniers qui moururent en détention à une date inconnue entre 1974 et 1977. La cause de sa mort n'est pas établie : certaines sources affirment qu'il a été enterré vivant, d'autres qu'il a eu le crâne fracassé au marteau. Mais ce genre de détails étaient souvent tenus secrets et n'arrivaient pas aux oreilles des donateurs d'aide.
Les nombreux amis du régime allaient ensuite assister, incrédules, à une spirale pour violence en 1990-1994. À leurs yeux, toutes les critiques adressées à Kigali étaient inspirées par la sympathie pour ceux que le MRND appelait les fédéo-revanchards , les démons Inyenzi tapis dans l'ombre, attendant qu'une opportunité se présente de se ruer sur le pauvre petit Rwanda catholique. La révélation de la vertu meurtrière intrinsèque de l'idéologie rwandaise fut un choc qui mit à rude épreuve leur capacité de réflexion et d'autocritique. Certains, comme le pasteur Keiner que nous avons cité précédemment, ont su puiser dans leurs croyances morales indépendantes la force de revoir leur ancien enthousiasme. D'autres, motivés par un mélange de réelle sympathie « démocratique » parfois abusée (les rendant incapables d'admettre que des associés jusqu'alors apparemment « vertueux » puissent être capables d'obliquité morale) et d'incapacité à reconnaître qu'ils ont pu se tromper, insistèrent ou nièrent la nature de la réalité à laquelle ils étaient confrontés (101). Dans certains cas extrêmes, comme nous le verrons au chapitre 8, ce reniement a même conduit des ONG vertueuses d'obédience chrétienne et des individus honnêtes en d'autres circonstances, souvent proches des milieux démocrates-chrétiens européens, à ignorer le génocide et à essayer de continuer à aider les vestiges du MRND sous le couvert de l'aide aux réfugiés. Mais même si les germes de ces développements étaient déjà contenus dans l'idéologie rwandaise revisitée, comme un serpent venimeux encore à naître dans son oeuf, le régime Habyarimana fut globalement, jusqu'environ 1988, l'un des moins mauvais d'Afrique si l'on se base uniquement sur ses actions et pas sur son fondement intellectuel sous-jacent.
La crise. Le seul épisode malodorant en quinze années de pouvoir (de 1973 à 1988) fut la conspiration et la tentative de coup d'état fomentée en avril 1980 par l'ancien chef de la sécurité, Théoneste Lizinde. Si l'on voulait faire honneur aux schémas marxistes quelque peu mécaniques, il faudrait observer que le prix élevé du café a connu une diminution constante depuis 1977 pour se redresser après 1980 avant de finir par s'effondrer en 1986.
Les cours mondiaux de l'étain s'effondrèrent peu après ceux du café (1984-86) conduisant à la fermeture des exploitations minières au Rwanda. Comme c'est l'étain qui avait compensé la chute des prix du café en 1982-83, sa part dans les recettes d'exportation allant même jusqu'à atteindre 20% (le café avait représenté jusqu'à 75% avant de retomber à environ 50%), ce nouveau choc fit vaciller le Rwanda sur ses bases (102)...
Et l'on peut dire que la stabilité politique du régime a suivi exactement la même courbe que les prix. Le Rwanda est un pays extrêmement pauvre, fondé sur une agriculture vivrière, et dont la masse rurale ne génère que très peu de valeur ajoutée. L'élite du régime tirait sa richesse de trois sources : les exportations de café et de thé, les exportations d'étain (pendant une courte période) et les prélèvements sur l'aide étrangère.
Une bonne partie des deux premières devant servir au fonctionnement de l'État, la raréfaction des sources était telle en 1988 que seule la troisième offrait encore une alternative viable. Tout ceci ne fit qu'accentuer la compétition pour avoir accès à cette ressource très spécialisée que l'on ne pouvait s'approprier que par le contrôle direct des plus hautes sphères du pouvoir. Les différents accords conclus entre les clans politiques rivaux depuis la fin du régime Kayibanda commencèrent à se lézarder à mesure que les ressources se raréfiaient et que la lutte interne pour le pouvoir s'intensifiait.
Le premier signe que les choses tournaient mal fut le meurtre du colonel Stanislas Mayuya en avril 1988. Mayuya était un ami proche du président Habyarimana et des rumeurs persistantes faisaient état de son arrivée au pouvoir, éventuellement au poste de vice-président, en vue de le préparer à prendre la succession du président. Ce fut la perte d'un des principaux clans politiques du régime, d'abord appelé « le Clan de Madame » à Kigali puis « akazu » (103) . Comme son nom l'indique, le Clan de Madame se composait de membres de la famille de l'épouse du président et de leurs proches associés. Les principaux membres de ce groupe étaient ses trois frères, le colonel Pierre-Célestin Rwagafilita, Protais Zigiranyirazo et Séraphin Rwabukumba, son cousin Elie Sagatwa et leurs proches associés le colonel Laurent Serubuga et Noël Mbonabaryi. Ils étaient secondés par un certain nombre de serviteurs moins importants mais dévoués, parmi lesquels le colonel Théoneste Bagosora allait jouer un rôle capital par la suite. Trois raisons particulières permettent d'expliquer pourquoi le Clan de Madame joua un rôle aussi important dans le déroulement des événements.
D'abord, dans la tradition politique rwandaise que le régime Hutu du MRND avait héritée de Grégoire Kayibanda et des anciens Abami Tutsi, le dirigeant devait avoir des partisans qui étaient ses yeux et ses oreilles, des personnes extérieures à la structure officielle du pouvoir qui lui étaient entièrement dévouées et qui feraient n'importe quoi sans poser de questions. Les Abami avaient trouvé ce type de personnes au sein de leur propre clan Abayinginya et au sein de leur clan marital, l'Ababega. Le tout avec son éternel cortège de trahisons, conspirations, renversements d'alliances, etc. qui étaient le lot quotidien de cette cour florentine. Depuis lors, comme nous l'avons vu, les clans hutus étaient devenus en grande partie une construction politique de l'ordre politique tutsi au pouvoir, ils ne se prêtaient pas facilement à ce type d'utilisation car n'obtenant qu'un mince engagement de la part de leurs membres. Sous la république hutue, le régionalisme se substitua au clanisme. Le président Kayibanda monta plusieurs groupes les uns contre les autres et eut tendance à se reposer essentiellement, jusqu'au point de s'isoler, sur les gens de Gitarama. Et puis, il faut aussi compter avec la tendance inhérente à chaque « maffia régionale » qui consiste à créer des sous-unités en fonction d'une origine géographique définie avec précision.
Ensuite, vu sous cet angle, le président Habyarimana avait un problème. La Seconde République qu'il créa en 1973 était au départ une revanche des Rwandais du nord sur les Rwandais du sud du Parmehutu (104). Mais une fois qu'il fut clair que les portefeuilles ministériels, les opportunités économiques et les bourses d'études à l'étranger allaient avant tout aux Rwandais du nord, ceux-ci commencèrent à s'entre-déchirer pour savoir qui se taillerait la part du lion. Le président et son épouse favorisaient les gens de la préfecture de Gisenyi par rapport au groupe de la préfecture de Ruhengeri, dirigé par le ministre des Affaires étrangères Casimir Bizimungu et le ministre des Travaux publics Joseph Nzirorera. Ceux du clan de Ruhengeri furent donc contraints de jouer les seconds couteaux derrière ceux du clan de Gisenyi. Mais cela ne s'arrêtait pas là. Les faveurs étaient accordées en fonction de la commune d'origine et à ce niveau, le président avait une faiblesse. Le président Habyarimana était né dans la commune de Karago, mais il n'était pas « quelqu'un », il n'était pas issu d'un lignage respectable. En fait, des rumeurs persistantes rapportaient que son grand-père aurait été un immigrant provenant soit de la province ougandaise de Kigezi, soit de la province zaïroise du Kivu. Il était à plusieurs égards un homme seul, qui s'était forgé lui-même. Bien qu'étant devenu le mwami des Hutus, le shebuja à la tête du pays, il n'avait pas de véritables abagaragu qui soient dévoués entièrement à sa personne.
Enfin, le cas de la femme du président était différent. Agathe Kanzinga provenait de Bushiru et était la fille d'un de ces petits lignages Abahinza du nord qui dirigèrent de petites principautés indépendantes jusqu'à la fin du XIXe siècle et, dans certains cas même, jusque dans les années 1920. Elle et sa famille étaient très fières de leur lignage qui était vaste et bien connu. Le président s'en remettait donc au clan de sa femme et à ses abagaragu pour être ses yeux et ses oreilles. Elle devint si puissante qu'on lui donna le surnom « Kanjogera », en mémoire de la terrible mère du roi Musinga, qui tenait les rênes du pouvoir dans l'ombre du trône. Son époux se reposait sur elle et sur sa famille, mais peu à peu, il devint leur prisonnier et finalement leur victime. (105) Dans le climat de la fin des années 1980, alors que la compétition politique pour arracher le contrôle d'une économie en net recul s'intensifiait, les projets de succession que le président Habyarimana nourrissait pour le colonel Mayuya constituaient une grave menace pour le Clan de Madame qui risquait de perdre le contrôle du pouvoir à un moment où ce contrôle était plus vital que jamais car Mayuya était l'homme du président (l'un des rares! (106)). Le colonel Serubuga, un des akazu les plus puissants, organisa le meurtre de Mayuya. Le sergent qui appuya sur la détente fut par la suite assassiné en prison et le magistrat du ministère public en charge du dossier fut assassiné pendant l'instruction.
L'affaire Mayuya fut l'étincelle qui mit le feu aux poudres et il ne fallut pas attendre longtemps avant de voir les différents clans en venir aux mains en 1989, le budget fut réduit de 40%, mesure qui fut compensée en grande partie par une réduction des services sociaux (107). Cette mesure fut très mal accueillie par les paysans déjà écrasés par des taxes en tous genres (umusanzu , taxe sur l'eau, taxe sur la santé, droits d'inscriptions dans les écoles, etc.) et par des doses croissantes de travail « volontaire » (umuganda ) qui ressemblait plutôt aux travaux forcés, d'autant qu'il devait être accompli sur des terres qui étaient la propriété des « petits copains » du régime. La question de la distribution des terres devenait elle aussi de plus en plus épineuse. La surpopulation atteignait des niveaux critiques et un approvisionnement en denrées alimentaires de plus en plus marginal rendit le pays fortement dépendant des caprices de la météo. Une mini-sécheresse provoqua la famine de ruriganiza qui tua environ 300 personnes en 1988-89 et provoqua le départ de milliers de Rwandais qui franchirent la frontière tanzanienne en quête de nourriture. Le gouvernement essaya d'imposer un black-out de l'information sur la question, le chef de la sécurité, M. Augustin Nduwayezu, déclarant candidement à un journaliste belge : « Les journalistes ne devraient pas écrire d'articles qui risquent d'irriter les autorités supérieures » (108). Dans ce climat, les histoires d'accaparement de terres ont eu un effet particulièrement exaspérant sur les paysans : « L'accusation selon laquelle sous le couvert d'un projet de développement financé par la communauté internationale, les plus hautes autorités de l'Etat se sont approprié des terres qu'elles utilisent pour élever du bétail, a pris une valeur très symbolique et joué un rôle décisif dans le mouvement de déception qui naquit à ce moment » (109).
Ce à quoi le professeur Guichaoua fait ici référence sans le nommer, c'est le projet Gebeka, financé par la Banque mondiale, qui provoqua un grand scandale rapidement étouffé. Selon un de ses managers (110), tout ce projet était une supercherie. La forêt de Gishwati, une des dernières forêts primitives du Rwanda, fut sauvagement abattue pour défricher des terres qui ont ensuite été utilisées pour faire paître du bétail exotique importé d'Europe afin de monter une entreprise de produits laitiers. Bien que les terres et le financement soient publics, les profits générés par le développement furent partagés entre les bonzes du régime et des expatriés malhonnêtes de la Banque mondiale qui avaient investi dans le projet. Alors que la « révolution démocratique » de 1959 symbolisait le libre accès aux terres et au bétail pour les Hutus, avec la signification que l'on sait, l'arnaque de Gebeka porta un coup idéologique sérieux à cet idéal.
Le gouvernement essayait de se refaire une virginité, à grands coups d'hypocrisie moralisatrice, pour récupérer le terrain perdu en termes de bains de sang et de scandales financiers : les femmes libres de Kigali ont été arrêtées à plusieurs reprises et envoyées dans le camp de « rééducation » de Rwamagana (111), des commandos catholiques radicaux anti-avortement ont pillé des pharmacies afin de détruire les stocks de préservatifs avec l'approbation du ministère de l'Intérieur, de jeunes chômeurs, arbitrairement surnommés abanyali (bandits), étaient maîtrisés en rue, rasés puis envoyés en centre de « rééducation » et certains bidonvilles ont été démolis en partie sous prétexte qu'ils abritaient des « criminels ».
Ces mesures n'eurent pas d'effet durable et ne firent rien pour apaiser la tension politique. En août 1989, la députée Félécula Nyiramutarambirwa fut délibérément écrasée par un camion après avoir lancé des accusations de corruption à l'encontre du gouvernement dans des contrats de construction routière. Elle était originaire de Butare et on la soupçonnait d'y encourager l'opposition politique. En novembre de la même année, le père Silvio Sindambiwe, un journaliste qui avait son franc parler et qui avait signé des articles trop libertaires sur certaines pratiques douteuses du gouvernement, fut également tué dans un « accident de la circulation » simulé. D'autres journalistes qui tentèrent de relater ces faits furent arrêtés (112).
Le président Habyarimana se rendit à Paris en avril 1990 et à La Baule en juin pour y assister au sommet franco-africain. (113) Le président Mitterrand qui menait alors une politique africaine « libérale » et qui semblait vouloir lier l'aide économique à la démocratisation politique (114), conseilla à Habyarimana d'introduire le multipartisme au Rwanda. Habyarimana suivit promptement ce conseil et, alors qu'il avait toujours veillé à appliquer strictement le monopole politique du MRND, il déclara soudainement qu'il soutenait le multipartisme (juillet 1990).
Mais sa conviction personnelle en la matière semble avoir été assez superficielle. En tout cas, cela n'empêcha pas trente-trois intellectuels de signer un manifeste réclamant une démocratisation immédiate (août 1990). Il y avait de l'agitation dans les collines et les étudiants de Butare qui avaient fait une émeute en juin pour des raisons non politiques et qui avaient vu un des leurs abattus, se rendirent rapidement compte que leur mouvement était récupéré et amplifié. (115) Au début de l'automne 1990, l'arène politique rwandaise n'était plus qu'une crise grave et envahissante.
Les points 3.1.1 et 3.1.2., constituent, comme le chapitre 2, un bref aperçu du cadre général de l'ONU et des principes qui sous-tendent les diverses opérations de paix.
Les organes principaux des Nations unies, qui sont énumérés à l'article 7 de la Charte des Nations unies et dont les chapitres subséquents de la Charte des Nations unies règlent le fonctionnement, sont :
l'Assemblée générale;
le Conseil de sécurité;
le Conseil économique et social;
le Conseil de tutelle;
la Cour internationale de justice;
le Secrétariat.
Chacun de ces organes remplit des fonctions déterminées qui lui sont attribuées par la Charte.
Deux de ces organes ont joué un rôle important dans la décision de constituer une force de maintien de la paix au Rwanda (MINUAR) et dans l'exécution de celle-ci : il s'agit du Conseil de sécurité et du Secrétariat.
3.1.1.1. Le Conseil de sécurité
Le Conseil de sécurité a pour fonction principale, aux termes de l'article 7 de la Charte des Nations unies du 26 juin 1945, de veiller au maintien de la paix et la de sécurité internationales.
Depuis le 1er janvier 1966, le Conseil de sécurité se compose de 15 membres, dont cinq membres permanents ayant un droit de véto, à savoir la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie. Dix membres sont élus par l'Assemblée générale pour une période de deux ans; cinq membres sont remplacés chaque année. Pendant la période examinée par la commission, les États membres élus qui siégeaient au Conseil de sécurité étaient :
Membres non permanents du Conseil de sécurité
des Nations unies
| 1992-1993 | Verkozen 1 januari 1993 Élus le 1er janvier 1993 |
Verkozen 1 januari 1994 Élus le 1er janvier 1994 |
| Kaapverdische Eilanden/Îles du Cap-Vert | Pakistan | Rwanda |
| Japan/Japon | Brazilië/Brésil | Nigeria/Nigéria |
| Marokko/Maroc | Nieuw Zeeland/Nouvelle-Zélande | Oman |
| Hongarije/Hongrie | Spanje/Espagne | Tsjechische Republiek/République tchèque |
| Venezuela | Djibouti | Argentinië/Argentine |
Comme le montre ce tableau, le Rwanda était membre du Conseil de sécurité depuis le 1er janvier 1994 pour un mandat de deux ans. Il a été élu par l'Assemblée générale avec la majorité nécessaire des deux tiers. Il était l'un des deux pays africains membres du Conseil. Son élection a été obtenue en dépit du fait que ce pays faisait l'objet du déploiement de forces de maintien de la paix. (1a)
Le Secrétariat est dirigé par le Secrétaire général, qui est nommé par l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité.
Le Secrétaire général a notamment pour fonction de porter à l'attention du Conseil de sécurité toute affaire qui, à son avis, menace la paix et la sécurité internationales.
En 1994, la structure de commandement du Secrétariat, qui est aussi responsable de la gestion des opérations de maintien de la paix à travers le Département des Opérations de Peacekeeping (DPKO), était la suivante :
Structure de commandement de l'Administration du Conseil de sécurité des Nations unies

* DPKO : Department for Peacekeeping Operations.
La Représentation permanente belge
De plus, un rôle important a été joué par la représentation belge auprès des Nations Unies.
M. A. Brouhns, à l'époque premier secrétaire de la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'ONU à New York, a dressé un bref aperçu, lors de l'audition du 8 février 1997, du fonctionnement de la représentation permanente auprès des Nations unies. « Le rôle de la Représentation permanente auprès de l'ONU à New York est de servir de courroie de transmission entre le secrétariat ainsi que les États membres et le ministère belge des Affaires étrangères. Il s'agit aussi d'analyser le processus de décision du Conseil de Sécurité et d'informer le ministère des rapports de force existant au sein du Conseil. Le ministère est également informé par les ambassades ou les renseignements militaires, pour ne citer que ceux-là. La synthèse se fait à Bruxelles où les décisions sont prises. Quand le ministre envoie des instructions, la Représentation permanente essaie de convaincre les autres États membres.
En 1993, la Représentation permanente se composait de 13 diplomates (2a). Trois suivaient les dossiers du Conseil de sécurité et les huit autres l'Assemblée générale, les commissions et les institutions spécialisées. » (3a)
Selon M. Cools, il faut dûment se rendre compte de la situation dans laquelle se trouvent les États qui ne sont pas membres du Conseil de sécurité. Il s'est expliqué comme suit : « Durant la période concernée, la Belgique n'était pas membre du Conseil de sécurité et le problème est dès lors de savoir comment obtenir des informations. Je tiens à signaler que le Conseil de sécurité utilise des procédures très opaques (...). La Belgique devait donc, au moment qui nous occupe, mendier pour obtenir des informations. Nous avions de bons contacts mais nous ne connaissions pas les détails. » (4a)
En outre, un conseiller militaire auprès de la Représentation permanente était chargé des relations avec le DPKO : « (..) Lors de la première opération belge, dans le cadre de l'ONU, nous avons envoyé un militaire à New York auprès de notre représentant permanent. Sur des problèmes d'ordre purement militaire, notre représentation pouvait prendre des contacts directement avec le DPKO mais de manière informelle. » (5a)
Un conseiller militaire était donc chargé des relations avec le DPKO, mais « sur des questions n'engageant pas les Affaires étrangères. Ainsi, le planning des relèves des bataillons belges en Slavonie est une question technique sur laquelle nous pouvons directement entrer en contact avec les Nations Unies pour les informer. Il en va de même pour l'organisation de visites des autorités belges, pour lesquelles nous demandons l'autorisation aux Nations Unies, qui sont responsables de la sécurité et de l'accueil de ces personnes. » (6a)
Selon la Charte des Nations Unies, le premier but des Nations Unies est « maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin : prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l'ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix ». (article 1, 1.)
Les chapitres VI et VII de la Charte énoncent des mesures concrètes pour parvenir à ce but.
Le chapitre VI prévoit que le Conseil de sécurité peut faire des recommandations aux différentes parties d'un conflit afin de régler leurs différends par des moyens pacifiques. Une solution pacifique doit être trouvée par les parties elles-mêmes, sur une base volontaire, qui mettra en pratique les décisions du Conseil de sécurité. Si les moyens diplomatiques et les négociations échouent, et si le Conseil de Sécurité détermine qu'une menace contre la paix ou qu'un acte d'agression existe, des mesures d'imposition de la paix, prévues par le chapitre VII de la Charte peuvent être utilisées. Ces mesures vont de l'embargo économique et de l'isolement diplomatique à des actions militaires, si elles sont nécessaires pour restaurer la paix et la sécurité internationales.
Le chapitre VII de la Charte prévoit la situation de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression. Il met en place toute une panoplie de moyens d'actions contraignants dans ces hypothèses extrêmes (article 39) (7a).
Le dispositif établi par la Charte pour mettre fin aux litiges internationaux comporte deux phases principales. D'abord, il faut constater l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression (article 39). Ensuite, les Nations Unies adoptent éventuellement des mesures : mesures provisoires (article 40) ou recours à la force armée (article 42).
Durant la plus grande partie de l'histoire des Nations Unies, les antagonismes de la guerre froide ont bloqué en pratique les mécanismes du Conseil de sécurité (pour rappel, les décisions du Conseil de sécurité sont prises à l'unanimité des membres permanents et à la majorité de 9 membres sur 15) empêchant un travail réel. Pour sortir de cette impasse, le Secrétariat des Nations Unies a adopté une attitude pragmatique et novatrice : le mandat dit « Chapitre Six et demi ».
Ce nouveau concept, inventé par l'ancien Secrétaire général Dag Hammarskjold, combine la médiation, la négociation et les techniques pacifiques qui caractérisent le chapitre VI de la Charte avec l'emploi d'une force militaire qui trouve sa justification dans le chapitre VII, mais dans un rôle non répressif. C'est ce qui est parfois appelé « la première génération des opérations de maintien de la paix » (en anglais « peacekeeping operations » PKO) et décrit comme des opérations « classic » ou « traditionnelles ».
La fin de la guerre froide a vu se développer des concepts nouveaux, encore en élaboration.
Le concept de maintien de la paix a subi une profonde mutation, qui s'est traduite par une vision multidimensionnelle des opérations, englobant des composantes de nature militaire, policière, politique, électorale, humanitaire, économique ainsi qu'une référence aux droits de l'homme.
Parallèlement à cette évolution, la fin de la guerre froide a aussi eu pour effet d'ouvrir à l'usage des instruments du chapitre VII auparavant inutilisés.
Ces deux évolutions concomitantes ont suscité une prolifération d'idées et de propositionssur la manière « de renforcer le rôle des efforts de paix des Nations unies et de créer un nouvel ordre mondial ». Ce mouvement vers une application plus énergique de la Charte dans la résolution de conflits est apparu comme une réponse à une autre transformation du paysage géopolitique : la disparition du clivage est-ouest a modifié la nature de la plupart des conflits qui, de moins en moins, opposent des États et, de plus en plus, tournent à la guerre civile. Dans un tel contexte, le maintien de la paix s'avère plus complexe et plus aléatoire dans le mesure où certaines des conditions antérieures, et notamment le consentement et la coopération de toutes les parties, ne sont plus toujours réunies ou garanties pour un temps suffisant.
Dans une tentative de faire converger les deux tendances, le secrétaire général a présenté, en juin 1992, un rapport intitulé « Un Agenda pour la Paix » (8a). Il était assorti d'une série de recommandations portant notamment sur la diplomatie préventive et de nouveaux moyens d'utiliser la force militaire, soit pour rechercher la paix, soit pour répondre à des agressions, ou encore pour appliquer des cessez-le-feu. Il envisageait en outre une série de mesures d'« édification de la paix post-conflit » , en vue de promouvoir la confiance entre les parties et d'aider à la reconstruction des États saignés à blanc.
Dans l'état actuel des choses, on peut synthétiser comme suit la mise en oeuvre de la mission de maintien de la paix par les Nations unies :
Les interventions des Nations Unies peuvent être divisées en, d'une part, les opérations dites peacemaking ou peace-enforcing (actions coercitives basées sur le chapitre VII) et, d'autre part, les opérations dites peacekeeping (actions de maintien de la paix). En dépit d'une confusion récurrente, leur fondement juridique et leur portée diffèrent sensiblement. Par ailleurs, les Nations unies peuvent aussi prendre des « mesures provisoires ».
Tout d'abord, le Conseil de sécurité, dans le cadre du chapitre VII, peut adopter toute mesure provisoire qu'il juge nécessaire ou souhaitable (art. 40). Ces mesures peuvent être adoptées tant à l'égard des parties au conflit qu'envers des États non parties au conflit. Il peut s'agir de mesures militaires ou économiques les plus diverses : cessez-le-feu, embargo sur les fournitures des armes, démilitarisation de certaines zones. Le Conseil de sécurité peut rendre ces mesures obligatoires ou non.
D'autre part, toujours en vertu du chapitre VII, le Conseil de sécurité peut prendre deux types de mesures de contraintes : des mesures non militaires (art. 41) de type économiques et diplomatiques et des mesures militaires (art. 42), englobant le blocus et la guerre.
Enfin, il y a les mesures de maintien de la paix, issues de la pratique.
3.1.2.2. Les opérations de maintien de la paix Peacekeeping
L'action de maintien de la paix est une action non coercitive. Il s'agit d'un moyen d'action né on l'a dit de la pratique, sans base juridique formelle dans la Charte. Ce procédé est devenu l'un des moyens d'action des Nations unies les plus usités. Il a été mis au point lors de l'affaire de Suez. L'ONU y a recouru maintes fois ultérieurement, pour contribuer à désamorcer les conflits armés. On y recourt tant dans le cadre de conflits internes que dans celui de conflits internationaux.
La doctrine a tenté à de nombreuses reprises de définir ce type d'activités.
La définition donnée il y a près de vingt ans par le professeur Flory peut encore servir de base : « les opérations de maintien de la paix, ce sont toutes les opérations militaires et paramilitaires qui sont organisées sous la pression de la nécessité, faute de pouvoir mettre en oeuvre les mécanismes de l'article 43 » (9a), c'est-à-dire en l'absence des accords spéciaux visant à mettre des forces armées à la disposition de l'Organisation mondiale.
Cette définition permet de faire ressortir le fait que les opérations de maintien de la paix peuvent, a priori , se fonder à la fois sur le chapitre VI ou sur le chapitre VII.
Une définition plus pragmatique et plus actuelle, issue de l'observation de la pratique, est proposée par Marrack Goulding (ex-Under-secretary-general for peacekeeping operations) : « Field operations established by the United Nations, with the consent of the parties concerned, to help, control and resolve conflicts between them, under United Nations command and control, at the expense collectively of the member states, and with military and other personnel and equipment provided voluntarily by them, acting impartially between the parties and using force to the minimum extent necessary » (10a).
Cette dernière définition synthétise les caractéristiques essentielles des opérations de peacekeeping.
Primo, ce sont bien des actions des Nations Unies; elles peuvent être créées à l'initiative de l'un des organes législatifs des NU (Conseil de sécurité ou l'Assemblée générale sur la base de la Résolution nº 377) (11a). Elles sont placées sous le contrôle et la direction du Secrétaire général.
Secundo, la mise en place de ces forces est subordonnée à l'accord des États en conflit.
Tertio, les forces de maintien de la paix doivent être impartiales. Elles ne peuvent prendre parti.
Quatro, ces forces sont composées de contingents fournis par les États membres, placées sous l'autorité des Nations Unies : les « casques bleus ». Leur constitution dépend donc du bon vouloir des États membres.
Quinto, la mission reste pacifique. Elle ne peut être répressive ou coercitive. Le principe est le non-usage de la force. Celle-ci était strictement réservée au cas de légitime défense. Cette dernière notion a été, au fil du temps, interprétée de manière très large. Les troupes ont été autorisés à faire usage de la force en réaction « to attempts by force to prevent them from carrying out their responsibilities » (12a).
Jusqu'à ces toutes dernières années, les experts distinguaient essentiellement deux formules principales.
La première se limite à une mission d'observation et d'information. Elle est confiée à un nombre restreint d'observateurs militaires. Elle vise souvent à veiller au respect du cessez-le-feu entre les belligérants. En toute hypothèse, ces forces sont investies d'une mission de police et doivent demeurer neutres dans le conflit. Leur action, purement conservatoire, ne préjuge en rien du règlement du conflit.
La deuxième formule consiste à désigner une force armée plus conséquente chargée de s'interposer entre les adversaires, de manière à ce que la reprise des hostilités exige un acte de contrainte dirigé contre cette force. La logique de ces opérations voudrait qu'elles soient temporaires et, dès lors, de courte durée.
Les évolutions récentes ont compliqué un peu les choses. Il faut considérer que l'ensemble de situations possibles touchant /à la paix et la sécurité dans le monde/ est un continuum oscillant entre deux pôles : la paix et la guerre.
Les situations mouvantes auxquelles la communauté doit faire face dictent la séquence la mieux adaptée de ce que l'ONU appelle les « techniques de paix ». Essayer de classer les opérations en purs /chapitre VI/ ou /chapitre VII/ est illusoire, autant que d'essayer de maintenir les classifications qui ont prévalu pendant la guerre froide. Certaines situations requièrent l'application d'outils inspirés des deux chapitres, qui s'échelonnent du déploiement préventif au peace-enforcement pour imposer le respect d'un cessez-le-feu ou protéger la fourniture d'aide humanitaire aux populations, en passant par le peacekeeping « traditionnel », selon la typologie établie par Marrack Goulding, qui comprend six types d'opérations (13a).
La mission est définie par l'ONU en fonction de chaque situation. Le volume et la composition des forces multinationales diffèrent selon la mission assignée.
Le programme de mise en place est établi par le Secrétariat général, sous le contrôle de l'organe qui a décidé la création (le Conseil de sécurité ou l'Assemblée générale). Son commandant en chef est désigné par les Nations unies. Les États qui fournissent des contingents sont déterminés par un accord entre l'organe compétent et les États membres.
Les missions sont définies par l'organe des Nations unies qui décide leur organisation, ainsi que les États territoriaux concernés. Ces missions prennent fin avec la décision de l'organe compétent, ou avec le retrait exigé par l'État où stationne la force.
Ces missions sont concrétisées par un mandat, contenus dans une résolution de l'organe qui le décide. Des règles de comportement à suivre dans l'exécution de ce mandat, les « Rules Of Engagement » (ROE) sont définies. Enfin, le suivi de l'opération au niveau opérationnel est organisé.
3.1.3.2. Élaboration du mandat
M. Brouhns, lors de son audition du 28 février 1997, a résumé ainsi la procédure d'établissement d'un mandat de maintien de la paix (peacekeeping). « Lorsqu'une intervention est décidée, elle se caractérise par des moyens militaires et des règles d'engagement restrictives. Il s'agit d'un rôle d'assistance. On n'impose pas la paix, on veille à son respect.
Il y a deux exceptions au principe de non-usage de la force : la légitime défense des Casques bleus menacés et le cas où ils sont empêchés d'accomplir leur mandat par la force. (...)
Quand on évoque le maintien de la paix, fruit d'une résolution du Conseil de sécurité, il faut distinguer trois niveaux de commandement.
Tout d'abord, un mandat est un texte de compromis entre quinze pays. De ce fait, le mandat n'est pas toujours lisible et opérationnel. Je rappelle que la Belgique ne siégeait pas au Conseil de sécurité quand le mandat relatif au Rwanda a été voté (14a). Trois pays, les USA, la France et la Grande-Bretagne sont les trois membres permanents qui constituent le moteur de toute action.
Lorsqu'ils arrivent à un accord, la négociation s'étend à la Chine et à la Russie, plus passives, et ensuite aux pays non alignés qui gardent beaucoup d'influence à New York.
Ensuite, le second niveau de commandement est celui de la direction exécutive, c'est-à-dire le Secrétaire général. Enfin, le troisième niveau est le commandement sur le terrain, assuré par le chef de mission.
Certains États membres siégeant au Conseil de sécurité déterminent les mandats tandis que d'autres États envoient des troupes. Ceux-ci ne participent pas aux délibérations du Conseil ni aux trois niveaux de pouvoir susmentionnés » (15a). La Commission constate que la délégation belge auprès des Nations unies à New-York a, pendant cette période, envoyé au Ministère des Affaires étrangères des informations sur la position des différents pays du Conseil de sécurité concernant l'élaboration du mandat, et que la Belgique a été pressentie au début de septembre 1993 pour participer à une Force de maintien de la paix au Rwanda et que la résolution a été votée le 5 octobre 1993.
3.1.3.3. Élaboration des ROE (Rules of Engagement ou règles de comportement) (16a)
En règle générale, dans toutes les opérations de maintien de la paix, les ROE ne sont pas élaborées par le Conseil de sécurité, mais sur un canevas provenant du secrétaire général. Les ROE sont élaborées par le commandant de la Force, en collaboration avec les pays contributeurs de troupes.
3.1.3.4. Coordination entre le terrain et le département de peacekeeping
Une « situation room » a été créée en avril 1993 pour établir un lien de communication entre le terrain et le département de peacekeeping (DPKO) à New York.
Cette « situation room » , prévue au départ uniquement dans le cadre de UNPROFOR, a été créée à la demande de la Belgique, qui en a fourni le premier militaire.
La mission de la « situation room » était d'accélérer les flux d'information, de maintenir un contact par toutes les voies de communication possibles avec toutes les missions et ceci 24 heures par jour. En pratique l'information que le centre recevait des missions de la paix a très vite été formalisée, le centre exigeait un rapport de la journée précédente. Au début l'information reçue était purement militaire. L'information essentielle passait soit directement vers l'officier politique en charge de la mission soit directement au général Barril, ou au secrétaire général adjoint, M. Kofi Annan, responsable du DPKO, ou au Secrétaire général. L'information dont disposait le centre était donc très pauvre, très partielle. Pour résoudre ce problème, le centre a essayé de créer des liens avec d'autres sources d'information.
Ce centre a tenté de changer les mentalités à l'ONU puisque, pour la première fois, par la gestion de l'information et le contrôle des flux d'information, un point de contact unique était ainsi réalisé pour tous les départements. L'officier supérieur responsable n'a toutefois pas pu percevoir des informations pertinentes sur l'évolution de la situation au Rwanda, cette information pertinente étant conservée et n'étant échangée qu'entre quelques décideurs.
3.1.4. La décision d'intervention de l'ONU au Rwanda
Quand, le 5 octobre 1993, le Conseil de sécurité de l'ONU adopte sa résolution 872, autorisant l'établissement de la MINUAR, le Rwanda se trouve depuis plusieurs années à son agenda et à celui du Secrétaire général.
L'implication de l'ONU s'est concrétisée essentiellement par l'envoi de l'UNOMOG, groupe d'observateurs militaires neutres, dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu de N'sele, modifié lui-même deux fois (16 septembre 1991 à Gbadolite et le 14 juillet 1992 à Arusha). L'accord d'Arusha du 14 juillet 1992 créait une zone de sécurité entre la partie du territoire occupée par le FPR et le reste du Rwanda. C'est suite à cet accord que fut déployé l'UNOMOG (17a).
Par la suite, et en fonction de demandes formulées tant par le gouvernement de la République d'Ouganda que de celui de la République du Rwanda (22 février 1993) (18a), le Conseil de sécurité (résolution 846/1993 du 22 juin 1993) décida de la création de l'UNOMUR sur la frontière rwando-ougandaise.
Les accords d'Arusha dont les négociations furent entamées officiellement le 10 août 1992 pour se conclure, après divers rounds, le 4 août 1993, accorderont une place importante à la force internationale de maintien de la paix MINUAR. Une requête commune en ce sens est adressée dès le 14 juin 1993 au Président du Conseil de sécurité par le gouvernement rwandais et le FPR (19a).
Il importe de rappeler que durant cette période où se décidait la création de l'UNOMOG et, ensuite, de l'UNOMUR, de très graves troubles et massacres se déroulaient par intermittence au Rwanda (20a).
Le rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme des Nations unies, après une visite qui eut lieu du 8 au 17 avril 1993, déposa son rapport le 11 août 1993. Ce rapport contient des allégations extrêmement graves en matière de violations des droits de l'homme imputables aux forces gouvernementales et conclut notamment que certains massacres relèvent de la Convention sur le crime de génocide. Il formule douze recommandations générales en vue de prévenir la poursuite des massacres de populations civiles.
Il est à noter que l'on ne trouve aucune trace de ce rapport et à fortiori de ces recommandations dans les écrits officiels du Secrétaire général des Nations unies à cette époque.
3.1.4.1. Création de la MONUOR (21a)
Suite à l'incursion, le 8 février 1993, du FPR dans la zone tampon, les gouvernements du Rwanda et de l'Ouganda ont écrit séparément au Président du Conseil de Sécurité le 22 février pour demander que les Nations Unies installent une mission d'observation à déployer sur les 150 kilomètres de frontière commune (22a). Le gouvernement ougandais a expliqué que cette demande visait à prévenir toute propagation du conflit armé du Rwanda au territoire de l'Ouganda et à anticiper toute accusation d'ingérence ougandaise dans les affaires intérieures du Rwanda. Les forces internationales, comme l'a brièvement exposé l'Ouganda, devaient patrouiller, observer et veiller à ce qu'aucune assistance militaire ne soit prêtée au FPR depuis le territoire ougandais.
Par cette initiative, l'Ouganda a tenté de s'insinuer dans les bonnes grâces de la communauté internationale. Cependant, nous savons aujourd'hui qu'en pratique, son comportement ne correspondait pas à l'image qu'il souhaitait donner. Ainsi, l'Ouganda a-t-il continué, après la conclusion des accords d'Arusha, à soutenir en permanence l'armée des rebelles en lui fournissant des effectifs et des armes. C'est en tout cas ce que montrent une série de télex :
C'est ainsi que notre ambassadeur signale, dans le télex 994 du 4 octobre 1993, que la Première ministre Uwilingiyimana lui a fait remarquer « dat het FPR aarzelt om zijn demobiliseerbare eenheden op te geven en dat in sommige kringen vermoed wordt dat het FPR zelfs niet beschikt over voldoende eenheden om 40 % van het toekomstige nationale leger uit te maken. » Notre ambassadeur ajoute le commentaire suivant : « waardoor de veronderstelling zou bewaarheid worden dat talrijke elementen van het Ugandese leger aan de zijde van het FPR vochten. »
En tout cas, il a été difficile de contrôler. Précisément, nous avons souligné que la MINUAR avait l'intention, en mars 1994, d'acquérir des hélicoptères munis de détecteurs de nuit. Nous pouvons en déduire que pendant la période qui a précédé le mois de mars, le contrôle laissait pour le moins à désirer. L'Ouganda ne le facilitait en tout cas pas. Dans le télex 1142 du 16 novembre 1993, notre ambassadeur signale : « Le général Dallaire n'a pu rendre visite à la MONUOR comme il en avait l'intention suite au refus des autorités ougandaises de lui permettre l'accès au territoire ougandais. »
Dans le télex 64 du 23 janvier 1994, l'ambassadeur ajoute : « UNAMIR meldt ons dat MONUOR belemmerd wordt in zijn waarnemingsaktiviteiten op Oegandees grondgebied. Terzelfdertijd worden FPR-vrachtwagens gemeld die Rwanda 's nachts vanuit Oeganda ravitailleren (levensmiddelen, wapens ?). »
M. Boutros Boutros-Ghali esquisse la création de la MONUOR comme suit : « Le Conseil de sécurité s'est réuni en consultations informelles le 24 février 1993 pour examiner ces requêtes. Suite à ces consultations, j'ai envoyé une mission de bon vouloir au Rwanda et en Ouganda pour organiser des rencontres susceptibles de m'aider dans la rédaction de recommandations sur l'opération d'observation. La mission a visité la région du 4 au 19 mars 1993, ne se rendant pas seulement au Rwanda et en Ouganda mais aussi à Dar es-Salaam pour les consultations avec le Secrétaire général de l'OUA, Salim Salim, le coordinateur des négociations d'Arusha.
Durant son séjour au Rwanda, la mission surveillait l'accord de cessez-le-feu de juillet 1992. Le NMOG se composait d'observateurs du Mali, du Nigeria, du Sénégal et du Zimbabwe, de représentants de l'armée gouvernementale rwandaise et du FPR.
Le 7 mars 1993, alors que la mission de bon vouloir se trouvait au Rwanda, le gouvernement rwandais et le FPR ont fait un communiqué à Dar-es-Salaam réinstituant le cessez-le-feu et annonçant la reprise des pourparlers de paix d'Arusha. Dans sa résolution 812 (1993) du 12 mars, le Conseil de sécurité s'est réjoui de ce développement et a appelé les deux camps à respecter le cessez-le-feu et à permettre la distribution de colis humanitaires. Le Conseil m'a également invité à examiner, en consultation avec l'OUA, la contribution que les Nations Unies pourraient apporter au renforcement du processus de paix au Rwanda, y compris l'établissement possible de forces d'observation internationales « chargées (...) d'apporter une assistance humanitaire, de protéger la population civile et de soutenir les forces de l'Organisation de l'Unité africaine dans le contrôle du cessez-le-feu ».
Les pourparlers de paix d'Arusha ont repris le 16 mars 1993, un représentant des Nations Unies participant aux négociations en tant qu'observateur. Les consultations entre les Nations Unies et l'OUA, telles que demandées par le Conseil de sécurité, ont été entreprises dès que la mission de bon vouloir a rencontré le Secrétaire général de l'OUA durant sa visite à Addis-Abeba du 17 au 19 mars. Le Secrétaire général de l'OUA, Salim Salim, a demandé l'assistance des Nations Unies dans la poursuite des efforts déjà déployés pour étendre la supervision du nouvel accord de cessez-le-feu. Suite à un échange de lettres entre M. Salim Salim et moi-même, j'ai déployé deux représentants à Addis-Abeba chargés d'apporter une assistance technique à l'OUA pour soutenir ses efforts de paix.
Conformément à la résolution 812 (1993) du Conseil de sécurité, une mission technique des Nations Unies s'est rendue, sur mes instructions, au Rwanda et en Ouganda du 2 au 6 avril 1993 pour évaluer les possibilités du déploiement d'une mission de contrôle des Nations Unies le long de leur frontière commune. Lors de leurs réunions avec la mission technique, les gouvernements rwandais et ougandais ont réitéré leur soutien au déploiement d'observateurs militaires à la frontière. Le FPR, qui contrôlait à peu près quatre cinquièmes de la zone frontalière, a toutefois fait savoir à la mission technique qu'il s'opposait au déploiement d'observateurs du côté rwandais de la frontière, mais qu'il ne voyait aucune objection à un déploiement sur le territoire ougandais. Dans une lettre du 18 mai 1993 au Président du Conseil de sécurité, le gouvernement ougandais a dit qu'il était prêt à accepter l'installation d'une équipe de contrôle du côté ougandais de la frontière sans insister sur un déploiement simultané du côté rwandais. Après sa visite dans la région, la mission technique a conclu à la faisabilité d'une telle opération.
En conséquence, j'ai recommandé dans un rapport au Conseil de sécurité du 20 mai 1993 (23a) que le Conseil établisse une mission de 81 observateurs militaires pour surveiller la frontière entre l'Ouganda et le Rwanda. Ce genre d'opération avait pour but de soutenir les pourparlers de paix en cours à Arusha et d'encourager les deux camps à poursuivre leurs efforts de réconciliation nationale. Le 22 juin, le Conseil a adopté la résolution 846 (1993) instituant la Mission d'observation des Nations Unies Ouganda-Rwanda (MONUOR (24a)), à déployer du côté ougandais de la frontière commune. Le Conseil a décidé que la MONUOR surveillerait la frontière pour veiller à ce qu'aucune assistance militaire n'atteigne le Rwanda, en se concentrant surtout sur le transit ou le transport, par route ou chemin de fer, de toute arme meurtrière et de munitions à travers la frontière. Une équipe de reconnaissance de la MONUOR, conduite par l'observateur militaire en chef de la mission, est arrivée en Ouganda le 18 août; le reste des observateurs du Bangladesh, du Botswana, du Brésil, de Hongrie, des Pays-Bas, du Sénégal, de Slovaquie et du Zimbabwe fut déployé et devint opérationnel fin septembre. »
Le contenu des accords d'Arusha a été traité. Cependant, il est pertinent de rappeler le rôle que ces accords réservaient à l'ONU.
Les accords d'Arusha demandaient aux Nations Unies de jouer un rôle de soutien majeur pendant une période de transition de 22 mois (protocole sur différentes questions et dispositions finales, article 22), commençant par l'installation d'un gouvernement transitoire à large base et se terminant par l'organisation d'élections nationales (protocoles sur le partage du pouvoir).
Les accords veillaient à l'intégration du NMOG (Neutral Military Observer Group) dans la nouvelle force de contrôle internationale (Protocole sur l'intégration des forces armées des deux parties, article 53). La force NMOG originale de 55 observateurs a été remplacée début août 1993 par NMOG II et comptait 132 observateurs au moment où les accords d'Arusha ont été conclus (25a).
3.1.4.3. Établissement de la MINUAR
Suite aux accords d'Arusha, les organes de l'ONU ont entamé le processus d'élaboration du mandat de la MINUAR, qui allait être concrétisé dans la résolution 872.
M. Boutros Boutros Ghali en fait la synthèse suivante : « Le 24 septembre 1993, j'ai présenté au Conseil de sécurité un plan opérationnel relatif à la proposition d'installation de forces de maintien de la paix des Nations Unies au Rwanda. Le plan comportait un programme de déploiement en quatre phases et nécessitait pour les forces de maintien de la paix un effectif de 2 548 militaires, 18 civils et 3 représentants de la police civile. La phase un avait trait aux préparatifs d'établissement d'une zone de sécurité à Kigali et à l'installation du contrôle du cessez-le-feu entre les deux camps. Elle devait durer 90 jours et se terminerait par l'établissement du gouvernement de transition élargi à Kigali, prévu selon mes estimations pour la fin de 1993. À l'achèvement de la phase un, l'effectif des forces serait de 1 428, y compris 211 observateurs militaires. Les observateurs militaires travaillant avec la MONUOR seraient intégrés sous le commandement des nouvelles forces des Nations Unies à des fins administratives, mais le mandat MONUOR initial de contrôle de la frontière entre l'Ouganda et le Rwanda serait distinctement maintenu.
La phase deux de l'opération devait débuter le jour suivant l'installation du gouvernement de transition, pour se terminer approximativement 90 jours plus tard à l'achèvement des préparatifs de désengagement, de démobilisation et d'intégration des forces armées et de la gendarmerie. La surveillance de la zone démilitarisée existant le long de la frontière Rwanda-Ouganda allait se poursuivre, et l'opération comprendrait aussi la délimitation d'une nouvelle zone démilitarisée (ZDM) qui devait être étendue afin d'inclure des sites de rassemblement et des points de cantonnement pour l'exercice de démobilisation, ainsi que des centres de formation pour l'intégration des forces des deux camps. La mission aiderait aussi à assurer la sécurité dans et autour de Kigali en établissant une zone « sans armes » dans un rayon d'approximativement 10 kilomètres du centre de la capitale, zone dans laquelle les unités militaires des deux camps devaient déposer leurs armes et leurs munitions. La MONUOR et le NMOG II allaient être pleinement intégrés dans la mission durant la phase deux, et un deuxième bataillon d'infanterie devait rejoindre celui déjà en poste au Rwanda, portant ainsi les forces à un plein effectif de 2 217 soldats et de 331 observateurs militaires.
Durant la phase trois, qui allait durer à peu près neuf mois, le deuxième bataillon d'infanterie établirait et surveillerait la ZDM étendue, et aiderait au contrôle de la frontière Ouganda-Rwanda. Les forces devaient alors établir approximativement 26 points de rassemblement/cantonnement et centres de formation, dans le cadre du processus de désengagement et de démobilisation. Elles devaient aussi aider à maintenir la sécurité dans tout le pays et dans la capitale. Dès la fin de cette phase, on commencerait à réduire l'effectif de la mission, pour arriver approximativement à 1 240. Cette réduction devait faire en sorte que l'opération soit rentable (un bon rapport coût-efficacité), tout en maintenant une force crédible pour assurer la sécurité.
Durant la quatrième et dernière phase du plan de déploiement, le processus de désengagement, de démobilisation et d'intégration serait achevé. Cette phase durerait 10 mois et se terminerait par des élections. On continuerait à réduire l'effectif des forces, pour arriver à approximativement 930 membres de personnel militaire, dont 850 officiers d'état-major et soldats et 80 observateurs militaires.
La coordination d'activités humanitaires devait faire partie intégrante de l'opération. Après la signature de l'Accord d'Arusha, quelque 600 000 des 900 000 personnes déplacées au Rwanda sont rentrées chez elles. Leur retour atténua considérablement l'état d'urgence, mais l'assistance d'urgence resta nécessaire pour les 300 000 personnes restées dans les camps. Le coordinateur résident des Nations Unies au Rwanda, qui avait précédemment coordonné le travail d'organismes des Nations Unies avec celui de la communauté donatrice et d'organisations non gouvernementales (ONG), devait poursuivre son travail pendant la période de transition. Une fois le gouvernement de transition établi, les activités de soutien au rapatriement des réfugiés allaient commencer sous la coordination du HCR. Des travaux de déminage allaient également être entrepris, et une petite unité de police civile des Nations Unies devait être déployée pour vérifier que l'ordre public était effectivement et impartialement maintenu. Les fonctions de la police civile des Nations Unies devaient aussi inclure le contrôle des activités de la gendarmerie et de la police communale, le suivi de la réduction des forces de gendarmerie de 6 000 à 1 800 durant la phase de démobilisation et le suivi de la reconstruction des nouvelles forces (6 000) à mettre en place après des élections. Le contingent de la police civile (60 policiers) devait être dirigé par un commissaire de police et être déployé à Kigali et dans les principales préfectures.
En proposant ces éléments et d'autres du plan au Conseil de sécurité, j'ai insisté sur le fait que deux conditions essentielles devaient être remplies pour que les Nations Unies jouent leur rôle au Rwanda avec succès et efficacité. Premièrement, les deux camps devaient coopérer pleinement l'un avec l'autre et avec les Nations Unies, conformément à leurs engagements pris en vertu de l'Accord d'Arusha. Deuxièmement, les Nations Unies devaient pouvoir disposer en temps opportun des ressources humaines et financières nécessaires.
Le 5 octobre 1993, le Conseil de sécurité a autorisé, par un vote unanime de la résolution 872 (1993), l'établissement de la Mission d'assistance des Nations unies au Rwanda (MINUAR) et a accepté, comme je l'ai esquissé à grands traits dans mon rapport, le déploiement progressif de la mission. Le Conseil m'a demandé d'essayer de réaliser des économies lors de la planification et de la mise en oeuvre du déploiement progressif de la MINUAR. À cet égard, le Conseil m'a invité à examiner les façons de réduire l'effectif maximal total de la MINUAR, notamment par un déploiement progressif, sans qu'il y ait d'incidence sur la capacité de la mission à effectuer son mandat.
Le Conseil a donné à la MINUAR un mandat de six mois, mais a prévu qu'il réévaluerait la situation après les nonante premiers jours de la mission pour vérifier si des progrès substantiels avaient été faits ou non en vue de l'exécution des Accords de paix d'Arusha. » (26a)
Le secrétaire général ne signale pas que sa proposition constituait déjà un compromis.
Cela vaut également pour le nombre d'hommes : « One military expert in the Secretariat estimated that ideally, a mission of this kind should have 8 000. Dallaire proposed 4 500 as his maximum option. In the end, the Secretariat recommended a force only half that size, anticipating that this was the maximum that the Security Council would approve. Having exercised an anticipatory veto, the Security Council on 5 october authorized a force level of 2 548 military personnel without discussion.
The decisive restraint on the overal size of the mission was financing. Being assessed 31 % of the costs of UN peacekeeping, the United States insisted on a minimal force. The Clinton administration had just started an executive review of its UN policy, and was sensitive to Congressional concern over the mounting American share of peacekeeping costs, which had increased a stunning 370 % from 1992 to 1993. Emphasizing the bright aspects of the Rwandese situation, the costconscious US delegation in New York suggested in September that a token mission of some 500 men would suffice. The French mission in New York recommended a small force of around 1 000 men, noting that the French contingent in Kigali was merely 6-700 men. The end result of 2 548 was more than a token force, and at that time considered quite acceptable by the Force Commander. UNAMIR was estimated to cost about US $ 10 million a month, a very modest amount compared to other UN-peacekeeping operations. (e.g. UNTAC Cambodja : US $ 60-70 000 million a month) (27a).
On a ainsi réduit progressivement et systématiquement l'effectif : de 8 000 hommes dans le cadre de l'option idéale, celui-ci est passé à 4 500 hommes dans l'option nécessaire pour atteindre 2 548 hommes dans la proposition réalisable.
Quant au rôle de la MINUAR tel qu'il est défini par la résolution 872, il est lui aussi plus limité que ce qui était prévu dans les accords d'Arusha, et particulièrement dans le protocole relatif à l'installation de la force internationale neutre.
AA : « Assist in catering for the security of civilians » in the Report becomes : « to monitor the civilian situation through the verification and control of the Gendarmerie and the Communal police. » This is subsequently specified as monitoring with unarmed UN Police Observers, and in UNSC : « to investigate and report on incidents regarding the activities of the gendarmerie and the police ». Here the mandate becomes more delimited and specific and to that extent weaker.
The accords have two strong provisions for confiscating illegal arms : « Assist in the tracking of arms caches and neutralization of armed gangs throughout the country » and « assist in the recovery of all weapons distributed to or illegaly acquired by the civilians ». The Reports lists such activities as means of achieving the principal goals identified for NIF, notably : « Assist in tracking arms and neutralizing armed groups with armed UN Military Forces » and « Assist in recovering arms in the hands of civilians with armed UN Military Forces and unarmed UN Police Observers. » Significantly UNSC has no provisions at all for confiscating illegal arms. (28a)
Alors qu'il est question, dans le protocole d'accord, de « contribuer à la recherche des caches d'armes et à la neutralisation des bandes armées » et de « contribuer à assurer la sécurité de la population civile », la résolution de l'ONU définit de façon nettement plus limitée et moins précise le rôle de la MINUAR comme consistant à « contribuer à la sécurité à l'intérieur de la zone désarmée de la ville de Kigali » et à « exercer un contrôle sur la sécurité générale ». Cette définition sera plus tard déterminante en ce qui concerne les possibilités dont disposera la MINUAR sur le terrain.
« It is important to recall that this mandate grew out of but differed from what was envisaged in the Arusha Accords. In the central clauses defining UNAMIR's role in providing security, in protecting civilians, and in confiscating illegal arms, the Arusha Accords were significantly broader than the terms of the final UN mandate (29a).
Three documents deal with the mandate for UNAMIR... These are the Arusha Accords (thereafter AA), the report of the UN Reconnaissance Mission, headed by the future Force Commander, and which visited the region from 19 august until 3 september 1993 (thereafter « Report »), and the Security Council resolution 872 of 5 october 1993 (thereafter UNSC). A comparison of the three shows significant differences on key issues :
AA : « guarantee overall security of the country », in the report becomes « establish security zone in and around the capital city area of Kigali » and in UNSC : « contribute to the security of the city of Kigali inter alia within a weapon-secure area established by the parties in and around the city » i.e. a progressively weaker mandate. »
Si le mandat ne fait pas allusion au désarmement des civils, ce n'est ni un accident ni une omission, mais le fruit d'une volonté expresse. En effet, les États-Unis ont, pour cette raison, supprimé du mandat, par la voie d'amendement, la référence au rapport du secrétaire général du 24 septembre, parce qu'il y est bien question du désarmement des civils. En témoigne le texte des amendements des États-Unis à la proposition de résolution d'un groupe de travail du Conseil de sécurité : « replace « in paragraphs 21 to 26 and 39 to 43 of the report of the SG, which include in particular to » with the word « below » (the initial mandate was too broad, and included elements which we believe are inappropriate, such as disarming civilians. For that reason, we do not want to include a reference to paragraphs... in the resolution.) » (30a)
Ce n'est pas la seule modification que les États-Unis ont apportée au projet de texte. Ainsi le texte définitif de la règle du mandat « Contribute to the security of the city of Kigali... » est-il le résultat d'un amendement américain, alors que le texte original était le suivant : « Assist in ensuring the security of the city of Kigali... » ; les États-Unis ont également limité la possibilité d'assurer la sécurité des réfugiés et des personnes déplacées revenant au pays. Le texte du groupe de travail était le suivant : « To assist in providing security for the repatriation of Rwandese refugees and displaced persons ». Après un amendement américain, ce texte est devenu : « To monitor the process of repatriation... » (31a)
La délégation diplomatique belge auprès des Nations unies était, elle, consciente de cet affaiblissement : « Il est évident que le mandat de la MINUAR n'allait pas aussi loin que les accords d'Arusha. » (32a)
Le Premier ministre Dehaene a lui aussi déclaré : « Je savais qu'il y avait de fortes réticences au sein du Conseil de sécurité à l'égard du mandat et qu'il fut notablement réduit. » (33a)
À la question de savoir s'il savait que le mandat de la MINUAR était systématiquement vidé de son contenu en ce qui concerne les missions prévues qui ont été confiées à la force d'intervention neutre, le ministre Claes a toutefois répondu ce qui suit : « On ne m'a jamais informé que les accords d'Arusha étaient systématiquement vidés de leur contenu. » et « On ne m'a de toute façon pas demandé d'obtenir une amélioration du mandat, car personne n'en ressentait le besoin. Nous ne sommes donc pas intervenus, mais si nous l'avions fait, nous aurions, sans aucun doute, essuyé un refus catégorique des membres permanents. » (34a)
M. Brouhns confirme que la délégation belge n'a pas été chargée de tenter de renforcer le mandat de la MINUAR pour que celui-ci corresponde à la définition qui figurait dans les accords d'Arusha; il ajoute : « Tout d'abord, la marge de manoeuvre des pays qui participent aux opérations est faible. C'est en effet le Conseil de sécurité qui détermine le mandat, de concert avec le secrétaire général. Il est vrai que la Belgique était en contact permanent avec le secrétariat pour savoir à quoi ressemblerait le mandat. C'était, à l'époque, le meilleur mandat possible. » (35a)
La Belgique n'a donc pas fait usage de sa position-clé en tant que fournisseur de troupes potentiel le plus important, pour prendre des initiatives diplomatiques permettant de modifier la résolution des Nations unies. M. Brouhns déclare à ce sujet : « Nous n'avons pas reçu d'instructions dans ce sens. En outre, les pays fournisseurs de troupes ne disposaient d'aucune influence sur le processus de décision. (...) Il n'y a pas eu de refus de la Belgique d'agir sans un mandat plus fort. Cela n'aurait d'ailleurs pas changé la décision, mais l'aurait simplement retardée. » (36a)
De plus, il est étrange que, lors du processus décisionnel, le Conseil de sécurité n'a, à aucun moment, tenu compte des importantes violations des droits de l'homme, dont faisaient état divers rapports, notamment celui du Human Rights Watch (février 1992), celui du FIDH (mars 1993) et celui du rapporteur spécial de la Commission des Nations unies pour les droits de l'homme (avril 1993, publié le 11 août 1993).
C'est surtout ce dernier rapport qui est important, d'une part, parce qu'il a été rédigé par une organisation des Nations unies et, d'autre part, parce qu'il mentionne déjà un éventuel génocide et la nécessité de démanteler les caches d'armes.
Dans la résolution visant à créer la MINUAR, il n'est pas fait référence aux constatations qui ont été faites dans ce domaine, et l'on n'en tire pas davantage les conclusions qui s'imposent en ce qui concerne le mandat.
M. Ndiayé, rapporteur spécial, est très aigri lorsqu'il parle du manque d'intérêt qu'a suscité son rapport : « Mon rapport me fait penser à une bouteille qu'on jette à la mer. Il n'existe, en effet, aucun système qui permette de donner réellement suite à un rapport. On a certes pu le lire, mais j'ai l'impression qu'on n'en a pas tenu compte. » (37a)
D'habitude, le Conseil de sécurité ne semble d'ailleurs pas tenir compte des rapports de la commission des Nations unies pour les droits de l'homme, parce que le sujet des droits de l'homme est un sujet extrêmement sensible d'un point de vue politique :
« La politisation extrême de la question des droits de l'homme empêche la création d'une structure effective, car certains pays s'y opposent. Il faut donc faire appel aux bons offices du secrétaire général lorsqu'on veut aborder la question avec le Conseil de sécurité. » (38a)
« Je n'ai jamais été consulté lors de l'élaboration du mandat de la Minuar. C'est seulement à l'épreuve de la réalité que l'on peut juger de l'efficacité d'une mission ou d'un mandat. Je ne peux pas dire que mon rapport ait vraiment joué un rôle. »
« Il m'a semblé que la Minuar n'avait pas la capacité pour ouvrir le feu et pour protéger la population. Ses moyens n'étaient pas suffisants pour couvrir le pays... » (39a)
3.1.4.4. Décision de création de la MINUAR La résolution 872
« Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 812 (1993) du 12 mars 1993 et 846 (1993) du 22 juin 1993,
Réaffirmant également sa résolution 868 (1993) du 29 septembre 1993 relative à la sécurité des opérations des Nations unies,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 24 septembre 1993 (S/26488 et Add. 1),
Se félicitant de la signature de l'Accord de paix d'Arusha (y compris ses Protocoles) le 4 août 1993, et exhortant les parties à continuer de le respecter pleinement,
Notant la conclusion du Secrétaire général selon laquelle, pour permettre aux Nations unies de jouer leur rôle, les parties doivent coopérer pleinement l'une avec l'autre et avec l'Organisation en remplissant les engagements qu'elles ont pris dans l'accord d'Arusha,
Soulignant l'urgence qui s'attache au déploiement d'une force internationale neutre au Rwanda, telle que soulignée par le Gouvernement de la République rwandaise et par le Front patriotique rwandais, et réaffirmée par leur délégation conjointe dépêchée auprès des Nations unies,
Rendant hommage au rôle joué par l'Organisation de l'unité africaine (OUA) et par le Gouvernement de la République unie de Tanzanie dans la conclusion de l'Accord de paix d'Arusha,
Déterminé à ce que les Nations unies apportent, à la demande des parties, dans un esprit pacifique et avec l'entière coopération de toutes les parties, leur pleine contribution à la mise en oeuvre de l'Accord de paix d'Arusha,
1. Accueille favorablement le rapport du Secrétaire général (S/26488);
2. Décide de créer une opération de maintien de la paix intitulée la mission des Nations unies pour l'assistance au Rwanda (MINUAR) pour une période de six mois, étant entendu que celle-ci ne sera prolongée au-delà de la période initiale de quatre-vingt-dix jours qu'une fois que le Conseil de sécurité aura examiné un rapport du Secrétaire général indiquant si des progrès appréciables ont été réalisés ou non dans la mise en oeuvre de l'Accord de paix d'Arusha;
3. Décide que, à partir des recommandations du Secrétaire général, la MINUAR aura le mandat suivant :
a) Contribuer à assurer la sécurité de la ville de Kigali, notamment à l'intérieur de la zone libre d'armes établie par les parties s'étendant dans la ville et dans ses alentours;
b) Superviser l'accord de cessez-le-feu, qui appelle à la mise en place de points de cantonnement et de rassemblement et à la délimitation d'une nouvelle zone démilitarisée de sécurité ainsi qu'à la définition d'autres procédures de démobilisation;
c) Superviser les conditions de la sécurité générale dans le pays pendant la période terminale du mandat du gouvernement de transition, jusqu'aux élections;
d) Contribuer au déminage, essentiellement au moyen de programmes de formation;
e) Examiner, à la demande des parties ou de sa propre initiative, les cas de non-application du protocole d'accord sur l'intégration des forces armées, en déterminer les responsables et faire rapport sur cette question, en tant que de besoin, au Secrétaire général;
f) Contrôler le processus de rapatriement des réfugiés rwandais et de l'installation des personnes déplacées, en vue de s'assurer que ces opérations sont exécutées dans l'ordre et la sécurité;
g) Aider à la coordination des activités d'assistance humanitaire liées aux opérations de secours;
h) Enquêter et faire rapport sur les incidents relatifs aux activités de la gendarmerie et de la police;
4. Approuve la proposition du Secrétaire général d'intégrer la Mission d'observation des Nations unies Ouganda-Rwanda (MONUOR), telle qu'établie par la résolution 846 (1993) au sein de la MINUAR;
5. Se félicite des efforts et de la coopération de l'OUA pour aider à mettre en oeuvre l'Accord de paix d'Arusha, et notamment de l'intégration du groupe d'observateurs militaires neutres (GOMN II) dans la MINUAR;
6. Approuve de plus la proposition du Secrétaire général d'effectuer de façon échelonnée le déploiement et le retrait de la MINUAR et note, dans ce contexte, que le mandat de la MINUAR, s'il est prolongé, devrait s'achever à la suite des élections nationales et de la mise en place d'un nouveau gouvernement au Rwanda, événements programmés pour octobre 1995, en tout état de cause au plus tard pour décembre 1995;
7. Autorise dans ce contexte le Secrétaire général à déployer, dans les délais les plus brefs, pour une période initiale de six mois, un premier contingent à Kigali au niveau d'effectifs spécifié dans le rapport du Secrétaire général, dont la mise en place complète permettra l'installation des institutions de transition et l'exécution des autres dispositions pertinentes de l'Accord de paix d'Arusha;
8. Invite le Secrétaire général, dans le cadre du rapport auquel il fait référence dans le paragraphe 2 ci-dessus, à faire également rapport sur les progrès de la MINUAR à la suite de son déploiement initial, et se déclare déterminé à examiner en tant que de besoin, sur la base de ce rapport et dans le cadre de l'examen auquel il est fait référence dans le paragraphe 2 ci-dessus, la nécessité de procéder à des déploiements additionnels dont le volume et la composition seront conformes aux recommandations du Secrétaire général dans son rapport (S/26488);
9. Invite le Secrétaire général à étudier les moyens de réduire l'effectif maximum total de la MINUAR, sans que ceci affecte la capacité de la MINUAR à exécuter son mandat, et demande au Secrétaire général, lorsqu'il préparera et réalisera le déploiement échelonné de l'opération, de chercher à faire des économies et de faire rapport régulièrement sur les résultats obtenus dans ce domaine;
10. Accueille favorablement l'intention du Secrétaire général de nommer un Représentant spécial qui prendrait la tête de la MINUAR sur le terrain et exercerait son autorité sur tous ses éléments;
11. Prie instamment les parties de mettre en oeuvre de bonne foi l'Accord de paix d'Arusha;
12. Demande au Secrétaire général de conclure avec diligence un accord sur le statut de la MINUAR et de tout le personnel qui y participe au Rwanda pour que celui-ci entre en vigueur aussi tôt que possible après le début de l'opération, au plus trente jours après l'adoption de cette résolution;
13. Exige que les parties prennent toutes mesures voulues pour garantir la sécurité de l'opération et du personnel qui y participe;
14. Lance un appel pressant aux États membres, aux institutions spécialisées des Nations unies ainsi qu'aux organisations non gouvernementales, pour qu'ils fournissent et intensifient leur assistance économique, financière et humanitaire en faveur du peuple rwandais et du processus de démocratisation au Rwanda;
15. Décide de rester activement saisi de la question. (40a) »
M. Cools a déclaré à propos du mandat ONU que :
« Le 24 septembre 1993, le secrétaire général propose la MINUAR. Le mandat est clairement défini. Il s'agit d'une opération au cours de laquelle les deux parties doivent favoriser le processus de paix. Les Nations unies n'ont pour seule mission que d'apporter leur aide. La résolution stipule que les Nations unies doivent uniquement contribuer à la sécurité et au désarmement, contrôler le cessez-le-feu, enquêter en cas de non-application du protocole, surveiller le retour des réfugiés, coordonner l'aide humanitaire et faire rapport sur des incidents éventuels.
Le mandat impose également des limites financières. Le mandat durera six mois et ne sera prolongé au-delà de nonante jours qu'après avoir reçu les instructions nécessaires du secrétaire général. Le mandat expirera à la fin décembre 1995 au plus tard. La résolution impose aussi d'étudier la possibilité de diminuer les coûts et de réaliser des économies.
Les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Russie étaient à l'origine hostiles à l'opération. Petit à petit, ils y ont consenti. Dans la troisième phase, les effectifs atteindraient 2 500 hommes, mais ils devaient immédiatement être ramenés à 1 200 hommes. Sur ce point, il fut possible d'aboutir à un compromis (41a).
Globalement, les Nations unies réunissaient toutes les conditions pour une opération sous le chapitre VI. Le plus important, était que les deux parties demandaient l'opération, de telle sorte qu'il ne pouvait être question d'une ingérence dans les affaires intérieures (42a) ».
Ce mandat a donc été établi à la suite d'une négociation entre les pays membres du Conseil de sécurité, avec l'intervention du Secrétaire général de l'ONU, et dans les limites fixées par les accords d'Arusha. Le poids des membres permanents est bien sûr particulièrement déterminant dans de discussions. Dans le cas présent, ce sont les États-Unis et la France qui ont joué les premiers rôles. Les États-Unis ont fait montre d'une certaine inertie, « confirmant leur peu d'intérêt pour une nouvelle opération en Afrique », ainsi que le déclara M. Cools à la commission.
Aperçu chronologique des événements et des décisions qui ont mené à la décision du Gouvernement du 19 novembre 1993.
Le président du Rwanda et le président du FPR signent les accords de paix d'Arusha. Ces accords étaient le fruit d'un long processus de négociation qui s'est étendu du milieu de l'année 1992 jusqu'au 4 août 1993. Les accords d'Arusha formaient un ensemble, dont deux protocoles principaux relatifs au partage du pouvoir et un protocole militaire constituaient les éléments les plus importants. L'accord prévoyait l'installation d'un gouvernement de transition. En outre, les protocoles signés antérieurement entre les deux parties continuaient à faire partie de l'accord final. L'organisation d'élections libres devait former la clé de voûte du processus de démocratisation.
1º l'accord de cessez-le-feu du 12 juillet 1992
2º le protocole du 18 août 1992 relatif à l'État de droit
3º le protocole du 30 octobre 1992 et du 9 janvier 1993 relatif au partage du pouvoir
4º le protocole du 9 juin 1993 relatif au retour des réfugiés
5º le protocole du 3 août 1993 relatif à l'intégration des forces armées. Ce protocole, qui portait sur l'intégration des forces armées, prévoyait de faire appel à une « Force internationale neutre » (FIN) sous le commandement de l'ONU, laquelle aiderait à désarmer, démobiliser et fusionner les deux armées et à créer la nouvelle armée. Cette force contribuerait également à assurer la sécurité générale dans le pays, à protéger les expatriés et à poursuivre l'aide humanitaire
6º le protocole du 3 août 1993 relatif à diverses questions.
Un représentant du FPR demande à la mission belge aux Nations Unies de veiller à un déploiement rapide de la FIN.
Cette démarche suit la demande commune du gouvernement rwandais et du FPR adressée au secrétaire général des Nations Unies, M. Boutros Boutros Ghali.
La mission belge auprès des Nations Unies est invitée de manière informelle à faire participer la Belgique à la force armée internationale. M. Cools a déclaré : « La Belgique est le premier pays sollicité » (43a). La Belgique est pressentie pour cette mission en raison des liens traditionnels qui existent entre elle et le Rwanda, de ses bons résultats aux cours d'opérations de paix antérieures et surtout parce que le FPR et le gouvernement rwandais ont insisté pour qu'elle prenne part à la mission de l'ONU. Le colonel Engelen a déclaré, lors de son audition du 16 avril : « À ma connaissance, l'initiative d'envoyer des paras belges émanait bien de l'ONU. C'est le major Martin qui m'en a personnellement fait part en m'expliquant que la Belgique était sollicitée, avec la priorité absolue, parce qu'elle était le seul pays à rencontrer tous les suffrages. L'ONU demandait 800 hommes. J'ai alors immédiatement envoyé mon rapport en Belgique en insistant pour que le général Charlier soit averti le premier. (..) La demande adressée à la Belgique, bien qu'informelle, était ferme » (44a).
Lors de la réunion du 5 mars 1997 de la commission spéciale, M. Leo Delcroix, l'ancien ministre de la Défense, interrogé à ce sujet, déclare qu'il était informé dès la deuxième quinzaine d'août, par le biais des Affaires étrangères, que la Belgique avait été invitée de manière informelle à participer à la FIN. Les Nations Unies demandaient 800 hommes.
M. Dehaene confirme la déclaration de M. Delcroix au cours de la même réunion de la commission spéciale : « En ce qui concerne le contingent envoyé au Rwanda, les premiers contacts à ce sujet furent noués au mois d'août entre le secrétaire général de l'ONU et notre ministre des Affaires étrangères » (45a).
À la suite de son entretien avec le major Martin, le colonel Engelen s'est informé sur la possibilité d'un commandement belge de l'opération.
Pour des raisons politiques, entre autre pour éviter au Rwanda que la MINUAR ne soit assimilée à la Belgique, le Gouvernement belge ne veut explicitement pas demander le commandement. Le chef de l'état-major a déploré cette décision lors de son audition.
Willy Claes, le ministre des Affaires étrangères de l'époque, informe le Conseil des ministres de la signature des accords d'Arusha. M. Claes communique également que le secrétaire général souhaite la présence d'un bataillon belge au Rwanda. On a demandé à la Belgique de fournir un bataillon de 800 hommes. Le débat sur cette question est porté à l'ordre du jour du Conseil des ministres du 17 septembre.
Après délibération, le Conseil des ministres approuve le principe de la participation de la Belgique à un contingent armé international pour le Rwanda, mais décide que sa participation sera limitée. L'effectif demandé par l'ONU est jugé trop élevé. Pour des raisons politiques et budgétaires, le Conseil écarte l'idée d'une présence prépondérante de la Belgique à Kigali. Une participation éventuelle de la Belgique au Rwanda rendait la continuation d'une présence en Somalie pratiquement impossible.
Le ministre de la Défense déclare que la Belgique pourra envoyer de 200 à 300 hommes seulement au Rwanda et non 800.
Présentation du rapport du secrétaire général de l'ONU. Il propose un plan opérationnel « Une mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda » (MINUAR), qui doit soutenir les différentes étapes du processus de paix. La mission UNOMUR sera intégrée dans la MINUAR. Le mandat de cette dernière est défini avec précision. Il s'agit d'une opération où les deux parties doivent mettre en oeuvre le processus de paix. Les Nations Unies doivent seulement les y aider. La force de paix aura quatre missions :
contribuer à la sécurité à Kigali;
surveiller le cessez-le-feu, y compris la création d'une zone démilitarisée et l'adoption de procédures de démobilisation;
surveiller l'état de sécurité jusqu'aux élections;
déminer.
La résolution qui sera ratifiée par le Conseil de sécurité prévoit que l'ONU doit uniquement contribuer à la sécurité et au désarmement, surveiller l'application du cessez-le-feu, enquêter sur la non-application du protocole, surveiller le retour des réfugiés, coordonner l'aide humanitaire et rapporter les incidents. Le mandat doit prendre fin au plus tard en décembre 1995. À la fin de la deuxième phase c'est-à-dire 90 jours après la formation d'un gouvernement , la MINUAR devrait compter un effectif de 2 548 hommes. À la fin de la démobilisation et de la fusion des armées, cet effectif devrait s'élever tout au plus à 1 240 hommes.
Lettre du ministre des Affaires étrangères Willy Claes à Warren Christopher, le ministre des Affaires étrangères des États-Unis à l'époque, dans laquelle il plaide avec insistance pour un déploiement rapide d'une force internationale au Rwanda.
Lors d'une visite dans notre pays, le président Habyarimana exprime le souhait de voir des Casques bleus de l'ONU arriver le plus rapidement possible dans son pays.
Le président déclare lors d'une conférence de presse que le ministre de la Défense Leo Delcroix ne lui a encore rien dit sur l'effectif que la Belgique compte affecter à la force de maintien de la paix.
Le Conseil de sécurité de l'ONU décide de créer la MINUAR (résolution 872). Il décide d'envoyer 2 600 hommes au Rwanda.
Le Conseil des ministres décide de fournir des troupes belges pour l'opération MINUAR. Cette décision est communiquée de manière informelle au secrétariat de l'ONU par le biais de la mission belge à New York. La communication à New York vise surtout à obtenir une demande formelle de participation de la Belgique.
Il est également décidé le 8 octobre d'envoyer une mission de reconnaissance au Rwanda. Cette décision est confirmée par le Conseil des ministres du 19 novembre (46a). On peut lire dans le procès-verbal du Conseil des ministres du 8 octobre 1993 que « le Conseil marque son accord sur l'envoi d'une mission de reconnaissance » (47a).
L'ONU adresse à la Belgique une demande formelle de participation. Les Nations Unies demandent 1 bataillon, soit 800 hommes (48a). Les militaires belges seront déployés à Kigali (49a).
Dans une note au ministre de la Défense, le lieutenant-général Charlier trouve bienvenue la décision de participer à l'opération au Rwanda. Dans la même note, il suggère que la participation à la force internationale au Rwanda offre un argument pour rejeter la demande d'une prolongation de la présence belge en Somalie (50a).
Dans un dossier que l'état-major général a remis au ministre de la Défense, l'on recommande de répondre favorablement à la demande de l'ONU relative à l'envoi de 800 hommes au Rwanda dans le cadre de l'opération de l'ONU. La note est accompagnée d'une annexe où figure le coût d'une opération basée sur un effectif de 600 hommes.
La mission de reconnaissance (Recce MINUAR) part pour le Rwanda. Le colonel Flament commandait un détachement de 25 hommes, dont 20 paracommandos.
Fin de la mission de reconnaissance au Rwanda. Le rapport de cette mission (daté du 2 novembre 1993) est remis, ensemble avec une lettre du général Dallaire du 31 octobre 1993, dans laquelle il insiste pour un déployement rapide du contingent, au ministre de la Défense nationale le 10 novembre 1993. Dans un message qu'il adressera au ministre le 10 novembre, le lieutenant-général Charlier émet des réflexions critiques quant à la préparation des Casques bleus belges.
Le message était très spécifique et portait sur des points (procédures, commandement, armement) qui, par la suite, allaient causer des difficultés croissantes sur le terrain.
Le ministre de la Défense Leo Delcroix reçoit une note émanant du lieutenant-général Charlier, chef de l'état-major. Dans sa note, celui-ci plaide pour un effectif de 600 hommes (51a). « En conclusion j'estime que le contingent que la Belgique enverra au Rwanda, sous le couvert de la MINUAR, doit être fort d'au moins 600 hommes ... » (52a). Cette proposition du commandement de l'armée était fondée sur le rapport de l'unité de reconnaissance belge au Rwanda.
Le Conseil des ministres tenu le 8 novembre 1993 décide de convoquer le cabinet restreint en réunion spéciale pour le 10 novembre (53a).
Lors de sa réunion spéciale du 10 novembre, le cabinet restreint se déclare disposé à envoyer deux compagnies de 150 hommes ainsi que les éléments d'appui nécessaires et le personnel d'état-major. Dans sa note au Premier ministre Jean-Luc Dehaene, M. Delcroix, ancien ministre de la Défense, formule sa proposition de la manière suivante :
envoi de deux compagnies;
avec 50 à 70 hommes pour l'appui logistique (état-major 40, 15 à Djibouti et 15 au Kenya);
les deux compagnies à charge du budget de la Défense et le reste à charge du budget de la Coopération au développement;
la Belgique revendique la zone du centre ainsi que la Quick Reaction Force (QRF);
le coût par personne est de 2,6 millions de francs par an (coût réaliste).
Nous retenons les éléments suivants des conclusions qui ont été formulées à l'époque par le Premier ministre à la suite de cette proposition :
impossibilité, pour des raisons tant politiques que financières, d'accéder à la proposition de l'état-major de l'armée;
en ce qui concerne la proposition opérationnelle, le cabinet est disposé à envoyer 300 hommes + 70 hommes;
M. Claes et M. Delcroix établissent les contacts nécessaires avec l'Autriche en vue d'obtenir une contribution de ce pays;
aspects budgétaires;
dans la mesure du possible, la décision sera mise en tête de l'ordre du jour du prochain Conseil des ministres;
si, pour une raison quelconque, l'état-major ne devait pas approuver la présente proposition, on renoncerait à participer à cette opération de l'ONU;
une présence trop forte de la Belgique dans cette opération constituerait une erreur politique (54a).
Dans une note au ministre de la Défense, le lieutenant-général Charlier proteste contre l'intention du Gouvernement de n'envoyer que deux compagnies à deux pelotons, soit 370 hommes. « Il s'agit finalement de la sécurité des soldats que nous enverrons là-bas, je me refuse de cautionner la faisabilité militaire de cette solution » (55a).
De JS, à Evere, un fax a été envoyé au Ministère de la Défense nationale, à l'attention du ministre Léo Delcroix. Dans ce fax, une proposition de communication, par laquelle JS marquait son accord sur le chiffre de 450 militaires, était soumise au ministre pour le Conseil des ministres du 19 novembre.
Le Gouvernement décide en définitive d'envoyer 370 hommes en se réservant la possibilité de porter l'effectif à 450 au cas où la sécurité des troupes l'exigerait. Nous lisons dans le compte rendu de la réunion du Conseil des ministres du 19 novembre 1993 que celui-ci a approuvé les points suivants :
participation, pour une durée d'un an, d'un détachement de 370 militaires à l'opération MINUAR;
augmentation de l'effectif du détachement à 450 militaires au maximum si cela devait s'avérer indispensable pour la sécurité du personnel;
dans l'attente de l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions statutaires en la matière, le personnel de l'opération MINUAR est soumis à un statut similaire à celui qui s'applique au personnel des opérations UNPROFOR et UNOSOM.
Les aspects budgétaires de cette opération sont assumés par :
la Coopération au développement versera un montant de 200 millions de francs sur le compte « Opérations humanitaires » de la Défense nationale;
les sommes qui seront remboursées par l'ONU seront également versées sur ce compte;
le solde du coût de l'opération sera financé dans le cadre de l'enveloppe de 98 milliards de francs du budget de la Défense nationale pour 1994, comme cela a été le cas jusqu'ici pour l'opération UNPROFOR en ex-Yougoslavie (56a).
Dans une communication faite à la presse, le Gouvernement et le ministre de la Défense nationale confirment que la Belgique participera à l'opération de maintien de la paix au Rwanda. Et le Gouvernement d'ajouter que les premiers éléments du détachement pour la MINUAR sont déjà partis à bord de cinq C-130 le 18 novembre, c'est-à-dire le jour avant que la décision ne soit prise (57a).
Au cours de ses réunions, la commission a accordé une attention particulière aux éléments politiques qui avaient ou non joué un rôle dans le processus décisionnel du Gouvernement belge. Outre l'aperçu des différentes phases de la prise de décision, la commission a estimé qu'il était tout aussi opportun d'énumérer et d'analyser les motifs et arguments sociaux, politiques et historiques dont le gouvernement avait tenu compte.
L'engagement politique de la Belgique au Rwanda depuis 1916 et les liens résultant d'une évolution historique entre les gouvernements successifs des deux États, y compris au cours de la période post-coloniale, expliquent que les relations bilatérales avec le Rwanda étaient sensibles. Le passé belge dans son territoire sous mandat, le fait que pour nombre de Belges, le Rwanda était devenu une seconde patrie, la position belge lors de la crise de 1990, le soutien aux accords d'Arusha ou la visite du président Juvénal Habyarimana en Belgique en octobre 1993 sont autant de facteurs qui ont vraisemblablement joué un rôle à la table des négociations du Conseil des ministres. La commission tenait dès lors à accorder suffisamment d'attention à ces éléments au cours des auditions.
La commission a cependant constaté que les éléments suivants ont joué un rôle important dans la décision belge de participer à la MINUAR.
3.2.2.1. L'incidence du passé colonial de la Belgique sur la participation à la MINUAR
Le Conseil de l'ONU a dérogé à une règle non écrite en envoyant au Rwanda des Casques bleus belges. Cette règle prévoit que l'on n'incorpore pas dans une force de maintien de la paix des troupes provenant de pays voisins ou de pays spécialement impliqués dans le pays ou le territoire de destination de la force de maintien de la paix. Cela signifie par exemple que les Casques bleus ne proviendront pas d'un pays susceptible de faire valoir des prétentions territoriales sur le territoire soumis à une opération de « peace-keeping » ou d'une ancienne puissance occupante ou coloniale.
Le Gouvernement était conscient de ce problème. Le Premier ministre Dehaene l'a dit au Sénat, le 22 avril 1994 : « Au moment de prendre la décision, on s'est également demandé, au sein du Gouvernement, s'il était opportun que la Belgique participe à une opération de l'ONU dans un pays avec lequel elle a eu précédemment des rapports coloniaux. »
Le Gouvernement a également motivé son idée initiale de ne fournir que 200 soldats (au lieu des 800 demandés) en arguant du fait que ce serait malsain, compte tenu « des liens actuels et passés ». Voici ce que dit le ministre Delcroix au Sénat de Belgique, le 23 septembre 1993 : « Nous avons cependant demandé aux Nations Unies d'être chargés d'une tâche de moindre importance que celle qui nous était initialement assignée. Plus de la moitié de l'intervention devait en effet être assurée par la Belgique. Nous devons considérer nos relations passées et présentes avec ce pays. »
Le 27 avril 1994, le ministre Claes expliqua également devant la Commission des Affaires étrangères de la Chambre que cette question avait été prise en considération dans le cadre de l'envoi de troupes au Rwanda, et en particulier de la décision de n'envoyer « que » 450 hommes : « Tout d'abord, nous estimions qu'il fallait garder une certaine prudence dans une région où nous avons joué un rôle pendant plusieurs décennies. Deuxièmement, conformément à une règle de l'ONU, il faut éviter, tant que faire se peut, d'intégrer des troupes des pays donateurs qui ont joué un rôle historique ou qui sont considérés comme voisins. »
Tout comme le professeur Suy devant la commission le 11 mars 1997, le ministre Claes annonça que l'ONU avait commencé à déroger à cette règle avant même de constituer la MINUAR : « Vous avez constaté comme moi que, depuis quatre ou cinq ans, l'ONU ne parvient plus à respecter cette règle à cause du manque de candidats prêts à fournir les troupes. »
Ce manque de pays donateurs a sans doute amené l'ONU en ce qui concerne la MINUAR à ne plus appliquer l'ancienne règle à la Belgique.
3.2.2.2. Les décisions d'octobre 1990
À l'automne de 1990, la problématique rwandaise a fait l'objet d'importantes discussions au sein du Gouvernement belge. Le 1er octobre 1990, des rebelles armés tutsis avaient fait irruption au Rwanda à partir de l'Ouganda. Plusieurs centaines de citoyens rwandais avaient cherché à rejoindre les milices dans leur progression. Le 3 octobre, le FPR n'était plus éloigné que de 60 kilomètres de la capitale Kigali. Bien que l'invasion fût généralement considérée comme une tentative de Tutsis exilés de reprendre le pouvoir, le FPR affirma poursuivre un objectif plus noble. Il se présenta comme une alternative de rechange au régime en place à Kigali, qui était accusé de corruption, de népotisme et de violations graves des droits de l'homme. Le 4 octobre, ils arrêtèrent leur progression à l'entrée de la capitale. Très vite, les premières fusillades se firent entendre à Kigali.
Le Gouvernement belge fut saisi du problème à ce moment. Jusque là, selon la déclaration du Premier ministre Martens devant la commission, « le Rwanda ne constituait pas un problème pour la Belgique ». Il était « considéré comme un pays politiquement stable et en cours d'évolution positive et efficiente vers la démocratie » (58a).
Plusieurs éléments intervenaient dans le débat qui se noua à l'époque quant à l'éventuelle intervention de la Belgique au Rwanda :
le 3 octobre, le président rwandais Habyarimana fut reçu par le Roi Baudouin et le Premier ministre. Il demanda un appui militaire et des troupes pour venir en aide à son gouvernement. « Le 5 octobre, on décida d'envoyer 500 paras à Kigali. Ils avaient pour mission de protéger les 1 600 Belges et de procéder éventuellement à leur évacuation. Leur objectif était d'occuper l'aéroport de Kigali. On décida également de livrer au Rwanda les munitions commandées auparavant à la FN. Nous avons fourni un avion pour livrer ces munitions » (59a);
la présence de 1 600 Belges qui risquaient de devoir être évacués;
« les liens historiques étroits de notre pays et le problème des réfugiés » (60a);
de multiples dénonciations de violations des droits de l'homme.
Une question annexe provoqua un débat important au Parlement; une lettre du Roi au Premier ministre, lui demandant de donner un soutien explicite au gouvernement Habyarimana fut dévoilée au public par un journaliste. La commission n'a pas pu découvrir quelle était la source de cette fuite qui avait découvert la couronne.
À ce sujet M. Wilfried Martens a répondu : « Je ne souhaite pas m'exprimer sur la façon dont le Roi est intervenu. Le Roi a le droit de mettre en garde, mais bénéficie quant au reste d'une immunité absolue. En cabinet restreint, j'ai lu une lettre du Roi avec son assentiment formel » (61a).
Le Gouvernement décida :
1º d'accélérer la livraison de munitions commandées précédemment à la FN, et de mettre un avion de transport C 130 à disposition pour assurer le transport;
2º de mettre sur pied une mission humanitaire afin d'assurer la protection de nos concitoyens (62a). Le Premier ministre a souligné « le caractère humanitaire de la décision du Gouvernement ». « Cette action a pris la forme d'envoi de troupes à Kigali » (63a). 500 hommes du régiment paracommando furent envoyés à Kigali.
3º « de tout mettre en oeuvre pour que les compatriotes qui le souhaitent, et en priorité femmes et enfants, puissent momentanément quitter le Rwanda » (64a).
Bientôt affluèrent des informations contradictoires sur les combats et le comportement des troupes. On fit état de brutalités et de massacres commis par l'armée régulière rwandaise.
La neutralité de la mission de nos troupes paraissait difficile à maintenir.
Le monde politique belge, tant l'opposition que certaines composantes de la majorité, s'émut de cette situation.
Des dissensions se firent jour au Gouvernement. De vives discussions eurent lieu, après la décision gouvernementale, au Parlement (65a).
En résumé :
L'intervention des troupes belges devait être basée exclusivement sur la protection de l'ensemble des résidents belges au Rwanda;
L'intervention de la Belgique au Rwanda ne pouvait être interprétée comme un soutien à la répression en cours dans ce pays;
Nos troupes devaient donc pouvoir assurer leur mission en toute neutralité;
Elles ne pouvaient pas non plus devenir une force d'interposition entre l'armée régulière et le FPR;
L'envoi de troupes devait être accompagnée d'une initiative diplomatique de la Belgique, visant à favoriser un règlement négocié au conflit.
Le 11 octobre 1990, le Gouvernement décida de supprimer l'aide militaire supplémentaire au Rwanda et, le 12 octobre 1990, une seconde livraison de munitions fut suspendue.
Il fut sursis à la décision de retrait des troupes, pour ne pas compromettre la recherche d'une solution pacifique au conflit (66a).
La décision de suspension de la livraison de munitions laissera des traces importantes dans la relation entre les deux pays.
« Dans un entretien avec M. A. Geens, à l'époque soit en novembre 1990 secrétaire d'État à la Coopération au développement, M. Habyarimana s'est plaint du refus d'une seconde livraison de munitions. Dans une lettre qu'il m'a adressée en mars 1991, M. Habyarimana me remercie de mes actions diplomatiques mais ne se plaint plus à ce sujet. » (67a)
Pour sortir de l'impasse, le Premier ministre décida d'envoyer une mission de négociation à Nairobi pour y créer un cadre diplomatique permettant de retirer les paras à brève échéance.
Le 14 octobre 1990, le Premier ministre Martens partit pour Nairobi en compagnie des ministres Eyskens et Coëme. M. Martens nota dans son agenda trois points d'action : un armistice, une ouverture politique entre le gouvernement rwandais et le FPR et une conférence régionale pour les réfugiés.
Le 17 octobre 1990, dans la ville tanzanienne de Mwanza, on put amener Habyarimana à engager avec l'opposition un dialogue politique, qui se concrétisa un peu plus tard dans les accords de Mwanza. De Nairobi, M. Coëme, le ministre de la Défense nationale de l'époque, put, au nom du Gouvernement belge, donner son accord pour le retour des troupes belges.
Le 1er novembre 1990, les paras quittèrent Kigali. Selon le professeur Reyntjens, notre Gouvernement a dès lors été beaucoup moins actif.
Les bonnes relations traditionnelles entre la Belgique et le Rwanda s'envenimèrent. Un certain nombre de témoins ont déclaré devant la commission que les décisions prises par la Belgique en ce qui concerne les livraisons d'armes étaient une épine dans le pied de bon nombre de Rwandais. « ... de antipathie en ontgoocheling die men had teweeggebracht, door het feit dat men in 1990 de wapens en munitie waarvoor men had betaald, niet had geleverd ... » (68a). Cette explication de Mme De Backer avait déjà été fournie précédemment par le colonel Vincent, qui, dans son témoignage devant la commission, avait précisé qu'il régnait effectivement, avant 1993, un sentiment antibelge qui « était dû à la non-livraison d'armes et de munitions pourtant payées en 1990. » (69a) Dans le cadre des missions qu'elle accomplissait au Rwanda en tant que journaliste, Mme De Temmerman a fait état d'expériences similaires : « ... tijdens één van mijn eerste gesprekken met Rwandezen werden de Belgen verantwoordelijk gesteld voor de inval van het RPF, want wij Belgen hadden niets gedaan om het RPF tegen te houden... Dat was er eigenlijk al van in 1990. » (70a)
Enfin, le Premier ministre Dehaene a fait savoir que, durant la période qui a précédé la décision de participer à la MINUAR, son ministre des Affaires étrangères, M. Willy Claes, avait bien dit « qu'il y avait certaines réactions et frustrations nées des événements de 1990, mais que l'on ne peut pas parler d'un climat antibelge généralisé » (71a).
Le fait que les événements de 1990 n'avaient pas encore été digérés au Rwanda et ont provoqué une certaine hostilité a également été confirmé par le major Podevijn, le capitaine Claeys et Eric Gillet. Même le général Rusatira, pourtant considéré comme appartenant à l'aile modérée, a reconnu devant la commission que, tout comme beaucoup d'autres Rwandais, il était mécontent de la non-livraison des armes et du retrait de la Belgique en 1990.
La commission constate que le Gouvernement était conscient de ce problème mais a estimé que ce n'était pas une raison suffisante pour ne pas participer à la MINUAR puisque les parties rwandaises concernées avaient insisté pour que la Belgique participe.
3.2.2.3. Le soutien aux accords d'Arusha
La décision du Gouvernement belge de participer à la MINUAR était basée en grande partie sur la confiance qu'avait le Gouvernement dans la possibilité d'exécuter les accords d'Arusha.
La commission a retenu en particulier les témoignages des hommes politiques qui avaient pris le 19 novembre 1993 la décision de fournir des troupes à l'opération de paix des Nations unies au Rwanda.
L'ambassadeur Swinnen, qui était à l'époque un observateur privilégié de l'élaboration des accords d'Arusha, a affirmé que les accords : « devaient répondre au difficile défi auquel le Rwanda était confronté, à savoir la réalisation d'un processus de réforme interne axé sur la mise en place d'une société démocratique et pluraliste. Pour la Belgique, les accords s'inscrivaient dans la logique de paix pour laquelle elle avait plaidé depuis octobre 1990. Il s'agissait d'une politique volontariste par laquelle nous entendions marquer notre solidarité avec un peuple ami. C'est ce peuple que notre pays a choisi résolument, non une des parties au conflit. Notre politique se caractérisait par la neutralité en raison, non pas des liens historiques, mais bien de notre foi dans le potentiel de ce pays. Il s'agissait d'une politique nuancée, équitable, objective et critique d'engagement et de solidarité. Il ne faut donc pas s'étonner que notre pays se soit déclaré prêt à participer à l'exécution des accords d'Arusha. La décision de participer à la MINUAR s'inscrivait dans le cadre de cette politique » (72a).
Le soutien aux accords d'Arusha était, d'un point de vue politique, incontestablement la raison principale pour laquelle la Belgique avait accepté que des militaires belges participent à la MINUAR. Le professeur Reyntjens l'a résumé comme suit : « La politique belge reposait sur trois piliers : le respect des droits de l'homme, le soutien au processus démocratique et l'appui aux accords d'Arusha. Cette politique belge de 1990 au 7 avril 1994 fut une bonne politique, neutre et équilibrée. La décision de la Belgique de collaborer était donc correcte. C'était également la conséquence de notre soutien volontariste aux accords d'Arusha. Les deux parties rwandaises demandaient d'ailleurs une participation belge. Le FPR a toutefois opposé son véto à la participation des Français (...) Personnellement, j'estimais que la participation à la MINUAR était la conséquence logique du soutien volontariste que notre pays a apporté au processus d'Arusha par le biais de notre ambassadeur Swinnen. » (73a)
Le Premier ministre Jean-Luc Dehaene partageait l'avis de son ancien ambassadeur au Rwanda. Au cours de l'audition du 5 mars 1997, le Premier ministre a analysé la politique du Gouvernement belge pendant la période précédant la décision du 19 novembre 1993 de la manière suivante : « À partir d'octobre 1990, avec les accords de Mwanza comme point de départ, la politique belge visait à trouver une solution politique et non militaire. L'accord de Mwanza fut un premier encouragement à des négociations politiques. Durant tout le processus de négociation, la Belgique a été un observateur actif. Étant donné les efforts constants pour aboutir à un accord politique et concrétiser les accords d'Arusha, c'était le couronnement de nos efforts. La décision de participer à l'opération des Nations unies, prévue dans les accords, était le prolongement logique de cette politique » (74a).
Le fait qu'il n'y avait « aucune divergence de vues au sein du Gouvernement au sujet de la politique à mener » (75a) ressort également de l'exposé que le ministre des Affaires étrangères, Willy Claes, a fait le 3 novembre 1993 au cours de la discussion relative au budget des voies et moyens pour l'exercice 1994.
Dans ses explications relatives aux crédits destinés aux Affaires étrangères, Willy Claes a affirmé : « Les relations avec le Rwanda sont résolument placées sous le signe du soutien que peut apporter la Belgique à la mise en oeuvre des accords d'Arusha »(76a).
Si, au sein du Gouvernement, il régnait un consensus quant au soutien à apporter à l'exécution des accords d'Arusha, l'état-major de l'armée accordait lui aussi beaucoup d'importance à la mise en oeuvre de ces accords.
Le lieutenant-général Charlier : « Donc un premier motif à mes yeux pour que la Belgique participe à la MINUAR était d'accompagner le processus d'Arusha, de donner le plus de chances possibles à ce processus d'aboutir pour que ces modalités concrètes et en particulier ces modalités militaires : la création de la zone démilitarisée, la zone libre d'armes, l'amenée des premières unités du FPR dans Kigali, la fusion des deux armées, l'entraînement à donner à ces deux armées; bref que tout ce processus ait toutes les chances de réussir puisque la Belgique appuyait le processus d'Arusha, il me semblait normal et il me semble encore normal qu'elle ait essayé d'accompagner ce processus. » (77a)
Néanmoins, le Gouvernement et les hommes politiques disposaient, avant le 19 novembre 1993, d'une série d'indices montrant qu'une hypothèque pesait peut-être sur l'exécution des protocoles d'Arusha.
Le lieutenant-général Charlier dit à ce sujet : « Il n'était en effet pas certain que le processus d'Arusha allait réussir, il existait un certain risque. Dès le début du processus, certaines voix s'étaient d'ailleurs déjà levées contre. La Belgique avait 1 500 ressortissants au Rwanda. Au point de vue militaire et politique, nous avions une responsabilité si le processus d'Arusha échouait. Dès août 1993, on avait annoncé que l'échec risquait de provoquer des violences. Le souci pour la Belgique était donc d'avoir une présence militaire plus forte que la dizaine de coopérants techniques sur place. Au point de vue militaire, nous avions fait l'expérience de la difficulté de mener une opération de rapatriement des coopérants. Le moment le plus critique est d'amener les premiers moyens. En participant à la MINUAR, nous pensions pouvoir éviter cette phase critique de l'opération. Si le processus d'Arusha avait réussi, nous possédions un tremplin pour la coopération future. Par contre, si le processus échouait, nous étions prêts pour assumer en toute sécurité une évacuation » (78a).
Dans une note du SGR du 6 août 1993, l'on signale qu'au sein du noyau hutu, il existait pas mal de mécontentement et d'opposition à ces accords, et que c'était également le cas dans des milieux militaires.
L'ambassadeur Swinnen, lui aussi, a brossé le tableau des obstacles entravant le processus d'Arusha. Au cours de son audition du 12 mars 1997, l'ambassadeur a déclaré que : « Des dissensions avaient déjà surgi au sein du MDR avant la signature des accords d'Arusha. À l'époque, ce parti était considéré comme le principal parti d'opposition en puissance. Les problèmes au sein du MDR et du Parti libéral étaient liés aux accords d'Arusha, mais également à des antagonismes régionaux et individuels. Nous étions convaincus que le centre politique ne résisterait pas à la bipolarisation et à la radicalisation des positions. Le souci de la « mouvance présidentielle » pour disposer d'une minorité de blocage dans les institutions de l'État ne fit que renforcer cette tendance. Les difficultés liées à l'article 11 du protocole concernant l'inculpation du président par l'Assemblée nationale en sont le résultat. » (79a)
Notre ancien représentant diplomatique à Kigali a indiqué l'assassinat du nouveau président burundais Ndadaye le 21 octobre 1993 comme un élément négatif important pour le processus d'Arusha : « Le coup d'État du 21 octobre 1993 au Burundi a fortement hypothéqué les négociations en vue de l'installation du nouveau gouvernement. Au Burundi, nous avons assisté à un processus de démocratisation réussi. Le président Buyoya avait lui-même contribué à la transition vers un régime démocratique. Grâce à lui, des élections démocratiques ont pu avoir lieu quelques mois avant la conclusion des accords d'Arusha. M. Ndadaye, qui appartenait à l'ancien parti de l'opposition, le Frodibu, avait gagné les élections de façon éclatante. Il était ainsi devenu le premier président hutu démocratiquement élu. Il voulait cependant procéder de façon très prudente. Il n'a pas immédiatement fait nommer des gens de son parti.
Le nouveau président fait de nombreuses concessions à l'Uprona et aux Tutsis. L'assassinat du nouveau président a causé au Rwanda une réaction de méfiance vis-à-vis du processus de paix. Le président Habyarimana a réagi de façon très acerbe.
Le président estimait que la communauté internationale lui reprochait de ne pas avoir joué le jeu et d'avoir été trop méfiant par rapport au processus de paix. Or, un président d'un pays voisin a été assassiné, malgré sa politique progressive de réconciliation nationale. Il est difficile d'expliquer aujourd'hui à la population et aux acteurs politiques qu'Arusha est un ensemble d'accords difficiles à appliquer (..). Le processus d'Arusha n'a jamais cessé, mais il y eut d'importants atermoiements. On a toujours continué à négocier malgré les ambiguïtés, les rancunes personnelles et les oppositions entre le nord et le sud » (80a).
Le Premier ministre Dehaene soulignait que les accords d'Arusha constituaient pour le Gouvernement belge, « un point culminant » et un « couronnement ». Il y ajoute : « Nous étions conscients de la complexité de ces accords puisqu'il s'agissait d'un compromis et non pas d'un accord parfait. » (81a)
À la commission, qui lui avait demandé si le Gouvernement savait que certains sabotaient les accords d'Arusha, le Premier ministre a répondu : « Il est absurde de supposer qu'un accord ne sera pas respecté. Les gouvernements qui participent aux opérations des Nations unies s'engagent à exécuter les accords ou à exercer des pressions afin qu'ils le soient. C'est pourquoi toute opération des Nations unies se compose d'un volet militaire et d'un volet politique. Le Gouvernement continuait à croire aux accords d'Arusha comme seule alternative à la violence. » (82a)
Enfin, le 9 avril 1994, dans une interview accordée à De Morgen , le ministre des Affaires étrangères et à l'époque secrétaire d'État à la Coopération, M. Derycke, a déclaré que les concepteurs des accords d'Arusha avaient commis une grosse bévue. Devant la commission, le ministre a affirmé qu'il fallait plutôt considérer sa réaction comme une réaction émotionnelle : « Du point de vue éthique et après toute la misère qui j'avais vue en Afrique, je considérais Arusha comme une solution. Je croyais effectivement aux accords d'Arusha. J'étais convaincu que, si l'on voulait donner un avenir au Rwanda, il fallait transformer le régime unilatéral. Les institutions transitoires étaient composées de manière assez harmonieuse. Le plan pour l'intégration des armées me paraissait réalisable. Je trouvais cependant que le FPR adoptait une attitude ambiguë : d'une part, il souhaitait une participation au pouvoir et, d'autre part, le passé avait laissé des traces profondes et il n'y avait sans doute pas suffisamment de communications avec la base. Mais j'ai cru aux accords d'Arusha jusqu'au 6 avril. » (83a)
Outre les indications venant de l'ambassadeur Swinnen et qui montraient que les accords d'Arusha se vidaient de leur substance, le Gouvernement a reçu des informations supplémentaires montrant un affaiblissement de ces accords de paix.
Eric Gillet, membre du bureau exécutif de la FIDH (Fédération internationale des ligues des droits de l'homme) et coauteur du « Rapport de la Commission internationale d'enquête sur les violations des droits de l'homme au Rwanda depuis le 1er octobre 1990 », a été interrogé le 19 mars par la commission spéciale. Interrogé sur la signification des accords de paix d'Arusha, Eric Gillet a déclaré : « Les accords d'Arusha étaient une bonne chose et il fallait évidemment s'y investir. Tout ce qui pouvait être fait, le fut. La Belgique a bien joué son rôle. Mais ni Habyarimana ni son entourage ne voulaient de cet accord et le président usera de toutes les ficelles pour soutenir la violence et bloquer le processus. Le président conserve le pouvoir réel. Le Premier ministre n'en aura jamais l'usage. Les défenseurs des droits de l'homme, tant rwandais qu'internationaux, ne s'y trompent pas : ils ne pensent pas que celui qui est capable d'organiser des massacres puisse se transformer soudainement en démocrate. Sur le terrain, ils voient ce qui se passe. Les organisations de défense des droits de l'homme communiqueront leurs sentiments et leurs constatations en permanence aux autorités belges. Tout au long des deux ans qu'a duré le processus des accords d'Arusha, tout s'est passé à deux niveaux.
Il y a d'abord le double langage du pouvoir qui ne tient pas le même discours vers l'étranger ou à l'intérieur, en français ou en kinyarwanda ou même en anglais ou en kiswahili. Il y a aussi le double jeu de séduction du président » (84a).
« Après la signature des accords d'Arusha, le 15 novembre, le président Habyarimana déclare qu'il considérait qu'il ne s'agissait que d'un chiffon de papier » (85a).
« L'erreur importante qui a été commise était de croire que les accords d'Arusha allaient facilement s'appliquer alors qu'on laissait se développer sur le terrain une situation tout à fait différente. Il fallait associer les accords d'Arusha aux aspects concernant le respect des droits de l'homme » (86a).
Le professeur Reyntjens fait observer que : « L'assassinat du président Ndadaye a probablement provoqué la mort du processus de paix. D'une part, parce que cet assassinat a fait douter les modérés bien intentionnés et, d'autre part, parce qu'il a donné aux opposants à ce processus des arguments permettant de le bloquer (...) Ensuite, interviennent le coup d'État du Burundi et l'assassinat du président burundais, ce qui a pour conséquence que les Hutus et notamment les Hutus qualifiés de modérés affirment qu'on ne peut pas faire confiance au FPR et, par extension, aux Tutsis eux-mêmes, entrant ainsi dans une logique génocidaire. Cette opinion est renforcée par le fait que certains Tutsis ont jubilé à Kigali lors de l'annonce du coup d'État au Burundi et ont refusé d'assister à la manifestation de soutien au peuple burundais organisée le 23 octobre. Avec le recul, on peut conclure que l'accord d'Arusha est mort avec l'assassinat du président du Burundi. C'est en amplifiant le meurtre du président et en convainquant la population de ce que, si elle ne tue pas les Tutsis, c'est elle qui va être exterminée, qu'on développe l'idéologie et la structure nécessaire à la mise en marche du génocide » (87a).
3.2.2.4. La visite de Habyarimana en Belgique le 4 octobre 1993
Un autre élément qui a pu jouer un rôle dans la décision belge a été la visite du président rwandais, M. Habyarimana, en Belgique :
Le 4 octobre 1993, le président rwandais Juvénal Habyarimana était l'hôte du palais royal de Laeken. Outre le président, étaient également présents le Premier ministre, Jean-Luc Dehaene, le ministre de la Défense nationale, Leo Delcroix, et le secrétaire d'État à la Coopération au développement, Eric Derycke. Au cours d'un entretien avec la presse, le président avait déclaré espérer l'arrivée imminente de Casques bleus de l'ONU dans son pays pour aider à la mise en oeuvre de l'accord de paix et a également exprimé le souhait que le nombre d'hommes de la MINUAR serait supérieur au nombre de 2 500 comme proposé par le secrétaire général de l'ONU.
Le 6 août 1993, soit deux jours après la signature des accords d'Arusha, le président Habyarimana était accueilli comme chef d'État à l'occasion des funérailles du Roi Baudouin.
Le « Comité pour le respect des droits de l'homme au Rwanda » avait, à l'occasion de cette visite, publié un communiqué mettant en garde la communauté internationale contre les dangers que cette visite représentait. Celle-ci risquait, en effet, de réduire à néant les pressions faites sur le Rwanda pour un retour à la démocratie et pour l'application des accords de paix.
Ce communiqué de presse soulignait également « que le président Habyarimana jouait manifestement un double jeu ».
M. Gasana Ndoba a déclaré devant la commission : « Il était notoirement l'actionnaire majoritaire de la radio des « Mille Collines » (88a). Le retour du président au Rwanda fut suivi de l'assassinat d'une série de personnes qui avaient commis des crimes contre l'humanité. Ces exécutions avaient évidemment pour but de réduire au silence tous les témoins potentiels de la politique présidentielle » (89a).
La visite du président Habyarimana aux institutions belges avait été prévue dans le cadre du soutien que la Belgique devait apporter à la mise en oeuvre des accords de paix. Chacun avait confiance dans les accords d'Arusha et dans l'intention que manifestait le président de les faire respecter, bien que certaines nouvelles inquiétantes indiquassent qu'un noyau dur de l'entourage du président Habyarimana était hostile à ces accords.
Dans une note confidentielle du SGR du 15 avril 1993, les services de renseignements écrivent que le partage prévu du pouvoir suscite peu d'enthousiasme dans l'entourage du président : « Dans son entourage, il existe effectivement un noyau de « durs », qui sont prêts à tout pour ne pas perdre les privilèges que leur octroyait l'ancien régime. Parmi ces « durs », il y a certains chefs militaires » (90a). Le Premier ministre Dehaene avait de plus en plus le sentiment qu'Habyarimana souhaitait respecter les accords d'Arusha, mais que le président était sous pression « notamment du fait de la famille de sa femme » (91a).
M. N'Diaye allait, par la suite, déclarer devant la commission : « Les accords d'Arusha représentaient une obligation de partage qu'il (le président) ne voulait pas mettre en oeuvre. Il y avait aussi le refus de voir au-delà des intérêts du clan ... on a sans doute minimisé la duplicité des dirigeants rwandais. Dans leur esprit, partager le pouvoir c'était reconnaître leur défaite.
Chaque tentative de retour des réfugiés tutsis avait été un échec et avait conforté le triomphalisme du pouvoir (...) Manifestement, Habyarimana sabotait les accords » (92a).
L'ancien sénateur de la Volksunie Willy Kuijpers profita de la présence d'Habyarimana à Bruxelles pour lui poser des questions par une lettre ouverte sur l'influence de l'Akazu, que M. Kuijpers qualifie de « puissance occulte », qui se compose de personnes faisant partie de l'entourage du président et qui organise des meurtres et des échauffourées à caractère politique dans tout le pays.
Dans sa lettre, Willy Kuijpers demande au président de clarifier son rôle dans une série d'affaires criminelles impliquant ce groupement également appelé « Réseau Zéro ». Par ailleurs, M. Kuijpers ne croit pas que le président soit réellement favorable aux accords. Il se demande si Habyarimana n'a pas souscrit à ceux-ci sous la pression de l'opinion internationale (93a).
Habyarimana éluda les questions de M. Kuijpers en les qualifiant d'« affirmations gratuites » (94a).
Le ministre des Affaires étrangères, Willy Claes, a reçu le 28 septembre 1993 une speaking note qui pouvait servir d'éventuelle base de discussion pour la rencontre du 4 octobre 1993 avec le président Habyarimana.
Le texte intégral de cette note est le suivant :
1. Accord de paix d'Arusha du 4 août 1993
1.1. Nous nous félicitons de la signature de l'accord de paix entre le gouvernement et le FPR qui met fin à la guerre.
1.2. Nous félicitons les protagonistes qui ont réussi à surmonter leurs intérêts partisans pour prendre des décisions dans l'intérêt du peuple rwandais en acceptant de trouver des solutions au conflit par la négociation qui implique des concessions mutuelles parfois difficiles.
1.3. Nous invitons toutes les parties concernées à veiller au respect intégral et à la mise en oeuvre effective des accords conclus, dans un climat de réconciliation nationale, de confiance et de tolérance mutuelles. Ces accords doivent contribuer au renforcement de la démocratie et aboutir à des élections libres.
2. La Belgique est prête à donner à cet accord son soutien politique et logistique
2.1. Sur le plan politique
Nous avons sensibilisé nos partenaires de la Communauté européenne pour qu'ils soutiennent le processus de paix et de démocratisation ainsi que la mise en oeuvre de l'accord.
Nous sommes intervenus auprès des membres du Conseil de sécurité des Nations unies en faveur de la constitution d'une FIN, et en particulier auprès des USA.
2.2. Sur le plan logistique
2.2.1. GOMN 1, Délégation à Arusha, Déplacés de guerre.
Nous avons fourni une aide en jeeps au GOMN 1 dès 1992.
Nous avons financé (600 000 francs) les voyages de délégations à Arusha.
Nous avons apporté une aide humanitaire d'urgence (110 millions de francs) aux déplacés de guerre, via des ONG.
Nous donnons une aide financière au GOMN 2 (3 millions de francs pour 3 mois).
Nous participons au financement de la MONUOR (environ 3 millions de francs pour 6 mois).
2.2.3. FIN, Fusion des armées, Démobilisation, Déplacés de guerre, Élections.
Le Gouvernement examine des actions dans les domaines suivants :
FIN ou MINUAR : envoi d'un contingent de 200 à 300 hommes. L'attention du président pourrait être attirée sur le fait qu'il a tout intérêt à accepter les propositions du secrétaire général de l'ONU sur l'importance (2 500 hommes) de la FIN, étant donné les réticences de certains membres permanents du Conseil de sécurité.
Fusion des armées :
Doublement de la coopération technique militaire (20 instructeurs supplémentaires)
Organisation en Belgique de stages de formation de type court pour militaires.
Envoi d'un magistrat conseiller pour la création d'un auditorat militaire.
Démobilisation :
Étude par la Coopération d'un programme spécial de mesures d'accompagnement socio-économique et réorientation des priorités et des programmes d'aide, pour la reconstruction du nord du pays.
Sensibilisation de la Banque mondiale.
Déplacés de guerre :
Maintien d'une aide immédiate dans les camps, vu les délais de réinsertion et de reconstruction des zones de guerre.
Élections :
La coopération au développement étudie un certain nombre d'actions d'aide à la préparation des élections, étape finale du processus démocratique, en relation avec la CE, l'ONU et les partenaires donateurs.
3. Situation interne au Rwanda
Nous faisons appel au président pour qu'il contribue activement à créer les conditions nécessaires à la poursuite de la pacification et de la démocratisation.
Nous sommes inquiets à cause de la discorde existant dans certains partis qui risque de bloquer le processus.
Nous sommes très préoccupés, de même que les autres donateurs, par les détournements de l'aide alimentaire. Il est urgent d'y mettre de l'ordre au moment où le Rwanda demande un accroissement de l'aide internationale.
3.2.2.5. La présence au Rwanda d'une communauté belge
La commission, tout en constatant que le support aux accords d'Arusha et la demande des deux parties avaient pesé sur la décision du Gouvernement belge de soutenir sur le plan logistique le processus de paix au Rwanda, a estimé par ailleurs que plusieurs facteurs avaient joué un rôle dans la décision d'envoyer des troupes au Rwanda. Lors de la deuxième réunion de la commission, Mme Beckers, la soeur d'une victime civile belge, a posé la question suivante : « La Belgique ne devait-elle pas protéger ses ressortissants (95a)/A>) ? »
D'après les chiffres provenant d'une note confidentielle du 15 avril 1993, la communauté belge au Rwanda comptait 1497 Belges, dont 900 habitaient dans la capitale Kigali. Les autres Belges étaient répartis entre 10 préfectures. La plus petite communauté belge habitait à Kibuye. On pouvait trouver la plus forte concentration de ressortissants belges hors Kigali dans la préfecture de Butare, où 190 Belges avaient leur résidence officielle. Outre 570 particuliers, la population belge était constituée de 428 coopérants, 168 volontaires, 231 missionnaires et 100 autres personnes qui avaient été incorporées dans l'administration ou qui, après leur service actif, avaient préféré habiter au Rwanda plutôt que de retourner en Belgique. « Les Belges représentent la communauté expatriée la plus importante du Rwanda » , tandis que les Français, les Allemands et les Américains étaient au Rwanda avec respectivement 600, 350 et 200 compatriotes. La coopération militaire belge comprenait une vingtaine d'officiers et de sous-officiers accompagnés de leur famille (96a).
« Si nous n'avions pas participé à la présence internationale » , a affirmé le Premier ministre Dehaene, « je pense que cela n'aurait pas été compris ni par la population rwandaise ni par la population belge présente au Rwanda. Cette dernière a d'ailleurs été un des éléments de notre prise de décision (97a). » Ainsi le Service de renseignements de l'armée belge (le SGR) a-t-il émis un avis positif sur une éventuelle participation de la Belgique à ce qui s'appelait encore la FIN, en se fondant sur la conviction que la présence d'effectifs belges au Rwanda rassurerait de nombreux expatriés (98a) (complément d'information du 28 septembre 1993, SGR document 7140).
Les autorités belges ont estimé d'emblée que la protection des compatriotes et la préparation d'une éventuelle évacuation devaient être une des tâches du détachement belge auprès de la MINUAR. Les autorités militaires de Bruxelles et de Kigali partageaient cet avis. Pourtant, la protection spécifique des expatriés belges (et d'autres Occidentaux) n'était pas prévue dans le mandat de l'ONU, qui prévoyait uniquement, au point 3.A, une mission générale de contribution à la sécurité à Kigali. L'évacuation, l'assistance en vue d'une évacuation ou la préparation d'une évacuation n'étaient pas non plus prévus initialement par le mandat.
Même après les événements dramatiques du 7 avril 1994, lorsqu'il décida l'évacuation des Belges, le Gouvernement « ... wou namelijk de VN-spelregels respecteren. Daarom werd beslist tot evacuatie, niet met behulp van Blauwhelmen, maar door het zenden van Belgische en Franse para's » déclara M. Claes. M. Riza a averti « ... denk er niet aan om als Belgen met uw blauwhelmen unilateraal op te treden » (99a).
3.2.2.6. Les informations relatives à la campagne antibelge et anti-MINUAR
Enfin, un dernier élément a pesé dans la décision de fournir ou non des troupes à la MINUAR: la connaissance qu'avait le Gouvernement belge de l'existence de réactions hostiles à la Belgique et à la participation de celle-ci à l'opération de paix.
À cet égard, le groupe ad hoc Rwanda a cité, dans le rapport qu'il a transmis le 7 janvier 1997 à la Commission des Affaires étrangères du Sénat, un nombre d'indices contenus dans les documents examinés, sur la base desquels il conclut que, pendant la période qui a précédé la décision d'envoyer des troupes à Kigali (100a), « un climat antibelge s'était développé au Rwanda, du moins dans les milieux extrémistes hutus proches du président Habyarimana et de son entourage direct » (101a).
Au cours des auditions devant la commission, une série de témoins ont nuancé ce constat.
C'est ainsi que le Premier ministre, M. Dehaene, a fait, au cours de sa première audition, la déclaration suivante : « Il est clair que nous étions conscients qu'il y avait des réactions antibelges mais on ne pouvait parler d'un climat général défavorable. Il y avait effectivement des actions menées par une minorité, actions qui étaient amplifiées par la Radio RTLM. (...) Il n'y avait donc pas de climat général antibelge. Au contraire, notre présence était souhaitée par la population » (102a).
L'ambassadeur Swinnen relativise lui aussi les informations relatives aux sentiments antibelges. Notre ancien ambassadeur à Kigali estime que « les sentiments antibelges étaient exprimés dans les milieux extrémistes et antipacifistes. C'était normal, étant donné que la Belgique menait une politique extrêmement pacifiste. Ces sentiments antibelges étaient parfois dirigés contre ma personne. Les sentiments antibelges sont à situer dans le contexte plus large d'une opposition contre le processus de paix. (...) Cela ne signifiait pas qu'il était question d'une action antibelge préméditée » (103a). Néanmoins, M. Swinnen reconnaît que la Belgique avait une mauvaise image dans les milieux extrémistes et qu'à l'époque, il était très préoccupé par « certains groupes extrémistes » qui voulaient discréditer le processus de paix. Il estime toutefois qu'en réalité, il n'y a jamais eu lieu de rendre compte d'une atmosphère antibelge généralisée. Selon l'ambassadeur, le malaise concernant les Belges devait être considéré comme une opposition au processus de paix et à l'engagement de la Belgique dans ce dernier.
Toujours selon l'ambassadeur Swinnen, on ne peut pas prétendre que le MRND et le président Habyarimana étaient opposés à une participation belge à la MINUAR. Le MRND « n'était pas contre la participation belge, mais bien contre une participation trop dominante et contre un rôle dominant exclusivement belge. Le MRND était partisan d'un rôle substantiel belge. (...) Le 12 novembre, le président m'a dit que son voeu le plus cher était de voir la Belgique s'engager dans la MINUAR et que la Belgique ne change pas d'idée. Il voulait un contingent équilibré à Kigali » (104a).
Au cours de sa première audition, le 5 mars, l'ancien ministre des Affaires étrangères, M. Willy Claes, a abordé plus en détail la question de l'existence d'un climat antibelge au Rwanda. Selon lui, il n'y avait pas de climat antibelge. « Il n'y avait pas de climat antibelge, si ce n'est dans un certain milieu antipacifiste actif » (105a). Willy Claes a résumé le climat qui régnait au Rwanda comme suit : « au moment où nous avons pris la décision d'envoyer des troupes au Rwanda, il n'y avait pas de climat antibelge. Toutefois, un groupe minoritaire dangereux s'activait contre les accords d'Arusha et par conséquent aussi contre notre pays » (106a).
Cependant, la commission a également retenu des témoignages confirmant l'existence d'un sentiment antibelge.
Le lieutenant-général Charlier ainsi que M. Gasana Ndoba, représentant du Comité pour le respect des droits de l'homme et la démocratie au Rwanda, ont témoigné que certaines décisions belges du passé ont été à la base d'une campagne antibelge.
Le lieutenant-général Charlier : « Une campagne antibelge était menée depuis fin octobre 1990. À cette époque le gouvernement avait décidé de retirer les éléments militaires envoyés au moment de l'invasion du nord du pays. L'attitude des militaires rwandais vis-à-vis des Belges s'était alors modifiée. Si on se met à leur place, leur attitude est compréhensible. Le pays est envahi et la nation qui avait fourni un appui militaire se retire dès qu'elle a sauvegardé ses coopérants. En outre, le Gouvernement belge a refusé de livrer une commande d'armes qui était déjà payée par les Rwandais. Encore une fois, on peut comprendre leur réaction. On ne peut toutefois pas dire que les relations étaient rompues entre les militaires rwandais et belges. Nous avons maintenu une coopération technique et militaire (formation de cadres, appui médical et infrastructure). Il y a eu des visites de militaires rwandais en Belgique et vice versa. Des relations tout à fait normales, mais nous ressentions que le climat avait changé. Un autre élément contribuait à créer un climat antibelge : le processus d'Arusha n'était pas accepté par tous les Rwandais. Les opposants au processus refusaient d'accepter la participation de la Belgique à la MINUAR. Dès septembre, il y a eu des campagnes antibelges et des faits ont été perpétrés contre les civils. Il était donc nécessaire de protéger nos compatriotes. Lorsque nous sommes partis au Rwanda, nous connaissions les risques (107a). (...) Le climat antibelge était bien connu » (108a).
M. Gasana Ndoba : « On a beaucoup épilogué sur la maladresse des troupes belges. Dès 1990, un sentiment antibelge avait pris naissance suite au retrait des troupes belges et à la cessation des livraisons d'armes par la Belgique » (109a).
Comme le groupe ad hoc Rwanda, la commission conclut qu'il s'est bel et bien développé, au cours de la période qui a précédé la décision d'envoyer des troupes, prise le 19 novembre 1993, un climat antibelge, du moins dans les milieux extrémistes hutus liés au président Habyarimana et à son entourage direct.
Quoi qu'il en soit, la commission estime que, qu'il faille ou non qualifier les extrémistes hutus de minorité, ils étaient en tout cas au coeur du pouvoir. Ils appartenaient en effet à l'élite militaire et politique proche du président Habyarimana.
Il n'apparaît pas à la commission que l'existence de ce climat anti-belge ait été un élément déterminant dans la décision du Gouvernement belge le 19 novembre 1993 d'envoyer des troupes au Rwanda. Le climat a bel et bien joué un rôle, en plus des éléments budgétaires, dans le choix politique de limiter le nombre d'hommes à un maximum de 450.
À ce sujet, le Premier ministre Jean-Luc Dehaene a déclaré : « Au Conseil des ministres, il n'a pas été fait lecture des télex cités. Ceux-ci faisaient partie de l'information de base de M. Claes. Il nous a pourtant dit qu'il y avait certaines réactions et frustrations nées des événements de 1990 mais on ne peut pas parler d'un climat antibelge généralisé » (110a).
Outre les éléments de nature politique qui ont influencé la décision de participer à la MINUAR, la commission constate que des considérations d'ordre militaire ont aussi eu une influence. Un échec du processus de paix d'Arusha n'était pas imaginaire. Dès le début, les accords auxquels on était parvenu à Arusha ont rencontré une vive opposition. Participer à la MINUAR signifiait que l'on allait avoir sur place une forte présence militaire, qui pourrait se mettre immédiatement en action pour rapatrier les ressortissants belges en cas d'échec du processus de paix. On évitait ainsi la phase la plus critique d'une mission d'évacuation, à savoir amener les premiers moyens (111a). De plus, le rapport du groupe de travail ad hoc (se référant à la note du 15 octobre 1993 du lieutenant général Charlier au ministre de la Défense nationale) a déjà souligné que le haut commandement de l'armée avait aussi accueilli favorablement la participation à la MINUAR parce qu'il disposait notamment là d'un argument pour fonder le refus de prolonger la présence militaire belge en Somalie (112a). Le lieutenant général Charlier nuance cette affirmation lors de sa première audition, le 28 février 1997 : « Il ne faut pas croire que nous sommes allés au Rwanda pour avoir le prétexte de quitter la Somalie » (113a). Le Premier ministre Dehaene précise à cet égard, lors de sa première audition, le 5 mars 1997 : « Il ne faudrait toutefois pas croire que notre retrait de ce pays était la condition pour envoyer nos troupes au Rwanda » (114a). Des indices laissent aussi à penser que d'autres motifs ont joué un rôle, entre autres le plan de restructuration et de réduction de l'armée, qui poussait l'état-major général à une participation maximale des forces armées belges à des missions de paix internationales. Ce que le lieutenant général Charlier nie pourtant expressément (115a), appuyé en cela par le colonel Engelen, à l'époque conseiller militaire à la représentation permanente belge auprès de l'ONU, qui déclare que le chef d'état-major général n'était manifestement pas enthousiaste lorsque de New York, il lui fit part de l'intention des Nations Unies de demander à la Belgique de participer à la MINUAR (116a).
Quoi qu'il en soit, la commission constate que sur le plan militaire, la décision de participer à la MINUAR présentait, à tous les égards, les caractéristiques d'un compromis, tentant de concilier impératifs militaires et considérations politiques. Le lieutenant général Charlier employa lui au cours de son audition du 28 mars 1997, le terme « marchandage » (117a).
3.2.3.1. Le rapport de la mission de reconnaissance au Rwanda, connu sous le nom de rapport Recce
C'est sur ce rapport daté du 2 novembre 1993 qu'a été fondée, du point de vue militaire, la décision de participer à la MINUAR. Il constituait, avec le « mémo justificatif d'un besoin opérationnel » (non daté) et deux télex transmis au C Ops à Evere par la mission de reconnaissance restée au Rwanda, le dossier envoyé le 10 novembre 1993 par l'état-major général au ministre de la Défense nationale. Il a déjà été commenté en détail dans le rapport du groupe de travail ad hoc (118a).
En résumé, la mission de reconnaissance estimait que, comme le demandait d'ailleurs le général Dallaire, le secteur de Kigali nécessitait un bataillon composé de quatre compagnies dont une équipée de véhicules blindés transporteurs de troupes (APC). Cette dernière compagnie ferait office de QRF (Quick Reaction Force) sur l'ensemble du territoire rwandais pour intervenir en cas de situation critique. Bien que le général Dallaire ait envisagé pour le secteur de Kigali un bataillon de 800 hommes, tant la mission de reconnaissance que l'état-major général et l'état-major des paracommandos sont partis du principe qu'environ 600 hommes devaient suffire. C'est ce que le lieutenant général Charlier a communiqué au ministre de la Défense nationale dans une note datée du 3 novembre (119a). Toutes les personnes interrogées, à l'exception du général major Schellemans, chef de cabinet du ministre de la Défense nationale, confirment que telle était l'option de l'armée. Lorsqu'on demande au colonel Flament, chef de la mission de reconnaissance, quel était son point de vue initial sur les effectifs nécessaires pour exécuter la mission, telle qu'elle était décrite dans le « mémo justificatif d'un besoin opérationnel », il répond : « 600 hommes » (120a). C'est ce que confirme le lieutenant colonel Briot, le chef de la sous-section de planification des opérations extérieures, de l'état-major général, lors de son audition du 28 février 1997 : « La demande initiale exprimée par l'ONU était de 800 hommes. Une analyse théorique a été faite par l'état-major général et complétée par un élément de la mission de reconnaissance. Nous avions proposé à l'état-major général une limite de 600 personnes pour que la mission soit réalisable, que la sécurité du personnel soit assurée, ainsi qu'un bien-être maximum des hommes » et « Si nous n'avions pas 600 hommes, il fallait laisser tomber certaines missions. » (121a) Le lieutenant général Charlier est encore plus explicite : « 600 hommes permettaient quatre compagnies et une force d'intervention rapide » et « Nous avons estimé que 600 hommes étaient nécessaires car il était important que Kigali soit considérée comme un tout. Scinder un commandement dans une ville rend les choses beaucoup plus difficiles. Nous voulions aussi que la QRF soit entre nos mains et c'est pour cela que j'ai demandé quatre compagnies, dont une blindée » et d'ajouter « Le bataillon de 600 hommes que nous avons proposé comprenait trois compagnies de fusiliers plus une de véhicules blindés. » (122a) Ce point de départ était aussi celui de l'état-major paracommando.
C'est ce qu'a confirmé le lieutenant-colonel Leroy lors de son audition du 24 mars 1997 : « L'état-major paracommando a étudié différentes autres propositions comportant environ 500 à 550 hommes mais toujours organisés en quatre compagnies dont une équipée de blindés. » (123a) Seul le général major Schellemans défend un autre point de vue. Lors de son audition du 12 mars 1997, il déclare que même avec 600 hommes belges, certaines tâches, en particulier la QRF, n'auraient pas pu être accomplies (124a).
Bien que la commission constate que le rapport de la mission de reconnaissance était suffisamment clair, les déclarations du colonel Flament, auteur dudit rapport, montrent que ce document avait été conçu, du moins dans son esprit, comme un document qui devait permettre au commandement de l'armée de « négocier ». « Si j'ai demandé 600 soldats, c'était uniquement pour avoir la certitude d'en avoir 400. » « Si nous avons demandé 600 hommes dans notre dossier, c'est pour avoir la certitude d'en obtenir 450. » « Ce n'est pas une habitude, mais il a bien fallu négocier ce que nous estimions nécessaire pour la sécurité. » Toutefois, lorsqu'on lui demande « Négocier avec qui ? », le colonel Flament ne répond pas et dit qu'il faut poser cette question au lieutenant général Charlier (125a).
Et le colonel d'ajouter : « Lorsque je suis parti par Kigali, l'état-major général parlait toutefois de 200 hommes... » (126a). Or, le luitenant général Charlier déclara qu'au départ du Recce il avait estimé : « qu'il fallait rester réaliste et que si l'on recevait 300 à 400 hommes, il faudrait considérer que c'était satisfaisant. » (127a)
3.2.3.2. Les négociations sur les effectifs
Que le rapport Recce ait ou non été écrit dans l'optique de négociations entre le haut commandement de l'armée et les responsables politiques, il est de fait que deux semaines de discussion sur les effectifs ont été nécessaires pour parvenir à la décision du Conseil des ministres du 19 novembre 1993 d'envoyer 370 hommes, avec la possibilité, si la sécurité des troupes l'exigeait, de porter ce nombre à 450.
En reconstituant cette discussion, la commission a constaté qu'outre un certain nombre d'éléments de nature personnelle, qui ont indubitablement joué un rôle, on a finalement opté pour un arrangement qui voulait répondre à la fois à certains objectifs purement politiques et à certains impératifs militaires sur le terrain, qui leur étaient contraires à bien des égards.
L'attitude du gouvernement fut, dès le début, assez univoque. Après que notre représentant permanent eut reçu, le 8 septembre 1993, la demande informelle des Nations Unies à la Belgique d'envoyer des troupes dans le cadre de l'opération de paix de l'ONU au Rwanda, la position du Gouvernement, si elle n'était pas arrêtée de manière formelle, l'était en tout cas de manière informelle : oui à une participation, mais pour des raisons politiques c'est-à-dire en raison de l'histoire de la Belgique au Rwanda et pour éviter une présence trop visible , il n'était pas question d'envoyer un bataillon de 800 hommes comme le souhaitaient les Nations Unies (128a). Les chiffres ont été communiqués à la presse par les ministres concernés. Le Gouvernement opta donc pour une participation limitée que l'on estimait à 200, voire au maximum à 300 hommes. C'est ce que confirme le Premier ministre Dehaene lors de sa première audition, le 5 mars 1997 : « Le 17 septembre, le Conseil des ministres a discuté de la question de savoir si la Belgique allait ou non participer à la MINUAR. À ce stade, il s'agissait uniquement d'une décision de principe. (...) La discussion a alors porté sur l'importance du nombre de soldats à envoyer, la demande des Nations Unies paraissant trop élevée par rapport à l'opération. En outre, une présence dominante de la Belgique à Kigali était politiquement inopportune, car elle aurait créé une confusion entre notre pays et l'ONU (...). Le chiffre de 200 à 300 hommes a alors été évoqué, mais aucune décision n'a été prise » (129a). À ce stade du processus de décision, les autorités militaires n'ont pas été consultées par le Gouvernement belge. Lors de leurs auditions du 5 mars 1997, les ministres de la Défense nationale et des Affaires étrangères de l'époque ont réitéré ce point de vue. M. Delcroix : « (...) lorsqu'il fut décidé de renoncer à une action militaire de grande envergure. Cette décision fut essentiellement inspirée par des raisons politiques et par nos liens historiques. (...). Le Gouvernement a en tout cas pris l'option politique d'une présence limitée. Au départ, il était question d'envoyer 200 militaires et ensuite 200 à 300. (...) la volonté politique d'assurer une présence symbolique, même limitée, de la Belgique. (...) Avec ce chiffre, le Gouvernement entendait indiquer qu'il ne voulait pas avoir une présence trop dominante » (130a). M. Claes : « Des considérations budgétaires et politiques sous-tendaient la politique suivie. Dès le 17 septembre, il a été décidé que la Belgique ne pouvait pas y participer à grande échelle (...) » (131a).
Outre des éléments politiques, des motifs budgétaires ont donc tout autant influencé la limitation des effectifs, d'autant plus que l'on ne pouvait escompter qu'un remboursement de quelque 20 % de la part des Nations Unies et qu'un tel remboursement se fait souvent attendre plusieurs années. Bien que lors de sa première audition, le lieutenant général Charlier ait nié qu'il eût jamais été question d'une enveloppe budgétaire concernant l'opération au Rwanda (132a), il a confirmé lors de son audition du 21 avril 1997 que par deux fois, le ministre de la Défense nationale avait rejeté sa demande de 600 hommes pour des raisons budgétaires et que jamais un argument politique n'avait été avancé en sa présence. La note d'évaluation du 12 juillet 1994, qu'a rédigée le lieutenant général Charlier à la demande du ministre de la Défense nationale, dit, elle aussi, que le nombre d'hommes a été limité pour des motifs budgétaires (133a). Le ministre de la Défense nationale, M. Delcroix, est moins précis. Tantôt, il déclare que l'on a refusé de porter les effectifs au niveau demandé par le haut commandement, à savoir 600, surtout pour des motifs politiques. Tantôt, il déclare que toute « la discussion concernant l'augmentation du contingent fut plutôt une question budgétaire » . Quoi qu'il en soit, des motifs tant politiques que budgétaires, voire sociaux (134a), comme l'a souligné devant la commission l'ancien ministre de la Défense nationale, M. Delcroix, ont déterminé l'attitude minimaliste du Gouvernement. À cet égard, selon le ministre des Affaires étrangères, M. Claes, la Belgique n'aurait pas participé si l'on avait estimé que le nombre de 450 hommes était insuffisant; cette attitude est confirmée par le général-major Schellemans, chef de cabinet du ministre de la Défense nationale, lors de son audition du 12 mars 1997 (135a); il en est d'ailleurs question dans les conclusions du rapport du cabinet restreint du 10 novembre 1993 : « Si, pour l'une ou l'autre raison, l'état-major n'était pas d'accord sur la proposition actuelle, on renoncerait à participer à cette opération de l'ONU » (136a).
On a déjà commenté partiellement ci-dessus la position du haut commandement de l'armée. Il demandait 600 hommes pour accomplir la mission. Il considérait comme insuffisant le nombre de 300 hommes, dont il avait été initialement question, ou celui de 370 qu'envisagea le cabinet restreint du 10 novembre 1993; cette position a été communiquée par le lieutenant général Charlier au ministre de la Défense nationale dans une note datée du 12 novembre 1993; le contenu de cette note figure dans le rapport du groupe ad hoc (137a). Selon le lieutenant général Charlier, qui avait transmis l'intention originale d'envoyer 370 hommes déjà le 11 novembre à l'état-major des forces terrestres pour que celui-ci l'exécute (l'état-major s'y est opposé et s'en est tenu à la décision d'envoyer quelque 500 hommes, état-major général y compris), le chiffre avancé ne correspondait à aucune « solution militaire » (138a). Cet effectif limité ne permettait même pas de constituer une réserve (139a). Avec 450 hommes, il était possible de composer des compagnies pour occuper le terrain, tout en ayant une réserve pour chacune d'elles (140a), même si ce chiffre comprenait le personnel qui travaillait au quartier général du général Dallaire et du colonel Marchal, ainsi que le personnel chargé des tâches logistiques. En les retranchant du nombre de 450, on arrivait à un total de 350 hommes disponibles pour les missions (141a).
Il est moins évident que l'on ait aussi fait suffisamment comprendre aux responsables politiques qu'il résulterait de cette diminution des effectifs à 450 hommes, que certaines tâches (entre autres la QRF) ne pourraient plus être effectuées par les Belges, partant, devraient être confiées à un contingent étranger. Le lieutenant général Charlier prétend que cela a été fait. Dans son audition du 28 février 1997, il déclare : « J'ai répété au ministre de la Défense nationale, dans un courrier que je lui ai adressé, que je refusais de prendre la responsabilité des opérations avec moins de 450 hommes, s'il n'y avait pas de force de réaction rapide sur place et que le contrôle d'une partie des secteurs ne soit pas assuré par une autre nation » (142a). Et lors de son audition du 21 avril 1997, il répond par l'affirmative lorsqu'on lui demande si le ministre Delcroix savait qu'avec 450 militaires, nous ne pourrions jamais constituer une QRF (143a). Ces dires sont confirmés par le lieutenant-colonel Briot qui, à la question de savoir si l'on avait dit au Gouvernement qu'il était impossible de remplir toutes les missions prévues avec 450 hommes, répond : « Assurément » (144a). Le ministre de la Défense nationale prétend que cela n'a pas été fait. Il nie par deux fois que le lieutenant général Charlier l'ait informé qu'avec un effectif de moins de 600 hommes, les missions seraient réduites (145a), avant d'ajouter qu'il était conscient qu'en raison de la réduction des effectifs, la Belgique ne se chargerait pas de la QRF (146a). Pourtant, à la question : « A-t-on discuté du fait que certaines tâches demandées par le général Dallaire ne pourraient être exécutées ? » , son chef de cabinet, le général-major Schellemans répond sans ambiguïté : « Évidemment » (147a).
Il convient encore d'attirer l'attention sur deux aspects de l'attitude du haut commandement de l'armée, à savoir son exigence d'obtenir le commandement du secteur de Kigali et l'influence que cela a eue sur les effectifs. Lors de son audition du 28 février 1997, le lieutenant général Charlier a confirmé cette exigence, tout en déclarant que ce point ne fut toutefois pas déterminant dans la fixation du nombre d'hommes (148a). Ensuite la question de savoir si l'armée belge était vraiment capable de fournir davantage que 450 hommes, étant donné que des opérations étaient en cours en ex-Yougoslavie et en Somalie. Ces opérations rendaient impossible l'envoi de plus de 450 hommes sur le terrain, c'est pourquoi l'état-major général a accepté le nombre de 450. Le lieutenant-général Charlier conteste ce point : « Le nombre maximum d'hommes que nous pouvions envoyer dépendait de la durée de la mission. Si celle-ci avait été courte, nous pouvions envoyer beaucoup de monde. À partir du 15 décembre, vu les circonstances, nous avons considéré que nous pouvions assurer la présence de 600 hommes » (149a), un point de vue que confirment le commandant de KIBAT I, le colonel Leroy (150a), et l'amiral Verhulst, à l'époque chef du C.Ops à Evere : « La force terrestre nous a ainsi fait savoir qu'elle pouvait fournir 548 hommes relevables tous les quatre mois. Si vous ajoutez à cela le personnel annexe, vous atteignez 600 personnes » (151a).
Comme il a déjà été constaté ci-dessus, le choix ne s'est pas fait entre l'approche politique d'une part ou militaire d'autre part, mais ces points de vue contradictoires ont plutôt débouché sur un compromis qui ne rencontrait finalement ni les préoccupations initiales du Gouvernement qui pour des motifs budgétaires et politiques voulait éviter de fournir l'épine dorsale des troupes de la MINUAR, ni les souhaits du général Dallaire et des propositions initiales de l'armée belge.
Tant le gouvernement que le haut commandement de l'armée ont marqué leur assentiment sur le compromis ainsi atteint.
Lors de sa deuxième audition devant la Commission spéciale, le 28 mars 1997, le lieutenant-général Charlier a longuement relaté les conversations qu'il avait eues avec l'ancien ministre de la Défense nationale et son cabinet, et qui avaient abouti à la décision d'envoyer 450 hommes au Rwanda. Le 21 avril 1997, une confrontation à huis clos entre le lieutenant-général Charlier et l'ancien ministre de la Défense nationale, M. Delcroix, a eu lieu à ce sujet. Par la suite, un certain nombre de questions écrites, dont les réponses sont parvenues à la commission le 19 juin 1997, ont été posées au général-major Schellemans, à l'époque chef de cabinet du ministre de la Défense nationale, que la commission avait déjà entendu le 12 mars 1997 (152a).
Selon le lieutenant-général Charlier, la décision du 19 novembre 1993 d'envoyer 450 hommes au Rwanda fut le résultat d'un « marchandage » dont il a accepté l'issue à contre-coeur, parce qu'il craignait que s'il persistait dans son refus, quelqu'un d'autre à la tête de l'armée eût accepté l'envoi avec moins d'effectifs. « Si j'avais refusé, je serais parti. Un autre aurait accepté la mission avec 300 hommes. » (153a).
Dans sa réponse du 19 juin, le général major Schellemans confirme certains de ces événements tout en les relativisant ou en les situant dans un contexte quelque peu différent. Il confirme en tout cas que le lieutenant-général Charlier s'est plaint auprès de lui de la manière dont on traitait ce dossier; « Il parlait même de démissionner et de rendre publiques certaines choses (sans les spécifier). » Selon le général-major Schellemans, cela se passait avant l'envoi de la fameuse note du 12 novembre, peut-être le 11 novembre. Le ministre fut informé de cette menace. Selon le général-major Schellemans, le ministre de la Défense nationale n'était d'ailleurs pas en désaccord avec cette note. Le lieutenant-général Charlier l'aurait bien contacté une deuxième fois, à savoir le 18 novembre, pour lui exprimer son mécontentement sur la présentation du dossier au Conseil des ministres du jour suivant. À cette occasion, le général-major Schellemans déclare : « J'ai alors tenté d'expliquer que le cabinet restreint avait déjà pris une décision, qu'une telle décision ne serait pas modifiée à la légère et qu'il était dès lors préférable de présenter le dossier tel que le souhaitait le cabinet. Il est possible qu'au cours de mon argumentation, j'aie évoqué des « sensibilités » (« perdre la face » ?) mais je ne visais certainement pas la personne du ministre. » La teneur de cette discussion a également été portée à la connaissance du ministre. Il ne sait si, après la décision finale du 19 novembre, le ministre a demandé au lieutenant-général Charlier de ne donner aucune publicité à l'affaire.
Pour sa part, l'ancien ministre de la Défense nationale, M. Delcroix, n'a pu se souvenir d'aucun de ces faits.
Quoi qu'il en soit, il est clair en tout cas pour la commission que la préparation de la décision du Conseil des ministres du 19 novembre ne se basait pas exclusivement sur des considérations objectives de nature politique ou technico-militaire, mais aussi sur des arguments subjectifs et conflictuels, voire des menaces. Il est impossible de dire si la décision finale aurait été différente si la discussion s'était déroulée autrement, plus sereinement, mais il est en tout cas possible qu'on aurait alors consacré davantage de temps et d'attention à des problèmes essentiels comme l'absence d'un second contingent crédible, l'absence d'une QRF (Quick Reaction Force) efficace, etc.
3.2.3.3. L'absence d'un second contingent crédible
Dès l'instant où il devenait clair que la Belgique ne fournirait qu'une partie des troupes de la MINUAR pour le secteur de Kigali, la présence d'un second contingent crédible prenait une grande importance, surtout étant donné que le Gouvernement avait opté au début pour une présence plutôt de 200 à 300 hommes. Dans l'optique du Gouvernement, en effet, les troupes belges ne devaient constituer qu'une composante mineure d'une force plus vaste des Nations Unies, dont une autre nation que la Belgique aurait été l'élément principal. Pour la capacité opérationnelle et, surtout, la sécurité des militaires belges, il était dès lors vital de savoir dans quel contexte multinational ils seraient appelés à opérer. L'ancien ministre des Affaires étrangères, M. Claes, a tenté de savoir quels pays seraient sollicités par les Nations Unies pour participer à la force armée (154a). Dans un télégramme du 5 novembre 1993, fut communiquée une liste de pays entrant en ligne de compte (Bangladesh, Belgique, Egypte, Ghana, Malawi, Tunisie, Uruguay, Togo et Canada), à la suite de quoi la représentation permanente de la Belgique à l'ONU reçut pour instruction d'entreprendre des démarches auprès des délégations autrichienne et canadienne (155a). Cette dernière ne tarda toutefois pas à se désister. Il ne resta que l'Autriche; le cabinet restreint du 10 novembre 1993 chargea donc les ministres des Affaires étrangères et de la Défense nationale de prendre les contacts nécessaires en vue d'obtenir une contribution de ce pays (156a). Quoi qu'il en soit, le Premier ministre Dehaene a déclaré que la participation de troupes expérimentées en provenance d'autres pays européens n'a jamais été mise comme une condition à la participation belge à la MINUAR; le problème de la crédibilité d'un second contingent n'a jamais été évoqué (157a). Le ministre de la Défense nationale, M. Delcroix, va même jusqu'à affirmer « C'est le problème de l'ONU Il s'agissait d'une opération de l'ONU et non d'une opération belge » (158a). En guise de justification, on fait valoir tour à tour que ce n'est que dans le courant de l'opération MINUAR elle-même qu'il est apparu clairement que les troupes bangladaises n'étaient pas à la hauteur de leur tâche et qu'avant la décision du 19 novembre, le problème posé par le contingent bangladais se limitait à des questions lingistiques. En outre, il est fait état des démarches qui ont malgré tout été entreprises pour amener l'Autriche à participer à la MINUAR avec un contingent de quelque 200 hommes.
La commission fait toutefois les constatations suivantes :
Comme indiqué dans le rapport du groupe de travail ad hoc , le rapport Recce du 2 novembre 1993 mentionne déjà des termes critiques au sujet de l'état-major du contingent bangladais. Ce rapport faisait partie du dossier transmis au ministre de la Défense nationale en vue de la réunion du cabinet restreint du 10 novembre 1993 (159a).
Le lieutenant-colonel Kesteloot (membre de la mission de reconnaissance, resté au Rwanda après le retour de la mission), dans deux télex, datés du 9 novembre 1993 (repris également dans le rapport du groupe ad hoc et joints au dossier transmis au ministre de la Défense nationale en vue de la réunion du cabinet restreint du 10 novembre 1993) s'exprime lui aussi en termes critiques au sujet du contingent bangladais qui devait occuper le secteur de Kigali conjointement avec les troupes belges. Ces problèmes vont bien au-delà de la logistique. Les télex évoquent des problèmes relatifs au commandement, aux transmissions et à l'absence de véhicules (160a). Le lieutenant-colonel Kesteloot déclare en tout cas « Nous avons ressenti l'insuffisance des Bangladais dès leur arrivée » , constatation à laquelle souscrit le colonel Marchal : « La première partie du détachement bangladais est arrivée le 6 décembre sans une bouteille d'eau, sans nourriture. Les instructions de l'ONU prévoient pourtant que les détachements doivent être autosuffisants pour trois mois » (161a). À la question de savoir si cela a été signalé au C Ops à Evere, le lieutenant colonel Kesteloot répond par l'affirmative (162a).
Aucune enquête préalable n'a été réalisée par l'armée belge au sujet de la capacité opérationnelle des troupes qui allaient devoir opérer avec les militaires belges dans le secteur de Kigali (163a).
Il était clair dès le départ qu'aucune troupe ne serait (pourrait être) fournie par l'Autriche durant la première phase de l'opération. Le ministre de la Défense nationale, M. Delcroix, son chef de cabinet, le général-major Schellemans, ainsi que le chef d'état-major de l'armée, le lieutenant-général Charlier, sont très explicites à ce sujet. Le 29 mars 1994, le ministre de la Défense nationale confirmait au Parlement qu'il était clair dès l'automne 1993 que des troupes autrichiennes ne pourraient être engagées que 9 à 12 mois plus tard (164a).
L'ancien ministre le confirme au cours des auditions de la commission.
Lors de son audition, le général-major Schellemans a déclaré : « Après quelques semaines, il était clair qu'il était impossible d'envoyer des soldats autrichiens dans un délai raisonnable » (165a). Et le lieutenant-général Charlier a déclaré au cours de sa deuxième et sa troisième audition que son idée était de profiter de la relève de KIBAT I à la mi-mars 1994 pour obtenir le renfort autrichien (166a). Du reste, indépendamment du fait de savoir quand le contingent autrichien serait opérationnel, on n'était pas d'accord sur la question du rôle qu'il devrait jouer. Pour le cabinet de la Défense nationale, il viendrait remplacer une partie des troupes belges (167a). Pour le chef d'état-major-général, le lieutenant-général Charlier, il devait s'ajouter au contingent belge, comme renfort (168a). En janvier 1994, le lieutenant général Charlier proposa même de retirer les troupes belges si, comme cela était apparu lors d'une réunion des chefs d'état-major avec le ministre de la Défense nationale, l'intention était de substituer la compagnie autrichienne à une compagnie belge (169a). L'attitude de l'ONU, a varié. Sur le terrain, le général Dallaire fut d'abord hostile à une participation autrichienne, parce qu'il s'agissait de miliciens et qu'ils devaient encore être formés (170a). Plus tard, il en fut partisan à condition que ce soit comme renfort (171a), mais là, c'est le secrétariat des Nations Unies qui était contre pour des raisons budgétaires (172a). Pour le secrétariat des Nations Unies, avec la venue des troupes bangladaises, le nombre autorisé par le Conseil de sécurité était atteint et le contingent complété (173a).
La commission constate que le problème de l'absence d'un second contingent crédible n'a en tout cas pas bénéficié de l'attention requise et que les nombreuses mises en garde formulées concernant la valeur des autres troupes de la MINUAR n'ont pas été suivies d'une réaction appropriée.
3.2.3.4. Les différentes missions dont la QRF (Quick Reaction Force)
La limitation du contingent belge et l'absence d'un second contingent crédible ont eu pour conséquence immédiate que des tâches essentielles qui avaient été confiées au secteur de Kigali de la MINUAR n'ont pu être exécutées que dans une faible mesure, voire pas du tout. Officiellement, les troupes belges à Kigali se virent attribuer deux des trois secteurs, à savoir Kigali-centre et l'aéroport, et les Bangladais un secteur, à savoir Kigali-Nord, tandis que ce que l'on a appelé la QRF, une force d'intervention équipée de véhicules blindés légers et placée sous le commandement du général Dallaire, devait intervenir partout au Rwanda si une situation critique venait à l'exiger. Le commandant de KIBAT I, le lieutenant-colonel Leroy déclare qu'il était déjà clair au moment de la reconnaissance qu'il n'y avait pas assez d'hommes pour mener à bien les missions prévues, notamment la recherche d'armes dans les secteurs attribués (174a). En outre, il n'était guère, voire nullement question d'une QRF, de sorte que les troupes belges ont été obligées de mettre sur pied elles-mêmes, dès le départ, une réserve plus grande (les delta teams ) et d'utiliser le personnel logistique pour effectuer les gardes et relever quarante à cinquante personnes. En pratique, cela signifiait que 350 hommes seulement étaient disponibles sur le terrain, ce qui était insuffisant pour effectuer les tâches que le contingent belge s'était assignées (175a), ou du moins pour le faire avec l'intensité voulue (176a).
Outre la limitation du nombre d'hommes, l'absence d'une force d'intervention opérationnelle est donc à l'origine d'une exécution déficiente des missions. L'absence de QRF était d'ailleurs elle-même la conséquence du contingent limité envoyé par la Belgique, bien que l'on puisse se demander pourquoi l'état-major général a opté pour l'occupation de deux secteurs à Kigali, dont l'aéroport, plutôt que d'un seul secteur, à savoir celui où se trouvait l'aéroport et la force mobile d'intervention. Certes, les deux options présentaient des avantages et des inconvénients. Un « choix dramatique » a dû être effectué, selon les termes utilisés par ancien chef d'état-major de la force terrestre, le lieutenant général Berhin, lors de son audition (177a). On a finalement retenu la première option. Parce que, pour « des raisons politiques » , la Belgique ne revendiquait pas le commandement de la Force. « Je comprends très bien qu'il y ait eu des raisons politiques pour que la Belgique ne revendique pas le commandement de la Force. J'estime qu'il y avait des raisons militaires pour qu'elle le revendique. La décision a été prise sans consulter les militaires. Le mandat, il est évident que nous étions dans ce schéma de l'ONU que nous connaissions bien pour l'avoir expérimenté déjà depuis 2 ans en Yougoslavie » , si l'on en croit les déclarations du lieutenant-général Charlier lors de sa première audition (178a), bien qu'il ressorte de plusieurs témoignages, notamment du lieutenant-général Charlier, que les autorités militaires belges avaient, elles aussi, choisi d'être présentes, et dans le centre de Kigali (où habitait du reste la plus grande partie de la population et des expatriés belges) et dans le secteur où se trouvait l'aéroport, afin de pouvoir utiliser celui-ci en cas de besoin comme base de sortie (179a). Toutefois, selon le lieutenant-général Charlier, la solution même fut décidée sur le terrain par le général Dallaire : « Devant l'insistance du ministre de limiter l'effectif à 300 hommes, nous avons discuté avec l'état-major présent sur place à Kigali afin d'examiner si nous pouvions réorienter les missions. Il en est ressorti que nous pourrions assurer deux secteurs de Kigali, étant entendu que la QRF serait fournie par un autre pays et que les autres secteurs de Kigali seraient également du ressort d'un autre pays. Cette solution émanait du commandant de la force (180a).
Le général Dallaire le confirme :
« What quick reaction capability I had was based on a company of the Bangladeshi Battalion. I had originally planned to give that role to the Belgian contingent; however, the decision to only send a « demi-Battalion » (approximately 400 personnel) rather than the requested full Battalion (800 personnel) meant that the Belgian forces could not perform that role and all the other essential security tasks in the KWSA .
The APCs had arrived in late February/early March without tools, spare parts, mechanics, manuals and with limited ammunition. The main weapon on the APCs had never been test fired in Rwanda. Training for the Quick Reaction Force had commenced bij late February in roles envisaged in keeping with the deterrent aspects of peacekeeping. They were meant to provide a presence to deter conflict between the opposing parties. They also had limited training in crowd control operations. This small force did conduct some training in the rescue of hostages. The proficiency of the forces involved, however, had not progressed to the point that they could be considered for those tasks without an unacceptable measure of risk. The equipment limitations and their proficiency in using such systems was still below acceptable operational standards » (181a).
Ce qui n'est pas clair, par contre, c'est quand a été prise la décision d'agir ainsi. Les déclarations du colonel Marchal au cours de l'audition du 7 mars 1997 pourraient donner à penser que c'est pendant la mission de reconnaissance, vu qu'il dit que la décision a été prise par le colonel Flament et le général Dallaire (182a). Dans un rapport de la réunion du cabinet restreint du 10 novembre 1993 rédigé à l'intention du Premier ministre, il est dit toutefois que le ministre de la Défense nationale propose que la Belgique demande la zone centrale et la QRF. Ce point n'apparaît plus toutefois dans les conclusions du Premier ministre.
Le Premier ministre a déclaré à ce sujet lors de sa deuxième audition que : « ... een centrumzone essentieel was en ook een voldoende aantal mensen om de leiding ervan te nemen... » . Le Premier ministre a poursuivi que le QRF : « ...in de besprekingen niet als een essentieel punt aan de orde is gekomen, en ook naar de conclusies toe niet is weerhouden als een punt dat zich in het centrum van het debat vond. (...) Blijkbaar heeft minister Delcroix dit in zijn inleiding zo vermeld » (183a).
La thèse défendue par quelques-unes des personnes interrogées, comme quoi la décision finale de laisser la QRF à RUTBAT serait la conséquence du refus du général Dallaire d'opérer avec des engins à chenilles plutôt qu'avec des blindés sur roues que la Belgique ne possédait pas à l'époque, ne trouve aucun élément de confirmation dans les déclarations écrites faites par le général Dallaire à l'intention des instances judiciaires belges. Elle est également réfutée par les déclarations du colonel Marchal lors de son audition du 14 mars 1997 : « Le général Dallaire était d'ailleurs d'accord pour demander des blindés et des munitions ». À la question de savoir si le général Dallaire ne persistait donc pas à demander des véhicules à roues et non des véhicules à chenilles, le colonel Marchal répond : « Je crois qu'au moment de la reconnaissance, le général Dallaire a pensé à des véhicules lourds à chenilles. Techniquement ce n'était pas à recommander. Les blindés légers, dont la pression au sol est minime, étaient plus indiqués. Au moment où les événements se passent, le général Dallaire est toutefois persuadé que la QRF arrivera au moment voulu avec des hélicoptères. Je rappelle que cette reconnaissance se passe en octobre et qu'en décembre la situation a évolué, et cela d'une manière négative » (184a).
Quoi qu'il en soit, personne n'a vérifié avant le déploiement des troupes belges si les Bangladais étaient effectivement en mesure d'assurer une QRF, alors que l'un des télex du lieutenant-colonel Kesteloot du 9 novembre 1993, déjà cité plus haut, contenait déjà quelques indications pour susciter des doutes à ce sujet. Ainsi qu'on l'expliquera plus loin dans le rapport (voir point 3.3.4.), le commandant du bataillon n'est arrivé que fin janvier et il fallut attendre fin février début mars 1994 avant que n'arrivent au Rwanda les véhicules, des BTR, qui avaient encore été utilisés par l'ONU dans une opération au Mozambique. De plus, les Bangladais n'étaient pas formés à la conduite de ces véhicules et il n'y avait pas de personnel prévu pour en assurer l'entretien et la réparation. Il n'a donc pas été question d'une QRF opérationnelle pendant toute la durée de l'opération MINUAR (185a). Cela est confirmé par le général Dallaire qui, dans son témoignage écrit à l'avocat général de la Cour militaire belge, déclare : « By 7 April 1994 the preparation of the Bangladeshi force had not progressed to the point that they could be considered for those tasks as their equipment limitations and their ability in using such systems were below acceptable operational standards. In keeping with the peace-keeping mandate, the Quick Reaction Force was not trained, equipped, nor operationally to be prepared to conduct any offensive assault operations » (186a). Il y a lieu de se demander si cela était inéluctable. Sans doute pas, du moins si l'on avait réagi au cri d'alarme du colonel Marchal. Immédiatement après son arrivée à Kigali, le 4 décembre 1993, il constate qu'il est exclu que l'on dispose d'une QRF durant les premiers mois de l'opération. Et à peine quatre jours plus tard, le 8 décembre 1993, il adresse dès lors une demande à Bruxelles pour pouvoir mettre sur pied lui-même une QRF et obtenir pour cela des véhicules blindés, demande à laquelle il n'a jamais été répondu (187a). Le contingent belge fut dès lors contraint de maintenir la réserve limitée qu'il avait constituée dès le début de l'opération, et ce malgré le nombre d'hommes peu important dont il disposait.
Selon la commission, il résulte de tout cela qu'il faut poser la question de savoir si c'était bien justifié d'envoyer des troupes au Rwanda sans que les autorités militaires ou politiques aient pu s'assurer au préalable qu'une force de réaction ou d'intervention crédible serait présente. Il faut également poser la question de savoir si c'était de la responsabilité de l'ONU de veiller à ce qu'une QRF opérationnelle soit disponible sur le terrain. Il était cependant tout autant de la responsabilité des autorités belges de s'assurer que les Bangladais étaient en mesure d'assumer cette mission et de prendre immédiatement les mesures nécessaires lorsqu'il apparut, dès le départ, que tel n'était pas le cas.
3.2.3.5. La dispersion des cantonnements
Ainsi qu'on l'a souligné déjà dans le rapport du groupe ad hoc , la mauvaise préparation de la participation à l'opération MINUAR s'est manifestée également dans les problèmes qui se sont posés concernant le casernement (188a). En premier lieu le CTM aurait été chargé de cette mission, mais à cause de la neutralité obligatoire ceci était impossible.
« (2) Implantation de KIBAT
(a) Lors de la préparation de la mission, la CTM avait été chargée d'effectuer des Recce pour l'implantation de KIBAT.
L'idée qui a alors prévalu dans le choix des Cant était que chaque Cie restât soudée (cf. Exposé du Lt Col Beaudoin). La raison en était plus d'ordre pratique (facilités de Comdt, d'Sp Log, diminution des charges ancillaires de garde et de permanence) que d'ordre tactique. Par la suite, pour respecter la neutralité de la MINUAR, la CTM a été déchargée de cette mission.
(b) KIBAT I a d'abord été regroupé dans le stade Amahoro jusqu'à l'arrivée de RUTBAT (10 décembre 1993). Le Bn a alors été dispersé en 14 cantonnements allant de l'école abritant 90 personnes (Groupe Sud à Beverly Hills) jusqu'à la villa privée de 5 personnes (Det Med à Vitamine).
Cette dispersion, dont le principe était tout à fait défendable, était d'une part voulue par le Gen Dallaire qui souhaitait une présence la plus large possible de la MINUAR, surtout au Centre ville et d'autre part, imposée par l'Infra existante et les budgets limités. La MINUAR était considérée comme une Ops à petit budget et l'ONU n'intervenait pas pour le paiement de logements en dur. Il a donc fallu se tourner vers des Infra gratuites (Don Bosco, Soeurs, etc.)
(c) Certaines implantations ne répondaient pas aux besoins Ops (ex : séparation des médecins de l'ACP, des pilotes de leur Helis).
(d) Cette dispersion inquiétait toutefois le Lt Col Dewez qui souhaitait rassembler à l'Aer le groupe AIRFIELD, les Helis avec leurs pilotes et l'ACP. L'Ops KIGALODGE était en bonne voie et devait constituer une bonne solution au problème » . (189a)
Quand les hommes quittèrent la Belgique le 18 novembre 1993, aucune solution satisfaisante n'avait été trouvée à ce problème. En fin de compte, les Casques bleus belges seront logés dans pas moins de quatorze cantonnements, répartis sur l'ensemble du territoire de Kigali (190a). Certains de ces cantonnements étaient de simples demeures privées dans lesquelles pouvaient être logés au maximum cinq ou six hommes. Cette situation, qui offrait peut-être l'avantage de permettre une présence intense sur le terrain et de faciliter une opération d'évacuation éventuelle (191a), souleva dès le départ nombre de problèmes logistiques. Cependant, elle occasionna surtout des problèmes sur le plan de la sécurité. La garde de ces quatorze cantonnements différents nécessitait en effet beaucoup d'hommes et, de plus, rendait problématique le regroupement des hommes en cas de nécessité. Le problème fut évoqué dès le déploiement des troupes belges. Le 3 décembre 1993, le lieutenant-colonel Leroy, commandant de KIBAT I, adresse une note au C Ops à Evere, dans laquelle il propose pour des raisons de sécurité de ramener le nombre de cantonnements à neuf autour de cinq lieux. Le rapport d'inspection du major Guérin du 31 janvier 1994, qui sera évoqué plus en détail au point 3.3.4., met également l'accent sur le danger de cette dispersion en cas de troubles. Le chef d'état-major de l'armée, le lieutenant-général Charlier a reconnu lui aussi le problème. En cas de difficulté, KIBAT devait assurer sa propre sécurité en se repliant en hérisson : « ... en cas de reprise des hostilités ou dans toute situation dont le contrôle vous échappe, l'attitude que vous devez prendre est celle du hérisson en boule, qui consiste à se replier dans ses cantonnements et à être prêt à se défendre » (192a).
Un repli en hérisson est évidemment plus problématique quand les hommes sont aussi dispersés que c'était le cas pour les troupes belges à Kigali (193a).
La question que la commission s'est posée à ce propos est celle de savoir qui ou ce qui avait été à l'origine de ces problèmes d'hébergement. Selon le chef de l'époque du C Ops à Evere, la solution la plus indiquée aurait été que les Casques bleus belges soient regroupés par compagnie et logés, non pas dans des tentes, pour des raisons de sécurité, mais dans des bâtiments, mais « le général Dallaire souhaitait disperser les troupes » (194a). Selon le chef d'état-major de l'armée, le lieutenant-général Charlier, l'hébergement constituait une responsabilité de l'ONU : « Le représentant de l'ONU avait annoncé qu'on ne disposerait que de logements gratuits mis gratuitement à disposition par les Rwandais » . Il ajoute que le général Dallaire souhaitait que le terrain soit couvert au maximum (195a),(196a).
Il dément également que des problèmes budgétaires aient été à l'origine du problème. Dès décembre, le colonel Marchal aurait été assuré du budget nécessaire (197a). Il ressort toutefois de la déposition du colonel Marchal que c'est précisément là que se situait le problème. Le colonel Kesteloot, qui faisait partie de la mission de reconnaissance et est resté sur le terrain pour préparer la venue des troupes belges « aurait demandé de pouvoir signer les contrats de location pour des bâtiments disponibles » (198a). Il n'a apparemment pas reçu immédiatement l'accord pour ce faire, parce que Bruxelles continuait à partir du principe que l'ONU s'en chargerait. Le secrétariat de l'ONU avait conclu un accord avec le gouvernement rwandais, notamment sur ce point de la mission du 5 novembre 1993. Le texte mentionne toutefois que le gouvernement rwandais se chargerait de l'hébergement « dans la mesure de ses possibilités » (199a). Quoi qu'il en soit, quand le colonel Marchal arrive à Kigali le 4 décembre 1993, le problème de l'hébergement n'a toujours pas été résolu : « J'ai obtenu très vite l'autorisation du lieutenant-général Charlier pour signer ces contrats mais les grands bâtiments n'étaient plus disponibles » (200a). Avec la conséquence que les troupes belges se retrouvèrent finalement hébergées non par compagnie dans quelques cantonnements, mais dans quatorze cantonnements différents.
3.2.3.6. Les problèmes d'armements et de munitions
Comme l'indique le rapport du groupe de travail ad hoc , les troupes belges sont parties au Rwanda avec un armement léger (FNC et MINIMI 5.56). Elles avaient à leur disposition des véhicules UNIMOG et MANN et des jeeps ILTIS sur lesquelles on pouvait monter des mitrailleuses de type MAG 7.62., elles disposaient également de mitrailleuses .50. Elles pouvaient encore faire usage de deux hélicoptères et de six CVRT (deux Scimitars équipés d'un canon de 30 mm, mais dépourvus de munitions, et quatre Spartans équipés de mitrailleuses MAG 7.62) (201a). En ce qui concerne les munitions, les troupes disposaient notamment de grenades, de mortiers principalement de type « ILL » (illuminating) et « SMK » (smoke), de munitions pour les MAG et les FNC et de LAW antichars de courte portée (202a). Enfin, ils disposaient aussi d'affûts de MILAN (un lance-missiles antichar de moyenne portée) mais que l'on n'avait emporté que pour pouvoir en utiliser le dispositif de vision nocturne. Les missiles eux-mêmes n'étaient pas présents. Au total donc, il y avait au centre logistique une réserve de munitions représentant quelque 30 à 40 % de la dotation standard (basic load) que l'on emporte d'ordinaire pour une opération (203a). Enfin, des munitions pour mortier de type « HE » (high explosive) furent envoyées quelques jours après le déploiement des troupes belges, le 3 décembre 1993. Selon le lieutenant-colonel Briot, chef de la sous-section de planification pour les opérations extérieures au niveau de l'état-major général, cela s'est fait « discrètement » , à l'encontre des directives des Nations unies, pour « la sécurité du détachement » et après avoir reçu l'accord du chef de l'état-major général (204a). L'amiral Verhulst, qui assurait la direction du C Ops récuse toutefois le fait et impute l'envoi de ces roquettes à une erreur purement matérielle commise à l'insu de l'état-major général (205a).
Quoi qu'il en soit, selon plusieurs témoins, en vertu des directives adoptées par les Nations unies, il était impossible d'emporter des armes et des munitions plus lourdes au début de l'opération (206a). D'autres témoins soulignent en revanche que c'est le général Dallaire qui se serait opposé à la présence d'armes plus lourdes (207a). L'amiral Verhulst prétend même qu'il fallait également l'autorisation du Rwanda (208a).
La commission fait toutefois les constatations suivantes :
Les « Guidelines for Governments contributing military personnel to UNAMIR » n'interdisent pas d'emporter des armes et des munitions plus lourdes. Le texte stipule « mortars and other heavy crew-served weapons are not required » , ce qui veut dire littéralement qu'elles ne sont pas requises. Cela ne signifie nullement qu'elles ne puissent pas être emportées (209a). Il ressort par contre des mêmes instructions qu'il n'y a remboursement (partiel) qu'en cas de « request » par les Nations unies, d'où il faut déduire que les frais liés à un équipement qui n'est pas requis par les Nations unies, sont à charge du pays participant lui-même (210a). Si invraisemblable que cela soit, selon le colonel Engelen, l'ancien conseiller militaire à la représentation permanente de la Belgique à l'ONU, « not required » signifie bel et bien que les armes en question ne peuvent être emportées, encore qu'il puisse être dérogé à cette interdiction à la demande du pays sollicité. « En principe, ce n'est pas autorisé », mais « pour toute une série de raisons, certaines nations, pour certaines opérations, veulent emporter d'autres armements. C'est alors traité au cas par cas ». Quoi qu'il en soit, « l'ONU détermine le type d'armement à utiliser dans le cadre d'une mission après discussion avec les responsables du pays sollicité ». Et, selon le colonel Engelen, l'ONU n'a pas imposé de limitations et la Belgique a obtenu tout ce qu'elle demandait : « Je n'ai connaissance d'aucun refus de l'ONU. L'autorisation nous a été accordée pour l'utilisation de postes MILAN après que nous ayons fourni des explications » (211a).
Les règles d'engagement prévoient explicitement l'utilisation possible d'armes plus lourdes. L'article 8 dispose que c'est le commandant de la force qui a le pouvoir de faire usage d' « armes d'appui lourdes (ex. : lance-roquettes, pièces d'artillerie, mortiers légers, etc.) » et de « mitrailleuses ou canons lourds (cal. 50, 20 mm, etc.) » . Si l'on prévoit dans les directives pour l'opération MINUAR que le chef de celle-ci peut faire appel à cet armement, cela signifie mutatis mutandis qu'il peut également être déployé (212a).
Comme l'indiquent également les rapports d'évaluation d'opérations antérieures de l'ONU auxquelles la Belgique a participé, d'autres pays tels que le Danemark, le Canada ou la Grande-Bretagne emportent les armes et les munitions qu'ils jugent nécessaires sans beaucoup s'inquiéter des normes ou instructions édictées par l'ONU (213a). Du reste, on passe bel et bien outre à ces normes et instructions lorsque le C Ops ordonne, le 28 mars 1994, de répondre (partiellement) à la demande du terrain d'envoyer à Kigali des obus de 30 mm.
Selon plusieurs déclarations du colonel Marchal, le général Dallaire n'était nullement hostile à l'acheminement d'armes et de munitions plus lourdes. Au contraire « Le général Dallaire était d'ailleurs d'accord pour demander des blindés et des munitions, car il estimait que tout renforcement était un plus » (214a). Le général Dallaire le confirme dans son témoignage par écrit à l'auditorat-général près la Cour militaire, « (...) la fourniture des munitions, d'armes et d'autres équipements incombe à l'État fournissant le contingent » (215a).
La demande tendant à obtenir des munitions supplémentaires (notamment des missiles MILAN, des roquettes LAW, des cartouches .50, des mortiers et des obus de 30 mm, bombes pour les mortiers 60 mm) que le colonel Marchal et le lieutenant-colonel Leroy ont adressée, le 20 janvier 1994, au C Ops prouve en tout cas que l'armement était insuffisant dès le départ. Ils justifient tout deux leur demande en évoquant une possible détérioration de la situation à Kigali, qui obligerait à défendre l'aéroport et à procéder à l'évacuation de compatriotes (216a), un diagnostic d'ailleurs soutenu dans le rapport du 31 janvier 1994 du major Guérin venu inspecter l'opération à Kigali au nom du C Ops (217a). En d'autres termes, dans le chef des militaires belges qui avaient la responsabilité de l'opération à Kigali ou qui allaient reconnaître la situation sur le terrain, les armes et les munitions présentes étaient insuffisantes pour faire face à un possible « worst case scenario » .
3.2.3.7. La préparation des effectifs
Le général-major Roman, ancien commandant de la brigade paracommando, et le lieutenant-colonel Leroy, commandant de KIBAT, ont largement commenté devant la commission la préparation du premier détachement (218a). Avant la décision de déployer, des briefings logistiques et opérationnels ont été organisés par le C Ops, la section opérations de l'état-major de la force terrestre et la brigade des paracommandos. Un officier a été désigné au sein de la brigade paracommando pour réunir toute l'information nécessaire (219a). Nous avons également reçu des informations du service de renseignement militaire (SGR) et des contacts ont été pris avec des spécialistes de l'Afrique, de la RTBF et de la BRTN. Le programme d'entraînement a été modifié et orienté sur une mission éventuelle dans le cadre de l'ONU. On a mis sur pied un entraînement de trois semaines : une semaine de théorie et deux semaines de pratique de peace-keeping (les règles d'engagement, les principes de neutralité, l'organisation des patrouilles, les opérations de fouille et de désarmement, le « Cordon and Search » ). Une fois la décision prise, l'information a encore été intensifiée. On a rédigé ainsi un syllabus ainsi qu'un « petit livre rouge » au sujet de l'opération (220a). Il fut distribué sur le terrain en décembre. Tous les hommes ont également pu obtenir tous les renseignements nécessaires concernant les partis politiques, les personnalités, l'attitude à adopter, et les possibilités touristiques (221a).
Néanmoins, au cours des auditions, la commission a noté toute une série de plaintes concernant cette préparation.
l'information concernant les événements politiques récents s'arrêtait à l'année 1990 (222a);
l'information sur la région où il fallait opérer était trop générale, parfois même erronée (La commission a constaté que les Belges sur place ne savaient pas communiquer avec la population locale dans leur langue) (223a);
le briefing organisé par le C Ops fut intensif, mais basé sur des documents néerlandais ou danois; au lieu d'un briefing, on aurait d'ailleurs dû dispenser toute une formation (224a);
la préparation ne comportait aucune indication relative aux problèmes administratifs et aux méthodes de gestion propres aux Nations unies (225a);
Le lieutenant Nees n'était pas entraîné pour sa mission à Kigali : « Ces derniers qui n'ont pas reçu d'entraînement ont fait de leur mieux mais ils n'ont pas récolté l'information aux bons endroits. » (226a)
l'information fournie par le SGR était trop sommaire : « Du 3 au 11 novembre, nous avons reçu à titre de préparation une note générale du SGR où il n'était question que de généralités et nullement d'un climat antibelge. (...). La deuxième partie des préparatifs consistait à inviter des personnes qui avaient été au Rwanda. (...). Nous avons obtenu plus de détails d'eux que par les notes du SGR » (227a)
il n'y eut pas de préparation psychologique : « Nous étions dans une ville où tout semblait normal mais l'attitude de nos hommes au début me laissait à penser qu'ils n'avaient pas été suffisamment préparés » (228a);
Sans doute y avait-il un problème de mentalité des troupes parce qu'elles n'avaient pas encore eu de longues périodes de repos en Belgique. L'idée initiale du commandement de n'envoyer des militaires qu'une fois tous les deux ans en mission à l'étranger ne pouvait plus être respectée depuis longtemps (229a). Mais à l'époque de KIBAT I, le Ier para ne respectait même plus la règle du minimum absolu de 8 mois d'intervalle puisqu'ils avaient servi en Somalie jusqu'en avril 1993 (230a).
le chef du secteur de Kigali n'a guère été éclairé et préparé pour l'accomplissement de sa mission. « J'étais en possession d'un brouillon des règles d'engagement et d'une copie du rapport de reconnaissance du colonel Flament grâce à mes fonctions au cabinet. Je ne possédais pas de résumé des textes de la MINUAR ni de directives plus spécifiques quant à ma mission de commandant du détachement belge » (231a). Par contre, avant son départ, le colonel Marchal eut un entretien avec le chef d'état-major de l'armée, au cours duquel celui-ci lui fit deux recommandations. « La première concernait son souci de la sécurité pour le personnel. La seconde me demandait de veiller à ce que le cordon ombilical entre KIBAT et la brigade paracommando soit coupé » (232a).
les hommes n'ont reçu qu'un condensé des règles d'engagement : « La partie relative au génocide et aux crimes y était omise » (il s'agit du point 17 des règles d'engagement) (233a).
Enfin, la commission constate avec le général-major Roman que le chef des troupes de la MINUAR pour le secteur de Kigali, le colonel Marchal a en tout cas été désigné beaucoup trop tard, à savoir plus ou moins au moment du départ des troupes belges, de sorte qu'il n'a pas été associé directement à leur préparation (234a). Cela résulte du fait que le général Dallaire n'a décidé que tardivement qu'il y aurait un commandant de secteur distinct. Une autre option qui fut envisagée consistait à faire en sorte que le chef du bataillon belge commande aussi les Bangladais. Le lieutenant-colonel Leroy l'a toutefois refusée (235a).
3.2.3.8. Les limitations du mandat et des ROE (Rules of engagement)
Le rapport du groupe de travail ad hoc a déjà souligné le caractère limité du mandat tel qu'il était prévu dans la résolution nº 872 (approuvée par le Conseil de sécurité de l'ONU le 5 octobre 1993). Alors que les accords d'Arusha du 4 août 1993 prévoyaient encore une force armée internationale neutre chargée « to guarantee overall security of the country » , l'article 3a. de la résolution nº 872 limitait le mandat à « to contribute to the security of the city of Kigali, inter alia, within a weapons-secure area established by the parties in and around the city » (236a). En d'autres termes, alors que, selon les accords d'Arusha, des actions pourraient être entreprises partout au Rwanda pour garantir la sécurité, la résolution des Nations unies a limité cette faculté à Kigali et ce qui revêt plus d'importance encore à « to contribute » . Cet affaiblissement du mandat serait imputable à l'opinion qui prévalait au sein du secrétariat de l'ONU, à savoir que le mandat défini dans les accords d'Arusha serait irréalisable, et à l'opposition tant des États-Unis que de la Russie (237a).
Le télex de New York du 9 août 1993 précise dans le point 2.4 : « Le secrétariat souligne qu'une des tâches principales de la mission de reconnaissance est de mettre au point un « mandat réaliste et praticable » vu la retenue des USA, de UK et de Russie (...). »
Le texte précise en outre que « par conséquent, il pourrait bien y avoir une grande différence entre ce que les deux parties ont demandé dans leur requête initiale du 14 juin au secrétariat général et le mandat final de la Force d'intervention neutre » (238a).
En tout cas, l'ancien ministre des Affaires étrangères, M. Claes, a déclaré que ses services ne lui ont jamais signalé que l'on vidait de sa substance le mandat prévu par les accords d'Arusha (239a). L'on n'a fait aucun effort avant le début de l'opération MINUAR, pour obtenir un mandat plus étendu ou le plus étendu possible. M. Brouhns, ancien représentant permanent adjoint de notre pays auprès des Nations unies, a affirmé ne pas avoir reçu d'instructions de Bruxelles en vue d'obtenir un mandat plus étendu ni en vue de tirer parti de notre position clé d'épine dorsale de la MINUAR pour subordonner notre participation à l'acceptation d'un certain nombre de conditions à cet égard (240a). L'ancien ministre des Affaires étrangères et son chef de cabinet de l'époque, l'ambassadeur Willems, l'ont d'ailleurs confirmé (241a).
M. Claes a déclaré devant la commission : « Au moment de la discussion, les membres permanents du Conseil de sécurité voulaient réduire autant que possible la portée du mandat. Les Américains, les Russes, les Chinois et les Anglais étaient très réticents. Je crois qu'il eût été illusoire d'essayer de les convaincre d'élargir le mandat. On ne m'a de toute façon pas demandé d'obtenir une amélioration du mandat, car personne n'en ressentait le besoin. Nous ne sommes donc pas intervenus, mais si nous l'avions fait, nous aurions, sans aucun doute, essuyé un refus catégorique des membres permanents » (242a).
Pour leur part, les autorités militaires belges étaient convaincues ainsi que le rapport du groupe de travail ad hoc l'a déjà précisé également que leurs troupes pourraient développer des actions de leur propre initiative pour instaurer une zone démilitarisée dans et autour de Kigali, alors que selon une interprétation stricte du mandat, il s'agissait uniquement d'« assister » (243a).
Cette limitation du mandat s'est également traduite dans les « Rules of engagement », (ROE), et dans la « Procédure opérationnelle pour l'établissement de la zone de consignation d'armes de Kigali » . Les ROE comportent un ensemble de dispositions impératives, d'interdictions et de directives à l'usage des Casques bleus de l'ONU, qui déterminent à quel moment et dans quelle mesure il peut être fait usage de la violence et par qui l'autorisation doit en être donnée. La procédure opérationnelle pour l'établissement de la zone de consignation d'armes de Kigali établit de quelle façon et avec quels moyens la zone démilitarisée (KSWA) serait instaurée dans et autour de Kigali (244a). En dépit d'un certain nombre de déclarations contradictoires faites par différents témoins (245a), il est établi aux yeux de la commission que, comme l'avait déjà démontré le rapport du groupe ad hoc sur la base de documents du C Ops d'Evere, les autorités militaires belges ont bel et bien été associées à l'élaboration des deux documents (246a). Les ROE ont été rédigées par le général Dallaire, en concertation avec les autorités militaires belges qui ont entre autres demandé l'avis du service juridique de l'armée. Le secrétariat de l'ONU à New York les a finalement approuvées. Ce cours des choses est confirmé par M. Cools, ancien conseiller du représentant permanent de notre pays auprès des Nations unies, et par le lieutenant-général Berhin, l'ancien chef d'état-major de la force terrestre (247a). Par ailleurs, la procédure opérationnelle pour l'établissement de la zone de consignation d'armes de Kigali date de la nuit du 23 au 24 décembre 1993. Elle a été approuvée par les deux parties (FAR et FPR), à l'issue de négociations auxquelles participait, entre autres, le colonel Marchal.
Quoi qu'il en soit, malgré la consultation et la collaboration des autorités militaires belges, les ROE sont restées une source de confusion. Le général-major Roman, ancien commandant de la brigade paracommando, le dit sans ambages : « Elles n'étaient pas claires et nettes, de sorte que la réaction dépendait du caractère de chacun, ce qui était dangereux » (248a). Le colonel Marchal l'a exprimé comme suit : « Notre attitude était de ne pas tenir compte des règles d'engagement au sens propre. D'ailleurs, si on lit ces règles, on se rend compte qu'elles ne sont pas si contraignantes que cela. À Kigali, j'avais toujours les règles d'engagement dans ma malette et quand je vois les dispositions relatives à l'utilisation des armes, j'estime que toutes les possibilités restaient ouvertes » (249a). Après une lecture attentive des ROE, la commission est d'avis que celles-ci sont plus théoriques qu'opérationnelles. Tout dépend de l'interprétation (large ou stricte) que l'on donne du terme « autodéfense » . La commission estime même que les ROE comportent de nombreuses dispositions qui ne sont pas du tout restrictives, mais au contraire très larges. Elle renvoie entre autres à l'article 17, qui, sous l'intitulé « Crimes contre l'humanité » , autorise la MINUAR et l'oblige même moralement et légalement à utiliser tous les moyens pour mettre fin à des actes tels qu'exécutions, émeutes ethniques, attaques contre des étrangers, etc. (250a). S'il y a eu un problème en matière de directives, celui-ci viendrait plutôt de la procédure opérationnelle pour l'établissement de la zone de consignation d'armes de Kigali, qui indiquait clairement que la MINUAR ne pouvait pas intervenir de son propre chef dans le cadre de l'exécution de ses missions. Il s'est avéré, ainsi que cela sera encore abondamment évoqué ci-après, que ce fut là le principal obstacle à la liquidation des dépôts d'armes secrets.
D'autres questions d'ordre technico-militaire qui ont retenu l'attention de la commission sont :
(1) l'absence de plan d'évacuation lors du déploiement des troupes;
Le colonel Marchal a déclaré : « Le 8 janvier, nous étions encore au début de la mission. Il n'existait pas de plan d'évacuation » (251a).
L'audition de l'amiral Verhulst fait apparaître que à l'échelon de l'ONU. « L'évacuation s'est faite en combinant les forces de la MINUAR et les moyens belges arrivés ultérieurement. Mais c'est la MINUAR qui avait préparé, avec les ambassades, le plan d'évacuation » (252a).
(2) l'absence de directives claires relatives au statut des Casques bleus belges en cas de difficultés graves;
Lors de son audition du 14 mars 1997, le colonel Marchal aborde le problème du statut. « Dois-je suivre les instructions onusiennes ou les directives belges pour l'évacuation des compatriotes La situation peut basculer. Je demande des directives précises. (...) Je voulais savoir ce qu'il convenait de faire si l'évacuation se passait mal. C'était un problème de statut. » (253a)
(3) l'absence d'un service de renseignement (page 374);
(4) l'absence de matériel logistique essentiel.
La commission constate que lors de la préparation de l'envoi de troupes belges dans le cadre de l'opération MINUAR, il n'a pas été tenu compte d'un certain nombre de leçons des opérations de l'ONU auxquelles la Belgique avait participé en 1992 et 1993. Force est de constater, à la lecture des rapports rédigés suite à l'UNPROFOR-1992 et à l'UNPROFOR-1993, que ceux-ci avaient mis en garde et formulé des recommandations contre des erreurs et manquements tout à fait identiques à ceux commis lors de la participation belge à l'opération MINUAR. Tant l'état-major général que le ministre de la Défense nationale et son cabinet avaient connaissance de ces rapports.
La commission attire plus précisément l'attention sur :
(1) Le rapport du colonel Malherbe relatif à l'UNPROFOR du 21 août 1992.
Dans ce rapport qu'il adresse à l'état-major général et au chef d'état-major de la force terrestre, l'ancien commandant des troupes belges en ex-Yougoslavie, le colonel Malherbe, affirme qu'à ce sujet d'autres nations qui participent fréquemment à des opérations de l'ONU ne se sentent pas strictement liées par les directives de l'ONU. « L'expérience m'a néanmoins appris que les nations ayant une expérience ONU (par ex. Danemark, Canada, R-U, etc.) ne se sentent pas exagérément liées par les normes ONU (par ex. par le nombre d'APC, l'armement emporté, etc.). » (254a)
(2) Le rapport du colonel Malherbe relatif à l'UNPROFOR du 2 septembre 1992.
Ce rapport, également adressé à l'état-major général et au chef d'état-major de la force terrestre, rend compte de la mission UNPROFOR-secteur Est du 13 mars 1992 à fin-août 1992. (255a)
(3) Le rapport du colonel Heyvaert relatif à l'UNPROFOR du 13 mai 1993.
Dans ce rapport qu'il adresse à l'état-major de la force terrestre, le colonel Heyvaert, le commandant de BELBAT 2, aborde les problèmes auxquels sa mission a été confrontée. Il est frappant de constater que ces problèmes sont identiques à ceux que nous rencontrons également dans l'opération MINUAR (256a).
Le colonel Heyvaert parle plus particulièrement des problèmes suivants :
il n'y a pas de véritable maintien de la paix; « (...) il est utopique de croire dans de vraies missions de maintien de paix, maintenant ou à l'avenir »;
il faut tenir compte de la possibilité d'une dégradation de la situation;
il est indispensable d'emporter des armes plus lourdes;
chaque peloton doit être équipé de minimum deux tireurs MILAN.
Toutes ces recommandations reviennent dans le rapport transmis, le 12 juillet 1994, après le retrait de KIBAT, par le chef d'état-major de l'armée, le lieutenant général Charlier, au ministre de la Défense nationale. Tout comme les documents précités, le rapport Charlier indique que (257a):
notre pays ne peut s'engager dans une opération de l'ONU qu'à la condition de disposer, dès le début de cette opération, de garanties suffisantes quant aux moyens en termes de personnel, d'équipement, d'armement et de moyens financiers et quant à la protection et à la sécurité des hommes; le mandat doit également être rédigé de telle manière que les règles d'engagement et l'équipement puissent être adaptés à l'évolution de la situation sur le terrain;
les moyens déployés doivent être conformes à l'analyse militaire de la situation sur place;
la protection des hommes doit être garantie par, entre autres, un armement lourd et des véhicules blindés;
un appui aérien doit être prévu;
il y a lieu de créer un service de renseignements avec des moyens suffisants.
Malgré le rapport du lieutenant général Charlier l'on peut se demander si nous tirons effectivement des leçons du passé. La commission constate que nous ne l'avons en tout cas pas fait dans le cadre de l'opération de maintien de la paix suivante. Lorsque, quelques mois à peine après la MINUAR, une vingtaine de militaires belges participent à une nouvelle opération de l'ONU, plus précisément à l'opération COLUMBUS-Haïti, l'on commet les mêmes fautes et manquements, en dépit de tous les rapports d'évaluation et d'inspection. Le rapport du 5 novembre 1994 du major De Greeve, l'officier chargé du commandement, est parfaitement clair : « Au moment du départ, le 2 novembre 94, la Mun n'était PAS encore présente malgré le contact Tf à 5 heures avec le 93 Bn log (PERSONNE n'était au courant au 93 Bn Log !). En l'absence de changement à 6 heures (heure de départ selon le plan de vol), je suis parti. Nous pouvons utiliser (Nl) Mun (...) ». Il ressort des rapports ultérieurs d'Ops. COLUMBUS que le problème traîne en longueur pendant plusieurs semaines. L'absence d'un plan d'évacuation, des moyens de transmission défectueux et d'autres problèmes similaires sont également évoqués dans les rapports journaliers du major De Greeve. (258a).
Le paysage politique rwandais s'est polarisé avant la signature des accords d'Arusha en août 1993.
Selon le professeur Reyntjens, cette polarisation a débuté à partir de janvier 1993. Elle s'est concrétisée par le fait qu'au lieu de jouer à trois partenaires comme le prévoyaient les accords (MRND-FPR-partis d'opposition), on s'est déjà trouvé à la mi-1993 dans une situation limitée à deux parties. « Tous les partis d'opposition se sont scindés en deux ailes, l'une favorable aux accords d'Arusha, l'autre réticente et méfiante, voire plus.
Le premier moment important se situe en février 1993 lorsque le FPR entame une offensive importante qui le mène aux portes de Kigali. Les partis d'opposition et certaines organisations de défense des droits de l'homme clament alors leur désapprobation.
En juillet 1993 et en prévision de la signature prochaine des accords d'Arusha, nous assistons à une nouvelle scission à savoir celle du MDR, le principal parti d'opposition.
Ensuite interviennent le coup d'État du Burundi et l'assassinat du président burundais, ce qui a pour conséquence que les Hutus, et notamment les Hutus qualifiés de modérés, affirment qu'on ne peut pas faire confiance au FPR et, par extension, aux Tutsis eux-mêmes, entrant ainsi dans une logique génocidaire.
Cette opinion est renforcée par le fait que certains Tutsis ont jubilé à Kigali lors de l'annonce du coup d'État au Burundi et ont refusé d'assister à la manifestation de soutien au peuple burundais organisée le 23 octobre.
Avec le recul, on peut conclure que l'accord d'Arusha est mort avec l'assassinat du président du Burundi » (1b).
Le professeur Reyntjens a estimé que d'un point de vue politique, l'accord d'Arusha était équilibré, dès lors que le paysage politique du pays demeurait tripolaire. Mais le Rwanda étant devenu bipolaire, « les autorités ont joué sur la minorité de blocage pour l'octroi de certains portefeuilles et de sièges parlementaires. La bipolarisation et la croissance de la méfiance entre groupes qui s'en sont suivies, ont rendu ces accords de moins en moins réalistes. L'acteur principal de ce pays est la peur » (2b).
Ce blocage de la situation a été observé par d'autres acteurs extérieurs, notamment par M. Ndiaye, rapporteur spécial de la Commission des Nations unies sur les droits de l'homme. Selon ses déclarations devant la commission, il y eut volonté délibérée de ne pas respecter les accords d'Arusha. « Les accords semblaient raisonnables, car ils visaient à une démocratisation réelle, à la fusion des armées etc. Ils concrétisaient la logique qui menait à la paix.
On a sans doute minimisé la duplicité des dirigeants rwandais. Dans leur esprit, partager le pouvoir c'était reconnaître leur défaite. Chaque tentative de retour des réfugiés tutsis avait été un échec et avait conforté le triomphalisme du pouvoir. Le succès du FPR menaçait directement l'équilibre politique, ce qui a mené le groupe dirigeant à la recherche d'une solution finale qui puisse racheter l'échec militaire.
J'ai rencontré des gens qui venaient de voir le président Habyarimana et qui m'ont affirmé de bonne foi que celui-ci allait respecter les accords. Or, manifestement, il les sabotait.
Lors de mon passage, il n'y avait pas de ministre de la justice car l'action de celui-ci ayant été bloquée par le MRND, il avait démissionné. Personne n'avait pu obtenir ensuite l'agrément du président pour ce poste. Le même blocage s'exerçait contre le ministre de l'information, membre d'un parti de l'opposition qui ne contrôlait, par exemple, pas la radio, dont 85 % des agents étaient membres du MRND. Habyarimana ne lâchait rien. Il n'avait pas partagé le pouvoir depuis dix-neuf ans. Les accords d'Arusha représentaient une obligation de partage qu'il ne voulait pas mettre en oeuvre. Il y avait aussi le refus de voir au-delà des intérêts du clan » (3b).
Cette situation de blocage était également perceptible par les Rwandais eux-mêmes, ainsi que l'affirme M. François-Xavier Nsanzuwera, ancien procureur de la République rwandaise :
« Dès le mois de janvier 1994, tout le monde était conscient que la guerre allait reprendre, car le mouvement Interahamwe se faisait de plus en plus important. (...)
La distribution des armes était déjà systématique à l'époque et le fusil le plus distribué était l'ancienne arme de l'armée rwandaise : le G3. Je m'en suis rendu compte, car ces armes furent utilisées lors de vols à main armée. (...) Les deux parties préparaient la guerre » (4b).
Le lieutenant-général Uytterhoeven déclare d'ailleurs lui aussi : « Il ressortait de mon entretien avec M. Nsabimana que la nouvelle attitude du contingent belge était jugée acceptable. Selon lui, son pays était au bord de la guerre, non à Kigali, mais dans le Nord. En tant que militaire, son devoir était de préparer cette guerre. (...) Selon lui, la guerre avec le FPR ne s'était jamais terminée et il n'y avait qu'une période d'accalmie. Il envisageait même la possibilité d'armer les civils » (5b).
Quant aux acteurs politiques et militaires belges, étaient-ils au courant de l'importance de la dégradation de la situation politique du pays ?
D'emblée, la commission répond de manière affirmative à cette question, puisqu'aussi bien M. Swinnen que les Affaires étrangères avaient très bien perçu la polarisation et la radicalisation croissante qui s'opérait au Rwanda suite notamment à l'action des « extrémistes ».
Comme le professeur Reyntjens, l'ambassadeur Swinnen avait perçu le début de la bipolarisation avant la signature des accords d'Arusha en août 1993. «Des dissensions avaient déjà surgi au sein du MDR avant la signature des accords d'Arusha. À l'époque, ce parti était considéré comme le principal parti d'opposition en puissance. Les problèmes au sein du MDR et du parti libéral étaient liés non seulement aux accords d'Arusha, mais également à des antagonismes régionaux et individuels. Nous étions convaincus que le centre politique ne résisterait pas à la bipolarisation et à la radicalisation des positions. Le souci de la «mouvance présidentielle» pour disposer d'une minorité de blocage dans les institutions de l'État ne fit que renforcer cette tendance.
Le coup d'État du 21 octobre 1993 au Burundi a fortement hypothéqué les négociations en vue de l'installation du nouveau gouvernement rwandais.
Le président estimait que la communauté internationale lui reprochait de ne pas avoir joué le jeu et d'avoir été trop méfiant par rapport au processus de paix.
Or, un président d'un pays voisin a été assassiné, malgré sa politique progressive de réconciliation nationale.
La méfiance suscitée de la sorte était significative. On devint particulièrement vigilant à l'égard des engagements avec le FPR et les partis d'opposition. Le facteur burundais a pesé lourdement sur les négociations à venir.
Au sein du MDR et du PL, il y eut une lutte pour obtenir des postes ministériels et des sièges parlementaires. La plupart du temps, cette lutte opposait les partisans des accords d'Arusha à ceux qui s'en méfiaient» (6b).
Les informations recueillies par M. Swinnen étaient systématiquement envoyées, par télex (cf. rapport groupe ad hoc ), aux Affaires étrangères.
Les Affaires étrangères connaissaient donc le climat qui régnait au Rwanda au cours de l'année 1993 et au début de 1994.
C'est d'ailleurs en ce sens que se sont exprimés, respectivement, M. W. Jaenen, conseiller général à la direction d'administration des relations bilatérales (service P50) et le ministre Claes : « Nous avons constaté que les accords d'Arusha n'étaient pas exécutés et supposé qu'il y avait dans les divers partis des gens qui n'avaient aucun intérêt à ce que les accords soient appliqués. Nous ignorions cependant de quelles personnes il s'agissait. (...) Nous étions convaincus que l'exécution des accords d'Arusha était bloquée. C'est pourquoi le ministre Claes s'est rendu au Rwanda » (7b).
Quant à M. Claes, il déclare : «Le Gouvernement n'a pas caché l'existence de caches de munitions ni le fait que la population était armée. Au contraire, il l'a même rendu public.
Trois jours avant mon départ au Rwanda, j'ai établi un bilan de la situation suite à une interpellation de M. Van Peel. J'ai rassemblé le texte de cette interpellation et la réponse que j'y ai donnée dans une brochure que j'ai transmise aux membres de la Chambre et du Sénat ainsi qu'à divers milieux intéressés.
On peut lire dans cette brochure : l'insécurité pourrait s'accroître si la situation reste bloquée, d'autant plus que des armes circulent.
Cela prouve bien que le Gouvernement n'a pas sous-estimé l'affaire. Je suis allé au Rwanda lors d'une période particulièrement dramatique. (...) (8b)
Le dimanche après-midi, j'ai convoqué tous les partis à l'ambassade. Le FPR ne s'est pas présenté. J'ai alors déclaré que j'étais venu en ami du pays pour leur demander de mettre fin à tous les conflits. Je leur ai fait part des avertissements provenant de New York et je les ai exhortés à convoquer le parlement. J'ai précisé aussi que la commission mixte Belgique-Rwanda ne se réunirait pas tant qu'il n'y aurait pas de progrès.
Au cours de cette même nuit, de graves incidents ont éclaté, au cours desquels deux personnalités ont été tuées, dont le ministre Gatabazi qui venait de plaider en faveur de la réconciliation.
Ensuite, je me suis rendu chez le président Museveni et je lui ai demandé d'inciter le FPR à se rendre au parlement.
Le FPR a alors pris contact. Lors de mon retour à l'aéroport, j'ai rencontré un représentant du FPR qui m'a déclaré ne pas avoir confiance et ne pas être en mesure de se rendre à la réunion d'installation du parlement. Je lui ai répondu que je n'appréciais pas cette attitude et que le FPR avait le devoir de se rendre à l'assemblée, éventuellement sous escorte » (9b).
Dans la brochure précitée reproduisant sa réponse à l'interpellation de M. Marc Van Peel du 15 février 1994, le ministre Claes écrit : « Actuellement, l'obstacle principal à la mise en oeuvre des accords d'Arusha est la discordance au sein de deux partis politiques, le MDR et le PL, empêchant la formation du gouvernement de transition et l'installation du parlement de transition » (10b).
Dans la même réponse, M. Claes signale que :
« Le choc des ambitions et intérêts personnels n'est pas étranger non plus aux difficultés qui s'opposent à la mise en oeuvre des accords d'Arusha » (11b).
Le ministre Claes écrit dans sa lettre du 11 février 1994 (et non du 14 mars 1994 comme indiqué erronément dans le Blue Book (12b)) au secrétaire général Boutros Boutros-Ghali :
« Il me paraît cependant que cette accentuation du profil de l'ONU au niveau politique devrait aller de pair avec une attitude plus dissuasive de la MINUAR sur le plan de la sécurité.
Je suis conscient de la complexité de la situation comme des contraintes qui vous sont imposées dans le cadre de la résolution 872 du Conseil de sécurité.
Il est à craindre néanmoins qu'à défaut d'enrayer l'évolution négative à laquelle nous assistons, la MINUAR pourrait se trouver dans l'impossibilité de poursuivre valablement sa mission fondamentale, à savoir jouer un rôle majeur d'appui à la mise en oeuvre de l'Accord de paix d'Arusha.
Je puis vous assurer que le Gouvernement belge continue de son côté à exhorter le président Habyarimana et les autres responsables politiques rwandais à accepter les compromis qui s'imposent. »
Immédiatement après son départ du Rwanda, le ministre Claes envoie le télex 138 à partir d'Ambabel Bujumbura :
« 1. (Traduction) Vu la situation au Rwanda, il convient, selon moi, que Delbelonu New York et Ambabel Washington transmettent respectivement au secrétaire général des Nations unies Boutros et à son adjoint Moose le message suivant. (...)
2.1. Au cours de mon séjour à Kigali (19-22 février 1994), j'ai eu des contacts avec le président, le Premier ministre, le Premier ministre désigné du futur gouvernement de transition, le ministre des Affaires étrangères, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies, M. Booh-Booh, le général Dallaire (MINUAR), les représentants de l'OUA, de l'UE et de la Tanzanie. En outre, j'ai eu des conversations avec les représentants de tous les partis politiques qui constitueront le gouvernement de transition. (...)
2.3. (...)
Les partis MDR et PL restent intérieurement divisés et empêchent la formation du gouvernement de transition. Selon les représentants de la communauté internationale que j'ai contactés (voir point 2.1.), il ne fait aucun doute que le président Habyarimana y est pour quelque chose, s'efforçant ainsi de s'assurer dans les nouvelles institutions une minorité de blocage à son avantage. (...) »
Il conclut par un avertissement clair :
« 2.6. J'estime que la Belgique, les Nations unies et les États-Unis ont tout intérêt, pour l'avenir du Rwanda, à éviter une nouvelle guerre civile et à exercer des pressions sur les responsables rwandais, et en particulier sur le président rwandais pour que l'on crée les institutions de transition et que l'on poursuive l'exécution des accords d'Arusha. Il est judicieux de commencer immédiatement à exercer de telles pressions si l'on veut éviter que la situation au Rwanda ne dégénère encore plus et si l'on veut épargner des vies humaines au Rwanda. »
Du côté militaire, la perception de la dégradation de la situation est moins constante et est fonction de la gestion quotidienne des événements.
Par exemple, le colonel Marchal a déclaré que «la situation du 15 janvier était préoccupante. Le gouvernement et les institutions prévues par les accords d'Arusha n'étaient pas en place et le point de vue des parties se radicalisait. J'essayais d'apporter une réponse à d'éventuelles conséquences de cette situation» (13b).
Par ailleurs, il ajoute : «J'ai toujours essayé de faire preuve de réalisme. Ainsi, si j'ai déclaré le 21 février que j'étais certain que le gouvernement de transition serait mis en place, j'ai par la suite toujours exprimé un doute. Dans ma note du 23 mars, j'insiste sur le fait que les jours à venir seraient ceux de tous les dangers. Les 24 et 27 mars, j'ai encore laissé planer le doute, tout en continuant à espérer le gouvernement de transition» (14b).
Il faut souligner que les autorités belges disposaient de très nombreuses informations en ce qui concerne le pouvoir en place et les chefs politiques à Kigali (cf. Rapport groupe ad hoc , pp. 58, 59 et 60), mais que ces informations étaient beaucoup moins nombreuses en ce qui concerne le FPR.
Concernant le FPR, notre ambassadeur signale dans le télex 1062 du 24.10.1993 que la Première ministre Agathe Uwilingiyinama exprimait elle aussi «ses préoccupations à propos des intentions militaires du FPR, dans le contexte de la crise burundaise. On parle de nouvelles concentrations d'unités du FPR dans la région située au Nord de Buymba ».
Lors des auditions, l'ambassadeur Swinnen a déclaré « Les minorités extrémistes sont difficiles à identifier. En fait partie le CDR, parti politique agréé. Je me souviens qu'il y a eu des rapprochements entre le CDR et le MRND, qui ont même constitué avec d'autres partis, temporairement, une coalition. Les liens entre le CDR et les autres partis nous préoccupaient sérieusement, de même que le développement de tendances extrémistes au sein du PL, du MDR et du MRND. À part cette coalition temporaire, il n'y a pas eu de liens formels entre certains partis et le CDR. Nous constations seulement que leurs positions avaient tendance à se ressembler de plus en plus » (15b).
Il ajoute :
« Je me suis toujours posé la question de la crédibilité d'Habyarimana. Était-il un acteur politique ou l'otage de son entourage ? Je n'avais pas de réponse et je n'en ai toujours pas » (16b).
De son côté, Lode Willems, à la question « Vous méfiiez-vous des milices du MRND ou du Hutu Power ? Était-ce des groupes fanatiques ? » a répondu : « Effectivement » (17b).
Willy Claes a déclaré quant à lui :
« J'ai tenté d'attirer l'attention des Américains sur le possible double jeu du président Habyarimana » (18b).
« Au fur et à mesure que le temps s'écoulait, des éléments négatifs provenaient du côté présidentiel » (19b).
Devant la commission, M. Claes a déclaré :
« Je pensais que la famille du président agissait contre le processus de paix, mais que le président lui-même comprenait qu'il n'y avait pas d'autre solution possible que d'exécuter les accords d'Arusha » (20b).
D'autre part, dans le télex nº 250 du 25.03.94, notre ambassadeur écrivait :
« Eerste minister Uwilingiyimana spaart haar kritiek op het FPR niet. Ze sluit niet uit dat de harde opstelling van het FPR in de onderhandelingen te maken heeft met plannen om de vijandelijkheden te hervatten. »
Selon le lieutenant Nees :
(Traduction) « Depuis la mi-février, le FPR est divisé en deux camps : les « durs » souhaitaient l'installation du gouvernement de transition au début de janvier. Comme cela ne s'est pas fait, il faut reprendre les hostilités.
Les modérés estiment que les accords d'Arusha ont permis d'obtenir l'incroyable, que l'on ne sait pas à quoi mènera une reprise de la guerre et que l'on ignore en tout cas comment les Hutus réagiront vis-à-vis des Tutsis si le FPR reprend les hostilités » (21b).
La commission s'est alors posé la question de savoir si l'attitude des acteurs politiques belges face à cette situation était adéquate ou relevait d'une certaine naïveté. La question a notamment été posée à plusieurs experts, dont M. Reyntjens et M. Ndiayé.
Le professeur Reyntjens est d'avis que si la MINUAR était restée, en soutenant les officiers modérés de l'armée rwandaise, il était encore possible d'éviter le pire, selon lui, même après les événements du 7 avril.
La réponse de M. Ndiayé est également négative : « Je ne pense pas qu'il s'agissait d'une attitude naïve. C'était, à l'époque, la seule possibilité d'aider les Rwandais. Comme je viens de le dire, certaines ambassades poussaient à la solution négociée. L'ambassade de France, par contre, était sur la défensive, davantage même que le président Habyarimana lui-même.
La situation au Rwanda était complexe : le pays était en guerre, mais un processus de démocratisation était en cours et celui-ci permettait l'expression du mécontentement, même des Hutus, vis-à-vis de l'accaparement du pouvoir par le clan du président; enfin, le pays subissait un plan d'ajustement structurel du FMI. Le régime se sentait menacé par tous ces éléments et son refus d'accepter des changements a probablement accéléré les massacres.
Connaissant cette réalité, peut-on taxer de naïveté ceux qui poursuivaient la négociation d'accords de paix, et de mauvaise foi ceux qui soutenaient le régime ? C'est une analyse possible à posteriori, mais il m'a semblé, à l'époque, que la solution passait obligatoirement par l'instauration d'une démocratie réelle. La question principale restait de savoir comment communiquer la conscience des intérêts à long terme à des gens dont la préoccupation essentielle était la survie au jour le jour » (22b).
L'ambassadeur Swinnen a déclaré : « Nous avons toujours continué de croire que cela allait réussir. C'était un compromis, mais il n'y avait pas d'alternative.
Nous pouvions donc croire à la dynamique, mais nous étions conscients de la radicalisation, qui nous préoccupait beaucoup. C'est pourquoi nous avons continué avec conviction d'encourager les modérés » (23b).
À la question de savoir si le Gouvernement avait envisagé de menacer d'arrêter la coopération au développement, le ministre Derycke, à l'époque secrétaire d'État à la Coopération au développement a répondu :
« Je ne souhaitais pas brandir en permanence la menace d'un arrêt de l'aide au développement parce que cette menace est contre-productive. Du reste, elle n'est efficace qu'une seule fois.
L'aide au développement accordée par la Belgique était en majeure partie destinée à l'enseignement, à l'agriculture et aux soins médicaux. La première victime de l'arrêt de cette aide aurait donc été l'homme de la rue.
Il faut également tenir compte du contexte européen dans lequel on travaille. Si un pays donateur se retire, un autre pays est prêt à prendre sa place, en l'occurrence les Pays-Bas et l'Allemagne. Un autre argument en faveur du maintien de l'aide au développement était le souci de ne pas aggraver la situation dans les camps de réfugiés au Rwanda. » (24b)
D'autre part, à la suite de sa rencontre avec le président Habyarimana, le ministre Claes a adressé depuis Bujumbura un telex a Delbelonu et à Ambabel Washington.
Il y disait :
« 2.3. Le Gouvernement belge estime que si le gouvernement de transition n'est pas créé comme prévu par les accords d'Arusha, cela aura de graves répercussions sur les efforts de pacification fournis jusqu'ici ainsi que sur le processus de démocratisation, et que cela menacera gravement la coopération au développement belgo-rwandaise hormis l'aide purement humanitaire.
2.6. J'estime que la Belgique, les Nations unies et les États-Unis ont tout intérêt, pour l'avenir du Rwanda, à éviter une nouvelle guerre civile et à exercer des pressions sur les responsables rwandais, et en particulier sur le président rwandais pour que l'on crée les institutions de transition et que l'on poursuive l'exécution des accords d'Arusha. Il est judicieux de commencer immédiatement à exercer de telles pressions si l'on veut éviter que la sitiuation au Rwanda ne dégénère encore plus et si l'on veut épargner des vies humaines au Rwanda. »
Existait-il une alternative ?
Mme Des Forges a déclaré à la commission : « Je suis convaincue qu'une attitude très ferme eût pu éviter le génocide. Si les dirigeants politiques avaient été convaincus en janvier, février et mars que la Minuar adopterait une position forte contre les violences, ils n'auraient pas essayé de braver la communauté internationale » (25b).
M. Gillet ajoute : « Ma conviction était qu'il fallait utiliser le levier de l'opinion publique et que rien n'empêcherait un gouvernement de rendre les informations publiques. Cette publicité aurait pu désamorcer le processus » (26b).
En résumé, la commission constate que plusieurs éléments sont intervenus, qui ont rendu plus difficile l'application des accords d'Arusha et qui démontraient que cette application était combattue. Il s'agit essentiellement :
de la bipolarisation du paysage politique entre les partisans de l'accord de paix (et par conséquent du partage du pouvoir avec le FPR) et ceux qui refusaient ce partage du pouvoir;
de l'attitude du président Habyarimana, qui pose de nouveaux obstacles, tentant de détenir une minorité de blocage;
des six tentatives de constitution d'un gouvernement de transition, qui ont échoué en raison de l'opposition déclarée ou des hésitations des parties.
Le rapport des Nations Unies publié en décembre 1996 retient les conclusions suivantes :
« Depuis sa création jusqu'à son retrait, la MINUAR a toujours semblé en retard sur les réalités de la situation au Rwanda. Elle a été déployée en 1993 pour aider à mettre en oeuvre un processus de paix qui semblait être dans l'impasse avant même d'avoir été amorcé. Au plus fort de la crise, la décision prise unilatéralement par certains gouvernements de retirer leurs contingents nationaux a laissé le reste de la MINUAR encore plus vulnérable et incapable d'assurer la protection des civils en danger. Quand bien même l'effectif de la MINUAR ait été accru en mai 1994 en raison des massacres qui se poursuivaient, et qu'en novembre 1994 le niveau d'effectif
autorisé de 5 500 ait été atteint, la guerre civile était terminé, et le pays n'avait plus besoin d'une aide pour le maintien de la sécurité mais d'une aide pour la reconstruction nationale. »
« Les mandats de la MINUAR découlaient du contexte politique international dans lequel ils avaient été formulés et reflétaient généralement des préoccupations et des impératifs de certains États membres qui avaient peu de rapport avec la situation au Rwanda. Une incompréhension fondamentale de la nature du conflit a également donné lieu à des hypothèses politiques et à des évaluations militaires erronées. Le Conseil de sécurité, qui est le principal responsable de l'élaboration des mandats de maintien de la paix, a eu tendance, au début de la crise, à considérer la situation au Rwanda comme une petite guerre civile, comme l'ont déclaré certains membres du Conseil. On a passé sous silence ou omis d'explorer les conflits politiques au sein du gouvernement rwandais et les preuves croissantes d'assassinats politiques et de violation des droits de l'homme dans le pays. »
En conclusion, la commission peut dire que, si les acteurs politiques percevaient bien la dégradation de la situation politique, traduite notamment par le blocage des accords d'Arusha, et ce jusqu'à l'issue fatale du 6 avril, ils n'ont cessé d'espérer la mise en place du gouvernement et du parlement de transition, ce dont témoignent les démarches pressantes effectuées à cet égard (27b).
3.3.2.1. L'appréciation de la menace contre le KIBAT/la MINUAR au Rwanda
La commission a constaté qu'après l'installation de la MINUAR également, les Belges en général et les Casques bleus belges en particulier ont fait face à un climat antibelge en tout cas dans les milieux extrémistes hutu. Dans une première partie, la commission confirme les indications qui figurent dans le rapport du groupe ad hoc Rwanda. Dans une deuxième partie la commission prête son attention au témoignage de Mme Braeckman qui lui a fourni une importante indication complémentaire concernant la menace qui pesait sur les Casques bleus belges. Dans une troisième partie, la commission examine les informations apportées par l'informateur Jean-Pierre. Enfin, la commission signale les témoignages d'officiers, principalement ceux qui étaient chargés de recueillir et d'examiner les informations. La plupart de ces officiers ont apporté des éléments confirmant l'existence de menaces antibelges.
(1) Le rapport du groupe ad hoc Rwanda
Les auditions auxquelles la commission a procédé lui ont donné l'occasion d'approfondir les questions qui avaient déjà été traitées par le groupe ad hoc Rwanda dans son rapport à la Commission des Affaires étrangères. Dans ce rapport, le groupe ad hoc Rwanda a avancé deux thèses concrètes et examiné en fonction de celles-ci les télex, documents et rapports de l'armée disponibles. Le groupe ad hoc Rwanda a retenu les bulletins, télex et informations qui faisaient état de la montée d'un sentiment négatif à l'égard des Belges en général et de la participation d'unités militaires belges à la MINUAR en particulier. L'ambassade belge et la représentation militaire ont fourni les sources principales.
Comme la commission a pu le constater grâce aux informations qui avaient été rassemblées dans le rapport du groupe ad hoc Rwanda, la période comprise entre le déploiement de la MINUAR et le massacre des dix paras commandos belges, d'une part, et le retrait final des troupes belges, d'autre part, s'est déroulée sur fond de menaces, de projets d'assassinat et d'attentats. Dans son enquête sur les circonstances du massacre des paras commandos, la commission a examiné en détail les difficultés que les Casques bleus ont rencontrées au cours de l'exécution de leur mission. Les militaires belges ont-ils été gênés, pendant la mission de paix au Rwanda, par des actes antibelges commis par les Rwandais ? Les menaces et les attentats auxquels les militaires belges ont été exposés ainsi que l'assassinat des dix Casques bleus belges peuvent-ils être mis sur le compte des risques normaux d'une mission de maintien de la paix ?
(2) Le plan visant à empoisonner les Casques bleus belges.
Au cours des auditions, la commission a dès lors enregistré nombre de témoignages de militaires et de journalistes qui ont souligné qu'une menace planait sur les Belges au Rwanda. La plupart des déclarations confirment les constatations que le groupe ad hoc Rwanda a faites dans son rapport. Certains témoins y ont ajouté des faits marquants.
Mme Colette Braeckman, journaliste, a témoigné le 21 mars devant la commission. Elle a attiré l'attention de la commission en déclarant qu'il existait un scénario qui prévoyait l'empoisonnement des Casques bleus belges. Mme Braeckman avait recueilli cette information lors d'une rencontre avec le Premier ministre rwandais.
« Avant de me rendre à l'enterrement du président Ndadaye, je suis passée par Kigali et ai rencontré le colonel Leroy. Il m'a expliqué qu'il régnait un climat d'optimisme tel que les Casques bleus patrouillaient à pied. Dans les collines je partageais ce sentiment. Le même jour, le 5 décembre, j'ai reçu un appel du chef de cabinet du premier ministre, Mme Agathe, qui m'invitait à venir l'interviewer. Mme Agathe m'a reçue le lendemain matin et m'a expliqué que le climat était tendu, que RTLM multipliait les attaques contre les Belges et qu'elle-même avait reçu des menaces de mort. Elle m'a expliqué que ses services de renseignements avaient eu connaissance d'un plan prévoyant d'empoisonner une dizaine de militaires belges. C'est Mme Agathe qui a alors insisté pour me rencontrer et qui m'a fait part des menaces qui pesaient sur les Belges et sur elle-même. J'aurais dû publier cette information ... (28b). »
« Cette information ne correspondait pas au climat positif mais certains, dans le clan présidentiel, ne souhaitaient pas la présence belge et désiraient le départ de la MINUAR. Cette information était pour moi stupéfiante. Aussi me suis-je rendue chez le colonel Leroy. Mme Agathe m'a dit qu'elle avait également prévenu l'ambassadeur. Après l'enterrement, je suis repassée par Kigali et j'ai demandé à l'attaché de presse des Casques bleus, le lieutenant Pirard, quel usage avait été fait de l'information transmise. Il m'a répondu que toutes les mesures nécessaires, notamment sur le plan de l'approvisionnement et la préparation de la nourriture, avaient été prises. À Kigali, le 12 décembre, j'ai bavardé avec les derniers Français qui quittaient la ville et particulièrement avec un officier français. Il m'a dit qu'il souhaitait bien du plaisir à ses amis belges car ils allaient être pris entre deux forces ennemies. Le climat antibelge débutait » (29b).
La commission a bien entendu fait part au colonel Leroy, commandant de KIBAT I, de l'étrange récit concernant un plan d'empoisonnement. Le colonel le confirma avant d'ajouter : « Il faut situer tout cela dans le contexte africain. Vous devez tenter d'imaginer notre situation à l'époque : nous avions un stock d'aliments frais et les rations nécessaires; nous connaissions la provenance des aliments et de l'eau et nous disposions de spécialistes en logistique au courant de tout ce qui concernait l'achat de rations alimentaires. Sur ce point, nous étions donc rassurés » (30b).
La commission constate que le colonel n'a envisagé de communiquer ce scénario meurtrier aux autorités belges ni à son commandant de secteur.
Mme Agathe avait déclaré selon Mme Braeckman avoir transmis l'information à l'ambassadeur M. Johan Swinnen, qui quant à lui affirme : « Je vous assure que le Premier ministre ne m'en a jamais parlé, sinon je l'aurais certainement signalé » (31b).
Le 13 janvier personne ne s'est plus souvenu de l'appel au secours de Mme Agathe.
Major Hock : « Nous savions qu'il y avait des menaces concernant des Casques bleus d'ailleurs reprises dans le document du lieutenant Nees, mais je n'avais jamais entendu parler d'un empoisonnement. Cela ne m'étonnerait pas car il s'agit d'une arme traditionnelle, que ce soit du côté tutsi ou hutu » (32b).
Le récit de Mme Braeckman appuie l'hypothèse selon laquelle l'on ne peut pas considérer le meurtre des dix paras comme le triste résultat d'un malheureux concours de circonstances. Son témoignage apporte, par contre, une nouvelle indication, que les événements du 7 avril 1994 font partie d'un plan prémédité qui prévoyait une fin tragique pour les Belges.
(3) Les informations de « Jean-Pierre »
Un mois après le « scénario de l'empoisonnement », le capitaine Frank Claeys, qui, en tant que « Military Information Officer », transmettait des informations au général Dallaire et aux colonels Marchal et Kesteloot, a dactylographié le télex annonçant que l'informateur « Jean-Pierre » a donné des indications à la MINUAR sur l'existence de caches d'armes secrètes et de formations paramilitaires pour les jeunes, ainsi que sur la présence de gendarmes en civil aux manifestations organisées par les Interahamwe, sur l'utilisation par ces derniers de matériel de communication appartenant à l'armée et sur l'existence d'un plan « pour tuer ou blesser des militaires belges afin de contraindre le détachement belge, voire la MINUAR, à se retirer ». Le capitaine Claeys confirma qu'il avait foi en la crédibilité de son informateur : « ... we werden door generaal Dallaire op 10 januari naar de heer Twagiramungu gestuurd. Deze gaf ons het telefoonnummer van de heer Jean-Pierre zonder zijn naam te geven. (...) Jean-Pierre zelf heeft nooit gesproken over enige financiële tegemoetkoming voor de informatie die hij gaf. Hij vroeg alleen voor hemzelf en zijn familie, dit wil zeggen zijn vrouw en zijn twee kinderen, een vrijgeleide. (...) Hij heeft ons uit eigen initiatief naar verscheidene opslagplaatsen gebracht. » (33b).
« Hij informeerde mij bijvoorbeeld over de lijsten van geregistreerde Tutsi's. Hij heeft mij die echter nooit willen overhandigen. Het bestaan van die lijsten werd later bevestigd door de uitvoering van het plan. (...) Hij heeft ons de precieze plaatsen aangeduid waar wapenopslagplaatsen zich bevonden. (...) Hij heeft ons ook getoond langs waar de konvooien zouden rijden. (...) Verder vertelde hij ons altijd dat hij onder druk werd gezet door de partij om zo snel mogelijk de wapens en de munitie te verdelen. » (34b)
« Aangezien we Jean-Pierre echter geen vrijgeleide konden garanderen, kreeg ik de raad hem niet meer te ontmoeten. Ik ben hem op persoonlijke basis wel blijven ontmoeten. » (35b)
D'une part, nous constatons que le capitaine Claeys obtient des informations capitaine Claeys : « Al de informatie die hij op vrijwillige basis gaf was welkom. » (36b) dont la nature était telle que ceux qui les ont reçues les ont prises au sérieux, sans toutefois être disposés à accéder à la demande de protection. Capitaine Claeys : « À un moment donné, nous avons communiqué à New York que des informateurs nous avaient donné des informations intéressantes mais qu'ils demandaient, en contrepartie d'informations supplémentaires, une protection diplomatique. Nous n'avons jamais reçu de réponse de l'ONU à ce sujet » (37b). Même pas lorsqu'il s'est avéré que les renseignements concernant les caches d'armes étaient exacts.
Le colonel Marchal devait déclarer à ce sujet : « En ce qui concerne l'importance accordée aux renseignements fournis, je peux affirmer qu'après vérification, je n'avais plus aucun doute sur ce qui se préparait. Le nombre et la précision des détails obtenus indiquait qu'un plan était en phase d'exécution et que sa mise en pratique laissait présager un nombre énorme de victimes. Mon évaluation des pertes s'élevait à plusieurs dizaines de milliers de morts. » (38b) Le colonel Marchal ajoute : « Les contacts que j'ai eus avec Jean-Pierre ont été très révélateurs et ont fourni une base solide. » (39b)
Le capitaine Claeys : « ... heel die tijd die vertragende beweging van « wij kunnen geen garanties bieden » dus eigenlijk onrechtstreeks aan mij zeggen : « Die man is waarschijnlijk niet geloofwaardig genoeg om hem te steunen. » (40b). D'autre part, le capitaine allait continuer à voir son informateur jusqu'au 15 mars, et ce, avec l'aval tacite de ses supérieurs. Le capitaine Claeys : « , ... voor de UNO mag er niet aan intelligence worden gedaan. Vandaar dat men een gebrekkige term hanteert zoals military information officer. Wat ik officieel moest doen, lag heel ver van wat ik in werkelijkheid deed. Officieel moest ik briefings geven aan de nieuwe stafofficieren. » (41b) Le colonel Marchal était lui aussi au courant des choses. Le colonel Marchal : « Comme aucun pays n'avait répondu de manière positive à la demande d'asile politique, j'ai, dans son intérêt, rompu les contacts avec Jean-Pierre. » (42b)
Faustin Twagiramungu, qui avait introduit l'informateur à l'époque, nuança au cours de la réunion du 30 mai l'importance de « Jean-Pierre ». « Jean-Pierre était un chauffeur. Il a travaillé au MRND à ce titre. Il a été licencié par le MRND mais il est resté dans les Interahamwe. À moins qu'il n'y ait un autre Jean-Pierre. Ce genre de personnes visent à obtenir des avantages qu'on leur accorde soit pour la vente d'informations soit pour mentir. On vante à une certaine bravoure que, souvent ils n'ont pas. (...) Il était tutsi ... ces gens travaillaient avec les Interahamwe, même s'ils ne prenaient pas de décisions. » (43b)
Le général-major Verschoore du SGR qui n'était pas au courant de l'existence de Jean-Pierre et des renseignements qu'il fournissait, parmi lesquels figurait le plan d'assassinat des Casques bleus belges, déclara devant la commission que l'on accordait aux informations de Jean-Pierre « une valeur extrême. Elles étaient considérées comme très fiables. » (44b) Cette appréciation est diamétralement opposée à celle du major Hock qui déclara, au cours de la réunion du 21 mars, vouloir donner à Jean-Pierre la cote F6. « C'était un informateur de la MINUAR. En examinant le personnage d'un peu plus près, l'on constate qu'il appartenait initialement aux services de sécurité du président, lesquels avaient une réputation déplorable. Jean-Pierre était déserteur et l'on ne pouvait donc pas lui faire confiance à priori. Tout ce qu'il dit doit être vérifié. » (45b)
La commission constate que le major Hock considérait l'informateur comme étant peu crédible alors que le général Dallaire et la MINUAR l'avaient jugé très fiable.
La commission s'interroge plus particulièrement à propos de l'appréciation erronée qui a été faite des informations communiquées par Jean-Pierre sur la possibilité d'attentats contre les Casques bleus belges. Pourquoi n'a-t-on pas attribué aux informations sur le sort réservé aux Casques bleus belges la même valeur qu'aux informations qu'il avait communiquées concernant l'aspect « dépôts d'armes » qui s'étaient avérées sérieuses et fiables après vérification sur le terrain de la réalité des caches d'armes, ou aux moins demandé une enquête supplémentaire ?
(4) L'appréciation de la menace contre les Belges
Dans cette partie du rapport, la commission constate, à propos de la collecte et du traitement des informations relatives à la menace contre les Belges, que les informations ont rarement dépassé le bureau de celui qui les avait obtenus. Les personnes chargées d'une mission de renseignement n'étaient pas suffisamment bien formées et ne disposaient pas de moyens suffisants pour pouvoir mener correctement à bien leur travail.
La commission a également constaté que les informations récoltées ne circulaient ni au niveau du bataillon ni au niveau de la Force.
Dans les témoignages qu'ils ont donnés devant la commission, les officiers de renseignements, les officiers supérieurs et certains officiers qui accomplissaient leur mission au niveau de la compagnie ont parlé de signes inquiétants confirmant l'existence d'un climat antibelge, en tout cas dans les milieux extrémistes hutus.
Le colonel Dewez a déclaré: « Je n'ai jamais dit aux hommes qu'ils allaient en vacances ... ce bruit s'était certainement répandu entre eux en raison de la comparaison avec la Somalie ... à Kigali la vie était « normale », ils pouvaient sortir, aller au restaurant le soir, ils pouvaient aller nager à la piscine du Méridien. » (46b)
Le lieutenant Lecomte : « ... je me rends compte maintenant que nous, sur place, nous n'avions que très peu d'informations concernant la menace qui pesait sur le détachement belge. (...) Si menace il y avait eu, nous ne serions pas sortis à Kigali toutes les nuits. Je pense que si une faute cruciale a été commise, c'est certainement dans le manque de distribution de l'information. » (47b)
Interrogé sur sa propre appréciation des sentiments antibelges au Rwanda, le capitaine Claeys a déclaré : « Met de anti-Belgische houding bedoel ik de anti-houding tegen de Belgische militairen omdat deze hun werk goed deden. (...) Dit was een hinderpaal voor de oppositie. (...) Voorspellen dat het provoceren en vermoorden van een aantal Belgische militairen tot gevolg zou hebben dat België zijn troepen zou terugtrekken lijkt mij twijfelachtig. De MRND moest dan zeer goed geïnformeerd zijn omtrent de reactie van de Belgische regering. (...) Het was dus pure speculatie. » (48b)
Dans son exposé devant la commission Uytterhoeven, le capitaine Claeys note que « les Rwandais étaient heureux que les Belges soient là. Le reproche qu'on faisait aux Belges découlait de la situation qui avait été créée en 1990, lorsque les Belges avaient quitté le pays sans soutenir le gouvernement. » (49b)
Interrogé sur la raison pour laquelle l'officier de renseignement a jugé les informations relatives au génocide plus fiables que celles qui avaient trait aux menaces à l'encontre des Belges, Claeys a répondu « Ik ging zowel overdag als 's nachts ongewapend erop uit... Had men echt kwade bedoelingen tegen de Belgen gehad, dan had men alle Belgen die op straat liepen als burger of als militair op elk ogenblik van de dag kunnen kidnappen of vermoorden. » (50b) Pour la commission, il est clair qu'en l'occurrence, le sentiment de sécurité personnelle a influé sur l'appréciation de la situation. Le 2 juin 1995, le capitaine confirmera à l'auditeur général que : « Il y avait une attitude antibelge qui était exprimée via la radio qui émanait du mouvement hutu. Cette attitude n'aurait toutefois jamais pu laisser présager l'issue fatale. » Contrairement à ce qu'il a affirmé devant la commission, le capitaine a déclaré ce qui suit devant le tribunal militaire : « Il était notoire que ce qu'un Rwandais dit ne correspond pas à ce qu'il pense. Il fallait donc se méfier d'eux. Je n'aurais jamais remis mon arme. J'aurais convaincu mon interlocuteur de me la laisser en promettant de ne pas l'utiliser. » (51b)
Le lieutenant Nees, S2 KIBAT I : « Le 18 novembre, les premiers éléments de KIBAT sont partis au Rwanda. Entre les 3 et 11 novembre, nous avons reçu à titre de préparation une note générale du SGR où il n'était question que de généralités et nullement d'un climat antibelge. Quelques petites phrases mentionnaient toutefois l'existence de milices de jeunes. La deuxième partie des préparatifs consistait à inviter des personnes qui avaient été au Rwanda, je pense à des collaborateurs de la RTBF, de la Croix-Rouge et de Radio Vlaanderen. Nous avons obtenu plus de détails d'eux que par les notes du SGR. Nous avons entendu parler pour la première fois du « Réseau Zéro ». Je suis parti le 18 novembre. La population rwandaise était rassurée par notre présence. Nous avons vite constaté que la population et surtout les enfants étaient mal informés ou de manière unilatérale sur la venue de la MINUAR et sa mission. Nous avons noué les premiers contacts avec la population dans l'école des pères. Les élèves nous ont entre autres posé les questions suivantes : étions-nous venus pour combattre les ennemis des Hutus ? Étions-nous venus pour aider les Tutsis à prendre le pouvoir ? À mon sens, il n'était pas question d'un climat antibelge, mais bien de désinformation sur la venue de la MINUAR. Le renforcement du climat antibelge au cours des mois de décembre à février s'explique par le fait que l'homme de la rue n'a jamais reçu d'informations détaillées sur l'objectif de la MINUAR. Par contre, la RTLM pouvait diffuser sans restriction aucune de la propagande contre la Belgique dans presque tout le Rwanda. Il y a un élément important dont il faut tenir compte. Les personnes qui séjournaient dans les camps étaient très sensibles à cette propagande. La confiance initiale des Rwandais a également disparu progressivement. Dans la nuit du 16 au 17 novembre, un massacre eut lieu près de Ruhenge où il y eut 40 morts. Le général Dallaire a dit que l'on allait ouvrir une enquête. Plusieurs enquêtes ont effectivement été ouvertes, mais elles n'ont jamais donné de réponse adéquate à la question de savoir ce qui s'était passé. La confiance a disparu progressivement. Pour le citoyen rwandais, la MINUAR était synonyme de présence belge. C'est le KIBAT qui a introduit le bataillon FPR à Kigali. À partir de janvier, le nombre et le caractère des messages de la RTLM ont dès lors augmenté. À partir de ce moment-là, la radio profitait de chaque occasion pour discréditer la Belgique. Il y a eu une série d'incidents dans lesquels KIBAT est intervenu de façon correcte, alors que la RTLM a abusé de la situation. Je pense à l'hélicoptère belge qui aurait prétendument braqué des mitrailleuses sur la résidence présidentielle. Le 20 janvier, nous étions présents à une rencontre avec M. Twagiramungu. Les Belges étaient obligés de tirer en l'air pour évacuer M. Twagiramungu. À RTLM, on a dit que les militaires belges avaient tiré dans le tas et qu'il y avait eu des morts. Le 8 janvier, 300 membres d'une milice de la jeunesse ont provoqué les militaires belges. » (52b)
Partant de sa perception de militaire, le lieutenant Nees a cru discerner deux menaces réelles. Le lieutenant Nees : « Le 5 février, lors de l'installation du KWSA, une patrouille nocturne a remarqué de nombreux Rwandais armés autour de la maison du colonel Bagosora. La patrouille voulait intervenir mais, à ce moment-là, le colonel Bagosora est sorti et a ordonné à sa garde militaire de braquer ses armes sur les Belges. La deuxième menace était une fusillade aux confins de Kigali entre des milices ou des citoyens armés et les militaires belges d'une escorte. En dehors de ces deux incidents, il n'est pas vraiment question d'un climat antibelge. Par après la situation s'est néanmoins déteriorée. » (53b).
Le capitaine De Cuyper, qui a succédé au lieutenant Nees comme S2 au sein de Kibat II, n'a rien remarqué d'un climat antibelge dans la vie quotidienne au Rwanda. « En tant qu'officier belge de la Minuar, je n'ai pas rencontré de problèmes. En revanche, j'ai ressenti une certaine réticence. Dans certains milieux, proches du pouvoir, on considérait les Belges à Kigali comme des intrus un peu trop curieux. Lorsque je suis arrivé, je savais seulement, grâce aux informations contenues dans les dossiers du lieutenant Nees, que des événements s'étaient déroulés à Kigali. » (54b)
Dans un document du 7 février 1994, le lieutenant Nees a écrit qu'il fallait considérer l'attitude antibelge non pas comme hostile à l'égard des Casques bleus belges, mais comme faisant partie d'une politique délibérément dirigée contre les Belges. Et le lieutenant Nees de déclarer à ce sujet : « Oui, nous avons écrit cela, Il n'y a eu que quelques incidents déplorables. Les problèmes, notamment aux points de contrôle, étaient provoqués en général par les Rwandais. Les problèmes se produisaient durant les missions de patrouilles. Les autres incidents étaient provoqués par des personnes de la même tendance politique. Je me souviens d'un incident où j'étais moi-même à un poste de contrôle. Il y avait toujours, à chaque poste de contrôle, deux gendarmes rwandais qui contrôlaient les véhicules. Ces contrôles se déroulaient sans la moindre agressivité. À un certain moment, un véhicule a passé un poste de contrôle et les militaires belges ont dû s'esquiver. Je l'ai signalé au commandant du KIBAT et lui ai demandé si nous ne devions pas en informer le colonel Marchal. » (55b)
Pour la methode utilisée pour obtenir des information et le traitement, voir chapitre 3.3.3.
Le major Podevijn, qui était presque tous les jours en contact avec le capitaine Claeys, a déclaré devant la commission Uytterhoeven que dès le début de l'opération, le climat était hostile à la MINUAR et, surtout, aux Belges. « C'est parce que nous étions pro-FPR. En janvier-février, il y a eu de graves manifestations. En mars tout s'était apaisé. Puis, il y a eu l'explosion. Il y avait bien un risque potentiel de la part d'une partie de la population (les milices). Mais aucun signe ne laissait prévoir que la Gd. et les FAR entreprendraient quoi que ce soit contre les Belges de la MINUAR. » (56b)
Au cours de l'audition de la commission spéciale du 7 mars, le major répétera les propos suivants : « Une fois sur place, nous avons constaté qu'on publiait des pamphlets et des articles qui noircissaient les paras belges. Au début, jusqu'au 18 décembre, nous n'avons pas tellement remarqué l'hostilité. Plus tard, il y a eu des incidents impliquant des Belges. Il y eut, par exemple, la grenade dans le jardin du colonel Marchal; on jeta des pierres contre une patrouille; il y eut des coups de feu devant la maison de M. Booh Booh. On a également empêché le passage d'un véhicule d'escorte des paras belges lors des manifestations dans les environs du quartier général du général Dallaire. Tous ces incidents ont été rapportés .
Cela commença déjà le 6 décembre lorsqu'un inconnu est venu demander au quartier général des paras où les Belges étaient logés. Plus tard, il s'est avéré qu'il s'agissait d'un poseur de bombes. Le 10 décembre, des partisans des Interahamwe ont traité de Tutsis des soldats de la MINUAR passant dans un minibus. Lors d'autres incidents, des grenades ont été jetées dans des maisons de familles de Tutsis. Des commerçants et des propriétaires de bars que fréquentaient des Belges ont été menacés. Des observateurs militaires de la MINUAR ont été attaqués et volés. Lorsque des Interahamwe manifestaient contre la MINUAR et les Belges, les gendarmes rwandais ou l'armée n'intervenaient guère. Ils regardaient tout simplement. Le 17 janvier, le SGR était informé du climat antibelge. On demanda d'effectuer une enquête à propos des menaces proférées contre la composante belge de la MINUAR. Une série d'incidents indiquait donc que quelque chose se passait. Nous savions que le MRND était opposé à notre présence. La RTLM menait également une campagne antibelge. On nous reprochait également de ne plus avoir voulu fournir d'armes en 1990 et d'être favorables au FPR. » (57b)
Le colonel Vincent, chef de la coopération militaire et conseiller militaire de l'ambassadeur Swinnen, était, avec les officiers de renseignements qui rassemblaient et transmettaient au commandement belge les données au niveau de KIBAT-MINUAR et au niveau du QG-MINUAR, une source très importante d'information du SGR pour le commandement de l'armée. Selon le colonel, il existait effectivement un climat antibelge (voir point précédent campagne antibelge et anti-MINUAR avant le 19 novembre 1993) mais il fallait le relativiser. Colonel Vincent : « Il était surtout une arme utilisée au niveau politique. Par contre, la population ne ressentait pas d'aversion particulière à l'égard des Belges. Une semaine avant les événements tragiques du mois d'avril, mon épouse faisait encore ses commissions au marché, sans difficultés. » (58b) Selon le colonel, il n'y avait pas d'attitude antibelge à l'égard de la communauté belge, mais bien à l'égard de la MINUAR, qui était le symbole des accords d'Arusha. Pour le prouver, le colonel relata l'incident du 8 janvier au cours duquel ses soldats et lui-même n'avaient rencontré aucun problème avec la population qui était pourtant particulièrement agitée.
Le colonel savait, de son propre aveu, qu'il y avait des « problèmes », mais il n'a jamais rien remarqué, ni au sein de l'armée rwandaise ni au sein de la gendarmerie, concernant un plan de génocide. Il n'a rien remarqué concernant la préparation d'un attentat contre les Casques bleus belges. La coopération technique et militaire fonctionnait comme source de renseignements mais ne disposait pas de son propre réseau d'informations. Le colonel Vincent : « Nous nous contentions de rapporter à Bruxelles nos informations. » (59b) Le colonel Vincent précisa encore que la radio RTLM fut créée dans un cadre anti-MINUAR. « Quant à sa propagande, elle se situait en dessous du niveau des ragots du pire torchon. » (60b) C'est un point de vue que défendit aussi son collègue du CTM, le lieutenant colonel Duvivier. « RTLM émettait régulièrement des critiques vis-à-vis des Belges. Par exemple les Belges sont à la solde du FPR. À la mort du président, RTLM a diffusé : les Belges sont responsables de la mort du président. Ils ont proposé que dans chaque ville, il fallait tuer un Belge. » (61b)
Le lieutenant colonel Leroy, qui était commandant de KIBAT I, a admis devant la commission que l'opération comportait des risques mais qu'à son sens il n'y avait pas de menace directe. Si le colonel pensait que « selon lui il n'y avait pas de climat antibelge », cela ne l'a pas empêché de déclarer ce qui suit : « Jusqu'à la date de mon départ, j'ai bien ressenti des provocations envers mes troupes, mais rien de plus. Mon rôle se limitait à tirer la sonnette d'alarme. Ce que j'ai fait en tant que militaire réagissant à un risque militaire. » (62b) Le 6 février, le colonel transmit un fax au C Ops, dont voici le texte : « 060850 feb 94, le véhic. milit. Du gén. Nzabimana franchit un CHP de la 11e Cie. Le gén. refusa de s'arrêter. Il dut le faire en raison du trafic, descendit et se mit à inciter, probablement dans sa langue, ceux qui assistaient à la scène à s'insurger contre le fait que les Mil(BE) osaient arrêter un Gen(RW). Le sec Comd et le Comd Cie le laissèrent poliment poursuivre sa route. Il s'agissait du énième incident avec des officiers supérieurs (RW) ou des membres de leurs familles. Avant que quelqu'un n'écrase volontairement un de mes hommes ou qu'une des parties n'ouvre le feu, j'ai demandé au Sector Comd de supprimer TOUS LES CHP qui avaient été prévus et de les remplacer par des patrouilles. Le Sector Comd acquiesça » (63b). Lorsqu'on l'interrogea sur les problèmes qui se posaient aux points de contrôle, le colonel déclara : « Dans la plupart des checkpoints, il y a danger lorsqu'il y a provocation. Ainsi, dans un des 152 checkpoints, un véhicule s'arrête et le passager ordonne à ses gardes de sécurité d'armer. Le chef de patrouille fait armer à son tour. Le ton baisse et, sur la carte remise par le passager, qui déclare qu'on entendra parler de lui, on lit Bagosora. J'ai informé le commandant de secteur et Bruxelles parce que c'était le énième incident qui se produisait dans le cadre de la mission de sécurité. Je ne me sentais pas équipé et entraîné pour y faire face. À la date du 1er mars, j'ai envoyé un message à Bruxelles demandant des directives, mais en vain, et je me suis refusé à appliquer les ordres, voulant à tout prix éviter de faire remplir par mes hommes des tâches de gendarmerie au lieu de tâches militaires. » (64b)
Au cours de la réunion du 13 mai 1997, le commandant Noens a déclaré à propos du colonel Bagosora : « Tijdens één van de nachtelijke patrouilles botste een bereden patrouille in een kleine straat op een 30 à 35 gewapende FAR-soldaten. Dat betekende een grove schending van de regels van de KWSA. Dat wordt aangekaart en nog eens besproken ter gelegenheid van de Veiligheidsconferentie van 15 februari, waaraan de minister van Landsverdediging, de Stafchef van de Rijkswacht en kolonel Bagosora deelnamen. Deze kolonel was in feite zowat de slechte geest van de groep, de meester provocateur van onze para's. Met een brede smile op zijn gezicht verklaarde hij dat er geen enkele overtreding gebeurd was en dat zijn soldaten het volste recht hadden om daar te zijn, want zo zei hij, ik heb recht op vijf man en ik heb nog een reeks autoriteiten bij mij uitgenodigd die elk hun escorte hebben meegebracht. » (65b)
Dans sa déclaration devant la commission Uytterhoeven, le colonel Leroy affirme : « À partir du moment où une grenade explose dans le jardin du Comd Sect, il y avait menace. Dans l'attitude de Mil appartenant au régime en place, arrogance, provocation pour tester la composante belge de MINUAR. Pour ces raisons, mes Comd Cie ont demandé à pouvoir engager une balle dans le canon, ce qui fut refusé. » (66b)
À la question de savoir si les menaces spécifiques telles que les avaient rapportées le lieutenant Nees pouvaient être également qualifiées de telles par le colonel, ce dernier ne nia pas que ses Casques bleus étaient menacés. « Il y a certes eu des menaces contre les Belges, mais cela ne reflétait pas le climat général. J'ai régulièrement attiré l'attention du C Ops sur les dangers que nous courions à rechercher des armes ou à maintenir l'ordre public. Mais cela ne constitue pas un climat antibelge, c'est-à-dire s'appliquant à tous les Belges. La menace contre les Casques bleus belges aurait pu se cristalliser si nous avions continué à saisir des armes. Nous ne l'avons pas fait. » (67b)
Le colonel conclut la réunion du 24 mars en constatant : « Mon sentiment a été influencé par tout ce que j'ai lu et entendu depuis lors. Je ne suis plus le même homme que celui qui est revenu du Rwanda. À l'époque, j'étais persuadé qu'il n'y avait pas de menaces. »
Le colonel Leroy déclara en outre : « Il y avait effectivement des problèmes, mais ils n'étaient pas comparables aux problèmes réels qui se sont produits à KIBAT II. » (68b)
La commission a entendu le colonel Dewez, commandant de bataillon de KIBAT II, le 16 avril 1997. Aux dires du colonel, l'on n'a eu, dès le début de la mission, aucune vue de la situation au Rwanda. Selon le colonel Dewez : « Les informations que j'ai obtenues de l'état-major concernant la situation au Rwanda étaient d'ordre général. Pour avoir un témoignage plus vivant, je me suis adressé au Père Bouts, réputé pour sa connaissance du Rwanda. Il nous a donné un premier briefing et j'ai retenu la complexité de la situation aux niveaux politique, social et ethnique. Il y avait une rupture de dialogue évidente entre le pouvoir et la population et c'était le règne de la désinformation. » (69b)
« La question du sentiment antibelge ne me paraissait pas cruciale car la majorité de la population rwandaise souhaitait une intervention de l'ONU et se réjouissait de notre arrivée. Je les (les officiers) ai informés de la campagne antibelge et anti-MINUAR en insistant sur le fait que tout faux pas de leur part serait systématiquement exploité. » (70b)
Lors de sa dernière audition par la commission d'enquête le 30 juin, le colonel Dewez a une fois de plus reconstitué le briefing qu'il avait donné à ses hommes au début de l'opération à Kigali. « Je vous ai dit qu'un cours a été donné ... à tous les gradés, jusqu'au niveau de chef de peleton ... j'ai expliqué le fonctionnement général de l'ONU, des opérations de paix etc. Ensuite, le capitaine Choffray a poursuivi avec, notamment, les régles d'engagement. À l'issue de ce briefing, un document a été distribué à chaque compagnie. (...) ensuite, la mission de chaque compagnie consistait à transmettre ce briefing au sein de la compagnie vers les pelotons. (...) Un autre jour ... j'ai rassemblé les compagnies donc tous les soldats et je leur ai donné un briefing d'une heure environ. (...) Vous constaterez que j'indiquais que la mission allait être difficile et qu'il ne s'agissait pas du tout de vacances. Je n'ai jamais dit aux hommes qu'ils allaient en vacances ... ce bruit s'était certainement répandu entre eux en raison de la comparaison avec la Somalie. » (71b)
La commission a été troublée par la manière dont le colonel a été préparé pour sa mission de commandant de bataillon de KEBAT II. La commission s'interroge à propos du fait que le colonel devait chercher ses informations auprès de certaines personnes, comme le Père Boets, plutôt que de pouvoir se reposer sur ses autorités à qui revenait la responsabilité de l'informer adéquatement sur le milieu dans lequel il allait devoir opérer. Il est tout aussi étonnant que les informations aient été transmises de façon si imparfaite. Le colonel n'a pas été mis au courant des rapports du lieutenant Nees. Il n'a en outre pas pu confirmer s'il avait été mis au courant des informations fournies par Jean-Pierre. Il a toutefois pu faire davantage de clarté sur les renseignements que le colonel Leroy lui avait transmis. Le colonel Dewez déclare : « On y (au cours du briefing) a évoqué plus les menaces contre les opposants hutus et les hutus liés à la Belgique qu'envers les Belges eux-mêmes . (...) J'ai passé une semaine avec lui (le colonel Leroy) au Rwanda, à la fin du mois de janvier. Il m'a fait part des problèmes rencontrés, notamment du fait que le moindre incident était monté en épingle et que les soldats faisaient l'objet de provocations. De retour en Belgique, je ne m'attendais pas à recevoir plus d'informations du SGR (...) Il n'y a pas eu de document écrit au sujet de ce briefing. Je dispose simplement de mes propres notes dans mon carnet . (...) J'y ai noté, le 4 février, que la situation au Rwanda était délicate. Il y avait une campagne antibelge. Le moindre incident pouvait être exploité et pouvait avoir des répercussions directes dans les milieux politiques belges. Nous devions être absolument neutres et éviter tout excès. » (72b)
Contrairement au colonel Dewez, le colonel Balis était, lui, au courant des informations dont disposait le capitaine Claeys depuis janvier. Le colonel savait également que le capitaine Claeys continuait à rencontrer le fameux indicateur. Le colonel Balis, qui était, à l'origine, chargé d'élaborer un plan d'évacuation, a vivement critiqué la déficience du service de renseignements. Il a déclaré, à ce sujet : « Het is natuurlijk zo dat we heel veel geruchten, mededelingen, hadden, maar weinig concreets op papier. Volgens mij was dat misschien wel de grootste zwakte van de zending UNAMIR. (...) Het is mij direkt opgevallen dat de belangrijkste sectie in zo'n staf bestond uit één Belgische kapitein. Die man heeft dag en nacht gewerkt. Die heeft werkelijk schitterend werk gedaan, maar dat was veel te veel voor hem. Ik heb generaal Dallaire voorgesteld ... om mij toe te laten om een inlichtingencel op te richten met drie, vier of vijf officieren en vooral met enkele mensen die Rwandees kennen. (...) Het antwoord van New York was dat het niet wenselijk was een inlichtingencel op te richten omdat het inwinnen van inlichtingen een daad van agressie zou zijn. » (73b) Le colonel Balis : « Iedere inlichting was welgekomen, uiteraard, maar er waren heel alarmerende feiten. (...) Ik had ook geen enkele Afrika-ervaring. (...) Na drie tot vier maanden permanent te moeten horen dat ik er niet moest mee inzitten, dat de Arusha-akkoorden zouden worden uitgevoerd. » (74b) Le colonel Balis, qui a lu tous les « code cables » du général Dallaire et était donc même au courant de l'information de Jean-Pierre, ne s'est toutefois senti menacé personnellement qu'une seule fois suite à la manifestation de janvier. « ... tegen de middag werden de voorbijrijdende UNO-voertuigen gecontroleerd op de aanwezigheid van Belgen. Ik weet dat omdat ik zelf in zo'n voertuig zat. Gelukkig zat er een Bengalese chef aan het stuur en bleef mijn Belgische wimpel achter zijn schouder verborgen ... bij het zien van de Bengalezen riep de Rwandees luidkeels « Il n'y a pas de Belges, ils peuvent passer. » (75b) Bien que le colonel ne se soit pas senti personnellement menacé, il a convenu qu'il y avait des indices que la présence belge faisait l'objet de menaces. Tout comme il avait déjà déclaré devant la commission Uytterhoeven que les menaces n'étaient pas dirigées contre la MINUAR mais qu'il existait une controverse concernant la présence belge. Le colonel Balis a confirmé, devant la commission d'enquête parlementaire : « Anti-belgisch? Ja, dat wisten we reeds voor we vertrokken. Het was ons niet onbekend dat het terugtrekken van de troepen in 1991 niet in dank was afgenomen door bepaalde groepen. » (76b)
Le colonel a déclaré qu'il avait quand même été très inquiet. « Le troisième jour que j'étais au Rwanda, j'ai entendu à la radio officielle un homme qui, d'une voix hystérique, déclarait : « Nous n'avons pas voulu les accords d'Arusha, ils nous ont été imposés et nous ne les accepterons jamais. » Et moi j'étais là avec mon béret bleu à participer à l'UNAMIR ! » (77b)
Le colonel Marchal, commandant de secteur de la MINUAR à Kigali, a été interrogé en détail par la commission au sujet de ce que l'on appelle le climat antibelge au Rwanda. Au début de sa première audition, le colonel a relativisé le sentiment antibelge. Il a estimé utile d'apporter une précision en affirmant : « Il existait un climat anti-MINUAR avec des poussées de fièvre qui se focalisaient sur les Belges. Un incident m'a paru significatif à cet égard : c'est le jet d'une pierre dans la porte vitrée des responsables de Radio Mille Collines. J'ai compris qu'il y avait danger pour la sécurité des militaires belges et des expatriés. » (78b)
Au cours de sa deuxième audition, le 14 mars, le colonel Marchal a été interrogé une deuxième fois concernant la manifestation du 8 janvier 1994. Il a déclaré : « Concernant le climat antibelge, je voudrais signaler que la manifestation du 8 janvier était la première du genre à Kigali. Si le détachement belge s'était engagé dans ce type d'opération, le climat antibelge aurait connu une poussée de fièvre. La manifestation du 8 janvier m'a inquiété car le mouvement de foule n'était pas à maîtriser. J'ai demandé des directives à l'état-major à Bruxelles... La réponse m'a été envoyée un mois plus tard. » (79b)
Même s'il lui était difficile d'évaluer les incidences de l'atmosphère anti-MINUAR et antibelge, le colonel Marchal a pris certaines mesures afin de diminuer les risques. « J'ai ainsi supprimé toutes les sorties nocturnes ainsi que les contrôles routiers. Un plan d'évacuation des expatriés a été minutieusement mis au point et j'ai personnellement tenu un « briefing » pour l'expliquer... J'ai également exprimé officiellement mes préoccupations au général Dallaire concernant les conséquences des émissions de Radio Mille Collines. » (80b) Le 14 mars, le colonel Marchal explique ses démarches auprès de l'ambassadeur : « Il était temps que Bruxelles se préoccupe du problème. » (81b)
Le major Maggen, qui était responsable, au quartier général de la Force, de la cellule de permanence chargée de réceptionner et d'expédier les messages, a résumé comme suit les premières impressions qu'il a eues de sa mission au Rwanda : « Op 4 december 1993 kwam ik aan in een land waar het zogezegd vrede was. Het eerste wat ik de generaal (Dallaire) hoorde zeggen was dat hij de pers weer eens had moeten vertellen dat de Belgen die waren toegekomen, blauwhelmen waren en geen Belgen. Er was dus inderdaad een kiem van anti-Belgische gevoelens op dat ogenblik. (...) Wat wij als Belgen onder de UNAMIR-vlag hebben gedaan, draaide voor ons niet goed uit. Wij hebben immers het anti-Belgische gevoel versterkt door dat bataljon van patriotten van het Noorden van het land over te brengen naar Kigali met Belgische vrachtwagens en onder Belgische escorte. (...) In Kigali escorteerden we permanent de VIP's van de patriotten van het RPF. (...) Begin januari reeds had ik het gevoel dat het Arusha-verdrag het resultaat was van een oorlog die de huidige machthebbers hadden verloren. » (82b) (...) Le major Maggen: « Ik vermeld de verklaring van 8 januari, de tip in verband met de plannen van de Interhamawe ... voorts was er een speciale actie rond de wapendepots in Kigali, die erin bestond dat een speciale search-operatie zou worden uitgevoerd om de hand te leggen op de wapendepots. Dit waren geheime operaties waarvan enkel de generaal (Dallaire) en een beperkte kring van mensen, waartoe ikzelf niet behoorde, op de hoogte waren. » (83b) En résumé, le major, qui avait déclaré, en décrivant sa mission à Kigali, être responsable du suivi des incidents, de l'analyse des informations reçues et du rapport quotidien à adresser à New York par le biais du SITREP, n'apparaît vraiment pas comme bien informé.
Après avoir entendu les officiers supérieurs, la commission a invité une série d'officiers qui exerçaient leurs fonctions au niveau de la compagnie. Bien qu'elle leur ait surtout demandé d'apporter leur témoignage sur les événements tragiques du 7 avril, l'évacuation de l'école Don Bosco et le retrait, la commission a tenté de savoir, en marge de leur audition, comment ces officiers évaluaient la situation qui régnait avant les faits du 7 avril.
Le capitaine Lemaire, dans son audition devant la commission, a dénoncé la mauvaise exploitation des informations dont on disposait sur place. « Il semblerait qu'on connaissait le risque de génocide et le danger pour les Belges. » « En fait, tout allait mal depuis le début. Déjà lors de la constitution de la force, on n'a pas fait confiance aux militaires. »
Le capitaine, qui avait obtenu lui-même des informations relatives à des distributions d'armes et à l'imminence d'un bain de sang, a déclaré qu'il n'était pas informé du danger que représentait sa mission. « On nous a dit que le risque, pour nous, était limité. Jamais on ne nous a parlé de risques directs pour les Belges et la MINUAR sinon je n'aurais pas autorisé les sorties le soir. Si les officiers avaient su qu'un génocide se préparait, ils n'auraient pas autorisé tout cela. Nous nous sommes cependant rapidement rendus compte que les gendarmes jouaient avec la MINUAR et que le 1er Paras avait été muselé et trompé. C'est pour cela que nous n'avons plus communiqué aux gendarmes l'emplacement des check points ni les trajets des patrouilles. Cette décision a suscité leur mécontentement. » (84b)
Le 13 mai, la commission a entendu le capitaine Marchal. Le capitaine Marchal avait déjà longuement commenté, devant l'auditeur militaire, son expérience du climat qui régnait dans la période antérieure au 7 avril. « Après cette date (1er avril), il y avait une certaine tension qui se manifestait en ville par des grèves et des assassinats, que j'ai moi-même constatés. La population ne croyait plus dans la MINUAR, des soeurs me l'avaient rapporté. Journellement j'adressais au bataillon un rapport où je faisais part de mes observations. J'étais moi-même devenu méfiant envers les gendarmes et des Rwandais parce que j'avais constaté que, ce qui ne s'était jamais passé avant, lors d'assassinats politiques les gendarmes étaient avant nous sur place. » (85b)
Le capitaine a confirmé ce témoignage devant la commission. En tant que responsable du groupe du centre-ville, il avait en effet remarqué qu'à partir du 4 avril, l'armée et la gendarmerie étaient toujours sur place avant les Casques bleus. Le capitaine a hésité à en conclure qu'il existait un plan préétabli visant à provoquer le départ de la MINUAR pour permettre le génocide.
La commission constate que les informations disponibles n'ont pas été appréciées correctement alors même que la plupart des officiers étaient au courant des menaces qui pesaient sur les Belges en général et les soldats de leur propre détachement en particulier. La commission constate qu'alors que tout le monde a recueilli des indications non négligeables de l'existence d'une menace antibelge, ces informations n'ont pas été regroupées sur le terrain et qu'il n'y a eu pratiquement aucune communication entre les différents services à Kigali.
3.3.2.2. L'appréciation en Belgique de la menacecontre le KIBAT/la MINUAR
(1) Par les autorités militaires
La commission s'est également intéressée à la manière dont l'autorité militaire en Belgique a analysé et apprécié les flux d'informations qui lui parvenaient de Kigali. Dans ce cas aussi, la commission a constaté que les informations en provenance du Rwanda ont été interprétées de différentes façons. C'est ainsi que la commission constate que les informations recueillies au niveau de KIBAT par les services de renseignements du SGR en Belgique n'ont pas été appréciées à leur juste valeur. De plus, la commission constate les carences de communication interne entre l'état-majorgénéral et les services de renseignements militaires à Bruxelles.
Lors de la première audition du 28 février 1997, le lieutenant général Charlier avait déjà attiré l'attention sur le caractère antibelge du climat qui régnait au Rwanda (voir aussi le chapitre sur la menace au cours de la période qui a précédé la décision). D'après le lieutenant-général, le retrait des troupes belges en 1991 et la suppression des livraisons d'armes ont alimenté les sentiments hostiles à la Belgique. Un mois plus tard, au cours de sa seconde audition, l'ancien chef d'état-major a souligné que toutes les informations relatives à la campagne antibelge figuraient dans les documents du SGR. Ces documents ont été transmis au ministre. Le lieutenant général Charlier a déclaré que les informations négatives et positives se succédaient en alternance : « Au Rwanda les signaux négatifs étaient essentiellement des menaces verbales jusqu'au 6 avril, à l'exception d'un petit incident » (86b). Le lieutenant-général Charlier a également fait la comparaison avec les opérations antérieures en Slavonie et en Somalie où les incidents étaient plus graves. Le lieutenant-généralCharlier a pourtant déclaré : « Nous n'avons jamais sous-estimé les menaces. À chaque nouvelle information concernant des menaces, j'ai demandé au commandant sur place au Rwanda de confirmer l'information, de m'en donner son analyse et de m'expliquer les mesures prises. Il n'y a jamais eu de relâchement. Le retrait de KIBAT a été envisagé à trois reprises . (...) Nous avons encore envisagé ce retrait après le télégramme alarmant du colonel Marchal qui demandait des précisions sur ce qu'il devait faire en cas de généralisation des troubles. Si l'on envisageait l'évacuation de tous les Belges, je savais que nous enverrions des troupes mais je nepouvais pas envoyer ce message à un état-major de l'ONU. J'ai donc téléphoné au colonel Marchal car je craignais que son télégramme ne soit la conséquence de l'épuisement nerveux qui guette les officiers dans ce genre de situation. Le colonel Marchal s'est cependant dit prêt à continuer sa mission. Il l'a répété au ministre de la Défense lors de sa visite au mois de mars. » (87b)
Même si le lieutenant général a pu se faire une idée de la menace imminente qui pesait sur les Casques bleus belges grâce aux rapports du SGR, il a dû se passer des informations détaillées de Jean-Pierre. « J'ai découvert l'existence de Jean-Pierre dans lesrapports de la commission. » (88b) Et il n'a pas pu donner de réponse définitive à la question de savoir si le lieutenant général avait discuté avec le ministre de la Défense de la note de synthèse du 2 février 1994, dans laquelle est mentionné que l'on voulait tuer des Belges.
Au cours de la réunion du 21 avril, le lieutenant général a donné des informations au sujet de la visite à notre pays du général rwandais Ndindiliyimana. Le lieutenant général Charlier a déclaré à ce propos : « Je lui ai parlé des menaces contre les militaires belges. Selon lui, ces menaces étaient isolées. Je ne l'ai cependant pas cru. » (89b)
Le général Charlier prétend qu'il était déjà, au mois de mars, conscient des risques contre les Casques bleus belges.
Le général-major Verschoore, l'adjoint du général-major Delhotte, chargé de rassembler et d'analyser des informations pour le SGR, a, lui aussi, été invité à esquisser le climat qui régnait au Rwanda et, plus particulièrement, l'attitude adoptée à l'égard des Belges.
« Les renseignements rassemblés en septembre 1993 démontraient clairement que la situation au nord du Rwanda était extrêmement tendue. Le FPR occupait en effet une partie de cette région. Début 1994, il n'était pourtant pas question d'un climat antibelge.
Fin janvier, il y a eu des incidents avec les Interahamwe dans le but de déstabiliser le pays. Des agressions contre les Belges n'étaient donc pas exclues. Radio Mille Collines stigmatisait les Belges et la MINUAR. Toute opération militaire présente des risques semblables. Le SGR percevait quelques indications de troubles graves mais ne pouvait certainement pas conclure des informations reçues qu'un génocide se préparait » (90b).
« À partir de janvier, nous avons constaté un climat antibelge. Auparavant, il y avait déjà eu des incidents, mais à partir de janvier, le climat anti belge était plus prononcé au sein de certains groupes de la population et il y avait un risque » (91b). Dans son appréciation personnelle de la situation politique au Rwanda, le général-major situe les émissions de RTLM, les entraînements ainsi que la distribution d'armes à la fin décembre 1993, début janvier 1994.
« Les INSUMS présentent les faits, une analyse ainsi qu'une conclusion. Ma conclusion était que quelque chose se préparait » (92b). Bien que le général-major ait été conscient d'une menace contre les militaires belges en fonction des renseignements reçus de SGR, il affirme que le service de renseignements n'a pas pu prédire de quelle façon la situation évoluerait. « Nous n'avons jamais pensé à une attaque contre les militaires belges. Nous avons considéré les menaces comme de l'intimidation » (93b).
Le général-major Delhotte, qui a été entendu par la commission le 21 mars, a déclaré qu'il n'y avait pas de menace concrète, mais a également admis « que les faits étaient mieux connus du commandement local que du SGR. C'est ce commandement qui doit en premier lieu évaluer les faits » (94b). Il a ajouté que : « C'est le colonel Marchal qui a été informé par Jean-Pierre et nous connaissions ces informations par son entremise. » Le général-major Delhotte a interprété la situation de la façon suivante : « En décembre, on a encore organisé des activités de loisirs pour les paras. Si cela a pu se faire, c'est que la situation ne devait pas être tellement grave. » Les informations transmises notamment par le colonel Marchal et le major Podevijn indiquaient, selon le général-major, « qu'on ne ressentait pas de véritables problèmes. Toutefois, les Interahamwe ont provoqué des incidents dans le nord en décembre et dans le sud, près du Burundi, en janvier » (95b).
La commission constate que le général-major Delhotte considère que les nouvelles alarmantes en provenance de Kigali constituent un risque intrinsèque à ce genre de mission, alors que son adjoint général-major Verschoore, a décrit la situation du mois de janvier comme étant plus grave. La commission constate en outre que le général-major, qui est le chef du service de renseignements militaire, rend les troupes opérationnelles sur place responsables de l'appréciation de la menace, alors que ses services de renseignements étaient les mieux placés pour procéder à une analyse globale. Le général-major Delhotte s'est justifié en déclarant devant la commission qu'il n'appartient pas au SGR de donner de fausses alarmes, puisqu' « à l'époque, les renseignements que nous possédions n'indiquaient pas une menace précise. Dès le début, il y a eu un peu de provocations et l'importance des Interahamwe a été exagérée ». Le général ajoute : « Les synthèses et les appréciations du SGR n'ont été contredites par aucune autorité locale. (...) Si le rapport n'avait pas été plausible, il y aurait eu un choc en retour du lieutenant-général Charlier » (96b).
Il est évident que la gravité de la menace qui pesait sur les Casques bleus belges n'a pas été mesurée de manière univoque. Les officiers présents sur le terrain connaissaient très bien les dangers. Par contre les officiers supérieurs en Belgique, qui en étaient informés et les ont appréciés d'une manière différente et en avaient une autre perception. En outre, l'on constate qu'au niveau du service de renseignement belge et de l'état-major, les avis étaient également partagés. C'est entre autres parce qu'il y avait eu des déficiences dans l'analyse et l'évaluation des informations qu'il y a eu des appréciations erronées et incomplètes au niveau de l'état-major, malgré le fait que celui-ci disposait de ces informations par d'autres canaux. La mauvaise interaction entre les divers services et échelons « aucun feed-back » , a affirmé le colonel Marchal a empêché une appréciation objective des signaux d'alarme.
La commission s'est intéressée à la manière dont leGouvernement belge a perçu les nombreuses informations alarmantes dont la plupart ont été transmisespar le représentant local, l'ambassadeur Swinnen.Dans le paragraphe visé, nous reprendrons les constatations que les responsables politiques ont faites aucours de la période qui va de l'installation de laMINUAR au drame du 7 avril 1994.
L'ambassadeur Swinnen, qui, en tant qu'auteur dutélex nº 32 du 13 janvier 1994, a communiqué à laBelgique un plan visant à tuer ou à blesser des militaires belges, maintient la conclusion qu'il a formulée aucours de sa première audition. Il affirmait ce qui suit :« C'est une question de gradation. À ce moment-là, nous ne pouvions pas parler d'un climat antibelge généralisé . » (97b) La commission s'est occupée des questions relatives à l'informateur Jean-Pierre et à la connaissance des menaces concrètes (voir supra), et s'est informée sur les initiatives que M. Swinnen avait prises pour mettre fin à la campagne antibelge. Concrètement, l'on a demandé à M. Swinnen s'il avait fait appel, pour ce faire, à ses collègues français. L'ambassadeur n'a pas répondu de manière approfondie à la dernière question, mais il a déclaré ce qui suit : « La propagande antibelge était surtout évoquée dans le cadre de nos inquiétudes au sujet du climatantipacifiste de certains milieux. J'ai abordé plusieurs fois ce problème, avec des résultats positifs » (98b).
La note que Johan Swinnen adresse, le 26 janvier 1994, au ministre Claes, et dans laquelle il fait le bilan des relations bilatérales avec le Rwanda au cours de 1993, complète utilement les nombreux télex et briefings qui ont été communiqués à Bruxelles. La note a été rédigée par le collaborateur diplomatique Philippe Colyn. Robert Schriewer, chef de la section coopération, est l'auteur de la partie relative à la coopérationau développement. Le chapitre consacré à la coopération technico-militaire avec le Rwanda est de la main du colonel Vincent, chef de la coopération technique et militaire et adjoint à l'ambassade en tant que conseiller militaire.
Dans le cadre de considérations politiques, l'ambassadeur écrit ce qui suit : « Les diatribes antibelges des extrémistes actifs au sein de la mouvance MRND-CDR, à l'occasion du déploiement de la MINUAR, nous accusant fallacieusement d'abandon du pays et de complicité avec le FPR, au contraire du véritable ami qu'est la France dont les troupes durent laisser la place à la MINUAR, ne peuvent que nous conforter dans la justesse de notre approche, d'autant que les extrémistes récusant le processus d'Arusha ne reçurent pas le soutien escompté au sein de la population .
Cette manipulation de l'opinion au détriment de l'image de la Belgique ne devrait cependant pas être négligée, pas plus que ne doit être sous-estimé le danger potentiel que représentent les milieux extrémistes, appuyés de plus par une partie de l'appareil d'État et par certains médias, ainsi que par des milices comme les Interahamwe, pour le processus de paix et d'ouverture politique préconisé et soutenu par notre diplomatie » (99b).
L'ambassadeur Swinnen a déclaré devant la commission que le cabinet des Affaires étrangères était son premier interlocuteur. En plus du cabinet, certains autres responsables gouvernementaux concernés et leurs départements et services ont également été informés de la situation politique au Rwanda. Dans ce chapitre, la commission constate que l'attitude de plus en plus négative à l'égard des Belges et de leur présence dans la MINUAR était un fait, du moins dans les milieux extrémistes. La commission confirme ce qui a été dit dans le rapport du groupe ad hoc , où l'on peut lire que : « En plus de cette menace spécifique, la MINUAR et les troupes belges de la MINUAR , bien qu'elles fussent envoyées au Rwanda dans le cadre d'une opération de « peacekeeping » et non pas de « peacemaking », sont devenues la cible d'attaques et d'attentats de tous genres très vite après leur arrivée . »
Le premier incident a eu lieu le 2 décembre 1993, on a attaqué et mitraillé une patrouille de la MINUAR dans le nord du Rwanda.
La commission constate toutefois que l'évaluation des événements s'est faite d'une manière divergente, qu'ici aussi, la transmission d'informations aux cabinets depuis Kigali diffère et que la communication et l'interaction entre les différents cabinets, d'une part, et la collaboration avec les autorités militaires, d'autre part, étaient déficientes.
Interrogé à propos de l'attention que le Conseil des ministres a accordée aux nouvelles concernant les menaces lancées contre notre pays au cours de l'opération au Rwanda, le Premier ministre Dehaene a répondu comme suit, au cours de la séance du 26 juin : « Les opérations se font au niveau des départements concernés. Ils doivent voir s'il y a des éléments à transmettre au Conseil des ministres » (100b). À propos de la gravité de la menace, le Premier ministre a fait la déclaration suivante : « Il n'y a pas eu de communication dans ce sens à cette époque. » (...) « À l'ordre du jour du Conseil des ministres, il y a toujours le point communication du ministre des Affaires étrangères . » (...) « Régulièrement, le ministre des Affaires étrangères fait une communication générale et informe le Conseil des ministres sur certains points. » Le Premier ministre ajoute : « Il est vrai que M. Claes a régulièrement parlé, entre autres, des caches d'armes. Je travaille sur base de ce qui a été repris dans les notules. M. Claes a régulièrement parlé de deux choses, ses contacts avec les Nations unies pour renforcer le mandat et le fait que les caches d'armes étaient connues » (101b).
À la question de savoir ce que le Premier ministre Dehaene savait lui-même, au moment de l'opération, de la menace qui pesait sur les Casques bleus belges et si le ministre des Affaires étrangères avait parlé à l'époque, en Conseil des ministres, du télex du 11 janvier 1994 dans lequel il était question de l'information de Jean-Pierre concernant un éventuel plan d'extermination des Tutsis et un plan d'assassinat des Belges, le Premier ministre a répondu à ce sujet : « Over dit specifieke, niet in mijn bijzijn » (102b).
M. Leo Delcroix, l'ancien ministre de la Défense nationale, a nuancé l'importance des messages qui faisaient état de menaces contre les Casques bleus belges. Se fondant sur les informations auxquelles il avait eu accès à l'époque, l'ancien ministre a déclaré ce qui suit : « En Belgique, on était convaincu, à tous les niveaux, qu'il n'y avait pas de danger imminent. Certains informateurs, comme le colonel Vincent, entretenaient de bons contacts avec les autorités militaires et avec la gendarmerie rwandaise. Selon tous ces informateurs, nous bénéficiions de la crédibilité nécessaire. La vie des militaires belges n'a été mise en danger dans aucune situation. Avant le mois d'avril, il n'y a jamais eu ni de morts ni de blessés. La situation à Kigali ne fut pas perçue à Evere comme représentant un danger aigu. De plus, il y avait un grand nombre de journalistes et de cameramen belges à Kigali. Je ne les ai jamais entendu dire que la situation était dangereuse. Il y avait donc un noyau dur d'extrémistes dont nous avions sous-estimé la détermination. C'est pourquoi j'estime, comme le colonel Vincent, que le climat antibelge était surtout un instrument utilisé au niveau politique » (103b).
M. Delcroix situait l'attitude antibelge dans les milieux extrémistes et antipacifistes : « Dans les milieux extrémistes, il y avait effectivement des personnes qui ne souhaitaient pas de partage du pouvoir et qui boycottaient les accords d'Arusha. Elles exprimaient également leur mécontentement au sujet de l'attitude que la Belgique avait adoptée dans le passé. Il serait toutefois erroné d'attribuer cette opinion, que l'on trouvait dans des groupes extrémistes, à l'ensemble de la population de Kigali et du Rwanda » (104b).
Au cours de la réunion du 18 juin 1997, M. Delcroix sera d'accord pour reconnaître ce qui suit : « Op uw vraag wat er niet gefunctioneerd heeft, moet ik antwoorden dat wij allemaal, zowel de politici als de militairen hier, in New York en Kigali, een verkeerde inschatting hebben gemaakt van de krachten rond extremistische Hutufiguren »(105b).
Lors de l'opération au Rwanda, le ministre a pu se faire, sur la base des documents qui lui étaient transmis, une idée de l'ampleur de la menace qui pesait sur les Belges. « De meeste dreigementen stonden vermeld in de telexen van de ambassade. Daarnaast waren er ook vermeldingen in de SGR-verslagen. (...) Vooral de verslagen vanuit de ambassade verwoordden de dreigementen terwijl de SGR-verslagen een eerder relativerende toon hadden. (...) De bedreigingen werden dan ook gerelativeerd, zeker van militaire zijde »(106b).
Au cours de sa dernière audition par la commission, le 18 juin, M. Delcroix répétera ce qui suit : « Vooral de verslagen vanuit de ambassade verwoordden de dreigementen terwijl de SGR-verslagen een eerder relativerende toon hadden. Het kabinet en de generale staf hadden de indruk dat de bedreigingen eerder moesten worden geïnterpreteerd als aankondigingen. In negen van de tien gevallen kwam er van de aangekondigde actie niets in huis » (107b). Interrogé sur sa réaction face au rapport du 2 février 1994 qui faisait état d'attaques contre les troupes belges, l'ancien ministre Delcroix a répondu comme suit : « Men moet de documenten van de SGR altijd in hun totaliteit lezen. (...) Het belangrijkste in de documenten van de SGR is echter niet de informatie, niet het eerste gedeelte, maar wel het tweede, namelijk de commentaren. (...) De informatie die wordt aangehaald, moet men in een bredere context zetten. In het tweede deel wordt de informatie gerelativeerd. (...) Het is dus een beetje geven en nemen, zodat er bij het ontvangen van het document ook niet meteen algemeen alarm is geslagen. (...) Nog vóór de heer Hock zijn rapport had bezorgd, had kolonel Vincent reeds demarches gedaan bij de twee chefs van de generale staf. Zowel de heer Claes als ikzelf begonnen ons toen vragen te stellen over de impasse. In dezelfde periode werden ook de bezoeken vastgelegd. (...) We wilden kijken hoe ernstig de dreiging was en hoe de soldaten ter plaatse dit alles aanvoelden. Wij hebben de informatie dus genoteerd, maar noch door politici, noch door militairen, noch in Evere, noch in Kigali, werd er groot alarm geslagen (...) In Rwanda werd er aangekondigd dat er iets zou gebeuren, maar de bewuste datum ging voorbij zonder dat er echt iets gebeurde. Er werden dus zeer veel loze dreigingen geuit. (...) In Rwanda voelde men de situatie niet echt als bedreigend aan. Ook tijdens mijn bezoek hebben de militairen ter plaatse dat gezegd » (108b). « Dans l'ensemble, il y avait aussi bien des messages alarmants que des messages relativisants. Avec le recul, je constate qu'on a sous-estimé la situation »(109b).
M. Delcroix précise l'appréciation qu'il avait faite à l'époque des messages concernant une campagne antibelge et les risques que les Belges couraient au Rwanda en déclarant notamment qu'il ne se serait pas rendu à Kigali si le climat avait été antibelge. « Il ne nous serait pas venu à l'esprit de laisser une délégation de 65 personnes sur place pendant quatre jours, si nous avions su que cela représentait un grand danger pour nous en tant que Belges ou si nous nous étions attendus à des incidents sérieux ou à un génocide. Je ne me rappelle pas que les membres de la délégation aient eu le sentiment de se trouver dans une situation dangereuse. Le briefing à l'adresse des membres de la délégation précisait qu'il y avait eu quelques assassinats et des incidents au cours des semaines précédentes, que des armes avaient été distribuées à la population, qu'il y avait des camps d'entraînement pour les milices, qu'il y avait des incidents entre le FPR et le président, que les Casques bleus belges faisaient l'objet de critiques, que Dallaire connaissait insuffisamment l'Afrique et qu'il y avait des tensions au sein de la MINUAR »(110b).
Au cours de son séjour, M. Delcroix n'a pas davantage eu l'impression que les Belges couraient un danger particulier au Rwanda. À ce propos, M. Delcroix déclara ce qui suit : « Alle leden van onze delegatie (...) hebben daar in alle vrijheid kunnen rondlopen, ook 's avonds. (...) Zo risicovol was de situatie dan ook weer niet. Er gebeurden uiteraard ook wel gewelddadigheden, zowat overal in Rwanda. Ook was het algemeen bekend dat er doodseskaders bestonden » (111b). « Ik herinner mij bijvoorbeeld een gesprek met mevrouw Agathe, de eerste minister. (...) Zij heeft gezegd dat er weliswaar vanuit beperkte hoek kritiek kwam op de Belgische militairen, maar dat dit streng beperkt bleef tot de CDR, MRND en de Interahamwe. Het was geen veralgemeend gevoel dat leefde in andere partijen of bij de bevolking »(112b).
Au cours de son séjour au Rwanda, M. Delcroix demandera néanmoins, lors d'un entretien avec le président, que celui-ci « mette fin aux menées anti-belges d'un émetteur radio qui opère manifestement dans son entourage . » « L'amour ne peut jamais venir d'un seul côté », a dit M. Delcroix, qui a prétendu avoir dit, en privé, « ses quatre vérités à Habyarimana » (113b). Au cours de la réunion du 18 juin 1997, M. Delcroix a déclaré à ce sujet : « Nadat we daarover hadden gesproken hebben we over Radio Mille Collines gesproken, ik heb dat onderwerp aangebracht. Zowel voor onze militairen als voor de politieke en publieke opinie in België was het een steen des aanstoots dat die radio systematisch tegen de Belgen, de militairen en de diplomatie, op hatelijke wijze van leer trok. Ik heb hem gevraagd om zijn invloed aan te wenden om dat te temperen en terug in goede banen te leiden » (114b).
Interrogé à propos des mesures que le ministre avait prises après réception de la note du SGR du 2 février 1994, laquelle reprenait notamment les informations que contenait le télex nº 32 du 13 janvier 1994, M. Delcroix a répondu qu'il avait effectivement parlé de la note avec son cabinet : « Wellicht heb ik dat eerst beproken met mijn kabinetschef. Natuurlijk wordt dan de hele nota doorgenomen, ook het relativerend gedeelte. Wat ik wel weet is dat wij toen geen groot alarm hebben geblazen, dat wij zeker niet in paniek zijn geslagen vanuit de schrik dat de Belgische soldaten in acuut gevaar verkeerden. Dat was zeker niet het gevoel dat wij toen hadden . » (...) « Dat gevoel was er ook niet in Evere, op Quatre Bras of in New York. Waarschijnlijk hebben wij ons allemaal samen vergist, op al die verschillende plaatsen. » (115b)
En dépit des déclarations qu'il avait faites antérieurement, en 1996, pour le documentaire de la RTBF « Les oubliés de Kigali », selon lesquelles il n'était pas au courant des informations qui avaient été livrées par Jean-Pierre et communiquées par le télex nº 32 : « Je ne pense pas que j'ai lu ce rapport. En tout cas, je ne m'en souviens pas et le général Dallaire ne nous en a pas non plus parlé directement » (116b), l'ancien ministre de la Défense nationale a dit, au cours de l'audition du 18 juin 1997 : « Ik vermoed van wel, zeker telex nummer 32 van 13 januari » (117b).
Cette information avait déjà été confirmée par le luitenant-général major Schellemans, l'ancien chef de cabinet de M. Delcroix, qui, le 12 mars 1997, avait fait la déclaration suivante devant la commission spéciale : « Pour autant que je me souvienne, le cabinet a reçu des messages d'un certain Jean-Pierre ... À mon avis, le ministre a lu ces messages » (118b). L'ancien chef de cabinet, qui rapportait au ministre les messages pertinents émanant des INTSUMS et INTREPS, a déclaré « Le ministre doit avoir vu la note en question du 11 janvier » (119b).
« J'ai effectivement vu les rapports de l'informateur en question. On n'en a pas fait de fiche, parce que le ministre recevait également les documents que j'avais reçus » (120b).
Le lieutenant-général Schellemans confirme l'appréciation de son ministre concernant l'importance des messages relatifs à la menace contre les Casques bleus belges.
Schellemans déclare : « Le cabinet était au courant des communiqués concernant des déclarations et des actions anti belges. Toutefois, ces communiqués n'ont jamais été jugés à ce point alarmants qu'on pouvait penser à des meurtres ou à un génocide. Nous étions informés des menaces, mais celles-ci n'étaient pas considérées comme très dangereuses. Contrairement à la Somalie, il n'y avait pas encore eu au Rwanda de morts ou de blessés parmi les Casques bleus belges. RTLM menaçait évidemment de mener des actions » (121b).
« Il y eut plusieurs briefings avec le ministre à différents échelons. Il n'y fut jamais question du climat antibelge . »
Par ailleurs, lors de sa deuxième audition, le vendredi 18 avril 1997, l'ancien ministre Willy Claes s'est attardé sur la question de savoir s'il existait ou non un climat antibelge au Rwanda après le 19 novembre 1993. Selon lui, « il y avait un danger, mais il n'est pas réaliste d'affirmer qu'il y avait un climat anti belge généralisé » (122b). Toujours d'après l'ancien ministre, les attaques visant les Belges devaient être attribuées à « un petit parti politique, le CDR, et des Interahamwe » (123b).
(3) Autres sources d'information
À l'appui des témoignages des officiers belges membres de la MINUAR et de ceux des hommes politiques, la commission constate que d'autres autorités ont également témoigné de l'exacerbation d'un climat anti belge, en tout cas dans des milieux extrémistes hutus dirigés contre la présence belge en général et contre la participation de Casques bleus belges à la MINUAR en particulier.
Interrogés à propos des menaces qui pesaient sur les Belges en général et sur les Casques bleus belges en particulier, une série de témoins ont confirmé l'existence de risques et de dangers pour eux. D'autres témoins ont souligné que la présence des troupes belges suscitait des sentiments ambigus.
Alison DesForges (Human Rights Watch), par contre, a affirmé dans son témoignage qu'il y avait bel et bien des indices montrant l'existence d'une campagne contre la participation de la Belgique à la MINUAR :
« Dès son installation au Rwanda, la MINUAR rencontra des difficultés. Un camion de la Croix-Rouge belge fut pris pour cible et, le 2 décembre, une première attaque prenait pour cibles les paras belges de la MINUAR (...).
C'est à cette époque que s'intensifie la propagande haineuse contre les Tutsis, les opposants politiques et les troupes belges de la MINUAR . Vous en avez sûrement déjà les preuves. Mais l'importance des caricatures pornographiques et violentes qui représentaient les militaires belges dans les journaux de l'époque apporte un élément supplémentaire. On trouve des références en abondance dans le travail de Jean-Pierre Chrétien et de ses collaborateurs » (124b).
Mme Astri Suhrke, rapporteuse du rapport « The joint evaluation of emergency assistance to Ruanda » :
« Les deux aspects antibelges et anti-MINUAR se sont exprimés. Différentes sources montrent clairement qu'il y avait un sentiment antibelge. Il est cependant difficile de démêler les deux types de sentiments »(125b).
Le général de brigade Leonidas Rusatira a rappelé, au cours de son audition devant la commission, le refus de la Belgique de livrer des armes en 1990.
« Effectivement, en 1990, j'ai été hostile au retrait de la Belgique, des troupes belges mais ce n'était pas hostile à la Belgique. Si donc je souhaitais qu'ils restent, ce n'est pas de l'hostilité. Chez les Rwandais, en général, le même sentiment régnait pour que la Belgique se retire. En 1990 ce n'était donc pas de l'hostilité puisqu'on voulait que la Belgique reste et qu'elle laisse passer nos munitions.
La décision de l'époque a été prise mais il est clair qu'on avait cherché des solutions de rechange pour faire rencontrer au Rwandais pour arrêter les combats et pour arrêter ainsi les soupçons du pays.
S'il y avait le rejet de cette solution, pourquoi la guerre s'arrête. Ce ne sont pas mes militaires qui auraient préféré la guerre, la solution que la Belgique était en train de chercher était, si elle avait été atteinte, la meilleure, malheureusement elle n'a pas réussi et la guerre a continué. »
« Il n'y avait pas de sentiment antibelge mais anti-MINUAR et chacun savait que les Casques bleus belges étaient le fer de lance de la Minuar . Sans eux, la MINUAR ne signifiait plus rien et les Rwandais retrouvaient leur liberté d'action. » (126b)
François-Xavier Nsanzuwera, ancien procureur de la République rwandaise, a nuancé l'existence d'une menace contre les Belges en signalant qu'« une campagne antibelge existait mais il ne s'agissait pas d'un climat généralisé »(127b).
À côté de cela, la commission a également noté le témoignage de Mme Rika De Backer, ancien ministre qui, selon ses dires, n'a pas perçu, de sentiments anti-belges :
« U mag toch niet vergeten dat ik net uit Rwanda was teruggekeerd en dat ik er had gesproken met mensen van de MRND, van de MDR, van de PSD, van de PL, en eigenlijk met zowat iedereen van laag tot hoog. Bij die gesprekken heb ik helemaal niet ontdekt dat er een grote antipathie zou hebben bestaan tegen de Belgische Blauwhelmen. (...) Ik was er dus heel gerust in dat de meeste mensen van de MNRD en de MDR op dat ogenblik niet tegen de blauwhelmen gekant waren. (...) Hoe hoger op de ladder van de verantwoordelijken, hoe minder kritiek er werd geuit op de Minuar en de Belgen . (...) Dat waren de eerste gegevens over wrijvingen tussen de Rwandese bevolking en de Minuar, waarvan ik toen kennis kreeg let wel, ik zeg wel degelijk de Minuar en niet de Belgen. Toen heb ik tevens ontdekt dat Radio Mille Collines ijverde voor de terugtrekking van de Minuar-troepen uit Kigali. (...) Toen ik daar was, waren ook minister Claes, minister Derycke en iets later minister Delcroix en oud-minister Wilfried Martens daar. Iedereen spreekt met iedereen. Als er al een duidelijk anti-Belgisch klimaat zou heersen, zouden deze personen dat toch zeggen. Niemand sprak hierover. (...) Een persoon als ambassadeur Swinnen gaat het toch niet in zijn hoofd halen van drie à vier ministers als je Martens erbij rekent naar Rwanda te roepen als daar inderdaad zo een anti-Belgisch klimaat heerst » (128b).
La participation de la Belgique à l'opération MINUAR a posé toute une série de problèmes opérationnels et logistiques. La plupart de ces problèmes sont apparus très tôt, c'est-à-dire dès le début de l'opération, immédiatement après le déploiement des troupes belges. La commission constate que, bien que ces problèmes aient généralement été signalés en temps voulu, et souvent même à plusieurs reprises, aux autorités militaires à Bruxelles et qu'en outre, deux rapports d'inspection aient été rédigés après une visite sur place (respectivement le 31 janvier 1994 par le major Guérin et le 25 février 1994 par le lieutenant-général Uytterhoeven), les problèmes eux-mêmes étaient restés en grande partie sans solution quand se produisirent les événements dramatiques des 6 et 7 avril 1994.
La commission donne ci-après un aperçu de ces problèmes logistiques et opérationnels les plus importants, en vérifiant chaque fois quand et comment ceux-ci ont été traités par les différents échelons de commandement de la MINUAR, ou par l'état-major général, notamment par son centre opérationnel d'Evere (C Ops.) et, le cas échéant, pourquoi les problèmes n'ont pas été résolus.
3.3.3.1. La demande de munitions supplémentaires
Presque tous les témoignages des officiers belges montrent qu'il n'a pas été possible de lancer, le 7 avril, une opération destinée à délivrer le groupe Lotin, notamment parce que les munitions lourdes faisaient défaut et aussi parce les CVRT dans la mesure où ils pouvaient être engagés ne disposaient pas des munitions adéquates. Le rapport Guérin du 31 janvier 1994 mentionne lui aussi explicitement la nécessité de disposer d'armes lourdes pour garder l'aéroport et procéder à une éventuelle évacuation vers celui-ci. Dans son rapport, Guérin affirme qu'« il serait souhaitable de prépositionner de toute urgence une dotation de munitions lourdes à KIBAT » (traduction).
La première question est de savoir qui a le pouvoir de décider de la dotation et du type de munitions destinées à la MINUAR.
Le colonel Marchal a demandé pour la première fois des munitions supplémentaires au C Ops à Evere le 15 janvier 1994 et il a envoyé une note au général Dallaire contenant cette même demande le 20 janvier; il a déclaré avoir reçu une réponse positive et l'avoir transmise à Bruxelles. Le 28 janvier, Marchal a réitéré sa demande urgente de munitions lourdes supplémentaires et y a ajouté une question très urgente relative à leur coût, sur la requête du Force Commander . Sur ce document figure, à côté du cachet du C Ops, le mot « urgent ». Le rapport du major Guérin du 31 janvier 1994 a confirmé que des munitions lourdes supplémentaires étaient nécessaires.
Néanmoins, le colonel Marchal a dû insister une nouvelle fois pour obtenir ces munitions, ce qu'il a fait dans une note du 14 mars. Il a demandé quels étaient les motifs qui faisaient obstacle à l'envoi de ces munitions et a demandé encore une fois de traiter le dossier des munitions « D'URGENCE ».
La première action effective du C Ops a consisté à envoyer, le 28 mars 1994, un fax adressé à la division logistique, dans lequel on donne l'ordre de fournir pour le 20 avril une quantité de munitions 30 mm au KIBAT II.
Pourquoi a-t-on traîné aussi longtemps à Evere avant de se décider à agir, alors que la demande avait été formulée par le commandant du secteur le 15 janvier et qu'elle ne sera exécutée que le 20 avril ?
Selon le lieutenant-général Charlier : « Je ne suis au courant des problèmes d'armement qu'à la mi-mars. Le 15 janvier, le colonel Marchal nous informe de son intention de commander des munitions à travers les procédures de l'O.N.U. L'O.N.U. doit être mise au courant, car Kigali est une zone de consignation des armes mais aussi parce que de son accord préalable dépend le remboursement du coût. Le 28 janvier, le colonel nous informe que le général Dallaire n'est pas opposé à cette demande mais veut en connaître le coût. Nous le lui communiquons. » (129b)
Néanmoins, une note du colonel Marchal du 22 avril 1997 montre que le chef d'état-major était informé bien avant cette date du problème des munitions : « Major Guérin m'a dit, à cette occasion, avoir donné le 7 février 1994 un briefing, à JS et GS et d'autres officiers, sur le contenu de son rapport. En ce qui concerne la problématique des munitions, toujours d'après le Major Guérin, JS aurait demandé à l'E.M.G. d'évaluer la possibilité militaire et politique d'envoyer les munitions demandées et aurait désigné le LtCol Briot comme pilote du dossier. » (130b) (131b)
De son côté, l'amiral Verhulst affirme que : « Dallaire s'y est opposé et a dit de faire la demande à New York. Le 28 janvier, le commandant envoie un fax au C Ops pour dire son intention de demander des munitions et pour s'informer sur leur coût. Ce n'est que le 14 mars qu'il s'inquiète de ne pas avoir reçu ces munitions, alors que pendant cet intervalle, les liaisons avec Kigali sont restées normales et qu'il y a eu les visites sur place du ministre des Affaires étrangères et du lieutenant-général Uytterhoeven. Le 15 mars, il est convenu par téléphone que le commandant de la force introduira la demande annoncée le 28 janvier. Le C Ops prescrit ce même jour de prendre la commande mais il n'y a aucune réaction des autorités sur place et aucune demande de New York ou de Kigali. Finalement, la commande est envoyée par le premier avion où il y a de la place, soit le 20 avril. Nous espérions qu'entre-temps, nous recevrions des instructions de New York. » (132b) Outre l'absence d'autorisation de New York, il souligne qu' « au C Ops, la demande a traîné sans doute suite à un problème interne de hiérarchie. » (133b)
Le lieutenant-colonel Briot signale également le problème de l'absence d'autorisation de la part de New York de fournir des armes. « L'état-major est prêt à fournir les munitions demandées et à donner les directives ad hoc c'est-à-dire, à l'intérieur des forces armées mais a demandé au commandant de secteur d'obtenir l'approbation du force commander, c'est-à-dire le général Dallaire » (134b) ... « Mes déclarations, et celles des autres officiers qui ont été entendus par cette commission, montrent que tout le monde est d'accord sur ce point : nous n'avons jamais été les destinataires de l'accord du général Dallaire . » (135b)
Cependant, l'argument selon lequel New York ne donnait pas ou n'aurait pas donné d'autorisation est réfuté premièrement par la déclaration du général Dallaire lui-même, qui nie que lui-même ou le quartier général de New York se soit opposé de quelque manière que ce soit à la fourniture de munitions supplémentaires demandées par le colonel Marchal « (...) the supply of ammunition, arms and other equipment is the responsability of the State contributing the contingent (...). The Force Commander directed Colonel Marchal to deal directly with Belgium on ammunition as the UN did not possess, nor could it likely obtain from other Governments the necessary arms and ammunition in a timely fashion . » (136b)
Le colonel Marchal est formel : « Le Force Commander avait donné son autorisation au mois de janvier. Question : Cette autorisation figure-t-elle dans le rapport du 15 janvier ? Non. Le fax du 15 janvier signale que je dois encore introduire la demande au Force commander. Cette demande je l'ai introduite à l'aide du document que j'ai sous les yeux, daté du 20 janvier. Quelques jours plus tard, le général Dallaire m'a répondu en apposant sur ce document la mention « d'accord ». Ce document, je l'ai transmis à Bruxelles, et je ne l'ai retrouvé nulle part, tout comme j'en ai d'ailleurs envoyé d'autres que je n'ai trouvé nulle part non plus. Ici, je n'ai pas indiqué de chiffres intentionnellement car j'estimais que le Force commander devait se prononcer sur un principe. J'ai également envoyé un document reprenant les quantités par type de munitions. C'est un document que j'ai envoyé et que je n'ai retrouvé nulle part non plus. Le Force commander avait donc donné son accord fin janvier, très rapidement après cette note du 20. Son principe était le suivant : c'est un problème national; si le pays veut renforcer le détachement au moyen de munitions, c'est son problème, et c'est à lui de veiller à l'acheminement des munitions . » (137b)
Deuxièmement, l'on finit quand même par décider d'envoyer les munitions sans l'autorisation de New York. Selon le lieutenant-général Charlier : « la demande des Nations unies n'étant jamais parvenue à l'état-major, j'ai fait envoyer les munitions sans l'attendre. Je trouvais que le petit jeu avait assez duré » , ce que le lieutenant-colonel Briot confirme : « Parce que le 15 mars, le colonel Marchal avait demandé : « Où restent mes munitions ? » C'est une décision du chef d'état-major qui estime que cela suffit et qu'il prend le risque de les envoyer » . (138b)
En outre, il s'avère que : « De plus, je voudrais signaler que le même cas s'est produit en Yougoslavie; sauf erreur de ma part, c'est avec Belbat-3, où on a envoyé des munitions sans autorisation de l'ONU. » (139b)
L'exemple suivant montre également que le C Ops fonctionnait mal. Début décembre 1993, 396 pièces de munition lourde ont été envoyées « discrètement » à Kigali. Selon l'amiral Verhulst, il s'agissait d'une erreur et il a décidé de les laisser sur place (140b). Par contre, le lieutenant-colonel Briot affirme que ces munitions ont été volontairement ajoutées pour la sécurité du détachement (141b). Dans un témoignage ultérieur, le lieutenant-colonel Briot concède néanmoins que le KIBAT ne disposait pas sur place des mortiers adéquats pour utiliser ces munitions (142b).
La commission constate qu'il y avait des problèmes graves dans le fonctionnement du C Ops, ce que confirment plusieurs officiers de l'état-major qui étaient adjoints au C Ops.
Le ministre de la Défense ou son cabinet étaient-ils au courant de ces problèmes au C Ops et du problème des munitions supplémentaires en particulier ?
En application de l'arrêté royal du 19 décembre 1989 portant organisation de l'état-major général, le chef de l'état-major général (JS) est le responsable final de la conduite des opérations y compris l'organisation du centre d'opérations, et il est par conséquent responsable de la question des munitions supplémentaires. Le lieutenant-général Charlier déclare : « En ce qui concerne les munitions, je répète la déclaration déjà faite sous serment que je n'ai été mis au courant des problèmes qu'à la mi-mars. L'état-major n'a donc pu en parler plus tôt au ministre . » (143b) Le ministre Delcroix affirme pour sa part très clairement : « Il n'appartient pas au ministre, qui n'est pas un spécialiste des problèmes de défense, de décider de l'équipement des troupes. Cette tâche incombe à l'état-major général . » (144b) Le général Schellemans confirme : « Le problème des munitions relève de la compétence de l'état-major et n'a jamais été posé au cabinet. » (145b)
3.3.3.2. L'armement insuffisant des hommes sur le terrain et la difficile distribution des armes et des munitions
La question peut être posée s'il est normal que le peloton qui faisait office de réserve et devait en outre accomplir constamment des missions d'escorte ait circulé sans MAG ? En vertu des règles d'engagement, en cas de légitime défense, on devait se limiter à tirer au coup par coup. Pour l'utilisation de mitrailleuses et d'armes plus lourdes, une autorisation de l'échelon supérieur était nécessaire. C'est pourquoi le colonel Dewez, le commandant de KIBAT II, donna pour instruction que les mitrailleuses MAG montées sur les jeeps soient orientées vers le haut et que l'on ait individuellement à portée de la main une arme (par exemple un FNC) permettant de tirer au coup par coup pour se défendre (146b). Le capitaine Lemaire, commandant de compagnie, interpréta l'instruction comme suit : « En ce qui concerne les MAG, l'ordre donné n'a jamais consisté à ne pas les prendre dans les véhicules mais bien de faire attention car il s'agit d'armes agressives et, dans la mesure où nous devions travailler de façon calme dans les checkpoints, il nous était demandé de ne pas les mettre en batterie sur les véhicules. Ce soir-là, je me souviens très bien avoir insisté auprès de ma compagnie sur le fait qu'il n'était pas question de laisser les MAG en arrière et qu'elles devaient partir avec les véhicules dans tous les déplacements effectués dans les camps où nous remplissions une mission; en cas de besoin, les MAG étaient sorties. Pour moi, c'était évident. » (147b)
Selon le capitaine Marchal, lui aussi commandant de compagnie, l'ordre du commandant de bataillon était « qu'il ne voulait plus voir de mitrailleuses ». Après protestation, au dire du capitaine Marchal, les commandants de compagnie interprétèrent l'ordre littéralement : on conservait les mitrailleuses dans les véhicules, mais de manière à ce qu'elles ne soient pas visibles (148b). Une autre interprétation de cette instruction a-t-elle été à l'origine du fait que Lotin n'avait pas ses MAG avec lui le jour en question ? Ou était-ce la conséquence de l'absence des affûts nécessaires, comme le suggère le rapport du groupe de travail ad hoc ? (149b). Le colonel Dewez confirme la dernière hypothèse au cours de sa confrontation avec le capitaine Theunissen : « Les mitrailleuses ne pouvaient pas être montées sur les affûts parce qu'il manquait une pièce. J'avais demandé aux compagnies de me donner cette pièce puisqu'elles en avaient et que les Mortiers n'en avaient pas. Donc, il y avait plus de problèmes pour eux pour monter les mitrailleuses sur les jeeps qu'il n'y en avait au peloton Mortier, qui avait reçu ces pièces. » (150b) Selon le capitaine Lemaire, commandant de compagnie, des affûts furent installés dès le début (151b). Quoi qu'il en soit, la question se pose de savoir pourquoi, dans la nuit du 6 au 7 avril, quand l'alerte rouge fut lancée, le colonel Dewez ne retira pas son ordre selon lequel les mitrailleuses ne pouvaient être visibles.
Et bien que l'alerte rouge eût été proclamée et que, dans la nuit du 6 au 7 avril, de plus en plus de barrages routiers aient été dressés, les FAR déployant des blindés légers au moins deux AML , l'ordre ne fut pas donné, ou personne ne demanda l'autorisation au quartier général, de distribuer aux hommes les roquettes antichars de courte portée (LAW) et les munitions de mortiers. Elles restèrent au centre logistique Rwandex. Selon le colonel Dewez, il était précisément impossible d'aller les y prendre en raison des barrages et, de plus, à ce moment, « il n'y avait pas de motif de distribuer ces LAW » (152b). Ce n'est que les 15 et 16 avril que les LAW furent distribués, selon le colonel Dewez, « Les LAW ont été distribués plus tard, en fonction de l'évolution de la situation. Nous ne voulions plus être confrontés à la même impuissance que quand, le 7 au matin, nous avons été sous la menace d'AML . » (153b)
Le colonel Marchal affirme qu'une procédure existait au sein du bataillon en vertu de laquelle tous les cantonnements devaient être autonomes pendant plusieurs jours, notamment pour ce qui est des munitions. Il déclare n'avoir donné pour sa part aucune directive concernant le calibre des munitions. « C'est le commandant du bataillon qui a estimé qu'il ne fallait pas utiliser les LAW. » (154b) Pourtant, selon un des commandants de peloton, le lieutenant Lecomte, le secteur intervenait en permanence dans la distribution des munitions (155b).
Ces problèmes ne se limitaient apparemment pas à la distribution des armes et des munitions lourdes. La commission note un certain nombre de plaintes en ce qui concerne également l'armement léger.
Selon le lieutenant Lecomte, « il y avait un manque crucial de munitions pour chaque soldat puisque nous n'avions que 120 coups pour notre carabine, alors qu'en Somalie nous en avions 200. En outre, il nous était interdit d'utiliser nos armes automatiques, ce qui nous empêchait de réagir efficacement en cas d'accrochage . » (156b)
Sur la question de savoir si, indépendamment des problèmes qui se posaient, il y avait suffisamment de munitions disponibles à Kigali, les avis ne sont pas unanimes. Le caporal-chef Pierard répond par l'affirmative à la question de savoir s'il y avait encore suffisamment d'armes et d'autre matériel militaire pour continuer à être opérationnel à Kigali (157b). En revanche, le major Choffray qui, durant l'opération MINUAR, était responsable en tant que S3 des opérations à KIBAT II, affirme : « le bataillon disposait d'un armement et d'un personnel qui étaient déjà tout juste au niveau d'une opération « Peacekeeping », mais ne disposait sûrement pas d'un personnel ni d'un matériel permettant de gérer une situation de crise » (158b).
La commission constate que le major Choffray n'a pas procédé, en tant que responsable des opérations au niveau du bataillon, à la distribution d'armes et de munitions supplémentaires. « On n'était pas encore dans une situation de crise et il n'y avait pas encore eu d'atteinte directe aux troupes de l'ONU » (159b), voilà le premier argument du major Choffray, qui est réfuté par la constatation que, dans la nuit du 6 au 7 avril, on a donné l'alerte rouge, ce qui montre bel et bien, selon la commission, que la situation était critique. « Nous y avons pensé », déclare le major Choffray, « il fallait pouvoir les acheminer vers les cantonnements ... Nous ne disposions pas de véhicules pour forcer les barrages (...) . » (160b)
À la question de savoir pourquoi l'on n'a pas utilisé les CVRT ou les BTR à RUTBAT, le major ne donne pas de réponse claire (161b). « Ce n'est pas la question d'utiliser, mais bien de distribuer. Ces LAW n'ont pas été distribués et sont restés centralisés à Rwandex pour les raisons que je vous ai dites. Il était de toute façon hors de question de les utiliser dans une pareille situation. Par ailleurs, nous avons reçu la mission de reprendre les missions, comme s'il n'y avait rien eu, le lendemain » (162b); ces propos constituent le deuxième argument du major Choffray. La commission constate toutefois que les règles d'engagement comportent des procédures relatives à l'utilisation des armes, mais aucune procédure relative à leur distribution. Plusieurs officiers ont d'ailleurs réclamé ces munitions un peu après 11 heures, comme la commission peut du moins le déduire du « Journal de campagne KIBAT » et du « Carnet de veille » (163b). Les munitions seront finalement quand même distribuées, comme le dit le major Choffray. « Il a été décidé de les distribuer dans le courant de la journée. Question : À quelle heure ? Je ne peux pas vous le dire exactement, mais sans doute à la fin de l'avant-midi, dans la journée du 7. (...) Il en a été question et on a étudié le problème de leur récupération, parce qu'ils étaient tous centralisés au même niveau. Il y a d'ailleurs des véhicules du secteur qui, après les différents contacts entre le bataillon et le secteur, sont passés par Rwandex pour en récupérer » (164b), déclare-t-il. Toutefois, le S3 lui-même n'était pas convaincu de l'utilité d'utiliser les LAW, puisqu'il déclare ce qui suit : « Dans un premier temps, je sais que ces LAW auraient servi à dissuader. D'autres moyens pouvaient être employés si on devait, dans un premier temps, utiliser les armes. Il y avait donc une gradation. Jusqu'alors nous n'avions pas encore utilisé le fusil individuel » (165b).
Pour que le présent rapport soit complet, la commission renvoie à l'évolution de la situation en matière d'armement et de munitions, qui a été dépeinte dans l'aperçu suivant, qui figure dans le rapport du lieutenant-général G. Vanhecke, chef d'état-major de la force aérienne :
A. Situation de départ
| Bataljons Bataillons |
Uitrusting Équipement |
Bewapening Armement |
Munitie Munitions |
| Belgisch bataljon Bataillon belge |
Lichte voertuigen Véhicules légers :
vrachtwagens camions jeeps jeeps 2 lichte helikopters 2 hélicoptères légers |
Per sectie Par section :
7 FNC 1 MAG 2 Minimi Per peletoncomdt Par Comdt peloton : 3 MILAN 1 Mor 60 mm 1 Mi.50 Bij het peleton Recce Au peloton Recce : 8 MAG Bij het stafbataljon A l'EM bataillon : 2 Mi.50 geen/pas de Mor 81 mm TOTAAL TOTAL : 18 MILAN afvuurinstallatieposten 18 postes de tir MILAN 10 mitrailleurs .50 10 mitrailleuses .50 LAW |
Geen munitie MILAN Pas de munitions MILAN
Geen munitie 30 mm Pas de munitions 30 mm Mortiermunitie bij vergissing geleverd Munitions mortiers livrées par erreur |
| 2 CVR-T Scimitar | 6 mortieren 60 mm 6 mortiers 60 mm | ||
| 4 CVR-T Spartans | 2 kanonnen 30 mm + MAG 2 canons 30 mm + MAG | ||
| MAG coaxen MAG co-axes |
B. Situation qualitative et évolution
Bataillon belge
| Data Dates |
Bron Source |
Toestand Situation |
|
| Eind dec 93. Fin déc. 93 |
Belgisch bataljon Bataillon belge | CVR-T voertuigen niet operationeel Véhicules CVR-T non opérationnels :
bemanning niet opgeleid équipages non formés 30 mm munitie niet aanwezig munitions 30 mm non présentes voertuigen en pantsertorens niet operationeel véhicules et tourelles non opérationnels |
|
| 15 jan. 94 | Kolonel Marchal Colonel Marchal | Verzoek aan FC om Mun + Kopie voor COps Demande au FC pour avoir des Mum + Copie pour COps
Antwoord Dallaire : verzoek richten tot UNNY Réponse Dallaire : introduire une demande à UNNY |
|
| 19 jan. 94 | Belgisch bataljon Bataillon belge | Verzoek voor het leveren van munitie C30 mm, MILAN-raketten en mortiermunitie Demande pour livrer les munitions C30 mm, les missiles MILAN et les munitions mortiers | Geen spoor bij COps Pas de traces au COps
Ingeschreven bij GS3 op 8 maart 1994 Inscrit chez GS3 à la date du 8 mars 1994 |
| 21 tot 28 jan. 94 21 au 28 jan. 94 |
Maj. Guérin | Verslag van het bezoek : verzoek om dringende levering van kanon 30 mm-munitie, MILAN-raketten en mortiermunitie Compte rendu de la visite : propose de livrer d'urgence les munitions canon 30 mm, les missiles MILAN et les munitions mortiers | Fiche Staf gericht tot JSO-P en GS3 op 31 januari 1994 Fiche EM adressé à JSO-P et à GS3 le 31 janvier 1994 |
| 28 jan. 94 | Kolonel Marchal Colonel Marchal | Vraag aan COps om kostprijs van munitie te kennen Demande au COps pour obtenir le coût des munitions | Deze nota schept verwarring. De kolonel vermeldt enkel de kosten Cette note introduit la confusion. Le colonel ne mentionne que les coûts |
| 31 jan. 94 | COps | Antwoord van kolonel Marchal Réponse du colonel Marchal | |
| 16 feb. 94 16 fév. 94 |
COps | Vraag naar toestand van CVR-T in het Belgisch bataljon Demande relative à la situation des CVR-T au bataillon belge | |
| 19 feb. 94 19 fév. 94 |
Bezoek GSX aan het Belgisch bataljon Visite GSX au bataillon belge | ||
| 22 feb. 94 22 fév. 94 |
Belgisch bataljon Bataillon belge |
Antwoord over operationele situatie van de CVR-T Réponse relative à la situation opérationnelle des CVR-T | |
| 9 maart 94 9 mars 94 |
Bezoek MLV aan Rwanda Visite MDN au Rwanda | ||
| 14 maart 94 14 mars 94 |
Kolonel Marchal Colonel Marchal | Verzoek om dringend munitie te leveren Demande pour livrer d'urgence les munitions | |
| 23 maart 94 23 mars 94 |
Einde opdracht van contactteam dat CVR-T moest herstellen Fin de la mission du contact team chargé de réparer les CVR-T | ||
| 28 maart 94 28 mars 94 |
COps | Bevel om munitie te leveren Ordre pour livrer les munitions | Leveringsprocedure was gestart na herstelling La procédure pour livrer les munitions n'à été entamée qu'à l'issue de la réparation |
| 1 april 94 1er avril 94 |
COps | Aankondiging aankomst munitie met vliegtuig van 20 april 1994 Annonce de l'arrivée des munitions avec l'avion du 20 avril 1994 | |
| 7 april 94 7 avril 94 |
Moord op de Belgische blauwhelmen Assassinat des Casques bleus belges | ||
| 10 april 94 10 avril 94 |
Installatie CVR-T-munitie in het raam van SILVER BACK Mise en place de munitions CVR-T dans le cadre de SILVER BACK |
Le rapport Van Hecke (166b) stipule à ce propos :
« Le mandat manquait de clarté et permettait différentes interprétations du type de munitions autorisées. Il ne semblait pas exclure les mortiers et les armes lourdes. Le contingent belge est parti en opérations doté d'un armement et d'un équipement légers à l'exception de six véhicules blindés légers de type CVR-T. Les armes antichars de type MILAN furent emportées sans les missiles, le but étant de disposer de moyens performants de vision nocturne. Les deux véhicules CVR-T SCIMITAR ne disposaient pas de munitions pour les canons 30 mm. Le 19 janvier 1994, le commandant de KIBAT a demandé les munitions lourdes. Ce besoin a été réitéré par le major Guérin fin janvier 94 et par le commandant du Secteur Kigali le 14 mars 1994. La procédure pour livrer les munitions n'a été entamée qu'à la suite de la réparation des CVR-T, soit le 23 mars 1994. Le 1 er avril, le Centre opérationnel de l'état-major général annonçait l'arrivée des munitions avec l'avion du 20 avril 1994. Lors des évènements, nos casques bleus ne disposaient que d'un armement léger. La majorité des munitions était stockée à RWANDEX. Seule une dotation minimale individuelle était distribuée aux militaires. Partie ou totalité du basic-load n'était pas répartie dans les différents cantonnements. Dans ces conditions, la réserve de KIBAT II ne pouvait être engagée. »
La commission constate toutefois que l'insuffisance des armes et des munitions ne constituait pas le seul problème. Le matériel transporté au Rwanda était généralement usé. Les véhicules UNIMOG étaient rouillés, l'équipement de transmissions était incomplet, etc.
3.3.3.3. Le mauvais état des CVRT
À Kigali, KIBAT disposait effectivement de 6 blindés légers du type CVRT, mais il ressort de la quasi-totalité des témoignages sur la question que ces véhicules n'étaient pas opérationnels, car ils étaient dans un état déplorable et on manquait d'équipages formés à leur utilisation et de munitions adaptées.
Le chef d'état-major de la force terrestre, le lieutenant-Général Behrin, dit également clairement les choses : « Quant aux véhicules, je vais faire un commentaire qui sera peu agréable pour les hommes politiques. La Belgique est le seul pays occidental qui envoie ses hommes en opération avec un matériel roulant âgé de plus de vingt ans ». ... « Les unités qui partent dans une mission ONU emmènent leur matériel une fois pour toutes. Car il est difficile d'en changer à cause des procédures lourdes dues à la prise en charge par l'ONU. Les véhicules utilisés sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire vétustes. Nous avons cherché à pallier leurs déficiences par des renforts en mécaniciens. » (167b)
Le rapport d'inspection du major Guérin, qui a été rédigé en janvier et a été examiné avec l'état-major le 7 février 1994, est lui aussi impitoyable à propos de l'état des CVRT : « Les véhicules sont très détériorés suite à la Somalie : suspensions grippées, corrosion, ... Le chargement des pièces de rechange dans des containers a été exécuté de façon hâtive et négligente : Mat fragile et coûteux écrasé, batteries retournées, ... Le Comd KIBAT a demandé au Det Jud d'ouvrir une enquête. » Dans le même rapport, le major affirme qu'il n'y a pas assez de spécialistes pour rendre ces véhicules opérationnels. Les MAG-COAX et les canons C 30 mm doivent être calibrés. Or, si les équipages sur place sont de bonne volonté, il leur est malheureusement impossible d'effectuer cette opération. En outre, selon lui, seulement trois CVRT sur six étaient en état de rouler. À la question de savoir quand il a su que trois CVRT sur six étaient hors d'usage, l'amiral Verhulst a répondu « Dès leur arrivée sur place » . (168b)
Il y avait pourtant possibilité, au sein du contingent, d'envoyer des chauffeurs et des canonniers spécialisés. L'amiral Verhulst a réagi à cette information en faisant la déclaration suivante : « C'est un reproche qu'on ne peut adresser au COps. La question pouvait se régler à un échelon inférieur. » (169b).
L'avis de l'amiral Verhulst sur les causes du mauvais état des véhicules est très clair : « Pour des raisons économiques, l'état-major de la force terrestre a proposé de faire transférer six véhicules de Somalie vers le Rwanda. Dix spécialistes ont été envoyés à Kismayio avec des pièces de rechange pour reconditionner les véhicules. Les blindés ont été transférés vers le Rwanda après réparation et essai sur route. Le rapport des spécialistes souligne que du point de vue de l'armement et des munitions, leur état était très bon. Comme ils n'ont pas été repeints, ils n'étaient pas beaux mais ils étaient opérationnels. Dès le 20 décembre, les logisticiens de la force terrestre ont demandé à la MINUAR ce qu'il était nécessaire de leur envoyer pour réparer les dégâts dus au transport. Il fallait une réponse avant le 21 janvier. Sept personnes sont parties le 21 janvier pour faire les réparations sur les véhicules du point de vue de la mobilité, et des spécialistes en armement sont partis pour effectuer des réglages autour du 21 février. Dès ce moment, ces véhicules étaient mobiles et aptes au tir. » (170b)
Le lieutenant-général Charlier, chef de l'état-major, n'avait pas conscience de ces problèmes non plus : « Les véhicules provenaient de Kismayo. Afin d'être certain de l'état des véhicules, le personnel qui les a reconditionnés devait les utiliser. Nous étions assurés ainsi que les véhicules étaient en ordre. Ce problème d'état des véhicules ne doit donc pas être pris en ligne de compte » (171b).
Alors que l'état-major et le C Ops à Evere étaient manifestement convaincus, depuis la fin février, que tout était pour le mieux en ce qui concerne les CVRT, les témoignages des officiers sur place contredisent cette conviction : Selon le major Choffray, « Les deux CVRT disponibles étaient effectivement à l'aéroport. On sait dans quel état ils étaient au niveau de l'équipage et de l'armement. Pour ces raisons, ils n'ont pas été utilisés » (172b) . Le colonel Marchal confirme : « Non, les CVRT n'étaient certainement pas dans le même état » (173b). Ils avaient un autre armement et d'autres munitions » (174b).
La question de savoir pourquoi l'état-major ou le C Ops n'ont pas complété le détachement avec des équipages spécialisés a été évoquée à plusieurs reprises au sein de la commission. Il y avait en effet juste assez de marge au sein du contingent pour envoyer ces hommes à Kigali.
Le lieutenant-colonel Briot réplique laconiquement à un commissaire, selon lequel il y a toujours une marge de 22 hommes supplémentaires, : « C'est un autre problème ». Le colonel Flament ajoute : « Dans mon rapport de reconnaissance, je disais également qu'il était indispensable je l'avais même souligné de prévoir un peloton de génie, que nous n'avons pas eu non plus » (175b).
La commission constate que ces véhicules chenillés étaient de type différent (quatre Spartans et deux Scimitars) et qu'ils n'étaient pas organisés comme une unité qui pouvait être engagée. Ces véhicules étaient destinés à transporter les autorités rwandaises et autres autorités et servaient plutôt de guérites blindées (176b). Les deux Scimitars ont été déployés à l'aéroport. Ils ne disposaient cependant pas de munitions. La commission constate en outre qu'on ne disposait pas de personnel entraîné, que les munitions adéquates faisaient défaut et que les véhicules étaient à peine en état de rouler.
3.3.3.4. Le nombre d'hommes et l'absence d'une réserve propre
La commission constate que l'envoi d'un contingent restreint, comptant 450 hommes au lieu de 600, a aussi des conséquences sur l'organisation d'une réserve propre, dans laquelle les CVRT peuvent jouer un rôle.
D'autre part, le colonel Marchal s'est rendu compte qu'avec un contingent de 450 hommes, il ne pouvait pas compter sur une réserve capable d'intervenir au niveau du secteur Kigali, en attendant l'arrivée de la QRF bangladaise. De là sa demande au C Ops de fournir des véhicules blindés supplémentaires, avec équipages.
Le colonel Marchal : « J'ai adressé ma demande au C Ops et je n'ai pas eu de réponse. Le 8 décembre, me rendant compte que la QRF ne serait pas là avant un ou deux mois, j'ai demandé des blindés pour constituer une réserve. Comme c'était en vain, je me suis senti abandonné et livré à moi-même. Cela m'inquiétait car il était important pour le bataillon de savoir qu'il allait disposer des munitions nécessaires. On pourrait effectivement penser que ma situation n'était pas concevable mais les documents en votre possession prouvent ma bonne foi. Le général Dallaire était d'ailleurs d'accord pour demander des blindés et des munitions car il estimait que tout renforcement était un plus. » (177b)
Le lieutenant-colonel Briot a confirmé l'existence d'un document dans lequel le colonel Marchal demandait à la Belgique de consentir un effort pour fournir des blindés et des troupes. Le lieutenant-colonel Briot a déclaré à cet égard : « Nous avons analysé sa demande. Nous avions le matériel et, bien sûr, le personnel instructeur . » (178b) Et le lieutenant-colonel Briot de poursuivre en déclarant qu'il a analysé la demande et a transmis son avis à son chef, le colonel Flament. Celui-ci ne s'en souvient toutefois pas, mais tous deux supposent que cette information a dû remonter vers le chef d'état-major. En ce qui concerne la réaction du chef d'état-major, le lieutenant-colonel Briot a déclaré : « Il s'agit d'une des conclusions de l'analyse menée. Nous avons les moyens techniques pour le faire, nous avons le personnel mais une limitation gouvernementale nous fixe un quota de 450 et, avec ce quota, nous ne pouvons pas le faire. » (179b)
C'est ce qu'a confirmé l'amiral Verhulst : « Dans le premier projet, celui dans lequel il était prévu d'envoyer 600 hommes, il avait aussi été prévu de les doter de 22 véhicules CVRT. Cette option n'a pas été reprise dans le plan prévoyant 450 hommes. Le général Dallaire était opposé à l'utilisation de véhicules blindés à chenilles. Ces véhicules ont, en effet, une apparence agressive et le général Dallaire ne voulait pas susciter de réactions négatives de la population alors que Kigali semblait vivre normalement. » (180b)
Cependant, la commission constate que l'ordre de bataille de KIBAT II n'a jamais compté 450 hommes. Le détachement belge auprès de la MINUAR a toujours compté entre 400 et 428 hommes au maximum, ce qui laissait une marge numérique de 22 hommes supplémentaires. La commission constate que le C Ops et l'état-major général d'Evere n'ont jamais fait état de la possibilité d'envoyer 22 militaires spécialisés pour équiper et entretenir les véhicules blindés.
Dans son témoignage du 28 mars 1997, le chef d'état-major Charlier a dit comprendre le problème de la réserve propre : « L'équipement dépend de l'effectif. Des CVRT ne suffisent pas pour renforcer la force mobile. Il faut aussi des équipages de pilotage des CVRT. Au Rwanda, nous avions juste de quoi occuper le terrain. Mon idée était de retirer, lors de la relève, une compagnie de fusiliers et de la remplacer par du personnel pour des opérations mobiles sur des véhicules blindés . » (181b)
Un mois plus tard, le chef d'état-major Charlier allait toutefois répondre à la question de savoir pourquoi cela ne s'était pas fait : « Cela aurait pu être fait, mais cela n'a pas été demandé par la Force . » (182b)
La demande du colonel Marchal du 8 décembre n'est-elle pas, en fin de compte, parvenue au chef d'état-major par l'entremise du lieutenant-colonel Briot et du colonel Flament ? Il est, en outre, étonnant que l'amiral Verhulst affirme avoir lui-même demandé l'autorisation au général Dallaire d'acheminer une réserve de véhicules blindés, alors qu'il affirme, par ailleurs, ne pas être en mesure de confirmer la demande du colonel Marchal (183b).
La commission constate néanmoins que, même avec les moyens particulièrement limités mis à sa disposition, KIBAT a constitué une réserve propre. Il s'agissait précisément du peloton Mortiers auquel appartenait le groupe Lotin, qui constituait la réserve du bataillon et qui devait assurer trois escortes permanentes (184b). Les événements du 7 avril allaient montrer que combiner des missions d'escorte de personnalités rwandaises et la constitution d'une réserve n'était pas une solution crédible.
Le rapport Van Hecke le confirme : « Au moment des événements, le bataillon belge ne disposait pas d'une réserve crédible. » (185b)
3.3.3.5. Absence d'une QRF opérationnelle et crédible
Comme son nom l'indique, la QRF (Quick Reaction Force) est une force d'intervention rapide qui devait être mobilisable sur l'ensemble du territoire Rwandais et se trouvait sous l'ordre direct du général Dallaire (186b). Au sein de la MINUAR, la QRF consistait en une compagnie (80 hommes) des forces armées bangladaises et était fournie par RUTBAT. Cette QRF disposait de 8 BTR, véhicules de transport sur roues, blindés et armés de mitrailleuses pour l'infanterie, de fabrication d'Europe de l'Est, provenant d'opérations antérieures en Mozambique.
Il ressort de quasi tous les témoignages que la QRF était confrontée à des problèmes tels qu'elle ne pouvait, à aucun moment, constituer une force capable de réagir rapidement et de manière efficace.
Dès leur arrivée le 4 décembre 1993, le colonel Marchal et le lieutenant-colonel De Loecker constatent les carences qu'avait déjà mises en évidence un mois plus tôt le lieutenant-colonel Kesteloot, membre de la mission de reconnaissance. « Question : Wanneer bent u in Kigali toegekomen, kolonel ? Op 4 december 1993, samen met de andere detachementen. ... De QRF moest een zeer mobiele eenheid worden, maar dat was precies een probleem bij de Bengalen. Op het ogenblik van hun aanduiding beschikten zij over geen enkel vervoermiddel. De voertuigen voor de QRF waren toen nog niet aanwezig. Men heeft moeten wachten tot begin februari om de opleiding van die eenheid te starten. Dat was op 7 februari. » (187b)
Cette arrivée tardive des véhicules nécessaires ne constitue pas la seule déficience. Aux dires de plusieurs témoins, il était extrêmement difficile de traiter avec les officiers et les hommes bangladais. Le colonel Marchal témoigne : « Le commandant du bataillon n'est arrivé que fin janvier et il avait donné instruction de ne pas exécuter d'ordres avant qu'il ne soit présent. J'ai néanmoins fait travailler les Bangladais mais ils l'ont fait avec des pieds de plomb. » (188b)
Le lieutenant-colonel De Loecker, qui était chargé de l'entraînement des soldats bangladais de la QRF, le confirme : « Bovendien was de stafchef van ons hoofdkwartier een Bengaal die, om het zacht uit te drukken, er helemaal niet van hield dat ik ter plaatse naar zijn landgenoten ging kijken. Hij gaf er de voorkeur aan dat ik op het hoofdkwartier bleef, op mijn stoel achter de telefoon bleef zitten en dat ik van daaruit de opleiding controleerde. » (189b)
Il ressort cependant de tous les témoignages que ces soldats bangladais ne pouvaient que bénéficier de l'entraînement qui leur étaient offert. Et le lieutenant-colonel De Loecker de déclarer : « Na 14 dagen opleiding was er al een achterstand van 13 dagen. Het eerste probleem was dat de chauffeurs die voertuigen niet konden besturen. Nochtans hadden zij ons verzekerd dat er zeer ervaren tankchauffeurs zouden overkomen, zodat ik erop vertrouwde dat wij na een dag reeds de baan op zouden kunnen. » (190b) Le colonel Marchal est lui aussi conscient de cet état de choses : « ... il n'y avait pas de mécaniciens et les chauffeurs devaient être formés. Il y avait donc des lacunes évidentes du côté bangladais. » (191b)
Même le général Dallaire, le « Force Commander », convient que : « there simply was no credible military force within UNAMIR which could on the short notice required by the situation gather a sizable intervention force. » (192b)
Après la constatation que le personnel bangladais était non opérationnel, se pose au sein du contingent bangladais le problème du manque de véhicules, lesquels présentaient en outre de sérieuses déficiences. Le colonel Marchal déclare : « Cette force devait pouvoir intervenir n'importe où au Rwanda, mais la fiabilité des véhicules laissait à désirer. » (193b)
Le général Dallaire est très clair en la matière : « The original plan had called for 20 APC's and 8 helicopters in order to allow for a company strenght Quick Reaction capability ... By the date of the incident, only 8 APC's had been provided of which just 5 were serviceable. » (194b) ... « The APC's had arrived in late Februari/early March without tools, spare parts, mechanics, manuals and with limited ammunition. The main weapon on the APC's had never been test fired in Rwanda... The equipment limitations and their proficiency in using such systems was still below operational standards ». (195b)
La commission constate qu'en raison de tous ces problèmes, la QRF bangladaise n'était pas du tout opérationnelle et était tout à fait dénuée de crédibilité dans le cadre de la MINUAR. Ce qui s'est passé le matin du 7 avril est encore la meilleure illustration de la « valeur » de la QRF et de son influence au moment du dérapage de la situation. À 8.50 heures, les trois BTR de RUTBAT ont essayé de franchir un barrage. Ces trois BTR constituaient alors 60% des véhicules de la QRF. Le barrage était doté d'armes antichars. Ils informèrent le colonel Marchal qu'ils étaient bloqués. Ayant vainement négocié le passage, et après que les Rwandais eurent menacé d'utiliser leurs armes antichars, ils firent demi-tour. À compter de ce moment, il était évident pour le colonel Marchal que la MINUAR ne disposait plus de sa liberté d'action. Le colonel Marchal ajoute : « Non, les CVRT n'étaient certainement pas dans le même état. Ils avaient un autre armement et d'autres munitions. Question : Si vous les aviez eus, cela aurait tout changé ? Il est clair qu'en tant que responsable militaire, connaissant la valeur de l'élément bangladeshi, je n'aurais jamais demandé à ces gens de foncer et de faire sauter le barrage. D'ailleurs, le commandant de bataillon exigeait des ordres écrits de ma part pour faire bouger ces gens. Telle était la procédure. Il est clair que quand vous pouvez engager ce genre d'objectif avec un canon de 35 ou 30 mm, les choses sont en effet tout a fait différentes. Et cela, vous pouvez le faire de loin. » (196b)
Les officiers de la MINUAR ont-ils entrepris des actions pour répondre à cette déficience importante ?
Le lieutenant-colonel De Loecker, qui avait le plus de contacts avec le détachement de la QRF, déclare qu'il a maintes fois abordé le problème : « Ik heb dat uiteraard gemeld. Iedereen werd op de hoogte gebracht, tot en met generaal Dallaire zelf. ... Ik meld de informatie en wat de staf ermee doet is niet mijn taak, andere mensen moeten dit nader bekijken en een oplossing zoeken. Ik heb het probleem verschillende malen gemeld. Elke dag was er 's morgens een coördinatievergadering op het hoofdkwartier en daar kwam het verloop van de opleiding van de QRF regelmatig ter sprake. ... Ik weet niet wat mijn oversten met mijn informatie deden. Ik meen mij te herinneren dat er regelmatig nota's naar Brussel werden gezonden waarin men om bijkomende middelen vroeg. Die vraag bleef voor zover ik mij kan herinneren, zonder respons. » (197b)
Le colonel Marchal alerte alors le général Dallaire : « L'autre mesure a consisté à expliquer au général Dallaire que je ne pouvais faire face à mes missions; je lui ai suggéré d'envisager la possibilité de demander le remplacement du Bengladesh par un autre pays. Question : À quelle époque a eu lieu ce débat entre M. Dallaire et vous à ce sujet ? Le 3 avril, après son retour de congé ... Donc, fin mars-début avril. Il m'a demandé de rédiger un document pour pouvoir réagir. J'ai donc rédigé un document à l'intention du général Dallaire, en décrivant toutes les limitations techniques et opérationnelles du bataillon bengladeshi. » (198b)
Il ressort des témoignages du colonel Flament et du lieutenant-colonel Briot que ces messages sont bel et bien arrivés à Evere. Lorsqu'un commissaire demande au colonel Flament à quel moment il a constaté, étant au C Ops, que la QRF n'était pas opérationnelle, il répond : « Au fil des semaines. ... C'était le problème du général Dallaire. » (199b) Le lieutenant-colonel Briot confirme les propos de son collègue : « Ce sont les Nations unies qui désignent le Bengladesh suivant des procédures bien connues d'après l'évolution géographique et les influences. Celui-ci a accepté de fournir le personnel mais n'avait pas les véhicules. Les Nations unies ont fait appel à différents pays pour trouver ces véhicules et le personnel de formation. » (200b) ... « L'état-major général a rapidement été conscient de la non-existence de la QRF. Le colonel Marchal, par un fax, nous a dit qu'il faudrait plus ou moins deux mois pour rendre les Bangladais opérationnels. Nous étions donc au courant. L'ONU devait trouver, en fonction de critères d'équilibre, les pays qui fourniraient des véhicules. Elle a fait appel à différents pays tant pour les véhicules que pour le personnel. » (201b)
Le C Ops n'était pas le seul à être au courant du problème. Les départements concernés en avaient également connaissance. L'incompétence du contingent bangladais fait l'objet d'une discussion au cours de deux réunions de coordination du Ministère des Affaires étrangères et du Ministère de la Défense nationale, auxquelles un représentant du Premier ministre était présent. Le déploiement du contingent autrichien est discuté plusieurs fois.
L'on a déployé les efforts nécessaires pour convaincre les Autrichiens, comme le montre le rapport concernant la visite que le ministre Delcroix a rendue le 18 février 1994 à son collègue autrichien de la Défense. Même après le 13 janvier, l'on a tenté d'amener l'Autriche à fournir rapidement une force de 150 à 200 hommes. Cependant, la commission constate que le but était de réduire proportionnellement le nombre de soldats belges, ce qui fait qu'il n'était pas question d'un deuxième contingent crédible.
La commission constate que toutes les autorités, tant militaires que politiques, tant en Belgique qu'aux Nations unies, étaient au courant de l'absence d'une QRF opérationnelle. La commission constate également qu'un certain nombre d'initiatives, tant militaires que politiques, ont été prises, mais qu'elles n'ont pas eu de résultat.
3.3.3.6. Les difficultés avec les autres contingents étrangers
« It will also be recalled, as stated in my report of 24 September 1993, that the projected strength of UNAMIR military personnel was to stand at 1,428 by the end of phase I and to reach a peak, at the end of phase II, with a total of 2,548 all ranks. As of 22 March 1994, UNAMIR had a strength of 2,539 military personnel, from the following 24 nations : Austria (15), Bangladesh (942), Belgium (440), Botswana (9), Brazil (13), Canada (2), Congo (26), Egypt (10), Fiji (1), Ghana (843), Hungary (4), Malawi (5), Mali (10), Netherlands (9), Nigeria (15), Poland (5), Romania (5), russian Federation (15), Senegal (35), Slovakia (5), Togo (15), Tunisia (61), Uruguay (25) and Zimbabwe (29). These figures include the 81 military observers serving with the United Nations Observer Mission Uganda-Rwanda (UNOMUR). » (202b)
Il ressort de divers témoignages que le malaise au sein de la QRF reflétait celui de l'ensemble du contingent RUTBAT, et même celui des autres détachements étrangers.
Le chef de l'état-major, le lieutenant-général Charlier, a déclaré au sujet de RUTBAT : « On s'est très rapidement aperçu que les militaires du Bangladesh n'étaient pas en mesure d'assurer leur mission. Cela allait jusqu'au refus d'obtempérer. C'est pourquoi nous avons envisagé d'obtenir un renforcement de KIBAT. À l'époque, mon opinion était qu'il fallait obtenir les renforts autrichiens ou se retirer. Les discussions se sont éternisées. » (203b) L'amiral Verhulst a souscrit à ce point de vue : « C'est donc dans l'action que nous avons constaté que les Bangladais refusaient d'obéir aux ordres. Nous estimons donc qu'il est nécessaire d'avoir l'appui d'une autre nation disposant de troupes équipées et bien entraînées pour ce genre d'opérations. » (204b)
Le problème des Ghanéens était d'un tout autre ordre. Le contingent ghanéen était composé d'hommes bien entraînés, mais ils n'étaient pas en possession du matériel requis.
Quant aux autres contingents étrangers, on peut lire à ce sujet le témoignage inquiétant du général Dallaire : « In addition the Bangladeshi battalion was under-equipped, the Ghana Battalion deployed into the country in January and February without their equipment which was yet to transit by sea. The 60 man Tunisian Company, which was a well-led, trained and disciplined force, possessed no integral vehicles, communication equipment or logistics capability. Medical, logistics and engineering assets were similarly poorly equipped and supplied. » (205b)
Le colonel Marchal a témoigné devant la commission qu'il en avait parlé avec le général Dallaire, mais que « Il était assez délicat de solliciter le remplacement des Bengladeshis pour incompétence alors qu'à cette époque le Bengladesh avait mis 15 000 Casques bleus au service de l'ONU. Le Conseil de sécurité n'aurait certainement pas accepté, puisque c'était un fournisseur de troupes. » (206b)
L'état-major à Evere a été mis au courant de la situation désastreuse d'une partie de nos partenaires militaires au Rwanda dès le 31 décembre 1993, au moyen d'une note du SGR : « Toutes les troupes (...) qui font partie de cette mission ONU sont arrivées, mais pour la plupart elles sont très mal organisées, hormis les Belges (...). Les détachements des autres nations sont très mal équipés; ils ne sont pas opérationnels, certaines troupes sont venues presque sans armements ! » (207b)
Le colonel Marchal répète ce constat dans un rapport qu'il fait parvenir le 28 janvier 1994 au C Ops à Evere : « Je dois reconnaître que notre partenaire au sein du secteur Kigali n'est pas fiable. » (208b)
La commission constate qu'en Belgique et au sein des Nations Unies, les autorités militaires et politiques étaient informées du caractère non opérationnel de plusieurs contingents étrangers. Le détachement bangladais (RUTBAT) avait reçu une mauvaise formation et, en outre, il était réticent à se soumettre aux ordres des supérieurs hiérarchiques de la MINUAR. Les autres détachements étrangers étaient fiables quant à eux, mais ils ne disposaient généralement pas des véhicules, des moyens de communication et du soutien logistique nécessaires pour pouvoir être opérationnels.
3.3.3.7. La dispersion des cantonnements
Au cours de la mission de la MINUAR, la situation des cantonnements du KIBAT II est restée inchangée. Les troupes belges étaient réparties entre 14 cantonnements, dont certains ne disposaient que d'une section ou d'une équipe de quelques militaires.
Une série de témoignages montrent que cette forte dispersion a eu des répercussions sur la possibilité d'engager les troupes, sur la sécurité, et sur la constitution d'une réserve propre au détachement belge.
Pourtant, et le colonel Leroy (KIBAT I) et le colonel Dewez (KIBAT II) ont insisté auprès du général Dallaire pour que l'on réduise le nombre de cantonnements et que l'on regroupe les troupes belges. Le capitaine Theunissen en témoigne comme suit : « En ce qui concerne le regroupement des cantonnements, avant le départ de la mission, ici en Belgique, on a reçu un briefing général de la MINUAR. Je lis : « localisation des cantonnements : actuel 1 para très dispersé - projet 2-CODO il s'agit du colonel Dewez « centralisation des cantonnements : un par groupe » il y avait trois groupes, une compagnie c'est un groupe, « un groupe en ville, avec deux cantonnements, un cantonnement à l'aérodrome et un cantonnement à « Don Bosco » cela c'est la quatorzième compagnie. Telle était donc l'idée du colonel. Mais je sais qu'il a subi des pressions pour conserver la dispersion parce qu'il fallait une présence en ville. Question : de la part de qui a-t-il subi des pressions ? ... C'était probablement Dallaire ». (209b)
L'amiral Verhulst confirme l'existence de divergences de vues entre l'état-major général à Evere et le Force Commander en ces termes : « L'état-major général voulait le plus possible réduire les cantonnements. Le général Dallaire, quant à lui, souhaitait disperser les troupes dans la ville afin de favoriser l'information et les contacts avec la population » (210b).
Dans son rapport d'inspection, le lieutenant-général Uytterhoeven signale que, pour diverses raisons, la dispersion des cantonnements participait d'une décision logique : « en ville + de l'hygiène + durée de la mission + saison des pluies + disponibilité de bâtiments en dur (hangars et maisons) ». Le lieutenant-général Uytterhoeven a affirmé que la dispersion des cantonnements était également inspirée par le souci d'assurer la sécurité des compatriotes : « Il fallait également tenir compte du fait qu'une éventuelle évacuation nous obligeait à pénétrer dans la ville. Le cantonnement d'un peloton dans la ville procurait d'une part un sentiment de plus grande sécurité et pouvait d'autre part faciliter une éventuelle évacuation. » (211b). Le général confirme par ailleurs que le Force Commander approuvait cette décision (212b).
Ce sont les militaires belges sur le terrain qui ont constaté quotidiennement que cette forte dispersion limitait sensiblement leurs possibilités d'action militaires. Deux commandants de compagnie en témoignent.
Voici ce qu'en dit le capitaine Marchal : « Il suffit de voir la manière dont le bataillon était réparti dans Kigali pour comprendre que les principes de l'art militaire n'étaient pas respectés ». (213b)
Voici l'avis du capitaine Lemaire : « Or , moi, quand je suis venu en janvier, la première chose qui m'a effrayé je pense que nous étions tous dans le même cas au 2-CODO était la dispersion du bataillon dans la ville. D'ailleurs, c'est un des éléments qui fera que d'office, au départ, le bataillon était inopérationnel, parce que nous étions chaque fois en position de faiblesse par rapport à un ennemi éventuel, puisque nous étions fractionnés. Quand nous avons discuté sur place du problème de la dispersion, on nous a bien sûr expliqué les problèmes de location au niveau ONU, mais on nous a parlé également d'un problème de confort, en disant qu'en Afrique, il faut du confort. Il est évident que pour nous, la priorité c'était d'abord la sécurité ». (214b)
Le S3 du KIBAT, le major Choffray, confirme les choses en ces termes : « La situation eût été plus facile, si nous avions été centralisés. ... L'intervention de KIBAT pour mener une opération n'était pas réalisable. Les cantonnements étaient trop dispersés, mal protégés et vulnérables ». (215b)
Le lieutenant-colonel Leroy déclare qu'en cas de troubles majeurs, il fallait 75 hommes pour garder les cantonnements : « En cas de manifestation, une partie des hommes affectés aux activités logistiques abandonnent celles-ci pour faire la garde des cantonnements. En cas de troubles majeurs, ce sont les 75 personnes de la logistique qui interviennent. » (216b)
Le colonel Dewez impute l'absence de réserve notamment à la dispersion importante des cantonnements : « Les cantonnements étant relativement dispersés, le peloton de réserve n'était pas entièrement disponible, puisqu'il fallait toujours laisser des sentinelles pour la protection du camp ». (217b)
Les signaux relatifs à ce problème ont-ils atteint le C Ops et l'état-major général à Evere et, si oui, quelles mesures a-t-on prises ?
Le 3 décembre 1993, le commandant du KIBAT I, le colonel Leroy, a envoyé une note au C Ops à Evere dans laquelle il proposait, pour des raisons de sécurité, de réduire le nombre de cantonnements à 5. Sur ce, le C Ops a envoyé, le 6 décembre 1993, un rapport à l'état-major général (JSO-P), dans lequel il affirmait qu'il n'y voyait aucune objection (218b).
Le 19 décembre, le colonel Marchal a adressé un rapport au C Ops, dans lequel il mentionnait que les problèmes relatifs aux cantonnements n'étaient toujours pas résolus (219b).
Le 31 décembre, une information du SGR signalait que l'un des problèmes principaux auxquels les casques bleus belges étaient confrontés était celui du logement (220b).
Le rapport du major Guérin du 31 janvier 1994 traite de manière approfondie le problème des cantonnements. Son jugement est sévère et ses recommandations à l'état-major général sont très claires : « Par volonté du Comd Force et par manque de logements gratuits, le Bn a réparti ses moyens entre 14 Cant, certains n'étant occupés que par une Sec ou une Eq (Heli, CVR-T, Med). Sur le plan de la sécurité, cette dispersion est dangereuse en cas de troubles. Les unités isolées pourraient se retrouver otages de l'un ou l'autre parti.
Le Comd KIBAT II a l'intention de regrouper ses moyens par Cant de Cie. Vu les frais de location et la rareté des habitations disponibles, il serait souhaitable d'importer ou de construire des containers. Les moyens locaux (ATS Don Bosco, menuiseries locales) permettraient une construction sur place par de la main-d'oeuvre locale. Une étude détaillée des besoins sera fournie par le Comd KIBAT II lors de sa visite du 3 février 1994 à JSO-P.
Quelle que soit la solution choisie, il est URGENT de fournir au Pl qui campe sur l'aéroport des moyens pour améliorer la salubrité de son Cant :
1. SIX grandes tentes pour remplacer les tentes FR actuelles
2. Aérosol anti-moustiques à pulvériser par Heli AIII sur les marécages avoisinants. »
Une série de rapports du C Ops qui datent de la période allant du 3 février au 24 mars 1994 ont montré que l'on préférait placer une série de cantonnements dans des modules à construire soi-même (Kigalodge). L'objectif était de ramener le nombre de cantonnements de 14 à 10. Le 24 mars, le plan Kigalodge a été communiqué. Cependant, le lieutenant colonel Leroy a constaté, dans un rapport du 30 mars 1994 qu'il a adressé à l'état-major général, que les militaires belges étaient toujours confrontés à d'énormes problèmes de logement. Kigalodge ne sera finalement jamais construit (221b).
Les autorités politiques étaient-elles informées du problème des cantonnements et des conséquences de celui-ci sur la sécurité de nos troupes et sur la possibilité de les engager ?
Le chef d'état-major Charlier confirme que le problème a été abordé avec le cabinet du ministre de la Défense : « Le colonel Marchal m'en a parlé au début du mois de décembre. Il m'a dit qu'il pouvait résoudre le problème du logement s'il obtenait un budget. J'ai répondu qu'il l'obtiendrait et j'en ai prévenu le cabinet du ministre. Il a reçu l'argent. Quelques jours plus tard, il m'a retéléphoné et je lui ai dit de procéder aux locations. Il a reçu l'assurance qu'il aurait l'argent durant la première semaine de décembre. Il avait estimé le besoin à 5 millions de francs belges ». (222b)
La Défense nationale s'est déclarée d'accord pour octroyer plus d'argent pour un meilleur logement.
La commission constate que, dès décembre 1993, les autorités militaires de l'ONU et la Belgique étaient informées du problème de logement des Casques bleus belges et ont rassuré les autorités civiles. Ce n'est que quatre mois plus tard, le 24 mars 1994, que l'état-major général parvient à communiquer un calendrier pour la construction de Kigalodge. Au moment où la crise éclate, le KIBAT est toujours dispersé entre 14 cantonnements et cette dispersion sera l'un des facteurs déterminants de l'absence d'intervention.
3.3.3.8. La mise au point laborieuse du plan d'évacuation et l'absence de scénario catastrophe
La commission fait quatre constatations importantes concernant ce problème. D'abord, l'absence de plan d'évacuation opérationnel, avant mars 1994, ce plan n'a toutefois pas été finalisé au niveau de KIBAT. Puis le fait que KIBAT et ses différentes compagnies n'étaient absolument pas préparés à un scénario de crise. Ajoutons-y une grande confusion quant aux éventuels groupes cibles d'un plan d'évacuation et, enfin, les mauvaises communications sur ce plan entre Kigali et l'état-major général d'Evere.
Le colonel Balis a été chargé par le général Dallaire de dresser un plan d'évacuation, bien qu'en fait, cela relevât selon lui de la compétence du collègue bangladais. Cette mission lui a été confiée à la mi-février 1994. « Pas nadat ik samen met de h. Booh Booh naar Mulindi geweest ben, kreeg ik de nodige inlichtingen en stelde ik het evacuatieplan op. Het is dus onrechtstreeks mijn verantwoordelijkheid geworden. Ik vatte het plan op als een zeer klassiek militair manoeuver in verschillende fasen. De eerste fase bestond in het verzamelen van de vreemdelingen in de verschillende provinciehoofdsteden, ze naar Kigali te brengen en vervolgens de militairen met een systeem van inkrimpende perimeters naar de luchthaven te brengen en ze uit Rwanda te verwijderen.
De dringende reden voor het evacuatieplan was het feit dat ik op 4 of 5 maart met de h. Booh Booh, die de plaatselijke politiek verantwoordelijke was van UNAMIR, naar een vergadering ben geweest in Mulindi. » (223b)
Ce plan ne partait toutefois pas d'un scénario catastrophe, ce qui se révélera ultérieurement être sa plus grande faiblesse : « Onze basishypothese was wel dat wij niet in een vijandelijk milieu zouden opereren. We verwachtten niet dat men ons zou viseren, maar dat UNAMIR zich zou kunnen terugtrekken in een neutrale of beter gezegd semi-neutrale sfeer » (224b).
La principale critique relative au plan émane du commandant de secteur, le colonel Marchal, qui a quand même une certaine expérience de l'Afrique et qui dit, sur un ton très tranchant : « J'ai l'expérience pour les évacuations. En 1978, j'ai déjà opéré à Kolwezi. Le général Dallaire n'avait aucune expérience en la matière. Le 1 er avril, nous avons « briefé » la communauté des expatriés, non seulement les Belges mais également les autres. Les Français voulaient être certains que le plan d'évacuation leur convenait. Après discussion et légère adaptation, ils ont marqué leur accord sur ce plan » (225b). Un commissaire lui ayant demandé si ce plan avait finalement été mis à exécution, il répond laconiquement « non ».
Il ressort de différents témoignages que ce plan d'évacuation n'existait que sur papier, mais qu'il n'a jamais atteint les commandants de compagnie sous la forme d'un ordre opérationnel. Le capitaine Theunissen affirme qu'au niveau de la compagnie, rien n'était prévu concernant un plan d'évacuation de la MINUAR (226b).
Le chef des opérations de KIBAT, le major Choffray, confirme également qu'il n'existait pas de plan de regroupement et que KIBAT II ne s'est jamais exercé au regroupement des effectifs en cas de difficultés » (227b).
La commission constate qu'il s'est produit à propos de ce plan d'évacuation de sérieuses difficultés de communication entre le commandant de secteur, le colonel Marchal, et le commandant de bataillon, le colonel Dewez. En réponse à la question répétée de la commission quant à savoir pourquoi ce plan d'évacuation n'avait jamais été finalisé à l'échelon des bataillons, nous notons les témoignages suivants. L'amiral Verhulst : « Je ne peux pas répondre à votre question. C'est le colonel Marchal qui était responsable de la diffusion de l'information sur le plan d'évacuation. Posez-lui la question » (228b). Le colonel Balis s'étonne, lui aussi, de ce manque de communication : « Daaruit kan ik alleen afleiden dat het plan dat naar mijn weten is gestuurd naar de verschillende ondergeschikten van het hoofdkwartier van UNAMIR namelijk voor de sector Kigali naar kolonel Marchal, naar de sector DMZ of de gedemilitariseerde zone waar een Ghanese kolonel de chef was en naar de sector UNMO; die zich uitstrekte over gans Rwanda wel degelijk is ontvangen. Zij hebben het bovendien « ter lezing gekregen » wat wil zeggen dat zij het met hun opmerkingen moesten terugsturen. Afgezien van enkele details, waren er geen opmerkingen. Het zou mij dan ten zeerste verbazen dat zij dit rapport dan niet ter kennis gebracht hebben van hun ondergeschikten. Dat is immers de normale stafprocedure » (229b).
Le colonel Marchal donne sa version des faits : « En fait, le plan d'évacuation des expatriés avait été minutieusement coordonné par l'ambassade de France, en collaboration avec l'ambassade de Belgique. De mon coté, le 1er avril, j'avais donné un briefing à tous les responsables belges de secteurs en ce qui concerne le plan d'évacuation. Ce plan à nécessité quatre mois de préparation et de coordination. Dans ce domaine-là, on n'improvise pas : ce n'est pas au moment où l'on est confronté à la situation que l'on réfléchit. Je me suis rendu compte, de façon tout à fait fortuite, que KIBAT ne semblait pas au courant du plan d'avacuation : il connaissait le plan, mais pas son mécanisme. Le plan consistait à rassembler les expatriés à divers endroits, à les évacuer le long de deux itinéraires qui devaient être protégés par les troupes de la MINUAR, vers l'aérodrome. Cette évacuation a débuté par une évacuation sauvage, sans la mise en place d'aucun dispositif particulier. C'est sur ce point que nous étions en désaccord, le colonel Dewez et moi-même.
Les conséquences pouvaient être dommageables pour la sécurité des expatriés, car nous ne leur garantissions pas une structure sûre sur le plan de l'encadrement du rassemblement » (230b).
Les faits, tels que le capitaine Lemaire, commandant de compagnie, les rapporte, montrent que l'exécution du plan catastrophe ne marchait pas bien : « Je pense que c'est le 9, on nous a dit que nous pouvions commencer l'évacuation des expatriés, alors qu'à cette date, ils étaient déjà aux trois quarts rassemblés » (231b).
Dans son rapport du 16 novembre 1994, le lieutenant-général Uytterhoeven a confirmé que le plan d'évacuation n'a pas été appliqué. Une grande partie des expatriés avait déjà été regroupée et il ne restait qu'à réunir des informations auprès des personnes encore sur place et à organiser ensuite, à partir des divers cantonnements, une évacuation, sous escorte militaire, vers l'aéroport (232b).
Abstraction faite de la constatation que ce plan d'évacuation n'était pas ou presque pas opérationnel, il y avait la question de savoir quels étaient les groupes cibles d'une éventuelle évacuation.
Le colonel Balis a interrogé le général Dallaire à ce propos : « Ik vroeg hem of ik ook moest voorzien in de evacuatie van de « expatriés », de vreemdelingen in Rwanda. Hij moest die vraag op zijn beurt stellen aan het hoofdkwartier in New-York ... Het ging wel degelijk enkel om niet-Rwandezen. Door omstandigheden heb ik generaal Dallaire tweemaal expleciet gevraagd of Rwandezen ook mochten worden geëvacueerd als ze in gevaar waren. Hij antwoordde formeel dat de bevelen van New-York « no locals » luidden. Er mochten dus geen Rwandezen geëvacueerd worden. » (233b)
Même en ce qui concerne l'évacuation des expatriés, la position du Force Commander était ambiguë. Voici ce qu'en dit l'amiral Verhulst : « En cas de complications, l'ONU avait prévu d'évacuer son propre personnel. Le « Force Commander » marqua son accord pour que l'on procède également à l'évacuation des expatriés. Contrairement au colonel Marchal, il ne souhaitait pas que cela figure dans le plan d'évacuation officiel. Le colonel Marchal espérait pouvoir infléchir le point de vue du général Dallaire. Il était prévu de faire intervenir la délégation belge auprès de l'ONU, si nécessaire.
Le général Dallaire souhaitait que l'évacuation complète des expatriés soit achevée dans les quatre jours. Le colonel Marchal demandait s'il devait suivre les instructions des Nations unies ou celles de la Belgique, si ce délai n'était pas respecté. Le colonel Marchal a reçu deux lettres et un fax. Il est stipulé dans le rapport du Secrétariat général de l'ONU du 24 septembre 1993, que le mandat de l'ONU n'est pas limitatif. Les expatriés étaient couverts par le mandat de l'ONU. Cela a été confirmé par l'ambassadeur à Kigali. En cas de catastrophe, la MINUAR devait protéger les expatriés. Le général Dallaire reconnaît donc que l'évacuation des expatriés fait bien partie du mandat de la MINUAR et, dès lors, que la réponse de l'état-major général au colonel Marchal correspond à la réalité » (234b).
Se pose enfin la question capitale de savoir si le colonel Marchal a aussi informé l'état-major général à Evere de cette carence et si ce dernier a envisagé ou entrepris des actions.
Après la manifestation du 8 janvier 1994, le colonel Marchal est parvenu à la conclusion qu'il se pouvait que la situation devînt incontrôlable et qu'il était urgent de mettre au point un plan d'évacuation et un scénario catastrophe. Au point nº 5 d'un rapport qu'il a adressé au C Ops le 15 janvier 1994, le colonel Marchal fournit la précision suivante : « Ce point est secret et a été transmis via le STU II et SECURE. Je demande une réponse rapide sur ce point . » Le contenu de ce message a été transmis par communication téléphonique cryptée. Le colonel Marchal demandait, dans ce message, de plus amples directives en cas d'événements graves et d'une nécessaire évacuation. « Ben ik verplicht de VN bevelen te volgen of moet ik een Belgisch standpunt innemen en verder landgenoten evacueren ? (onder Belgische muts i.p.v. blauwe). Ik vraag dringend antwoord. Situatie kan basculeren. Duidelijke richtlijnen » (235b).
Le colonel Marchal fit le témoignage suivant devant la commission : « En ce qui concerne le statut, ma première demande remonte au 15 janvier. Elle porte sur les conséquences d'une dégradation de la situation et de l'accroissement du danger pour nos expatriés et même pour la communauté des expatriés. La manifestation du 8 janvier m'a inquiété, car le mouvement de foule était non maîtrisable. J'ai alors essayé d'exprimer mon inquiétude en demandant des directives au cas où la situation devrait encore s'aggraver. Je n'ai jamais obtenu de réponse à ma demande du 15 janvier. À la mi-mars, je suis allé trouver l'ambassadeur et lui ai expliqué que j'avais demandé des directives mais qu'aucune réponse satisfaisante ne m'avait été fournie. J'ai souhaité qu'il intervienne via le Ministère des Affaires étrangères pour mettre ce point à l'ordre du jour de la réunion du jeudi suivant, à Bruxelles.
Le 20 mars, j'ai confirmé la teneur de nos entretiens et de mes préoccupations à l'ambassadeur. Il était temps que Bruxelles se préoccupe du problème. Je me demandais si, en cas de problèmes, il convenait de garder mon béret bleu ou de remettre mon béret belge pour avoir une attitude nationale.
Je crois avoir fait preuve de responsabilité en avertissant les autorités sur la situation que je prévoyais et qui malheureusement s'est présentée quelques jours plus tard.
J'estimais que les problèmes posés était importants pour la sécurité du détachement. J'étais commandant ONU mais aussi Belge. Ma mission m'imposait en outre de préserver la sécurité des expatriés belges » (236b).
Le 15 janvier, le C Ops a répondu à la demande du colonel Marchal par un message qui précisait la portée du mandat. À la question d'un commissaire qui désire savoir si le colonel Marchal avait reçu ce message, celui-ci répond comme suit : « Oui, mais il n'était pas satisfaisant. Le fond du problème était différent. Je voulais savoir ce qu'il convenait de faire, si l'évacuation se passait mal. C'était un problème de statut.... À la suite de la manifestation du 8 janvier, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas les moyens pour faire face à cette situation de crise.... Je voulais recevoir des directives pour savoir ce que je pouvais faire, en cas de trouble, pour évacuer les expatriés. Les évacuations précédentes se sont toujours déroulées convenablement mais, cette fois, je n'étais pas convaincu des résultats. Le propre d'un responsable est de prévoir les cas de force majeure » (237b).
La commission constate qu'il y a eu également des discussions au cours desquelles le colonel Marchal a insisté pour recevoir des directives spécifiques applicables dans un scénario de crise. Un commissaire a demandé si l'on avait examiné la possibilité de remplacer un béret bleu par un béret vert au cas où se produirait un tel scénario.
L'amiral Verhulst a répondu à cette question de la manière suivante : « Il n'y a pas eu de réponse écrite, mais il y a eu des discussions entre l'état-major général et le colonel Marchal dont je ne connais pas la teneur. Je ne comprendrais pas d'ailleurs que le colonel Marchal n'en ait pas parlé au chef d'état-major... La possibilité de changer de béret était implicite dans la priorité donnée par le chef d'état-major au commandant de KIBAT d'assurer la sécurité de son personnel » (238b).
La commission constate que le colonel Marchal n'a jamais obtenu de réponse satisfaisante à ses questions.
La question d'une évacuation éventuelle des expatriés n'a pas été mentionnée seulement dans les messages et les discussions entre le secteur Kigali et l'état-major général. Le rapport Uytterhoeven du 25 février 1994 la mentionne lui aussi explicitement.
« Évacuation de la communauté des expatriés.
Bien que cette évacuation soit à présent intégrée au plan général d'Evac de l'UNAMIR, la question se pose de savoir quelle doit être l'attitude du Det (Be) UNAMIR si cette Evac ne se passe pas comme prévu et que des expatriés de la communauté belge ne peuvent pas être évacués avant le départ des Tp de l'ONU ?
D'autre part, en cas de départ anticipé de l'UNAMIR, la communauté des expatriés se trouvera sans protection extérieure. Quid de la présence Be ? » (239b)
Après les événements dramatiques des 6 et 7 avril, KIBAT se trouvait dans un scénario catastrophe auquel il n'était pas préparé. La discussion et la contradiction, que l'on avait déjà remarquées à la suite de la manifestation du 8 janvier, ont été manifestes au cours des jours qui suivent le 7 avril. Dans un télex du 9 avril, le colonel Dewez a fait rapport au C Ops à Evere de l'entretien qu'il a eu avec le général Dallaire. Il appert de ce télex que le général Dallaire a une fois de plus interdit aux Casques bleus belges de participer à l'opération d'évacuation. Cela a manifestement fortement déçu le colonel Dewez qui a déclaré ce qui suit : « si New-York ne modifie pas le mandat, nous ne pouvons participer à cette ops et devrons donc nous même faire partie du pers MINUAR à évacuer et non des unités évacuant (...). (...) l'humiliation de devoir répondre sans cesse aux compatriotes qu'on ne pouvait quasiment rien faire (...). Je demande instamment que la Belgique contacte New-York pour demander soit de changer notre mandat, soit de nous permettre de quitter la MINUAR et de repasser sous ctl BE et faire ops avec collègues FR en BE. » (240b).
La commission constate qu'il y avait, au niveau de l'ambassade belge, un plan d'évacuation des civils et que des expatriés avaient des contacts téléphoniques avec l'ambassade. Nombre d'expatriés ont été évacués individuellement après avoir demandé à l'être à l'ambassade. La commission constate aussi que, sur le plan militaire, les autorités de Kigali et d'Evere étaient au courant du manque de crédibilité militaire du plan d'évacuation et du manque de directives claires à l'intention des commandants de compagnie et des commandants de peloton pour le cas d'un scénario catastrophe.
3.3.3.9. La préparation de KIBAT II
La commission constate que la préparation de KIBAT II différait entre autres de celle de KIBAT I dans la mesure où l'accent était mis constamment sur la nécessité de prévenir la répétition des indisciplines de KIBAT I. On exhortait Kibat II à adopter une attitude moins agressive, à n'utiliser les armes qu'avec l'autorisation d'en haut.
Le capitaine Lemaire témoigne :
« Le briefing comportait quatre aspects. Il y avait la limitation du mandat et le fait d'éviter la répétition des indisciplines commises par la 1 Para. Ensuite on nous a demandé d'éviter les attitudes agressives envers les Rwandais et on nous a signifié que des autorisations étaient nécessaires pour utiliser les armes.
Je peux résumer le message comme suit : « Vous êtes en quelque sorte ici comme observateurs... »
On nous a dit que le risque, pour nous, était limité. Jamais on ne nous a parlé de risques directs pour les Belges et la MINUAR, sinon je n'aurais pas autorisé les sorties le soir » (241b).''
En outre, la commission constate qu'il y avait une grande confusion concernant les ROE au cours de la préparation de KIBAT II. Nous n'approfondirons pas la question des règles d'engagement dans le présent volet, étant donné qu'un chapitre entier y sera consacré.
Enfin, la commission constate que la préparation en général était plutôt défectueuse et sommaire, comme le montrent les témoignages reproduits ci-dessous.
La combinaison des expériences en Somalie avec les problèmes disciplinaires de KIBAT I a provoqué une réaction disproportionnée, qui a amené l'état-major général à Evere à décider de donner une autre préparation à KIBAT II.
Le lieutenant-général Charlier affirme que c'est la conclusion essentielle qu'il a tirée de l'opération KIBAT I : « Le rapport du lieutenant-général Uytterhoeven fait le constat de ces difficultés. Il en est résulté une modification de l'entraînement du deuxième Codo. Les problèmes de discipline du premier bataillon étaient la conséquence de son retour de Somalie où il avait connu un univers totalement autre. L'entraînement différent donné au deuxième bataillon Codo consistait notamment à expliquer qu'il s'agissait d'un autre mandat et qu'il fallait éviter les incidents. Il ne s'agissait nullement d'apprendre à mieux se défendre, mais bien de s'inscrire plus parfaitement dans un mandat de maintien de la paix en milieu urbain. (...) Le deuxième Codo a aussi participé à la mission en Somalie. Il y avait de toute façon des leçons à tirer. Mais assurer la sécurité fait partie de l'entraînement de base » (242b).
D'après le commandant de bataillon Dewez, l'on a informé suffisamment et convenablement les hommes sur la nature de leur mission : « Je vous ai dit qu'un cours a été donné, dans la salle de musique, à tous les gradés, jusqu'au niveau de chef de peloton. Dans ce cours, j'ai assuré la première partie et j'ai expliqué le fonctionnement général de l'ONU, des opérations de paix etc. Ensuite, le capitaine Choffray a poursuivi avec, notamment, les règles d'engagement. À l'issue de ce briefing, un document a été distribué à chaque compagnie... Ensuite, la mission de chaque compagnie consistait à transmettre ce briefing au sein de la compagnie vers les pelotons... Un autre jour c'était au camp de Vogelzang j'ai rassemblé les compagnies donc tous les soldats et je leur ai donné un briefing d'une heure environ.
Lors de ma première audition, je vous ai donné une photocopie de ces notes extraites de mon petit carnet noir. Vous constaterez que j'indiquais que la mission allait être difficile et qu'il ne s'agissait pas du tout de vacances. Je n'ai jamais dit aux hommes qu'ils allaient en vacances; je vous ai expliqué l'autre jour que ce bruit s'était certainement répandu entre eux en raison de la comparaison avec la Somalie. À Kigali la vie était « normale » si je puis dire certes pas comme à Bruxelles , mais ils pouvaient sortir, aller au restaurant le soir, ils pouvaient aller nager à la piscine du Méridien » (243b).
Le colonel Dewez concède néanmoins que les renseignements qu'il avait reçus de l'état-major général à propos de la situation au Rwanda étaient d'ordre relativement général, et que, pour se faire une idée plus précise de la situation, il s'était adressé sur place au père Bouts (244b).
Cependant, le colonel Dewez estime que son bataillon a été convenablement préparé.
Le 6 avril, il a expliqué au général Dallaire comment il préparait ses hommes et celui-ci a exprimé sa satisfaction à ce sujet. Après une reconnaissance sur place, le colonel Dewez a regroupé les chefs de section, de compagnie et de bataillon pour un nouveau briefing au cours duquel il a exposé les règles de l'ONU et les différentes phases de la MINUAR. Il a encore rappelé que la mission était différente de celle menée en Somalie. Au Rwanda, chaque section devait opérer en collaboration avec la gendarmerie locale.
En outre, à l'arrivée, il a fait remettre à chacun un aide-mémoire reprenant les règles d'engagement (245b).
Le chef d'état-major Charlier estime lui aussi que les hommes étaient bien informés de la nature de leur mission : « Je suppose que le briefing ne constituait pas la seule source d'information du colonel Dewez. Des synthèses sur le Rwanda existaient à l'état-major et le colonel Dewez a dû en avoir connaissance. (...) Je n'accepte pas que l'on dise que nos militaires sont partis au Rwanda comme s'ils allaient en vacances. Ce que vous me lisez me paraît difficilement concevable » (246b).
Le commandant de la brigade paracommando, le général Roman, affirme lui aussi qu'il n'a rien à se reprocher. À la question de savoir ce qu'il a fait pour mieux former et informer KIBAT II après les expériences de KIBAT I, le général Roman a répondu ce qui suit : « Concrètement, j'ai veillé à ce que toutes les conditions soient remplies pour que le bataillon puisse mener sa mission à bien. Cela relève d'ailleurs des responsabilités du chef. Toutes les conditions dans lesquelles se trouvait KIBAT II devaient être favorables. Le bataillon lui-même reconnaît qu'il a été bien formé. Le colonel Dewez tenait à être bien informé. Il est donc parti sur place en mission de reconnaissance et a d'emblée pris contact avec ses collègues de KIBAT I. Il disposait donc des dernières informations » (247b).
Alors que l'état-major à Evere et le commandant de bataillon Dewez affirment formellement que les hommes connaissaient très clairement la nature de la mission, qu'ils étaient informés des ROE et qu'ils avaient été convenablement préparés à l'exécution de cette mission, une série de témoignages montrent que les chefs de peloton et les cadres inférieurs ne partageaient pas du tout ce point de vue.
Le caporal-chef Pierard a déclaré sans ambages : « On nous disait d'oublier la Somalie. On disait que le Rwanda était autre chose, qu'on nous offrait des vacances » (248b). Le témoignage de Mme Lotin va aussi dans le même sens : « Mon mari m'a dit que ce qui lui faisait peur, c'est qu'on leur avait dit qu'ils partaient en vacances. Pourtant, un père trappiste l'avait informé des dangers de la mission. D'ailleurs, lui-même a déclaré qu'il craignait de ne pas être prêt si des événements dangereux survenaient » (249b).
L'adjudant Boequelloen ne partage pas non plus l'avis de son commandant de corps selon lequel les hommes étaient bien préparés : « La seule préparation que j'ai eue est la conférence d'un père ». Il a également reçu une farde de son prédécesseur et communication des règles d'engagement. « Je n'ai assisté à aucun cours sur le changement des règles d'engagement » (250b).
Le capitaine Marchal, commandant de compagnie, a en outre déclaré que la préparation avait été très sommaire. À la question de quelle manière il avait été informé de la gravité de la situation avant son départ pour Kigali, le capitaine Marchal a répondu : « Je n'ai pas réellement reçu de briefing en ce qui concerne la gravité de la situation. Il a été question du climat dans lequel nous partions. Des briefings ont été organisés à ce sujet. Dès que nous sommes arrivés à Kigali, nous avons eu une réunion avec le colonel Marchal lequel nous a dit que nous devions travailler avec les institutions en place » (251b).
L'aumônier Quertemont, qui a participé à la préparation de KIBAT II, estime lui aussi que la préparation a été fort courte et quelque peu bâclée (252b).
Le colonel Marchal admet aussi que la préparation était défectueuse : « Je vais donner un exemple concret, pour montrer la complexité du problème. J'ai donné un « briefing » aux officiers du second détachement. Or, un commandant m'a reproché de n'avoir rien dit et que rien ne lui avait été communiqué sur les règles d'engagement, ce qui est inexact. Toutefois, il n'était pas de ma responsabilité d'organiser un « briefing ». C'est au moment de la préparation de la mission qu'il doit avoir lieu et non pas sur le terrain. J'ai cependant essayé de subvenir à un manquement manifeste » (253b).
L'état-major à Evere savait-il que la préparation du contingent, qu'il jugeait très sérieuse, ne portait aucun fruit sur le terrain ? Y a-t-il eu des rapports qui, soit faisaient ressortir les erreurs ou les manquements dans la préparation, soit signalaient que KIBAT II n'avait pas tiré d'enseignements de l'expérience de KIBAT I ou en avait tiré de mauvais ?
Il y a tout d'abord le rapport du lieutenant-général Uytterhoeven, dans lequel est examiné en détail le problème de la nature de la mission et selon lequel le général Dallaire n'était pas tellement satisfait de la préparation de nos hommes : « Au départ, il y a eu un problème. KIBAT I est arrivé au Rwanda avec une mentalité « peace-enforcing », comme en Somalie, alors que la situation requérait une mentalité de « peace-keeping ». La situation, qui était en pleine évolution, commandait en tout cas une adaptation permanente qui n'est pas facile à réaliser au niveau des échelons d'exécution... Le 1 Para a été confronté le premier à des problèmes d'adaptation énormes, à une infrastructure difficile, à de nombreux changements, à l'absence du niveau secteur, etc. Il s'est bien tiré d'affaire. Nous avons payé le prix de l'inexpérience. Ceux qui assurent la relève n'ont pas le droit de passer par la même période d'adaptation.
Le commandant de la brigade paracommando et l'état-major général de la force terrestre prendront les mesures qui s'imposent pour préparer le 2 Cdo. Outre une meilleure préparation en Belgique, il faudra prévoir un bon schéma pour la relève sur place des échelons inférieurs (traduction) » (254b).
Le général Dallaire a fait observer au lieutenant-général Uytterhoeven que les soldats belges étaient conditionnés pour une opération de peace-making alors que l'opération en cours relevait du peace-keeping pur, c'est-à-dire qu'elle constituait une mission de police. Le général Dallaire a demandé au lieutenant-général Uytterhoeven d'assurer une bonne préparation psychologique du détachement suivant et lui a signalé que, pour ce genre de mission, le Canada n'envoyait pas de parachutistes et faisait suivre à ses hommes une préparation spéciale de trois mois. Le lieutenant-général Uytterhoeven conclut que la brigade paracommando et l'état-major général de la force terrestre devaient résoudre ce problème ASAP (as soon as possible ) (255b).
La commission constate que la brigade paracommando et l'état-major général à Evere étaient convaincus que KIBAT II avait été bien préparé et qu'on avait tiré les enseignements de l'expérience de KIBAT I. Elle constate cependant que de nombreux témoignages tendent à indiquer que les troupes avaient été préparées d'une manière trop sommaire et que l'on a fait une interprétation erronée du caractère « maintien de la paix » de la mission.
3.3.3.10. Les problèmes de communication
Quelle était la situation de KIBAT en avril 1994 ?
Le colonel Marchal était manifestement satisfait du matériel : « Je n'ai jamais travaillé avec un réseau aussi fiable et fonctionnel que le réseau Motorola.
Il faut bien se rendre compte que, le 7 au matin, les réseaux étaient saturés et que la procédure qui devait être appliquée pour permettre de transmettre un message n'était pas opérationnelle. Je vous ai dit qu'il me fallait généralement plusieurs minutes afin de faire passer un message et que j'étais très content lorsque j'y parvenais » (256b).
L'adjudant Boequelloen, qui était le responsable de la transmission au niveau du bataillon, et spécialiste en la matière, a expliqué à la commission quels étaitent les moyens de transmission dont on disposait.
Au sein du bataillon, on travaillait essentiellement avec le système « SAIT », équipement spécifique différent de l'équipement organique des unités para-commandos, amené par KIBAT I et repris par KIBAT II. Le peloton Mortiers n'avait pas été doté de postes portatifs de ce type.
Par ailleurs, il avait emporté de Belgique, malgré l'interdiction officielle, ses postes radio « PP 11 », postes portatifs relativement compacts. Ces PP 11, vu les distances considérées en l'occurrence, auraient pu permettre une liaison entre le peloton Mortiers et le PC du bataillon, moyennant une adaptation des cristaux (opération de routine, pour autant qu'on dispose de ces cristaux, ce qui n'était pas le cas).
Il semble d'ailleurs que le lieutenant Lotin n'avait pas emporté de PP 11 le 7 avril. Même s'il les avait emportés, il n'aurait pas pu, avec le cristal dont ses postes étaient munis, communiquer sur une des fréquences utilisés le 7 avril par le bataillon et les compagnies.
Le peloton Lotin ne pouvait donc pas entrer dans le réseau de commandement du bataillon dès qu'il s'éloignait de ses véhicules, ce qui fut le cas le 7 avril.
L'on disposait, au niveau du bataillon, outre de ce réseau de combat, d'un réseau téléphonique civil, qui était branché sur le réseau Rwandatel, mais que l'on pouvait facilement saboter.
Il affirme : « Au sein du bataillon, l'on a installé un réseau téléphonique mais il a montré très vite ses limites, car il reposait sur le réseau Rwandatel, le téléphone local, et dès que les quelques centraux sautaient, le réseau était paralysé (...). Cela, c'était donc le réseau interne KIBAT. Au niveau supérieur, à savoir celui du Secteur et de la Force, il y avait un système installé par le personnel civil de l'ONU, que l'on pouvait très facilement saboter et utiliser pour du contre-espionnage. (257b) Nous, les militaires, nous évaluons très rapidement les possibilités dont l'autre pourrait disposer pour nous rendre inopérants. Nous savions également comment neutraliser le système au niveau supérieur. »
En ce qui concerne l'utilisation du Motorola, l'expert est formel : « Le KIBAT avait également accès à ce réseau. Mais ce système civil fonctionne comme un réseau GSM : tout le monde peut l'utiliser. N'importe qui pouvait acheter un Motorola et suivre les conversations sur les différents canaux » (258b).
L'adjudant Boequelloen fait clairement la distinction entre le niveau du bataillon (2e commando) et les échelons supérieurs de l'ONU. « Jusqu'au stade du bataillon, nous étions une armée en opération. Par contre, au-dessus de ce niveau, le système était civil car nous étions en opération de maintien de la paix.
Un système civil, je vous le dis honnêtement, montre rapidement ses limites. Il eût suffi de saboter deux stations et c'était terminé, il n'y avait plus de liaisons » (259b).
L'adjudant Boequelloen a demandé des éclaircissements à propos de cette situation au colonel Marchal, qui l'a renvoyé tout simplement à la Force : « Là, j'ai rencontré un officier de transmission bangladais qui ne pensait qu'à jouer aux cartes sur son ordinateur. Il m'a renvoyé à Rwandex, auprès de civils de l'ONU, qui m'ont dit qu'ils disposaient de motorolas et m'ont indiqué où se trouvaient les relais. Je leur ai dit que cela n'allait pas mais ils m'ont répondu que c'était ainsi. Si vous me le permettez, je voudrais ajouter que du point de vue militaire, c'était de l'amateurisme, mais les gens qui ont fait ça sont des professionnels » (260b).
« Je le répète, dans le cadre d'une opération militaire, ce système ne nous permet pas de réagir. En effet, il s'agit de petits motorolas que l'on met sur une table et qui mènent à un relais, mais si celui-ci saute, il n'y a plus de motorola, donc plus de communication » (261b).
La déclaration suivante montre que l'utilisation du motorola demande moins d'efforts de la part du personnel que l'appareillage radio classique, mais qu'elle ne favorise pas la discipline militaire :
« Un beau jour, j'ai constaté qu'une jeep vide se trouvait sur un parking, la radio allumée. J'ai été très désagréablement surpris. J'ai constaté que deux officiers mangeaient un petit bout. Ils avaient laissé leur jeep sur le parking avec la radio de combat allumée, et ils étaient assis à table avec leur motorola » (262b).
Dans ses premières déclarations, l'adjudant Boequelloen parle du motorola ainsi que du réseau radio « camp de vacances ». Il s'explique : « Cela signifie qu'il était organisé comme un camp de vacances. Chacun avait sa petite radio. Quand on se levait le matin, on l'allumait et, ensuite, on l'éteignait tout simplement. Ce n'était pas un réseau de combat » (263b).
Il s'avère que si, au niveau du bataillon, l'on utilisait un appareillage militaire, celui-ci n'était pas pour autant adapté aux situations à risques. Le lieutenant Lotin et son peloton de mortiers furent coupés du bataillon, pour ce qui est de la communication, lorsqu'ils quittèrent leurs véhicules, car leurs radios étaient montées sur les véhicules et ils n'avaient pas reçu de kits ou de radios portables. À un moment comme celui-là, une bonne liaison radio est tout à fait vitale. C'est ce que confirme le rapport de Uytterhoeven, du 16 novembre 1994 : à 8 h 20, au moment où Mme Uwilingiyimana a décidé de s'enfuir par les jardins, le lieutenant Lotin a demandé des instructions. Le colonel Pochet (quartier général Secteur) a dit au lieutenant Lotin que sa mission était de la protéger et qu'il devrait donc l'accompagner (même dans les jardins).
Le lieutenant Lotin a fait remarquer qu'il lui était impossible de le faire à pied, car, en le faisant, il ne disposerait plus de sa liaison radio. C'est à ce moment-là et pour ladite raison que l'on a décidé que le peloton Mortiers ne suivrait pas Mme Uwilingiyimana dans sa fuite (264b). S'il avait disposé d'un matériel radio portable, le groupe Lotin aurait pu poursuivre sa mission de protection dans les jardins, avec ses armes.
Quelle était la situation de l'adversaire ? Les FAR disposaient-elles de moyens radio convenables ? En cas d'opération coup de poing en direction de Lotin, pouvaient-elles demander rapidement des renforts ? Il est frappant de constater que les officiers qui n'ont aucune expérience de l'Afrique estiment que oui, alors que ceux qui la connaissent, relativisent nettement les possibilités de transmission des FAR.
En tout cas, il est certain qu'il n'y a aucune clarté à propos de ces renseignements élémentaires, alors que l'on sait qu'il y avait une coopération militaire entre la Belgique et les FAR.
L'adjudant Boequelloen, qui a accompli beaucoup de missions en Afrique, répond : « Je ne pense pas qu'il (le système de transmission des FAR) était fantastique. Nous voyions bel et bien des antennes, mais elles ne semblaient pas très puissantes ».
Le caporal-chef Pierard doute lui aussi de la possibilité pour les FAR d'appeler rapidement des renforts : « Les petits groupes que nous voyions à gauche et à droite comptaient environ une quinzaine d'hommes, ils n'avaient aucune radio, etc. (265b) ».
Le C Ops ou l'état-major général à Evere étaient-ils informés des difficultés de transmission à KIBAT ? Le rapport Guérin consacre un chapitre particulier à cette question et souligne qu'il y a lieu de résoudre le problème d'urgence.
« a. Tr Long Range
Actuellement, tous les moyens sont au Sect, ce qui oblige le Bn à passer par le Sect. Même pour les Tr de routine (Br1, Br4, ...), avec le retard que cela implique. Une Eq et des moyens pourraient être déplacés de Mombassa à Kigali pour Rft le Bn.
b. Tf Rwandatel
Le réseau Rwandatel fonctionne de manière satisfaisante mais il est sur écoute. Il n'est pas disponible dans chaque Cant et il est vulnérable. Il peut être amélioré à peu de frais dans certains Cant (Don Bosco, ...) avec des moyens Mil (Centrale, dérivation de raccordement, ...) .
c. R civiles
Le réseau motorola utilisé au niveau de la Force et du Sect est encombré par les utilisateurs Mil et civils. Aucun des systèmes proposés (Motorola, Kenwood, Philips) n'est sûr. Une dizaine de radios portables de faible encombrement serait cependant utile au Bn pour certaines missions spécifiques (Ln Comd, Lo, ...) .
d. R Mil
Le réseau SAIT/BLU fonctionne de manière satisfaisante dans la KWSA mais il est très probablement sur écoute. La mise en place de Mat Rita permettrait d'assurer des Ln Safe entre les Cant sans nécessiter de Pers supplémentaire.
Évaluation sommaire des besoins :
une station fixe par Cant (14 actuellement)
une station mobile par autorité (Co, Comd Cie, S3, Otr)
e. Immarsat mobile
Le Bn reçoit régulièrement des missions à longue distance (escortes). Il est nécessaire de doter certains Veh d'un Immarsat pour assurer les Ln jusqu'aux frontières de la Tanzanie et Ouganda : Heli, Pl Recce, ... (266b). »
La commission ignore dans quelle mesure le C Ops a tenu compte des remarques faites par Guérin.
A-t-on tenu un debriefing sur les problèmes relatifs à la transmission ? A-t-on tiré les conclusions qui s'imposaient ? La situation en la matière a-t-elle été améliorée depuis ?
Selon l'adjudant Boequelloen, aucun debriefing n'a eu lieu. Et le caporal-chef Pierard ajoute qu'en Yougoslavie, on utilise encore les mêmes motorolas. « Dans mon groupe, nous disposions de notre radio et d'un motorola. En Yougoslavie, mon groupe est en contact avec la compagnie par la radio et avec le Force Commander, le G2, par le motorola » (267b).
3.3.3.11. La difficile collecte et l'utilisation insuffisante des renseignements
La collecte des renseignements, leur interprétation exacte et leur traduction en directives opérationnelles destinées aux troupes stationnées à Kigali se sont faites de manière très lacunaire.
Dans le présent chapitre, la commission constate, dans sept grandes parties que, dans de nombreux domaines, les informations militaires et politiques ont été collectées et traitées de manière très lacunaire. Dans la première partie, la commission constate que l'ONU ne dispose d'aucun service de renseignements; dans une deuxième partie, elle constate la tentative d'organisation des services de renseignements aux divers niveaux opérationnels, à Kigali; une troisième partie est consacrée aux renseignements qui ont été obtenus ou non grâce à la coopération technico-militaire; une quatrième partie traite des échanges d'informations avec les services étrangers et les autorités rwandaises; ensuite, la commission cite une série de témoins qui expliquent ce qui est advenu des informations collectées, quelles actions l'on a entreprises à l'égard de l'état-major général et, plus particulièrement, à l'égard du SGR à Evere; dans une sixième partie, la commission constate comment ce service fonctionne en pratique et, dans une septième et dernière partie, elle constate comment les informations ont atteint le Ministère de la Défense et le Ministère des Affaires étrangères et comment s'est faite l'interaction entre ces départements en matière de renseignements.
(1) Le fait qu'il n'existait pas de service de renseignements de l'ONU
Dans sa réponse à l'avocat général de la Cour militaire, le général Dallaire constate qu'il n'existait pas de point de rassemblement des informations au niveau de l'ONU : « The United Nations Assistance Mission for Rwanda (UNAMIR), like all other United Nations Peacekeeping Operations, did not have an independent « intelligence » service. The collection of information was done overtly by military staff officers assigned as Information Officers, to the UNAMIR Military Division Force HQ, the five Sector Hqs and the three Battalion Hqs. Information contained in patrol reports, observation post reports, and investigations reports was transmitted in the form of daily situation reports through the chain of command, from the Military Information Officer through the Chief Operation Officer, to the Deputy Force Commander and the Force Commander himself. The Special Representative of the Secretary-General (SRSG) or his Chief Civilian Staff Officer, were briefed regularly by the Force Commander and the Military Information Officer. Occasionally, unofficial information was provided by local informants and diplomatic or governmental sources » (268b).
Le capitaine Claeys, qui, au niveau de la Force, était responsable de la branche 2 (renseignements), se plaint que, pour cette raison, sa mission était officiellement trop limitée : « Neen, de UNO moest als neutrale partij blijven optreden. Ik weet niet of u ervan op de hoogte bent, maar voor de UNO mag er niet aan intelligence worden gedaan. Vandaar dat men een gebrekkige term hanteert zoals military information officer.
Wat ik officieel moest doen, lag heel ver van wat ik in werkelijkheid deed. Officieel moest ik briefings geven aan de nieuwe stafofficieren. Ik moest hen het relaas geven van de vooruitgang en van de verschillende pogingen om de overgangsregering in de startblokken te zetten. Ik moest de verschillende granaataanslagen en moordpartijen opvolgen die er op het ganse grondgebied gebeurden. Daarbuiten beperkte mijn taak zich tot eventuele contacten met liaisonofficieren van het RPF of de liaisonofficieren van de FAR. » (269b). Cependant, le capitaine Claeys informe quotidiennement le major Maggen, qui est responsable des Sitreps quotidiens destinés à New York, et concernant les incidents et les autres renseignements pertinents (270b).
Le major Podevijn, qui était chargé officiellement de l'accompagnement des convois humanitaires, et qui, en outre, rassemblait discrètement des informations pour le SGR au niveau de la Force, le confirme comme suit : « Non, je devais d'ailleurs rester discret à ce sujet, surtout vis-à-vis de l'ONU, étant donné que recueillir des informations ne faisait pas partie des missions de l'ONU » (271b) ».
Au niveau du secteur, le commandant de secteur, le colonel Marchal, constate également l'absence d'officiers spécialisés : « Pour pallier ces insuffisances, fin décembre, j'ai demandé au général Dallaire de pouvoir disposer d'un officier spécialisé au QG du secteur. La composition des états-majors est de la compétence de l'ONU à New York, car il faut respecter les équilibres de nationalité. J'avais suggéré que cet officier supplémentaire soit belge, car il était impératif qu'il parle la langue du pays. La réponse fut négative, car le renseignement est une fonction offensive qui ne fait pas partie du mandat de la MINUAR (272b). »
Le colonel Balis, qui était officier de liaison entre la Force et le Secteur, a également proposé au général Dallaire de créer semblable cellule de renseignements : « Het is natuurlijk zo dat we heel veel geruchten, mededelingen, hadden, maar weinig concreets op papier. Volgens mij was dat misschien wel de grootste zwakte van de zending UNAMIR.
U moet mij verontschuldigen, ik ben een verkenner (NDLR : officier des troupes de reconnaissance). Ik wil weten wat er gebeurt.
Het is mij direct opgevallen dat de belangrijkste sectie in zo'n staf en zo'n operatie bestond uit één Belgische kapitein. Die man heeft dag en nacht gewerkt. Die heeft werkelijk schitterend werk gedaan, maar dat was te veel voor hem.
Ik heb generaal Dallaire voorgesteld, toen mijn Bengalese chef er was en er bijna geen, of geen, operaties liepen, om mij toe te laten een G2 te maken, om een inlichtingencel op te richten met drie, vier of vijf officieren en vooral met enkele mensen die Rwandees kennen. In heel die staf sprak niemand Rwandees. Dat is dus onvoorstelbaar.
Dallaire heeft gezegd : « OK, ik noteer dit. Ik vraag de toelating aan New York. » Het antwoord van New York was dat het niet wenselijk was een inlichtingencel op te richten omdat het inwinnen van inlichtingen een daad van agressie zou zijn » (273b).
Le commandant de la brigade paracommando, le général-major Roman, a affirmé également qu'il était très difficile de se faire une idée exacte de la réalité : « L'analyse de la situation sur place était très complexe. Il faut, en effet, brasser des centaines de documents pour construire une image mouvante de la réalité. Ce type de structure est inexistant à l'ONU » (274b).
Le général-major Delhotte, chef du SGR à Evere, explique cette lacune par le fait que les États membres de l'ONU craignaient que les Américains n'acquièrent une influence excessive dans une telle cellule de renseignements : « En ce qui concerne la conduite d'opérations sous la responsabilité de l'ONU, on devrait se demander pourquoi cette institution n'a pas son propre service de renseignements. La raison est que les Américains avaient offert à l'ONU de mettre en place gratuitement un centre de renseignements alimenté par leurs propres banques de données.
Les autres pays ont, bien entendu, rejeté cette proposition qui aurait permis aux Américains de téléguider les décisions de l'ONU » (275b).
Le commandant adjoint du SGR, le général-major Verschoore, regrette que le SGR n'ait reçu aucune analyse de la part de l'ONU. Selon lui, ce n'est qu'à l'occasion du déplacement d'un officier belge à l'ONU en rapport avec le dossier yougoslave que le SGR a pu obtenir davantage d'informations (276b).
Bien que, comme le montrent les témoignages ci-dessus, l'on n'ait pas pu compter sur un service de renseignements de l'ONU, l'on a fait appel, pour tenter de combler cette lacune, à un service de renseignements au niveau du bataillon. Selon le S2 (renseignements) au niveau du bataillon KIBAT I, le lieutenant Nees, c'était une première pour une mission des Nations unies. Il concède néanmoins qu'il n'a pas demandé de renforts à son échelon, parce que ses supérieurs n'estimaient pas cela nécessaire (277b).
La commission constate que tous les échelons, à Kigali et à Evere, ont trouvé très grave que l'ONU ne dispose d'aucun service de renseignements. L'on a fait diverses démarches pour résoudre le problème, mais New York a toujours rejeté catégoriquement toute proposition en la matière.
(2) La tentative d'organisation de services de renseignements aux divers niveaux à Kigali
Malgré l'absence d'un service de renseignements de l'ONU, le capitaine Claeys a tenté lui-même à plusieurs reprises, au niveau de la Force, de collecter des renseignements utiles à la MINUAR. Il était l'officier d'information qui pouvait, dans cette fonction, recueillir des renseignements importants : « Hij (Jean-Pierre) informeerde mij bijvoorbeeld over de lijsten van geregistreerde Tutsi's. Hij heeft mij die echter nooit willen overhandigen, want dat was zijn grootste garantie. Het bestaan van die lijsten werd later bevestigd door de uitvoering van het plan. Hij zei toen al dat men in staat was om 1 000 Tutsi's per 20 minuten te vermoorden in heel Kigali. Hij heeft ons de precieze plaatsen aangeduid waar wapenopslagplaatsen zich bevonden. Het ging dan zowel om kleine loodsen, als om zogezegde beerputten. Hij heeft ons ook getoond langs waar de konvooien zouden rijden. Het ging in feite niet om konvooien, maar om burgervoertuigen voor vervoer van wapens vanuit militaire kampen naar opslagplaatsen. Verder vertelde hij ons altijd dat hij onder druk werd gezet door de partij om zo snel mogelijk de wapens en de munitie te verdelen. Hij zei ons dan dat hij, ofwel de wapens, ofwel de munitie bezorgde, maar nooit aan dezelfde persoon wapens en munitie. » (...) À la question de ce qu'il a fait de ces informations, le capitaine répond : « Die werden telkens doorgezonden naar generaal Dallaire. Elke ontmoeting die ik met hem heb gehad, heb ik gebrieft aan de generaal. Vraag : welke Belgische officieren waren op de hoogte van uw ontmoeting met Jean-Pierre ? Alleen kolonel Marchal en kolonel Kesteloot » (278b).
Le colonel Marchal a fourni un témoignage important et détaillé devant la commission concernant la manière dont le secteur Kigali recueillait les informations : « En ce qui concerne les informations fournies, je vais distinguer deux périodes. La première se situe avant mon départ, le 4 décembre 1993, pour le Rwanda. J'étais informé par la presse de l'époque et par des télex envoyés par l'ambassadeur Swinnen, dont j'avais connaissance, le suivi des opérations étant de ma compétence.
Quand je me suis trouvé sur place, je disposais de diverses sources d'information telles que la radio, les synthèses du service de presse de la MINUAR et un ensemble de contacts personnels. Mon information était encore alimentée par notre perception des réactions de la population, lorsque nous circulions dans Kigali et par des comptes rendus verbaux et écrits émanant de mes unités.
Les contacts que j'ai eus à partir du 10 janvier avec Jean-Pierre ont été très révélateurs et ont fourni une base solide.
Je voudrais maintenant détailler la structure qui permettait d'obtenir des informations de la MINUAR. En premier lieu, le QG de commandement du général Dallaire, dont la branche opérations était constituée de deux officiers, un Belge et un Sénégalais, bénéficiait d'une cellule renseignements. En ce qui concerne le QG secteur, rien n'était organisé dans ce cadre. Au niveau des unités elles-mêmes, elles disposaient de leurs propres cellules de renseignements, dirigées par le lieutenant Nees pour le bataillon belge. J'estime que le lieutenant Nees a pu ainsi acquérir des informations indispensables. Rutbat avait une cellule de renseignements dont le niveau technique n'était pas plus élevé » (279b).
À côté de cela, le colonel Marchal a pris lui-même une série d'initiatives en vue de collecter des informations supplémentaires : « Il y avait une troisième réunion qui se tenait toutes les semaines et que je présidais. Elle réunissait les commandants de détachement » (280b).
Ainsi a-t-il obtenu également l'autorisation du lieutenant-général Charlier, et ce, à la demande du lieutenant Nees, de créer un réseau d'informateurs et de disposer d'un budget (281b).
La commission interrogea aussi le lieutenant sur la méthode utilisée pour obtenir des informations et pour les traiter, ainsi que sur l'accueil que ses supérieurs leur avaient réservé. Le lieutenent Nees déclara : « J'ai reçu 30 000 francs rwandais par mois, ce qui correspond à 1 000 francs belges, pour indemniser les menus frais des informateurs. (...) Le colonel Leroy recevait les rapports complets. Il y ajoutait des copies si cela s'avérait nécessaire. Il envoyait le tout au colonel Marchal. S'il s'agissait de rapports importants, ils étaient transmis au C Ops... Il n'y a eu que très peu de réaction à mes messages de la part de l'état-major général. En tant que « petit pion » dans l'armée belge, je ne m'attends d'ailleurs pas à recevoir une demande de renseignements de la part de l'état-major général » (282b)
Le lieutenant Nees a en outre confirmé que la transmission des renseignements obtenus aux différents niveaux était soit inexistante, soit insuffisamment organisée. Son supérieur hiérarchique était le colonel Marchal, et il ne disposait pas d'un service de renseignements à son niveau.
Comme le capitaine Claeys au niveau de la Force, il a tenté d'obtenir immédiatement, au niveau du bataillon, des renseignements tactiques utilisables, concernant, par exemple, les endroits où se trouvaient des armes (283b).
Pourtant, le colonel Marchal s'est plaint à plusieurs reprises de la difficulté particulière de rassembler et d'échanger efficacement des renseignements utiles: « Il ne suffit pas d'avoir de l'information. ... Une réunion hebdomadaire, présidée par le chef d'état-major bengalais, traitait du renseignement. Assistaient à cette réunion les officiers de renseignements. Malheureusement, cette réunion avait lieu en anglais, langue parfois mal maîtrisée par nos officiers (...). J'ai ainsi pu constater, hélas, que les militaires belges avaient tendance à avoir un complexe de supériorité. Je me suis efforcé de faire apparaître les aspects positifs des autres détachements » (284b).
Selon le colonel Marchal, l'absence d'officiers de renseignement spécialisés, au niveau du secteur et au niveau de KIBAT, qui auraient pu l'assister dans sa mission de collecte de renseignements, constituait une lacune importante : « Le rôle des officiers S2 dans les bataillons est de récolter des informations tactiques. La récolte des informations opérationnelles était la mission de Podevijn et Claeys, pas celle des officiers S2. Ces derniers, qui n'ont pas reçu d'entraînement, ont fait de leur mieux, mais ils n'ont pas récolté l'information aux bons endroits.
Le capitaine De Cuyper propose des analyses à propos des gouvernements de transition. Ce n'est pas son rôle. Il devait s'occuper d'informations tactiques. De plus, je ne suis pas d'accord avec son analyse, car si le Gouvernement de transition n'est pas en place le 25 mars, c'est dû au manque d'un des acteurs, le FPR » (285b). Le colonel continue : « Ma préoccupation principale était d'éviter l'intoxication, ce qui est une tâche difficile pour un spécialiste du renseignement et encore plus difficile pour les amateurs que nous étions. Il fallait respecter la neutralité et bien évaluer l'information. J'ai demandé que l'on me fasse, à la fin de chaque mois, un rapport de synthèse et d'évaluation pour chaque détachement belge. Je n'en ai jamais reçu » (286b).
Le colonel Marchal estime qu'avec des analystes spécialistes, on aurait pu éviter le drame : « Ce qui m'a particulièrement fait défaut, c'est l'absence d'une équipe d'analystes du renseignement. En effet, nous étions régulièrement confrontés à des incidents sans pouvoir identifier ceux qui tiraient les ficelles. Si, dans la nuit du 6 au 7 avril, des analystes avaient été sur place, je suis convaincu qu'ils auraient détecté que le schéma burundais se répétait à Kigali.
Nous aurions dès lors pris des dispositions pour que Mme Agathe soit mise en sécurité » (287b).
Pourtant, la situation dont le colonel Marchal se plaignait ne date pas du début 1994. Le lieutenant-colonel Leroy, commandant de KIBAT I, était convaincu, dans un premier temps, que la collecte d'informations ne posait pas de problème : « Il était possible d'obtenir le maximum de renseignements. Ainsi, tous nos hommes de KIBAT I pouvaient disposer d'informations sur les partis politiques, les personnalités, les attitudes à adopter, les possibilités touristiques, etc. » (288b). Il concède néanmoins que la réalité sur place était totalement différente : « Lors de nos contacts sur place, nous nous sommes rendus compte que nous avions peu de connaissance de l'arrière-plan politique. Nous recevions peu de renseignements de l'état-major général. Nous avons donc dû les collecter nous-mêmes. Dans cette démarche, le travail du lieutenant Nees a été très utile » (289b).
Le lieutenant Nees, qui était S2 à KIBAT I, avait lancé la collecte de renseignements pour son bataillon. Il avait créé un réseau de cinq informateurs et avait également essayé d'écouter RTLM. Ce n'était toutefois pas une tâche aisée : « Au moment où je suis arrivé au Rwanda, je ne connaissais pas le pays. On ne peut pas faire fonctionner convenablement un réseau de renseignements en quatre mois » (290b). Cela concernait aussi le fait que l'on n'avait pas d'informateur auprès du FPR : « Il était très difficile d'entrer en contact avec le FPR. En fait, nous n'avions aucun contact avec lui » (291b).
Le fait que son supérieur, le colonel Marchal, ne disposait pas d'un service de renseignements à son niveau, compliquait encore sa mission (292b). Le lieutenant Nees a fait de son mieux pour traiter les informations qu'il recueillait.
Tout d'abord, il devait, pour ce faire, obtenir confirmation des renseignements de sources diverses. Cependant, il ne pouvait pas le faire seul et, en outre, ce n'était pas son unique mission. Il assurait souvent aussi la permanence à la chambre d'opérations (293b). Pourtant, le lieutenant Nees s'est efforcé d'accorder une attention suffisante aux émissions de RTLM : « À KIBAT I et II, quelques sous-officiers maîtrisaient le kinyarwanda. Ces personnes écoutaient sporadiquement la RTLM. J'ai chargé mon informateur principal de prêter surtout attention à la RTLM, mais nous n'avions pas suffisamment de personnes, ni de moyens pour écouter en permanence. J'ai en tout cas demandé si cela pouvait être réglé » (294b).
Enfin, il relativise lui-même les possibilités de son réseau d'information ainsi que ses propres connaissances en la matière : « J'ai commencé à collaborer avec un certain nombre de personnes en décembre et j'ai reçu l'autorisation officielle le 16 janvier. J'ai travaillé avec un informateur principal et quatre informateurs occasionnels. Tout cela a été monté en épingle dans la presse et présenté comme un réseau de renseignements. Je n'ai pas été formé pour travailler comme officier de renseignements. C'est la mission du SGR. En fait, nous ne savions rien du Rwanda et nous n'y connaissions personne. Je trouvais donc très important que nous obtenions des informations, par exemple sur l'appartenance politique des différents quartiers de Kigali. (...) C'était effectivement dû à mon initiative. J'ai également demandé à un moment donné à mon supérieur d'évaluer mes renseignements. On m'a alors répondu qu'ils étaient très intéressants. Le 20 mars, je suis parti du Rwanda. Le capitaine De Cuyper m'a remplacé le 14 mars.
Lui aussi avait des contacts avec mon informateur principal. Mais le capitaine De Cuyper ayant des contacts au Rwanda, il n'avait plus besoin de mon réseau » (295b).
Le capitaine De Cuyper, qui reprend en effet la mission de S2 (à KIBAT II) du lieutenant Nees, affirme pourtant qu'il continue à suivre la voie empruntée par son prédécesseur : « Ma façon de travailler était tout à fait identique à celle du lieutenant Nees. Je n'ai ajouté que quelques informations supplémentaires. Je pouvais aisément savoir ce qui avait été dit et par qui. Au moyen d'un réseau constitué d'un certain nombre de hauts fonctionnaires, j'ai seulement voulu savoir s'ils pouvaient confirmer ce qui avait été dit lors de certaines réunions. Pour le reste, j'obtenais des informations par le biais des commandants de compagnie, de réunions politiques et de personnalités. (...) La façon dont l'information circulait a changé lors de l'arrivée de KIBAT II. J'ai communiqué des informations secrètes et confidentielles au commandant de KIBAT II, lequel ne transmettait à son tour que les informations confidentielles. Seul le commandant de KIBAT II disposait donc d'informations secrètes. Le Sitrep quotidien contenait seulement des informations confidentielles » (296b).
Le capitaine De Cuyper confirme lui aussi que le colonel Dewez, son commandant de bataillon, ne pouvait s'appuyer que sur les informations qu'il lui transmettait, et que ce dernier n'a en tout cas jamais pu lui fournir d'informations complémentaires (297b).
Les officiers subalternes se plaignent également, dans leur témoignage devant la commission, du manque d'informations et regrettent aujourd'hui que le peu d'informations disponibles ne leur soit même pas parvenu.
Le capitaine Lemaire : « Le deuxième gros problème concernant les fautes relatives à la mort des paras, c'est que pour moi, après coup, et sur place en tout cas, il y a eu une mauvaise exploitation de tous les renseignements dont on disposait. Je vais reprendre plusieurs volets : le colonel Marchal, certainement; le 1-para aussi. Je vais m'expliquer un peu. Il semblerait qu'on savait sur place qu'il y avait un risque de génocide et qu'on savait également qu'il y avait un risque direct dirigé contre les Belges. » (298b).
Son adjoint, le lieutenant Lecomte, le confirme également comme suit : « Je me rends compte maintenant que nous, sur place, nous n'avions que très peu d'informations concernant la menace qui pesait sur le détachement belge. Cette menace était très peu perceptible par nous, sur place. Moi, en tant que commandant en second d'une compagnie « fusilliers » qui se trouvait à Don Bosco, je n'ai pas ressenti cette menace. L'information qui est parvenue à notre échelon et à l'échelon « compagnie » se basait principalement sur des informations provenant du lieutenant De Cuyper et des informations que la compagnie avait réussi à obtenir via certains contacts locaux. Je tiens à préciser que toutes ces informations ont fait l'objet de rapports de situation qui ont été envoyés à l'échelon supérieur.
Mais ces informations concernaient principalement des réunions qui montraient la collusion entre certaines personnalités de la gendarmerie et des groupes d'Interahamwe.
Maintenant, quand on voit la masse d'informations qui provenaient aussi bien de l'ambassade de Belgique, du Service général de renseignements et de la CTM que de l'état-major « secteur », on se rend compte que nous, sur place, nous ne disposions que d'une infime partie de ces informations.
Je n'ai personnellement jamais entendu parler de menaces directes contre des Belges, contre des soldats belges. Maintenant, il suffit aussi de s'imaginer que, toutes les nuits, nous pouvions, à tour de rôle, sortir à Kigali pour se rendre compte que la menace n'était pas présente. Si menace il y avait eu, nous ne serions pas sortis à Kigali toutes les nuits.
Je pense que si une faute cruciale a été commise, c'est certainement dans le manque de distribution de l'information. Je pense qu'avec toute l'information qui est arrivée en Belgique, on aurait pu « la redistribuer » et la renvoyer aux hommes qui étaient sur le terrain, afin qu'ils puissent se rendre compte exactement dans quel jeu, dans quelle situation ils se trouvaient » (299b).
À Evere, l'on savait que nos officiers de renseignements à Kigali étaient mal équipés, mais le général Roman, commandant de la brigade paracommando, affirme que nos hommes à Kigali n'étaient pas inquiets : « Faire une analyse à distance n'était pas dans les capacités de notre service de renseignements (...) Selon moi, les officiers de renseignements sur place étaient mal équipés. Toutefois, je tiens à répéter combien il est difficile de prévoir certaines situations. Nous sommes dans une situation où chacun cherche à montrer qu'il a bien fait son travail. Les officiers du renseignement n'étaient pas inquiets. La preuve en est que certains voulaient, eux aussi, faire venir leur femme. La vérité de l'analyse des renseignements est qu'ils rassemblaient des faits partiels qu'ils ne pouvaient intégrer dans une image plus grande » (300b).
La commission constate qu'une série d'officiers à Kigali ont tenté de récolter quand même un minimum d'informations, mais qu'ils n'avaient aucune formation en la matière et que leurs moyens étaient insuffisants. À Evere, l'on était certes conscient de la situation, mais l'on n'a pas fait grand-chose, ou, du moins, rien de concret pour renforcer les services de renseignements belges au Rwanda.
(3) Les renseignements provenant de la coopération technique militaire
Le colonel Vincent a commandé la coopération technique militaire auprès de l'armée rwandaise à partir de 1991. Il était également le conseiller militaire de l'ambassadeur Swinnen et une source d'informations importante pour le SGR.
Il ressort des témoignages reproduits ci-après que la MINUAR, en général, et KIBAT, en particulier, entretenaient peu de contacts avec la coopération technique militaire (CTM). Les officiers de renseignements belges avaient d'ailleurs pour instruction d'avoir le moins possible de contacts avec la CTM. L'objectif était de préserver la neutralité belge. Bien que ce fût justifié, cela n'a pas favorisé l'échange d'informations.
À la question de savoir comment le lieutenant Nees, le major Podevijn et le colonel Marchal avaient certaines indications sur l'imminence du génocide, et pas lui, le colonel répond: « Je précise que la CTM fonctionnait comme source de renseignements mais ne disposait pas de son propre réseau d'information. Nous nous contentions de rapporter à Bruxelles nos informations. Je n'ai pas perçu l'imminence du génocide et je n'ai jamais pensé au cas de figure du 6 avril 1994. L'assassinat du président n'a été prévu par personne et c'est pourtant cela qui a fait basculer le Rwanda dans l'horreur » (301b).
Le lieutenant-colonel Beaudoin, officier CTM, fait mention d'un entretien avec des officiers des FAR en ce qui concerne le génocide : « Quinze jours avant l'attentat, lors d'un dîner chez chef CTM, le G3 FAR a déclaré que « si Arusha était exécuté, ils étaient prêts à liquider les Tutsis » (302b).
Le colonel Vincent a fourni, devant la commission, des précisions sur la manière dont il traitait les informations qu'il recueillait : « Nous devions contrôler l'inflation des nouvelles. Si la même information nous parvenait trois ou quatre fois, nous aurions pu penser qu'il s'agissait de nouvelles différentes. Étant moi-même coopérant technique militaire auprès des forces rwandaises, des rapports professionnels poussés auraient terni l'image de la MINUAR. Je connaissais toutefois le colonel Marchal mais nous n'évoquions pas nos problèmes professionnels » (303b).
Le colonel Vincent déclare qu'il disposait de bons renseignements, car, en tant que chef du bureau de liaison, il entretenait des contacts fréquents avec le commandement de l'armée rwandaise et il avait beaucoup de contacts avec les responsables rwandais des trois projets belges (304b). Il était également au courant de beaucoup d'informations en tant que conseiller militaire de l'ambassadeur Swinnen, mais uniquement dans le domaine militaire (305b).
Il souligne cependant qu'il n'était pas, lui-même, un officier de renseignements, mais le chef de la coopération, et que ce n'était donc pas à lui de faire des analyses (306b).
D'après le colonel Vincent, les contacts qu'il entretenait avec le major Podevijn, qui travaillait lui aussi pour le SGR, se limitaient à transmettre les documents de celui-ci lorsque son fax était en panne (307b).
De son côté, le major Podevijn confirme ces contacts avec le colonel Vincent : « au début, j'ai utilisé son infrastructure pour expédier des rapports » (308b).
Le « Information officer » officiel auprès de la Force, le capitaine Claeys, a déclaré qu'il avait été en contact avec le colonel Vincent, mais jamais pour des affaires concrètes comme Jean-Pierre. Il s'agissait plutôt de discussions informelles sur la situation en général, comme les incidents continuels, les milices, le climat antibelge, ... (309b).
Le lieutenant Nees, le S2 de KIBAT I, témoigne que ses contacts avec le colonel Vincent étaient uniquement sporadiques : « Dès le début, on nous a dit d'avoir le moins de contacts possible avec la CTM afin de garantir la neutralité belge. Il y avait des militaires belges qui donnaient cours aux Rwandais et qui portaient des uniformes rwandais. Je n'ai jamais eu d'informations au sujet d'une implication éventuelle du colonel Vincent, à Kigali. Nous n'avons eu que des contacts sporadiques » (310b).
La commission constate que le colonel Vincent, parce qu'il séjournait à Kigali depuis 1991 et du fait de la fonction qu'il y occupait, disposait de beaucoup d'informations utiles. Elle constate également qu'il n'y avait, par la volonté de l'état-major, pratiquement pas de collaboration entre la CTM et les officiers de renseignements de la MINUAR et de KIBAT au niveau des renseignements.
(4) La collaboration avec les services de renseignements rwandais et étrangers
Le général Delhotte, le commandant du SGR, témoigne qu'au cas où la CIA ferait une analyse importante qui intéresse la Belgique, elle la communiquerait si on la lui demandait, mais pas automatiquement (311b). Le général pense d'ailleurs que des questions précises ont été posées aux Français et aux Américains concernant les milices Interahamwe (312b). Cependant, il admet que, en ce qui concerne le Rwanda, le SGR n'a pratiquement rien reçu comme information en provenance des États-Unis et absolument rien des Français (313b). À la question d'un commissaire qui désirait savoir si la France a refusé de communiquer ces renseignements, le général Delhotte a répondu par la déclaration suivante : « Il est évident qu'un service de renseignements étranger ne refuse jamais catégoriquement de fournir des informations, mais qu'il dira qu'il ne les a pas. Étant donné que la France avait encore des personnes travaillant sous couverture sur place et qu'elle menait sa propre politique nationale dans cette région, je présume que ce pays disposait quand même d'informations, mais je n'en ai naturellement pas la preuve » (314b).
Le général Verschoore, adjoint du SGR, a confirmé ce fait : « Les services de renseignements français et américains ne nous ont guère fourni d'informations. J'avais l'impression que le seul objectif des États-Unis était d'obtenir des informations de la Belgique » (315b).
Le major Hock, qui était analyste pour le Rwanda au SGR, donne une explication plus précise de la mauvaise volonté des Français : « Nous n'avions pas de relations individuelles avec les services secrets étrangers. Vis-à-vis des Français, le syndrome de Kolwezi subsistait et ce n'est que plus tard que la confiance a été rétablie. (...) Les relations avec la France n'ont pas toujours été simples. (...) Dans le renseignement, lorsque l'on demande quelque chose, il faut offrir autre chose » (316b).
La collecte de renseignements en provenance des collègues étrangers posa également des problèmes sur le terrain à Kigali. Le capitaine Claeys témoigne : « Il aurait été difficile de tester ce genre de choses sur d'autres nationalités. En effet, le bataillon bengali sur place ne faisait aucune collecte d'informations. Cependant, je sais que le général Dallaire a contacté les ambassadeurs de France, des États-Unis et de la Belgique. Je suppose que ceux-ci ont également prévenu leur attaché à la défense sur place. L'attaché des États-Unis était aussi en poste à Bujumbura. Une dame s'occupait également de cette question sur place » (317b).
Le lieutenant Nees (KIBAT I) donne sa version des faits : « Je n'ai eu aucun contact avec les services de renseignements français ou américains. Pour autant que je sache, cela vaut également pour toutes les autres personnes du KIBAT. Nous savions que les militaires français n'avaient pas tous quitté Kigali. Il y avait même des rumeurs selon lesquels les Français écoutaient toutes les communications téléphoniques et radiophoniques. Il n'y avait cependant aucune forme de coopération » (318b).
Le capitaine De Cuyper (KIBAT II) (319b) assistait aux réunions hebdomadaires de la gendarmerie : « Je ne participais pas aux débats lors des réunions hebdomadaires de la gendarmerie. Je n'y étais qu'observateur. J'ai cependant averti le commandant de KIBAT II que ces réunions n'avaient aucune valeur étant donné que le général-major de la gendarmerie éludait toutes les questions et remarques à quelques rares exceptions près. Aucun membre ne s'y est opposé, à l'exception de deux membres du UNCIVPOL. Le colonel français attaché au DAMI (détachement d'assistance militaire à l'instruction) assistait également aux réunions. Il intervenait régulièrement pour soutenir le général-major. Des réunions hebdomadaires se tenaient régulièrement au secteur. On n'y a jamais rien dit d'intéressant et je n'ai guère pu prendre la parole. Aucune information ni analyse ne nous parvenait d'en haut » (320b).
La commission constate qu'il n'y avait pas d'échange d'informations avec les services étrangers. On n'a pas non plus pu recueillir d'informations utiles auprès de la gendarmerie rwandaise. Il n'y a eu des contacts qu'au niveau diplomatique, mais ces contacts n'ont eu aucun résultat pour les officiers de renseignements sur le terrain.
(5) Le traitement des renseignements aux divers échelons à Kigali et à Evere
Dans ce chapitre, la commission étudiera le cheminement des renseignements militaires et diplomatiques à partir du moment où ils étaient recueillis au niveau de KIBAT (et à un échelon supérieur) jusqu'à ce qu'ils parvenaient au SGR et (éventuellement) à l'état-major général. Les témoignages montreront que beaucoup de renseignements ne parvenaient pas au SGR et à l'état-major général et que certains renseignements n'ont pas été appréciés correctement.
Le capitaine De Cuyper, S2 de KIBAT II, explique que sa responsabilité consistait à transmettre des renseignements à son chef de corps : « ... Je n'ai aucun contrôle sur ce qui est transmis au-delà. Je sélectionnais les informations à mon niveau et j'en faisais rapport complet à mon commandant de corps. » (321b)
Son prédécesseur, le lieutenant Nees, S2 de KIBAT I, travaillait de la même manière : « Les rapports étaient quasiment rédigés chaque jour ou tous les deux jours. Le premier destinataire de ces rapports était le commandant de KIBAT, c'est-à-dire le lieutenant-colonel Leroy. Les rapports contenaient un aperçu des informations, des rumeurs, des faits et des pamphlets dont nous avions eu connaissance. Les rapports étaient transmis intégralement au colonel Marchal. Le colonel Leroy n'avait pas le temps ni les moyens de filtrer ces informations. C'est pourquoi il transmettait les rapports au secteur. Par après, j'ai vu que les rapports avaient également été transmis au C Ops. » (322b)
Le lieutenant Nees est très clair sur la question de savoir si on a fait quelque chose de ces informations : « Il n'y a eu que très peu de réactions à mes messages de la part de l'état-major général. En tant que petit pion dans l'armée belge, je ne m'attends d'ailleurs pas à recevoir une demande de renseignements de la part de l'état-major général. » (323b) Lorsqu'un commissaire lui demande si, dans ces conditions, il estimait que son travail avait été inutile, le lieutenant Nees a répondu : « Lorsque j'étais à Kigali, je l'estimais utile, parce qu'il me donnait une idée des structures et des relations politiques existant au Rwanda à ce moment-là. Quand on regarde ce qui s'est passé, mon travail était peut-être bien inutile. » (324b)
En outre, l'officier de renseignement au niveau du bataillon (Nees) n'avait pas de contact avec l'ambassade (325b), de sorte que le cheminement de l'information du bataillon à Bruxelles ne passait pas par notre ambassade.
Le colonel Leroy (Cdt KIBAT I) confirme qu'il recevait de nombreux dossiers, mais que les rapports de Nees constituaient sa seule source d'information : « Cependant, ce n'était pas à moi de faire une analyse. Nous ne sommes pas formés pour cela et nous n'avons pas le recul nécessaire. Nous ne pouvons que collecter des informations et résoudre des problèmes concrets. » (326b)
Le colonel Leroy ajoute qu'il transmettait les informations qu'ils avaient collectés, mais qu'il n'en faisait pas de synthèse. Il n'en avait ni le temps ni les moyens. Il ne pouvait pas faire appel au major Podevijn ni au capitaine Claeys pour cela, car ils ne faisaient pas partie de son bataillon (327b).
Le colonel Dewez (KIBAT II) confirme que, le 3 février 1994, au C Ops, le SGR lui a communiqué certains renseignements. Selon les termes du colonel, on lui a alors exposé la situation en cinq minutes. Au cours de ce briefing, il n'a été fait état, ni de Jean-Pierre, ni des rapports du lieutenant Nees. Le colonel Dewez mentionne qu'il n'y a pas eu de document écrit au sujet de ce briefing de la part du SGR et qu'il dispose simplement de ses propres notes dans son carnet (328b).
Le commandant de secteur, le colonel Marchal, a collecté lui-même des informations à son niveau et il avait connaissance des informations relatives à Jean-Pierre et au rapport du lieutenant Nees, informations auxquelles il attachait l'importance voulue. C'est le colonel Marchal qui a mis l'ambassadeur et le C Ops à Bruxelles au courant : « En ce qui concerne l'importance accordée aux renseignements fournis, je peux affirmer que, après vérification, je n'avais plus aucun doute sur ce qui se préparait. Le nombre et la précision des détails obtenus indiquaient qu'un plan était en phase d'exécution et que sa mise en pratique laissait présager d'un nombre énorme de victimes. Mon évaluation des pertes s'élevait à plusieurs dizaines de milliers de morts.
Ceci a suscité diverses réactions et j'ai prévenu l'ambassadeur ainsi que le centre d'opérations à Bruxelles. Le 17 janvier, le général Charlier m'a téléphoné pour s'informer sur les caches d'armes et sur mon appréciation du général Dallaire. Je lui ai répondu que j'estimais qu'il fallait absolument soutenir le général dans sa démarche. Le 9 février, le général Charlier me contacte à nouveau et je lui réitère ma demande de soutenir le général Dallaire, notamment pour mener des actions offensives. » (329b)
L'officier responsable de l'information au niveau de la Force, le capitaine Claeys, déclare qu'il était en rapport direct avec le SGR, plus particulièrement avec un officier de l'état-major, à savoir le major Podevijn (330b).
Le major Podevijn confirme qu'il avait des contacts quasi quotidiens avec le capitaine Claeys (331b) et il se considère comme une des sources d'information du SGR. Il réunissait toutes les informations et faisait des notes (332b).
D'autre part, le SGR ne faisait pas parvenir d'informations à la Branche 2 (renseignements) de la Force. Le capitaine Claeys témoigne : « Neen, want ik kreeg geen feedback van SGR. Ik werkte op dat ogenblik als Belgisch officier, maar ik was niet in verbinding met de Belgische staf. ... Alle informatie die ik kreeg heb ik, telkens de gelegenheid zich voordeed, doorgespeeld naar zowel generaal Dallaire als naar kolonel Marchal. Men heeft mij altijd geantwoord dat er op hoger niveau geen garanties konden worden geboden aan Jean-Pierre. Men kon dus moeilijk nog meer informatie verwachten.
Alle informatie die hij op vrijwillige basis gaf was welkom. » (333b)
L'on peut résumer comme suit l'échange d'informations entre le colonel Vincent (CTM), l'ambassadeur Swinnen et le SGR : « Le colonel Vincent a rédigé des rapports pour le SGR. Nous en avons la synthèse. Il faisait également rapport à l'ambassadeur Swinnen et les informations qu'il lui transmettait étaient intégrées dans les télex adressés à ce dernier. À part quelques rapports SGR, nous ne disposons pas de rapports directs du colonel Vincent. ... Il y a, par exemple, la réunion avec le président Habyarimana, de février, à laquelle le colonel Marchal et l'ambassadeur Swinnen étaient également présents. Il en existe même un double rapport. Celui du colonel Vincent est adressé au SGR. » (334b)
L'ambassadeur Swinnen déclare devant la commission qu'il a transmis régulièrement des messages à Bruxelles. C'est ainsi qu'il a plaidé pour que l'on continue à suivre très attentivement la question de la sécurité et que l'on n'exclue pas d'entreprendre des démarches supplémentaires à la lumière de certaines évolutions (335b).
L'ambassadeur a également pris des mesures pour que les émissions de RTLM soient écoutées et que Bruxelles soit informée du contenu de celles-ci : « Au départ, cette radio n'émettait qu'une à deux heures par jour en français. À un moment donné, j'ai donné l'ordre d'écouter plus souvent les émissions. Bon nombre d'entre elles ont été enregistrées et j'ai toujours amplement informé Bruxelles de leur contenu. » (336b) Un jeune diplomate, Bruno Angelet, a été envoyé en renfort à l'ambassade en janvier 1994. L'ambassadeur Swinnen déclare qu'il faisait le nécessaire pour envoyer des extraits des émissions de RTLM à Bruxelles. L'ambassadeur admet cependant que les moyens pour ce faire étaient très limités : « Si nous avions pu, nous aurions tout enregistré et demandé une traduction des émissions en kinyarwanda. Nous aurions aussi enregistré radio Rwanda. Mais nous manquions de personnel. Nous écoutions donc les émissions en français diffusées le soir ainsi que les éditoriaux. Nous informions ensuite Bruxelles par télex. » (337b)
La commission constate que ces témoignages ne concordent pas avec les déclarations du général Roman, commandant de la brigade paracommando, qui a répondu formellement « non » aux questions suivantes que lui a posées un commissaire : « Étiez-vous au courant de plans de terroristes rwandais visant à faire exploser les cantonnements belges et de plans visant à empoisonner ou assassiner les Casques bleus belges afin de forcer le retrait de la Belgique de la MINUAR, comme notre informateur Jean-Pierre nous l'avait annoncé ? ... Étiez-vous au courant de l'appel lancé à la fin janvier sur RTLM incitant à viser des cibles belges ? ... Aviez-vous connaissance des informations sur la manière dont on tentait de provoquer les Casques bleus belges ? Ou du Sitrep faisant mention du risque d'une attaque à la grenade ? Certains Sitrep furent également envoyés à la brigade paracommando. Saviez-vous qu'il existait une note du service de renseignements traitant des Interahamwe et des menaces potentielles à l'égard des Belges ? » (338b)
La commission constate que les messages des officiers de renseignements et de l'ambassade ne sont jamais arrivés jusqu'au commandant de la brigade paracommando.
Le général Roman a déclaré à ce propos : « Il y a des documents du terrain qui sont parfois envoyés à la brigade paracommando, mais pas toujours. Les documents du SGR auraient dû m'être transmis. (...) Mais pour lui : « (...) Les informations ponctuelles n'étaient pas utiles au second bataillon paracommando parce qu'elles risquaient d'être mal interprétées. » (339b)
Les informations en provenance de Kigali étaient essentiellement et directement transmises au SGR à Evere, où le major Hock était responsable des analyses concernant la situation au Rwanda. À la question de savoir s'il a reçu ces documents du capitaine De Cuyper, S2 (renseignements) à KIBAT II, le major Hock répond qu'il ne se souvient même pas du nom de De Cuyper, mais bien de Claeys (340b). Le major Hock ne se souvient pas davantage que le capitaine De Cuyper a succédé au lieutenant Nees (KIBAT I). Il déclare en tout cas ne pas pouvoir faire de différence entre ses interlocuteurs en arguant que la continuité dans la façon de traiter l'information était assurée, puisque la fonction (S2) avait été reprise. Lorsqu'on connaît personnellement l'interlocuteur, on s'en souvient mieux, prétend-il (341b). Le major Hock connaissait mieux le colonel Vincent (CTM) et, comme la commission l'a déjà constaté ci-dessus, il accordera davantage d'importance aux informations que celui-ci lui fournit : « J'ai croisé le colonel Vincent, car nous avons fréquenté des écoles équivalentes. Je l'ai personnellement connu lorsqu'il a rejoint le SGR. » (342b)
La commission constate, comme en témoigne le major Hock, que le fait de connaître personnellement son interlocuteur, lorsqu'il s'agit de renseignements joue un rôle important en ce qui concerne l'appréciation du contenu de ceux-ci.
On en trouve une preuve plus concrète dans la façon dont le major Hock a traité les informations fournies par Jean-Pierre : « À l'époque, Jean-Pierre était un inconnu pour nous. C'était un informateur de la MINUAR. Si l'on analyse le personnage, on remarque qu'au départ il appartenait aux services de sécurité de la présidence qui bénéficiaient d'une triste réputation. C'était un déserteur. Donc, a priori, il n'était pas fiable. N'oubliez-pas que l'intox, ça existe. ... Les informations de Jean-Pierre ont été intégrées, mais seulement après vérification, car nous pouvions avoir à faire à un affabulateur. » (343b) Le major Hock déclare formellement devant la commission qu'il fait une distinction déterminante entre les informations, et ce, selon leur source : « La cote 6 (344b) est attribuée s'il n'y a pas de vérification possible. Dans le cas de Jean-Pierre, j'aurais mis la cote F6. » (345b) Un commissaire ayant fait observer que le général Verschoore avait souligné que ce témoignage (de Jean-Pierre) était très fiable et très important, le major Hock répond que « si l'information provient de l'ambassadeur ou de son attaché militaire (le colonel Vincent), la cote fournie sera généralement A 1. » (346b)
Enfin, le major Hock déclare lui aussi qu'il manquait de moyens : « La situation au Rwanda nous paraissait, à cette époque, moins importante que celle du Burundi. Notre service qui, comme beaucoup l'ont souligné, manque de moyens, a donné la priorité au Burundi » (347b).
Le général Verschoore (adjoint au SGR) explique à la commission comment le SGR traitait les informations en provenance de Kigali : « Le SGR est un service militaire placé sous les ordres de l'état-major général. Le ministre de la Défense, le chef de la maison militaire du Roi et, en fonction de la nature des informations, d'autres instances militaires, ont été systématiquement informés.
L'analyse des informations, qui provenaient de différentes sources, consistait en une évaluation de celles-ci. Nous essayions d'en extraire les vraies informations. Nous procédions à des comparaisons et nous en déduisions ce qui était important. Tant en ce qui concerne les informations que les sources, nous analysions ce qui était crédible ou non. Il appartenait alors à l'analyste d'évaluer la valeur des informations.
Le major Podevijn a été envoyé par le SGR en vue de fournir des informations sur la situation de l'époque. Le colonel Vincent était également chargé de transmettre des renseignements. Ces deux personnes n'ont toutefois pas été confrontées, étant donné qu'il s'agissait de puiser le maximum d'informations dans différentes sources. C'est pourquoi on ne procède jamais à une confrontation des sources. Le colonel Vincent n'a jamais été informé de notre conclusion » (348b).
Le général déclare ensuite que le SGR avait uniquement pour but de rassembler des informations et de les transmettre aux autorités compétentes. Le service était placé sous le commandement direct du chef de l'état-major général (JS). Le service n'avait pas pour mission, d'après le général Verschoore, de faire des propositions politiques (349b).
Le général confirme qu'il y a eu des instructions de l'état-major concernant des activités du SGR, mais qu'il ne se rappelle plus de quelles questions précises il s'agissait (350b).
À la question de savoir s'il était au courant de l'existence de Jean-Pierre et des informations qu'il fournissait, parmi lesquelles celle au sujet d'un plan visant à assassiner des Casques bleus belges, le général Verschoore donne en tout cas une réponse catégoriquement négative. Il ne pense d'ailleurs pas avoir jamais lu d'informations au sujet d'un plan visant à assassiner des Casques bleus belges (351b).
Un commissaire déclare que le colonel Marchal considérait, en tant que commandant le plus haut placé, que les informations de Jean-Pierre sur les préparatifs du génocide étaient essentielles. À la question de savoir si ces informations ne constituaient donc pas un signal pour faire intervenir le SGR, et si l'on en avait parlé au C Ops, le général répond une fois de plus : « Pas pour autant que je sache » (352b).
La commission constate néanmoins que le général Verschoore disposait d'informations importantes, comme il ressort des messages alarmants, qui figurent dans le « Complément d'information » du 2 février 1994. Après qu'Evere eut reçu les informations de Jean-Pierre, l'état-major général a chargé le SGR de rassembler davantage d'informations. C'est à ce moment que l'on a rédigé ce « Complément d'information », que le SGR a adressé à divers destinataires, dont le C Ops.
Des informations importantes en provenance de Kigali avaient toutefois déjà été adressées auparavant au SGR. C'est ainsi que le major Podevijn avait, déjà en décembre, transmis des informations concernant un éventuel attentat contre un cantonnement belge. De plus, il y avait les rapports du lieutenant Nees (S2 KIBAT I), dont certains étaient alarmants. (353b).
Le général Verschoore répond qu'il doute fortement que les renseignements du lieutenant Nees soient parvenus au SGR. Il croit qu'ils ont été transmis directement au centre d'opérations. La commission constate toutefois que le SGR a bel et bien reçu ces informations, comme en témoignent certaines pièces du procès Marchal (354b).
Interrogé sur le sort qui avait été réservé à ces informations, le général Verschoore répond ce qui suit : « Les informations qu'on recevait furent traitées et présentées à l'état-major. ... Les rapports ont été acceptés (par l'état-major général). Je ne me souviens pas de critiques éventuelles, mais il arrivait parfois qu'on posait des questions supplémentaires. ... Il y a eu une discussion entre toutes les parties intéressées. À cet égard, je pense aux chefs de l'opération et à leurs responsables, dont le colonel Flament. Celui-ci participa aux réunions. Il disposait de tous les éléments en notre possession, ainsi que des éléments belges. Il devait en tirer ses conclusions. Le SGR n'a pas participé à la prise de décision » (355b).
Le général Delhotte, le chef du SGR, confirme qu'il avait été mis au courant, par l'intermédiaire du colonel Marchal, des informations fournies par Jean-Pierre.
Un commissaire lui demandant pourquoi l'on a privilégié l'information qui était minimalisée par le colonel Vincent (CTM), alors que le SGR disposait de toute une série d'informations alarmantes, le général Delhotte répond : « Les synthèses et les appréciations du SGR n'ont été contredites par aucune autorité locale. Le C Ops n'a pas considéré la voix du SGR comme prépondérante. Il disposait d'autres sources et les renseignements du SGR n'ont pas été critiqués. Si le rapport n'avait pas été plausible, il y aurait eu un choc en retour du général Charlier » (356b).
Et le général Delhotte d'ajouter : « Vincent était un des nombreux informateurs et, comme vous l'avez déjà dit, il n'était pas membre du SGR. ... Vincent avait de l'expérience et pouvait dès lors fournir davantage d'informations » (357b).
Le chef de l'état-major général, le général Charlier, confirme qu'il avait été informé par le colonel Marchal, de l'existence des dépôts d'armes. Il confirme qu'il a lu son rapport et l'analyse qu'en a faite le SGR. Le général Charlier déclare ensuite très brièvement que cela faisait partie des informations négatives qu'il avait intégrées dans l'évaluation de la situation (358b).
La commission constate que les informations de CTM étaient considérés comme bien plus importantes que les informations en provenance des officiers de renseignements de KIBAT.
(6) Le fonctionnement du SGR à Evere
Plusieurs témoignages d'officiers concernés en poste à Evere révèlent qu'il y avait un manque de moyens et d'hommes. Les témoins concèdent, en outre, à plusieurs reprises, qu'il peut arriver, dans le domaine des renseignements, que l'on fasse des erreurs d'appréciation.
Le général Roman, commandant de la brigade paracommando, a déclaré qu'une situation peut évoluer rapidement sur le plan de la sécurité et qu'aucune analyse ne peut être réalisée en Belgique à ce sujet (359b).
Le major Hock, analyste du Rwanda au SGR, concède qu'il y a eu des erreurs d'appréciation : « Nous n'anticipions pas un génocide mais des dérapages en dehors du processus d'Arusha qui auraient pu amener à des milliers de victimes. ... Personne ne pouvait imaginer ce qui allait se passer. Un service de renseignements n'est pas Mme Soleil » (360b). Le Major Hock admet néanmoins qu'il dispose, au SGR, de nombreuses sources d'information, sinon de toutes : « Les sources pour le Rwanda sont la coopération technique militaire, le ministère des Affaires étrangères et, en particulier, l'ambassade du Rwanda et d'autres postes, nos services IH et IC, les services amis, la presse, la Sûreté de l'État à travers la voie hiérarchique et les troupes sur place, c'est-à-dire le major Podevijn, le commandant de secteur et les rapports du lieutenant Nees qui nous parvenaient via le centre d'opérations » (361b).
C'est surtout le chef adjoint du SGR, le général Verschoore, qui se plaint du manque de moyens : « Les moyens dont nous disposions étaient limités. Nous avons fait le maximum avec les moyens disponibles » (362b). Il fournit des précisions sur les personnes dont il a pu disposer et souligne que, selon lui, elles ont fait du bon travail : « Le major Podevijn était le seul spécialiste pour le Rwanda. Le major Hock était responsable pour le Zaïre et le Burundi. Il suivait également la situation au Rwanda, pour pouvoir intervenir en cas de besoin. Le chef de bureau, le major Boogaerts, connaissait également l'Afrique et pouvait éventuellement venir en aide. Plus tard, le major Podevijn reprendra les fonctions du major Hock. Les officiers du même bureau devaient s'initier au plus vite. Ils ont fait un excellent travail » (363b).
Le général a déclaré qu'avec davantage d'analystes, il aurait naturellement pu effectuer un meilleur travail d'analyse. Selon lui, cela suppose également que, sur le terrain, il y ait davantage de possibilités d'obtenir des informations plus fiables. À cet égard, il cite l'exemple de la permanence de 24 h. qu'on n'a assurée qu'après avoir appris, au SGR, que l'avion présidentiel avait été abattu : « Cette permanence prit fin au retour des derniers paras ... Avant cette date, ce n'était pas le cas par manque de personnel ... J'en ai fait part à l'état-major mais aucune suite n'y a été donnée. Le renfort provenait du service même : on n'a pas engagé des personnes de l'extérieur, mais bien des personnes qui travaillaient dans les bureaux d'Afrique et d'Asie. Le SGR travaillait avec des officiers de carrière et un civil » (364b).
Il s'est également plaint de la collaboration avec la Sûreté de l'État : « Les informations échangées entre la Sûreté de l'État et le SGR étaient limitées. La collaboration n'était pas entièrement satisfaisante. Nous transmettions les informations qui nous semblaient importantes pour eux. Le SGR ne faisait pas uniquement des analyses. J'assurais le management du SGR. J'étais associé aux plannings budgétaires, à la question du personnel, aux développements techniques, etc. Ce n'était pas le travail qui manquait » (365b).
Lorsqu'un commissaire lui fit remarquer qu'il ne se souvenait plus de grand-chose, il répondit : « Il est inexact que ma mémoire est défaillante. Je me souviens de beaucoup de choses, mais pas de détails. Je crois que, compte tenu des moyens dont nous disposions, nous avons fait tout notre possible » (366b).
À la question de savoir si après la crise du Rwanda, l'on a fait une analyse et/ou pris des mesures, il a répondu : « Une telle analyse n'a pas été faite. Il y a bien eu une évaluation en vue de remédier aux dysfonctionnements à l'avenir. Ainsi, on a conclu qu'il faudrait disposer de plus d'analystes, assouplir le fonctionnement interne du SGR et prendre des mesures afin de pouvoir retrouver plus facilement les informations » (367b).
Le général Verschoore attribue cette carence en hommes et en moyens au fait que tout est une question de budget et il ajoute que, depuis lors, la situation a peu évolué. Il déclare cependant qu'en revanche, on s'efforce d'améliorer la formation (368b).
Le général Delhotte, chef du SGR, estime que, de manière générale, les faits étaient mieux connus du commandement local que du SGR. C'est ce commandement qui doit en premier lieu évaluer les faits. Le SGR en a cependant fait des rapports de synthèse et journaliers (369b). La commission constate que le commandement local a transmis nombre d'informations utiles au SGR, mais que le SGR n'a pas beaucoup tenu compte de ces informations spécifiques. Il n'en a même pas tenu compte du tout dans certains cas.
Le général Delhotte se plaint, en outre, du manque de personnel : « Le service de renseignements contient une cellule d'analystes avec différents bureaux par région. Alors que le Pentagone peut disposer de plusieurs milliers de personnes par cellule, nous disposons d'analystes par continent. Pour le Rwanda, le Zaïre et le Burundi, nous pouvions disposer de trois à quatre analystes ainsi que de M. Podevijn à Kigali. Le SGR ne dispose pas de résidents sur place. Il utilise les services de volontaires qui ne sont, la plupart du temps, pas payés. Le colonel Vincent en constitue un exemple ... Le SGR appartient aux forces armées. Il ne peut être comparé à la CIA. Il ne s'agit pas d'un service de renseignements national. Il n'y avait, en 1993, aucun centre où ramener toutes les informations. Le SGR est un service à son niveau, comparable au service des renseignements militaires du Pentagone. Le SGR ne possède pas d'hommes sur place. Il n'a donc pas les moyens de faire du renseignement tactique » (370b).
Le général Delhotte, en tant que chef de service, a néanmoins informé directement le ministre Delcroix de ces plaintes. Le général a constaté que la rotation n'était pas importante au SGR et il a dit regretter, en s'adressant au ministre Delcroix, que, depuis des années, il n'y avait plus un seul officier du SGR retenu pour de l'avancement. Pour le général Delhotte, ce n'est pas l'idéal pour motiver (371b).
La commission constate, d'après les témoignages des officiers concernés, que le SGR disposait de moyens insuffisants et d'effectifs trop peu nombreux dont la formation présentait, de surcroît, des lacunes. Il est néanmoins d'une importance capitale, pour que les ordres soient efficaces et opérationnels, de disposer d'une analyse correcte des informations rassemblées. Enfin, la commission constate que l'échange d'informations se faisait principalement dans un seul sens et que les analyses d'Evere ne parvenaient pas à Kigali.
(7) L'information des autorités politiques et la coordination entre les Ministères de la Défense nationale et des Affaires étrangères
Dans ce chapitre, la commission fait une série de constatations concernant l'échange d'informations destinées aux autorités politiques. Dans une première partie, l'on examine si des informations sont parvenues au cabinet de la Défense nationale et, le cas échéant, quelles étaient ces informations, ainsi que les réactions éventuelles qu'elles ont entraînées. Dans une deuxième partie, le même examen est fait au niveau des Affaires étrangères et, dans une troisième partie, l'on examine comment s'est opérée la coordination entre ces deux départements en matière de traitement de ces informations et de prise de décision.
À un commissaire qui lui demandait s'il avait pu vérifier, après coup, lesquelles de ces informations étaient parvenues au cabinet de la Défense nationale et s'il avait l'impression que ces informations étaient transmises de façon régulière, le major Podevijn (Tak 2 Force) a répondu qu'après son retour en Belgique, il a effectivement eu cette impression-là. Mais il ajoute qu'au Rwanda même, il n'avait aucun feedback (372b).
Selon le chef adjoint du SGR, les INSUMS (Information Summary) étaient également transmis au cabinet de la Défense nationale. Ces Insums présentent les faits, une analyse ainsi qu'une conclusion : « Les renseignements fournis à l'état-major étaient essentiellement de nature tactique et concernaient la sécurité sur les routes, l'accès à l'aéroport, etc.
Nous disposions de peu d'informations au sujet de la situation politique. Celles-ci étaient transmises directement au cabinet du ministre. Personnellement, je situe les émissions de la RTLM, les formations ainsi que la distribution d'armes à la fin décembre, début janvier. Les INSUMS présentent les faits, l'analyse et la conclusion. Ma conclusion était que quelque chose se préparait. On a également transmis les INSUMS au cabinet de la Défense nationale. » (373b)
Le général Charlier, chef d'état-major (JS), a expliqué devant la commission comment l'on a organisé la transmission de renseignements du SGR et du C Ops au cabinet de la Défense nationale : « Chaque jour, les officiers du SGR et ceux du C Ops se rencontrent le matin et présentent un exposé couvrant les faits des 24 dernières heures. J'essayais moi-même d'assister à cette réunion. Chaque jour, un document est publié. Il est surtout l'oeuvre du SGR. La contribution de ce service est reprise dans un document périodique qui est transmis au ministre (374b).
Selon le chef d'état-major général, le contenu du document journalier est, selon les besoins, aussi communiqué au ministre. Il faut savoir que le porte-parole du Ministère de la Défense nationale assiste à la réunion quotidienne et que ce porte-parole, qui est un officier, a été mis en place par le ministre. Et le général Charlier de conclure que ce porte-parole est donc chargé de la coordination des informations (375b).
Le général n'a jamais eu l'impression qu'entre l'état-major et le cabinet du ministre, il y ait eu le moindre degré différent d'information. Ainsi, les informations sur la campagne antibelge ont-elles été reprises dans les documents SGR transmis au ministre (376b).
Le général a déclaré que, dans un ensemble d'une ampleur telle qu'est la force armée, le processus de décision est certes structuré autour de différents échelons, mais que, selon lui, la responsabilité en matière de défense et de forces armées est indivisible (377b).
Le général Schellemans, à l'époque chef de cabinet du ministre de la Défense nationale, a confirmé que l'échange d'informations se faisait lors de la réunion journalière de 11 h au C Ops : « Celle-ci (la réunion de 11 h) était consacrée au briefing du chef d'état-major général sur les événements des dernières 24 h ainsi qu'à l'examen des questions laissées en suspens à la réunion de 9 h. Cette réunion n'a fait l'objet d'aucun rapport. La réunion commençait systématiquement par un briefing du SGR, dont il existe un document. Au début, nous ne recevions pas les rapports jusqu'au moment où un pilote du cabinet déclara qu'ils contenaient d'importantes informations. Dès lors, on demanda au général Charlier de les transmettre. Dès ce moment, il furent transmis régulièrement au cabinet. Cela se passait en décembre et en janvier (378b).
Le chef de cabinet confirme que la note de synthèse du major Hock (SGR) du 2 février est, entre autres, parvenue au cabinet. Cette note fait apparaître les risques que mettent en évidence les révélations de Jean-Pierre. On y trouve des allusions aux risques encourus par les Belges de la MINUAR et au génocide, et elle fait également référence à la localisation de familles tutsies. Le chef de cabinet déclare avoir reçu des informations concernant des menaces, mais ces menaces n'étaient pas considérées comme très dangereuses. En ce qui concerne plus précisément la question de savoir si le nom de Jean-Pierre lui était connu, le chef de cabinet a répondu : « Pour autant que je m'en souvienne, le cabinet a reçu des messages d'un certain Jean-Pierre. Le nom de Jean-Pierre n'apparaît dans ces messages que durant quelques jours. À mon avis, le ministre a lu ces messages ... Je confirme avoir vu le nom de Jean-Pierre dans le courrier et qu'en principe ce courrier a été transmis au ministre (379b). Dans un fax du 11 janvier, il est aussi question d'un certain Jean-Pierre et des informations qu'il avait reçues sur un projet de génocide. En ce qui concerne ce fax, le chef de cabinet a déclaré qu'il décidait lui-même des informations des INSUMS et des INTREPS qui étaient pertinentes pour le ministre. Il y a toutefois ajouté que le ministre devait avoir vu la note en question du 11 janvier.
D'une manière plus générale, le chef de cabinet a déclaré, lors de son témoignage devant la commission, que les INSUMS du SGR et les rapports de la Sûreté de l'État lui étaient adressés directement. Il les lisait avant de les transmettre aux « pilotes » (380b). Le chef de cabinet a dit, en outre, qu'il pouvait ainsi déjà faire un rapport oral à l'intention du ministre et que le ministre était donc bel et bien au courant de tous les documents, fût-ce au moyen d'un résumé. Le chef de cabinet n'a jamais constaté la moindre rétention d'informations par l'état-major général. Et le général Schellemans de poursuivre : « Personnellement, je n'ai jamais constaté la moindre rétention d'informations de la part de l'état-major général. Les informations étaient communiquées si le cabinet en faisait la demande ou si nous l'estimions important pour le cabinet. Il y avait également d'autres contacts entre le cabinet et l'état-major général, en présence d'un représentant du cabinet. Nous disposions des rapports de ces réunions. En outre, les contacts téléphoniques étaient également très fréquents. ... Il y eut des contacts réguliers entre le général Charlier et moi-même. Le général Charlier avait pris l'habitude de rendre visite au cabinet (381b).
Le ministre Delcroix a lui aussi déclaré qu'il ne soupçonnait personne d'avoir retenu des informations. Il a précisé devant la commission comment il a été informé de la situation au Rwanda : « L'information sur la situation au Rwanda arrivait à mon cabinet le plus souvent via des canaux informels et parfois aussi via des canaux formels. La source la plus importante était les rapports du SGR. Mon chef de cabinet attirait mon attention sur les événements importants contenus dans ces rapports. Je pouvais également disposer de rapports de synthèse du SGR pour préparer mes entretiens avec les ambassadeurs ou mon voyage à Kigali début mars » (382b).
Le ministre obtenait aussi des informations grâce à la coordination avec les Affaires étrangères, sur laquelle nous reviendrons.
À propos de la présence de représentants du cabinet aux diverses réunions, le ministre Delcroix relativise la déclaration du chef d'état-major Charlier : « Il y avait aussi des réunions quasi quotidiennes à l'état-major à Evere relatives aux diverses actions militaires. Ces réunions avaient lieu à 9 h et on y préparait la réunion de 11 h, qui était dirigée par l'état-major et où les décisions importantes étaient prises. Aucun représentant de mon cabinet n'assistait à ces deux réunions. Mon cabinet ne recevait pas non plus de rapports de ces réunions. Par contre, une réunion hebdomadaire se tenait au sujet du C Ops à laquelle mon collaborateur assistait. Je présume que l'on m'a communiqué d'éventuelles informations importantes issues de ces réunions. Le chef d'état-major, le général Charlier, avait des contacts réguliers avec mon chef de cabinet » (383b).
Le ministre a répété peu après qu'il n'y avait selon lui aucun des ses collaborateurs présents aux réunions journalières. Ils étaient toutefois présents lors de la réunion hebdomadaire, mais on n'y examinait que des affaires secondaires. Le ministre estime par ailleurs que la réunion formelle la plus importante était celle du C Ops qui se tenait à 11 h.
D'une manière générale, le ministre Delcroix a déclaré qu'il n'y avait pas ou presque pas de problèmes de communication entre le commandement et le Ministère de la Défense nationale (384b). Au cours de sa deuxième audition, le ministre Delcroix a répété que l'on ne peut certainement pas accuser le SGR de n'avoir pas suffisamment transmis d'informations à son cabinet et aux instances militaires concernées (385b).
La commission constate que le cabinet de la Défense nationale a eu, par divers canaux, des contacts fréquents avec l'état-major général et que le cabinet a reçu suffisamment d'informations de la part du SGR. Par ailleurs, la commission constate que le cabinet n'a pas donné de missions spécifiques à l'état-major général en ce qui concerne ces informations.
Le colonel Vincent, qui était non seulement chef de la C.T.M. mais également conseiller militaire de l'ambassadeur, faisait toutes les semaines un rapport sur la situation politique et militaire : « D'octobre 1990 à l'arrivée de la MINUAR en 1993, nos rapports quotidiens portaient surtout sur des actions militaires. Une fois par semaine, je rédigeais un rapport sur la situation politique et militaire. Celui-ci était envoyé à M. Swinnen qui le transmettait dans le rapport hebdomadaire au ministère des Affaires étrangères. Après l'arrivée de la MINUAR, notre importance a diminué et l'accent a été mis sur la MINUAR. Nous étions en retrait. Nous continuions cependant à transmettre nos informations directement à Bruxelles » (386b).
Le colonel Vincent déclare également qu'il transmettait ces mêmes informations directement au SGR. Il faisait donc rapport simultanément à l'ambassadeur et au SGR (387b).
L'ambassadeur Swinnen a déclaré devant la commission que son interlocuteur était les Affaires étrangères. Toutefois, dans la plupart de ses télex, il proposait qu'ils soient transmis à certains autres départements ou services, ainsi qu'à d'autres ambassades. Il savait également qu'à Bruxelles, le chef de cabinet et le directeur « Afrique » du Ministère des Affaires étrangères avaient maintenu des contacts permanents avec l'ambassade du Rwanda et d'autres acteurs (388b).
L'ambassadeur a également dénoncé un certain nombre de faits auprès des Nations unies, pour que le secrétaire général informe le Conseil de sécurité et que celui-ci publie les informations afin de mettre la pression (389b).
L'ambassadeur a, en outre, pris lui-même d'autres initiatives : « Moi-même j'effectuais aussi régulièrement des analyses. Les nouvelles hebdomadaires en sont un exemple. J'avais également des entretiens téléphoniques fréquents, entre autres avec le cabinet, l' « Africa-desk », avec Arusha et avec d'autres ambassades. Lors de mes séjours en Belgique, j'ai eu également des conversations approfondies sur notre politique au Rwanda » (390b).
Un commissaire fait remarquer que l'ambassadeur Swinnen n'utilise jamais le terme génocide, contrairement au ministre, qui emploie ce terme plus spécifiquement dans un télégramme qu'il envoie à Delbelonu après sa visite au Rwanda. Interrogé à ce sujet, l'ambassadeur déclare qu'il pense avoir eu connaissance de ce télégramme, mais qu'il ne sait plus s'il l'a reçu à ce moment-là. Pourtant, l'ambassadeur Swinnen est aussi conscient de la gravité des nombreuses informations qu'il reçoit : « Concernant les causes de l'escalade qui a finalement mené au génocide, je répète qu'au cours des mois qui précédaient le génocide, nous avons rassemblé beaucoup d'informations fort inquiétantes... Les informations de JP concernaient essentiellement la manifestation du 8 janvier et la menace portait essentiellement sur cette manifestation-là. Nous avions convenu que nous allions parler en termes généraux en nous référant à la démarche de MM. Dallaire et Booh-Booh. Nous avons insisté sur le point qui concernait la sécurité car nous étions convaincus que le message aurait été perçu et compris » (391b).
L'ambassadeur Swinnen avait déjà déclaré au cours d'une première audition, en mars 1997, qu'il considérait très positivement les échanges d'informations : « À la question de savoir si j'ai été suffisamment bien compris par les autorités belges et si la communication fut suffisamment bonne, je puis répondre très positivement. Les relations entre les autorités belges et l'ambassade étaient marquées par une confiance absolue. Je ne me suis jamais senti isolé, au contraire. Les instructions détaillées des Affaires étrangères me permettaient d'agir efficacement.
J'ai reçu des instructions tant écrites que verbales. À certains moments, j'avais des entretiens téléphoniques quotidiens avec le chef de cabinet Willems, ainsi que de nombreux contacts avec l'administration, en particulier avec le bureau africain. Je me suis donc toujours senti suffisamment soutenu » (392b).
Lorsqu'un commissaire lui demanda concrètement, au cours d'une audition ultérieure, en mars 1997, si M. Swinnen avait reçu des analyses de l'Africa-desk du Ministère des Affaires étrangères, celui-ci lui répondit qu'il était inutile de lui envoyer des tonnes de papier. Il ajouta qu'il croyait bien avoir reçu un certain nombre de documents dans lesquels la politique était stipulée (393b).
M. Lode Willems, à l'époque chef de cabinet du ministre des Affaires étrangères, déclare avoir reçu le rapport de l'ambassadeur Swinnen à propos d'un entretien qui a eu lieu le 13 janvier. À cet entretien participèrent : le général Dallaire, M. Booh-Booh et les ambassadeurs de Belgique, des États-Unis et de la France. L'entretien portait sur la lettre de l'informateur des Nations unies, le dénommé Jean-Pierre. Le lendemain, il y eut un entretien entre notre ambassadeur et ses collègues d'Allemagne, d'Égypte, des États-Unis et de France, en présence du nonce apostolique. Le chef de cabinet, M. Willems, ajoute que l'ambassadeur Swinnen lui a fait savoir à cet égard que, lors de cet entretien, l'aspect sécurité avait été souligné. La crainte générale serait à l'origine de méfiances et de préjugés. Le soir, lors d'une conversation téléphonique directe entre le chef de cabinet et l'ambassadeur, ce dernier a une fois de plus exprimé sa préoccupation.
Selon le chef de cabinet, l'ambassadeur était inquiet parce que les milices se trouvaient sous l'autorité du MRND, et parce que M. Booh-Booh et le général Dallaire avaient signalé des caches d'armes de même que des milices illégales (394b).
Lorsqu'un commissaire attire l'attention sur le fait que le télex nº 32 (du 13 janvier 1994) contient davantage d'informations, à savoir des plans spécifiques visant à assassiner des Casques bleus belges, et demande pourquoi il n'y a pas eu de réaction, le chef de cabinet répond que notre ambassadeur en était informé et avait mis le cabinet des Affaires étrangères au courant. Le chef de cabinet confirme que le ministre était bel et bien conscient, au début du mois de février, de l'évolution négative de la situation au Rwanda. Dans le cadre de son témoignage, il déclare que les informations sur les réserves d'armes se faisaient de plus en plus insistantes et que le blocage de la situation faisait craindre une explosion de violence (395b).
Le ministre des Affaires étrangères déclare devant la commission qu'il ne disposait, sur le plan militaire, que de données provenant de Kigali (le colonel Vincent). L'on obtenait également certaines informations par le biais des réunions de coordination avec la Défense nationale. Le ministre prétend toutefois avoir consacré chaque jour le temps nécessaire à la lecture des messages relatifs à la situation au Rwanda (396b).
La commission constate que le cabinet des Affaires étrangères disposait d'informations détaillées et fiables, surtout grâce aux télex de l'ambassadeur Swinnen. Elle constate également que l'ambassadeur a entretenu de nombreux contacts diplomatiques à divers niveaux et a régulièrement fait rapport de ses constatations.
(c) La coordination entre les deux départements ministériels
Pendant la période examinée, il y avait une réunion de coordination (presque) hebdomadaire entre les départements des Affaires étrangères et de la Défense nationale, à laquelle assistaient généralement aussi des représentants du cabinet du Premier ministre et de la Coopération au développement. Les informations échangées et les sujets traités étaient généralement de nature pratique. En outre, les deux départements échangeaient des renseignements (397b).
À un commissaire qui fait remarquer que plus de cent télex des Affaires étrangères sont parvenus également au cabinet de la Défense nationale, le chef de cabinet Schellemans répond que ces télex provenaient du SGR (398b). Le ministre Delcroix affirme lui aussi que le cabinet de la Défense nationale ne recevait pas systématiquement les télex de l'ambassadeur au Rwanda et que le contact pour l'ONU en Belgique était le département des Affaires étrangères (399b). Un commissaire fait remarquer au ministre que (presque tous) les télex de l'ambassadeur Swinnen mentionnent le cabinet de la Défense nationale. Le ministre prétend cependant qu'il n'a reçu que quelques télex, et qu'il n'était pas le destinataire direct de ceux-ci.
Pour le ministre Delcroix, la réunion de coordination hebdomadaire au cabinet des Affaires étrangères constituait une source d'information. Il prétend toutefois n'avoir jamais lu lui-même les rapports de ces réunions, mais il suppose que son cabinet l'a tenu au courant des éléments importants.
Au cours d'une audition ultérieure, à la fin du mois de mars 1997, le ministre de la Défense nationale a souligné une fois de plus que les réunions de coordination aux Affaires étrangères et les contacts aisés qui existaient entre les départements de la Défense nationale et des Affaires étrangères permettaient également un bon échange d'informations.
Le ministre Delcroix avait l'impression que les Affaires étrangères étaient mieux informées des affaires militaires que le cabinet de la Défense nationale; le ministre de la Défense nationale imputait cela à des relations personnelles, ce dont il ne s'offusquait pas (400b). Le ministre Delcroix estime que les membres du cabinet des Affaires étrangères étaient mieux au courant de matières intéressant son département, mais le ministre Claes prétend exactement le contraire : « Le principe général veut que les informations en provenance du service de renseignements de l'armée ne soient pas mises à la disposition des diplomates. C'est également le cas des renseignements de l'état-major. Les Affaires étrangères ne disposaient que de données provenant de l'attaché militaire à Kigali. Certaines données militaires ont toutefois été communiquées lors des réunions de coordination hebdomadaires réunissant le Premier ministre, la Défense nationale, la Coopération au développement et les Affaires étrangères » (401b).
Pour conclure, la commission constate que les décisions politiques de base ont été discutées en Conseil des ministres, comme le Premier ministre Dehaene en a témoigné devant elle. Le Premier ministre a déclaré que le Conseil des ministres était régulièrement informé de la teneur générale, mais que les télex ne lui étaient pas systématiquement soumis in extenso . Il prétend en outre qu'il ne ressortait pas des télex qu'il pouvait y avoir un climat antibelge généralisé.
3.3.3.12. La collaboration avec les forces armées rwandaises
Sur cette collaboration, les avis sont partagés. Selon certains témoins cette collaboration a été aisée. Par contre, selon d'autres, il y a eu de sérieuses difficultés. Les événements des 6 et 7 avril ont montré que cette collaboration était surtout apparente et que l'on n'a pas pu faire appel à la collaboration des autorités rwandaises au moment où l'on en a eu besoin. Dans cette partie du rapport, nous commencerons par approfondir la question de la composition et des missions de UNCIVPOL et par examiner l'utilité des réunions hebdomadaires qui eurent lieu entre les différentes autorités. Dans une deuxième partie, la commission fournira une idée de ce que fut l'attitude des gendarmes rwandais dans les cas où il fallut exécuter les tâches communes, comme les vérifications aux postes de contrôle et la fouille des caches d'armes. Nous nous intéresserons plus particulièrement ici à l'attitude provocante du colonel Bagosora. Enfin, nous nous arrêterons aux événements des 6 et 7 avril et des jours suivants, qui ont montré que la confiance en la collaboration avec les autorités rwandaises locales n'était plus fondée.
(1) UNCIVPOL et la collaboration
Quels étaient, outre la MINUAR, les différents acteurs à Kigali ? Au niveau local, il y avait essentiellement la gendarmerie nationale ainsi qu'une police communale limitée. Au niveau militaire de l'ONU, il y avait à la MINUAR une branche de la police militaire qui avait une compétence de police à l'égard du personnel des Nations unies. Enfin, toujours au niveau de l'ONU, il y avait le détachement de UNCIVPOL, qui était composé de membres de la police civile, de la police militaire et de la police judiciaire.
Bref, UNCIVPOL était composée de diverses nationalités. La mission principale de UNCIVPOL consistait à surveiller ce que faisait la police locale et à veiller à ce qu'elle fasse son travail de façon efficace et impartiale.
Un colonel autrichien se trouvait à la tête de UNCIVPOL. Il y avait une relation triangulaire entre UNCIVPOL, la gendarmerie locale et la MINUAR. UNCIVPOL a progressivement été élargie de façon à être complètement opérationnelle fin février 1994. L'unité comptait environ 60 personnes.
KIBAT a détaché le S2 (renseignements) pour qu'il participe aux réunions de coordination avec les autorités locales. Concernant ces réunions, le lieutenant Nees (S2 KIBAT I) fait la déclaration suivante : « Je participais régulièrement à des réunions auxquelles assistait également l'état-major. Le but de ces réunions était d'informer tout le monde d'éventuelles manifestations. L'état-major de l'armée me semblait donner là une impression d'un laisser-faire, laisser-passer. Les manifestations précédentes avaient été minimalisées par le général rwandais et il ne donnait que peu d'informations sur les manifestations annoncées. Je me pose des questions sur l'implication des responsables rwandais dans les événements » (402b).
Le capitaine De Cuyper (S2 KIBAT II) assistait lui aussi à ces réunions (403b). « Je ne participais pas aux débats lors des réunions hebdomadaires de la gendarmerie. Je n'y étais qu'observateur. J'ai cependant averti le commandant de KIBAT II que ces réunions n'avaient aucune valeur, étant donné que le général-major de la gendarmerie éludait toutes les questions et remarques, à quelques rares exceptions près. Aucun membre ne s'y est opposé, à l'exception de deux membres d'UNCIVPOL » (404b).
(2) Quelle a été l'attitude de la gendarmerie rwandaise au cours des opérations conjointes avec UNCIVPOL et la MINUAR ?
En 1990, la gendarmerie rwandaise se composait de 2 000 hommes, formés notamment par les Français et les Allemands. En raison de la reprise des hostilités en 1990, ces effectifs ont été augmentés. Le colonel Marchal a déclaré qu'à son arrivée, il avait trouvé 6 000 gendarmes non formés. Le grand problème de la gendarmerie, mais aussi de l'armée, était donc cette augmentation des effectifs et l'absence d'une formation adéquate (405b). La collaboration sur le terrain avec ces gendarmes rwandais était loin d'être idéale. Il y a eu des problèmes de langue, mais aussi et surtout le fait que les gendarmes adoptaient une attitude beaucoup trop laxiste, comme le montrent les témoignages suivants.
Pour le colonel Leroy (KIBAT I), la gendarmerie n'a pas fait sciemment obstacle à la MINUAR, mais il n'y avait pas de collaboration pour autant (406b).
Le colonel Balis, qui était responsable de l'élaboration d'un plan d'évacuation, a confirmé lui aussi qu'il ne comptait pas directement sur sa collaboration. Le colonel supposait toutefois qu'il ne devrait pas opérer en milieu hostile, mais dans un climat de semi-neutralité où la MINUAR ne serait pas visée (407b).
En décrivant l'attitude des gendarmes rwandais aux points de contrôle, les divers témoins constatent tous que cette collaboration était très difficile et que, sur les plans technique et militaire, elle était tout sauf opérationnelle.
Le lieutenant Nees (S2 KIBAT I) confirme que des gendarmes rwandais étaient présents à chaque point de contrôle. Souvent, ils ne parlaient que le kinyarwanda, ce qui entraînait parfois des problèmes de communication. Il fait également état de quelques incidents déplorables à ces points de contrôle : « Il n'y a eu que quelques incidents déplorables. Les problèmes, notamment aux points de contrôle, étaient provoqués en général par les Rwandais. Les problèmes se produisaient durant les missions de patrouille. Les autres incidents étaient provoqués par des personnes de la même tendance politique.
Je me souviens d'un incident où moi-même j'étais à un poste de contrôle. À chaque poste de contrôle, il y avait toujours deux gendarmes rwandais qui contrôlaient les véhicules. Ces contrôles se déroulaient sans la moindre agressivité. À un certain moment, un véhicule a passé un poste de contrôle et les militaires belges ont dû s'esquiver. Je l'ai signalé au commandant de KIBAT et je lui ai demandé également si nous ne devions pas en informer le colonel Marchal » (408b).
Le colonel Marchal a donné à la commission une idée du nombre d'hommes impliqués dans l'organisation de ces points de contrôle : « Dans certains cas, nous disposions d'une section, soit 10 hommes; dans d'autres cas, par exemple pour contrôler un carrefour, nous disposions d'un peloton. Il faut considérer que, pour dix hommes, il y avait quinze gendarmes. Comme nous ne disposions pas d'effectifs actifs suffisants, nous nous sommes coordonnés de manière séparée avec les observateurs de l'ONU. Ce système n'était pas parfait mais représentait une amélioration et un contrôle plus performant » (409b).
La deuxième mission importante de la MINUAR consistait à installer, en collaboration avec les autorités rwandaises locales, une zone sans armes (la KWSA - Kigali Weapon Secure Area). Pour accomplir cette mission, la MINUAR avait un mandat pour rechercher les caches d'armes en collaboration avec les gendarmes rwandais et UNCIVPOL. Le colonel Balis témoigne à ce sujet qu'il avait l'impression que les gendarmes n'avaient pas l'intention de rechercher ces caches.
Le colonel a cependant ajouté que New York n'a pas donné l'autorisation de vider les dépôts d'armes et que, dès lors, il ne pouvait pas savoir si la gendarmerie aurait coopéré (410b).
Le colonel Marchal aussi était conscient du problème que posait l'obligation pour la MINUAR de travailler avec la gendarmerie dans ce domaine. Il a déclaré qu'il devait veiller à sa présence dans toutes les actions, car seule la gendarmerie disposait de la compétence juridique requise, par exemple pour procéder à des fouilles. Le colonel Marchal a cependant tenté à plusieurs reprises de rechercher les caches d'armes avec la gendarmerie rwandaise. Voici le témoignage qu'il a donné à la commission à ce sujet : « Notre idée était d'impliquer la gendarmerie dans la recherche des caches d'armes. Ce n'était pas simple et il y a eu un long travail d'approche qui a finalement abouti à un résultat positif. Mi-mars, la gendarmerie avait procédé à sa première opération de fouille et de bouclage. Ce fut un fiasco qui s'expliquait essentiellement par la méconnaissance technique. Nous étions présents en qualité d'observateur et avons pu définir les problèmes, conseiller la gendarmerie et établir des recommandations qui furent d'ailleurs bien accueillies. La deuxième opération de fouille et de bouclage s'est faite dans le cadre de nos recommandations mais sans participation de la MINUAR. Elle avait donc un caractère purement rwandais. Nous étions bien sûr présents sur le terrain, afin de vérifier que, sur le plan militaire, tout se déroulait normalement et que, sur le plan civil, la législation du pays était respectée » (411b).
Avec la commission, le colonel Marchal constate l'échec de cette mission KWSA. En effet, dit-il, la zone de consignation n'a jamais été réalisée comme elle aurait dû l'être suivant le protocole (412b).
Le chef de cabinet Willems trouve intéressant que ce soient précisément les autorités rwandaises qui aient demandé à la MINUAR et à la gendarmerie de procéder à des actions visant à démanteler les groupes armés. La balle était ainsi dans le camp de New York dont la réponse a été négative, l'opération étant jugée trop dangereuse (413b).
Outre le laxisme généralisé de la gendarmerie rwandaise, la commission a relevé, en particulier, l'attitude récalcitrante du colonel Bagosora, chef de cabinet du ministre de la Défense. Plusieurs témoignages montrent que ce colonel n'hésite pas à menacer les troupes de la MINUAR avec des armes. La commission constate que l'attitude du colonel Bagosora constitue un indice important des motifs véritables et du caractère sincère ou non de la coopération avec les troupes de la MINUAR. Le lieutenant Nees (S2 KIBAT I) témoigne à propos d'un premier incident qui a lieu au début du mois de février 1994 : « Le 5 février, lors de l'installation du KWSA, une patrouille nocturne a remarqué de nombreux Rwandais armés autour de la maison du colonel Bagosora. La patrouille voulait intervenir mais, à ce moment, le colonel Bagosora est sorti et a ordonné à sa garde militaire de braquer ses armes sur les Belges » (414b).
Son commandant de bataillon, le colonel Leroy (KIBAT I), témoigne à propos d'un incident semblable et déclare qu'il a demandé immédiatement après des directives à Bruxelles, mais en vain. Il fait ensuite la déclaration suivante : « Dans la plupart des checkpoints et des escortes, il y a danger lorsqu'il y a provocation. Ainsi, dans un des 152 checkpoints, un véhicule s'arrête et le passager ordonne à ses gardes de sécurité d'armer. Le chef de patrouille fait armer à son tour. Le ton baisse et, sur la carte remise par le passager, qui déclare qu'on entendra parler de lui, on lit Bagosora. J'ai informé le commandant de secteur et Bruxelles, parce que c'était le énième incident qui se produisait dans le cadre de la mission de sécurité. Je ne me sentais pas équipé et entraîné pour y faire face.
À la date du 1er mars, j'ai envoyé un message à Bruxelles demandant des directives, mais en vain, et je me suis refusé à appliquer les ordres, voulant à tout prix éviter de faire remplir par mes hommes des tâches de gendarmerie au lieu de tâches militaires » (415b).
Le commandant de secteur, le colonel Marchal, ne laisse planer aucun doute à propos du colonel Bagosora: « Dès le début, j'ai essayé de me faire une idée de la valeur de ce partenaire. Je n'ai pas seulement discuté avec Bagosora, j'avais aussi de nombreux contacts avec les ministres. Je savais cependant que je ne devais attendre aucune collaboration de la part du colonel Bagosora » (416b).
Enfin, nous notons le témoignage du conseiller en droit de la guerre, le capitaine commandant Noens, qui témoigne que le colonel Bagosora se livrait constamment à la provocation et que celle-ci était très agressive : « Tijdens een van de nachtelijke patrouilles botste een bereden patrouille in een kleine straat op een 30 à 35 gewapende FAR-soldaten.
Dat betekende een grove schending van de regels van de KWSA. Dat wordt aangekaart en nog eens besproken ter gelegenheid van de veiligheidsconferentie van 15 februari, waaraan ook de minister van Landsverdediging, de Stafchef van de Rijkswacht en kolonel Bagosora deelnamen. Deze kolonel was in feite zowat de slechte geest van de groep, de meester-provocateur voor onze para's. Met een brede smile op zijn gezicht verklaarde hij dat er geen enkele overtreding gebeurd was en dat zijn soldaten het volste recht hadden om daar te zijn, want, zo zei hij, ik heb recht op vijf man en ik heb nog een reeks autoriteiten bij mij uitgenodigd die elk hun escorte hebben meegebracht.
Bij dergelijke provocaties, waarbij een Blauwhelm tegenover een FAR-soldaat kwam te staan, had de FAR-soldaat het geweer in de aanslag met een kogel in de kamer, terwijl onze Blauwhelm wel zijn lader op had, maar zonder kogel in de kamer. Dat is een merkelijk nadeel. Wij hebben bij herhaling aangedrongen op een aanpassing van the rules en gevraagd dat onze mensen buiten het kwartier en in zo'n situaties patrouilles zouden mogen uitvoeren met de kogel in de kamer. Ik besef dat dit een gevaarlijke situatie is. Op onze vraag is altijd een negatief antwoord gekomen » (417b).
(3) La collaboration pendant les événements des 6 et 7 avril
La commission constate que le colonel Dewez estime, au moment où lui parviennent les premiers messages alarmants du lieutenant Lotin, que la seule façon de résoudre le problème des barrages routiers consiste à demander l'intervention des gendarmes rwandais. Pour ce faire, il fait appel au commandant de secteur, le colonel Marchal, mais, comme le montrent les faits, le colonel Dewez attendra en vain que les autorités rwandaises interviennent d'une manière ou d'une autre en faveur du peloton Mortiers.
Le colonel Dewez le dit très clairement dans son témoignage : « J'ai eu une conversation avec le colonel Marchal à ce moment-là (pas précisément au sujet de l'escorte de Mme Agathe), et lorsqu'il m'a demandé de reprendre les patrouilles dans l'ensemble des missions, je lui ai fait part des problèmes que nous rencontrions pour les réaliser, notamment à cause des barrages. Il nous fallait obtenir l'aide des gendarmes et si possible des FAR, pour nous aider à franchir ces barrages.
Il m'a appris que, suite à une réunion, la gendarmerie et les FAR collaboraient pour contrôler la situation ... Dès le moment où l'on a repris ces escortes, plus exactement la mission de patrouille, j'ai insisté auprès de tout le monde pour avoir des gendarmes. J'étais persuadé que sans l'appui des gendarmes, on ne pourrait pas passer les barrages. Donc, il me fallait l'appui des gendarmes rwandais pour pouvoir passer les barrages et remplir les missions de patrouille comme on le faisait d'ailleurs d'habitude. Il y a eu des problèmes pour avoir suffisamment de gendarmes; on n'en a eu que quelques-uns. Je me suis également rendu compte en fin de nuit que les gendarmes ne suffisaient pas pour passer les barrages, que ceux-ci étaient constitués de gendarmes et de militaires rwandais et qu'il était quasiment impossible de passer si un officier des FAR n'accompagnait pas les patrouilles. J'ai, à plusieurs moments, demandé au QG-secteur lorsque je savais que mes gens étaient bloqués aux barrages de pouvoir disposer d'un officier FAR pour débloquer la situation. Aussi, lorsque j'ai suivi l'évolution des essais du lieutenant Lotin pour rejoindre Mme Agathe, je lui ai dit : « Si l'on ne veut pas te laisser passer le barrage alors que tu expliques pourquoi, de mon côté, je prends contact avec le secteur » (418b).
Le colonel Dewez est convaincu que cette démarche était la meilleure. Voici ce qu'il dit à ce propos : « Donc, comme je pensais qu'il y avait quelqu'un de l'ONU là-bas, j'ai pris contact avec le colonel Marchal, pour lui dire qu'il fallait absolument intervenir au niveau des forces armées rwandaises, car j'avais des hommes qui se faisaient tabasser alors qu'ils étaient prisonniers ... Sous le coup de l'émotion et du choc je me rendais compte que des hommes à moi se faisaient tabasser j'ai plutôt demandé du secours auprès de la personne qui, à mon sens, était en contact avec les forces armées rwandaises et avec les observateurs de l'ONU, parce que tout cela se trouvait au niveau du QG-secteur. C'est pourquoi j'ai pris contact avec le colonel Marchal, non pour me débarrasser d'un problème, mais en réagissant de manière instinctive. Dans ces circonstances, vous ne réfléchissez pas pendant une heure! » (419b).
Un commissaire fait remarquer qu'il s'avère, déjà entre 5 et 6 heures du matin, que la coopération avec les autorités rwandaises est en fait inexistante. À la question de savoir pourquoi le colonel Dewez n'a pas pris d'autres initiatives à ce moment-là, celui-ci répond qu'il s'était rendu compte que la coopération ne fonctionnait pas, mais qu'il avait mis cela sur le compte du temps nécessaire pour transmettre les instructions du comité de crise aux soldats installés sur les barrages. Il ressort de son témoignage qu'il pensait que les soldats n'avaient pas encore reçu l'ordre de coopération (420b).
Même lorsque le peloton Mortiers avait été désarmé et emmené, le colonel Dewez n'était pas vraiment inquiet. Il déclare que, quand les hommes ont été emmenés par les FAR, il était tranquillisé. Ils étaient prisonniers mais sains et saufs (421b).
L'importance des contacts personnels avec les collègues officiers ressort également du témoignage du colonel Dewez : « (...) À l'époque, quand je suis arrivé au Rwanda, j'ai rencontré des officiers rwandais avec qui j'avais fait mon deuxième cycle, mes études à l'IRSD. J'ai également rencontré le major Ntabakuze, le commandant du bataillon para, avec qui j'avais fait un an aux États-Unis. J'avais confiance en eux ... Et je dois avouer que le major Ntabakuze, tout commandant du bataillon de para qu'il fût, aurait pu dire qu'il était face à l'ennemi... Or, dans la suite des événements, il a tiré certains de mes hommes de mauvaises circonstances. Il est venu et il les a sortis de certains pétrins. Donc, j'avais en effet une confiance dans les FAR se trouvant à un certain niveau ... Je connaissais le colonel Vincent ... Il ne m'informait pas. Nous avons été manger à la CTM » (422b).
Le colonel Marchal a déclaré devant la commission qu'il s'est adressé au général Dallaire pour lui demander son intervention auprès des autorités rwandaises. D'après le colonel, c'était logique, puisqu'il aurait une importante réunion avec ces autorités. Le colonel Marchal a également tenté lui-même de contacter les autorités rwandaises avec lesquelles il était généralement en relation pour leur demander une intervention. Le colonel pense avoir informé le major Karangwa de la situation. Il ajoute que tout s'est passé il y a longtemps, mais qu'il a l'impression que ce major lui avait promis l'engagement des gendarmes (423b).
La commission constate toutefois qu'il n'y avait plus aucune collaboration avec la gendarmerie rwandaise dès la veille du 6 avril, et que les tentatives de trouver des officiers de liaison des FAR étaient vaines. La commission constate avec étonnement que le chef de UNCIVPOL observe, le 6 avril, aux alentours de 20 heures, que la gendarmerie rwandaise est « au complet et bien armée » . L'avion présidentiel ne sera pourtant abattu qu'une demi-heure plus tard et cette nouvelle ne sera diffusée pour la première fois sur Radio Rwanda qu'à 23 heures.
Dans son rapport, le général Uytterhoeven fait le récit exact des diverses demandes d'assistance qui ont été adressées à des gendarmes rwandais et à des officiers de liaison des FAR au cours de la nuit du 6 au 7 avril.
Le bataillon demande une première fois au colonel Marchal, aux alentours de 3 heures du matin, de lui envoyer une section comprenant des gendarmes rwandais, et ce, à la demande du premier sergent Leroy.
Le caporal Lhoir signale entre-temps au bataillon que le lieutenant Lotin est en pleine discussion avec les gendarmes qui se trouvent près du barrage.
À 3h30, le lieutenant Lotin signale au bataillon que les gendarmes rwandais ne peuvent pas non plus convaincre les militaires des FAR de les laisser franchir le barrage.
À 3h45, le colonel Dewez prévient le lieutenant Lotin qu'il fait tout le nécessaire pour lui envoyer un officier de liaison des FAR.
À 3h50, le S3 (capitaine Choffray) précise que le peloton Mortiers doit rester sur place en attendant l'arrivée de cet officier de liaison des FAR.
Le capitaine Marchal est lui aussi bloqué au barrage Mille Collines. Il attend à son tour l'arrivée d'un officier de liaison FAR.
À 4h10, le lieutenant Lotin informe le S3 que l'officier de liaison des FAR n'est toujours pas arrivé et qu'il se trouve encore au barrage Mille Collines (424b).
Ni le capitaine Marchal ni le lieutenant Lotin ne verront jamais un officier de liaison des FAR. Le capitaine Marchal parvient tout juste, sous une pluie de balles, à se rendre dans un cantonnement, alors que le lieutenant Lotin tient bon et atteindra, de sa propre initiative, la maison de Mme Agathe.
La commission constate que les demandes d'assistance adressées aux gendarmes rwandais et aux officiers de liaison des FAR sont restées sans suite depuis 3 heures du matin. Elle constate d'autre part que le colonel Dewez et, dans une moindre mesure, le colonel Marchal, continuent à croire, au moins jusqu'à 10 heures du matin le 7 avril, qu'il sera possible de résoudre la crise en collaboration avec les autorités rwandaises précitées.
En ce qui concerne le comportement des troupes belges au Rwanda, on peut distinguer le comportement des troupes en service et l'attitude des soldats lors des congés et permissions.
3.3.4.1. Le comportement des troupes en service
Plusieurs problèmes liés à l'attitude des soldats belges ont été soulevés devant la commission par différents interlocuteurs. Parmi ceux-ci, nombreux sont ceux qui ont estimé que ces problèmes étaient dus, au moins en partie, à une préparation insuffisante des hommes à la mission qu'ils allaient accomplir. D'autres témoins considèrent que ces problèmes sont dus, en majorité, à des provocations émanant de certains groupes de Rwandais.
Des incidents et difficultés d'application de la mission portés à la connaissance de la commission et liés au comportement des troupes, on peut retirer les éléments suivants.
Manifestement, au début de la mission KIBAT I, les troupes belges en opération ont adopté un comportement militaire classique, défensif, parfois qualifié d'agressif. Cela s'explique par la formation spécifique de paracommando qu'elles ont reçue, privilégiant les capacités de combat, renforcées par la dernière mission exécutée par ces troupes en Somalie quelques mois auparavant seulement, où il s'agissait d'une véritable opération de rétablissement de paix menée dans un climat souvent hostile. Ainsi, on lit dans le rapport de la commission Uytterhoeven, présidée par le lieutenant général Uytterhoeven, qu'il « faut aussi admettre que l'attitude adoptée au Rwanda n'était pas de nature à plaire au paracommando. Elle était éloignée des réflexes de base qui lui étaient jusqu'alors inculqués tout au long de sa formation : dominer la situation, en imposer en étalant sa force et sa confiance en soi. Le paracommando n'est pas un policier et n'aspire certainement pas à jouer ce rôle » (425b).
Le colonel Marchal a déclaré devant la commission : « Nos hommes sortaient de l'opération en Somalie. Au Rwanda, la situation était différente, mais ils croyaient qu'ils devaient travailler de la même façon. Par exemple, la première patrouille à Kigali, le 14 décembre, s'est faite fusil pointé alors que la situation était normale. Cette attitude a surpris la population et a entraîné des critiques. Je crois qu'on pouvait patrouiller d'une autre manière tout en restant prudent . » (426b)
De même, on lit dans le rapport de la commission Uytterhoeven que « les patrouilles eurent au début une attitude fort musclée » (427b). Ces patrouilles, tant à pied, en véhicules, qu'en hélicoptère, ont donné lieu à des plaintes de la part de la population (428b).
L'établissement de checkpoints (points de contrôle routier) fut également source de problème. Les contrôles se faisaient au début arme tenue des deux mains (429b). Cette attitude menaçante fut très mal perçue par la population, « aussi bien les Rwandais que les expatriés » (430b). De plus, de nombreux incidents éclatèrent lors de contrôle de militaires ou de personnalités politiques. Il semble que l'attitude des soldats belges n'ait pas toujours été adaptée à cette mission de simple police, exécutée par des agents étrangers contrôlant les autorités locales. Comme l'a souligné le colonel Marchal devant la commission, « quand le chef d'état-major des troupes rwandaises est arrêté à un contrôle routier, il faut adopter une attitude particulière. C'est ce manque d'adaptation qui est à l'origine de l'incident avec le général Nsabimana. (...) Nous avons connu ce genre d'incident aussi avec le ministre de la Défense et le colonel Bagosora » (431b). Des incidents éclatèrent aussi avec des « VIP civils ou militaires tous proches de la présidence qui ostensiblement refusaient de se soumettre à toute forme de contrôle » (432b). La réalisation du seul « road-block » de toute la mission (consistant à bloquer des personnes, sur ordre des observateurs de l'ONU, pour les empêcher de circuler sans escorte UNMO) fut également source de critiques, basées cette fois, semble-t-il, sur l'attitude désinvolte des troupes (433b).
À propos de la cause de ces incidents, certains ont évoqué l'hypothèse d'un plan visant à déstabiliser les militaires belges (434b). Dans plusieurs situations, le comportement des Rwandais contrôlés s'apparentait, selon plusieurs témoins, à de véritables provocations.
Le colonel Marchal « ne nie pas l'intention de déstabiliser le détachement et de susciter des incidents » , mais ne pense pas qu'il s'agissait d'un plan concerté de déstabilisation. De plus, il estime « qu'un militaire professionnel doit pouvoir éviter ce genre de piège (435b). (...) « La conclusion que j'ai tirée des incidents qui se sont produits pendant les contrôles routiers était que le détachement n'était pas préparé et qu'il y avait une méconnaissance de l'environnement dans lequel il évoluait. Cela engendrait des attitudes inamicales et inutilement agressives . » (436b)
Le lieutenant Nees a évoqué plusieurs provocations lors de son audition devant la commission d'enquête. Il cite notamment le cas de l'intervention d'une patrouille la nuit près de la maison de M. Bagosora, lors de laquelle ce dernier « a ordonné à sa garde militaire de braquer ses armes sur les Belges » (437b). Dans un document du 7 février 1994, Nees écrit qu'il faut considérer l'attitude antibelge non comme hostile à l'égard des Casques bleus belges, mais comme faisant partie d'une politique délibérément dirigée contre les Belges; il a confirmé ces propos devant la commission (438b).
L'auditeur militaire Van Winsen estime quant à lui, après enquête, que « les provocations ont été nombreuses, sans qu'elles soient suivies de réaction ». Il ne veut pas pour autant privilégier l'idée selon laquelle ces provocations s'inscrivaient dans un plan visant à obtenir le départ de la MINUAR, et qui aurait impliqué l'assassinat des soldats belges, même s'il ne peut rejeter totalement cette idée (439b).
À la suite de ces nombreux incidents, un changement d'attitude a été exigé par l'état-major [du secteur et de la Force] (440b).
Dans les checkpoints, les contrôles se firent « arme à la bretelle ». Bientôt, « le Force Commander (FCO) décida en date du 6 février 94 de mettre provisoirement un terme aux CHP [checkpoints] établis par des militaires belges. Ce n'est qu'en date du 25 février que les CHP furent remis au programme » (441b).
Les patrouilles à pied se firent moins nombreuses, ainsi que les arrêts lors des patrouilles en véhicules. On expliqua aux troupes que le but de ces patrouilles était « de prendre contact avec la population, amicalement. Fin mars, ces patrouilles étaient surnommées « patrouilles Coca-cola » (442b).
Après avoir eu une attitude « militaire », les forces belges ont adopté une attitude plus proche de celle de « policier de quartier », selon le rapport de la commission Uytterhoeven (443b).
Cette interprétation est cependant nuancée par le colonel Marchal qui s'insurge contre l'affirmation selon laquelle « il voulait limiter le rôle des militaires belges à celui « d'agents de quartier ». Il estime « avoir toujours exigé une mentalité d'opération ». Il a déclaré avoir « défendu une attitude conciliant une apparence décontractée et le doigt posé sur la détente (...) ma devise était « relax mais vigilant ». De ce point de vue, le colonel Marchal semblait en phase avec le général Dallaire.
Mais le colonel reconnaît lui-même que, si ses instructions concernant la décontraction apparente ont bien été appliquées, l'exigence de vigilance accrue a été moins bien rencontrée.
Lors de la préparation de KIBAT II, on a donné des consignes de modification de cette attitude. « On mit spécialement l'accent sur la différence d'attitude à adopter, en comparaison avec la Somalie. La philosophie de base était que l'on se rendait au Rwanda comme invité et que, dès lors, la coopération (avec la gendarmerie notamment) était la clé du succès » (444b).
Comme les militaires l'ont souligné eux-mêmes, il apparaît que ce changement ne s'est pas toujours fait sans problème (445b). « À titre d'illustration, l'on peut dire que le conseiller en droit de la guerre a notamment attiré l'attention sur certaines réactions divergentes des cadres subalternes au cours de la formation »(446b).
Dans une partie suivante, la commission fera une série de constatations sur la fonction et l'importance de ce conseiller en droit des conflits armés (CDCA).
Indépendamment du rôle de ce CDCA et des problèmes qui y sont liés, la communication des règles de comportement et son intégration par la troupe paraît avoir été difficile. À la suite des incidents de début de mission, il a donc fallu insister, tant sur place pour la deuxième partie de KIBAT I que lors de la préparation en Belgique de KIBAT II, sur la retenue nécessaire, et sur le caractère contraignant des ROE. « On a tant insisté sur les interdictions contenues dans les ROE que, finalement, le principe le plus important la légitime défense n'était plus présent à l'esprit des exécutants » (447b). La qualité de l'armement et des munitions, adaptée à un rôle de policier, mais qui rendait illusoire aux yeux des soldats toute action militaire sérieuse, « certainement eu une influence sur la vigilance des paracommandos, leurs réflexes de base, voire même sur leur sens de l'initiative et leur confiance en soi » (448b).
Enfin, « il faut ajouter que les cas pendants devant l'auditorat général, à la suite des opérations ONU en Somalie auxquelles ces mêmes unités ont participé, continuent de créer une certaine peur d'être jugé pour avoir utilisé son arme » (449b). L'auditeur militaire Van Winsen a affirmé que certains hommes « étaient traumatisés par les poursuites engagées » (450b).
« Sur le terrain, cela se traduisait par un sentiment d'impuissance » (451b). « Cela a conduit à une certaine démobilisation des esprits, mettant en doute l'utilité des patrouilles, contrôles ... » (452b).
On est donc passé d'un extrême à l'autre : à un comportement conquérant et peut-être trop agressif, a succédé une attitude effacée, incertaine. Bien entendu, aucune de ces attitudes ne convient aux missions de peace-keeping , lesquelles exigent « une maîtrise de soi de tous les instants, accepter de rester vigilants pendant de longues périodes, et contrôler son stress » (453b).
Alors que les incidents dus, d'une part, au comportement inadapté des troupes au début de la mission et, d'autre part, à une volonté de provocation de la part des Rwandais ont pu créer, ou renforcer, un sentiment de défiance vis-à-vis du contingent belge qui a pu mener à une attitude plus menaçante, l'attitude adoptée ensuite par nos troupes ne permettait pas de faire face à cette attitude menaçante, puisqu'il n'était plus question de « montrer sa force ». En somme, face à une attitude peut-être hostile mais peu menaçante, les paras ont adopté un comportement considéré comme agressif par certains; ensuite, face à une attitude réellement menaçante et face à une hostilité grandissante, les paras ont fait montre d'une attitude plus passive.
Le capitaine Theunissen témoigne également de la diminution du respect à l'égard des paras belges. Le capitaine Theunissen a déclaré au sujet de la valeur plutôt symbolique des barrages mis en place par les Rwandais : « Je vous ai parlé la dernière fois des barrages où l'on mettait deux cailloux et une baguette sur la route. Les gens faisaient demi-tour parce qu'il n'était pas question de forcer des barrages. Le soldat rwandais qui voit ce genre de réaction est conforté dans son idée que cette fois-ci il peut y aller : Belges ou pas de Belges, ils ont un béret bleu et il peut en profiter au maximum » (454b).
C'est ce que confirme le lieutenant Lecomte au cours de son audition du 7 mai 1997 :
« Ce n'est pas d'office, mais je pense que de voir en permanence les Belges cotoyer les gendarmes rwandais en ayant une attitude assez passive et assez discrète également fait que les Rwandais se sont sentis en position de supériorité vis-à-vis des troupes belges. »
Ensuite, le lieutenant Lecomte a déclaré :
« Je pense que, si on avait pu faire preuve de plus de fermeté, je ne dis pas que la situation ne serait pas arrivée, mais leur attitude aurait été totalement différente » (455b).
Nous retrouvons également des remarques similaires dans les déclarations faites à la commission Uytterhoeven : le sergent Bulinckx affirme par exemple :
« On nous a tellement martelé Show the flag que je me suis senti en faute après avoir utilisé les armes pour me défendre... Certains officiers (Capt. Marchal) se sont fait fouiller et désarmer par les FAR en passant un road block » (456b).
Dès lors, la commission Uytterhoeven a tiré la conclusion suivante, qui est importante :
« Sur le terrain, cela se traduisait par un sentiment d'impuissance : dans tous les cas, le succès d'une opération dépendait du bon vouloir des Rwandais. La MINUAR n'avait pas les moyens d'imposer sa volonté, son Comd n'a d'ailleurs jamais voulu utiliser la force pour ce faire. Cette impuissance de la MINUAR ne devait évidemment pas passer inaperçue des Rwandais. Ils ont donc pu estimer ne guère courir de risques en bloquant la MINUAR, voire en s'en prenant à ses troupes » (457b).
Cela a entrainé une réduction importante de la crédibilité de la MINUAR, qualifiée d'ailleurs de « Minua » (en kinyarwanda, « ceux qui parlent »).
À la suite de problèmes de formation, et des corrections brutales qui suivirent, il n'y eut donc jamais d'adéquation entre le comportement des troupes et la situation sur le terrain.
Le rôle du CDCA était important au sein des missions de KIBAT I et II.
L'existence du CDCA est prévue par le premier protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949, art. 82. La mission du conseiller a été définie après les événements au Rwanda par l'état-major :
« a. Conseiller les commandants militaires quant à l'application du droit des conflits armés, quant à la doctrine existante et à l'enseignement.
b. En cas de participation à une opération extérieure, conseiller les commandants en ce qui concerne les aspects du DCA (Droit des conflits armés) inhérents à ce type de mission » (458b).
Le commandant Noens était conseiller en droit des conflits armés auprès de la MINUAR, plus particulièrement auprès du KIBAT I. Il n'a été désigné comme tel que le 22 novembre 1993, après que la presse eut fait état de la mauvaise conduite des paracommandos en Somalie. Comme les directives destinées au CDCA se limitaient à un ordre général fort succinct de 1991, il a dû, pour ainsi dire, déterminer lui-même sa propre mission. En tant que conseiller de l'état-major, il vérifiait si les instructions étaient conformes aux règles d'engagement et au droit humanitaire. Le commandant Noens a rendu un seul avis négatif, sur le fait que l'armée belge n'était pas formée aux missions de maintien de l'ordre. Il assistait aux réunions de sécurité avec les Rwandais et donnait des cours de droit humanitaire au KIBAT I. Selon le commandant Noens : « Het werk op het terrein gaf dikwijls aanleiding tot hevige maar positieve discussies met de mensen, met de troep aangaande het nut van het oorlogsrecht en het nut van de VN-opdracht » (459b).
D'après le commandant Noens, nos soldats n'étaient pas préparés à la mission de maintien de la paix au Rwanda : « ... de para's die vertrokken zijn, hebben gedacht dat het een gemakkelijke operatie was en dat men in zekere zin een ruiloperatie had gedaan. (...) Het was allerminst aangenaam, vooral op mentaal gebied omdat zij van de Force en de sector kritiek kregen, vaak ten onrechte. (...) Zij hadden de indruk niet begrepen te worden, en vooral niet gesteund te worden » (460b).
Pour le commandant Noens, les divers messages fax envoyés à Evere soulignaient la nécessité de mieux préparer KIBAT II. Il craint que ces messages n'aient eu un effet négatif en ce sens que les hommes ont eu le sentiment de ne plus rien pouvoir entreprendre. Le commandant juge néfaste que les Casques bleus aient d'abord patrouillé à pied, en section (show the flag ) et armés et que, par la suite, ils aient réduit leur armement. Le commandant Noens estime que « ... Dat was in de kaarten spelen van bepaalde FAR-officieren die helemaal niet Belgisch gezind waren » (461b).
Au commandant Noens a succédé le major Bodart, qui a assumé la tâche de conseiller en droit des conflits armés pour le KIBAT II. Le commandant Noens et le major Bodart ne sont pas issus de la brigade paracommando et n'en font pas davantage partie. La commission constate pourtant que les rapports entre le commandant Noens (KIBAT I) et le premier bataillon para de Diest étaient assez bons, tandis que ceux qu'entretenaient le major Bodart (KIBAT II) et le deuxième commando de Flawinne avaient un caractère plutôt polémique.
Le major Bodart explique la situation comme suit : « J'ai fait en tout et pour tout trois interventions. La première c'est le 7 avril au matin lorsque j'ai vu arriver un chauffeur dans le cantonnement où je me trouvais, équipé d'une grenade. J'ai dit, tiens on a distribué des grenades. Je l'ai vérifié près du colonel Dewez qui m'a dit : « c'est normal, ils doivent pouvoir se défendre ». Ma deuxième intervention n'a pas trait à un phénomène d'armement mais à un bête problème de parking. J'ai demandé à un chef de section qui rentrait d'une mission relativement dure c'était la compagnie qui était à Don Bosco de bouger sa camionnette qui était dans le chemin. Au même moment, nous recevions des autobus pour évacuer des expatriés qui étaient à l'hôtel Méridien. Il y avait une certaine excitation. Je lui ai demandé à plusieurs reprises de déplacer sa camionnette. Il ne l'a pas bougée. Après trois fois, je l'ai légèrement empoigné par le bras pour le tourner vers sa camionnette en lui demandant de la bouger. À ce moment-là, un lieutenant a failli en venir aux mains. Je crois que cette réaction est tout à fait légitime » (462b).
Pour ce qui est de ce dernier incident, il apparaîtra toutefois que le commandant du bataillon, le colonel Dewez, avait donné l'ordre de sortir les MI.50. Le major Bodart témoigne qu'il n'était pas au courant de cet ordre. Il témoigne également qu'il a parfois dû entendre des mots durs, ce que confirment les témoignages suivants de quelques cadres inférieurs.
Le capitaine Theunissen a fait le témoignage suivant concernant le major Bodart : « Je le considère comme incapable. À aucun moment, il n'a appuyé son colonel » (463b).
Le caporal-chef Pierard a porté le jugement suivant sur le CDCA : « Je ne sais s'il s'est bien rendu compte de la situation » (464b). Et le caporal-chef Pierard d'ajouter que le major Bodart ne lui a donné aucun cours de droit de la guerre.
Le caporal Kinkin a dit quant à lui : « Nous avions l'impression que Bodart ne servait à rien. Il était là pour aider les Noirs, pas les Belges » (465b).
La commission constate que les CDCA de KIBAT ont dû remplir leur mission à Kigali alors qu'ils n'avaient pas été suffisamment préparés. Ce n'est qu'en 1995-1996 qu'un ordre de service précisera plus avant en quoi consistent la mission et la fonction de CDCA. De même, en ce qui concerne le recrutement de ces CDCA, la commission constate que leur candidature était volontaire et que la formation était très sommaire.
La commission constate, en outre, que le commandement s'est heurté, à plusieurs reprises, à des ordres contraires du CDCA, surtout lors du KIBAT II, ce qui ne fit qu'accroître la confusion parmi les troupes concernant leur comportement militaire et opérationnel. Au cours du KIBAT II, le rôle du conseiller militaire a manifestement été un problème en soi, du fait de sa personnalité et de certaines de ses positions (466b).
3.3.4.2. L'attitude des soldats hors service
Les militaires belges ont pu se promener, hors service, dans la ville de Kigali. En effet, des sorties étaient autorisées, et les congés pouvaient se prendre dans la zone d'opération.
Quant aux sorties, il a paru « normal » au commandement de KIBAT I, le lieutenant-colonel Leroy, « d'autoriser les sorties pour autant qu'elles se déroulent selon des règles très strictes (tenue civile, pas d'armes, sous la protection des RP, dans des endroits reconnus, et selon un horaire, et un tour de rôle préétablis) (467b). Ces règles sont précisées (pour KIBAT II), notamment dans un document daté du 19 mars 1994 signé par le LtCol Dewez consacré aux « régimes des sorties » (468b). Elles prévoient des sorties dans des restaurants autorisés, de 18 heures à 23 heures.
Les congés étaient organisés selon les règlements de l'ONU, qui « prévoient 2,5 jours de congé par mois presté dans la zone de mission, soit environ dix jours à prendre au cours des quatre mois de missions pour autant que la Sit. Ops le permette » (469b). En ce qui concerne ces congés, « le Rwanda et la Belgique entretenant des rapports cordiaux d'État à État, le FCO, le Sect Comd et le Comdt de KIBAT n'ont trouvé aucune raison valable au fait que des familles ne soient pas autorisées à se rendre à leurs frais à Kigali. D'autre part, si les congés devaient être pris dans la zone Ops, rien ne s'opposait en fait à ce que des Mil belges, accompagnés ou non de leur famille, prennent ces congés dans la KWSA, et plus particulièrement dans la ville même de Kigali » (470b).
Le 2 avril 1994, le lieutenant-colonel Dewez informait les troupes que « des problèmes de divers ordres se sont posés avec KIBAT I. KIBAT II n'a plus droit à l'erreur ». Et il imposait des restrictions dans le cadre des congés, notamment en imposant au personnel prenant ses congés dans la KWSA de rester soumis, en dehors du cantonnement, aux mêmes règles que le personnel qui n'était pas en congé (471b).
Ces « problèmes de divers ordres » étaient notamment de « nombreux incidents à caractère judiciaire ou disciplinaire » (472b). La note du lieutenant-colonel Leroy précise que « à la suite de nombreux incidents survenus en cours de service, mais pas par le fait du service, vingt militaires belges appartenant à KIBAT I ont été renvoyés en Belgique au cours des quatre mois qu'ont duré les Ops ». La note évoque des cas évidents de méconduite, d'indiscipline, voire d'escroquerie, et précise que, compte tenu de vols, d'accidents de la circulation, de plaintes diverses, l'auditeur militaire a traité en tout et pour tout soixante-cinq dossiers en date du 17 mars 1994. Dans les 65 dossiers sont inclus ceux où des militaires belges étaient les plaignants.
Le lieutenant-colonel conclut en espérant « que la justice suivra son cours et que certains éléments qui ont nui gravement au renom de l'unité, voire du pays, seront écartés de l'armée, où ils n'ont pas leur place. Pour ceux qui ont fauté moins lourdement, mais qui se sont rendus coupables d'actes répréhensibles qui sur place ont trouvé une incroyable caisse de résonance, qu'ils sachent qu'ils seront punis conformément aux règlements, mais de façon à ne pas pénaliser l'immense majorité de ceux qui se sont comportés comme il se doit ».
Le lieutenant-colonel Leroy confirme que « l'énorme majorité [de ses hommes] ont réussi à se conduire en adultes responsables, et à être nos meilleurs ambassadeurs auprès des instances de l'ONU, de la communauté expatriée, et surtout du peuple rwandais ».
Lors de son audition par la commission, le lieutenant-colonel a précisé que « certains individus ont nui à l'image de leur unité. Ils ont été punis. Les missions se sont déroulées du mieux possible selon les moyens dont nous disposions » (473b).
La commission a appris de diverses sources que ces incidents disciplinaires n'avaient rien à voir avec la mission. Il s'agissait, pour l'essentiel, de rixes durant les sorties. La multiplication des incidents a entraîné la menace d'interdiction de ces sorties puis sa mise en oeuvre. Cette suppression des sorties tenait à des raisons de sécurité mais elle était aussi la conséquence de ce que certains militaires belges de la MINUAR s'affichaient ostensiblement avec des Rwandaises Tutsies, ce qui provoquait des commentaires sur RTLM et de nombreuses caricatures dans la presse locale. De plus le général Dallaire a envisagé le renvoi de KIBAT I en raison de ces dérapages (474b).
A aussi été rapporté un incident qui s'est produit début mars : des hommes de KIBAT I, ivres, s'étaient rendus à l'Hôtel des Mille Collines où ils ont saccagé différents étages. Cela a sans aucun doute terni l'image du détachement.
Ici aussi, on a évoqué l'existence de provocations visant à déstabiliser le contingent belge. Ces provocations ne justifient pas les nombreux dérapages que l'on a observés dans le comportement des troupes.
Lors de la préparation de KIBAT II, une importance particulière a été accordée au respect de la discipline. Cela semble avoir porté ses fruits. Il n'y paraît plus avoir eu d'incidents graves à déplorer, et le comportement des troupes en congé ou en sortie semble avoir été plus adapté. De ce point de vue, il y a donc eu une évolution favorable.
Pour rappel, tel qu'il est défini dans la résolution nº 872 du Conseil de Sécurité des Nations unies, le mandat se basait sur les accords d'Arusha conclus le 4 août 1993. À l'origine, ces accords confiaient un mandat bien plus large à ce qui s'appelait encore la force internationale neutre (FIN). Les accords d'Arusha prévoyaient que la mission de la FIN consistait à « guarantee overall security of the country » tandis que le point 3a de la résolution nº 872 qualifie le mandat de la façon suivante : « to contribute to the security of the city of Kigali, inter alia, within a weapons-secure area established by the parties in and around the city ».
Le mandat des troupes de la MINUAR est donc fondé sur le point 3 de la résolution 872 approuvée par le Conseil de Sécurité des Nations unies (cf. 3.1.4 (4)).
Les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Russie ont été d'emblée hostiles à l'opération. Petit à petit, ils y ont consenti avec réticence. Cette attitude a abouti à l'adoption d'un mandat affaibli et d'une réduction des effectifs proposés.
La Belgique ne faisait pas partie du Conseil de sécurité; elle n'a donc pas été directement associé à la discussion relative au mandat.
Lors de son audition, le Premier ministre M. Dehaene déclare : « À ce moment, il n'était pas habituel que des pays non membres du Conseil de Sécurité s'immiscent dans les mandats. Ce n'est qu'après un certain nombre d'expériences en Yougoslavie, au Rwanda et en Somalie que certains pays ont posé des exigences vis-à-vis des Nations unies.
Ainsi, ils ont obtenus que les pays qui fournissent les troupes doivent être associés à la fixation du mandat. » (475b)
Il n'est pas inutile de rappeler ici les termes du mandat conféré par le Conseil de Sécurité à la MINUAR:
« a) Contribuer à la sécurité de la ville de Kigali, notamment à l'intérieur de la zone libre d'armes établie par les parties s'étendant dans la ville et dans ses alentours;
b) Superviser l'accord de cessez-le-feu, qui appelle à la mise en place de points de cantonnement et de rassemblement et à la délimitation d'une nouvelle zone démilitarisée de sécurité ainsi qu'à la définition d'autres procédures de démobilisation;
c) Superviser les conditions de sécurité générale dans le pays pendant la période terminale du mandat du gouvernement de transition jusqu'aux élections;
d) Contribuer au déminage, essentiellement au moyen de programmes de formation;
e) Examiner à la demande des parties ou de sa propre initiative, les cas de non-application du protocole d'accord sur l'intégration des forces armées, en déterminer les responsables et faire rapport sur cette question, en tant que de besoin, au Secrétaire Général;
f) Contrôler le processus de rapatriement des réfugiés rwandais et de réinstallation des personnes déplacées, en vue d'assurer que ces opérations sont exécutées dans l'ordre et la sécurité;
g) Aider à la coordination des activités d'assistance humanitaire liées aux opérations de secours;
h) Enquêter et faire rapport sur les incidents relatifs aux activités de la gendarmerie et de la police. » (476b)
Selon le Secrétaire Général, deux des quatre fonctions que la Mission doit remplir sont donc:
« a) Contribuer au maintien de la sécurité de la ville de Kigali (...)
« c) Continuer à surveiller la situation, du point de vue de la sécurité pendant la période finale du mandat du gouvernement de transition devant aboutir aux élections; (...) » (477b)
La sécurité de Kigali serait assurée en déployant un bataillon d'infanterie et une compagnie de véhicules blindés transporteurs de troupes pour assurer notamment la sécurité de l'aéroport, du camp du FPR, des bâtiments publics, des membres du gouvernement de transition.
À Kigali et dans la zone démilitarisée, la MINUAR devrait récupérer et vérifier les armes, installer des poste de contrôle, effectuer des patrouilles et assurer la sécurité des points de rassemblements et de cantonnement.
On peut constater que ce mandat utilise des termes peu interventionnistes: « contribuer, superviser, examiner, aider, enquêter ». Il s'agit d'un mandat classique de maintien de la paix (peacekeeping).
La commission s'est penchée sur les raisons qui ont conduit à l'élaboration d'un mandat aussi faible.
On peut tout d'abord trouver une explication dans l'attitude des USA:
Quelques jours avant la décision du 5 octobre 1993, 18 Casques bleus américains ont été assassinés en Somalie. Les rebelles somaliens ont traîné les corps des soldats américains dans les rues de Mogadiscio devant les caméras de CNN. Ces images ont traumatisé l'opinion publique américaine et déterminé l'attitude du gouvernement américain.
Ils ont donc mis tout leur poids pour imposer leur point de vue au Conseil de Sécurité.
À ce propos M. Cools déclare : « Les Américains ont confirmé par après leur peu d'intérêt pour une nouvelle opération en Afrique, l'opinion publique et le congrès étant négatifs à ce sujet. En outre, le Président Clinton a défini des règles d'intervention plus strictes.
Ils proposent 500 hommes, ce qui est une misère. Les Français proposent 1 000 ce qui n'est pas beaucoup mais leur raisonnement est que si l'on demande trop, les Américains vont refuser d'intervenir.
On arrive finalement à 2 500 hommes. Une commission commune FPR-gouvernement rwandais avait assisté à une séance du Conseil de Sécurité et avait montré sa volonté d'opérer la réconciliation et de mette en oeuvre les accords d'Arusha. Ceci avait fait forte impression notamment sur les Américains qui décident de lancer une opération sur base du chapitre VI nécessitant l'accord des parties.
Je tiens à préciser que la différence entre les chapitres VI et VII ne repose pas sur le fait de faire ou non usage des armes, mais sur l'existence ou non d'un accord entre les parties. » (478b)
Dans son exécution, le mandat s'est trouvé encore affaibli par l'interprétation qui en a été faite sur place.
M. Gasana, un représentant du CRDDR (Comité pour le respect des Droits de l'Homme et de la Démocratie au Rwanda), déclare : »De janvier à mars 1994, la mise en place des institutions fut sans arrêt sabotée en sous-main par les partisans de M. Habyarimana. (...) Malgré l'évolution négative de la situation, la MINUAR fut littéralement paralysée parce qu'elle interprétait restrictivement son mandat. Le 6 avril, le plan du génocide fut déclenché et le manque de préparation des troupes ne permit pas d'y faire obstacle. » (479b)
M. Claes met en cause la responsabilité du général Dallaire. Lors de son audition, M. Claes fait référence à une lettre du 11 février 1994 qu'il adresse au Secrétaire général de l'ONU en réaction aux informations inquiétantes provenant du Rwanda: « Cette lettre indique que l'accentuation du profil politique de l'ONU doit aller de pair avec l'augmentation de la sécurité. Il est a craindre qu'à défaut d'enrayer l'évolution négative de la situation au Rwanda, la MINUAR ne puisse pas jouer son rôle dans l'application des accords d'Arusha.
Ma lettre a provoqué l'étonnement car Dallaire avait reçu l'autorisation de procéder à un désarmement plus sévère de concert avec la gendarmerie rwandaise. Il est apparu cependant que le général Dallaire ne faisait pas grand-chose dans la pratique. En d'autres mots, le courant passait mal entre l'ONU à New York et la MINUAR à Kigali. » (480b)
Pour certains cependant, le mandat donnait satisfaction.
Ainsi pour le professeur Reyntjens : »Le mandat permettait des opérations de fouille et de désarmement, mais interrogé sur ce point, New York a estimé que de telles opérations étaient offensives et donc exclues du mandat.
Le général Dallaire, le colonel Marchal et la gendarmerie rwandaise estimaient pourtant que le mandat le permettait. » (481b)
La commission se demande dès lors pourquoi le général Dallaire s'était senti obligé d'interroger New York sur l'interprétation du mandat.
M. Claes a partagé un certain moment l'avis du professeur Reyntjens : »Un élargissement du mandat n'était pas nécessaire étant donné qu'il y avait suffisamment de possibilités dans les limites des règles d'engagement. » (482b)
À d'autres moments, M. Claes, comme beaucoup d'acteurs sur le terrain, trouvait qu'il fallait le modifier. Les tentatives de M. Claes pour obtenir un élargissement du mandat seront abordées au point 3.4.3.
Le ministre de la Défense de l'époque, M. Delcroix a affirmé au Sénat, le 29 mars 1994, que sans révision du mandat de la MINUAR, la Belgique envisagerait le retrait de ses troupes (483b).
(3) L'application du mandat sur le terrain
La commission constate que l'interprétation du mandat est assez confuse; elle s'est dès lors demandé qu'elle en avait été la perception d'une part par les autorités militaires et d'autre part par les acteurs de terrain.
Le lieutenant-général Charlier déclare à ce propos: « Les procédures de l'ONU sont lourdes. Il est impossible de modifier un mandat. » (484b)
« Le mandat qui a été donné à la MINUAR ne couvrait pas tout ce qui était contenu dans les accords d'Arusha. » (485b)
Le colonel Marchal, quant à lui s'interroge : »Le mandat était-il adapté ? Pour nous, ce mandat est le cadre politique dans lequel nous étions placés. Ce mandat n'a pas posé problème jusqu'au 7 avril. Pour moi, ma responsabilité consistait dans ses modalités d'application. À partir du 7 avril, il y eut inadéquation entre le mandat et la situation concrète. » (486b)
Concernant la mort des dix paracommandos, le capitaine Lemaire déclare: « Pour ce qui est des fautes concernant la mort des dix paras, je pense que ce problème présente trois grands aspects. D'abord, la faiblesse du mandat c'était un mauvais choix avant de commencer la mission mais également le fait que, sur place, le 1-para a essayé de réaliser ce qu'il avait comme mandat et il a été en permanence face à un mur qui l'empêchait de le réaliser. De ce fait, à la fin des quatre mois, les gens étaient complètement démoralisés et se demandaient à quoi ils jouaient. Ils prenaient des risques, ils prenaient des armes qu'il fallait restituer le lendemain. (...) et (...) les discours du secteur et de la Force étaient : adoptez un profil bas, nous ne sommes plus en Somalie, restez calmes, restez sérieux. » (487b)
Le capitaine Lemaire s'est aussi exprimé à propos du contenu du briefing tenu à l'occasion de la relève entre KIBAT I et KIBAT II. « (...) dès le départ, on a insisté sur le fait que le mandat était limité, que nous devions éviter les écarts de conduite qui étaient apparus chez le 1-para, ainsi que les attitudes agressives vis-à-vis des Rwandais. Par ailleurs, pour utiliser des armes automatiques, il fallait des autorisations successives du bataillon, de la force et du secteur. Donc, dès le départ, on nous a dit que nous étions là un peu en observateurs de deux parties qui ont un problème à régler entre elles. » (488b)
Mme Des Forges a également eu l'occasion de s'exprimer sur l'interprétation du mandat :
« Au sujet du mandat, je suppose que les militaires voulaient être rassurés sur l'étendue de leurs pouvoirs. Si le Général Dallaire avait agi au lieu de demander, tout aurait pu être différent. Il a donné l'occasion de dire non. Pourquoi a-t-il donc posé cette question ? Peut-être parce que lors d'une première tentative, il a dû rendre les armes confisquées. » (489b)
Les règles d'engagement sont également définies par l'ONU , mais l'État-Major belge a participé à leur formulation définitive.
Les règles d'engagement étaient définies au moyen de six règles, dont la sixième stipulait que l'emploi, la préparation, le déplacement et le tir avec des armes étaient interdits en présence des parties en conflit (V 1372). L'autorisation d'emploi d'armes automatiques était retenue au niveau des États-Majors sur place (force ou secteur). La modification du contenu des ROE relevait de l'autorité de l'ONU. (490b)
Lors de son audition M. Brouhns déclare:
« À partir du moment où le Conseil donne la ligne du mandat, on constate que les militaires sur le terrain négocient les règles d'engagement, mais que ces dernières ne reviennent jamais au Conseil de Sécurité, ce qui me semble une erreur assez fondamentale du système. À partir du moment où vous avez un Conseil de Sécurité, un organe politique qui décide du cadre général d'une opération, que vous avez des militaires, des exécutants, qui traduisent ce mandat politique en règles d'engagement, que vous avez un secrétariat qui se prétend le gardien de la pensée de l'ONU pour l'interprétation de ces règles d'engagement, et que l'institution politique, à l'origine du mandat, ne contrôle absolument plus rien, la situation est assez malsaine. » (491b)
M. Cools a déclaré lors de son audition:
« Je rappelle qu'il y a trois niveaux dans les règles d'engagement. Le niveau des principes concerne l'utilisation de la force uniquement en cas de légitime défense. Le niveau de la traduction en termes militaires est naturellement du ressort des militaires et les diplomates en sont relativement ignorants. Le problème se situait au troisième niveau, celui de la mise en oeuvre pour laquelle il y avait deux aspects contradictoires. Le premier consistait à dire que les règles d'engagement étaient très larges alors que le second consistait à dire qu'il fallait être prudents lors de leur exécution. (...) On fait souvent une confusion entre le mandat, qui est une mission générale de maintien de la paix, et les règles d'engagement qui traitent des conditions d'utilisation de la force.
Cela n'a pas été discuté à New York mais à Kigali entre le général Dallaire et le colonel Marchal. » (492b)
Ceci est contredit par le colonel Marchal :
« La problématique suivante concerne les règles d'engagement et les autres directives données au détachement MINUAR, ainsi que ma participation au processus décisionnel. En ce qui me concerne, je n'ai pas participé à la prise de décision. J'ai, en quelque sorte, pris le train en marche. « (...) » J'étais en possession d'un brouillon des règles d'engagement et d'une copie du rapport de reconnaissance du colonel Flament grâce à mes fonctions au cabinet.
Je ne possédais pas de résumé des textes de la MINUAR ni de directives plus spécifiques quant à ma mission de commandant du détachement belge. » (493b)
Il s'avère en effet que les projets de ROE ont été adressés, par le lieutenant-colonel Kesteloot, au C ops, à destination du colonel Flamant, dans un télex daté du 29 octobre 1993.
Le colonel Flament a annoté ce télex par les mots « reçu ce matin » et « étudié par nos soins ». Il a chargé le lieutenant-colonel Briot de cette étude. C'est donc au niveau de l'état-major de l'armée belge, à travers Kesteloot, Flament, Briot et CJS que les ROE ont été discutées.
Il faut noter, que de manière inhabituelle, l'article 17, concernant les actes de violence contre les civils, étaient repris dans ce projet de ROE.
Quant au lieutenant général Charlier, il déclare: « Nous avons essayé de rendre le jargon juridique compréhensible pour les soldats qui allaient devoir appliquer les règles sur le terrain. » (494b)
La commission constate qu'il n'y a pas unanimité dans l'interprétation des ROE par les membres de l'état-major.
Pour le lieutenant général Charlier : « Il est impossible d'enserrer des règles militaires dans des écrits stricts. C'est une vision de juriste. On crée ainsi paralysie et insécurité. C'est une utopie. » (495b)
Quant à savoir si des limites sont nécessaires , le lieutenant général Charlier déclare : « Un garde-fou doit exister dans la définition de la mission. Venir dire que pour pouvoir utiliser la mitrailleuse, il faut faire appel au commandant de bataillon ne correspond à aucune vision militaire. » (496b)
Le général Dallaire dans ses réponses au questionnaire soumis par le Juge-Avocat Général de la Cour militaire déclare : « La Force n'avait ni le mandat, ni l'équipement, ni la capacité, ni le soutien nécessaire pour contrôler ou influencer de telles hostilités. » (497b)
Pour le lieutenant général Berhin : « Les règles d'engagement ne sont pas si minimales qu'on veut bien le dire. Dès le moment où il est question de se défendre, elles laissent toute latitude pour le faire. C'est la mise en application de ces règles d'engagement par le Général Dallaire qui a été trop minimaliste. Même après le drame, le général Dallaire a toujours refusé de changer son interprétation. (...) Leur interprétation était trop minimaliste.
On attaque, on critique beaucoup les règles d'engagement et le mandat. Mais ce mandat et ces règles sont corrects. C'est l'application sur le terrain qui fut défaillante. » (498b)
Quant au colonel Marchal , il a déclaré en ce qui concerne les ROE, il n'en tenait pas compte « au sens propre » , qu'elles n'étaient « pas si contraignantes que cela », que toutes les possibilités restaient ouvertes en matière d'utilisation des armes(499b).
Cependant , il a cru devoir interroger le général Dallaire sur l'interprétation de ces ROE : « Quant aux règles d'engagement , j'y ai réfléchi pour la première fois lors de la préparation de l'opération du corridor. J'ai demandé au général Dallaire l'autorisation de faire usage de toutes les armes disponibles, si nécessaire. Pour des raisons que j'ignore, j'ai reçu son autorisation pour l'emploi de mitrailleuses moyennes, mais pas pour les mitrailleuses lourdes.
Cette obligation de demander à chaque fois une autorisation pour faire usage de l'armement me paraissait impossible à tenir. J'ai décidé de ne plus demander d'autorisation concernant les règles d'engagement et, lors du briefing qui a précédé l'opération corridor, je n'ai pas hésité à recommander à mes officiers de faire usage des mitrailleuses lourdes en cas de nécessité. » (500b)
L'avis du lieutenant général Berhin rejoint celui du colonel Marchal : « Je suis d'accord avec le colonel Marchal sur sa vision des règles d'engagement car dès qu'il y a défense légitime tout est permis sauf faire usage d'une force qui dépasserait le nécessaire. » (501b)
Quant au lieutenant général Uytterhoeven, il déclare : « Nous nous opposons à l'interprétation que le général Dallaire a donné aux règles d'engagement, à savoir une intervention d'agents de police.
Les règles d'engagement ont connu une évolution exponentielle: elles devenaient de plus en plus restrictives » (502b). Il a par ailleurs ajouté que lors de la relève de KIBAT II, il a insisté pour obtenir une adaptation.
(3) L'application sur le terrain
Le « flou », voire les contradictions, que la commission constate dans l'interprétation des ROE par les officiers supérieurs explique certainement une partie des problèmes rencontrés par les troupes belges sur le terrain.
Selon le commandant Noens : « Het begrip rules of engagement is onvoldoende of slecht gekend bij het begin van de operatie en vooral voor het kader dient hieraan gewerkt te worden. Ik vraag dat dit opgenomen wordt in het onderricht der Wapenscholen samen met de geplande lessen in oorlogsrecht. Dit is ondertussen gebeurd. Laatste bemerking. Een VN-opdracht in de zin van Peace Keeping is geen Piece of Cake voor een parabataljon. Aan begrippen als « Show the Flag, show your smile » heeft een para op het terrein niets. Tijdens zijn opleiding en zijn verdere training in zijn eenheid wordt een paracommando op scherp gezet, tijdens zijn VN-opdracht wordt hij ontscherpt. Het ontbreekt hem immers aan een duidelijk vijandsbeeld. Bovendien heeft hij de indruk dat hij niets mag doen. » (503b)
Lors de son audition, le lieutenant Lecomte déclare : « Dans le même contexte, les directives données étaient très restrictives. Je me pose actuellement la même question que je me posais sur place. Comment peut-on être crédible sans moyens d'action ? (...) C'étaient les directives que nous avions. Nous ne pouvions quasiment jamais utiliser l'armement, c'était seulement en cas d'autodéfense. » (504b)
Quand au major Bodart, conseiller en droit des conflits armés, il déclare : « Je relève (...) le mot « impression » : ils avaient aussi l'impression d'être en vacances... Je crois qu'il y a dans le chef des déclarations spontanées a posteriori, un amalgame et une schématisation un peu trop outrancière. Je répète à nouveau que je ne sais pas évaluer la façon ni la mesure avec laquelle les informations ont été données au deuxième bataillon commando. Je lis dans un document « briefing général MINUAR, règles de comportement, généralités », en première page, après le mandat détaillé de l'UNAMIR : « l'emploi de la force est autorisé en cas de légitime défense ». Comment peut-on interpréter cela différemment et dire : « je ne peux pas tirer, même en cas de légitime défense ? » Moi, je n'ai jamais dit : « vous ne pouvez pas tirer. (...) J'ai dit que la légitime défense restait d'application, que le droit de la guerre n'était pas quelque chose qui empêchait les gens de « tourner », que l'on devait pouvoir faire sa mission militaire avec les attitudes tactiques et techniques propres à l'usage de ses armes et spécifiques à l'unité et qu'il y avait des règles toutes simples, comme celles de la proportionnalité ou du minimum de dégâts collatéraux, etc. Cela me paraît sans équivoque. Cela n'a rien à voir avec : « je ne peux plus rien faire, je ne peux plus tirer, même en cas de légitime défense; qui me demandera des comptes ? » Non, on me demandera des comptes si je transgresse une règle. » (505b)
Ces interprétations varieront au cours de la mission entraînant des modifications dans les ordres du secteur et du bataillon.
Les déclarations du général-major Roman résument la situation : « Elles (les règles) n'étaient pas claires et nettes, de sorte que la réaction dépendait du caractère de chacun, ce qui est dangereux. » (506b)
Lors de son audition, le caporal-chef Pierard déclare : « (...) nous étions isolés et réagissions donc au fur et à mesure. Quand on nous tirait dessus, nous ripostions, c'est certain. » (507b)
Selon l'adjudant Boequelloen : « Je n'ai assisté à aucun cours sur le changement des règles d'engagement. » (508b) et selon le capitaine chef Pierard, « nous avons seulement eu un briefing du commandant de brigade qui est venu nous dire : « Retirez la cassette de la Somalie, le Rwanda c'est tout autre chose, ce sont des vacances que l'on vous offre. » (509b)
C'est l'impression qu'en ont retiré plusieurs familles de commandos assassinés.
La commission a demandé à l'adjudant Boequelloen et au caporal-chef Pierard si les officiers et les sous-officiers leur avaient expliqué la teneur de l'article 17 des règles d'engagement.
L'adjudant Boequelloen répond que l'« on ne pouvait pas intervenir. Nous devions adopter un profil bas » (510b); et le caporal-chef Pierard déclare : « nous avons reçu l'ordre formel de ne pas intervenir » (511b).
Les missions du mandat sont définies dans les « UN Guidelines for Governments contributing military personnel to UNAMIR ». Le « Concept of Operations » (idée de manoeuvre) est le paragraphe clé de tout document opérationnel militaire.
Il stipule :
« 8. Il s'agit d'établir et de maintenir un climat essentiel à l'établissement et au bon fonctionnement du gouvernement de transition.
9. b. To establish a weapons secure zone in and around Kigali through the deployment of a formed infantry battalion and military observers, to protect the international airport, to protect the RFP compound, to escort RFP government functionaries and to assist in the recovery of illegal arms from civilians.
9. c. To be prepared to employ formed UN troops for security of UN property and personnel anywhere in Rwanda until... »
L'application de ces directives est ensuite définie au niveau du QG Force, du QG Secteur et enfin de KIBAT.
La commission constate que le « concept d'Opérations » défini par l'ONU à New York n'était pas en rapport avec les moyens disponibles et qu'un tri réaliste n'a pas été réalisé ni au niveau de la Force, ni au niveau du secteur et à fortiori pas au niveau de KIBAT.
3.4.2.1. La « Kigali Weapon Secure Area » (KWSA)
La fonction de récupération des armes était une des tâches imparties au bataillon belge :
Le colonel Flament décrit cette tâche :
« Il s'agissait de boucler une région et de la fouiller. La « Kigali Weapon Secure Area » est une zone où il était interdit de faire entrer des armes. Nous fouillions le charroi sur la route vers le pont de Kabenge. Il n'est pas nécessaire, pour cela, de mettre en place un grand dispositif. Là où le bât a blessé, c'est dans notre capacité à faire comprendre à la population pourquoi nous étions là. » (512b)
Quant à la récupération des armes, le colonel Flament a déclaré:
« Le bataillon belge devait participer à l'opération de fouille. Le « cordon » était belge alors que le « search » était composé de gendarmes rwandais, d'observateurs de l'ONU ou des deux ensemble. On n'attendait donc pas que les Belges pratiquent directement les fouilles. » (513b)
En réalité, une seule récupération d'armes est réalisée le 5 janvier, en appui de la gendarmerie qui devait arrêter deux suspects. Participaient à l'action, un peloton de la 21e compagnie, les commandants de la compagnie, de KIBAT, du secteur. Aucune coordination préalable n'avait été possible, l'opération a consisté en une marche de nuit entre les huttes et une longue attente une fois sur place (514b).
On n'a jamais réussi à réaliser cette « Kigali Weapon Secure Area », si ce n'est que très partiellement, alors qu'il s'agissait d'un objectif clairement défini dans le mandat. La commission s'est interrogée sur les raisons pour lesquelles la KWSA n'a jamais été réalisée.
L'une des raisons invoquées était l'absence de collaboration ou d'efficacité des partenaires rwandais.
Selon le lieutenant-colonel Briot :
« Différentes actions furent prises pour lutter contre le trafic d'armes mais la MINUAR ne pouvait agir seule, sans la collaboration de la gendarmerie rwandaise. » (515b)
Le lieutenant Nees, lui, déclare :
« À chaque point de contrôle, des gendarmes rwandais étaient présents. Souvent ces gendarmes ne parlaient que le kinyarwanda, ce qui entraînait parfois des problèmes de communication. J'avais l'impression que leurs attitudes lors de l'exécution de ces contrôles laissaient à désirer. » (516b)
Si, concernant la récupération des armes, la gendarmerie rwandaise s'est avérée contreproductrice, sinon inefficace, la collaboration avec le FPR à ce sujet n'a pas non plus été très efficace, selon le colonel Marchal :
« J'en ai fait personnellement l'expérience lors de la première négociation relative au protocole d'accord de la KWSA. En plus, lorsque j'allais me plaindre du non-respect des règles, le suivi était très lent. J'ai fait mener des actions ponctuelles de contrôle, mais elles étaient très difficiles à réaliser et je n'avais jamais l'assurance que le résultat annoncé était correct. (...) J'ai toujours été persuadé que, lorsque le FPR allait chercher du bois de chauffage dans le nord, c'était pour amener des armes. On a tout essayé pour contrôler cela, mais en vain.
Néanmoins, chaque fois que j'estimais que le FPR ne se conformait pas au protocole KWSA, je rédigeais une réclamation écrite. Je dois dire que, personnellement, je n'ai jamais eu de problème avec le FPR qui m'a toujours considéré comme neutre et n'a jamais entravé ma liberté de mouvement. » (517b)
Une autre explication réside dans l'attitude du général Dallaire. À la question de savoir qui lui a interdit de chercher les caches d'armes dont l'existence avait été révélée par un indicateur, le lieutenant Nees a répondu de la manière suivante :
« Une demande d'autorisation de procéder à une telle recherche a été faite par le truchement de la structure usuelle de commandement. J'ai vu des documents qui démontrent que le colonel Marchal a demandé l'autorisation de procéder à une telle recherche mais que celle-ci lui a été refusée par le général Dallaire.
Il était en tout cas clair que Kigali ne constituait pas une KWSA comme prévu dans les accords d'Arusha. » (518b)
Ces propos ont été confirmés par le colonel Marchal, qui fait référence aux conséquences des révélations de « Jean-Pierre ».
« Suite aux révélations de Jean-Pierre, un télex, dont je ne connais pas le contenu, a été envoyé à New York pour proposer une opération. L'ONU a répondu dès le lendemain qu'il ne fallait pas intervenir » (519b).
3.4.2.2. Les patrouilles de sécurité
Les premières patrouilles de sécurité se sont faites à pied.
Le commandant Noens déclare :
« De eerste patrouilles en dat is kenmerkend die wij te voet in Kigali hebben uitgevoerd, waren in sectieverband met de ene helft van de sectie aan de linkerkant van de weg en de andere aan de rechterkant, met het wapen in de arm ... zo hebben wij gepatrouilleerd en dat is « show the flag ».
Blijkbaar was dat te agressief. Daarom mochten wij onze patrouilles niet langer zo uitvoeren en moesten wij voortaan het geweer op de schouder dragen. De bevolking zag dus begin december « les Casques bleus ONU belges » gewapend door de straten trekken, een paar dagen later iets minder agressief, het geweer over de schouder. Ook dat was echter nog te agressief. In een tweede fase heeft men ons dan verplicht te patrouilleren met de loop van het geweer naar beneden. (...) Dat was in de kaarten spelen van bepaalde FAR-officieren die helemaal niet Belgisch gezind waren » (520b).
Les patrouilles furent même qualifiées par certains de patrouilles « Coca Cola ».
Le colonel Marchal s'est exprimé de la manière suivante :
« (...) Je précise qu'elles rentraient dans le cadre d'une politique d'information de la population. L'objectif était de recueillir les informations nécessaires par le biais de contacts avec les gens. De plus, j'avais demandé de faire des patrouilles à longue distance pour créer un climat de confiance (...) » (521b).
Notons qu'il y a eu des patrouilles de tout type, chaque fois accompagnées de gendarmes rwandais. Elles constituaient l'essentiel des activités, visant la dissuasion et l'acquisition de renseignements.
Un seul a été réalisé, dans des circonstances particulières. Il s'agissait de bloquer, sur ordre des observateurs de l'ONU, la sortie est du CND, le Parlement rwandais, afin de pouvoir empêcher physiquement le FPR de quitter le CND sans escorte de ces observateurs. C'était une mission de jour uniquement qui nécessitait deux CVRT dont l'état était bien connu, et dont les équipages étaient de fortune (mécanicien faisant fonction de chef de char) (522b).
Dans un document écrit remis à la commission, le ministre Claes a relaté de quelle manière la Belgique avait tenté de changer le mandat, les ROE ou d'accroître les effectifs.
En plus des pressions politiques et diplomatiques, la Belgique a également tenté de rendre les interventions de la MINUAR plus efficaces.
Comme cela a déjà été signalé dans le chapitre 3.3.1., le ministre des Affaires étrangères W. Claes, dans sa lettre du 11 février 1994 (et non du 14 mars 1994 comme le dit à tort le Blue Book ), insiste sur « une attitude plus dissuasive de la MINUAR sur le plan de la sécurité » bien qu'il soit conscient « des contraintes qui vous (NDLR : le secrétaire général Boutros Boutros-Ghali) sont imposées dans le cadre de la résolution 872 du Conseil de sécurité ». Cette réaction est suscitée par « les atermoiements des partis, tandis que les informations relatives à la constitution de réserves d'armes par les différentes milices se font chaque jour plus insistantes. »
Alors que le ministre Claes n'est pas encore rentré de son voyage à Kigali, le chef de cabinet des Affaires étrangères M. Willems prend l'initiative de demander au représentant permanent à New York de faire examiner par le secrétaire général des Nations unies, comme par les membres les plus importants du Conseil de sécurité de l'ONU, une série de possibilités pour renforcer l'action de la MINUAR tant dans sa composante politique (M. Booh Booh), que dans sa composante militaire (général Dallaire). Le texte du télex nº 64 du 25 février 1994 de MINAFET à DELBELONU est rédigé comme suit :
« La forte dégradation de la situation sur le plan de la sécurité au Rwanda appelle les réflexions suivantes :
1. Les assassinats politiques, les troubles qui s'ensuivent, la détérioration du climat de sécurité, pourraient bien mener à un nouveau bain de sang.
2. Il faudrait accroître la pression diplomatique et politique en vue de parvenir à faire respecter strictement les accords d'Arusha dans un climat serein.
3. Le représentant spécial du secrétaire général au Rwanda, M. Booh Booh, semble avoir perdu de sa crédibilité sur place.
4. Dans le cadre de son mandat actuel, la MINUAR ne peut maintenir fermement l'ordre public. Un sérieux problème de crédibilité se pose.
Des démarches ont déjà été effectuées à un haut niveau à New York, mais elles sont restées sans résultat. La dernière déclaration du président du Conseil de sécurité concernant le Rwanda (le 17 février 1994) « la MINUAR ne sera assurée d'un appui suivi que si les parties appliquent intégralement et rapidement l'accord de paix d'Arusha » laisse présager une possible inactivité ou un arrêt de l'opération.
5. Quand, à la suite des assassinats et des troubles, la MINUAR a décidé au début de cette semaine de placer l'opération sous alerte rouge, cela a eu pour conséquence que tous les Casques bleus ont reçu l'ordre de se retirer dans leurs campements et d'attendre passivement. Si la situation devait effectivement dégénérer et que les ordres précités de la MINUAR restaient en vigueur, il serait inacceptable pour l'opinion publique que des Casques bleus belges puissent devenir au Rwanda les témoins passifs d'un génocide et que les Nations Unies n'entreprennent rien.
6. Si les conditions se détériorent, les Nations Unies et la Belgique ne peuvent pas, en réalité, se permettre de se retirer du Rwanda. La MINUAR devrait pouvoir jouer un rôle plus énergique et adopter sur place un profil plus marqué afin de renforcer la crédibilité de la communauté internationale.
7. La question qui se pose est de savoir si cela est possible sans un nouveau mandat du Conseil de sécurité. Si l'on doit tenter de renforcer la MINUAR par un nouveau mandat (une nouvelle résolution du Conseil de sécurité), on peut s'attendre à des difficultés, vu la politique actuelle des États-Unis en la matière. En ce moment, une extension de l'opération (Casques bleus, financement) semble exclue à leurs yeux. Au demeurant, dans les deux résolutions elles-mêmes (872, 893), on met nettement l'accent sur le caractère limité ou récessif de l'opération (sans mettre en péril la capacité de la MINUAR de remplir sa mission).
8. Il devient très important d'examiner comment on pourrait renforcer l'action dans le cadre du mandat actuel (intégration de Casques bleus autrichiens ? Une plus grande marge de décision pour Dallaire ? Déplacement provisoire de Casques bleus venant d'autres opérations dans la région ? ...), et comment augmenter efficacement la pression diplomatique et politique.
9. J'aimerais recevoir vos remarques à propos de tout ceci. J'insiste sur le fait que cela doit servir de base à une décision concernant de nouvelles démarches éventuelles, mais qu'aucune position n'a encore été arrêtée à ce sujet » (523b).
La réponse sur la question du renforcement de l'action des Nations unies est négative. L'ambassadeur Noterdaeme déclare dans son télex nº 326 du 28 février 1994 qu'il a « sérieusement réfléchi à la manière dont on pourrait infléchir l'action des Nations unies au Rwanda ». Il ajoute : « J'en ai parlé en détail avec les principaux membres du Conseil de sécurité et avec le secrétariat des Nations unies. Il y a en théorie 4 éléments sur lesquels on pourrait jouer :
1) L'élargissement du mandat ou le renforcement des effectifs de la MINUAR : « très improbable »
Non seulement les États-Unis et le Royaume-Uni s'y opposent, mais ils auraient même tendance c'est ce que confirment leurs délégations à retirer tout simplement la MINUAR « en cas de difficultés » (telle pourrait même être l'attitude de l'ensemble du Conseil de sécurité). Il y a là-derrière « une logique financière » (les États-Unis n'ont jamais voulu plus de 500 hommes pour la MINUAR).
Il y a également une logique politique : les opérations au Rwanda, au Libéria et au Mozambique relèvent du Chapitre VI; en d'autres termes, le Conseil de sécurité des Nations unies ne peut pas imposer de solution (en Yougoslavie et en Somalie, cela s'est avéré impossible, même dans le cadre du Chapitre VII).
2) Les règles d'engagement
Le secrétariat des Nations unies « n'est pas enclin à adapter les règles d'engagement » :
militairement, c'est trop dangereux; les Nations unies n'ont jamais autant de moyens que les parties;
politiquement : si les Nations unies recourent à la force, elles prennent parti (ne sont plus neutres) » (524b).
Les deux autres solutions préconisées par Noterdaeme étaient le renforcement du rôle de M. Booh-Booh et du général Dallaire.
Si, théoriquement, le secrétariat général ne se disait pas opposé à cette alternative dans la pratique, rien ne fut fait pour renforcer l'importance politique ou militaire de ces deux personnages.
Le ministre Delcroix, qui s'est rendu au Rwanda du 10 au 13 mars 1994 (avec 15 parlementaires), avait lui aussi attiré l'attention de ses interlocuteurs sur l'échéance du 5 avril 1994.
« À moins qu'une nouvelle dynamique n'intervienne d'ici là, on ne pourra plus éluder une remise en question approfondie de l'opportunité de poursuivre l'intervention de l'ONU. Le ministre Delcroix a laissé entrevoir une autre possibilité, à savoir celle d'une révision et d'un assouplissement du mandat pour donner au commandement de la MINUAR à Kigali une liberté d'action plus grande (la possibilité d'agir de manière plus dissuasive) sans l'obliger à attendre systématiquement les instructions de New York » (525b).
Bien que la Belgique ne soit pas membre du Conseil de sécurité, le ministre des Affaires étrangères, tout comme le secrétariat général de l'Organisation des Nations unies d'ailleurs, ont estimé que le renouvellement du mandat était l'occasion de donner un signal politique clair au président Habyarimana et aux parties en présence au Rwanda en limitant strictement le mandat dans le temps tout en le renforçant.
Il y avait une « option belge » qui a été défendue devant les deux membres permanents du Conseil de sécurité lors d'une concertation trilatérale (F, B, USA) le 22 mars 1994. Voici les termes de cette option :
« la mission de la MINUAR est prolongée pour une période brève (p.e. trois mois) au moyen d'une « résolution dure », après quoi le SG doit soumettre un rapport d'évaluation approfondi sur la base duquel le Conseil de sécurité peut prendre de nouvelles décisions, comme celle de réduire l'effectif de la MINUAR;
nous souhaitions en outre renforcer le mandat de la MINUAR.
La France était favorable à l'option belge, mais sans renforcement du mandat, ce que les partenaires jugeaient irréaliste. Washington souhaitait uniquement une prolongation pour une période courte, éventuellement avec un ultimatum. Cette dernière solution a été rejetée par la Belgique et la France : on sait d'expérience que les parties en présence ne remplissent qu'une partie des conditions imposées par le Conseil de sécurité, ce qui place ce dernier dans une situation difficile » (526b).
Le général Dallaire a proposé à M. Boutros Boutros-Ghali de prolonger le mandat de deux mois seulement (527b). Le DPKO souhaitait lui aussi une prolongation de 60 jours au plus, mais M. Boutros Boutros-Ghali a « supprimé le dernier paragraphe d'un trait de plume et propose maintenant de prolonger le mandat de la MINUAR de 6 mois ». Cette décision a été accueillie avec « consternation » au secrétariat de l'ONU, parce qu'elle n'apportait pas le signal politique désiré.
L'ambassadeur Noterdaeme a estimé que l'attitude du secrétariat général était « contraire à l'avis des États-Unis, de la France et de la Belgique ». Elle était contraire aux déclarations du secrétariare général même, c'est-à-dire à certains des propos qu'il a tenus dans son rapport du 30 mars 1994 au Conseil de sécurité et à certaines des déclarations qu'il a faites au président Habyarimana, notamment que la communauté internationale ne tolérerait plus longtemps l'absence de progrès (528b). À la suite des protestations du président français du Conseil de sécurité, le secrétariat général proposera, à titre de compromis, une prolongation de 6 mois avec un nouvel examen de la situation après 2 mois (529b).
Le secrétariat général avait des raisons financières pour proposer 6 mois (difficultés budgétaires). Finalement, l'on disposera dans la résolution 909 du 5 avril 1994, à la suite des pressions exercées par les États-Unis, que le mandat est prolongé pour 4 mois (jusqu'au 29 juillet 1994) et qu'il y aura un nouvel examen après 6 semaines.
Les conditions d'une nouvelle prolongation étaient les suivantes :
a) la mise en place d'institutions de transition;
b) la réalisation de progrès suffisants pour ce qui est de l'entrée en vigueur de la phase 2 du plan du secrétariat général.
Il s'ensuit que l'on a suivi l'option belge en partie, mais sans prévoir le renforcement souhaité du mandat, renforcement qui n'a pas été proposé par le secrétaire général et qui a été rejeté par les membres permanents du Conseil de sécurité.
Les tentatives que le Ministère des Affaires étrangères a faites, à partir de janvier 1994 jusqu'au déclenchement du génocide, pour obtenir un élargissement du mandat ou des ROE, ou du moins, une augmentation des effectifs ou un assouplissement de la marge de manoeuvre du général Dallaire n'ont donc pas abouti.
Plusieurs témoins font remarquer qu'il n'a été et qu'il n'est mené aucune enquête sur les circonstances dans lesquelles l'avion présidentiel a été abattu le 6 avril. Quand on lui a demandé de donner un aperçu de l'ensemble des enquêtes relatives à l'attentat contre l'avion du président, le professeur Reyntjens a déclaré : « Het antwoord op uw vraag is zeer kort : geen (530b). Voor zover ik weet zijn er geen onderzoeken gedaan. De ICAO heeft geen onderzoek gedaan, hoewel de Belgische regering daarom had gevraagd. De voormalige Rwandese regering heeft niets gedaan behalve het recupereren van de twee lanceerbuizen van de SAM 16's. Het nieuwe bewind heeft ook geen onderzoek gedaan en alleen het puin geruimd dat in de tuin van president Habyarimana lag. Burundi heeft evenmin iets gedaan, hoewel de Burundese president en twee ministers bij die aanslag zijn gestorven. Kortom, er is geen enkel officieel onderzoek gebeurd » (531b). Pour justifier l'absence de toute enquête, M. Faustin Twagiramungu, ancien Premier ministre du Rwanda, a avancé l'argument suivant : « Jamais on n'a fait allusion à la réalisation d'une enquête. La réponse du gouvernement rwandais était la suivante : « M. Habyarimana n'était pas plus important que toutes les autres personnes qui sont décédées. » C'était vrai, mais il me semble que le sens de l'État doit également prévaloir. Le gouvernement burundais a introduit une demande mais n'a pas obtenu de réponse. La famille du président Habyarimana a également introduit une demande auprès des Nations unies mais n'a pas non plus obtenu de réponse. » (532b).
M. Dismas Nsengiyaremye, ancien Premier ministre rwandais, a souligné devant notre commission l'importance d'une telle enquête : « J'ai refusé d'avoir une version. Je suis très surpris du fait qu'un événement aussi important et aussi lourd de conséquences ait été négligé à ce point. Je ne comprends pas pourquoi ni les Nations unies ni la MINUAR ni les puissances occidentales intervenues pour évacuer les ressortissants n'aient rien fait jusqu'à présent pour établir la lumière à ce sujet. Même si des problèmes existaient par rapport au président rwandais, étant donné que le président burundais a également péri, je ne comprends pas que l'on n'ait pas cherché à connaître la vérité et à informer les autorités burundaises. Pourquoi le gouvernement actuel n'enquête-t-il pas au sujet de cet événement Tout le monde se dérobe ... Je me dis que si les gens agissent ainsi, c'est qu'ils savent quelque chose. Il existe quelque part des gens qui savent et qui ne veulent rien dire. Je n'ai pas la capacité de les approcher. Une enquête pourrait toutefois être menée par les personnes plus ou moins concernées par cet attentat et qui se trouvent au plus haut niveau de l'État rwandais actuel, par les Nations unies ou par les puissances intervenues notamment pour procéder aux évacuations et qui ont certainement eu accès à certaines informations. Je demande que la lumière soit faite au sujet de cet événement. En effet, on ne pourra pas expliquer l'ampleur et la gravité du génocide si ce point n'est pas élucidé. Apparemment, nous sommes confrontés à une conspiration du silence ... » (533b).
M. Degni-Segui s'associe à cette déclaration : « Concernant l'attaque de l'avion présidentiel, c'est finalement le noeud gordien de la chose. Dès que j'ai pris mes fonctions, je me suis rendu à Genève. J'ai eu en audience l'ambassadeur de France parce que mon mandat spécifiait bien que je devais faire la lumière sur ce sujet. J'ai demandé si la France pouvait mettre à ma disposition la boîte noire de l'avion présidentiel. Il m'a dit : « J'ai compris, je vais m'en référer à mon gouvernement. » Par la suite, il m'a indiqué que le gouvernement n'avait pas cette boîte noire. Je me suis alors rendu à Kigali, où j'ai rencontré l'état-major militaire. Je leur ai demandé : « Est-ce que je peux avoir la boîte noire ? » Il y avait là quatre militaires, le chef d'état-major et d'autres. Vous savez ce qu'ils m'ont répondu Le chef d'état-major m'a dit : « la boîte noire se trouve chez les militaires. » Je lui ai dit : « Mais vous-mêmes, vous êtes des militaires. » Et finalement, il m'a dit : « On ne l'a pas, il faut voir avec la France. » J'ai donc été renvoyé de l'un à l'autre, et finalement, il y a eu un certain capitaine Baril qui a prétendu avoir la boîte vous avez dû suivre cela dans les journaux et j'ai demandé aux Nations unies de mettre à ma disposition une commission d'enquête avec un expert en balistique, en vue de faire les recherches. En effet, entre-temps, on a dit que l'OACI ne pouvait pas faire l'enquête, parce que l'avion n'était pas un avion civil, mais un avion militaire. Et il fallait donc une commission d'enquête. Je l'ai demandée aux Nations unies, et l'on m'a répondu qu'il n'y avait pas de budget pour cela. Le gouvernement rwandais m'avait demandé également de tout tenter pour faire la lumière à ce sujet. Et dans l'un de mes rapports, je rappelle justement, je tire la sonnette d'alarme, pour dire de faire vite avant qu'il ne soit trop tard. Je crains même qu'il ne soit trop tard maintenant. Si bien que, jusqu'ici, je n'ai pas accompli l'une de mes missions avant que l'on me dise de partir » (534b).
M. Van Winsen, auditeur militaire émérite au conseil de guerre, mentionne l'existence d'une enquête sur l'attentat contre l'avion, parce que « er een verband bestond tussen het neerschieten van het vliegtuig en wat er met de para's was gebeurd voor het wachtlokaal van het kamp Kigali. » Mais : « ik heb ook geen positief resultaat bekomen ! Ik weet nog niet wat er precies is gebeurd. Ik heb wel een persoonlijke mening over de zaak, maar in het kader van het onderzoek zelf heb ik enkel twaalf of dertien hypothesen kunnen formuleren. Dat is alles. Misschien moet daaraan nog een veertiende hypothese worden toegevoegd, namelijk deze van Colette Braeckman, die oppert dat de daders zich van doel zouden vergist hebben en eigenlijk een C-130 wilden neerschieten. Deze hypothese had ik nog niet en ze werd ook geformuleerd na de periode van mijn onderzoek ». (535b)
À la fin de son enquête, M. Van Winsen a obtenu l'autorisation d'aller au Rwanda, où il a eu de nombreux contacts, notamment avec les autorités de l'époque. Sur la collaboration avec les autorités locales à cet égard, M. Van Winsen est très clair : « In mijn satellietonderzoek naar het neerschieten van het vliegtuig heb ik echter heel veel problemen gehad. Men zei mij altijd dat ik mij daar niets van moest aantrekken, dat dat mijn zaak niet was. Ik sprak dit uiteraard tegen, omdat ik precies wilde weten of er een oorzakelijk verband bestond tussen de twee. Ik vroeg dan ook om de resultaten van het onderzoek naar deze gebeurtenis. Er is echter nooit een onderzoek ingesteld, noch door de oude, noch door de nieuwe regering, noch door UNAMIR. Een Russische kolonel, wiens naam mij nu ontsnapt, heeft wel een klein onderzoek ingesteld naar de moord op de tien para's, maar rond het neerschieten van het vliegtuig is er niets gebeurd. Toen ik ter plaatse was, had ik problemen met de mensen die het nu nog voor het zeggen hebben. Ik mocht het wrak niet zien. Ik vroeg stalen van het vliegtuig te nemen op de plaats van de inslag, om uit te maken met welk projectiel we te maken hadden, maar ik heb ze niet gekregen. » (536b) (...) « Het weigeren van medewerking, zowel van de vroegere als van de huidige Rwandese regering, als van om het even wie, doet mij denken dat er een coalitie bestond waarin men het eens was de persoon in kwestie te laten verdwijnen. Dat is een vaag idee van mij. Maar ik kan onmogelijk zeggen dat het om die groep, die nationaliteit of die vereniging gaat. Ik zie wel één zaak, dat is dat iedereen het eenparig eens is om geen onderzoek te doen. (...) Generaal Dallaire heeft echter geen onderzoek gedaan. Ik werd gewoon van het kastje naar de muur gezonden, maar ik kreeg geen toelating mijn onderzoek voort te zetten. De eenparigheid langs beide kanten doet bij mij de vraag rijzen of het geen afspraak was tussen iedereen. Ik kan tot geen ander idee komen » (537b).
La commission insiste sur l'opportunité de procéder à une telle enquête parce qu'elle est la seule possibilité que l'on ait de confirmer ou d'infirmer une ou plusieurs des hypothèses avancées. En effet, si nous avions connaissance des données relatives à l'assassinat du président, nous pourrions donner une idée et une interprétation plus claires des événements postérieurs, tant pour ce qui est de l'assassinat des Casques bleus que pour ce qui est du génocide. C'est en effet l'attentat contre l'avion présidentiel qui a constitué l'amorce de ces événements ultérieurs.
Au cours de ses travaux, la commission a pris connaissance d'un télex émanant du 15e Wing de transport de la Force aérienne, relayé par le C Ops à KIBAT II.
Ce télex, daté du 5 avril, avisait KIBAT II que le C130 qui devait arriver à Kigali le 6 avril, serait équipé de moyens de contre-mesures électroniques (ECM), en raison de la crainte d'attaques par des fusées anti-aériennes contre nos C130 en mission en Afrique.
La commission a jugé utile de vérifier s'il n'existait pas un lien quelconque entre cette crainte de menace anti-aérienne et l'attentat contre l'avion présidentiel.
Elle a entendu à cette fin le commandant De Troy de la Force aérienne (538b).
Il ressort de ce témoignage que, dans le cadre du programme d'équipement en moyens ECM de tous les C130 du 15e Wing, deux C130 en étaient pourvus à l'époque. L'un d'entre eux était réservé pour les missions à Sarajevo. Un second devenant disponible, il fut logiquement décidé de l'utiliser vers Kigali, en raison d'une menace d'attaques par des fusées anti-aériennes en Afrique, et pas spécifiquement à Kigali ou au Rwanda.
La commission se réfère pour le récit des événements au rapport du 8 mai 1996 de l'auditeur général près la Cour militaire qui, de l'avis de la commission, constitue la relation la plus minutieuse des faits dramatiques qui se sont produits le matin du 7 avril 1994 (539b) et qui ont coûté la vie de : Cpl Bruno Bassine, Cpl Alain Debatty, Cpl Christophe Dupont, Cpl Stéphane Lhoir, Cpl Bruno Meaux, Cpl Louis Plescia, Cpl Christophe Renwa, Cpl Marc Uyttebroeck, 1 Sgt Yannick Leroy et Lt Thierry Lotin.
« C. Désignation de la section Mortiers
En exécution des instructions données par le général Dallaire lors de la réunion à l'état-major des FAR, le colonel Marchal réinstaure les patrouilles et escortes qui avaient été supprimées dans le cadre de l'alerte « stade rouge ». Il confie dans le même temps par radio l'escorte de protection du Premier ministre Agathe au contingent belge ainsi que la protection du site de Radio-Rwanda (V 1574; D 1502; A 223).
D'après les directives en vigueur, le commandant de secteur est en effet le seul habilité à détacher les escortes (V 1311-1319). Une note du secteur, du 23 mars 1994, avait par ailleurs confié au bataillon belge la responsabilité de l'escorte permanente de Mme Agathe; d'autres escortes étaient exécutées par le bataillon bengali (Rutbat); les patrouilles, quant à elles étaient, effectuées tant par Rutbat que par Byubat (V 1313-1377).
Une discussion s'engage alors sur le réseau bataillon entre le Lt Col Dewez et le Col Marchal quant au rétablissement de ces escortes (C 1307).
Opposé à l'appréciation de la situation par son supérieur, le Lt Col Dewez lui fait observer que l'escorte pour Mme Agathe est une mission difficilement réalisable vu les difficultés de mouvement des patrouilles et la présence de barrages. Le Lt Col Dewez prétend qu'il était conscient que la situation était tendue et qu'instaurer une escorte cette nuit-là prenait une autre dimension que précédemment. Il avait de sérieux doutes quant à la réalisation de cette mission (C 1307 V 1287).
Le Maj Timsonet, adjoint du Lt Col Dewez, affirme que la mesure visant à supprimer les escortes lui semblait logique au vu des événements (IV 998). Il a été surpris que le secteur réinstaure les escortes car il craignait que la situation ne se détériore (A 143). Le Col Marchal répond que l'ordre lui avait été donné par le QG de la Force. Suite aux directives du Gén Dallaire relatives à la protection de Mme Agathe, confirme à 01 h 18 le maintien de cette escorte (V 1287).
D. Départ de la section Mortiers
À 02 h 16 le Lt Lotin, commandant du peloton Mortiers, qui se trouve à l'aéroport avec ses jeeps pour y faire le plein d'essence, se voit attribuer cette mission.
Sur ordre du Lt Col Dewez, l'escorte sera toutefois doublée et comportera quatre jeeps.
Les véhicules reviennent à ce moment d'une mission plus touristique qu'opérationnelle (V 1375; IV 886; A 428).
En théorie, les jeeps sont équipées d'affûts de manière à pouvoir monter des mitrailleuses automatiques MAG (IV 896; V 1375; C 1308). Il était par ailleurs prévu, qu'en cas d'absence d'affûts, les MAG devaient être emportées sans être fixées (V 1328).
L'enquête n'a toutefois pas pu déterminer avec certitude si, en quittant l'aéroport, les jeeps du Lt Lotin étaient équipées d'affûts pour MAG (V 1228).
Au départ de la mission, le dispositif des forces opérationnelles du contingent belge est le suivant : le bataillon est dispersé en 14 cantonnements allant de l'école abritant 90 militaires jusqu'à une villa privée de 5 militaires.
Ce dispositif, conçu pour une situation de « Peace-keeping » et non pour une situation de guerre civile, préoccupait le Lt Col Dewez qui, après une reconnaissance sur place, avait fait part à l'état-major général du problème d'insécurité que la dispersion des moyens et du personnel pouvait constituer. L'opération de regroupement à l'aéroport devait débuter le 15 avril 1994 (C 1306; A 272).
À 02 h 40, le Lt Lotin quitte l'aéroport en compagnie du Cpl Lhoir avec leurs deux jeeps. Il signale qu'il se rend chez Mme Agathe.
Les hommes sont porteurs de leur armement individuel et répartis dans les jeeps comme suit : Lt Lotin Thierry et Cpl Dupont Christophe; 1 Sgt Leroy Yannick, Cpl Meaux Bruno, Cpl Plescia Louis; Cpl Debatty Alain, Cpl Uyttebroeck Marc et Cpl Renwa Christophe; Cpl Lhoir Stéphane et Cpl Bassine Bruno (VI 1756).
Durant le parcours, le Lt Lotin passe par Viking, le cantonnement du peloton Mortiers et y récupère les jeeps du 1 Sgt Leroy et du Cpl Debatty.
Étant donné que le Lt Lotin indique qu'il doit franchir différents barrages aux carrefours, le Lt Col Dewez décide à 03 h 16 de lui envoyer le Capt Marchal et deux jeeps afin de l'aider à franchir un barrage situé avenue de la Republique.
Une demi-heure plus tard, soit à 03 h 45, le Capt Marchal indique que la mission Radio-Rwanda devient impossible vu la présence de blindés qui bloquent le passage.
Vers 05 h 00, cet officier rejoint le Lt Lotin pour lui indiquer le chemin à suivre pour se rendre chez Mme Agathe. Entre-temps les tirs se sont intensifiés de tous côtés, à tel point que la section du Capt Marchal, se voyant encerclée et menacée par une mitrailleuse en batterie devant elle, obtient, à sa demande, à 05 h 19, l'autorisation de se dégager.
À 05 h 30, le peloton Mortiers signale un contact avec Mme Agathe.
E. Arrivée à la résidence du Premier ministre
Il y trouve cinq soldats ghanéens affectés à la sécurité interne du Premier ministre à son domicile.
À 05 h 37, le Lt Lotin indique qu'il n'est plus question de se rendre à Radio-Rwanda. Ordre lui est donné de prendre une position défensive et le secteur est informé.
À 06 h 03, le peloton Mortiers fait savoir que deux des quatre jeeps sont inutilisables et qu'ils sont soumis à des tirs depuis deux heures.
À 06 h 55, le Lt Lotin signale qu'il est encerclé par une vingtaine de militaires rwandais, armés de fusils et de grenades, et que des membres de la garde présidentielle lui demandent de déposer les armes. Le Lt Col Dewez répond de ne pas rendre les armes mais de maintenir le dialogue.
D'après le carnet de veille du bataillon, la fuite du Premier ministre de son domicile est signalée à 08 h 34 tandis que d'après des témoignages de volontaires des Nations unies, cette fuite se situe à 07 h 40 (farde 24, p. 115 à 148).
Mme Agathe prend la fuite en compagnie de gendarmes affectés à sa sécurité qui vont la cacher dans la maison d'un voisin, M. Daff, volontaire de l'ONU. Elle y est découverte par des membres de la garde présidentielle qui la ramènent à son domicile où elle sera tuée vers 11 h 45 ainsi que son mari (VII 138, 145; B 622, 650, 891; A 177).
À 08 h 32, le bataillon demande des directives au secteur. Sur ordre du Lt Col Dewez le Lt Lotin est déchargé à 08 h 43 de sa mission d'assurer la protection de Mme Agathe.
Tandis que le Lt Lotin indique que ses antagonistes lui demandent de rendre les armes, le Lt Col Dewez s'adresse à 08 h 44 une nouvelle fois au secteur pour obtenir des directives. Le Lt Lotin fait part de l'agressivité des militaires autour de lui et de frictions avec la garde présidentielle.
À 08 h 49, le Lt Col Dewez enjoint Lotin de ne pas se laisser désarmer et de négocier « à l'Africaine ». Le Lt Lotin rétorque qu'il est trop tard car il a déjà quatre hommes désarmés à terre (V 122 1).
Le Lt Col Dewez répond au Lt Lotin que dans ces circonstances il l'autorise à rendre les armes s'il le juge nécessaire. Le Col Marchal, à l'écoute sur le réseau bataillon, intervient dans les termes suivants: « Tu es sur place, c'est à toi d'apprécier la situation ».
D'après les témoignages du Cpl Emmanuel Doe et du Sgt Georges Aboagye, tous deux appartenant au contingent ghanéen, la résidence du Premier ministre fut encerclée par des soldats rwandais porteurs de bérets noirs et rouges, armés de fusils et de grenades. Les cinq Ghanéens et les dix Belges furent désarmés sans résistance possible et conduits, les mains en l'air, sous la menace des armes, vers un minibus VW qui attendait à l'extérieur (farde 24, p. 127-138).
D'après l'enquête de l'ONU, un véhicule des FAR avait été appelé par radio sur instruction de l'état-major rwandais pour se rendre au domicile du Premier ministre (B 89 1 893) (VIII 117).
Dans le véhicule auraient pris place, outre le chauffeur, un militaire rwandais armé assis à l'arrière et le Maj Ntuyahaga de l'état-major de l'armée, qui aurait affirmé aux occupants qu'il les emmenait dans un endroit sûr (B 689-1647 et farde 24 p. 119-130-234).
F. Massacre de la section Mortiers au camp de Kigali
En arrivant à destination soit au camp militaire de Kigali les quinze militaires auraient été obligés, sur ordre du Maj Ntuyahaga, de quitter le véhicule et de s'asseoir sur le tarmac situé à l'entrée du camp.
Immédiatement le major rwandais aurait fait circuler la rumeur parmi les militaires FAR rassemblés dans le camp que les soldats belges avaient abattu l'avion présidentiel (B. 619). Sur place l'Adj-chef Sebutiyongera, secrétaire à la présidence, aurait répandu la même rumeur (VII 47).
Ceci aurait rapidement engendré une mutinerie et un soulèvement général pour le lynchage des militaires belges.
À l'entrée du camp, le Lt Lotin rencontre l'observateur de l'ONU, le Capt togolais Apedo. Ensemble, ils rejoignent le bureau de l'observateur où le Lt Lotin utilise, à 09 h 06, le poste de radio Motorola du Capitaine pour informer le Lt Col Dewez que son équipe a été emmenée dans un endroit inconnu et que deux de ses hommes se font tabasser et lyncher.
Après avoir demandé au Lt Lotin s'il n'exagère pas, le Lt Col Dewez met le secteur au courant des faits et demande une intervention des FAR ou de Rutbat pour dégager les Mortiers. N'obtenant pas de réaction, le Lt Col Dewez interpelle par radio à 09 h 08 le Capt Schepkens, officier de liaison auprès du secteur, en lui demandant si le Col Marchal est conscient de la gravité de la situation et demande les mesures envisagées (IV 992; V 1223).
Le Capt Apedo contacte le coordinateur Milob du secteur pour le tenir informé de la situation. À 09 h 10 le secteur indique au bataillon le lieu de détention des Mortiers (V 1223; C 978).
Entre-temps, des soldats rwandais parmi lesquels des handicapés de guerre se sont rués sur les militaires de l'ONU et les frappent à coups de crosses, béquilles, pierres, râteaux ou les piquent à l'aide de baïonnettes de fusil chinois, jusqu'à ce que quatre militaires belges succombent rapidement des suites de leurs blessures (VII 48-55; B 691-693; A 176).
Les magasins d'armement du camp, dont la Minuar avait la responsabilité, sont entre-temps fracturés (VII 137; V 1312).
Le Capt Apedo, qui a quitté son bureau, tente en vain de s'interposer pour arrêter les tueries.
Le Col Nubaha, commandant du camp, accouru sur les lieux en compagnie d'autres officiers, tente d'empêcher les Rwandais de pénétrer dans le local de permanence ONU où le Lt Lotin s'est réfugié avec quatre militaires belges qui l'avaient rejoint en profitant d'un moment de confusion.
De nombreux militaires rwandais qui s'interposent sont blessés (B 700).
Un cinquième militaire belge parvient bientôt à rejoindre le groupe Lotin en rampant sous un véhicule.
Suite aux conseils du Capt Apedo, le groupe Lotin composé de six militaires belges et les cinq ghanéens se réfugient dans un local annexe à celui de la permanence ONU.
Quelques instants plus tard, un militaire belge est tué par un tir d'arme à feu provenant de l'extérieur.
Le Capt Apedo, qui se trouve parmi le groupe Lotin, est extrait du local et obligé de suivre les Rwandais. Menacé de mort dans un premier temps, il est relâché et conduit à l'E.S.M. (école supérieur militaire) d'où il entend siffler les balles provenant du camp de Kigali.
Le local où sont réfugiés les militaires ONU est pris sous le tir des armes des Rwandais, obligeant les Belges et les Ghanéens à se jeter sous les lits qui s'y trouvent et à se protéger derrière le cadavre du soldat belge décédé.
Ayant arrêté les tirs pour un moment, les Rwandais ordonnent aux Ghanéens de quitter le local par une fenêtre qu'ils ont cassée. Sous escorte, les cinq Ghanéens rejoignent le Capt Apedo à l'E.S.M. où ils y rencontrent, vers midi, le Gén Dallaire et le Maj Maggen. Après avoir informé le général que les militaires belges sont frappés et lapidés, les Ghanéens sont reconduits sur ordre du général en véhicule à l'état-major de la Minuar où ils arrivent vers 12 h 30.
Entre-temps, un caporal rwandais non identifié, voulant pénétrer dans le local des Belges, se fait arracher son fusil Kalashnikov par le Lt Lotin qui le tue à l'aide de son revolver (A 176 B 636).
L'attaque redouble de violence contre les militaires belges qui appellent le Col Nubaha au secours (B 649). Des bombes lacrymogènes sont lancées dans le local tandis que les Belges tirent avec la Kalashnikov.
Un fusil lance-grenades est amené sur place. Le Cpl Twahirwa aurait alors escaladé le toit du local pour y lancer, d'un trou pratiqué dans ce toit, des grenades défensives (A 176 B623). Le Capt Hategikimana, surnommé « Power » et le Lt Uzabakiriho, appartenant au bataillon de reconnaissance, auraient contribué à cette action.
D'après des témoins, la résistance belge s'arrête entre 12 h 00 et 14 h 00 (VII 47; A 176; B 618-636; 652; 882).
L'Adj-chef Sebutiyongera prétend avoir quitté les lieux entre 12 h 00 et 13 h 00 à un moment où il y avait déjà cinq victimes belges (B 697).
G. Réunion à l'école supérieure militaire
Durant ces tragiques événements se déroule, dans les locaux voisins de l'ESM, la réunion convenue le soir précédent entre différents responsables politiques et militaires.
Initialement prévue chez l'ambassadeur des États-Unis, cette réunion se tiendra dès 10 h 00 dans un quartier militaire en raison de la présence de barrages en ville (V 1403).
Le Gén Dallaire quitte vers 10 h 00 son QG en véhicule en compagnie du Maj Maggen pour s'y rendre. Le Maj Maggen signale qu'il a entendu avant le départ une conversation entre le Gén Dallaire et un de ses adjoints, concernant le décès de deux ou trois observateurs ONU au camp de Kigali (A 216-335).
En cours de route, à hauteur du cabinet du ministre de la Défense nationale, ils changent de véhicule et montent dans une voiture conduite par un major de la gendarmerie rwandaise.
En passant devant l'entrée du camp de Kigali, le Gén Dallaire constate la présence de quelques militaires revêtus de l'uniforme belge allongés sur le sol. Il déclare qu'il a ordonné au chauffeur d'arrêter le véhicule en vue de se rendre sur place, ce qui lui fut refusé par le chauffeur, prétextant que les troupes au camp étaient hors de contrôle et que leur sécurité serait en danger (D 1472; A 216).
Vers 11 h 15, ils rejoignent la réunion à l'E.S.M., bâtiment situé à 200 mètres du camp de Kigali.
La réunion est présidée par le Col Bagosora, directeur du cabinet du ministre de la Défense, qui a été informé dès 10 h 30 par le Col Nubaha, commandant du camp de Kigali, de la tension qui y régnait (B 687).
Le Col Bagosora promet de se rendre sur place et demande au Col Nubaha de retourner au camp pour « calmer les esprits ».
Une dizaine de minutes après le départ du Col Nubaha, les participants entendent des coups de feu provenant du camp. Certains se rendent à l'extérieur pour apprécier la situation (B 630).
Le nommé Ntamagezo, qui se trouvait dans la salle d'opérations à l'état-major, déclarera qu'en regardant par dessus le mur de l'enceinte, il avait constaté la présence de corps qui jonchaient le sol devant le bureau du commandant du camp. Il a alors téléphoné à l'E.S.M. où le centraliste lui a répondu que les participants à la réunion étaient au courant (B 695).
D'après le Gén Ndindiliyimana, le Gén Dallaire a rejoint la réunion environ 15 minutes après les coups de feu et fut informé de la situation générale par le Col Bagosora (D 873). À la fin de la réunion, vers midi, le Gén Dallaire rencontre à l'extérieur du bâtiment les cinq Ghanéens et le Capt Apedo qui le mettent au courant des faits, à savoir que des militaires belges et ghanéens, transférés au camp de Kigali. avaient été frappés et lapidés (24 p. 10 doss 57/95).
Sur instruction du Gén Dallaire, ces 6 militaires sont emmenés dans son véhicule, en sa compagnie, vers le QG de la MINUAR où ils arrivent vers 12 h 30.
Le Gén Dallaire déclare qu'il est retourné ensuite au Ministère de la Défense où il a participé au comité de crise. Malgré ses demandes d'obtenir des renseignements sur le sort des Belges et de pouvoir se rendre sur place, il affirme qu'il n'a obtenu aucun renseignement concret, mais qu'interdiction lui fut donnée de se rendre au camp vu l'état de mutinerie qui y régnait (V 1382).
Le Maj Rugambaye prétend qu'à 15 h 00 on est venu lui dire que tout était terminé. Il a vu comment on a retiré quatre cadavres du local ONU et comment les victimes furent pillées (A 623).
Le Gén Dallaire croit qu'en début d'après-midi, il fut averti par le Col Marchal que 13 Belges avaient été tués au camp de Kigali. Cette information ne pouvait à ce moment être vérifiée (D 1476).
Il précise également que vers 21 h 00, le Gén Ndindiliyimana a eu confirmation du décès des Belges et qu'en sa compagnie, il s'est rendu à l'hôpital de Kigali où il découvre, vers 23 h 15, les corps entremêlés de militaires belges qu'il croit correspondre à 11 dépouilles mortelles. La manière dont les corps étaient entassés ne lui aurait pas permis de déterminer le nombre exact de victimes, à savoir dix ou onze (B 875). »
Toutefois, avant de procéder, sur la base de ces passages, à un certain nombre de constatations et de soumettre quelques points cruciaux à un examen approfondi, la commission entend apporter deux précisions :
premièrement, à la question de savoir si le groupe Lotin disposait ou non, pour exécuter sa mission d'escorte le matin du 7 avril, de ses mitrailleuses MAG, le capitaine Marchal, qui a encore rencontré le lieutenant Lotin à un barrage, déclare : « Parce que les jeeps étaient ouvertes et qu'on voyait ce qu'il y avait dans les jeeps. Si les mitrailleuses sont en super structure, dès qu'elles sont dessus, on les voit. C'est clair. Maintenant, quand les quatre véhicules de Thierry Lotin étaient arrêtés au niveau du carrefour des Milles Collines, j'ai parlé avec Thierry Lotin, je suis allé vers lui, on a discuté, on a dialogué. J'ai vu un peu ce qu'il y avait dans ces véhicules et j'ai le sentiment qu'il ne les avait pas. » (540b) On peut chercher l'explication dans l'ordre « équivoque » du commandant, qui ne voulait plus voir de mitrailleuses : « Le commandant de bataillon a signalé ne plus vouloir voir les MAC et les MINIMI sur les véhicules dorénavant. Les commandants de compagnies n'étaient pas très d'accord. Après discussion, le commandant de bataillon est resté sur sa position. Il invoquait la raison, s'encadrant dans le contexte dont nous avons parlé, selon laquelle ces armes étaient trop agressives pour la population. Dewez a donné l'ordre de les enlever des véhicules. C'est ici que se trouve l'ambiguïté. L'ordre est venu tel que je vous le décris. Je l'ai transmis aux compagnies. J'ai présenté la version du commandant de bataillon. Un des mes chefs de peloton, le plus ancien, est monté au créneau et m'a dit : « Mais, capitaine, c'est comme envoyer des pompiers au feu sans les lances d'incendie. » J'étais d'accord avec lui. Par honnêteté intellectuelle vis-à-vis de mon commandant de bataillon, je lui ai dit : « Je ne veux plus voir les MAC et les MINIMI, mais cela ne t'empêche pas d'avoir les mitrailleuses et les munitions dans tes véhicules en cas de besoin. » Voilà une interprétation personnelle. Je trouve l'ordre ambigu. (...) Il existe, à mon sens, une certaine marge d'interprétation. C'est à cet égard que joue, peut-être par l'expérience mais en tout cas l'ancienneté et le feeling. Je suis certain qu'un autre commandant de compagnie a agi comme moi. Le capitaine Lemaire, comme moi, a toujours gardé les moyens dont il disposait à l'intérieur des véhicules. Le lieutenant Lotin était plus jeune. Je ne sais pas comment il a interprété l'ambiguïté ou en tout cas, la marge d'interprétation qu'on lui laissait. » (541b)
en second lieu, la question de savoir comment il se fait que le groupe Lotin ait été chargé de la mission d'escorte de la Première ministre Mme Agathe Uwilingiyimana alors que, la veille au soir, cette tâche avait été attribuée à l'une des sections de la 16e compagnie.
Le capitaine Theunissen témoigne : « De opdracht werd eerst aan onze compagnie gegeven. Ze werd rond middernacht « gecanceled ». Vervolgens en rond 1 uur werd de opdracht aan het peloton Mortieren overgedragen. » (542b)
Le colonel Dewez explique sa décision : « ... je n'ai jamais désigné le lieutenant Lotin pour escorter Mme Agathe. À un certain moment, plusieurs escortes devaient être faites. Le lieutenant Lotin se trouvait avec une autre équipe à l'aérodrome pour faire le plein; le commandant de compagnie avait gardé ces hommes pour renforcer son dispositif. Pour ma part, je devais récupérer les gens du peloton Mortier comme réserve et pour assurer des escortes éventuelles. Le commandant de compagnie m'a répondu que ce n'était pas possible car son dispositif serait déforcé. Nous avons fait un compromis et je lui ai dit qu'il pouvait garder une équipe il y avait quatre jeeps mais que l'autre, soit l'équivalent d'une escorte, devait rentrer, car je devais pouvoir compter dessus. C'est en fonction de ce premier ordre que le lieutenant Lotin a décidé de laisser le sergent Pauwels je crois et son équipe à l'aérodrome et que lui-même est revenu vers Viking. Plus tard, j'ai dit au lieutenant Lotin que le peloton Mortiers devait escorter Mme Agathe de sa maison jusqu'à celle de la radio et que, vu les circonstances, j'exigeais une double escorte. C'est tout ce que j'ai dit. » (543b)
Sur la base des dépositions qui ont été faites devant elle, la commission a examiné trois points cruciaux :
1. la question de la planification de l'assassinat des 10 paras.
2. l'attitude des militaires.
3. la question de savoir si l'on aurait pu dégager les 10 paras.
1. La commission s'est tout d'abord penchée sur la question de savoir si le meurtre des dix paracommandos belges doit être considéré comme un événement qui a été la conséquence d'un concours malheureux et fortuit de circonstances, ou bien comme faisant partie d'un plan délibéré dans lequel l'accusation faite aux Belges d'être responsables de l'attentat contre l'avion présidentiel a servi de prétexte pour provoquer le retrait des troupes belges qui constituaient l'épine dorsale de la MINUAR.
Au cours des auditions, des témoins ont avancé des éléments à l'appui de trois hypothèses. Le colonel Vincent, par exemple, chef de la coopération technico-militaire, dit : « Je n'ai jamais pensé au cas de figure du 6 avril 1994. L'assassinat du président n'a été prévu par personne et c'est pourtant cela qui a fait basculer la Rwanda dans l'horreur. » (544b)
Le colonel Marchal écrit, dans sa note confidentielle : « L'assassinat de nos dix hommes demeure pour moi un fait qui sort totalement du cadre des bonnes relations que nous avions toujours entretenues avec le FAR et qui prévalaient toujours au moment des troubles. C'est dans cet état d'esprit que nous nous trouvions le 7 avril au matin. » (545b)
Par souci d'exhaustivité, la commission signale l'existence d'une autre hypothèse concernant la mort des dix Casques bleus. Selon MM. Prunier et Rusatira, ils ont été tués parce qu'ils avaient été témoins du meurtre de Mme Agathe. La commission fait toutefois remarquer que les Casques bleus n'ont nullement été témoins de ce meurtre. Et même dans cette hypothèse, reste à savoir pourquoi le major Bernard Ntuyahaga a emmené les Casques bleus, alors qu'il pouvait constater sur place que Mme Agathe Uwilingiyimana ne se trouvait plus avec eux.
Par contre, selon le major Choffray qui, à l'époque de l'opération MINUAR, était chargé des opérations à KIBAT II en tant que S3, le meurtre des paracommandos belges fut la conséquence d'un plan politique et prémédité. « Donc, pour moi, l'assassinat du président rwandais a permis l'enchaînement des faits suivants, à savoir : attiser un peu plus la colère de la population et de l'armée et cela, par l'intermédiaire de la radio des Mille Collines; attribuer l'attentat du président, via cette radio, aux militaires belges de l'ONU et, naturellement par voie de conséquence, réaliser le souhait du pouvoir en place, c'est-à-dire marquer par une action brutale « le retrait du détachement belge », en lui portant directement atteinte. Ce départ des militaires belges a naturellement laissé les mains libres aux extrémistes que nous connaissons bien et cela pour régler le problème rwandais, c'est-à-dire le problème Tutsi, etc. » (546b). Telle est aussi la conviction du capitaine Lemaire : « En ce qui concerne la question numéro deux, je réponds, mais je ne peux le dire qu'après avoir lu une série de livres par la suite, que, pour moi, la mort des dix mortiers était programmée. Il fallait que la MINUAR se replie et que les gens qui allaient prendre le pouvoir aient le champ libre. » (547b).
La commission a trouvé six indices importants qui vont nettement dans le sens de cette troisième hypothèse, en particulier qu'ils s'agissait d'une action préméditée.
M. Scheers a déclaré devant la commission qu'il avait connaissance de la formation, dans la région de Liège, d'un groupe de mercenaires ou de paras belges qui devaient perpétrer un attentat contre le président : « Ik heb Nahimana de eerste keer ontmoet in december 1993. Die studeerde op dat ogenblik en studeert misschien nu nog in Waver. Ik heb toen tegen Habyarimana gezegd : « Kijk mijn vriend, die historie heeft mij tot nu toe al enorm veel geld gekost. Een ticket Brussel-Kigali is niet goedkoop en ook faxen is duur. Kan ik geen kanaal hebben in Brussel of kunt u mijn kosten terugbetalen ? » Hij heeft mij toen Eugène Nahimana voorgesteld. Over hem ben ik later ernstige twijfels gaan koesteren. De president had hem voorgesteld als tussenpersoon in België omdat hij liever niet had dat ik telkens via de officiële ambassadeur van Rwanda in België passeerde. Als ik terugkijk op wat er allemaal gebeurd is, dan weet ik het niet zo goed of ik opnieuw op dezelfde manier zou werken. Nahimana heeft mij rond half maart, een goede drie weken voor de aanslag van 6-7 april, opgebeld. ... « Notre président, il y a des lourdes menaces qui pèsent sur sa tête. » Ik zeg dan : « Monsieur Nahimana, vous devez vous expliquer; dites-moi de qui il s'agit ? » ...Wij hebben gehoord, zo zei hij, dat er in de streek van Luik een groep huurlingen of Belgische militaire opgeleid worden om een aanslag te plegen op de president. Vraag : Wanneer was dat precies ? Dat was rond half maart. Ik kan de juiste datum nog terugvinden in mijn notaboekje. Vandaag vraag ik me af of ik niet door welbepaalde mensen werd gemanipuleerd. Men wist dat ik in België een aantal politieke contacten had, eerst met Willy Kuijpers en nadien ook nog met andere politici. Men wist waarschijnlijk dat ik bepaalde informaties kon laten doorsijpelen, informaties die misschien perfect pasten in de politiek tegen de Belgische Staat en tegen de Belgische para's, die in die periode in Rwanda meer en meer vorm kreeg. » (548b)
M. Jacques Collet, photographe de presse, a déclaré a l'auditeur militaire : « Ce sont des militaires belges qui ont abattu l'avion, cinq ont été abattus sur place et 5 autres le seraient par après. La personne précisait que ces militaires avaient été dénoncés par des casques bleus du Bangladesh. »
Le 8 juin 1997, cette même personne a écrit à la commission une lettre dans laquelle elle réitère à peu près ce récit :
« ... En effet, je suis journaliste photographe, et ayant appris la chute de l'avion du Président Habyarimana, le 6 avril vers minuit, je me suis rendu le lendemain vers 10 heures à l'ambassade du Rwanda, afin d'y prendre le visa nécessaire pour me rendre à Kigali pour couvrir l'événement comme la plupart de mes confrères.
Arrivé à l'ambassade, alors que j'étais en train de remplir les formulaires, j'ai été frappé par une conversation entre un groupe de rwandais. Ceux-ci qui m'ont dit par la suite être des stagiaires à l'École Royale Militaire, sortaient des bureaux de l'ambassade, disant que c'était confirmé, que c'était bien des paras belges qui avaient abattu l'avion du Président rwandais. Ensuite, ils ont déclaré, que les soldats belges avaient été vus et dénoncés par des soldats bengalis de la MINUAR, et que trois d'entre eux avaient été abattus.
Il faut vous dire que je parle couramment le Kinyarwanda, ce qui m'a permis de suivre aisément la conversation. »
Ensuite, M. Eugène Nahimana est sorti à son tour des bureaux et a annoncé la mort de 10 paras belges. Comme j'avais eu l'occasion de rencontrer M. Nahimana auparavant, je me suis adressé à lui en lui faisant part de mon étonnement, et mettant sa parole en doute quant à l'implication des Belges dans cet attentat, et m'étonnais aussi que 10 soldats aient pu être exécutés par l'armée rwandaise. M. Nahimana et les autres Rwandais présents ont monté le ton me disant que c'était normal qu'ils soient tués vu que c'était bien eux qui avaient abattu l'avion de leur Président.
Je n'ai pas cru nécessaire de prolonger le débat, je me suis rendu à l'agence Belga, j'ai fait part de la conversation à un journaliste de l'agence, et ensemble nous avons décidé de ne pas tenir compte d'une information qui nous paraissait des plus fantaisistes. Il était à ce moment-là environ 11 heures du matin ce 7 avril 1994. »
Le témoignage de l'avocat Johan Scheers confirme, à un point près, les informations livrées par cette lettre : « Heel vroeg in de ochtend van 7 april om 4 uur kreeg ik een telefoon van een vriend uit Kigali, die ik had leren kennen tijdens de vele keren dat ik in Rwanda was geweest. Die zei mij het volgende : « Johan, sais-tu ce qu'il s'est passé ? J'ai dit : « Mais non, explique ». Ik vroeg hem dan « Jean-Baptiste, pourquoi me téléphones-tu à cette heure-ci ? Tu sais quelle heure il est, ici, à Bruxelles ? On dort encore ... J'espère que tu me réveilles avec une bonne raison. » « Oui, mais » zegt hij « on vient de tuer le président ». Question : Il était quelle heure ? Réponse : Il était, madame, quand il m'a téléphoné, environ 4 ou 5 heures du matin ... Question : En Belgique Mais là-bas ? Réponse : Il y a une heure de différence. In de loop van dezelfde ochtend belt Eugène Nahimana mij op. Hij zegt mij : « Ziet ge wel dat ik gelijk had. Gij hebt mij nooit willen geloven en ge hebt geen enkel initiatief genomen. Vandaag is het zo ver de president is vermoord door de Belgische para's. » Question : Hoe laat was dat ongeveer ? Réponse : Ik vermoed dat het toen 10 30 à 11 uur was, alleszins het einde van de voormiddag. Question : C'était toujours le 7 ? En effet. Ik heb hem toen onmiddellijk gevraagd hoe hij dat wist. Hij zei mij : « Parce qu'on les a. Il faut déposer une plainte à La Haye contre la Belgique, parce que ce sont les Belges qui l'ont tué ». Je lui ai dit : « Si vous avez les paras, faites-moi un plaisir, il faut bien veiller à leur sécurité et les maintenir surtout en vie qu'on puisse les interroger pour savoir qui est derrière tout ça. » Hij heeft mij in de loop van die namiddag opnieuw opgebeld, ik weet niet meer precies hoe laat. Het is ondertussen immers al drie jaar geleden. Ik herinner mij wel dat hij mij die dag twee of driemaal heeft opgebeld. In de loop van de namiddag zei hij mij : « Wij hebben ze, de para's, ze hebben geprobeerd te ontsnappen en ze zijn vermoord » (549b).
L'incertitude subsiste en ce qui concerne le moment auquel M. Nahimana (550b) a communiqué le meurtre des paras.
M. Eugène Nahimana a confirmé, devant la commission, qu'il était à l'ambassade du Rwanda à Bruxelles, le 7 avril au matin, mais il a nié être au courant, dès ce matin-là, de la mort des 10 paras. « Le matin du 7 par la radio BBC, je crois. Les Américains et les radios ont d'abord parlé de trois observateurs militaires sans fixer leur nationalité. » Question : Quand avez-vous appris la mort de nos dix paras ? « Le 7, dans l'après-midi. » (551b)
Confronté au récit de M. Collet relatif à l'annonce de l'assassinat des 10 paras, il réagit en déclarant ce qui suit : « Je le nie, c'est clair. L'information venait des militaires, ce n'était pas à moi d'annoncer la mort des dix casques bleus. Beaucoup de choses se trament autour de moi. Comment peut-on envoyer un dossier à l'UNO et remarquer qu'on s'est trompé de personne ? Il y a un complot, une conspiration contre moi » (552b).
Quoi qu'il en soit la Commission estime qu'il est très étonnant que l'ambassade rwandaise fût déjà au courant du drame qui se déroulait au Rwanda.
Le général Rusatira a déclaré : « Je ne sais pas s'ils (NDLR : le major Ntuyahaga et le colonel Bagosora) se sont parlé. Mais la version du major me paraît invraisemblable, car la résidence du Premier ministre ne se trouvait pas sur sa route. De plus, il a évacué les paras et les a laissé désarmés dans le camp malgré l'accueil négatif qui leur avait été donné. J'en ai déduit que le major avait reçu des ordres qui consistaient à lever les mesures de protection à l'égard de Mme Agathe et de supprimer les témoins. »
Le capitaine Apedo, observateur de l'ONU au camp Kigali, a déclaré que le major Bernard Ntuyahaga excitait des hommes en prétendant que les Belges avaient abattu l'avion présidentiel (554b).
M. Silas Gashomba, un témoin oculaire, a déclaré devant l'auditorat militaire : « J'ai vu que des casques bleus belges sont arrivés à pied en compagnie de militaires GP. Ils avaient les mains en l'air. On les a stationnés devant le local ONU. Ils étaient sous la conduite d'un sous-lieutenant GP dont je connais pas le nom. ... J'ai entendu, au moment ou les éléments GP arrivaient avec les casques bleus, l'officier qui les conduisait chuchoter aux militaires stationnés au Tarmac que ces militaires belges avaient abattu l'avion présidentiel. C'est à ce moment que les militaires rwandais ont attaqué les casques bleus massivement et cruellement. » (555b)
D'autre part, Papias Ngaboyamahina, en sa qualité de président du comité de crise (de la communauté rwandaise de Belgique), a, dès le 7 avril 1994, diffusé une déclaration accusant les Casques bleus belges d'être les auteurs de l'attentat contre le président Habyarimana :
« (...) En effet, selon des sources militaires des Casques bleus non belges de la MINUAR, il est confirmé que les obus qui ont abattu l'avion présidentiel provenaient du site occupé par les militaires belges de la MINUAR.
(...) L'actuel double assassinat est donc l'aboutissement d'un long processus destiné à porter les FPR au pouvoir, et mûri par une puissance pour laquelle ont agi les militaires belges des Casques bleus de l'ONU.
La communauté rwandaise de Belgique dénonce avec insistance le comportement indigne de la Belgique dans le processus de pacification du Rwanda, alors que la Belgique est l'ancienne puissance de tutelle du Rwanda et du Burundi.
Ce ressentiment tient de plusieurs faits :
les armes de différents crimes proviennent de la Belgique;
les auteurs du crime ultime sont des militaires belges du contingent belge des Casques bleus, par ailleurs impliqués dans les attaques contre des populations civiles;
la politique du FPR (dont le siège est situé à Bruxelles au numéro 3, rue de l'Observatoire) bénéficie du soutien inconditionnel de plusieurs média et hommes politiques belges.
(...) C'est pourquoi nous en appelons à l'opinion internationale de condamner les auteurs de ces crimes ignobles et leurs commanditaires et demandons au secrétaire général des Nations Unies le retrait immédiat des troupes belges de la Mission des Nations Unies pour l'Assistance au Rwanda (MINUAR) et l'envoi d'une force neutre et à la hauteur de la mission de pacification. »
L'auditeur militaire émérite au Conseil de guerre, M. Van Winsen, a confirmé : « ils ont été assassinés à la suite d'une information concernant l'attentat contre l'avion présidentiel ». À la question de savoir qui a diffusé cette information, M. Van Winsen a répondu : « Majoor Bernard ... een adjunct die om 9 uur 's morgens met zijn combi toevallig in de rue Jean-Paul VI passeerde. » (556b)
La rumeur selon laquelle les Belges auraient abattu l'avion présidentiel a été répandue très tôt. Le colonel Dewez déclare : « C'est une information qui, je crois, est passée par le capitaine Marchal lui-même ou l'une de ses équipes. Cela devait être tôt dans la matinée, peut-être à 4, 5 ou 6 heures, je ne sais plus exactement . » (557b) Le colonel Marchal déclare qu'à 5 h 56, le bataillon l'a informé que des rumeurs rendaient les Belges responsables de l'attentat contre l'avion présidentiel (558b). Au moins trois témoins le capitaine Marchal, commandant de compagnie, le major Choffray, S3, et le major Bodart, conseiller en droit des conflits armées confirment toutefois que la nouvelle circulait déjà beaucoup plus tôt. Le capitaine Marchal déclare qu'il a eu cette information par un barrage, lors d'une patrouille, vers 3 h du matin, et qu'il l'a immédiatement transmise au bataillon (559b). Le major Choffray déclare que, deux heures déjà après l'attentat contre l'avion présidentiel, à la fin de la nuit du 6 avril, il a eu connaissance de la rumeur selon laquelle les Belges étaient les auteurs de l'attentat (560b). Le major Bodart : « Les premiers renseignements venant de l'aéroport, confirmés par Rutongo, c'était, si je me souviens bien vers 20 h 30, 20 h 45. Je crois que dans l'heure qui suivait, si je me souviens bien 21 h 30, 22 h, on entendait déjà, et je crois que c'était venant de l'aéroport, des gens qui disaient : « Des bruits courent que ce serait des Belges qui auraient descendu l'avion. » (561b)
Dans le témoignage écrit qu'il a donné à l'auditeur général près la Cour militaire, le général Dallaire a lui aussi livré une indication importante comme quoi le meurtre des 10 paracommandos belges devait être considéré comme un élément d'un plan délibéré. Il relate comment, peu après midi, le colonel Bagosora et le chef d'état-major de la gendarmerie lui ont déclaré que les événements au camp de Kigali montraient que les troupes belges de la MINUAR feraient mieux de se retirer du Rwanda. « Both, however, expressed concerns to me for the first time that it may be best to get the Belgians out of UNAMIR and Rwanda because of the rumours that they had shot down the Presidential airplane and the reactions already happening in Camp Kigali. » (562b)
2. La commission s'est aussi penchée sur l'attitude d'un certain nombre d'officiers de la MINUAR. Leur attitude a joué un rôle important dans les événements dramatiques du 7 avril au matin :
3.5.2.1. L'attitude du général Dallaire et du représentant spécial de l'ONU M. Booh Booh
La commission a d'abord examiné l'attitude du général Dallaire. C'est lui et M. Booh Booh qui ont pris la décision de protéger la Première ministre Mme Agathe Uwilingiyimana au moyen d'une escorte. Et c'est également le général Dallaire qui bien qu'au courant des difficultés auxquelles le groupe Lotin était confronté n'a rien entreprit pour intervenir.
La commission a donc examiné dans quelle mesure le général Dallaire et ses collaborateurs avaient connaissance des gros risques liés à la mission d'escorte du 7 avril. La commission a aussi examiné ce que le général Dallaire savait exactement de la situation dans laquelle se trouvaient le lieutenant Lotin et ses hommes. Pourquoi le général Dallaire n'a-t-il pris aucune initiative ?
(1) Quelles étaient les circonstances dans lesquelles le général Dallaire a pris la décision d'envoyer une escorte le 7 avril ?
Tant le général Dallaire que le colonel Marchal confirment que la décision de protéger la Première ministre, Mme Agathe Uwilingiyimana et d'assurer la sécurité dans la zone de radio Rwanda pour lui permettre ainsi d'adresser, à 5 h 30 du matin, un message d'apaisement au peuple, a été prise dans la nuit du 6 au 7 avril (563b).
Son témoignage écrit devant l'auditorat général de la Cour militaire révèle que lorsqu'il a pris cette décision, le général Dallaire était parfaitement au courant ou, du moins, aurait parfaitement pu être au courant des risques sérieux inhérents à cette mission. Il savait ou il aurait en tout cas pu savoir dès le départ que l'armée rwandaise, ou du moins, une partie de celle-ci, sous la direction du colonel Bagosora, s'opposerait violemment à cette initiative. C'est ce que révèlent notamment les passages suivants des témoignages du général Dallaire et du colonel Marchal :
À la réunion de crise du 6 avril, qui a débuté au quartier général des Forces armées rwandaises juste après que l'avion présidentiel eut été abattu, il est apparu que le colonel Bagosora prenait les rênes en mains. Il occupait « la position d'autorité ». Ceci se serait confirmé par la suite au cours de toutes les réunions auxquelles il a participé le 7 avril : « C'était vraiment le colonel Bagosora qui commandait. » (564b)
Au cours de cette réunion de crise, il est apparu que, d'emblée, le colonel Bagosora était opposé à l'initiative visant à faire prendre la parole à la Première ministre, Mme Agathe Uwilingiyimana, sur radio Rwanda : « Le colonel Bagosora était catégoriquement opposé, toutefois, à l'idée que le Premier Ministre parle à la radio, car, dit-il, elle n'avait aucune crédibilité auprès de la nation et son gouvernement n'avait aucune unanimité pour résoudre les problèmes » (565b).
Après la réunion de crise à 23 h 30 également, au cours d'une réunion distincte avec le général Dallaire et le représentant spécial des Nations unies, M. Booh-Booh, le colonel Bagosora a continué à s'opposer opiniâtrement à cette initiative : « ... Le colonel Bagosora refusa de manière inflexible. Le RSSG informa téléphoniquement les ambassadeurs des États-Unis, de Belgique et de France de l'évolution de la situation et programma une réunion avec le colonel Bagosora ». Cette réunion, dont l'objectif était clairement de convaincre le colonel Bagosora de ne plus s'opposer à cette initiative, devait se poursuivre le jour suivant à 9 heures du matin (566b). Cette réunion n'aura cependant jamais lieu.
Vers 2 heures du matin, une fois sa réunion avec M. Booh-Booh et le colonel Bagosora terminée et après avoir convenu de se revoir à 9 heures, le général Dallaire donne malgré tout au colonel Marchal l'ordre de protéger et d'accompagner la Première ministre, Mme Agathe Uwilingiyimana à radio Rwanda, pour qu'elle puisse adresser un message à la nation (567b).
Le général de brigade Leonidas Rusatira fait allusion au fait que les militaires avaient l'intention d'écarter la Première ministre : « C'est à la sortie de cette réunion que Bagosora aurait déclaré à Booh Booh que le gouvernement était discrédité et que les militaires avaient l'intention de renvoyer Agathe Uwilingiyimana. À la réunion du matin du 7 avril, j'ai rencontré beaucoup d'hostilité de la part de certains officiers lorsque j'ai déconseillé le recours à un coup d'état militaire. Ils avaient déjà pris la décision de faire partir la Première ministre. Vivante ? Je ne sais pas. » (568b)
Ce matin-là encore, après une conversation avec la Première ministre, Mme Agathe Uwilingiyimana, le général Dallaire doit constater que son initiative n'a aucune chance de réussir : « PM Agathe indicated that she could not contact any of the MRND ministers and the other ministers were indicating they feared for their lives. I tried Radio Rwanda and RTLM, but was unsuccessful in arranging for the PM to go to those radio stations. The personnel at the radio stations were either vehemently against her speaking (RTLM) or fearful of providing help. » (569b)
Tous ces faits montrent très clairement que le général Dallaire savait ou aurait pu savoir que les Casques bleus belges allaient être confrontés à de sérieuses difficultés dans l'exercice de leur mission. D'ailleurs, le colonel Marchal, comme il l'a reconnu lors d'une de ses auditions, était lui aussi informé de l'opposition du colonel Bagosora. Dès le début, il ne pouvait donc plus y avoir aucun doute quant au danger inhérent à l'opération qui avait été confiée au groupe Lotin. Il était clair que l'on pouvait s'attendre à une résistance sérieuse d'une partie de l'armée au moins.
(2) Le général Dallaire était-il informé de la situation dans laquelle se trouvait le groupe Lotin ?
Le général Dallaire affirme qu'il n'était pas informé de la situation dans laquelle se trouvait le groupe Lotin : « I was not aware that Lt. Lotin or the Belgian peacekeepers had been involved in a firefight or had been captured at the PM's house. The KIBAT personnel operated on a different radio system and were not on the UNAMIR Force level radio net. The interface in the communications systems was at Kigali Sector HQ. I do not recall any specific radio transmissions or reports regarding Lt. Lotin and his Section at that time » (570b).
Cependant, le colonel Marchal affirme que peu après 9 h 08, il a pu joindre le général Dallaire ou, du moins, quelqu'un de son état-major et l'a informé des problèmes auxquels le groupe Lotin était confronté. Il demande s'il pouvait intervenir auprès des autorités rwandaises, vu qu'une nouvelle réunion de crise était prévue avec ces mêmes autorités au cours de la matinée. Dans le même temps, un compte rendu est envoyé à la Force à la suite de l'appel du Colonel Dewez signalant que le groupe Lotin est retenu et maltraité (571b). À 10 h 30, quand circule la nouvelle selon laquelle des Casques bleus ont été assassinés, le colonel Marchal contacte à nouveau l'état-major du général Dallaire et a en ligne, par le Motorola, le capitaine Van Putten. Le colonel Marchal ne savait pas que, ce jour-là, le capitaine Van Putten n'accompagnait pas le général Dallaire après 10h30, bien qu'il ajoute que le général Dallaire était joignable jour et nuit, notamment par le biais du major Maggen ou du capitaine Van Putten, qu'on pouvait contacter en permanence par Motorola (572b).
Quoi qu'il en soit, la commission constate que même si l'affirmation du général Dallaire, selon laquelle il n'aurait pas été informé du sort du groupe Lotin, est exacte, il y avait de sérieux problèmes de communication et de graves lacunes dans le fonctionnement du quartier général de la force de l'Onu. Il est inacceptable que malgré toutes les informations alarmantes qui ont été envoyées par le colonel Marchal, le général Dallaire n'ait pas été informé de la situation dans laquelle se trouvait le lieutenant Lotin et ses hommes.
D'ailleurs, la commission constate également une contradiction entre les déclarations du général Dallaire et celles du colonel Marchal en ce qui concerne le moment où ils ont été informés de l'assassinat des Casques bleus belges. Le général Dallaire déclare ce qui suit : « during the early afternoon we received over the radio a report from Col. Marchal that 13 Belgians at Camp Kigali had been killed but it was not confirmed » (573b). Selon le colonel Marchal, au contraire, l'assistant militaire du général Dallaire l'a averti après 12h, que selon l'agence Reuter, des Casques bleus auraient été assassinés au camp Kigali (574b).
(3) Qu'est-ce qui empêchait le général Dallaire de prendre une initiative ?
La commission constate que le général Dallaire n'a rien entrepris, ou du moins, pas grand-chose, pour venir en aide au groupe Lotin, même lorsqu'il a disposé d'indications claires selon lesquelles les Casques bleus belges se trouvaient en danger de mort. Cependant, il y avait suffisamment d'indices et il y avait également suffisamment de possibilités d'intervenir :
Lorsque, vers 11 h, le général Dallaire passe devant le camp Kigali, il voit des Casques bleus belges allongés sur le sol. « While driving by the entrance to Camp Kigali, I caught to my right side a brief glimpse of what I thought were a couple of soldiers in Belgian uniforms on the ground in the Camp, approximately 60 metres. I did not know whether they were dead or injured; however, I remember the shock of realizing that we now had taken casualties. I ordered the RGF officer to stop the car. The officer refused, saying the troops in Camp Kigali were out of control and it was not safe for even RGF officers to go into the Camp. » (575b).
Quelques instants plus tard, lorsqu'il arrive à l'École supérieure militaire, où il doit participer à une réunion d'officiers de l'armée et de la gendarmerie rwandaise, il est interpellé à l'extérieur par un observateur togolais de l'Onu qui l'informe de ce qui se passe au camp Kigali. « The Togolese UNMO approached me in a nervous and excited manner and spoke to me as discretely as he could under the circomstances. To the best of my recollection he spoke of a number of Belgian peacekeepers being held at Camp Kigali and that they were being abused or beaten up. I told the Togolese and Ghanian soldiers to wait for me there as they seemed relatively safe with our escort officer. ». (576b)
Après la rencontre avec l'observateur togolais de l'Onu, le général Dallaire assiste à la réunion qui se termine vers 12 heures, sans évoquer le sort des Casques bleus belges. Lorsqu'il quitte l'École supérieure militaire, il négocie à propos de la libération de l'observateur togolais des Nations unies et des Casques bleus ghanéens qui ont été fait prisonniers en même temps que l'observateur togolais. Ensuite, il se rend au ministère de la Défense avec une escorte de l'armée rwandaise. À plusieurs reprises, il demande au colonel Bagosora l'autorisation de se rendre au camp Kigali, ce que ce dernier refuse toutefois catégoriquement. « Colonel Bagosora indicated that the situation in the camp was out of control and that the Belgians had fired on RGF soldiers. However, Colonel Bagosora stated he was going to secure the camp and obtain their release. I remember him briefing a senior officer accordingly at some time that afternoon. I kept pushing Colonel Bagosora to allow me to go to Camp Kigali to see the Belgians which was repeatedly and adamantly refused »(577b) .
Quoi qu'il en soit, pour la commission, l'attitude du général Dallaire soulève une série de questions. Pourquoi le général Dallaire n'a-t-il pas informé immédiatement le colonel Marchal de ce qu'il avait constaté lui même et de ce que l'observateur togolais des Nations unies lui avait appris ? Le général Dallaire voulait-il ainsi éviter coûte que coûte que les militaires belges interviennent ? Pourquoi le général Dallaire n'a-t-il pas insisté davantage pour s'arrêter lorsqu'il est passé devant le camp Kigali ? Pourquoi n'a-t-il pas parlé des Casques bleus au cours de la réunion à l'École supérieure militaire ? Pourquoi, après la réunion à cette même école, n'a-t-il pas été s'informer de la situation au camp Kigali ? Pourquoi n'a-t-il pas envoyé d'éclaireurs ? Pourquoi a-t-il tenté tout l'après-midi, sans résultat, d'obtenir l'autorisation du colonel Bagosora alors qu'il était clair que les Casques bleus belges avaient été tués ?
Bien que le colonel Marchal refuse de juger ou de condamner l'attitude du général Dallaire, la commission estime que le lieutenant Lecomte avait sans doute eu raison de déclarer devant la commission que le général Dallaire avait d'autres priorités et d'autres soucis que les Belges. Cette opinion est partagée par des affaires belges de KIBAT. Le colonel Marchal a déclaré : « Pour lui, l'essentiel était le succès de la mission. S'il a réagi de cette façon, c'est pour maintenir le calme dans la ville. Pour moi, les hommes ont été sacrifiés afin de ne pas rendre la situation encore plus explosive qu'elle ne l'était. » (578b)
Du reste, le général Dallaire confirme lui-même : « Precipitous action in the context of the tense and uncertain security environment in Kigali that morning could have been the spark which would have ignited a wider conflict. This would have placed UNAMIR in an adversarial role. This situation could have provided a possible excuse for the RPF to both punch out of its CND compound, and to move through the DMZ to ostensibly come to the rescue of UNAMIR (that sort of offer was in fact made to me by general Kagame that afternoon). » (579b) « Had either colonel Marchal or Lt. Col. Dewez requested authority form me to conduct an assault on Camp Kigali to rescue the detained group under the conditions of that time, my response would have been an outright refusal for such an armed intervention. The only solution reasonably available to us at that time was to continue to negotiate as a neutral force. » (580b)
3.5.2.2. L'attitude du major Maggen
Comme indiqué déjà, les déclarations du major Maggen, membre de la cellule d'opérations au quartier général de la MINUAR, doivent être qualifiées de cruciales, moins en raison de la fonction qu'il exerçait qu'en raison du fait qu'il accompagnait le général Dallaire le 7 avril et qu'il fut, ce matin-là, le seul officier belge à passer à proximité du camp de Kigali, où le groupe Lotin luttait pour sa vie. Le général Dallaire qui, ce matin du 7 avril, devait assister à une réunion du comité de crise des FAR, s'était fait accompagner du major Maggen parce que son aide de camp, le capitaine Van Putten, ne maîtrisait pas le français.
Le major Maggen a donc été un témoin privilégié de ce qui s'est passé exactement en ce 7 avril dramatique. La commission a toutefois, à plus d'un égard, de sérieux problèmes avec la déposition faite devant elle par le major Maggen.
Le témoignage du major Maggen devant la commission peut se résumer comme suit : à 9 h 30, le général Dallaire lui demande de l'accompagner avec son aide de camp, le capitaine Van Putten, à une réunion du comité de crise des FAR. Après avoir préparé le véhicule qui doit les transporter, il capte une conversation entre le général Dallaire, son « deputy » et le « public information officer » , dans laquelle il est question « de deux morts dans le camp Kigali, probablement un message du MILOB », sans qu'il soit toutefois spécifié qu'il s'agissait de Belges. Une heure plus tard, à 10 h 30, ils se trouvèrent bloqués à un barrage et poursuivirent leur chemin à pied, le capitaine Van Putten restant toutefois auprès du véhicule. Au cours de cette première partie du trajet, aucun propos n'est échangé concernant la nouvelle comme quoi il y aurait des morts au camp de Kigali. Ils parviennent ainsi à pied auprès des maisons occupées par l'UNDP, tout près de la maison de la Première ministre, Mme Agathe Uwilingiyimana, où le général Dallaire espère la trouver. Ils ne voient personne. Ils poursuivent alors leur chemin jusqu'au bâtiment abritant le cabinet du ministre de la Défense nationale, où un major de la gendarmerie rwandaise leur propose de les conduire à destination en voiture particulière. Pensant que la réunion du comité de crise doit se tenir au quartier général de l'armée rwandaise au camp Kigali, ils passent ainsi une première fois devant la première entrée du camp où se déroule le drame du groupe Lotin. Le major Maggen dit ne pas avoir vu à ce moment-là de soldats allongés sur le sol. Une fois passés, quelques dizaines de mètres plus loin, ils s'engagent dans la deuxième entrée du camp l'entrée du quartier général des FAR , où ils apprennent que la réunion se tient dans les locaux de l'ESM (École supérieure militaire), située à quelques centaines de mètres de là, le long de la route qu'ils ont empruntée. Il font donc demi-tour et passent une seconde fois devant la première entrée du camp Kigali où se trouve le groupe Lotin.
En passant, le général Dallaire fait arrêter la voiture et dit immédiatement : « Je vois des soldats à moi, je vais aller voir. » Le major rwandais qui conduisait la voiture réplique que sa sécurité n'est pas assurée à l'intérieur et poursuit sa route. Selon le major Maggen, le général Dallaire a seulement parlé de « soldats à moi »; il n'a pas dit que c'étaient des paras belges ni dans quelle situation ils se trouvaient. Pour sa part, le major Maggen dit n'avoir rien vu ni entendu, pas de morts, pas de soldats, pas d'attroupement, pas de coups de feu. Quelques instants plus tard il est près de 11 heures ils arrivent à l'immeuble de l'ESM où le général Dallaire rencontre le capitaine Apedo et rejoignent la réunion du comité de crise, qui a déjà commencé. Celle-ci se prolonge jusqu'à 12 h 15, après quoi en sortant, le général Dallaire pose des questions sur le sort de la Première ministre, Mme Agathe Uwilingiyimana, et parle avec le capitaine Apedo et cinq soldats ghanéens. Le major Maggen n'entend pas ce qui se dit. Il ne perçoit que la fin de la conversation quand le général Dallaire demande au capitaine Apedo de faire un rapport écrit sur les événements. Durant tout l'avant-midi, le général Dallaire n'a eu aucun contact avec son quartier général ni avec quelqu'un du secteur ou de l'un ou l'autre bataillon. Durant tout cet avant-midi, il n'a communiqué non plus aucun ordre. Le major Maggen affirme que, pour sa part, durant tout ce temps, il n'a pas été au courant des difficultés dans lesquelles se trouvaient le lieutenant Lotin et ses hommes (581b).
Tout d'abord, la commission constate que sur plusieurs points, ce témoignage est en contradiction avec plusieurs des déclarations antérieures de son auteur. Le major Maggen, en effet, a été interrogé quatre fois sur les événements du Rwanda. Une première fois le 16 avril 1994, par la commission dite Dounkov, une commission d'enquête installée par le général Dallaire et ayant pour mission d'enquêter sur les circonstances dans lesquelles les dix Casques bleus belges ont perdu la vie.
Une deuxième fois le 4 mai 1994, dans le cadre de l'enquête interne de la force terrestre, par la commission dite Uytterhoeven.
Une troisième fois le 29 mai 1995, par l'auditorat général près la Cour militaire.
Etune dernière fois, enfin, le 7 mai 1997 par la « commission d'enquête parlementaire concernant les événements du Rwanda », créée au sein du Sénat.
Devant la commission d'enquête Dounkov, Maggen ne dit mot de l'information qu'il aurait perçue vers 9 h 30 comme quoi il y aurait des morts (observateurs ou Casques bleus) au camp de Kigali. Et au sujet des événements de 11 h 00, il déclare « While passing by the Kigali Camp, the General noticed several bodies of the Belgian soldiers but was not allowed to come closer by the Gendarmerie Major, acting as an escort. » (582b). Le major Maggen est formel, le général Dallaire dit qu'il s'agit de soldats belges. Et « several bodies » ne peut rien signifier d'autre sinon que des corps sont allongés sur le sol, sans vie, ou blessés ou sous la menace. De quelqu'un qui (blessé ou non) se tient debout ou marche, on ne dit pas « I noticed bodies », mais « I saw or noticed persons or soldiers. »
Devant la commission d'enquête Uytterhoeven, le major Maggen parle pour la première fois, dans la déclaration rédigée de sa main, de l'information de 9 h 30 : « Juste avant que nous partions, j'entendis une conversation entre le Force Comd et le Deputy Force Comd concernant deux à trois observateurs de l'ONU qui auraient perdu la vie ». Au sujet du (...) du camp de Kigali, il déclare : « Après 1 500 mètres nous passâmes devant le camp de Kigali et le général demanda au chauffeur de s'arrêter. Il dit qu'il avait aperçu des corps de soldats de l'ONU et qu'il voulait aller voir. Le major de la gendarmerie nous le déconseilla parce qu'il craignait pour notre sécurité et proposa de le faire après la réunion et après concertation avec le chef d'état-major de la gendarmerie qui participait aussi à la réunion. (...). La réunion se termina vers 12 h 15 et je pus déduire des conversations qui suivirent ensuite que la Première ministre (Mme Agathe) aurait été assassinée ainsi que plusieurs militaires belges. Le comité de crise n'avait à ce moment aucun contrôle des troupes qui étaient impliquées dans les combats ni non plus aucune explication pour les faits qui s'étaient produits au camp de Kigali quelques heures auparavant. » (583b) Maggen déclare donc que le général Dallaire dit avoir vu « des corps de soldats de l'ONU » et confirme qu'après la réunion, il a été question du meurtre de Mme Agathe Uwilingiyimana et de militaires belges au camp Kigali.
Devant l'auditeur général près la Cour militaire, Maggen confirme en grande partie sa version des faits telle qu'il l'a consignée à l'intention de la commission d'enquête Uytterhoeven, sauf qu'il ajoute alors que l'information qu'il a perçue à 9 h 30 concernait « deux ou trois observateurs » qui « auraient perdu la vie au camp de Kigali » . Concernant le passage en voiture devant le camp de Kigali, il déclare « le général a fait stopper le véhicule à l'entrée du camp en disant « il y a là sur le sol des soldats à moi, je veux les voir » . Le major de la gendarmerie, qui était apparemment au courant de la situation, lui a répondu « n'entrez pas, car je ne peux garantir votre sécurité » . Comme devant la commission Uytterhoeven, Maggen déclare que ce même officier de gendarmerie propose au général Dallaire d'obtenir l'accès au camp Kigali par l'intermédiaire du général de la gendarmerie qu'il rencontrerait à la réunion du comité de crise (584b). Maggen ne parle plus de corps comme devant la commission Uytterhoeven, mais de soldats qui sont couchés sur le sol.
Son audition devant la commission d'enquête parlementaire s'écarte par conséquent sur plus d'un point de ses déclarations antérieures. L'information qu'il perçoit à 9 h 30 ne concerne pas deux ou trois observateurs de l'ONU morts, mais une communication sur le réseau des observateurs de l'ONU (MILOB) qui signale des morts au camp de Kigali. Avec cette dernière version, nous approchons très près de ce qui s'est révélé a posteriori avoir été le véritable cours des événements. En effet, à 9 h 06, le lieutenant Lotin utilisa le réseau MILOB au moyen du Motorola de l'observateur ONU du camp de Kigali pour informer son bataillon de la situation délicate dans laquelle il s'était retrouvé. Le général Dallaire était donc au courant dès 9 h 30 du fait que des hommes à lui se trouvaient en difficulté ou étaient morts. En ce qui concerne également les événements au moment où le général Dallaire passe devant le camp de Kigali, le major Maggen contredit aussi ses précédentes déclarations. Le général Dallaire aurait seulement dit « je vois des soldats à moi » , alors que dans des déclarations antérieures, il est question de « cadavres » ou de « corps » ou de soldats apparemment « couchés » sur le sol.
Quand le major Maggen dit-il la vérité ? Dans son témoignage fait sous serment devant la commission d'enquête parlementaire ou dans ses déclarations antérieures ? La commission n'a pu l'établir, mais cette contradiction dans ses témoignages doit bien avoir une raison. Soit sa déclaration du 4 mai 1994 est effectivement fautive et elle lui a été, comme il le suggère lui-même, soufflée par l'amiral Verhulst, le JSO, pour concorder avec la version officielle des événements dramatiques du 7 avril mise au point par les autorités militaires, à savoir que le combat du groupe Lotin au camp Kigali avait duré à peine de cinq à dix minutes. Ou bien sa déclaration du 4 mai est exacte elle est en tout cas plus conforme aux communications qu'il a faites à la commission Dounkov et à l'auditeur général près la Cour militaire et, quand il dû comparaître devant la commission d'enquête parlementaire, il a alors adapté sa version par crainte, sans cela, de conséquences personnelles.
Quoi qu'il en soit, il est nécessaire que l'on fasse la clarté sur ce point. Le dossier a été transmis à l'auditeur général près la Cour militaire dans ce but. Pour la commission, il est absolument inadmissible qu'un officier supérieur mente, soit sous la pression de la hiérarchie, soit par crainte pour sa personne.
La commission s'interroge sérieusement aussi sur un autre aspect des déclarations du major Maggen. Il est exclu que le major Maggen n'ait rien vu ni entendu. Plusieurs membres de la commission se sont rendus à Kigali et ont visité le camp Kigali où se sont déroulés les événements dramatiques. Le lieu où les hommes du groupe Lotin ont été lynchés et l'immeuble de l'observateur de l'ONU se trouvent à 35 ou 40 mètres tout au plus de la rue suivie par le général Dallaire et le major Maggen. Il n'y a pratiquement pas d'obstacles visuels. Le camp n'est séparé de la rue que par une barrière. En outre, il est incompréhensible que, si le général Dallaire regarde vers la gauche et dit « je vois des hommes à moi » , le major Maggen ne tourne pas lui aussi la tête vers la gauche et opère la même observation, d'autant plus qu'il se trouvait à l'arrière du véhicule et avait donc davantage de temps pour s'assurer de la situation et fixer dans sa mémoire une image des événements comme l'a fait le général Dallaire. Il est aussi invraisemblable que, durant toute la matinée du 7 avril, le major Maggen n'ait échangé aucun propos avec le général Dallaire sur ce qu'il a vu et entendu. Ils n'ont pas parlé de l'information de 9 h 30. Le major Maggen n'a pas posé de questions sur ce que le général avait vu exactement quand ils passèrent devant le camp de Kigali. Le major Maggen n'a pas non plus posé de questions sur ce que le capitaine Apedo, l'observateur de l'ONU du camp de Kigali, confia au général Dallaire.
3.5.2.3. L'attitude du colonel Dewez et du major Choffray
La commission s'interroge sérieusement aussi sur l'attitude du colonel Dewez et du major Choffray, le matin de ce 7 avril. Un certain nombre de points d'interrogation ont déjà été abordés ci-dessus, dans le chapitre consacré aux problèmes opérationnels (voir le point 3.3.4.); par exemple, la question de savoir pourquoi le colonel Dewez n'a pas annulé, la nuit du 6 au 7 avril, son ordre de retirer les MAG des véhicules ou encore celle de savoir pourquoi les LAW et les munitions lourdes n'ont pas été distribuées à ce moment. Mais les plus grandes réserves de la commission concernent la façon de réagir du commandant de bataillon face aux difficultés auxquelles le lieutenant Lotin et ses hommes ont été confrontés. Tant au cours de son audition que lors de sa confrontation avec le capitaine Theunissen, le colonel Dewez a prétendu qu'il n'était pas intervenu parce qu'il estimait que la situation n'était pas si dramatique : « Quand il a emmené au départ par les FAR, donc avant son dernier ... Là, j'étais c'est dur à dire maintenant un peu tranquillisé. » (585b). « Je savais que le lieutenant Lotin avait un problème mais je ne me suis jamais rendu compte du fait qu'il était en train de se faire massacrer par la foule. Si cela avait été le cas, j'aurais pris d'autres dispositions. » (586b) Du reste, affirme-t-il, une intervention aurait inutilement mis en péril la vie de ses hommes, qui étaient dispersés dans de nombreux cantonnements : « Ensuite, toute intervention musclée mettait en danger non seulement les gens en charge de cette intervention mais aussi tous les autres éléments isolés que j'avais un peu partout. » (587b) tandis que « Ceci peut vous paraître contradictoire dans mes propos, mais l'idée d'user de la force, je l'ai très vite ecartée en me disant : Si les gens sont prisonniers et tabassés, intervenir pourrait leur faire encourir d'autres dangers, car les gardiens eux-mêmes se sentiraient menacés » (588b).
En outre, selon ses dires, il ne connaissait pas le lieu exact où était retenu le groupe Lotin (589b). Enfin, une intervention aurait également été contraire aux règles d'engagement (ROE) (590b). Le colonel Dewez, tout comme le colonel Marchal, d'ailleurs, a espéré pendant toute la matinée qu'à la suite des accords conclus le soir précédent à l'état-major de l'armée rwandaise lors d'une première réunion de crise, la collaboration avec la gendarmerie rwandaise reprendrait ou que, du moins, des officiers des FAR interviendraient (591b).
« Comme je vous l'ai dit, la seule façon dont je voyais la libération de ces hommes qui avaient été faits prisonniers par les Forces armées rwandaises, c'était par un contact avec celles-ci » (592b). « J'avais confiance en eux » (593b).
Les questions que la commission s'est posées en l'espèce sont les suivantes : la situation dans laquelle se trouvaient le lieutenant Lotin et ses hommes était-elle aussi rassurante que le prétend le colonel Dewez, et ce tant avant 9 heures, avant leur arrestation, qu'après, lorsqu'ils ont été transférés au camp Kigali ? Le colonel Dewez et les autres officiers concernés du bataillon belge savaient-ils ou pouvaient-ils savoir où le groupe Lotin était détenu ? Pourquoi ont-ils continué à fonder tous leurs espoirs d'obtenir la libération du lieutenant Lotin et de ses hommes sur des interventions auprès d'officiers de l'armée rwandaise ? Quelle était la crédibilité de l'offre que le capitaine Theunissen aurait faite au colonel Dewez de dégager le groupe Lotin ? Et une telle intervention aurait-elle été contraire aux ROE, comme le prétend le colonel Dewez ? Pour répondre à ces questions, la commission a recherché tant des erreurs d'appréciation ou de jugement qui auraient été commises, et qui ont d'ailleurs été reconnues par le colonel Dewez dans sa lettre du 4 juin 1997, que des négligences et des fautes professionnelles. En d'autres termes, la commission a cherché à savoir de quels renseignements le colonel Dewez et son état-major disposaient exactement. Si les informations qu'ils ont reçues étaient alarmantes ou non. Et surtout si, lors de leur appréciation, on n'a pas négligé ou ce qui serait plus grave encore ignoré des faits incontestables ou des avertissements non équivoques.
Dans le dernier point de ce chapitre, la commission étudie si cette explication peut être trouvée dans le désarmement psychologique auquel colonel Dewez a fait allusion dans sa lettre du 4 juin 1997 à la commission.
(1) La situation dans laquelle se trouvait le groupe Lotin avant 9 heures était-elle alarmante ?
Pour la commission, la réponse est affirmative et il est incompréhensible que le colonel Dewez ne se soit pas rendu compte, après plusieurs heures, de la situation dans laquelle se trouvait le groupe Lotin, surtout après 5 h 30, devant la maison de la Première ministre, Mme Agathe Uwilingiyimana. Pourtant, les indices étaient nombreux et clairs.
Il y a d'abord eu, dès le début de la mission, c'est-à-dire avant même que l'on n'atteigne la maison de la Première ministre, des indications précises que la mission deviendrait dangereuse, difficile et risquée. Plus précisément :
l'alerte rouge, qui a déjà été déclenchée le 6 avril à 21 heures, c'est-à-dire à peine 30 minutes après que l'avion présidentiel eut été abattu, ce qui signifiait concrètement que les hommes étaient appelés à rejoindre leur cantonnement, que les gardes de ces cantonnements étaient doublées, l'armement renforcé et le port de gilets pare-balles et de casques rendu obligatoire (594b); le caractère exceptionnel de cette situation est mis en évidence par le fait que pendant toute l'opération MINUAR, l'alerte rouge n'a été déclenchée que deux fois : la première durant les troubles de février et la seconde le soir du 6 avril (595b);
les objections initiales du colonel Dewez lui-même, contre l'avis du colonel Marchal d'ailleurs, à l'encontre de l'organisation d'escortes et de patrouilles ce jour-là (le 7 avril, vers 1 heure du matin); à ses yeux, c'était irréalisable en raison des nombreux barrages, mais le colonel Marchal l'a convaincu du contraire en soulignant que la gendarmerie et les FAR étaient au courant (596b);. Comme il le déclare lui-même devant la commission, le colonel Marchal a fourni des explications au commandant de bataillon. « La mission donnée était de mettre un maximum de monde sur le terrain en patrouilles mixtes, accompagnées de la gendarmerie. » (597b) (...) « ce qui m'a également frappé, c'est la volonté qui a été exprimée par les officiers présents de vouloir revenir à la normale, le plus rapidement possible, et revenir à la normale, d'une part en gérant la situation dans ces premiers moments de situation destabilisée. Cette méthode a été exprimée par l'envoi de patrouilles un maximum de patrouilles sur le terrain, de façon à rassurer la population et montrer que la MINUAR et la gendarmerie travaillaient toujours de concert. » (598b) Finalement, l'effectif du groupe Lotin qui devait assurer l'escorte a été doublé (599b), ce qui indique que le colonel Dewez et son état-major ont d'emblée été conscients des dangers inhérents à la mission;
les objections du colonel Dewez à l'encontre de l'initiative prise par le colonel Marchal de faire exécuter un vol de reconnaissance au-dessus de Kigali par un hélicoptère (le 7 avril à 4 h 22 du matin); « Il faut se rendre compte que tout le monde est nerveux et je ne sais pas si c'est la meilleure solution K » , peut-on lire dans le « Carnet de veille OSCAR » en guise de réaction du colonel Dewez à l'initiative du colonel Marchal (600b);
la diffusion de la rumeur selon laquelle des Belges avaient abattu l'avion présidentiel, une information transmise spécialement aux troupes et les incitant à demeurer sur leurs gardes (le 7 avril à 5 h 56 du matin); « (...) restez très vigilants » , « restez sur vos gardes » et « restez à couvert à vos emplacements » , peut-on lire dans le « Journal de campagne KIBAT » et le « Cahier de veille OSCAR » en réaction à ces événements (601b);
les graves difficultés éprouvées par le groupe Lotin à atteindre (...) la maison de la Première ministre, Mme Agathe Uwilingiyimana; dès le début de sa mission d'escorte, en quittant l'aérodrome, le lieutenant Lotin s'est heurté à des barrages (le 7 avril à 2 h 16 du matin); après avoir contourné plusieurs de ces barrages, le lieutenant Lotin reste bloqué de 3 h 19 à 5 h 12 environ à un barrage situé à un kilomètre à peine de la maison de la Première ministre, avant de faire un détour, sur l'indication du capitaine Marchal, par le sud, où les FAR se sont montrées disposées à le laisser passer; il atteint vers 5 h 30 la maison de la Première ministre, où il essuie immédiatement des coups de feu; finalement, le groupe Lotin met donc plus de trois heures à parcourir une distance d'à peine quelques kilomètres (602b);
l'opposition à laquelle s'est heurté le groupe du capitaine Marchal de la part des FAR, tant pour atteindre Radio Rwanda que pour se joindre au groupe Lotin.
Finalement, le capitaine Marchal a dû se retirer de sa position à 6 h 38 et se replier dans un des cantonnements (VITAMINE). « Mov derrière moi je voudrais quitter RO pour aller sur VITAMINE. Des paras mettent une Mi en batterie derrière moi » , « Repliez sur Vitamine » , mentionne le « Journal de campagne KIBAT » (603b).
Une fois que le groupe Lotin a atteint la maison de la Première ministre, il ne peut assurément plus subsister le moindre doute sur la gravité de la situation.
Dès que le groupe Lotin s'approche de la maison de la Première ministre, il est menacé et essuie des coups de feu. Deux des quatre jeeps sont immédiatement mises hors combat. Et après que les hommes de Lotin se sont installés dans la maison et autour de celle-ci, la maison elle-même est prise pour cible. Pourtant, le colonel Dewez ne donne pas au lieutenant Lotin l'ordre de riposter. Les indications que le colonel Dewez donne vont toujours dans le même sens, « ne ripostez pas sauf si... » , « mettez-vous à couvert » , « essayez de vous arranger » . Au cours de son interrogatoire, le colonel Dewez a défendu cette attitude d'expectative en disant que les Casques bleus belges n'étaient pas directement visés : « Je lui ai dit : « Tu ne ripostes pas tant que tu n'es pas attaqué directement. » Question : « Wat bedoelt u daarmee precies ? Er werd op hun jeeps geschoten en op het huis waarin zij zich bevonden. Zij werden beschoten met « des grenades à fusil ». Is dat dan niet voldoende ? Réponse : Je lui ai dit d'attaquer directement mais s'il s'agissait de coups partout, si la situation n'était pas claire. » (604b) Toutefois, sur la base d'un certain nombre d'auditions de témoins, notamment du capitaine Marchal, et après une lecture approfondie du « Journal de campagne » et des « Carnets de veille », la commission aboutit à de toutes autres constatations. Il est effectivement indéniable que le lieutenant Lotin n'a pas réagi, mais les indications que lui a données le colonel Dewez ne l'incitent pas non plus à le faire. Au contraire.
Ces indications confirmaient en quelque sorte les instructions qu'avait reçues KIBAT II à l'entraînement et lors de ses reconnaissances, à savoir « favoriser le dialogue et la non-agressivité » , ce qui a fini par occulter d'autres éléments de la mission tels que la légitime défense en cas de menaces (605b). Il est toutefois évident, aux yeux de la commission, que contrairement aux déclarations du colonel Dewez, le groupe Lotin était bel et bien directement menacé et que d'autres directives que celles données par le colonel Dewez s'imposaient donc. Le matin du 7 avril, de 5 h 20 à 5 h 30, le groupe Lotin est bel et bien directement visé, en d'autres termes, il est une des cibles (tout comme la personne de la Première ministre, du reste). Au cours de son audition, le capitaine Marchal, commandant de compagnie, (C6), a confirmé à trois reprises qu'à son arrivée au domicile de la Première ministre, le groupe Lotin a été « pris sous le feu » et qu'on a « tiré » (606b). Le « Journal de campagne KIBAT » et le « Carnet de veille OSCAR » contenaient, eux aussi, des dizaines d'indications incontestables à ce propos. Certains des messages peuvent même être considérés véritablement comme un cri de détresse (« Y » désigne le groupe Lotin et « Y6 » le lieutenant Lotin lui-même); tous les messages ci-après proviennent du lieutenant Lotin ou d'un ses hommes, sauf indication contraire; il est à noter également qu'entre 7 h 20 et 8 h 17, il n'y a eu aucune liaison radio et que le lieutenant Lotin n'a donc pas pu être atteint par le bataillon, un fait qui est confirmé par les déclarations du major Choffray, le S3 de KIBAT II (607b):
5 h 15 « Situation ça tire de partout - Y6 se trouve devant moi AR » (message émanant de C6, c.-à-d. du capitaine Marchal);
5 h 19 « Contact avec Y6 Wait-Situation Tir de partout - Y6 devant essuie le feu » (message émanant également de C6, capitaine Marchal);
5 h 28 « On vient de voir un Veh blindé » ;
5 h 32 « J'ai un AML sur ma Posn » ;
5 h 42 « J'ai pris contact avec Agathe. Elle demande de renforcer sa sécurité. Plus question d'aller à Radio Rwanda. Les jeeps sont sur la rue. Je suis visé par un blindé » ;
5 h 49 « Tir dirigé maison Agathe » ;
5 h 52 « Les coups de feu étaient dirigés sur maison Agathe » .
5 h 55 « Ça a à nouveau ferraillé en poul (6) mais je n'ai plus contact avec Y » (message de C6, capitaine Marchal);
6 h 03 « Y6 véhicules inutilisables » (l'enquête de l'auditorat général a établi que ce message qui provenait du caporal Lhoir, un des hommes de Lotin, a donné lieu à une conversation avec le major Choffray, qui a demandé confirmation du message; le caporal Lhoir aurait répondu qu'il était normal que des jeeps soient hors d'état, puisqu'on tirait dessus depuis deux heures; le fait que ces deux heures étaient en fait vingt minutes aurait eu une connotation ironique, pour bien faire comprendre la gravité de la situation (608b);
6 h 43 « Derrière chez Agathe dans la rue parallèle 1 blindé léger » ;
6 h 44 « Tir artillerie dans notre direction » ;
6 h 49 « Tir artillerie dans notre direction Oui impacts dans notre direction » ;
6 h 55 « Nous sommes dans l'impossibilité de nous mettre à couvert (...). Je reste dehors c'est mieux pour sécurité » ;
6 h 55 « Il y a des gens du front de la jeunesse veulent rentrer (...). On est encerclé » ;
7 h 00 « Ils se préparent pour nettoyage. Garde présidentielle est sur le toit. Ils demandent de déposer les armes » ;
7 h 20 « Renseignons tirs armes automatiques dans notre direction Nous sommes dans la maison d'Agathe » ;
8 h 17 « Je refusez ? mission on me dit que serait les purges ministérielles. Les gens VK ne bougent pas essayez de voir pour prendre posit DEF. Je ne sais pas si je peux attendre en BELGIQUE » ;
8 h 17 « Ils ont des moyens que l'on n'a pas ils ont des grenades, Obus Etc On ne tiendrait pas » ;
8 h 22 « Agathe a demandé de l'aide » ;
8 h 35 « Veh avec Mil à proximité Agathe veut fuir » ;
8 h 40 « Composition de nos antagonistes. Nous proposent de nous ramener à la MINUAR. Agathe plus trouvable » ;
8 h 45 « ? secteur 4 Try p ? ? sur le plancher - ? faire » ;
8 h 49 « Frictions avec garde présidentielle 04 types Mor au sol » .
Il est dès lors incompréhensible, aux yeux de la commission, que le colonel Dewez, même après un message comme celui de 8 h 17, qui doit véritablement être considéré comme un cri de détresse, et qui est d'ailleurs le premier message qu'il reçoit du lieutenant Lotin après le rétablissement de la liaison radio, ait persisté dans son attentisme. Le lieutenant Lotin était prisonnier dans la maison de la Première ministre et son repli ne pouvait pas être assuré (609b); aucune initiative n'a du moins été déployée pour assurer son repli.
(2) La situation dans laquelle se trouvait le groupe Lotin après 9 heures était-elle inquiétante ?
Même après 9 h, alors que le groupe Lotin a déjà été capturé et que le lieutenant Lotin lui-même a envoyé un deuxième appel à l'aide au moyen d'un Motorola d'un observateur de l'ONU, le colonel Dewez ne considère pas que ses hommes soient en danger de mort. Il était toutefois « estomaqué », dit-il.
« Je suis resté avec toutes les conséquences que cela peut avoir naturellement avec les premiers mots du lieutenant Lotin : « J'ai des types qui se font tabasser » . J'ai fait une fixation sur ce terme-là Question : Et ils vont nous lyncher ? Oui, « et ils vont nous lyncher » . J'admets que c'est pour cela que j'ai demandé s'il n'exagérait pas un peu. J'admets que je n'ai pas compris ce qu'il voulait me dire. Je suis resté fixé sur le terme « tabasser » . D'ailleurs, directement, quand j'ai appelé le QG-Secteur, j'ai dit au colonel Marchal « j'ai des types qui se font tabasser » .
Dans mon esprit, bien entendu, ils courraient un danger. Ce n'est jamais très agréable de se faire tabasser mais je n'ai jamais imaginé à ce moment-là qu'ils étaient en danger de mort. C'est ma responsabilité aussi en tant que commandant de bataillon, en tout cas le capitaine Choffray ne m'a jamais dit textuellement « Mon Colonel, ils vont se faire tuer, si on ne fait rien. » (610b) De toute façon, quelle que soit l'interprétation que le colonel Dewez ait donnée de cette dernière conversation avec le lieutenant Lotin à 9 h 06, la commission juge en tout cas incompréhensible qu'il ne se soit « pas vraiment inquiété » et qu'il ait été plutôt « rassuré » et même « soulagé » , comme il le déclare lui-même. « Ils étaient prisonniers, mais sains et saufs. » (611b)
Selon la commission, il y avait pourtant plus d'un indice donnant à craindre le pire :
En premier lieu, la réaction des collaborateurs du colonel Dewez. Après cette dernière conversation avec Lotin, il y a eu un « silence éloquent », « un silence de mort . Comme le colonel Dewez l'a dit lui-même au cours d'une de ses auditions (612b) : un indice sérieux, selon la commission, que les autres officiers et soldats autour de Dewez se rendaient compte du caractère dramatique de la situation. En effet, le « silence » n'est pas un signe que l'on est rassuré, c'est plutôt une marque d'angoisse, de crainte, d'inquiétude. L'adjudant Boequelloen, qui se trouvait alors dans l'entourage du colonel Dewez, a exprimé cet état d'esprit comme suit : « Quand on dit qu'on va lyncher quelqu'un, cela signifie effectivement qu'on va le tuer. » (613b)
Et le major Choffray, le S3, interrogé sur ce à quoi il pensait à ce moment-là, répond : « Lorsque vous entendez cela à la radio, que vous vous trouvez sur le terrain depuis un mois et une semaine, et que du jour au lendemain, vous recevez un tel message, il est bien certain que vous envisagez le pire. » (614b)
Le deuxième indice qui pouvait faire présumer le pire était la constatation que le responsable des UNMO au quartier général de l'ONU ne pouvait plus entrer en contact avec son observateur du camp de Kigali; il se passait donc quelque chose (615b).
Toutefois, le troisième indice, et le plus flagrant, a été l'information qui a circulé sur le réseau à 10 h 30 et qui affirmait que le lieutenant Lotin avait été tué, même s'il était impossible d'identifier à ce moment la source de cette information (616b). Le colonel Marchal se souvient qu'il s'agissait en l'espèce d'« un message radio diffusé » annonçant « que des Casques bleus auraient été assassinés, sans aucune précision quant aux personnes » (617b). Le colonel Dewez, pour sa part, avait très bien compris que le communiqué concernait le lieutenant Lotin et ses hommes. « Cela provenait du QG-secteur, et, plus particulièrement, du capitaine Schepkens. » (618b)
Que le lieutenant Lotin ait été cité nommément ou non, le fait est que c'est là un communiqué qui aurait dû ouvrir les yeux. D'ailleurs, la commission a encore trouvé dans les documents de KIBAT d'autres messages inquiétants sur le peloton Mortiers qui étaient même antérieurs à celui annonçant que le lieutenant Lotin ou des Casques bleus auraient été assassinés. Dans le « Journal de campagne KIBAT », on trouve, face à l'indication horaire « 9 h 10 », une inscription en marge libellée comme suit : « Y » (lettre désignant le groupe Lotin, « Prisonnier et exécuté ? » À 9 h 22, le « Carnet de veille Oscar » précise « Toujours pas de réponse concernant nos gens qui viennent d'être arrêtés. » À 9 h 30, on peut lire, dans le même « Carnet de veille », « Via UNO Int nouvelles de Y » . À 10 h 19, le « Journal de campagne KIBAT » mentionne la communication du colonel Dewez, « Je vais rejoindre Y à ? ? ? et j'essayerai de voir ce que je peux faire ? ? Secteur ne peut rien faire AR » . Au même moment, donc à 10 h 19, et à nouveau cinq minutes plus tard, à 10 h 24, on annonce qu'une intervention de RUTBAT est à l'étude (619b).
À 10 h 30, on annonce que le lieutenant Lotin ou des Casques bleus ont été assassinés, bien que l'on ne retrouve aucune trace du message lui-même dans le « Journal de campagne KIBAT » ou les « Carnets de veille », tels qu'ils ont été regroupés en un seul document par l'auditorat général près la Cour militaire.
Enfin, il y a aussi le témoignage du colonel Marchal devant la commission, qui qualifie d'« électrique » les propos échangés entre 10 h 30 et 10 h 40 par le colonel Marchal et le colonel Dewez (620b).
(3) La mise au point d'une intervention pour délivrer le groupe Lotin a-t-elle été envisagée ou proposée ?
La commission constate qu'il y a de la confusion à propos de la question de savoir si l'on a envisagé une intervention en vue de « délivrer » le groupe Lotin et de celle de savoir si l'on a vraiment proposé d'organiser une telle intervention.
Le colonel Dewez nie qu'une telle intervention a été envisagée.
Le major Choffray, l'officier responsable des opérations au sein de KIBAT II, a declaré qu'il y ait eu une réunion au niveau de l'état-major pour examiner ce qui pouvait être fait pour le groupe Lotin (621b). « Il y a eu un briefing (...). La situation a été analysée » , « Le bataillon a demandé une intervention (...) des véhicules blindés bangladais » . « Dans l'avant-midi, nous avons demandé s'il était possible de changer les règles d'engagement » . Il n'y a toutefois eu aucune intervention du bataillon belge. Selon le major Choffray, l'absence d'une réserve suffisante fut l'une des raisons de la non-intervention. « La seule réserve dont nous disposions se trouvait à l'aéroport » , loin de l'endroit où se trouvait Lotin. Choffray répond par la négative à la question de savoir si c'était une bonne réserve (622b).
Le capitaine Theunissen, commandant en second du groupe City II, a répété devant la commission qu'à 7 heures du matin, il avait proposé au colonel Dewez de libérer le groupe Lotin, bien que ceci n'est pas mentionné, ni dans le rapport Uytterhoeven, ni dans le procès Marchal.
« Question : « Et qu'en est-il de votre intervention ? Vous êtes intervenu sur le réseau du bataillon ? Oui, sur le réseau du bataillon en disant « voilà, je suis ici avec l'ensemble du peloton Alpha du lieutenant Koenings, et une partie de mon PC » . Je disposais d'une point 50, de MAG, donc de mitrailleuses, et de minimis; j'ai d'ailleurs ici le détail du stock de munitions disponibles, que l'on peut faire circuler à titre d'information. Au niveau des MAG, donc des mitrailleuses, il y avait cinq caissettes par arme, ce qui représente environ 1 200 coups par arme. Pour une opération, c'est déjà bien. Pour les point 50, il y avait 200 coups par arme et j'avais 200 coups de munitions point 50 avec moi. Au niveau des munitions 5.56 LINK, les minimis, ou mitrailleuses légères, on en avait cinq boîtes, soit 1 000 coups par minimi, ce qui est bien aussi. Et chaque fusiller avec son FNC, son arme individuelle, disposait de 400 coups. J'avais, dès le matin, fait distribuer tout mon stock de munitions, grenades et réserves de petites munitions, mais nous ne disposions toujours pas des munitions anti-chars, donc des LAW qui sont des armes individuelles mais qui n'étaient pas distribuées et qui se trouvaient à RWANDEX. Je tiens encore à apporter un éclaircissement. Le commandant Choffray prétend que personne n'y a pensé, qu'il n'était pas possible de circuler en ville. Or, le général Dallaire est bien allé à sa réunion à 10 heures du matin à l'ESM, ce qui prouve qu'il était possible de circuler en ville.
Je vous résume ce que j'ai dit : « J'ai la possibilité d'intervenir pour aider le lieutenant Lotin. Je dispose d'une vingtaine d'hommes. J'ai tel armement. M'autorisez-vous à intervenir ? » On m'a répondu ce qui suit : « Non, ne bougez pas pour l'instant, on réfléchit au problème ... Question : Vers quelle heure cela s'est-il passé ? Vers 7 heures du matin, juste après que les FAR aient tiré des grenades à fusil dans la propriété du premier ministre. Je ne connaissais pas les détails la propriété, les jardins, les abords, etc. mais je savais où se trouvait la maison. En général, à l'échelon militaire, on fait appel à différents facteurs d'appréciation : l'ennemi, l'ami, le terrain, le milieu, les délais, etc.
Concernant le facteur « ennemi », nous n'avions pas beaucoup d'informations. J'ai retrouvé par la suite des renseignements selon lesquels il s'agissait d'une vingtaine d'hommes. À l'époque, cela ne nous avait pas frappés. Nous ne connaissions donc pas la force de l'ennemi ni le dispositif mis en oeuvre, mis à part le fait que des véhicules blindés bloquaient les différents accès. En ce qui concerne la localisation des lieux, comme je l'ai dit, nous savions où se trouvait la maison, mais nous ne connaissions pas les détails. Nous ne savions dès lors pas s'il existait une possibilité d'infiltration par l'avant, l'arrière, la gauche ou la droite. Sur le plan des délais, nous aurions pu, sur la base d'une échelle horaire, évaluer le temps nécessaire pour arriver à l'endroit en question, sans savoir bien sûr exactement quelle serait la résistance. Toutefois, je disposais d'un peloton composé de personnes relativement bien rodées, habituées à « faire du feu et mouvement » quand il le fallait. Nous aurions pu passer et briser n'importe quel obstacle. J'en reste persuadé. » (623b)
« Je reste donc persuadé qu'une intervention était possible. Je suis intervenu sur le réseau pour le dire et pour proposer mes services. Nous disposions de plus de munitions que nécessaire (...) Le commandant Choffray prétend qu'il était impossible de circuler en ville. Je constate cependant que le général Dallaire s'est rendu sans problème à sa réunion de 10 heures (...). Je disposais d'une vingtaine d'hommes pour aller aider le lieutenant Lotin ainsi que de l'armement nécessaire. J'ai demandé l'autorisation d'intervenir mais j'ai reçu une réponse négative. On, mais je ne sais pas qui, m'a dit qu'on réfléchissait au problème. Il était 7 heures du matin et je me trouvais à deux kilomètres de la maison de Mme Agathe. En ce qui concerne le facteur ennemi, nous ne disposions pas de beaucoup d'informations ni au point de vue de leur nombre ni au point de vue de leur dispositif. Nous savions seulement qu'ils disposaient de véhicules blindés. Nous ne disposions pas de détails en ce qui concerne la localisation. Nous savions où se trouvait la maison mais pas quelles étaient les possibilités d'infiltration. Enfin, en ce qui concerne les délais, puisque nous connaissions la distance, nous pouvions faire des estimations. Je disposais de militaires rodés au feu qui auraient pu passer » (624b).
Le caporal-chef Pierard a confirmé, lors de son audition, que le capitaine Theunissen était intervenu à 7 heures sur le réseau du bataillon et avait demandé à pouvoir intervenir et venir en aide au lieutenant Lotin. « Nous voulions essayer de passer par les jardins pour intervenir le plus vite possible dans la maison de Mme Agathe. » « Quand il a demandé d'intervenir, nous avions déjà été prévenus et nous étions prêts. » Pas plus que le capitaine Theunissen, il ne sait qui a reçu le message à l'autre bout du réseau (625b).
Le colonel Dewez ne se souvient pas que pareille proposition lui ait jamais été faite. Il se rappelle uniquement une communication reçue vers 10 heures : « L'officier de permanence m'a dit que les gens de Mirador étaient là, au complet, et il m'a demandé s'ils devaient faire quelque chose. C'est dans ces termes que cela m'a été relaté. J'avais déjà pu apprécier la situation et j'ai dit qu'ils restent en place. » Du reste, il était impossible, selon le colonel Dewez, de mettre sur pied une attaque au départ de Chinatown toute proche, vu la présence de blindés de l'armée rwandaise, tandis qu'une action par les jardins aurait également posé problème, compte tenu de la présence de murs garnis de tessons de bouteilles et de gardes qui pouvaient ouvrir le feu (626b).
Il est établi qu'il y a eu un contact entre le capitaine Theunissen et le colonel Dewez, par l'intermédiaire de l'officier de permanence ou non. Ce fait est confirmé par l'adjudant Boequelloen, bien qu'il ne puisse rien affirmer au sujet du contenu de la communication et de l'heure à laquelle elle s'est déroulée (627b). Le fait que le contact concernait une proposition d'intervention est également avéré. La question de savoir à quel moment il a eu lieu reste ouverte. À 7 heures ? À 8 h 30 ? À 10 heures ? Avant ou après la capture du groupe Lotin ? Ou deux fois, avant et après, comme le prétend le capitaine Theunissen (628b) ? On ne retrouve aucune indication précise à ce sujet dans le « Journal de campagne KIBAT » ni dans les « Carnets de veille d'OSCAR et CHARLIE » Quoi qu'il en soit, affirme le colonel Dewez, si on avait proposé à 7 heures de renforcer le groupe Lotin en rejoignant la maison de la Première ministre par les jardins et en forçant des barrages, ce qui était susceptible de déclencher des réactions violentes, il aurait dit « non » (629b).
(4) Le colonel Dewez et les autres officiers belges concernés savaient-ils ou pouvaient-ils savoir où le groupe Lotin était détenu ?
Le colonel Dewez prétend qu'une intervention en vue de libérer le groupe Lotin était de toute façon impossible, parce qu'on ne savait pas où il se trouvait exactement. Pour sa dernière conversation avec le colonel Dewez, le lieutenant Lotin a utilisé un Motorola d'un observateur de l'ONU (UNMO). « À ce moment-là, je ne le savais pas, dix minutes après, j'ai dit au secteur que l'on devait pouvoir dire qui parlait. Et c'est le secteur qui m'a dit après que cela devait être l'UNMO du camp Kigali. (...) C'était vers neuf heures, vers 9 h 10. (...) » (630b) Je suis allé par la suite moi-même au QG-secteur, pour voir avec le colonel Persher, qui était le commandant des UNMO, s'il avait encore des nouvelles de son UNMO, s'il savait où il se trouvait. À ce moment-là, il n'y avait pas de nouvelle. (...) j'ai pris contact afin de savoir justement s'il avait réussi à reprendre contact avec son UNMO, s'il savait où il se trouvait, etc. Et le colonel Perscher m'a dit qu'il n'arrivait plus à prendre contact avec lui. Il a encore essayé quelques fois devant moi. Ensuite, j'ai discuté avec des officiers. J'ai vu le colonel Marchal mais seulement pendant une minute et je lui ai demandé ce qui se passait et s'il pouvait prendre des actions pour libérer les hommes. Lorsqu'il restait environ une demi-heure à trois-quarts d'heure, j'ai discuté à la fois avec les officiers belges qui étaient au QG-secteur et avec le colonel Baudouin qui était de l'ACTM et qui, donc, connaissait un peu mieux les FAR. J'ai discuté avec lui de ce qui se passait... » Cela s'est passé vers 10 h 40 (631b). Le colonel Marchal a, lui aussi, déclaré ne pas avoir su exactement où se trouvait Lotin. « Le major Ntuyahaga avait dit au lieutenant Lotin : « Déposez les armes et je vous reconduirai à un cantonnement de l'ONU. » Pour nous, ce cantonnement n'était pas le camp Kigali. Notre perception du cantonnement était tout à fait différente. » (632b) Au cours de la même audition, il déclare toutefois qu'il savait dès 9 h 08 que le groupe Lotin se trouvait dans une caserne, et non dans un cantonnement de l'ONU. « Quelques minutes après vers 9 h 08, j'interviens pour dire qu'ils seraient dans une caserne près de l'ESM, ce qui figure bien dans la plupart des journaux de campagne. »(633b)
En dépit des déclarations qu'ils ont faites, il est clair pour la commission que tant le colonel Marchal que le colonel Dewez savaient ou, du moins, auraient dû malgré tout déduire logiquement, où se trouvait le groupe Lotin. Le major Choffray confirme que l'on savait très tôt le matin où le groupe Lotin se trouvait exactement. Cela ressort également des documents disponibles, et plus précisément du « Journal de campagne KIBAT (JC) », du « Carnet de veille OSCAR » et du « Carnet de veille CHARLIE », qui ont été regroupés en un seul document synoptique par l'auditorat général près la Cour militaire. Un peu après 9 heures, le colonel Marchal (en abrégé K9) et le colonel Dewez (en abrégé S6) s'entretiennent par le réseau de l'endroit où Lotin (en abrégé Y6) a été retenu.
Dans le « Carnet de veille OSCAR », on peut lire le message suivant : « 9 h 9 de K9 à S6 S6 speaking concernant 12 éléments de Y6 prisonniers QTH près de ESM ». Le « Journal de campagne KIBAT » précise « 9h10 de K9 SitY : Pas de contact avec FAR - Sinon Tf sans effet » et à la même heure « de S6 Y endroit : caserne à côté ESM - Voir contact avec UNMO sur place » (634b).
Ce dernier message, surtout, ne laisse subsister aucun doute. ESM signifie École supérieure militaire et la caserne à côté, c'est le camp Kigali. Le fait que les officiers belges concernés savaient pertinemment bien qu'il s'agissait du camp Kigali est confirmé à deux reprises lors de la confrontation entre le capitaine Theunissen et le colonel Dewez par ce dernier : « À 10 heures, je savais que le lieutenant Lotin était en danger. Je suis resté sur le terme « tabasser ». Je savais que le lieutenant Lotin avait des problèmes quelque part dans le camp de Kigali, mais je n'imaginais pas qu'il se faisait massacrer par une foule. » et « Lotin a des problèmes. Un objectif est de sortir Lotin des problèmes. Mais, quand on entend par objectif, l'objectif terrain, je sais après dix minutes, un quart d'heure, qu'il doit se trouver certainement dans le camp Kigali, puisque le motorola avec lequel il parlait était celui de l'observateur du camp Kigali. Je supposais donc qu'il se trouvait dans le camp Kigali. » (635b).
Le colonel Marchal le répète d'ailleurs une nouvelle fois explicitement à 9 h 45 s'écartant de ce qu'il a déclaré à deux reprises devant la commission (636b) : « Prend contact avec UNMO (camp Kigali) pour Sit Y car pas contact Tf avec FAR » (637b). La deuxième partie du membre de phrase que l'on retrouve dans le « Journal de campagne KIBAT » (à savoir « Voir contact avec UNMO sur place » et le fait de savoir que le lieutenant Lotin avait utilisé, pour son dernier contact, un Motorola dont disposaient les observateurs de l'ONU (UNMO) permettaient de croire qu'il se trouvait peut-être dans le bâtiment ou dans les environs de celui-ci. La question est alors de savoir si personne ne pouvait dire où se trouvait le bâtiment des UNMO dans le camp Kigali. Ou bien le colonel Dewez a oublié de s'informer à ce sujet et il a uniquement cherché à entrer en contact téléphonique direct avec l'observateur de l'ONU en question. Ou bien personne, ni à l'état-major du colonel Dewez, ni au QG-secteur de l'ONU, ne pouvait dire où ce bâtiment se situait. Cette dernière hypothèse est toutefois très improbable. Au QG-secteur de l'ONU à Kigali, le colonel Percher était le responsable des observateurs (UNMO). Il est impensable qu'il n'ait pas su où se trouvait exactement le bureau de son observateur au camp Kigali. Et si cette invraisemblance était quand même vraie, cela signifie en tout cas qu'il y avait une terrible lacune dans le fonctionnement de ce quartier général.
D'après le capitaine Theunissen, le colonel Marchal est intervenu, lui aussi, dans la conversation entre le lieutenant Lotin et le colonel Dewez pour déclarer que lui-même (Lotin) était le mieux placé pour savoir quelle initiative il devait prendre (638b). Le colonel Dewez, qui n'a pas pu suivre la conversation sur le réseau pendant quelques minutes, déclare : « D'après ce que certains officiers m'ont dit et notamment le capitaine Schepkens qui était l'officier de liaison du bataillon auprès du QG-secteur et qui se trouvait près du colonel Marchal , il semblerait que le colonel Marchal soit intervenu dans le réseau. Ce serait à ce moment que l'on aurait dit : c'est toi qui es sur place, c'est toi qui es le plus à même pour juger de la situation. » (639b) Le colonel Marchal dément (640b). La commission n'en a d'ailleurs pu découvrir aucune trace dans les documents mis à sa disposition.
Le capitaine Theunissen reproche aux officiers belges qui exerçaient le commandement de ne pas être allés se rendre compte sur place de la situation dans laquelle le groupe Lotin se trouvait. Lorsqu'on lui objecte qu'il y avait des barrages qu'il était impossible de franchir, comme l'affirme le colonel Dewez, il répond : « En insistant, il était possible de passer. » (641b) D'après lui, ces barrages ne représentaient d'ailleurs pas grand-chose : deux ou trois soldats des FAR qui disposaient parfois d'une arme automatique. Il y avait certes deux AML équipés d'un canon de 60 mm, mais le groupe Theunissen disposait, selon ses propres dires, de points 50 et de MAG capables de percer le blindage de ces véhicules (642b). Selon le colonel Marchal, par contre, il n'était pas possible, avec les mitrailleuses disponibles, notamment les point 50, de percer le blindage d'un AML; ce n'aurait été possible qu'avec un LAW (643b). Le colonel Dewez doute, lui aussi, que l'on puisse percer le blindage d'un AML avec un point 50 (644b).
(5) Une intervention de dégagement était-elle contraire aux ROE ?
Le dernier argument invoqué par le colonel Dewez pour justifier l'absence d'intervention en vue de libérer le lieutenant Lotin est qu'une telle action aurait été contraire aux règles d'engagement (ROE) : « Je dis non, parce que dans le cadre dans lequel je me trouve, je ne peux pas me permettre de faire une action purement militaire, comme nous en avons discuté tout à l'heure avec Mme Dua. Une action où l'on attaque, où l'on fait du feu et du mouvement comme l'a dit le capitaine Theunissen, je ne peux pas me la permettre. Pourquoi Parce qu'il y a les règles d'engagement. Mes règles d'engagement ne m'autorisent pas à franchir le barrage par la force. Et n'oubliez pas que je ne me rends pas compte que Lotin est en train de se faire massacrer. » (645b) Le général Dallaire voit, toutefois, les choses de manière tout à fait différente. Bien qu'il juge, lui aussi, qu'une intervention serait trop risquée, il n'en affirme pas moins, dans le témoignage écrit qu'il adresse à l'auditeur-général près la cour militaire, qu'une telle intervention était parfaitement conforme aux ROE, « (...) the ROE would have authorized an intervention force to come to the aid of the Belgian peacekeepers » (646b).
Quoi qu'il en soit, après une lecture détaillée, la commission estime que le colonel Dewez fait des ROE une interprétation très stricte, qui subordonne un danger réel ou potentiel pour les hommes au respect d'un certain nombre de directives bureaucratiques. Mais même en cas d'interprétation stricte des ROE, le raisonnement du colonel Dewez n'est pas correct aux yeux de la commission. Dès que le groupe Lotin arrive près de la maison de la Première ministre, Mme Agathe, ses véhicules sont pris sous le feu. Ensuite, il est sommé de déposer les armes. En tout cas, on l'empêche d'accomplir la mission qui lui a été confiée par Dewez, Marchal et Dallaire, ses supérieurs hiérarchiques, mission qui consiste à emmener et escorter la Première ministre à Radio Rwanda.
En lisant attentivement les ROE, on remarque que les points 10 et 15b de celles-ci sont applicables. Le point 10 définit le concept. Le point 15b dispose que l'on peut recourir à la force armée, c'est-à-dire, entre autres, aux armes à feu, notamment : (1) en cas de légitime défense; (2) contre des tentatives de désarmer le personnel de la MINUAR; (3) lorsque du personnel de la MINUAR est en danger de mort; (4) lorsque d'autres vies sont en danger; (5) pour défendre les installations ou les véhicules de l'ONU contre une attaque armée; (6) lorsque des tentatives sont faites pour forcer le personnel de la MINUAR au moyen d'une force armée à se retirer d'une position qu'il a reçu l'ordre d'occuper de ses supérieurs; (7) en cas de tentatives par le recours à la force armée de pénétrer dans les installations de l'ONU ou d'isoler une force de l'ONU; (8) en cas de tentative par la force d'empêcher le personnel de la MINUAR d'effectuer des missions assignées par ses commandants; et (9) en cas de tentative d'enlèvement ou d'arrestation de personnel militaire ou civil de l'ONU par la force.
Dans le cas du groupe Lotin, on pouvait invoquer au moins les §§ (1), (2), (5), (6) et, sûrement, (8). Les §§ (2) et (9) entrent, eux aussi, en considération. Toute discussion est donc impossible : les Casques bleus belges pouvaient recourir à la violence armée tant près de la maison de la Première ministre qu'après la capture par les FAR. Le point 11 des ROE, et plus précisément les §§ e. et f., définissent quelle forme de violence peut être exercée et avec quelle intensité. En cas de menace immédiate ou si une hésitation risque d'entraîner un nombre encore plus grand de victimes, on peut recourir immédiatement à la violence armée. Le principe appliqué en l'occurrence est qu'il faut utiliser la « force minimum », « minimal force ». Concrètement, une action dirigée contre la MINUAR peut donner lieu à une contre-réaction équivalente de la MINUAR. Il est parfaitement possible, en l'espèce, de percer ou de forcer un barrage. Enfin, la dernière question qui se pose est de savoir qui prend cette décision.
C'est celui qui est confronté à la menace qui juge, mais conformément au point 8 des ROE, c'est le commandant local jusqu'au niveau sous-officier qui décide de recourir ou non aux armes personnelles pour monocoups. Au cas où il faut faire intervenir des mitrailleuses légères, le commandant de secteur donne l'autorisation. Si l'usage d'armes plus lourdes (mitrailleuses lourdes, armes antichars et autres) s'avère nécessaire, c'est le commandant de la Force ou, en son absence, le commandant auquel il a délégué ses pouvoirs (647b). Une intervention visant à dégager le lieutenant Lotin, soit près du domicile de la Première ministre Mme Agathe Uwilingiyimana, soit au camp Kigali, n'était dès lors, dès le départ, pas contraire aux ROE. S'il fallait pour cela utiliser des armes plus lourdes que l'arme personnelle, le colonel Dewez devait en formuler la demande au colonel Marchal ou, éventuellement, au général Dallaire ou à son remplaçant. Aucun des documents disponibles ni des rapports d'auditions des témoins ne révèle qu'une telle requête ait été formulée ni même envisagée.
(6) Pourquoi le colonel Dewez a-t-il persisté à croire en une intervention de la gendarmerie ou des FAR ?
La commission constate que dès l'aube du 7 avril et jusque dans le courant de l'après-midi, le colonel Dewez a espéré une intervention des autorités militaires rwandaises. Suite aux accords conclus lors de la réunion de crise qui s'est tenue dans la nuit du 6 au 7 avril, on a escompté la collaboration de la gendarmerie pour permettre aux escortes et patrouilles de la MINUAR de franchir les barrages, tandis que de son côté, l'armée rwandaise serait mise au courant et laisserait le libre passage à la MINUAR.
Un examen approfondi des documents disponibles et aussi de nouveaux faits rapportés par les témoins ne laissent toutefois pas subsister le moindre doute. Très tôt dans la matinée déjà, il s'est avéré qu'il ne fallait pas attendre grand-chose de la promesse de collaboration de la gendarmerie rwandaise. Quand fut donné l'ordre de reprendre les patrouilles avec la gendarmerie, plusieurs officiers du bataillon belge firent des objections parce qu'ils savaient déjà que la gendarmerie rwandaise ne voulait plus travailler avec les Belges (648b). Peu après 2 h, quand l'officier de garde communiqua le nombre de patrouilles à effectuer et le nombre de gendarmes rwandais qu'il faudrait demander à cet effet, il s'avéra que l'on ne pouvait pas compter sur la gendarmerie rwandaise. Le document reconstitué par l'auditorat général près la cour militaire à partir du « Journal de campagne KIBAT » et des « Carnets de veille » révèle que les commandants responsables des patrouilles ont dû la plupart du temps assurer leur mission sans l'aide de la gendarmerie ou avec une aide très limitée de celle-ci. À 2 h 25, B6 communique : « Je suis à la Gd. Problème, ils savent la mort du président. Refusent de donner des Gd. » À 2 h 28 C6 communique la même chose. À 3 h 26, A6 communique : « Problème de Gd, 2 éléments sur place ne veulent pas en donner » , et une dizaine de minutes plus tard : « reçu un Gd mais pas très frais » (649b). Des dix-huit gendarmes, qui ont été demandés par A6 (...), B6 (...) et C6 (capitaine Marchal), seuls trois ou quatre se présenteront ou seront mis à disposition en tout et pour tout. Même l'officier de gendarmerie qui se trouvait d'habitude à l'état-major de KIBAT ne s'est pas présenté le 7 avril au matin (650b).
Ce matin du 7 avril, l'armée rwandaise ne donne absolument aucune velléité de collaboration. À quelques exceptions près, les militaires refusent de laisser le passage aux barrages de sorte que les patrouilles belges sont obligées de les éviter. De même, l'aide demandée par le secteur (colonel Marchal) et par KIBAT (colonel Dewez) au quartier général des forces armées rwandaises reste lettre morte. Les officiers de liaison des FAR, qui doivent aider les patrouilles de KIBAT à franchir les barrages où elles sont bloquées, ne se présentent pas. Le lieutenant Lotin, par exemple, restera bloqué près de deux heures, de 3 h 19 à 5 h 12 à un de ces barrages. Plusieurs fois, on lui communique, entre autres le colonel Dewez, qu'un officier de liaison des FAR va arriver pour débloquer la situation. Plusieurs fois, on demande au lieutenant Lotin si l'officier de liaison des FAR s'est déjà présenté. La réponse est chaque fois négative et finalement, sur ordre du capitaine Marchal, le lieutenant Lotin contourne le barrage et prend une autre route vers le domicile de la Première ministre Mme Agathe (651b). La même mésaventure survient à C6 (capitaine Marchal, ainsi qu'à A6 (...) et au groupe (RELAX), qui est bloqué à l'entrée de l'aéroport. Là aussi, l'officier de liaison des FAR ne s'est pas manifesté. Ce n'est que sept heures plus tard, à 7 h 18, suite à une intervention de l'ambassadeur de Belgique, qu'ils atteindront le quartier général du bataillon belge, à bord de leurs propres véhicules qu'ils avaient refusé de quitter et escortés par les troupes des FAR qui les menaçaient. Il en va de même de K7 (...) et de la section qui devait se rendre à Kanombe, le lieu où s'est écrasé l'avion présidentiel. L'officier de liaison promis à 3 h 45 n'est jamais arrivé et les troupes des FAR de Kanombe, que l'état-major des FAR aurait dû informer, ont refoulé les Casques bleus belges à leur arrivée.
Pour la commission, il est incompréhensible, sur le vu de ces incidents et d'autres encore qui se sont tous produits avant que le groupe de Lotin ne soit fait prisonnier, que le colonel Dewez ait continué à se fier aux officiers du quartier général des FAR (652b). Le colonel Dewez : « La seule façon dont je voyais la libération de ces hommes qui avaient été faits prisonniers par les Forces armées rawandaises, c'était par un contact avec celles-ci » (653b). ... « Autant j'avais une certaine confiance en certains officiers supérieurs des FAR, autant je me rendais compte que le contact était tout à fait différent aux échelons inférieurs, en ce qui concernait les sous-offciers ou les soldats en poste aux barrages. » (654b) ... « Quand il a été emmené au départ par les FAR, donc avant son dernier... Là j'étais c'est dur à dire maintenant un peu tranquillisé. Cela peut sembler dérisoire par la suite quand on sait ce qui s'est passé mais à l'époque je me suis dit qu'il valait être mieux prisonnier que mort » (655b). Aucun des accords conclus n'a été respecté. Même après 9 heures, après que le lieutenant Lotin eut été fait prisonnier, il s'est avéré que l'on ne pouvait pas compter sur les FAR. Le « Journal de campagne KIBAT » mentionne à partir de 9 h 10 que le colonel Marchal communique : « Sit Y : Pas de contact avec FAR sinon Tf sans effet ? ». À 9 h 22, le « Cahier de veille OSCAR » mentionne : « Toujours pas de réponse concernant nos gens qui viennent d'être arrêtés » . À 9 h 45, la même source mentionne le message du colonel Marchal : « pour sit Y car pas de contact Tf avec FAR » (656b). Le colonel Marchal a déclaré au cours d'une des auditions qu'en ce qui concerne le sort du groupe Lotin, il était finalement parvenu à contacter l'officier qui faisait la liaison entre les FAR et la MINUAR et que celui-ci lui avait promis que l'on enverrait un officier des FAR au camp Kigali. « ... l'officier de liaison n'est jamais arrivé, contrairement à ce qu'il m'avait promis. » (657b). Le colonel Marchal n'en a manifestement pas informé le colonel Dewez.
(7) L'attitude du colonel Dewez peut-elle s'expliquer par le « désarmement psychologique » ?
Enfin, la commission a également examiné dans quelle mesure le sentiment de désarmement psychologique a influencé la décision du colonel Dewez de n'apporter, le 7 avril 1994, aucune aide aux troupes du lieutenant Lotin.
La commission constate qu'au cours des auditions, le colonel Dewez n'a pas avancé l'aspect « désarmement psychologique » comme argument justifiant sa passivité du 7 avril.
Ce n'est que plus tard, dans une lettre du 4 juillet 1997 adressée au président de la commission d'enquête parlementaire, que Dewez a mis l'accent sur l'aspect de désarmement psychologique en affirmant que semblable charge psychologique a freiné de facto la capacité d'intervention de la Minuar et aurait donc également déterminé sa décision de ne pas intervenir. Les limitations du mandat des Nations unies la passivité imposée, l'absence de toute possibilité de résistance militaire et l'interprétation stricte des règles d'engagement expliquent, selon le colonel, l'attitude des troupes au cours de la mission ainsi que sa décision de ne pas donner l'ordre, le 7 avril 1994, d'aider le groupe Lotin.
Dans sa lettre du 4 juillet 1997, le colonel Dewez écrit :
« Qu'est-ce qui a pu paralyser à ce point mon jugement ? Après mûre réflexion, car ces questions me trottent dans la tête depuis plus de trois ans , je pense que plus que d'un problème matériel d'armement et de munitions, il s'agit d'un problème de conditionnement psychologique, de mentalité.
Je n'étais pas parti au Rwanda comme paracommando pour me battre, mais comme Casque bleu pour « aider » les Rwandais et ce par une simple présence plutôt symbolique et non par un engagement direct dans leurs problèmes. Donc, en cas de difficulté, je me devais de résoudre celle-ci par la négociation, en faisant le « gros dos » et seulement, en toute dernière extrémité dans le cas d'un tir direct (la légitime défense au sens strict), en ripostant par le feu non pas pour tuer, conquérir ou défendre un objectif au sens militaire du terme, mais pour persuader l'agresseur de stopper.
Ma perception des opérations classiques de l'ONU était que l'ONU ne se bat pas, ne doit pas se battre, mais faire le gros dos en attendant que cela passe.
J'avais reçu comme mission de préparer mon bataillon à une opération de soutien de la paix où nous devions renier certains principes classiques des opérations militaires (concentration des forces, effet maximum, etc.), museler l'agressivité et nos réflexes militaires (du moins ceux qui ne convenaient pas à cette mission « d'agent de quartier »). Toutes les directives allaient dans ce sens et aucune dans le sens de se battre en cas de problème. La sécurité du personnel prime, mais cette sécurité était erronément trop axée sur la passivité. À trop vouloir se protéger et faire le gros dos, on en perd tout sens de la combativité qui dans les opérations classiques est également un facteur de survie tout autant que les mesures de protection passive. Sur base de directives reçues, il n'y avait d'ailleurs pas d'ennemi clairement identifié et désigné, comment aurions-nous donc pu matérialiser notre combativité.
Quand les événements ont basculé avec la mort du président Habyarimana, la réunion du comité de crise et la volonté (je pense honnête) d'une frange du haut commandement militaire rwandais d'assurer l'ordre (avec l'aide de l'Unamir) ont contribué à me maintenir aveuglé dans cette logique ... Paralysé dans cette logique, je n'ai pas su (pas eu le temps ?) prendre le recul indispensable pour analyser les nouvelles données, je n'y ai pas non plus été amené par la chaîne hiérarchique ONU la formulation « les règles d'engagement restent d'application », employée sans autre commentaire, laissant implicitement sous-entendre que l'ONU ne voulait pas modifier son comportement plutôt passif. Dans cette logique et aussi sans doute aveuglé par ma formation au droit des conflits armés (conventions de Genève, etc.), le fait que mes dix hommes soient faits prisonniers par un major des FAR était même tranquillisant puisqu'après une situation de plus en plus confuse et dangereuse, après de nombreux tirs, il n'y avait pas de victime parmi mes hommes. »
Plusieurs militaires confirment que la passivité imposée a certainement conditionné l'attitude des troupes au cours de l'opération à Kigali.
Interrogé par la commission spéciale le 16 avril 1997, le colonel Dewez, notamment, signalera que les troupes ont été conditionnées par l'aspect « désarmement psychologique ». Selon le colonel, ses troupes étaient tellement impressionnées par les règles en matière d'interventions armées qu'elles ne réagissaient plus comme de véritables troupes commando. Selon lui : « À force d'insister sur les différences par rapport à la situation rencontrée en Somalie, certains hommes en sont arrivés à avoir l'impression qu'ils ne pouvaient plus tirer, même en cas de légitime défense. L'inquiétude régnait également suite aux enquêtes de l'auditorat militaire sur des tirs abusifs en Somalie. Les soldats avaient l'impression que chaque fois qu'ils ouvriraient le feu, on viendrait leur demander des comptes. » (658b)
Le colonel Leroy a déclaré lui aussi que certaines décisions prises en application des règles du mandat ont désarmé psychologiquement les soldats. Le « désarmement » des Casques bleus belges a en outre contribué à l'« armement psychologique » de tout agresseur potentiel.
« Nous avons agi au niveau des attitudes militaires. Ainsi nous avons cessé les patrouilles avec les armes tenues des deux mains et des sentinelles veillant au quatre points cardinaux. Le résultat a été que la population a baptisé les patrouilles nouveau genre, c'est-à-dire moins militaires, de patrouilles « Coca-Cola. » (659b)
Dans le « rapport Uytterhoeven » également, l'on souligne que le désarmement psychologique pour ce qui est de l'application des règlements d'engagement, a créé une atmosphère d'incertitude parmi les hommes.
« On a tant insisté sur les interdictions contenues dans les ROE que, finalement, le principe le plus important la légitime défense n'était plus présent à l'esprit des exécutants. Tout le monde se plaignait de ce qu'on ne pouvait pas faire, et perdait de vue les actions positives qui étaient permises. »
« Une certaine confusion régnait au sujet de l'emploi des armes : alors que le commandement n'avait autre objectif que de créer une image pacifique de la Minuar (en évitant de montrer ou de porter les armes de façon trop agressive), certains ont interprétés les directives comme une interdiction d'emporter certaines armes. »
« Il faut aussi admettre que l'attitude adoptée au Rwanda n'était pas de nature à plaire au paracommando. Elle était éloignée des réflexes qui lui étaient jusqu'alors inculqués tout au long de sa formation : dominer la situation, en imposer en étalant sa force et sa confiance en soi. Le paracommando n'est pas un policier et n'aspire certainement pas à jouer ce rôle. »
« L'armement et les munitions étaient adaptés à ce rôle de policier. Nos paracommandos ont interprété cette situation : le fait de n'être ni autorisés, ni en mesure faute de moyens d'intervenir avec fermeté, a certainement eu une influence sur leur vigilance, leurs réflexes de base, voire même sur leur sens de l'initiative et leur confiance en soi. » (660b)
Lorsqu'on l'interrogea sur les déclarations relatives à l'interprétation des règles d'engagement qu'il avait faites en 1994 et qui ont été remises à la commission dirigée par le général-major Uytterhoeven, l'aumônier Quertemont confirma son témoignage antérieur : « Les règles d'engagement étaient ce qu'elles étaient. Mais il y a eu un manque d'adaptation de ces règles. On a eu à faire à un commandement plus catholique que le pape.
Les chefs auraient pu décider à un moment de changer leur fusil d'épaule. Cela ne s'est jamais fait ... Il est un fait que des contestations se sont exprimées à plusieurs reprises, notamment à propos de l'utilisation de mitrailleuses sur les jeeps. Leur usage paraissait inadéquat parce que trop agressif. Le lieutenant Lotin aurait pour sa part compris qu'il fallait que ces armes ne soient pas visibles. À la fin du mois de mars, un bataillon a également demandé l'envoi d'armes FNC parce qu'il fallait préférer celles tirant au coup par coup plutôt que des salves. Ainsi, il y a eu inconsciemment la volonté de se faire plus catholique que le pape à propos de l'interprétation des règles d'engagement. Cet état d'esprit a continué après la crise. » (661b)
Cette situation s'est encore accentuée en raison du manque de sens des réalités du major Bodart, conseiller en droit des conflits armés. Plusieurs témoignages montrent combien était irréaliste son interprétation de la notion de « menaces » et de la notion de « légitime défense » qui y est liée.
Le lieutenant Vermeulen : « Un type qui se promène avec une grenade près d'un cantonnement, ce n'est pas une menace. Un type qui lance une grenade et qui s'en va, on ne peut pas lui tirer dessus. » (662b)
L'attitude du major Bodart est confirmée par le sergent Pauwels, qui a déclaré dans son témoignage au sujet de l'attitude du conseiller en droit des conflits armés après le meurtre des dix paracommandos et le début du génocide : « Après les incidents, quand le major Bodart voyait qu'on armait, il faisait enlever la munition. » (663b)
Dans sa déclaration, le caporal Walbrecq dresse un tableau pratiquement identique de l'attitude de Bodart au cours de cette période : « Le major Bodart a fait, après les événements, enlever la .50 qu'on avait mise sur l'Unimog. » (664b)
Le caporal Mathys l'a confirmé également. « Quand les gens sont menaçants, il ne faut pas y aller « comme ça », « la fleur au fusil ». On s'est fait engueuler par le Maj Bodart parce qu'on avait équipé nos véhicules de .50, Mag ... Pour nous, on était menacés, on menaçait aussi. » (665b)
La commission constate cependant que le « désarmement psychologique » n'a pas affecté tous les militaires de la même façon. Alors que le colonel Dewez, le commandant du bataillon, désirait, même pendant la crise du 7 avril 1994, appliquer encore strictement le mandat, la commission constate qu'au même moment, d'autres militaires ne se sont pas sentis désarmés psychologiquement, n'ont pas fait preuve de la même passivité et ne se sont pas sentis paralysés par les restrictions contenues dans les règles d'engagement.
Contrairement à l'attitude adoptée par le colonel Dewez et le commandement MINUAR, certains officiers subalternes voulaient bien intervenir.
Le capitaine Theunissen : « ... dans sa déclaration, le major Choffray a apparemment oublié mon intervention de 7 heures du matin, le 7. Or, je dispose d'un témoin en la personne d'un de mes snipers, le premier caporal-chef Pierard. Ce dernier m'a rappelé que j'ai demandé à un certain moment si nous avions une possibilité d'intervenir pour aider le lieutenant Lotin à s'extirper du pétrin dans lequel il se trouvait. 7 heures, c'est à peu près le moment où il a dû pour la première fois essuyer des tirs de grenades à fusil dans le jardin du Premier ministre. C'est à ce moment que j'ai demandé si avec les 25 à 30 hommes placés sous mon commandement, je pouvais... Le capitaine Marchal était toujours coincé avec son chauffeur de l'autre côté avec les AML qui obstruaient le passage.
C'est pour cette raison que je formule quelques reproches au commandement, que ce soit le colonel Dewez, le colonel Marchal ou le général Dallaire, je ne sais pas qui. À partir du moment où l'un de vos subordonnés est en difficulté, que vous le sentez, même s'il ne reconnaît pas ouvertement qu'il est dans le pétrin et ne sait pas s'en sortir, j'estime que c'est au chef à se rendre sur place, quels que soient les moyens. Et quels étaient les moyens disponibles ? Il y avait notamment les BTR des gens de RUTBAT que le colonel Marchal, c'est vrai, avait eu beaucoup de difficultés à rendre opérationnels. Je constate toutefois qu'à 9 heures du matin il y avait trois BTR en circulation en ville. Ils se sont faits arrêter à un barrage et, comme c'étaient des couards, ils ont fait demi-tour après une demi-heure de palabres à l'africaine, mais avec un peu de détermination, ils auraient pu passer outre le barrage et intervenir pour aller chercher le lieutenant Lotin et ses hommes. J'en rest persuadé et personne ne me fera dire le contraire.
Je suis intervenu sur le réseau du bataillon en disant « voilà, je suis ici avec l'ensemble du peleton ... Je disposais d'une .50, je disposais de MAG, de mitrailleuses, je disposais de minimis, ... Pour une opération, c'est déjà bien.
J'ai la possibilité d'intervenir pour aider le lieutenant Lotin. Je dispose d'une vingtaine d'hommes. J'ai tel armement. M'autorisez-vous à intervenir ? » On m'a répondu ce qui suit : « Non, je bouge pas pour l'instant, on réfléchit au problème » (666b).
Toujours en ce qui concerne le fait que le désarmement psychologique n'était plus opérant pendant les événements du 7 avril 1994, le capitaine Theunissen a témoigné devant la commission : « Il nous a mis en état d'alerte, tous ceux qui étaient là et puis il a demandé la permission pour intervenir et pour aider le lieutenant Lotin. » (667b)
Lors de l'audition du 27 juin, le caporal-chef Pierard a confirmé que le capitaine Theunissen avait formulé la demande de venir en aide à Lotin. Pierard : « il nous a mis en état d'alerte et a demandé à pouvoir intervenir. » (668b) Pierard a également déclaré qu'il était convaincu de la faisabilité d'une intervention. « Quand il a demandé d'intervenir, nous avions déjà été prévenus et nous étions prêts. Nous avions monté la .50 sur l'Unimog, les MAG du peloton A qui était coincé là-bas avec nous étaient déjà prêts. Nous avions reçu les grenades. Nous étions prêts à intervenir. » (669b)
Le caporal-chef Pierard a ajouté que lui et ses hommes étaient très motivés pour y aller et que le refus d'intervenir avait déçu ses troupes.
Il n'est pas aisé de trouver une explication pour l'absence de réaction militaire de la part du colonel Dewez (et d'autres). À la question de savoir si une opération militaire visant à dégager les dix Casques bleus belges aurait été possible, le lieutenant Leconte a répondu par une explication que toute personne désireuse de comprendre les événements du 7 avril doit garder à l'esprit : « Il fallait également assumer les responsabilités diplomatiques et politiques d'un tel acte. À ce moment-là, les troupes belges ne se comportent plus en « gardiens de la paix », mais ont une attitude agressive, attitude proscrite depuis le début de notre préparation. On ne pouvait pas être agressif : on nous a suffisamment répété que ce n'était pas la Somalie. » (670b)
Enfin, la commission ne peut pas affirmer avec une certitude totale que le groupe Lotin aurait pu se sauver en faisant feu sur ceux qui l'attaquaient le 7 avril 1994, bien que ce soit probable. Dans tous les autres cas où les Casques bleus belges ont réagi fermement aux intimidations des Rwandais, ils sont parvenus à les décourager.
La commission ne peut pas non plus affirmer avec certitude que la mise sur pied d'une opération militaire sous le commandement du colonel Dewez aurait permis de libérer Lotin et ses hommes, bien que ce soit probable, vu que non seulement les troupes étaient motivées pour intervenir, mais qu'il y avait également à ce moment assez d'armes et de munitions pour accomplir la mission.
S'appuyant sur les divers témoignages, la commission constate qu'une intervention aurait dû être la réponse normale pour des militaires et qu'en tout cas quelques officiers subalternes étaient prêts, le 7 avril 1994, à se libérer de l'effet « paralysant » du « désarmement psychologique ».
3.5.2.4. L'attitude du colonel Marchal
La commission rappelle que le colonel Marchal a été jugé et acquitté par la Cour militaire.
C'est le colonel Marchal qui, à la fin de la première réunion de crise de la nuit du 6 au 7 avril ou juste après celle-ci, a convaincu Dewez de faire abstraction de ses objections à l'encontre de certaines escortes et patrouilles à effectuer, arguant de ce que la gendarmerie et l'armée rwandaise avaient promis de collaborer. L'attitude du colonel Marchal relève des questions dès lors que, comme le colonel Dewez d'ailleurs, il a reçu assez tôt dans la matinée des messages laissant entendre que la collaboration promise restait lettre morte (la gendarmerie fournit peu de personnel, les officiers de liaison des FAR ne se présentent pas aux rendez-vous, l'armée rwandaise ouvre le feu sur des Casques bleus ou encerclent des cantonnements). Il est difficile de parler encore d'une opération de maintien de la paix à partir du moment où les FAR refusent de collaborer. Pourquoi, dès lors, continuer les escortes ? Pourquoi ne pas augmenter considérablement la force de feu de KIBAT ? (671b)
La commission constate que les avis sur la possibilité et/ou l'opportunité d'une intervention de dégagement du groupe Lotin sont partagés. La majorité des officiers sur place étaient convainçus qu'une intervention devait être exclue dans les circonstances données. Tous les témoignages estiment pourtant qu'une intervention de dégagement du groupe Lotin était certainement réalisable sur le plan militaire si on avait pu disposer de blindés légers et des munitions nécessaires pour ces véhicules.
Selon le colonel Dewez, le commandant de KIBAT II qui estimait qu'une intervention n'était pas opportune, le nombre des effectifs était aussi insuffisant (672b). Lors de sa confrontation avec le capitaine Theunissen devant la commission, il déclara qu'une intervention au camp Kigali eût été possible en attaquant avec une quarantaine d'hommes. Quoi qu'il en soit, d'un point de vue technico-militaire, dégager le lieutenant Lotin était une opération difficile mais pas impossible (673b). Contrairement à ce que déclare le capitaine Theunissen, selon le colonel Dewez les FAR ne disposaient peut-être pas d'un réseau de transmission très élaboré, mais elles avaient néanmoins des postes Motorola et Kenwood (674b).
Selon le major Choffray, l'officier responsable des opérations à KIBAT II, une opération de dégagement du lieutenant Lotin n'était pas réalisable. « D'abord, nous avions la dispersion et la vulnérabilité des cantonnements, qui étaient bien souvent sans aucune protection conséquente face à une attaque éventuelle des forces armées rwandaises.
Nous disposions également de 4 CVRT que nous ne pouvions sortir, car il s'agissait de véhicules légèrement blindés à chenilles, sans munitions et dont les équipages étaient non opérationnels.
Pour mener une opération à ce niveau, il fallait au moins l'équivalent d'une compagnie complète, simplement pour suivre un itinéraire, et donc avoir la protection suffisante, avoir l'armement et le personnel que l'on pouvait regrouper, donner des ordres et ensuite mener l'action. » (675b) À la question de savoir ce qu'il aurait fait si le bataillon belge avait disposé de blindés légers, il répond : « J'aurais proposé une action pour aider Lotin. Il est d'ailleurs possible qu'il ait reçu un ou deux de ces blindés pour sa mission d'escorte. » À la question de savoir pourquoi on n'a pas utilisé les deux CVRT disponibles, il répond : « Le problème de l'utilisation de ces CVRT ... Ils auraient été utilisés pour franchir les barrages. Mais pour franchir les barrages, si on leur tirait dessus, il fallait avoir un équipage qui sache utiliser le CVRT, ce qui n'était pas le cas : il fallait avoir de l'armement dessus, or ce n'était pas le cas pour tous les CVRT, il fallait avoir des munitions et nous n'avions pas les munitions pour les CVRT. »(676b)
Selon le colonel Marchal, pour intervenir au domicile de la Première ministre Mme Agathe Uwilin
giyimana, il aurait fallu des armes antichars de courte portée et un véhicule blindé. Pour une action de dégagement au camp Kigali, il aurait en tout cas fallu encore plus de moyens(677b). Il convient aussi de mentionner la conclusion que tira le colonel Marchal devant la commission lors de son audition du 10 juin 1997 de l'incident survenu le matin du 7 avril à 8 h 50 avec trois BTR de RUTBAT (voir ci-dessus point 3.3.4). Sa conclusion va dans le même sens que celle du major Choffray : avec les BTR, il était exclu de forcer des barrages; avec des CVRT en bon état la situation aurait été absolument différente (678b).
Selon le capitaine Marchal, une opération de dégagement du groupe Lotin « aurait été une entreprise hasardeuse et délicate » en raison de la présence d'expatriés, du regroupement nécessaire des troupes et vraisemblablement du manque de puissance de feu (munitions). À la question de savoir si l'opération aurait été possible s'il avait disposé de LAW et d'une QRF avec des CVRT et des APC, il répond : « Si nous disposions de tous ces moyens, oui. » Le capitaine Marchal pense toutefois que les forces armées rwandaises disposaient d'un réseau radiophonique (679b).
Selon le capitaine Lemaire, commandant de compagnie, il aurait fallu deux heures pour mettre sur pied une opération offensive et atteindre le camp de Kigali. La principale raison en était la présence des barrages et la dispersion des hommes entre les cantonnements, qui nécessitait un regroupement. La première chose qui aurait dû se faire en tout cas, c'était aller chercher les missiles antichars LAW au centre logistique RWANDEX. Le capitaine Lemaire confirme aussi que si le bataillon belge avait eu à sa disposition les munitions et les hommes nécessaires pour le fonctionnement des CVRT, ils auraient pu intervenir pour sauver le peloton mortiers (680b).
Le lieutenant Lecomte déclare qu'une intervention pour dégager le groupe Lotin était « techniquement » possible : « L'emplacement exac t du peloton mortiers nous était connu et nous aurions pu réunir rapidement deux gros pelotons grâce à la présence de la quatorzième compagnie. » Ce sauve
tage aurait certainement été plus facile si l'on avait disposé de blindés légers opérationnels (681b).
Selon une note du major Maggen du 17 mai 1994 rédigée à l'attention de l'état-major général (et transmise également à l'auditorat général de la Cour militaire et à la commission chargée de l'enquête interne de la force terrestre, la commission dite Uytterhoeven), une opération de dégagement du groupe Lotin aurait peut-être été possible, mais les Belges ne disposaient pas du « matériel lourd (M113, AIFV) nécessaire » (682b).
Le capitaine Theunissen affirme dans sa déclaration que non seulement une intervention pour dégager le groupe Lotin était possible, mais que si une QRF opérationnelle équipée de 22 CVRT, dont il avait été question avant le déploiement des troupes belges, avait été présente, rien ne se serait jamais passé : « Non, Lotin aurait pu les utiliser et la menace des FAR n'aurait pas existé. » (683b) Il souscrit ainsi au point de vue du major Choffray et du colonel Marchal.
Par ailleurs, pour le capitaine Theunissen, une telle intervention ne présentait pas de danger pour les expatriés : « Les unités rwandaises étaient dispersées et il n'était pas évident qu'elles disposaient de l'équipement radio nécessaire. Si notre attaque avait été locale et très rapide, elle n'aurait pas engendré de conséquences ailleurs. » (684b) Il est soutenu en cela par le caporal-chef Pierard, qui déclare que les FAR n'étaient pas organisées et qu'à l'exception de quelques AML, leur armement était léger. « En mettant en oeuvre les Points 50 et par après les LAW, nous n'aurions pas rencontré de gros problèmes. » (685b)
Au niveau de l'état-major de la Force, du secteur et du bataillon, par contre, l'opinion a prévalu que leur intervention avait constitué un risque pour les expatriés.
La commission fait remarquer que si la présence des expatriés a pu constituer un obstacle à une intervention quand des hommes se sont trouvés en difficultés le 7 avril, cette même présence d'un grand nombre d'expatriés a pu constituer un frein à l'action du contingent belge à d'autres moments.
3.5.3. L'assassinat des citoyens belges
Des citoyens belges civils ont été assassinés au Rwanda après le 6 avril 1994. La commission a pris connaissance d'une liste dressée par l'ambassade de Belgique à Kigali, qui reprend les noms de 10 ressortissants belges assassinés et deux ressortissants morts de mort naturelle, probablement suite au manque de soin. Plusieurs noms sont suivis de la mention « parce qu'il était belge », qui signifie que ces personnes ont été assassinée après la vérification de leur passeport, manifestement en considération de leur seule nationalité.
Les informations quant aux circonstances de ces assassinats ne sont pas très nombreuses.
La commission a entendu des familles de victimes (686b); à cette occasion, elle a reçu des documents relatifs aux assassinats de Mme Claire Beckers, Katia Bucyana et leur mari et père Isaie Bucyana (citoyen Rwandais) et aux assassinats de Antoine Godfriaux, Christine André et Olivier Dulieu, émanant respectivement de Mme Beckers et de M. et Mme Godfriaux, et a entendu ces personnes lors de ces auditions. Elle a aussi entendu Mme et M. Mugwaneza sur les circonstances de la mort de Mme Annie Roland et de son mari Jean Huss Mugwaneza (citoyen rwandais).
Quant aux circonstances de l'assassinat de Antoine Godfriaux, Christine André et Olivier Dulieu, la commission a aussi pris connaissance de la déposition faite par M. Marc Bohy le 26 juin 1997 devant un officier de police judiciaire, suite aux devoirs d'instruction prescrits par M. le juge d'instruction Vandermeersch.
La commission relève les informations suivantes :
Ces trois personnes se trouvaient au Rwanda dans le cadre d'un contrat de coopération avec l'ONG Nord-Sud Coopération, pour participer à des projets basés dans le village de Rambura, situé dans la préfecture de Gisenyi (687b).
L'ONG Nord/Sud Coopération, Association pour le développement dans le Monde, est une ASBL sise à Mons qui a pour objet « de contribuer par tous moyens au développement économique, social et/ou culturel des pays en voie de développement » (688b). Elle a été agréée par l'AGCD en tant qu'ONG par décision ministérielle du 9 mai 1985.
Le projet principal auxquels les trois coopérants ont participé est la création (construction, équipement et mise en fonctionnement) d'une école secondaire technique (en construction et électricité) en extension d'une école secondaire et normale existante, située à Rambura, sur la colline Kibihekane.
Rambura est le village natal du président Habyarimana. Ce village paraît bénéficier d'un traitement privilégié. Il est éclairé, goudronné et bénéficie de quatre écoles, manifestement réservée à une population scolaire aisée.
Selon l'exposé du projet remis par Nord-Sud comme « requête de cofinancement d'un projet de développement auprès de l'Etat belge », « l'école secondaire et normale de Rambura a été construite et est gérée par une association locale composée de parents d'élèves et de personnalités de la région », l'ASBL « ADECOGIKA ». A l'époque de la rédaction de cette note, l'association est présidée par Noël Mbonabaryi, député national et vice-présidée par le colonel Serubaga, chef d'État major adjoint. L'ASBL sera ensuite représentée dans les passations de marché par le colonel Théoreste Bagosora. Il s'agit donc de personnalités de stature nationale, très proches du président.
Le projet de création du lycée technique est présenté comme s'inscrivant dans le cadre des objectifs fixés par les autorités rwandaises. En témoignage de cette volonté, le document cite un extrait du manifeste du MRND, qui affirme la volonté d'orienter l'enseignement et l'éducation de la jeunesse de façon à permettre à celle-ci de s'intégrer dans le système de production ou de poursuivre la formation conformément à la vocation de chacun et aux besoins de la société; objectif qui, toujours selon la note est souvent rappelé par le chef de l'État, Juvénal Habyarimana.
Le projet s'étale sur cinq années (1989-1995). Il est dirigé par l'asbl « ADECOGIKA », qui assure la reprise après les cinq premières années.
Il prévoit l'envoi de trois coopérants pour le démarrage des sections. Les volontaires expatriés qui encadrent le projet seront présent de la 2e année du projet à la 5e année.
Le projet se verra accorder une subvention de 17 139 375 francs (pour un apport belge total de 22 852 500 selon les prévisions budgétaires de l'année 1989 de l'ASBL Nord-Sud, c'est-à-dire une répartition 75 %-25 %) par arrêté ministériel du ministre de la Coopération au Développement du 1er août 1989. La section de coopération de l'ambassade à Kigali avait remis un avis « très favorable » quant au co-financement du projet, l'AGCD un « avis favorable ».
Le projet semble avoir connu des retards dans la construction (phase I), constatés dès 1990, et s'aggravant en 1991. Ceux-ci seraient dus d'abord au fait que l'entreprise réalisant les travaux ait dû se consacrer aux travaux à effectuer pour la visite du Pape à Kigali, et ensuite aux troubles agitant le Rwanda en 1990-1991.
Le dossier administratif témoigne de ce que les autres phases du projet ont également connu des retards importants. Finalement, le projet sera interrompu lors de sa deuxième phase, alors qu'il devait en compter cinq.
Olivier Dulieu se trouvait au Rwanda depuis septembre 1992. En février 1993, il est évacué vu la reprise des combats dans la région. Il revient au Rwanda vers le mois d'avril.
Antoine Godfriaux a été engagé par Nord-Sud le 3 septembre 1993. Son départ était prévu pour le début novembre. La « convention d'envoi » entre lui et l'ONG « Coopération et progrès » a été signée le 16 novembre 1993 (689b). Il ne se fera finalement que le 17 janvier 1994, après plusieurs reports, sans qu'Olivier Dulieu et ses parents ne puissent s'expliquer ces reports. Son épouse, Christine André, le rejoindra le 20 février 1994 (690b). D'après un rapport d'activités adressé par Nord-Sud à l'AGCD, il semble que ce soit l'AGCD qui ait imposé un moratoire à l'agrément des coopérants.
D'après M. Bohy, qui a été coopérant au Rwanda du 2 octobre 1988 au 16 avril 1994, les trois coopérants sont, à ce moment, les seuls occidentaux dans cette partie du Rwanda. Leur envoi vers cette région l'étonne d'ailleurs. Il estime que « vers la fin de 1991, la tension a commencé à grandir dans la région du Nord et plus précisément Gisenyi et Ruhengeri. Il y a arrestation des opposants et c'était le début du massacres des Bagogwes (Tutsi du Nord). En fait, je dirai que le génocide avait déjà commencé à plus petite échelle. Environ un an et demi avant le génocide de 94, le climat d'insécurité avait atteint son maximum. (...) » Quant à lui, M. Bohy dit « n'avoir jamais avoir été menacé car [il] était considéré comme homme de confiance de M. Nzirorera Joseph, futur secrétaire général du MRND ». M. Bohy conclut: « C'est ainsi que lorsque j'ai appris que trois nouveaux coopérants allaient débarquer à cet endroit, il m'est arrivé à plusieurs reprises de me dire qu'ils n'avaient aucune idée du lieu où ils débarquaient, ni des dangers qu'ils allaient encourir. » (691b)
Les trois coopérants seront assassinés le 7 avril 1994. M. Bohy estime que « le fait d'avoir fait courir la rumeur selon laquelle les Belges avaient assassiné le président a contribué à l'assassinat des trois coopérants belges à RAMBURA. Leur mort n'est pas le fait du hasard. Il faut se replacer dans le contexte de l'époque, avec les entraînements des Interhamwes, qui obéissaient à des ordres venus d'en haut ». (692b)
Selon les parents d'Antoine Godfriaux, « l'unique raison invoquée par ces sources, l'ONG Nord-Sud-Coopération, le ministère des Affaires étrangères et la « justice de Bruxelles », pour expliquer l'assassinat des trois coopérants est leur nationalité » (693b). Au cours de son audition, le père d'Olivier Dulieu a affirmé lui que « les raisons de l'assassinat des trois coopérants dépassent le simple fait de leur nationalité », il a évoqué une « question de gros sous, de détournement et de blanchiment d'argent » (694b).
Bien des questions continuent à se poser quant à l'assassinat de ces trois coopérants : comment se fait-il qu'ils aient pu être envoyé dans une région qui avait d'autre part été évacuée par tous les coopérants ? Quelle est la procédure d'autorisation qui a précédé cet envoi ? Qui et quelle(s) autorité(s), belges et rwandaises, y ont participé ? Par qui ont-ils été assassinés ? Sur ordre de qui ? Dans quel(s) but(s) ? Ces assassinats étaient-ils programmés ? Une enquête judiciaire est en cours en Belgique, avec laquelle la commission ne veut pas interférer.
Quant à l'assassinat de Mme Claire Beckers, Katia Bucyana et Isaie Bucyana (citoyen Rwandais), la commission a entendu Mme Beckers. Sa soeur, sa nièce et son beau-frère ont été assassinés début avril. M. Isaie Bucyana était d'origine Tustsi. Au début des années '80, il avait déjà rencontré des difficultés pour trouver un emploi « parce qu'il était Tutsi » (695b). Il semble ce soit M. Bucyana qui ait été d'abord visé : « le vendredi 8 avril, la maison de ma soeur a été attaqué par des militaires et des civils. Ils disaient être à la recherche de mon beau-frère. » (696b)
Mme Beckers s'étonne de ce que aucune aide n'a été procurée à sa soeur et sa famille lorsqu'elle a cherché à fuir. Lorsque Mme Claire Beckers a téléphoné à la MINUAR, il lui aurait été répondu « qu'il était impossible de l'évacuer et qu'elle devait chercher elle-même un véhicule (...) Nous avons appris du responsable civil belge du quartier où vivait ma soeur qu'il avait tout fait pour lui venir en aide, mais ni l'ambassade ni la MINUAR n'ont réagi. Il y avait pourtant des soldats qui étaient prêts à intervenir mais qui n'ont jamais reçu l'autorisation nécessaire. Comment l'ambassadeur de Belgique n'a-t-il rien pu faire pour ma soeur alors qu'il était régulièrement en relation avec elle et qu'il savait qu'elle était particulièrement exposée à cause de son mari tutsi ? » (697b)
À ce propos, le vice-président et rapporteur de la commission a rencontré M. Jean Nachtergaele, directeur de l'école belge à Kigali, lors de sa mission au Rwanda, le 25 août 1997. Ce dernier lui a expliqué que la famille Bucyana a été attaquée une première fois le 7 avril. Le peloton Ramadan, qui était cantonné à Nyamirambo, où habitait la famille Bucyana, a évacué le 8 avril, sans emmener la famille. Selon les informations de M. Nachtergaele, le peloton n'aurait pas été autorisé à évacuer les couples mixtes, bien qu'il l'ait offert. Le samedi 9 avril, les membres de la famille Bucyana étaient assassinés.
Lors de son audition par la commission, le colonel Balis a été interrogé sur le plan d'évacuation qu'il avait été chargé d'élaborer par le général Dallaire en mars 1994. On lui a demandé si le plan prévoyait des dispositions particulières pour les couples mixtes. Il a répondu : « Het probleem heeft zich zover ik weet nooit gesteld. Ik neem aan dat wanneer een koppel op een bepaald adres verbleef en wij daar een voertuig naartoe stuurden, dat wij dan de echtgenote ook meenamen zonder eerst na te gaan of zij wel de dubbele nationaliteit bezat. Maar dit probleem stelde zich in feite nooit. » (698b)
Mais à la question de savoir s'il était prévu d'évacuer des Rwandais, le colonel a déclaré : « Het ging wel degelijk enkel om niet-Rwandezen. Door omstandigheden heb ik generaal Dallaire tweemaal expliciet gevraagd of Rwandezen ook mochten worden geëvacueerd als ze in gevaar waren. Hij antwoordde formeel : « Bevelen van New-York : no locals ». Er mochten dus geen Rwandezen geëvacueerd worden. » (1c)
Quant aux circonstances de la mort de Mme Annie Roland et de son mari Jean Huss Mugwaneza (citoyen rwandais), Mme et M. Mugwaneza ont témoigné des éléments suivants : « Notre père était visé comme intellectuel tutsi. Des militaires du gouvernement Habyarimana prirent d'assaut la maison de nos parents pour y assassiner notre père. Toute la famille fut regroupée dans le jardin pour être ensuite massacrée. » (2c)
Les circonstances de ces assassinats sont assez similaires. Mmes Annie Roland et Claire Beckers étaient toutes deux mariées avec des citoyens rwandais d'origine tutsie. Les familles estiment que l'on a visé ces hommes parce qu'ils étaient des intellectuels tutsis. Leurs femmes et enfants ont subi leur sort. Mais les familles ont toutes deux l'impression que l'on n'a pas fait beaucoup d'efforts, tant à l'ambassade de Belgique qu'à la MINUAR, pour évacuer ces familles « mixtes » ... Des enquêtes judiciaires sont en cours également quant à ces cas, qui éclaireront peut-être les zones d'ombre qui subsistent.
Au cours de la période entre le 7 avril et le mois de juillet 1994, le Rwanda fut ravagé par une vague de terribles et sauvages massacres. Bien que jusqu'à présent aucune estimation officielle du nombre de victimes n'ait été faite, la plupart des experts internationaux s'accordent pour estimer qu'entre 500 000 et 1 000 000 de Rwandais ont perdu la vie au cours de cette période la plus douloureuse de l'histoire de ce pays. Il est probable que le nombre exact des victimes ne sera jamais connu.
Dans son ouvrage « The Rwanda crisis », le professeur G. Prunier tente de procéder par déduction pour arriver à une estimation d'environ 800 000 Tutsis massacrés au cours de ces trois mois.
Selon lui, il convient d'ajouter à ce chiffre un nombre inconnu de Hutus modérés (entre 10 000 et 30 000). Le nombre de victimes du génocide s'élèverait par conséquent entre 800 000 et 850 000 (3c).
Au cours de son témoignage devant la commission, le professeur Prunier ajoute que le nombre de victimes massacrés par le FPR au cours de cette même année s'élève probablement à plus de 30 000 (4c).
Ces victimes innombrables sont souvent restées anonymes, les corps ne pouvant être identifiées. Cette circonstance ajoute au traumatisme, les familles ne connaissant pas le sort exact de leur disparu, et ne pouvant donc pas accomplir leur deuil.
Face à l'horreur, il n'y a pas lieu, pour la commission, de distinguer les morts; il n'y a pas de bonne ou de mauvaise victime.
3.6.2.1. Définition de la notion de génocide
L'article II de la Convention sur la prévention et répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 dispose : « Le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
a) Meurtre de membres du groupe;
b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;
d) Mesures visant à entraver des naissances au sein du groupe;
e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. »
Il ressort de cette disposition trois éléments constitutifs du génocide qu'on peut schématiser ainsi :
1) un acte criminel;
2) « dans l'intention ... de détruire tout ou partie »;
3) un groupe donné et visé « comme tel ».
3.6.2.2. Reconnaissance du génocide au Rwanda
Les rapporteurs spéciaux successifs de l'ONU ont reconnu que la notion du génocide devait être appliqué au Rwanda.
Ils distinguent le génocide des Tutsis des massacres qui ont touché les Hutus.
Le rapporteur spécial de la commission des droits de l'homme de l'ONU, M. Degni Segui, dans son rapport du 28 juin 1994, explique pourquoi, dans le cas des événements du Rwanda, les trois éléments constitutifs du génocide sont remplis : « La première condition ne semble pas faire de doute eu égard aux massacres perpétrés et même aux traitements cruels, inhumains et dégradants. La seconde n'est pas davantage difficile à remplir, car l'intention claire et non équivoque se trouve bien contenue dans les appels incessants au meurtre lancés par les médias (en particulier le RTLM) et transcrits dans les tracts. Et si ce n'était le cas, l'intention aurait pu être déduite des faits eux-mêmes, à partir d'un faisceau d'indices concordants : préparation des massacres (distribution d'armes à feu et entraînement des miliciens), nombre de Tutsis tués, et résultat de la poursuite d'une politique de destruction des Tutsis. La troisième condition qui exige que le groupe ethnique soit visé comme tel pose en revanche problème en raison de ce que les Tutsis ne sont pas les seules victimes des massacres, les Hutus modérés n'étant pas épargnés. Mais le problème n'est qu'apparent, et ceci pour deux raisons : d'abord, nombre de témoignages révèlent que les tris opérés au cours des barrages pour la vérification des identités visent essentiellement les Tutsis. Ensuite et surtout, l'ennemi principal, assimilé au FPR, reste le Tutsi qui est l'invenzi, c'est-à-dire « le cafard » à écraser à tout prix. Le Hutu modéré n'est que le partisan de l'ennemi principal, et il n'est visé qu'en tant que traître à son groupe, auquel il ose s'opposer.
Il existe un document émanant de l'État-major de l'armée rwandaise et daté du 21 septembre 1992, qui distingue bien l'ennemi principal de son partisan et qui chargeait la hiérarchie militaire de « faire une large diffusion ». Selon les termes de ce document, le premier « est le Tutsi de l'intérieur ou de l'extérieur extrémiste et nostalgique du pouvoir, qui n'a jamais reconnu et ne reconnaît pas encore les réalités de la Révolution sociale de 1959, et qui veut conquérir le pouvoir au Rwanda par tous les moyens, y compris les armes ». Le second « est toute personne qui apporte tout concours à l'ennemi principal ». De plus, le partisan peut être rwandais ou étranger. Il existe un certain nombre de documents qui confirment cette distinction et qui attestent que les Hutus modérés ne sont massacrés qu'en tant qu'associés ou partisans des Tutsis.
Les conditions prescrites par la Convention de 1948 sont ainsi réunies et le Rwanda, y ayant accédé le 16 avril 1976, est tenu d'en respecter les principes qui se seraient imposés même en dehors de tout lien conventionnel, puisqu'ils ont acquis valeur coutumière. De l'avis du Rapporteur spécial, la qualification de génocide doit être d'ores et déjà retenue en ce qui concerne les Tutsis. Il en va différemment de l'assassinat des Hutus. » (5c)
Pour le professeur Prunier :
« Il faut voir ce génocide comme ethnique, mais ethnique parce que politique. Le Tutsi est un ennemi politique. On n'a pas tué les gens parce qu'ils étaient Tutsis; Ce n'est pas comme la haine du Juif (...) et tout l'antisémitisme que traîne la culture européenne depuis 20 siècles. Ce n'est pas cela. C'est un ennemi politique. Le Hutu qui se range du côté des Tutsis, ou s'il est perçu comme tel, devient le complice l'ibyitso et il ne vaut pas mieux qu'un Tutsi. Toute sa famille va aussi mourir. (...) Ce n'est donc pas un génocide ethnique, c'est un génocide politique ». (6c)
Quant au professeur Reyntjens, il déclare :
« La violence n'a pas été ethnique mais politique. Ce sont les opposants et les Tutsis qui ont été visés et assimilés à des complices du FPR. » (7c).
La commission se doit de rappeler que suite aux refus de plusieurs états membres, un groupe politique n'est pas protégé par la Convention de 1948 sur le génocide.
Parallèlement au génocide, le Rapporteur spécial a relevé également des assassinats politiques qui ne peuvent être qualifiés de génocide, étant donné que ce n'est pas un groupe ethnique défini comme tel qui est visé.
« Des membres du groupe ethnique Hutu, comme il a déjà été indiqué, sont également victimes de massacres. Mais une distinction s'impose à ce stade. D'une part, il y a les Hutus modérés, auxquels, par extension, on associe certains étrangers tels que les Belges, et qui comprennent essentiellement les opposants politiques et les militants des droits de l'homme. Il constituent la cible toute désignée pour des éléments des Forces armées gouvernementales et les miliciens. D'autre part, il y a les Hutus extrémistes, composés surtout de miliciens, qui seraient victimes, sur simple dénonciation, d'exécutions dans les zones contrôlées par le FPR.
Ces actes constituent des assassinats et plus spécifiquement des assassinats politiques qui portent atteinte au droit à la vie, qui est un droit fondamental contenu dans nombre d'instruments internationaux.
Faute de citer toutes ces conventions, on en retiendra deux, dont les dispositions pertinentes s'imposent à l'État rwandais, qui y a accédé. Ce sont, d'une part, le Pacte International relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, et d'autre part, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 28 juin 1981. Ces assassinats politiques constituent une violation flagrante des instruments précités. L'on doit préciser que le droit à la vie est un droit fondamental, qui existe « en dehors de tout lien conventionnel », et dont le respect s'impose en toutes circonstances » (8c).
(3) Les victimes Hutus modérés
En ce qui concerne les 30 000 victimes du FPR dont parle M. Prunier, la commission n'a pas obtenu d'informations complémentaires. Elle n'a pas obtenu de réponse sur les raisons qui ont empêché la publication du rapport Gersony dont le contenu permettrait peut-être d'obtenir ces informations.
On constate des séquences très nettes dans le déroulement du génocide, à partir de l'attentat contre l'avion présidentiel.
Premièrement, « presque immédiatement (c'est-à-dire le soir même) après le crash de l'avion commença un assassinat sélectif d'hommes politiques de l'opposition, dont la plupart étaient des Hutus appartenant à des partis opposés au parti au pouvoir. L'acte le plus apparent fut l'assassinat du Premier ministre, Agathe Uwilingiyimana, ainsi que de 10 soldats belges des Nations unies qui avaient été chargés de sa protection. Le président du tribunal constitutionnel et le ministre de l'Information constituaient d'autres cibles éminentes immédiates. La direction de chaque parti de l'opposition fut frappée de la même manière (African Rights, 1994).
Le second groupe-cible des assassinats, une fois que les dirigeants politiques eurent été tués, fut constitué par des civils dissidents, hutus comme tutsis. Ceux-ci comprenaient des journalistes, des activistes des droits de l'homme, des représentants d'organisations non gouvernementales et des fonctionnaires. African Rights répertorie à titre d'exemple, en citant leur nom et leur fonction, 27 journalistes dont l'assassinat avait été signalé immédiatement après le 6 avril.
Faisant suite à cette élimination de l'opposition, le massacre généralisé de Tutsis commença. Celui-ci est documenté par African Rights, 1994, préfecture par préfecture, avec des rapports particuliers traitant d'attaques menées contre des femmes et des enfants, des églises, des hôpitaux, etc. Le réalisme et l'horreur des récits des témoins interviewés ne connaissent pas de limite. Bien qu'un certain nombre de personnes aient tenté d'aider les victimes de massacres, la plupart de la population semble avoir participé aux massacres, que ce soit de son plein gré, sous la menace ou sous la contrainte.
Les premières cibles étaient les garçons et les hommes tutsis. Même les plus petits garçons ne furent pas épargnés. Les hommes et les femmes tutsis instruits étaient particulièrement exposés, et l'université fut « purifiée » (African Rights, 1994). Le viol était largement utilisé. Il y a de nombreux rapports de femmes qui avaient été à la fois torturées et violées, tandis que d'autres, qui avaient été blessées, avaient été également violées. Les enfants ne furent pas épargnés, et de nombreux enfants tutsis furent assassinés, d'autres mutilés, conservant des séquelles physiques et psychologiques pour le reste de leur vie.
Les assassinats furent exécutés avec une cruauté extraordinaire. Des personnes furent brûlées vivantes, d'autres jetées mortes ou vives dans les fosses septiques et souvent contraintes à tuer leurs amis ou parents. Les survivants furent pourchassés dans tout le pays, même dans les hôpitaux et les églises. Certains des pires massacres furent dirigés contre des personnes qui cherchaient refuge dans des églises » (9c).
En ce qui concerne le rôle des Églises, Madame Alison Desforges s'est exprimée en réponse à des interrogations de la Commission.
« Le Rwanda est un pays essentiellement catholique. Avant le génocide, l'Église avait aussi ses divisions ethniques avec plutôt des Hutus dans le haut de la hiérarchie et de nombreux Tutsi dans le bas clergé. L'archevêque de Kigali était proche du président Habyarimana et de son épouse à tel point que de nombreuses blagues circulaient sur les liens entre ces trois personnes. L'archevêque avait été membre d'ailleurs du Comité Central du MNRD jusqu'à ce que ses supérieurs dans l'Église, lui demandent de démissionner.
Avant le génocide, des prêtres et des évêques ont certes tenté de jouer un rôle de médiateur dans les conflits. Certains ont constitué des comités pour la non-violence. L'abbé Sibomana, rédacteur en chef d'un grand journal, a été un admirable défenseur des droits de l'Homme. Le rôle du nonce aspostolique a également été positif car il a soutenu les associations de défense des droits de l'Homme rwandaises et internationales avant le génocide.
Quand les tueries ont commencé, les églises catholique et protestante, n'ont pas joué le rôle moral attendu d'institutions qui s'érigent en conscience de l'humanité.
Des prêtres ont relayé les annonces des autorités. Ils ont organisé des réunions préliminaires aux tueries. Des religieux ont participé à des tueries mais, dans chaque cas, il est essentiel de recueillir des preuves avant de condamner.
Il n'en reste pas moins qu'en tant qu'institutions, les églises ont failli. Elles n'ont même pas parlé à voix haute alors qu'il aurait fallu crier. » (10c).
Le Père Theunis déclare lors de son audition :
« quand on parle de l'Église, il faut savoir de qui l'on parle. Est-ce que l'Église, c'est la hiérarchie, est-ce que l'Église, ce sont les chrétiens, est-ce que l'Église, ce sont les cadres, c'est-à-dire les prêtres, les religieux, les religieuses ? Souvent, quand on nous pose des questions, on confond ces différents niveaux et on ne sait pas exactement de quelle Église on parle.
La hiérarchie, je pense aussi qu'il ne faut jamais globaliser. Dans l'article que j'ai écrit sur l'Église rwandaise pendant et après les événements, j'ai bien noté qu'il y avait une division au sein de l'Église. Cette division était très ancienne dans l'Église, et cette division est encore actuelle, c'est-à-dire que, même dans la hiérarchie, il n'y a jamais sauf pour les choses fondamentales de points communs. Cela veut dire que, ce qui est écrit dans l'article, c'est que certains évêques étaient en fait trop inféodés au régime Habyarimana.
Moi-même, je n'ai jamais eu peur et j'ai eu des difficultés avec Mgr Vincent Ntsegiumva. (...) Ce qui veut dire qu'il avait lui, un lien d'amitié personnelle avec le président Habyarimana, qui était très ambigu pour son rôle d'archevêque de Kigali.
Et cela, je l'ai écrit : « il y a toujours eu collusion, et c'est un des défauts du mode d'évangélisation que nous avons eu au Rwanda; il y a plusieurs défauts dans le mode d'évangélisation au Rwanda, mais un des défauts a été la trop grande proximité de l'Église qui était une institution puissante, avec les instances politiques.
Il y avait d'autres évêques qui avaient aussi une proximité; pour eux je ne parlerais peut-être pas nécessairement d'inféodation. Mais il y a des évêques qui avaient toujours gardé leurs distances vis-à-vis du régime. » (11c).
Au sujet du rôle politique des Pères blancs, il poursuit :
« ... le mot « politique » lui-même, pour moi, est à entendre à deux niveaux très différents. Parce qu'il y a « la politique », et l'Église fait toujours de la politique, et il y a une autre politique « politicienne », une politique de partis, dans laquelle on nous demande, dans les textes officiels de l'Église, de ne pas entrer.
Puisque vous me parlez du rôle de l'Église, puisque le rôle de l'Église est pour moi essentiellement un rôle prophétique, un rôle de formation des hommes, de leur conscience, il est évident que nous avons un rôle de formation politique. Du moins je suis de ceux qui pensent et nous avons fait au Rwanda un certain nombre de brochures sur les questions politiques, sur le multipartisme, sur la démocratie, sur les élections, sur le rôle des partis politiques, etc...
Et cela fait partie aussi de notre mission. Nous sommes aussi au service des plus pauvres, des défavorisés, des rejetés, nous avons aussi un rôle de défense de ceux qui sont souvent rejetés par la société. Nous avons un rôle d'initiative : c'est l'Église qui, dans beaucoup de pays, a commencé l'éducation pour tout le monde, ou les soins de santé pour tout le monde, ou des services sociaux de tout genre pour tout le monde : l'humanitaire, les soins palliatifs, que sais-je...
Donc, nous avons un rôle, et je pense qu'en cela nous sommes fidèles à l'Évangile, de recherche de la vérité. L'Évangile nous dit que « Seule la vérité nous rendra libres ». Et si moi-même, j'ai choisi d'être professeur et puis d'être dans les médias, c'est parce que je pense que ce rôle de recherche de la vérité est essentiel à la société humaine, mais fait partie du rôle de l'Église premièrement, comme la recherche scientifique, philosophique, théologique, etc...
Que, de même, la recherche de la paix, de la justice, de la prévention des conflits sont du domaine essentiel aujourd'hui. Si d'ailleurs j'ai accepté de venir témoigner ici, c'est bien dans ce rôle-là, parce que le rôle de la Commission, il me semble, est un rôle de recherche de la vérité. Mais normalement, je pense, vous devez préparer des dossiers à remettre à la Justice, parce qu'il y a des Rwandais vivant en Belgique qui doivent être jugés par la Justice belge, et surtout qu'il y a un rôle majeur pour la prévention des conflits que ce soit en Afrique centrale ou ailleurs . Aujourd'hui, au Rwanda, nous sommes dans une situation très critique. Il n'est pas impossible que dans les jours prochains des choses se passent. Il est évident que le rôle d'une commission comme celle-ci soit de faire quelque chose, ou de pousser les partis politiques ou le gouvernement à faire quelque chose. Au Burundi pays dont on parle peu , il y a actuellement la guerre civile, qui peut dégénérer de plus en plus. On sait tout le drame des réfugiés au Zaïre. La démission qui a eu lieu au Rwanda a entraîné la démission vis-à-vis des réfugiés en Afrique centrale, au Zaïre. Donc nous avons des choses inadmissibles pour nous chrétiens ! » (12c).
Quant à M. Prunier, il écrit :
« Were there any bystanders ? The bystanders were mostly the churches. Although, as we will see, there were admirable acts of courage among ordinary Christians, the church hierarchies were at best useless and at worst accomplices in the genocide. And the first to be appalled by this attitude were those priests who had supported human rights as a modern incarnation of Christian values and who found themselves betrayed. As two of them declared to a French journalist :
« Why did not the Bishops react ? They made a few vague speeches but had no prophetic commitment. If they had spoken out, the massacres might have stopped. (...) Most of the priest who were killed were those who had defended human rights (...) Only two bishops (out of nine) spoke out clearly, those of Kibungo and Kabgayi. The Bishop of Rwankeri even dared to ask the Christians to support the (interim) government. » (13c).
As a baffled foreign observer remarked after visiting Kirambo parish near Cyangugu after the massacres had ended : « There was not the slightest trace of collective guilt among the Christian clergy. » (14c). Worse, the church placed itself in an advantageous moral position, simply because, like every other institution, social body or profession in Rwanda, it had paid heavily in the genocide (15c).
There were few cases of priests being killed trying to defend their charges. Foreign priests were spared, but Tutsi and liberal Hutu priests were killed like their counterparts in the general population and, despite some courageous exceptions, most of the Hutu priests looked the other way. This situation was of course the result of the many years of close association between the Hutu republic and the Catholic church. This attitude had political consequences, even abroad, since the Christian Democratic International took an ambiguous attitude towards the RFP and never got around to an open condemnation of the Hutu extremists. (16c).
As for the Protestant Churches, although their association with the regime did not have the historical depth of the Roman Catholics », their attitude was little better. But at least there was an admission of guilt at a higher hierarchical level. In the courageous words of the Revd Roger Bowen, « Anglican Church leaders were too closely aligned with the Habyarimana government. The Archbishop spoke openly in support of the President and his party. (...) The ethnic issue also ran deep within the churches and all the Anglican diocesan bishops were Hutu. » (17c).
The result of this violence is that there is now a « church in exile » in Nairobi whose bishops staunchly refuse to denounce the genocide (18c) and which is rejected by the Tutsi « returnees » from Uganda and Burundi now flocking to Rwanda.
In the Catholic Church, the extreme point of bad faith was reached by the twenty-nine priests who on 2 August 1994 wrote a collective letter to the Pope in which they denied any Hutu responsibility for the genocide and attributed it to the RFP, denouncing the idea of an international tribunal to investigate crimes against humanity and defending the FAR.
Although written about the Protestant Churches, the Revd Jorg Zimmerman's words could apply to all Christian denominations : « What I witnessed was a sort of collective psychological repression phenomenon. Rwanda has to be re-evangelised and quite differently if we do not want such carnages to come back regularly. But unfortunately, the minds are not ripe yet. » (19c).
3.6.4. La planification du génocide - Violation des droits de l'homme
Comme le relève le rapport du Joint Evaluation , les massacres ont été exécutés avec tant de minutie qu'il paraît difficile de conclure qu'ils n'ont pas été organisés à l'avance (20c).
Outre les éléments relevés par le rapporteur spécial de l'ONU, déjà cités, de nombreux indices laissent penser que les massacres ont été menés dans le cadre d'un plan préparé par des officiels de haut niveau, tant au niveau local que gouvernemental, à la présidence, dans l'armée, et au sein du MRND (21c).
Au-delà du cadre général, la commission a examiné trois points particuliers : la création de milices, la constitution de listes de personnes à tuer et l'achat de machettes.
3.6.4.1. Planification - Généralités
M. Lemarchand montre que l'appareil qui a supervisé le génocide était constitué depuis 1992 : « En 1992, l'appareil institutionnel du génocide était déjà en place. Il impliquait quatre niveaux distinctifs d'activité, ou jeux d'acteurs : a) l'akazu (petite maison), qui est le groupe-clé, consistant en l'entourage immédiat d'Habyarimana, c'est-à-dire sa femme (Agathe), ses trois beaux-frères (Protée Zigiranyirazo, Séraphin Rwabukumba et Elie Sagatwa), ainsi que quelques conseillers de confiance (dont notamment Joseph Nzirorera, Laurent Serubuga et Ildephonse Gashumba); b) les organisateurs ruraux, dont le nombre était d'au moins deux à trois cents, tirés des cadres communaux et préfectoraux (préfets, sous-préfets, conseillers communaux, etc.); c) la milice (Interahamwe), estimée à 30 000, constituant les opérateurs de base de l'exécution des massacres; et d) la garde présidentielle, recrutée presque exclusivement parmi les hommes du nord et entraînée dans l'optique de fournir un support auxiliaire aux escadrons de la mort civils dans les massacres » (22c).
De nombreux témoins ont exprimé devant la commission leur conviction que ces structures ont bien planifié le génocide.
Lors de son audition du 11 juin 1997, le professeur Prunier explique : « (...) L'organisation préalable ne fait aucun doute. De plus, quantité de faits ont été, depuis lors, portés à la connaissance des chercheurs. Moi-même, j'en ignorais certains concernant, notamment, les achats d'armes lors de la rédaction de mon livre.
Dans la culture occidentale, on considère que l'achat d'armes doit être réalisé chez un marchand d'armes; en effet, nous pensons tout de suite à des armes à feu. Or, une collègue journaliste a retrouvé, parmi les connaissements des douanes de Kigali, les bills of lading, c'est-à-dire les documents de transport relatifs à l'importation de machettes en provenance du Kenya. Elles avaient été commandées chez Chillington, une bonne vieille entreprise anglaise implantée dans ce pays depuis très longtemps et spécialisée dans les instruments agricoles. Ce document porte le nom fait révélateur de Félicien Kabuga. Il s'agit tout de même de 50 000 machettes, et si l'on considère qu'elles étaient destinées à l'usage personnel de M. Kabuga, de sa famille et de ses connaissances, cela représente tout de même une grande quantité... Je possède ce document, daté de mars 1994.
Voilà donc une preuve documentaire, simple, émanant des services des douanes, comme en souhaitent les tribunaux. Ce camion transportait aussi des produits chimiques agricoles et d'autres produits anodins. Sans cette suite dramatique, on aurait pu penser qu'il achetait ces 50 000 machettes pour « s'installer » dans le commerce. Cette journaliste a retrouvé ce document après bien des recherches, mais je suis sûr qu'en creusant, nous retrouverions encore des archives.
À présent, venons-en au déroulement. J'ai parlé à de nombreuses personnes qui soit ont survécu au génocide, soit ont été des acteurs de celui-ci. Dans les deux cas, aussi bien les acteurs que les victimes potentielles décrivent la manière dont les bourgmestres, les autorités communales sont venus rassembler les gens, allant parfois les chercher chez eux quand ils étaient réticents à mettre la main à la pâte, si j'ose m'exprimer ainsi, afin de les amener à tuer. Il s'agissait donc d'une organisation tout à fait officielle de l'administration locale. Le terme utilisé était le mot « umuganda », qui désignait les travaux agricoles collectifs, comme le défrichage, le désherbage, l'entretien des fossés ou des routes. Ce terme bien connu était même l'un des éléments dont se vantait le régime : une population bien disciplinée, qui accomplissait des travaux d'intérêt général, pour le bien collectif, sans pour autant être rémunérée. Même le vocabulaire utilisé relevait de l'umuganda : on parlait par exemple de désherber ... Pour dire « tuer les enfants », on disait « arracher les herbes jusqu'à la racine ». C'est là un élément qui revenait souvent : « Dans les années '50, '60, nous avons laissé partir les femmes et les enfants; il aurait fallu les tuer aussi, parce que maintenant, ces enfants se retrouvent dans le FPR », ce qui, d'un point de vue strictement militaire, est tout à fait exact. Nous avions donc une administration qui remplissait une tâche. Il y a là d'ailleurs une sorte de mystère psychologique et social : beaucoup de paysans ont tué, froidement, leurs voisins, sans vraiment leur en vouloir » (23c).
« Je crois que le génocide n'est donc absolument pas une affaire spontanée. C'est un programme gouvernemental qui a été appliqué, de manière extrêmement maladroite, selon moi. Envisager de tuer trois quarts de millions d'êtres humains et de garder le pouvoir par la suite n'est peut-être possible que quand on est empereur de Chine, parce que l'on a alors la capacité de signer de très gros contrats, avec la maison Airbus ou avec d'autres, mais quand il s'agit d'un petit pays comme le Rwanda, on est obligé d'être relativement moral, car on n'a pas de gros contrats à signer. On n'oublie les crimes que s'ils rapportent. Le Rwanda n'avait rien à offrir pour faire oublier ses crimes. Les gens du noyau dur autour d'Habyarimana, qui ont cru pouvoir s'en tirer dans cette affaire, étaient donc de grands naïfs, des personnes qui, politiquement, n'étaient certainement pas conscientes de ce qu'elles étaient en train de faire et du contexte mondial au sein duquel elles opéraient » (24c).
« (...) le noyau de personnes qui a prévu et organisé est doublement responsable, responsable avant tout de la mort des victimes, mais aussi d'avoir transformé leurs concitoyens en criminels. Si tous ces paysans ont obéi bêtement aux ordres qui leur ont été donnés, c'est parce qu'ils jugeaient que ces messieurs bien éduqués dans les universités des Blancs, qui parlaient si bien, qui savaient lire et écrire et fréquentaient les conférences du FMI, avaient une bonne raison de leur dire de tuer, que cela devait être pour le bien de la patrie. Ces gens sont doublement responsables.
(...) Ce que je puis dire, c'est que les gens qui ont préparé le génocide étaient peu nombreux » (25c).
Lors de son audition du 17 juin 1997, M. Degni-Segui, ancien rapporteur spécial sur le Rwanda et auteur des rapports qui ont suivi le génocide, a résumé ses recherches concernant la planification du génocide de la manière suivante : « Mon rapport préliminaire indiquait un faisceau d'indices concordants quant à une planification. Ces indices sont au nombre de quatre :
l'incitation à la haine ethnique par la Radio Télévision Mille Collines;
la distribution d'armes en provenance de dépôts; en outre, les miliciens Interahamwe étaient entraînés;
la célérité exceptionnelle avec laquelle les événements se sont produits; le gouvernement intérimaire a été constitué et les barricades dressées en l'espace selon les informations que j'ai reçues de 30 à 45 minutes;
enfin, des listes de personnes qui devaient être arrêtées circulaient.
Il convenait d'effectuer des vérifications à propos de l'ensemble de ces indices.
Les investigations faites par les observateurs déployés sur le terrain et par les observateurs du Tribunal pénal international ont abouti à la découverte de fosses communes, de documents, de cassettes audio de Radio Mille Collines incitant à la haine. La traduction de ces enregistrements montrent une distinction entre les émissions diffusées en français et les émissions diffusées en kinyarwandais, ces dernières amenant à se prononcer sur l'assassinat. Des documents officiels portant trace d'une liste de personnes à assassiner et signalant des Tutsis comme étant des personnes à abattre ont également été découverts et transmis au Tribunal pénal international. La responsabilité individuelle des auteurs du génocide relève du tribunal et il ne m'appartient pas de divulguer quoi que ce soit à cet égard.
Je citerai cependant, comme je l'ai fait dans le cadre de mon rapport préliminaire, la garde présidentielle, les militaires, d'une manière générale, et les préfets et bourgmestres qui ont exécuté les décisions.
Le gouvernement intérimaire a joué un rôle important au niveau des ordres qui ont été donnés. En effet, il ressort de plusieurs témoignages que les ordres provenaient d'un échelon supérieur. Je vous donnerai deux exemples à cet égard. Le premier concerne les préfets; nous y reviendrons tout à l'heure.
L'une des causes du génocide était l'impunité. Par ailleurs, des préfets qui avaient accompli leur travail, c'est-à-dire empêché des massacres, ont été démis. C'était le cas du préfet de Gitarama et de celui de Butare qui ont empêché les Interahamwe d'entrer dans la ville et de piller les maisons. Le deuxième exemple, tout aussi célèbre, concerne le président du gouvernement intérimaire qui était originaire de Butare. Vous devez connaître son fameux discours du 19 avril 1994, dans lequel il incite les Rwandais à aller « travailler », dans le sens que l'on connaît » (19c).
Par ailleurs, Mme Des Forges a fourni à la commission, lors de son audition du 26 février 1997, l'analyse suivante : « Dès le début du conflit en octobre 1990, M. Habyarimana, président du Rwanda, et la cellule qui l'entourait, ont décidé d'attiser les conflits ethniques pour conforter leur position avec l'aide de la population hutue et pour régler d'autres conflits liés à la présence au pouvoir de M. Habyarimana depuis vingt ans. Les critiques contre son régime ne cessant de croître, le président rwandais décida d'attaquer les Tutsis pour consolider sa position grâce aux Hutus. Les autorités décidèrent de lancer des massacres de Tutsis, le 11 octobre au nord-est du pays en janvier 1991, au nord-ouest en mars 1992 et durant d'autres mois de la même année pour, fin 1992 et début 1993, revenir au nord-ouest. Ces massacres ont plusieurs caractéristiques répétitives. Ainsi, le rôle des autorités locales fut toujours d'intoxiquer les populations par une propagande adéquate afin de faire monter la peur juste contre un camp militaire et de fausses annonces radio selon lesquelles les Tutsis se préparaient à attaquer les Hutus. De plus, chaque fois, une série de prétextes furent invoqués et cela dès octobre 1990, avec des accusations selon lesquelles les Tutsis avaient des caches d'armes, communiquaient avec le FPR par radio, nouaient des contacts avec les étrangers et tenaient des réunions secrètes. Après chaque massacre, des excuses officielles étaient présentées. On assurait que les attaques n'étaient jamais que le résultat d'une colère spontanée et que les autorités locales avaient été débordées. En résumé, le génocide était le fait d'un peuple littéralement terrorisé qui ne faisait que se défendre. (...)
Ensuite, des incidents ethniques ont éclaté. D'abord, il y a eu la formation de milices du MRND, le parti d'Habyarimana, et du CDR, son proche allié. Ces milices ont bénéficié d'une formation militaire dirigée par des soldats rwandais, probablement des membres de la garde présidentielle. Des milices d'autres partis existaient également mais elles n'étaient ni formées ni armées. Au cours de l'été 1992, certaines autorités rwandaises se sont inquiétées de l'influence accrue des milices. Une enquête a, par exemple, été demandée par un procureur sur les cordelettes détenues par certaines milices et qui n'étaient alors utilisées que par les gardes présidentiels. En 1992 et 1993, des armes ont été distribuées à des civils. En octobre 1992, le gouvernement rwandais a acheté 20 000 fusils. Or, l'armée rwandaise était alors composée de 30 000 hommes. En fait, on a donné les nouvelles armes aux soldats et les plus anciennes ont été distribuées aux agents communaux et aux civils. À la même date, 20 000 grenades à main ont été achetées par le Rwanda. Ce type de grenade ne nécessite qu'un apprentissage de vingt minutes, à la différence de lance-grenades achetés plus tôt dans l'année, pour lesquels une formation plus importante est nécessaire. Lors du génocide, on a beaucoup parlé d'assassinats perpétrés avec des machettes. C'est exact, mais les armes à feu ont également joué un rôle important. Elles ont été très utiles pour faire peur et essentielles pour briser les résistances. En début 1993, lorsque les armes ont été distribuées, un gouvernement de coalition était au pouvoir. Le premier ministre a alors demandé que les armes soient retirées des populations civiles. Il a aussi demandé que cesse l'établissement par certaines autorités civiles et militaires de listes de gens partis à l'étranger, supposés membres du FPR et d'ennemis. (...)
Entre le mois d'août et la fin de l'année 1993, les Interahamwe achetèrent un grand nombre de machettes à Kigali. Un homme d'affaires et financier important de RTLM en fit même importer 25 tonnes de l'extérieur; Il est donc clair qu'il existait déjà à ce moment un projet de recommencer la guerre en prenant les civils pour cibles. Un événement capital fut l'assassinat par des militaires tutsis du président du Burundi, appartenant à l'ethnie hutue, et qui fut suivi par des tueries de civils, sans que la communauté internationale ne réagisse. Je suis convaincue que les coupables ont trouvé dans la passivité de la communauté internationale un encouragement à croire que la tuerie de civils était une stratégie tolérée pour raffermir leur pouvoir politique. (...)
Le 3 décembre 1993, des militaires haut gradés envoyèrent anonymement une lettre au général Dallaire pour l'avertir qu'Habyarimana et certains militaires importants se préparaient à commettre des violences ethniques et des assassinats d'opposants politiques pour faire recommencer la guerre. (...) Ce premier avertissement fut suivi par d'autres dont un télégramme envoyé en janvier où il était clairement fait état des préparatifs en cours. Des indications sont également venues d'autres sources. J'ai fait une compilation des risques avertisseurs entre novembre et mars : elle comprend une vingtaine de pages. La distribution des armes ne se faisait pas en cachette. Des diplomates en place à Kigali m'ont dit qu'ils en avaient discuté à haute voix entre eux. Ils savaient aussi qu'il y avait recrutement et formation de milices » (26c).
Mme Desforges a également analysé le lien entre le processus de démocratisation entamé après 1990 et les préparatifs des massacres : « Il existe un lien fort important entre le développement du processus de paix et celui de la violence et des préparatifs des massacres. Chez le président Habyarimana et ses proches, deux éléments ont été prépondérants : le FPR et l'opposition domestique interne. Leur souci essentiel était d'éviter l'union des deux. Dès janvier 1991, le danger de collaboration entre les Hutus de l'opposition et le FPR était bien identifié et cette crainte réalisée. Le processus de démocratisation a paru susceptible d'encourager une invasion militaire. Un amalgame fut volontairement créé entre le FPR, les Hutus rebelles et les Tutsis qui reçurent, tous les trois, le label d'« ennemis ». Cette conception prévalut au sein de l'état-major de l'armée rwandaise dès septembre 1992. Parmi les stratégies ennemies, on cite les efforts pour détourner l'opinion publique des questions socio-économiques au profit des questions ethniques; Les aspirations naturelles et bien fondées de la population à la démocratie étant ainsi placées au second plan. De ce fait, les efforts pour combattre la croissance de l'opposition interne démocratique et du FPR engendrèrent des massacres chaque fois que le pouvoir se sentit menacé » (27c).
Lors de son audition du 26 février, le professeur Reyntjens soulignait lui aussi les conséquences du coup d'État du Burundi et de l'assassinat du président burundais : « Ensuite, interviennent le coup d'État du Burundi et l'assassinat du président burundais, ce qui a pour conséquence que les Hutus et notamment les Hutus qualifiés de modérés affirment qu'on ne peut pas faire confiance au FPR, et, par extension aux Tutsis eux-mêmes, entrant ainsi dans une logique génocidaire. » (28c)
Le professeur Reyntjens déclare également : « Ce génocide n'est pas un accident de l'histoire, il a été tout à fait organisé. On peut montrer, qu'étape par étape, une structure génocidaire s'est mise en place et qu'il y a eu une évolution progressive de la logique génocidaire.
Le meurtre du président du Burundi n'est qu'un des éléments qui ont permis d'amplifier cette structure. Au-delà du noyau central et des cercles locaux, il existe un troisième cercle, celui des civils co-auteurs et complices du génocide. C'est en amplifiant le meurtre du président et en convainquant la population de ce que, si elle ne tue pas les Tutsis, c'est eux qui vont les exterminer, qu'on développe l'idéologie et la structure nécessaire à la mise en marche du génocide » (29c).
La commission constate cependant que l'attentat contre le président Habyarimana a été l'élément déclenchant qui a transformé ces préparatifs en réalité. La machine génocidaire s'est alors mise en marche et de nombreuses personnes s'y sont assocciées.
Monsieur Prunier a expliqué le processus de création des Interahamwe : « En ce qui concerne les Interahamwe, il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'une milice politique et non militaire tout simplement parce que la majorité d'entre eux n'avaient aucun entraînement militaire. Cette milice a été créée longtemps avant le génocide. Je ne crois pas qu'elle avait au départ vraiment pour but d'exécuter le génocide qui n'était même pas encore conçu à l'époque, me semble-t-il. Certaines personnes aimeraient bien que l'on oublie le rôle qu'elles ont joué dans la formation de ces milices. L'actuel ministre des Affaires étrangères de la République du Rwanda, M. Anastase Gasana, est un membre fondateur des Interahamwe et il est pourtant membre du gouvernement actuel ! C'est d'ailleurs une des manières par lesquelles le gouvernement le tient. Cela, on ne le dit jamais.
Ces milices étaient vues au départ comme une sorte de groupe d'activistes loyalistes. À cet égard, je ferais un parallèle avec les milices de l'Ulster Defence Force, les Orange men, de l'Irlande du Nord, c'est-à-dire une milice politique au service d'une idéologie avec, en arrière-plan, le désir de s'en servir dans une guerre civile urbaine, mais non dans ses opérations militaires sérieuses en rase compagne contre une armée. Quelques cadres ont été entraînés militairement dans les camps de l'armée, y compris par l'armée française. C'est sur ce fait que s'appuient ceux qui disent que les Français ont collaboré au génocide. Il ne fait aucun doute que certains cadres des Interahamwe ont été entraînés par les Français. Pourquoi? C'est assez simple à comprendre. Les Français avaient un programme de formation des officiers et sous-officiers des Forces armées rwandaises. Celles-ci comportaient 5 200 hommes en octobre 1990 et, au printemps 1994, elles en avaient près de 50 000. Sa taille avait décuplé. Vous imaginez ce que cela représente au point de vue logistique, de la formation et aussi des dépenses, ce qui a d'ailleurs entraîné des catastrophes budgétaires au Rwanda à l'époque et une inflation galopante ! Ce décuplement de l'armée a été largement assuré avec le concours français. Les Français ne se sont jamais battus directement en première ligne en tout cas au niveau de l'infanterie mais leur grosse coopération militaire était à ce niveau-là, c'est-à-dire la formation qui a permis de décupler l'armée rwandaise en l'espace d'un peu plus de deux ans. Quand les Interahamwe ont été créés, les Rwandais ont habilement « fourgué » il n'y a pas d'autres termes des Interahamwe comme sous-officiers en formation. Les Français les ont donc formés en croyant qu'ils allaient rejoindre l'armée régulière. En fait, lorsqu'ils sortaient de la période de formation, ils retournaient aux Interahamwe (30c). »
L'ancien premier ministre Nsengiyaremye confirme le point de vue du professeur Prunier : « ... il y a eu constitution de milices. Au début il s'agissait de mouvements de jeunesse des partis chargés d'animer des meetings politiques mais par la suite ils se sont transformés en forces de combat. Le processus s'est poursuivi avec le et l'armement et la situation s'est sérieusement aggravée à partir de septembre 1992 jusqu'à la fin. Quand on constitue une milice, c'est qu'elle devra un jour ou l'autre servir à quelque chose ! La présence de milices était donc un élément de préparation, un pion en cas de guerre civile. » (31c). »
Quant à l'importance numérique de ces milices, Mme Desforges juge qu'« il est difficile de préciser le nombre de personnes impliquées dans les milices qui furent d'abord créées par chaque parti pour lutter contre les autres. On a parlé de 1 200 à 1 300 Interahamwe, mais le général Dallaire pensait qu'ils étaient au moins 3 000 à Kigali. Le premier ministre a même affirmé, ce qui me semble excessif, qu'il y en avait dans chaque commune. Ceci serait donner trop d'importance au parti au pouvoir et minimiser le rôle joué par les autres (32c). »
3.6.4.3. Constitution de listes de personnes à tuer
Le professeur Prunier a expliqué très clairement le phénomène de la constitution de listes de personnes à tuer : « Le problème des listes était une question d'urgence parce que ces personnes ne savaient pas quand on allait les interrompre. Ils craignaient d'être interrompus dans leur tâche. Il y avait des ordres de priorité et les listes étaient très courtes. J'estime le génocide à 800 000 morts, avec une marge d'erreur très importante de l'ordre de 10 à 15 %. Il n'y avait pas 800 000 personnes sur des listes. Tout le monde n'avait pas le même ordre de priorité dans la mort. Certaines personnes devaient mourir tout de suite et à tout prix. Les personnes qui ont été tuées les 7, 8, 9, 10 et 11 avril devaient mourir parce qu'elles étaient importantes. Il y avait là un certain nombre de Tutsis mais aussi beaucoup de Hutus de l'opposition. Au départ, on a presque tué moitié, moitié. Mme Agathe a été tuée et son mari aussi, parce qu'il avait le malheur d'être le mari de sa femme ! Il était hutu et pas politisé. M. Landucas Ndasingwa était le secrétaire général du président du parti libéral et avait une femme canadienne blanche qui a aussi été tuée, ainsi que leurs enfants. Ils étaient sur la liste d'urgence parce que si on arrêtait les auteurs des tueries le troisième jour, il fallait au moins que ceux-là soient morts. Par exemple, l'ancien Premier ministre M. Twagiramungu leur a échappé en sautant par-dessus la clôture et en passant par les jardins. Il était évidemment sur la liste. Tous les leaders du parti social démocrate s'y trouvaient.
Personnellement, je suis membre du parti socialiste français et de son secrétariat international. J'avais des liens particuliers avec les membres du parti social démocrate. Sauf un, tous sont morts. Les gens du MDR, pas la tendance Mugenzi parce que c'était le MDR Power, mais la tendance Twagiramungu, étaient sur les listes. Il s'agissait d'une liste d'urgence. Ces personnes devaient mourir même si le génocide était interrompu le quatrième ou le cinquième jour. C'est pourquoi il y a eu cette affaire où vos soldats sont morts. Mme Agathe était sur la liste des priorités. Et ce n'était pas la dominante tutsie, mais la dominante politique, bien sûr, les Tutsis du FPR. Ils ont donc attaqué les bâtiments de l'Assemblée nationale où le bataillon du FPR était cantonné. Après cela, on a continué dans l'euphorie générale (33c). »
Concernant l'achat de machettes, M. Prunier informe la commission d'enquête des constatations suivantes : « La personne qui a acheté ces machettes n'est pas n'importe qui. Il s'agit de M. Félicien Kabuga, un des hommes-clés des milices Interahamwe. Il n'avait absolument aucun usage de ces machettes. Il pouvait simplement les distribuer à ses miliciens. La machette est un instrument agricole. De nombreuses personnes ont été tuées par des tas d'autres instruments, notamment avec des bâtons cloutés, car tout le monde ne disposait pas de machettes. Il suffisait d'enfoncer de très gros clous de charpenterie avec une pierre; on obtenait une sorte de massue primitive dont les clous frappaient violemment la boîte crânienne. Des houes ont également été utilisées pour tuer. Il s'agit aussi d'instruments agricoles dont le fer suffit à faire éclater une boîte crânienne. De nombreux crânes de victimes présentent d'ailleurs un éclatement au sommet. Les machettes ne sont jamais achetées en si grande quantité, tout simplement parce qu'il ne convient pas d'immobiliser un stock trop important. On n'achète pas 50 000 machettes en une seule fois, car il faudrait trop de temps pour les revendre. En fait, elles étaient achetées pour être distribuées. Vous me demandez s'il ne s'agissait pas d'un simple achat de matériel agricole. La réponse est non. Tout d'abord, l'acheteur n'était pas un agriculteur et, ensuite, la quantité était trop importante. Un marchand aurait pu effectuer un achat raisonnable de 500 ou 1 000 machettes, mais il aurait tout de même mis un certain temps à les revendre. Le nombre de 50 000 est complètement fou. Même en dix ans, ces machettes n'auraient pu être vendues » (34c). »
« Ces 50 000 machettes venaient du Kenya » (35c). »
Mme A. Desforges apporte d'autres précisions : « Les armes à feu ont été achetées par le ministère de la Défense, les machettes par une entreprise privée gérée par un ami proche d'Habyarimana. L'argent pour les armes à feu provenait de sources officielles. (À noter que 25 tonnes de machettes correspondent plus ou moins à 25 000 machettes). L'aide civile importante dont bénéficiait le Rwanda a contribué au déclenchement du génocide, dans la mesure où cette aide a permis d'acheter des machettes. Mais il faut également tenir compte d'emprunts faits par le Rwanda pour l'achat d'armes. Un important crédit en dollars a ainsi été accordé par le Crédit Lyonnais avec pour garantie, la production de thé pendant une période de cinq ans (36c). »
La commission n'est pas en mesure d'apprécier le lien entre ces achats et la préparation du génocide.
3.6.4.5. Autres éléments révélateurs de la planification du génocide
Lors de son exposé introductif à son audition pour la commission, Mme Suhrke, rédacteur du rapport 2 du « Joint Evaluation » , a déclaré : « Pouvait-on prévoir le génocide ? » Elle répond : « Personne n'a pu imaginer la rapidité et l'importance du génocide tel qu'il s'est développé. Les décideurs internationaux n'ont pas pu tirer les conclusions. Disposaient-ils des informations pour ce faire ?
Beaucoup savaient à l'époque que des forces organisées existaient. Il y avait eu des actes de violence et l'appareil de l'État était impliqué dans une propagande extrémiste. Elle visait l'élimination des Tutsis. Début 1994, la MINUAR envoyait un télégramme à l'ONU dans lequel il était fait mention des projets de tuer des Belges faisant partie des troupes de l'ONU. Le plan est détaillé dans le télégramme.
Toutefois, cette information n'a pas conduit à la conclusion qu'un génocide pourrait avoir lieu. Les tueries auraient dû être envisagées comme scénario. En outre, la CIA, en 1994, avait émis un rapport qui analysait les accords d'Arusha. Ce rapport concluait qu'on allait vers un échec. Il estimait que des violences massives allaient éclater et qu'elles conduiraient à l'assassinat d'un demi million d'hommes. D'autres observateurs ont certifié que la violence ethnique était probable si la guerre civile éclatait. Les raisons pour lesquelles les signaux n'ont pas été perçus sont dus notamment à une déficience structurelle dans le système de l'ONU.
On a identifié plusieurs signaux donnant les renseignements différents. Qui fallait-il écouter? La France était la mieux informée au Rwanda sur les extrémistes Hutus mais elle s'attachait principalement aux renseignements sur le FPR qu'elle considérait comme un adversaire.
Comme ce rapport de l'ONU ne faisait référence qu'à deux ou trois cents personnes, il n'a pas été pris au sérieux.
Il contenait des voeux pieux. Si le génocide semblait planifié, il préconisait une intervention internationale plus importante. Or, quand le génocide a eu lieu, la seule réaction de la Communauté internationale a été de se retirer. Il faut dire que le Rwanda, aux yeux des membres du Conseil de sécurité, avait peu de signification stratégique.
La mauvaise interprétation des signaux annonçant le génocide montre qu'il y avait aussi un problème dans l'efficience de la collecte de renseignements et dans l'analyse politique à l'ONU. En janvier 1994, le Secrétariat général avait des informations claires sur la préparation du génocide. Ces informations n'étaient pas isolées, elles circulaient dans tous les départements de l'ONU.
Les ambassades des États-Unis, de la France et de la Belgique à Kigali en disposaient aussi. Pourtant, aucun plan supplémentaire n'a été élaboré pour tenir compte du risque de détérioration de la situation. Il n'y a pas eu de changement dans les règles d'engagement de la MINUAR.
Les États aussi ont été incapables de collecter et d'utiliser les renseignements (37c). »
Parmi les « signaux » évoqués par Mme Suhrke, citons, outre les éléments relevés dans le rapport du groupe ad hoc :
a) Un document, révélant l'existence du « réseau zéro », rendu public pendant l'été 1992. Il s'agit du document « Le Réseau Zéro - lettre ouverte à Monsieur le Président du Mouvement Républicain National pour la Démocratie et le Développement (MRND) ». Ce document a très largement circulé dans les milieux diplomatiques de Kigali. L'auteur y expliquait ses raisons de démissionner du MRND. Dans sa lettre, il expliquait que notamment : « D'autre part, le « leadership » du MRND n'a précisément pas changé. Les quelques structures et hommes nouveaux ont été ankylosés, puis phagocytés par les vieux /gourous/ du MRND ancienne formule. Ceux-ci ont, depuis plusieurs années, déjà, formé ce que j'appelle « LE RESEAU ZERO », un noyau de gens qui a investi méthodiquement toute la vie nationale : politique, militaire, financière, agricole, scientifique, estudiantine, familiale et même religieuse. Ce noyau considère le pays comme une entreprise dont il est légitime de tirer le maximum de profit, ceci justifiant toutes sortes de politiques. Le « Réseau Zéro » se présente comme le champion de la défense du Chef de l'État actuel et chef du parti MRND, quitte à le réduire au niveau étroit de chef de plan. C'est que ce noyau s'est constitué à base de relations personnelles, multiformes, organisées par des hommes omniprésents et, ma foi, fort habiles. (...) C'est le /Réseau Zéro/ qui a attisé les clivages ethniques et régionaux pour couvrir ses visées et ses intérêts. Le « Réseau Zéro » est d'autant plus puissant qu'il occulte et qu'il dispose de moyens considérables financiers et d'autres ... innommables (38c) ».
Ce document a été publié de manière bilingue en français et en Kinyarwanda.
b) Janvier Afrika, directeur du journal Unurava, publie dans le numéro 10 du 28 août un article qui décrit dans le détail la façon de procéder de ce réseau. Afrika affirme lui-même avoir fait partie de ce réseau et avoir participé à des actions violentes. Il cite une liste de plus de 25 noms dont le président Habyarimana lui-même ainsi que ses trois beaux-frères et son gendre; Afrika est aussitôt arrêté (39c).
c) La dénonciation publique des escadrons de la mort.
En septembre 1992, le professeur Reyntjens et le sénateur Kuypers dénonçaient publiquement l'existence d'escadrons de la mort et le Réseau Zéro (40c). Les auteurs de ces dénonciations disposaient : « qu'un groupe de personnes met tout en oeuvre afin de faire échouer le procès de démocratisation. Il s'agit en l'espèce d'escadrons de la mort, qui sont organisés par une quinzaine de personnes, qui ont des fonctions importantes et qui se trouvent à proximité immédiate du Président. (...) Plusieurs personnes au Rwanda connaissent ce groupe qui opère actuellement sous le nom « réseau zéro ». Cependant, ce groupe dispose d'un tel pouvoir et est tellement dangereux, que personne n'ose en parler et que les enquêtes judiciaires sont vouées à l'échec. (...) (41c). »
Ce Réseau Zéro avait pour objectif de « discréditer le changement en cours ». Il était composé notamment de trois beaux-frères du Président Habyarimana (Protée Zigiranyirazo, Séraphin Rwabukumba, colonel Elie Sagatwa) ainsi que du colonel Bagosora.
Dans une note complémentaire intitulée « Les escadrons de la mort », le professeur Reyntjens écrivait : « (...) la technique la plus inquiétante consiste en des tentatives de causer des affrontements meurtriers. Nous possédons des témoignages très précis de ces déstabilisations au Bugesera et à Kibuye. Au Bugesera, les affrontements ont fait plusieurs centaines de morts, beaucoup plus de blessés et des milliers de déplacés. (...) Les activités de ce groupe ont un triple effet : - sabotage du processus de démocratisation, qui ne peut se dérouler correctement dans un contexte de déstabilisation; (...) (42c). »
Dans une lettre adressée au président Habyarimana le 2 octobre 1993, le sénateur Kuypers répétait ces accusations « sur le risque de déstabilisation continue au Rwanda et sur les entraves au processus de paix, suite aux manoeuvres et aux actes criminels de ce groupe (43c). »
d) Il faut encore signaler le discours de Léon Mugesera du 22 novembre 1992, à Kabaya en préfecture de Gisenvi.
Ce discours, émanant d'un haut responsable du MRND, est un véritable appel aux meurtres des Tutsis comprenant des phrases comme : « Sachez que celui à qui vous n'avez pas encore tranché la tête, c'est lui qui tranchera la vôtre » ou encore à propos des Tutsis : « Je vous apprends que votre pays c'est l'Éthiopie et nous allons vous expédier sous peu via Yangorabo (une rivière) en voyage express. » Ou encore dans les extraits : « Pourquoi n'arrête-t-on pas ses parents (des enfants qui auraient rejoint le FPR) pour les exterminer ? », « Pourquoi n'extermine-t-on pas tous ces gens qui convoient les jeunes au front ? Dites-moi vraiment, attendez-vous béatement qu'on vienne vous massacrer ? »
e) Le rapport de la FIDH (Fédération internationale des Ligues des Droits de l'Homme)
Pour la première fois, la question du génocide est évoquée dans un document public connaissant une large diffusion.
Dans ses conclusions, le rapport de la FIDH de février 1993 (44c) mentionnait entre autres : « (...) Après avoir recueilli des centaines de témoignages et entrepris des fouilles des fosses communes, la commission a conclu sans aucun doute que le gouvernement rwandais a massacré et fait massacrer un nombre considérable de ses propres citoyens. La plupart des victimes étaient des Tutsis, mais le nombre de victimes hutus, presque tous adhérants des partis du comité de concertation, monte depuis les derniers mois. Au total, on estime que le nombre de victimes se chiffre à au moins 2 000 depuis le 1er octobre 1990. De plus, les attaques organisées par le gouvernement ont blessé des milliers de personnes et les ont dépourvus de leurs raisons, animaux domestiques et de la presque totalité de leurs biens.
D'après le témoignage des agresseurs aussi bien que celui des victimes, les autorités étaient impliquées dans les attaques : des bourgmestres, des sous-préfets, des préfets, des membres de comité de cellules, des responsables de cellules, des conseillers, des policiers communaux, des cadres de services administratifs et judiciaires, des gardes forestiers, des enseignants, des directeurs de centres scolaires et des cadres de projets de coopération.
La complicité de ces autorités fut trop importante et trop générale pour supposer que leur participation ait été le résultat de décisions individuelles et spontanées. (...)
Dans chaque commune, les troubles épousent en général des frontières administratives, conséquence naturelle de la participation ou non-participation des autorités. La simultanéité des attaques dans les communes différentes établit l'existence d'une organisation plus étendue. De la même façon, les prétextes pour les attaques se répètent de l'une à l'autre : nécessité de débroussailler une région, travail à faire pour la communauté (umuganda), l'arrivée d'un inconnu avec un sac à la main, la présence d'un recruteur des Inkotanyi (45c). »
Dans ses conclusions, la FIDH abordait directement la question du génocide : « Les témoignages prouvent que l'on a tué un grand nombre de personnes pour la seule raison qu'elles étaient tutsis. La question reste de savoir si la désignation du groupe ethnique « Tutsi » comme cible à détruire relève d'une véritable intention, au sens de la Convention, de détruire ce groupe ou une part de celui-ci « comme tel ».
Certains juristes estiment que le nombre de tués est un élément d'importance pour que l'on puisse parler de génocide. Les chiffres que nous avons cités, certes considérables pour le Rwanda, pourraient, aux yeux de ces juristes, rester en deçà du seuil juridique requis.
La commission estime que, quoi qu'il en soit des qualifications juridiques, la réalité est tragiquement identique : de nombreux Tutsis, pour la seule raison qu'ils appartiennent à ce groupe, sont morts, disparus ou gravement blessé et mutilés; ont été privés de leurs biens; ont dû fuir leur lieu de vie et sont contraints de se cacher; les survivants vivent dans la terreur.
On constate certes une extension des agressions aux Hutus opposants du MRND ou de la CDR. Cette extension peut compliquer mais pas modifier la nature fondamentale du débat (46c). »
Par ailleurs, dans le chapitre consacré aux violations des droits de l'homme par les forces armées, la FIDH concluait : « (...) Ces exactions ont toutefois pu se développer et prendre un caractère structurel, non seulement par l'impunité dont elles ont bénéficié, mais également du fait que les exactions les plus graves sont manifestement le résultat d'initiatives organisées au plus haut niveau de l'état-major militaire. Si l'armée se comporte de manière arbitraire et indisciplinée vis-à-vis des populations, l'on observe que la hiérarchie est en revanche bien structurée et que l'autorité y est forte. La redoutable efficacité de l'armée dans un certain nombre de mises en scènes, de coups montés, d'exécutions massives (voir notamment à ce sujet le cas du massacre des Bagogwe) permet de conclure que cette autorité est utilisée pour de telles organisations d'exactions. En revanche, c'est à dessein que cette autorité ne se manifeste pas dans d'autres cas, où les militaires sont laissés à eux-mêmes et sont certains de rester impunis. (...) (47c) »
Le rapport reprenait ensuite les extraits les plus significatifs de la FIDH visant à définir l'ennemi cité plus haut (48c).
Dans ses conclusions finales et recommandations, la FIDH écrivait : « (...) Pour ce qui concerne l'État rwandais toutefois, la commission d'enquête internationale est arrivée à la conclusion que la violation des droits de l'homme a été commise de manière massive et systématique avec l'intention délibérée de s'en prendre à une ethnie déterminée de même qu'aux opposants politiques de manière générale (49c). »
La FIDH faisait trois recommandations au président de la République, M. Habyarimana, qui n'en a suivi aucune, en particulier la troisième « en sa qualité de président du MRND, le président de la République devrait dissoudre immédiatement la milice armée du MRND, appelée Interahamwe » (50c).
Ce rapport a fait l'objet d'un débat dans la Chambre des représentants belge le 10 février 1993.
f) Rapport du rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, M. Ndiayé : Mission Rwanda du 8 au 17 avril 1993. Ce rapport confirme largement celui de la FIDH :
78. The question whether the massacres described above may be termed genocide has often been raised. It is not for the Special Rapporteur to pass judgement at this stage, but an initial reply may be put forward. Rwanda acceded to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide on 15 April 1975. Article II of the Convention reads :
« In the present Convention, genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such :
(a) Killing members of the group;
(b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group;
(c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;
(d) Imposing measures intended to prevent births within the group;
(e) Forcibly transferring children of the group to another group. »
79. The cases of intercommunal violence brought to the Special Rapporteur's attention indicate very clearly that the victims of the attacks, Tutsis in the overwhelming majority of cases, have been targeted solely because of their membership of a certain ethnic group, and for no other objective reason. Article II, paragraphs (a) and (b), might therefore be considered to apply to these cases (51c). »
Outre les indices précités, que toute la Communauté internationale était en mesure de connaître, de quelles informations spécifiques la Belgique disposait-elle? Comment ont-ils été exploités? La menace a-t-elle été perçue ?
3.6.5.1. Rappelons que, parmi les documents à la disposition des autorités belges, le groupe ad hoc a identifié 19 documents dans lesquels il est question d'un plan machiavélique, d'un plan de déstabilisation ou de massacres possibles. Deux de ces documents mentionnent explicitement la possibilité d'un génocide, deux autres la suggèrent (52c), trois éléments sur la constitution d'une liste d'exécution, 11 sur la formation paramilitaire des milices hutues, 13 sur le boycottage des accords d'Arusha et 17 sur la distribution d'armes à la population par les autorités rwandaises.
Le rapport du groupe ad hoc Rwanda se fonde sur :
les télex diplomatiques de l'ambassadeur Swinnen;
la lettre du 3 décembre 1993;
le complément d'information du 2 février 1994;
les rapports du lieutenant Nees;
les rapports d'organisations des droits de l'homme locales;
le télex de Willy Claes du 25 février 1994 dans lequel il évoque la possibilité d'un génocide (volkenmoord ).
3.6.5.2. Le groupe ad hoc Rwanda ne couvrit que la période postérieure à la signature des accords finaux d'Arusha. La commission a cependant recueilli plusieurs documents et témoignages montrant des indices sérieux de préparation et de planification d'un génocide avant la signature des accords d'Arusha en août 1993.
La commission n'a pas eu accès aux documents des Affaires étrangères antérieurs aux accords d'Arusha; elle a cependant pris connaissance de certains de ces documents par l'intermédiaire de la justice belge, suite à une perquisition au ministère des Affaires étrangères. Cette perquisition avait été réalisée pour d'autres motifs par les autorités judiciaires.
a) Au printemps 1992, l'ambassadeur Swinnen a transmis au ministre Willy Claes par télex diplomatique des informations. Un premier télex faisait état d'un « État-major secret chargé de l'extermination des Tutsis du Rwanda afin de résoudre définitivement, à leur manière, le problème ethnique au Rwanda et d'écraser l'opposition hutue intérieure » (53c).
Un premier document a été transmis le 12 mars, intitulé « Betreft : Onlusten in Rwanda Actionaal terreurplan » .
Un deuxième document a été transmis le lendemain, intitulé « Betreft : onderhoud met X » .
Un troisième document est envoyé le 27 mars 1992, intitulé : « Onderwerp : Rwanda Onlusten Bugesera ». Le contenu en était le suivant :
« 1. Ik heb de eer u hierbij kopie van een anoniem vlugschrift te laten geworden dat een lijst bevat van de leden van de « État-major secret chargé de l'extermination des Tutsis du Rwanda afin de résoudre définitivement, à leur manière, le problème ethnique au Rwanda et d'écraser l'opposition hutue intérieure ».
Het is ook deze groep die volgens de auteurs verantwoordelijk is voor het mijnenleggen en de stadsterreur.
2. Zoals u merkt stemt deze lijst volledig overeen met de namen die X mij enkele weken geleden overmaakte, zelfs de volgorde is identiek.
3. Net zoals X deed opmerken, staat volgens het pamflet de verantwoordelijkheid van president Habyarimana vast.
4. Als uitvoerders van het uitroeiingsplan wijst het vlugschrift in de richting van de gendarmerieschool van Ruhengeri en de MRND-militie « Interahamwe ».
« De source sûre, nous venons de recevoir par chance une liste des membres de l'État-major secret chargé de l'extermination des Tutsis du Rwanda afin de résoudre définitivement, à leur manière, le problème ethnique au Rwanda et d'écraser l'opposition hutue intérieure.
La voici :
1. Protais Zigiranyirazo : président du groupe et beau-frère du chef d'État;
2. Elie Sagatwa : colonel, beau-frère et secrétaire particulier du président de la République, chargé des services secrets;
3. Pascal Simbikangwa : capitaine, officier au Service central de Renseignements (SCR);
4. François Karera : sous-préfet à la préfecture de Kigali, chargé de la logistique lors des massacres du Bugesera;
5. Jean-Pierre Karangwa : commandant, chargé des renseignements au ministère;
6. Justin Gacinya : capitaine, chargé de la police communale de la Ville de Kigali;
7. Anatole Nsengiumva : lieutenant-colonel, chargé des renseignements à l'état-major de l'armée rwandaise, un des responsables de l'assassinat des politiciens de Gitarama;
8. Tharcise Renzaho : lieutenant-colonel, préfet de la préfecture de la Ville de Kigali. Ce groupe est lié directement au président de la République qui le préside souvent soit à la présidence, soit à la permanence du parti politique MRND, building de Félicien Kabuga à Muhima, Kigali. Cet état-major clandestin dispose d'antennes au niveau de chaque préfecture et de chaque commune concernée. C'est ce groupe aussi qui pose des mines anti-char et anti-personne et sème la terreur dans les centres urbains, surtout à Kigali.
Autre information très utile : le groupe de tueurs professionnels qui vient de ravager le Bugesera avec une remarquable efficacité était constitué :
d'un commando recruté par les élèves de l'École Nationale de la Gendarmerie de Ruhengeri et entraîné à cet effet (habillés en civil); chargé de frapper des personnes préalablement sélectionnées, souvent des leaders locaux du PL (parti libéral) et du MDR (Mouvement Démocratique Républicain); il constitue le noyau central;
d'une milice « Interahamwe » du MRND recrutée en dehors du Bugesera, entraînée pendant des semaines dans différents camps militaires;
d'un groupe plus nombreux de miliciens « Interahamwe » du MRND recruté localement, chargé de piller et incendier, et comme indicateurs. La présence de ce dernier groupe permet de brouiller les cartes et de faire croire à un observateur non averti à des émeutes. »
À propos de ce document, il faut souligner que contrairement à la présentation qui en a été faite par un commissaire au cours de l'audition de l'ambassadeur Swinnen, le 20 juin 1997, le contenu de l'information et l'appréciation « de source sûre » n'émanait pas de l'ambassadeur lui-même, mais bien des auteurs de l'écrit anonyme transmis.
b) Les autorités belges disposaient d'un document émanant du ministère rwandais de la Défense nationale et transmis le 21 septembre 1992 à tous les commandants de secteur opérationnels ainsi qu'à l'état-major de la gendarmerie qui revenait à décrire les Tutsis de l'intérieur comme de l'extérieur comme l'ennemi principal et les partisans de l'ennemi comme toute personne qui apporte son concours à l'« ennemi principal ».
À cela, il faut ajouter le discours du 10 décembre 1993 de l'abbé André Sibomana en présence du nonce apostolique et de l'ambassadeur de Belgique prononcé à l'occasion du 45e anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme et de la 2e semaine des droits de l'homme organisée par l'ADL.
L'abbé Sibomana déclarait notamment : « (...) Chaque jour dans ce pays, des êtres humains sont assassinés. Ils meurent pour avoir exprimé une opinion politique, parce qu'ils appartiennent à une communauté et/ou à une région particulière, ou simplement parce qu'ils ont le tort d'être pauvres. (...) Certains responsables de la protection de la population n'hésitent pas à déformer la réalité pour rejeter sur d'autres la responsabilité des assassinats. Ils cherchent souvent à entretenir un certain flou sur l'identité des tueurs, présentés comme étant des délinquants civils ou militaires qui échappent au contrôle des autorités. Pourtant, des indices nombreux tendent à prouver que ces groupes opèrent bien souvent en étroite collaboration avec les pouvoirs publics, voire sont des simples couvertures pour certains agents de l'État. (...). »
c) Les autorités des Nations unies et les autorités belges étaient au courant des informations fournies par « Jean-Pierre », déjà évoquées dans un autre chapitre.
En ce qui concerne les autorités belges, le ministre Delcroix a déclaré, lors de son audition du 5 mars : « Pendant la période visée de 4 à 5 mois, ni les Quatre Bras, ni Evere, n'ont tiré la sonnette d'alarme pour communiquer les problèmes cruciaux. » (54c)
Cependant, ainsi qu'on l'a déjà noté en ce qui concerne l'appréciation de la menace contre les Belges de la MINUAR (point 3.3.2.3.), le ministre a reconnu, lors de sa seconde audition, avoir été informé de l'essentiel des informations données par Jean-Pierre : « (...) in die gegeven periode heb ik nooit een Jean-Pierre gekend. Ik heb ook nooit over hem horen spreken. Achteraf, ik weet niet meer wanneer dat precies aan bod is gekomen, wordt er wel over een zekere Jean-Pierre gesproken. Destijds heb ik uiteraard wel horen spreken over een informant. Ik geloof dat dit in de periode van januari, februari 1994 was. Toen werd in de documenten gesproken over een informant waaraan men zowat anderhalf jaar geleden, in de loop van november 1995, de naam Jean-Pierre heeft gegeven. Ik geloof niet dat deze man eerder met die naam werd geciteerd. In de toenmalige documenten was er alleszins geen sprake van de genaamde Jean-Pierre. Achteraf heeft men mij gezegd dat Jean-Pierre de echte voornaam was van de informant. Op het bewuste moment had ik er alleen kennis van dat « un informateur aurait déclaré à l'UNAMIR ». De informant beweerde ontstemd te zijn over de wending die de Interahamwe-agitatie had genomen, enz. Pas achteraf heb ik beseft, ik denk velen met mij, dat die man Jean-Pierre heette. » (55c) Le ministre a également reconnu avoir pris connaissance du rapport du major Hock du 2 février 1994.
Le général-major Schellemans, chef de cabinet du ministre, confirme la déclaration de M. Delcroix : « Pour autant que je me souvienne, le cabinet a reçu des messages d'un certain Jean-Pierre; le nom de Jean-Pierre n'apparaît dans ses messages que quelques jours. À mon avis, le ministre a lu ses messages (...) » . Il précise : « Je confirme avoir lu le nom de Jean-Pierre dans le courrier et qu'en principe ce courrier a été transmis au ministre. » (56c)
À propos de la note du 2 février faisant allusion aux risques encourus par les Belges de la MINUAR et au génocide, le général-major a déclaré : « Cette note est en effet parvenue au cabinet. Nous étions informés des menaces, mais celles-ci n'étaient pas considérées comme très dangereuses. » (57c)
Le ministre Claes a déclaré à la commission : « Lorsque nous avons été mis au courant par un informateur du développement inquiétant de la situation au Rwanda, nous avons réagi immédiatement ». (58c)
1. Le ministre Claes a réagi au nom du Gouvernement belge dès qu'un informateur eut fait parvenir, au début du mois de janvier, des nouvelles alarmantes. Tant à Kigali qu'à New York, il s'est alors avéré que la MINUAR ne recevait qu'une faible marge de manoeuvre du quartier général. Par la voix de feu l'ambassadeur Noterdaeme, le Gouvernement belge a soutenu à New York, à l'ONU, la requête par laquelle le général Dallaire demandait à pouvoir intervenir plus sévèrement.
2. Comme la réaction de l'ONU et de la MINUAR sur place était insignifiante, le ministre Claes écrit finalement, le 11 février 1994, une lettre au SG BB Ghali, dans laquelle il dit clairement que l'accentuation du profil politique de l'ONU (en d'autres termes, le représentant de l'ONU Booh-Booh doit intervenir plus activement) doit aller de pair avec un renforcement de la sécurité. Il souligne que l'impasse politique actuelle peut aboutir à une explosion de violence irréversible. Il est à craindre que, si l'on ne parvient pas à endiguer l'évolution négative de la situation au Rwanda, la MINUAR ne se trouve dans l'impossibilité de jouer son rôle dans l'application des accords d'Arusha.
Il faut signaler que les informations rapportées par Jean-Pierre sont mentionnées dans le compte rendu des réunions de coordination entre les Affaires étrangères, la Défense, la Coopération au Développement et le cabinet du Premier ministre, par ces simples phrases : « UNAMIR estime à environ 1 500 le nombre de milices MRND » (59c) et « l'État-major confirme l'insécurité qui règne dans la population à Kigali en raison de l'explosion d'une vingtaine de grenades au cours des derniers jours; Il s'agit à son avis d'une action concertée ». (60c)
Ces informations n'ont pas fait l'objet d'une mise à l'ordre du jour d'un Conseil des ministres. Le Premier ministre a confirmé qu'entre le 19 novembre et le 4 mars, le Rwanda n'a pas été à l'ordre du jour du Conseil des ministres. Selon M. Dehaene, « Les opérations se font au niveau des départements concernés. Ils doivent voir s'il y a des éléments à transmettre au Conseil des ministres. » (61c)
En réponse à la question « Jugiez-vous qu'il n'y avait pas suffisamment d'indices pour en discuter avec M. Dehaene ou M. Claes ? » (la question concerne particulièrement les informations sur les menaces pesant sur les casques bleus belges, mais celles-ci sont révélées par Jean-Pierre, en même temps que la menace de génocide). M. Delcroix a déclaré « Nee, dit was voor Evere en voor het kabinet inderdaad geen aanleiding om een crisisberaad bijeen te roepen. Dat werd zo niet aangevoeld. » (62c) Par contre, M. Delcroix souligne que « Er was een vast agendapunt op de ministerraad waarbij minister Claes de belangrijkste punten van de buitenlandse politiek toelichtte. Hij gaf dan de situatie van Rwanda weer. Soms kwam ik daarin tussen en gaf bijkomende informatie. Men mag niet beweren dat er op de ministerraad gedurende vier maanden niet over Rwanda werd gesproken. » (63c) Il ajoute : « de heer Claes las tijdens de ministerraad herhaaldelijk citaten uit berichten van de ambassade van Kigali, wanneer de situatie in Rwanda ter sprake kwam. » (64c)
Le ministre conclut : « Het algemeen gevoel was dat men de situatie onder controle had en dat er geen precair gevaar was. Veronderstel dat ik op basis van de informatie waarover ik beschikte ervan op de hoogte was geweest dat de Belgen daar systematisch gevaar liepen en dat er op elk moment een genocide kon uitbreken, dan zou ik drie weken voordien samen met zestig journalisten, parlementsleden, kabinetsmedewerkers en militairen toch geen bezoek gebracht hebben aan Rwanda. » (65c)
M. Dehaene confirme que le Gouvernement croyait aux accords d'Arusha. « Il est absurde de supposer qu'un accord ne sera pas respecté. » (66c) Ce sentiment, qu'il soit fondé ou non, a peut-être mené à relativiser certaines informations dites « alarmistes », et à en privilégier d'autres, plus conformes à l'opinion générale.
Ces premières étaient pourtant connues, ainsi que l'ont rappelé plusieurs témoins devant la commission.
Mme Des Forges a déclaré : « D'après les diplomates avec lesquels j'ai parlé et qui étaient à Kigali alors, la distribution des armes, le recrutement et la formation des milices qui continuaient et devenaient toujours plus importants étaient des sujets discutés à haute voix parmi les diplomates (...) Quand j'ai essayé de rassembler tous les signes avant-coureurs, tous les avertissements qu'il y a eus, je me rendais compte évidemment que les responsables du moment ne possédaient pas, tous, tous ces avertissements. Il n'y a pas eu quelqu'un qui s'est assis pour regarder tous ces avertissements à la fois mais, quand même, la série avait un tel poids, une telle densité, une telle intensité, que je trouve impossible le fait d'avoir ignoré qu'il y avait un risque très, très grave d'une tuerie massive. » (67c)
d) Les auditions ont permis d'apporter d'autres éléments sur les informations dont disposaient les autorités belges et internationales.
Lors de son audition devant la commission, M. Jean-Pierre Chrétien a déclaré : « (...) Parmi « les indications dont disposaient les autorités belges et la Communauté internationale quant à la préparation d'un génocide » je reprends la formulation de la commission , figurait donc la propagande développée dans les journaux les plus proches du pouvoir et en particulier de la faction présidentielle; En parlant de RTLM et des autres organes de la même mouvance, je reviendrai plus loin sur l'importance politique de ces médias, interdisant d'y voir des organes marginaux. Je crois utile de rappeler ici les points essentiels de cette propagande. Il ne s'agit pas d'une simple juxtaposition d'appels à la haine, forgés pour une polémique conjoncturelle mais d'un système cohérent, enraciné dans une idéologie prédéfinie. La mise à plat des différents aspects de l'argumentaire développé par cette propagande permet de dégager quatre grandes lignes :
1) La diabolisation globale des Tutsis identifiés biologiquement et dénoncés sur les plans social, politique et moral, (...)
2) La nécessité impérative pour les Hutus de constituer un bloc homogène, garantissant du « peuple majoritaire », fondement de la logique ethniste du Hutu power, (...)
3) La priorité de l'identification ethnique (...)
4) La légitimation de la violence absolue par l'autodéfense (...). » (68c)
M. Jean-Pierre Chrétien a longuement développé ces quatre points dans un exposé introductif qui a été remis à la commission lors de son audition. Il avait ainsi conclu : « (...) Fallait-il traiter cette propagande par le mépris ? La considérer comme un délire de marginaux particulièrement excités? En fait, elle émanait des réseaux les plus liés au pouvoir, c'est-à-dire de ce qu'on a appelé l'akazu. Le journal Murwanyashyaka, organe du MRND, traitait lui aussi de « chiens » en avril 1991 ceux qui selon lui trichaient sur leur ethnie en falsifiant leurs papiers; en 1992, il dénonçait les « partis traîtres » avec la même virulence que Kangura. Le style était le même (...). » (69c)
Plusieurs témoins se sont prononcés sur la prise en compte et les traitements des informations par les autorités belges et se sont interrogés sur la prévisibilité du génocide.
Lors de son audition du 11 juin 1997, le professeur Prunier explique : « Bon nombre de gens se refusent à admettre la possibilité selon laquelle ces événements auraient été organisés, car cela leur paraît trop monstrueux. Selon moi, ils étaient prévus. Mais étaient-ils prévisibles, notamment de la part des étrangers ? À cet égard, je tenterai d'exonérer quelque peu la responsabilité européenne. À mon avis, il était très probable que des actes de violences seraient commis, mais pas un génocide. Toute le monde a donc été surpris, même certains des participants, ce qui peut paraître paradoxal. Au niveau des proches du régime, on s'attendait certainement à ce que certains Tutsis et des responsables politiques soient tués, à ce qu'il y ait une sorte de Saint-Barthélemy politique, et d'aucuns le souhaitaient. Mais de là à passer de 3 à 4 000 morts ciblés à un massacre sans discrimination d'une foule de personnes qu'il était inutile de tuer... En effet, de même que le génocide des Juifs a plutôt freiné l'effort de guerre des Allemands pendant la deuxième guerre mondiale, le génocide des Tutsis et des Hutus démocrates a freiné l'effort de guerre des forces armées rwandaises contre le FPR. Cela ne les a certainement pas aidés sur le plan militaire, bien au contraire. De ce point de vue, le caractère prévisible du phénomène était très limité, selon moi.
Certains des acteurs eux-mêmes ont dû se demander dans quoi ils étaient embarqués. En effet, un flottement a été constaté. On l'a bien vu à propos de ce pseudo-gouvernement génocidaire qui s'est déplacé sur Gitarama à peine quelques jours après l'assassinat d'Habyarimana. Les gens de Gitarama étaient un peu dépassés par les événements. Certains, comme Théodore Sindikubwabo, souhaitaient aller jusqu'au bout. En effet, quand il est allé à Butare et qu'il a fait son fameux discours disant : « Qu'attendez-vous ? Vous dormez ? », c'était très clair. Mais certains autres, tels que le ministre de l'Éducation, qui était l'ancien recteur de l'université, étaient dépassés par les événements. Je ne peux pas croire que cet homme ait souhaité de tels événements. Je ne serais pas étonné qu'il ait plus ou moins collaboré à 3 ou 4 000 assassinats, mais je ne peux croire qu'il ait souhaité 800 000 morts. Il espérait une opération plus chirurgicale. Personnellement, il m'a fallu 4 jours pour comprendre ce qui se passait. Ce n'est que le quatrième jour que j'ai dû me rendre à l'évidence et me rendre compte que cela n'allait pas s'arrêter, que c'était le grand chelem. Je n'arrivais pas à y croire.
Quand on voit les quelques timides signes donnés à l'état-major du général Dallaire, au gouvernement de votre pays, par quelques Rwandais, durant les mois de février, mars et avril, je peux parfaitement croire que ces signes n'aient pas été pris au sérieux, d'autant plus qu'aucun de ces critères ne pouvait paraître sérieux à un regard européen. Il s'agissait de listes, gribouillées sur des pages de cahier, écrites au stylo-bille, avec un tas de noms dont 90 % nous sont inconnus. Pourquoi ceux-là plutôt que d'autres ? En plus, dans la région, tout le monde fait tout le temps circuler des plans de génocide et d'assassinat depuis 30 ans. De temps en temps, un d'entre eux se concrétise. Il y a le mythe de ce fameux plan Arthémon Simbananiye au Burundi. Tout le monde a un génocide dans sa serviette. Vous ne pouvez pas parler à un Hutu sans qu'il vous dise qu'il a le plan de domination régional de l'empire tutsi depuis l'Ouganda jusqu'à la Zambie et qu'il le tient de fort bonne source, de l'état-major de l'armée burundaise. Il vous sort un faux sur papier à en-tête de l'armée burundaise.
Si vous parlez à un Tutsi, il vous dira qu'il sait que les Hutus vont, au Kivu, massacrer la totalité des Tutsis du Masisi et que c'est arrangé avec Mobutu. On me disait cela aussi, avant le génocide au Rwanda, en parlant du Kivu. Ce problème ethnique existe dans toute la région et pas seulement dans les frontières des États. Tout qui a traîné ses guêtres a pu avoir entre les mains des plans faux, des listes de gens à assassiner, de gens qui allaient faire un coup d'État, qu'on allait emprisonner ou fusiller. De temps en temps, une concrétisation se produit, par exemple en 1972 avec le génocide partiel sélectif des élites Hutus par les Tutsis au Burundi. De temps en temps, c'est vrai. Mais depuis 22 ans, cela ne s'était pas produit et on avait fini par croire que cela s'était peut-être calmé. Encore qu'en octobre et novembre 1993, il y ait eu des embryons de génocide des deux côtés au Burundi. Honnêtement, je ne sais pas ce que j'aurais fait si j'avais été à la place du général Dallaire ou du secrétaire général des Nations Unies.
On dit qu'il se prépare quelque chose. Que fait-on ? Faut-il demander aux Nations Unies de donner à la Minuar un nouveau mandat, d'être sur le pied de guerre, d'avoir une préparation à l'action militaire immédiate ? C'est très difficile à imaginer quand on voit l'état d'esprit dans lequel se trouve l'assemblée général de New York face à ce genre de choses. On ne peut pas dire qu'ils brillent par leur activisme, leurs résolutions et leur rapidité dans l'exécution. C'est une litote. Honnêtement, je vois la prévisibilité comme assez basse. Personne n'y a vraiment cru. Tout le monde doit peut-être faire son mea culpa. Les Rwandais eux-mêmes n'y ont pas cru. Les gens du FPR non plus, vu la lenteur de leur réaction. Ils ont mis cinq jours à réagir. Dans les premières 48 heures, quand on parlais aux gens du FPR, ils disaient que le massacre attendu s'était produit mais ils n'utilisaient pas le terme « génocide ». Tout le monde savait qu'il y avait une Saint-Barthélemy politique. Elle était prévisible. Si l'on avait été prêt pour le « moins », on aurait peut-être pu agir sur le « plus ». On aurait pu au moins se dire qu'à Kigali, quelques centaines ou milliers de personnes étaient en danger à partir du moment où les accords d'Arusha devenaient applicables, qu'on tenterait d'éliminer ces gens avant l'application des accords. Il y avait là quelque chose de prévisible. Le massacre général de 800 000 personnes, par contre, n'était pas prévisible. » (70c)
Selon M. Gillet : « M. Habyarimana suivait en même temps deux logiques : celle d'Arusha et celle du génocide. Ce double jeu n'ait pas possible indéfiniment. Plus le temps avançait, plus un choix s'avérait nécessaire. La population rwandaise avait elle-même le sentiment que si les Accords d'Arusha n'étaient pas appliqués, un massacre généralisé aurait lieu. Habyarimana a finalement cédé à la pression diplomatique, surtout celle de la Belgique. Un scénario possible est que les membres de son entourage qui étaient contre Arusha ont alors décidé de l'éliminer. (...) »
Le lieutenant Nees qui est l'officier S2 chargé de réunir les informations pour KIBAT 1 apporte également quelques précisions. Au cours de sa mission, il a rédigé 29 rapports. Il a entamé la rédaction de ses rapports à partir du moment où il y a été autorisé par le colonel Marchal, c'est-à-dire ± le 16 janvier 1994. Son dernier rapport date du 11 mars 1994, date à laquelle le lieutenant De Cuyper a pris sa succession. Les informations recueillies par le lieutenant Nees étaient portées à la connaissance de l'état-major belge.
Les informations qu'il a recueillies concernant la préparation d'un génocide, ou du moins de massacres, se sont révélées assez nombreuses, quoique parcellaires. En voici des extraits : « En ce qui concerne nos informations sur les préparations du génocide, je tiens à souligner qu'il est trop facile après coup de rassembler les différentes pièces du puzzle. Une première indication était une note que nous avions reçue vers le 10 décembre. Cette note était anonyme mais prétendait traduire les opinions d'officiers rwandais supérieurs. Le titre en était : « le plan machiavélique d'Habyarimana ». Je suis convaincu que cette note traduisait effectivement les opinions de quelques officiers supérieurs : il est clair que tout l'état-major de l'armée ne soutenait pas les accords d'Arusha; Dans cette note, on annonçait également déjà des massacres dans les régions où habitaient beaucoup de Tutsis et le massacre de nombreuses personnalités qui avaient contribué à la conclusion des accords d'Arusha. Déjà le 18 décembre, le journal « Le Flambeau » a mis en garde contre le jour fatidique du règlement de compte. Celui-ci était prévu pour le 23 décembre mais de plus en plus d'indications annonçaient des massacres pour le mois de janvier et même pour le mois de mars. Or, les jours annoncés, rien d'anormal ne s'est produit. Nous avons également reçu des informations selon lesquelles l'Interahamwe donnait à ses membres un entraînement militaire et leur apprenait à utiliser des armes à feu. Même certains belges établis au Rwanda nous ont donné des indications concernant des caches d'armes à Kigali. Nous n'avons pas pu ou su vérifier ces indications et je ne sais donc pas si ces informations étaient fiables. » (71c)
Le colonel Balis a déclaré : « Iedere inlichting was welgekomen, uiteraard, maar er waren heel alarmerende feiten. Onder andere de moord op de heer Gatabazi. Het bericht dat ik had zien liggen dat was ook op kapitain Claeys zijn bureau meldde dat de Interahamwe klaar waren om binnen de twintig minuten 1 800 mensen te vermoorden. Er waren Tutsi-families die mij vertelden dat hun Hutu-buren hun bijna dagelijks kwamen zeggen dat ze heel binnenkort zouden worden afgemaakt. Er werden wapens uitgedeeld aan de Hutu's en een brave Tutsi-familievader die een officiële wapenvergunning aanvroeg, werd dit geweigerd. Er waren zoveel indicaties die duidelijk aantoonden dat er iets niet in orde was. Een inlichtingencel of een gespecialiseerd organisme, mensen die er dieper op zouden zijn ingegaan, hadden tot conclusies moeten komen. Daar ben ik vast van overtuigd. (...) Ik had ook geen enkele Afrika-ervaring. Ik ging er ook maar voor zes maanden naar toe. Na drie tot vier maanden permanent te moeten horen dat ik er niet moest mee inzitten, dat de Arusha-akkoorden zouden worden uitgevoerd en dat UNAMIR « a peace of cake » was, begint men zichzelf ... » (72c)
Par contre, l'analyse du colonel Vincent, chef de la CTM et informateur du SGR, sur cette question, a été toute différente : « Je n'ai pas perçu l'imminence du génocide et je n'ai jamais pensé au cas de figure du 6 avril 1994. L'assassinat du président n'a été prévu par personne et c'est pourtant cela qui a fait basculer le Rwanda dans l'horreur; (...) Je n'ai jamais reçu d'indications sérieuses quant au génocide. Je crois que le génocide était la manifestation du désarroi d'un peuple déstabilisé par toute une série de facteurs. D'abord, l'énorme pression démographique a entraîné une bonne partie de la population en-dessous du minimum vital. Le prix du café et du thé a dégringolé, les finances publiques ont été fragilisées et le FMI et la Banque mondiale sont venues imposer leur plan d'assistance structurelle. La guerre a engendré de nombreuses souffrances et a entraîné le déplacement de 900 000 personnes. En 1994, une disette a éclaté dans le sud. Ensuite, il y a la démocratisation qui n'est pas adaptée à ce type de société car les partis politiques ne reposent sur rien et ne font que renforcer les clivages. Pendant ce temps, des soi-disant journalistes se déchaînent dans des torchons. Quant aux accords d'Arusha, ils ont juste renforcé la méfiance atavique entre ethnies, méfiance encore accentuée par l'assassinat du président Ndadaye. Enfin, le facteur qui est, selon moi, le plus important est l'assassinat d'Habyarimana. Il était respecté et avait le système en mains, ce qui a permis de limiter les massacres précédents. Sa mort a déclenché le génocide, si on peut dire, car il y avait aussi des massacres de Hutus. » (73c)
Le général major Verschoore déclare : « Le SGR percevait quelques indications de troubles graves mais ne pouvait certainement pas conclure des informations reçues qu'un génocide se préparait. » (74c)
M. Swinnen, l'ambassadeur de Belgique au Rwanda de l'époque, a fourni, tout au long de l'exercice de ses fonctions, par l'envoi de télex multiples au ministère des Affaires étrangères et au cabinet, un grand nombre d'informations sur les violations des droits de l'homme perpétrés au Rwanda et sur la préparation de massacres. « L'ambassade ne disposait pas du personnel nécessaire pour écouter ou traduire toutes les émissions de RTLM. Au départ, cette radio n'émettait qu'une à deux heures par jour en français. À un moment donné, j'ai donné l'ordre d'écouter plus souvent les émissions. Bon nombre d'entre elles ont été enregistrées et j'ai toujours amplement informé Bruxelles de leur contenu. J'ai rédigé des rapports ponctuels au sujet du respect des droits de l'homme. » (75c)
« (...) Tout ce qui est repris dans les sections 4 et 5 du rapport ad hoc est correct et nous le savions, tout comme l'ONU, la France, les États-Unis, le Royaume-Uni et les voisins africains le savaient. L'assassinat de Gatabazi n'était pas un mystère; tout le monde a également vu les massacres de 1992-1993. Nous savions autant que les autres, mais nous avons fait dix fois plus. Le rapport Ndiaye sort le 11 août 1993, soit sept jours après Arusha. La commission des droits de l'homme ne l'a traité qu'en mars 1994. (...) Mais nous n'avons pas attendu le rapport. Après l'incident au Bugesera et après avoir lu les rapports d'un certain nombre d'ONG relatifs à ces incidents, nous avons immédiatement réagi. Nous avons rappelé notre ambassadeur et nous ne l'avons renvoyé que lorsqu'on a eu la garantie que le président et le premier ministre feraient ensemble une déclaration sur les droits de l'homme; ce qu'ils ont fait le 7 avril 1993.
Dans son rapport, Ndiaye dit de cette démarche que ce fut un acte positif. De même, nous n'avons pas attendu les conclusions de Ndiaye pour nous préoccuper des droits de l'homme. Ainsi, nous avons dit, devant Ndiaye, qu'il fallait instaurer une police civile. Cette police a ultérieurement fait partie de la MINUAR. Ndiaye a plaidé également en faveur d'une campagne de réconciliation. À cet égard, nous avons entrepris une quarantaine d'actions; Il trouvait par ailleurs qu'une action médiatisée était nécessaire. Cela aussi, nous l'avons fait : nous avons organisé avec l'AGCD un séminaire auquel Guy Poppe, Colette Braeckman et Frédéric François, ainsi que quelqu'un de RTLM étaient présents. Le 16 mars 1994, le Secrétaire d'État Derycke a présenté au Sénat sa note politique sur les droits de l'homme. » (76c)
La commission constate qu'au plus tard au milieu du mois de janvier 1994, les autorités belges disposaient d'une série d'informations concordantes qui concernaient, sinon la préparation d'un génocide, du moins l'existence de la préparation de massacres à grande échelle.
Certains éléments d'explication de ces problèmes d'interprétation et de prise en compte ont été exposés lors des auditions.
D'autre part, de nombreux acteurs (ONU, autres États, ...) disposant des mêmes informations, n'y ont pas donné une importance plus déterminante.
Le professeur Prunier a estimé devant notre commission que le FPR s'était rendu coupable de massacres à grande échelle.
À cet égard, Amnesty International a publié un rapport sur les assassinats et les enlèvements par l'Armée patriotique rwandaise pendant la période d'avril à août 1994.
« Amnesty International has known for several years that the RPF closely monitored and controlled movements of foreigners in areas under its control. Journalists and representatives of humanitarian organisations rarely talked to Rwandese citizens under RPF control without an RPF official being present. This ensured that before the new government came to power on 19 july 1994 very limited information about abuses by the RPA could be gathered or made public by independent observers. However, Amnesty International has received numerous reports of human rights abuses committed by the RPA since the war in Rwanda began in october 1990. These have included hundreds of deliberate and arbitrary killings or possible extrajudicial executions and « disappearances » of captured combatants and unarmed civilians suspected of supporting the former government. There have also been reports of civilian supporters of the RPF being allowed to kill opponents (77c) ».
Le rapport poursuit :
« Many of these killings by the RPA, which appear to have gone largely unreported, have taken place in north-eastern Rwanda in mid-April 1994. Others have occurred in southern and western Rwanda once the RPA took control of these areas in May and June 1994. (...) Several dozen witnesses reported that members of the RPA arrived in Kagitumba on 12 April 1994. At first the fighters were reportedly very friendly to the local population and promised that the RPA was determined to protect the local people who were then summoned to a public meeting at Gishara. On 13 April unarmed civilian men, women and children gathered at Gishara in Kagitumba. RPA officials reportedly began addressing the crowd and suddenly without provocation or warning they opened fire on the crowd and threw grenades in the crowd.
It is unclear how many people were killed. However, from accounts of eye-witnesses, dozens are likely to have been killed in the incident ».
Ces faits ait été portés à la connaissance de l'ONU par le rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme.
Le secrétaire général lui-même s'en faisait l'écho en communiquant le rapport de la Commission d'experts « established pursuant to Security Council resolution 935 (1994) » :
»b) Crimes against humanity and serious violations of international humanitarian law were committed by individuals of both sides of the conflict, but there is no evidence to suggest that acts committed by Tutsi elements were perpetrated with an intent to destroy the Hutu ethnic group as such, within the meaning of the Genocide Convention; the Commission recommended, however, that investigation of violations of international humanitarian law and of human rights law attributed to the Rwandese Patriotic Front be continued by the Prosecutor of the recently established International Tribunal for Rwanda (78c). »
Quant aux massacres imputables au FPR, le rapport transmis par ce courrier précisait :
« 95. The Commission of Experts has concluded that there exist substantial grounds to conclude that mass murders, summary executions, breaches of international humanitarian law and crimes against humanity were also perpetrated by Tutsi elements against Hutu individuals and that allegations concerning these acts should be investigated further.
96. As it was finalizing its preliminary report, the Commission of Experts received reports of violations of the right to life in Rwanda perpetrated in the period from August to early September 1994. The Secretary-General asked the Commission to investigate these reports (79c) ».
La commission ne dispose que de très peu de documents écrits datant de cette période (avril 1994) et ayant été rédigés sur le terrain.
Le rapport le plus circonstancié sur la situation est, sans doute, le code cable du représentant du secrétaire général de l'ONU, M. Booh Booh adressé à M. Kofi Annan le 8 avril 1994 :
« 1. La sécurité se dégrade à Kigali à mesure que les combats entre la Garde présidentielle et le FPR s'intensifient. Le reste du pays reste calme bien que la tension soit perceptible.
2. À la suite du décès des présidents du Rwanda et du Burundi dans la nuit du 6 avril, des éléments de la Garde présidentielle ont attaqué la résidence de plusieurs personnalités politiques et enlevé le Premier ministre, le juge-président de la Cour constitutionnelle, les ministres de l'Information, du Travail et des Affaires sociales, et de l'Agriculture. Nous avons ensuite reçu des rapports non confirmés selon lesquels ces dirigeants auraient été tués par leurs kidnappeurs. On rapporte que la Garde présidentielle a également attaqué plusieurs autres résidences et assassiné plusieurs personnes suspectées d'être des sympathisants du FPR.
3. Un important effectif de personnel militaire du FPR a quitté le complexe CND (ancien siège du parlement) le 7 avril à 16 h 00 (heure locale) pour se rendre dans les zones occupées par la Garde présidentielle, où ont eu lieu d'importants accrochages entre ces militaires et la Garde présidentielle. L'UNAMIR a observé plusieurs patrouilles armées du FPR se déplaçant à pied dans les zones jouxtant le QG de l'UNAMIR et du bataillon bangladais, qui sont aux mains des partisans du gouvernement.
4. Dans l'intervalle, un groupe d'officiers supérieurs des forces armées rwandaises s'est constitué en « Comité de crise » pour tenter de stabiliser la situation sur le plan de la sécurité. Ils ont demandé à l'UNAMIR d'arranger un cessez-le-feu entre le FPR et la Garde présidentielle. Ils ont également invité les partis politiques de l'actuel gouvernement de transition à se réunir pour instituer l'autorité légale et pour accélérer la mise en place des institutions transitoires évoquées dans l'accord de paix d'Arusha. L'UNAMIR soutient activement ces efforts et participe en qualité d'observateur aux réunions du « Comité de crise ». Veuillez trouver ci-joint une copie émanant dudit « Comité de crise ».
5. Nous avons organisé une réunion entre les membres du « Comité de crise » et le FPR. Cette réunion est prévue aujourd'hui à 14 h 00 (heure locale) et se tiendra au QG UNAMIR. Nous avons également noué des contacts avec le FPR et la Garde présidentielle afin de tenter de négocier un cessez-le-feu. Les négociations se poursuivent.
6. La mort du président de la République et la mort non confirmée du Premier ministre et du juge-président de la Cour constitutionnelle ainsi que de plusieurs ministres a créé une vacance du pouvoir qui risque de poser de nouveaux problèmes dans le processus de paix. Le Premier ministre désigné a été évacué par l'UNAMIR vers notre quartier général où il a trouvé refuge et nous assurons sa protection dans le site UNAMIR.
7. Aujourd'hui à douze (12) heures (heure locale), nous avons reçu le message suivant du général Kagame, à remettre au « Comité de crise » indiquant :
1) qu'il était prêt à participer à une rencontre à Kigali afin de poursuivre le processus de paix;
2) qu'il envoyait un bataillon à Kigali pour aider les forces gouvernementales à empêcher les forces renégates de tuer des innocents;
3) que le Comité de crise pouvait prouver son sérieux en n'ouvrant pas le feu sur son bataillon FPR en phase d'approche;
4) que le FPR n'autorisera aucun appareil à atterrir sur l'aéroport international Kayibanda de Kigali et que cette mesure est d'effet immédiat.
8. Notre réaction immédiate à ce message a été d'informer le général Kagame qu'à ce stade, l'introduction de nouvelles forces à Kigali risque de provoquer un résultat inverse à celui escompté et d'entraver les efforts en cours visant à négocier un cessez-le-feu entre la Garde présidentielle et le FPR. Nous lui avons exprimé notre appréciation du fait qu'il soit disposé à participer à une rencontre à Kigali en vue de poursuivre le processus de paix et avons transmis le message au Comité de crise conformément à sa requête.
8. Je poursuis mes efforts auprès de toutes les forces politiques pour établir la sécurité à Kigali afin de créer le contexte nécessaire à la reprise des efforts visant à mettre en place les institutions de transition. À ce sujet, la position de la direction du nouveau « Comité de crise » a été portée à ma connaissance et nous avons pu procéder à un échange de vues.
8. Au nom du secrétaire général et de tous les membres de l'UNAMIR, j'ai lancé un appel national à la restauration de la loi et de l'ordre et à la coexistence pacifique entre toutes les forces vives du pays. J'ai également diffusé la déclaration du président du Conseil de sécurité condamnant les meurtres et lançant un appel au calme.
9. J'ai le regret de confirmer la mort de dix (10) militaires du contingent belge qui ont été capturés et maintenus en détention par des éléments de la Garde présidentielle.
10. Le texte qui suit est une évaluation militaire de la situation actuelle et une mise à jour des aspects militaires de la mission.
11. Mandat et missions. Conformément à la résolution 872 du Conseil de sécurité du 5 octobre 1993 et au rapport du secrétaire général au Conseil de sécurité sur le Rwanda, date du 24 septembre 1993, nous avons passé notre situation en revue et vous présentons l'évaluation suivante.
12. À l'extérieur du KWSA. Les rapports de nos équipes UNMO dans les secteurs FAR, SUD et DMZ rapportent tous une situation générale calme, à l'exception de quelques réactions très négatives à la mort du président à Gisenyi. Dans le secteur FPR, d'importants préparatifs sont en cours en vue d'une offensive imminente. Nos contacts UNDP confirment également cette situation générale.
13. À l'intérieur du KWSA. L'apparition d'une campagne de terreur bien planifiée, organisée, délibérée et savamment orchestrée, menée principalement par la Garde présidentielle depuis le matin qui a suivi la mort du chef de l'État a complètement modifié la situation à Kigali. Des agressions ont été dirigées non seuleument contre les leaders de l'opposition, mais aussi contre le FPR (tirs prenant pour cible le CND), contre des groupes ethniques particuliers (massacre de Tutsis à Remera), contre la population civile en général (banditisme) et contre l'UNAMIR (tirs directs et indirects sur les installations, les véhicules, le personnel et les agences liées aux Nations Unies (à savoir l'UNDP), faisant plusieurs victimes dont certaines mortelles. Le meurtre particulièrement barbare des 10 soldats belges capturés souligne cette situation. Le mandat de l'UNAMIR est-il toujours valable ?
14. Les missions du KWSA et la situation actuelle à la lumière du mandat sont abordés ci-dessous :
A. Stockage des armes des parties en lieu sûr. Ce stockage n'a manifestement pas lieu étant donné que les parties ont retiré leurs armes et qu'elles ont ouvert les hostilités. Nos observateurs ont dû se retirer et cette mission ne peut plus être remplie dans la situation actuelle.
B. Maintien de la sécurité à Kigali. Le maintien de la sécurité était assuré à Kigali par deux petits bataillons d'infanterie mais le bataillon est à présent morcelé dans des camps confinés coupés de l'extérieur par les combats, les tirs et les barrages routiers et les éléments de ces bataillons se concentrent sur l'autodéfense. De plus, ces éléments sont coupés de leur appui logistique, à savoir une source d'approvisionnement en eau et en nourriture (à l'exception des rations d'urgence) et de leur réapprovisionnement en énergie, eau de lavage, carburant, sanitaires et, surtout, au vu de la menace que représente la situation actuelle, de leur hôpital de campagne. Kigali ne fait plus l'objet d'aucune surveillance, patrouille ou dispositif de sécurité vu la situation actuelle. Il s'agit d'un exercice de survie défensive pour l'UNAMIR.
C. Maintien de la sécurité de la zone FPR BN dans le CND. Pas assuré étant donné que le FPR est sorti de ses installations et conduit des opérations militaires offensives et défensives à Kigali. Le GD de la zone UNAMIR RPF BN s'est retranché dans son camp et a adopté une position défensive. La surveillance du FPR n'est donc pas assurée ni sa sécurité à Kigali.
D. Récupération des armes. Manifestement impossible puisque la Garde présidentielle et le FPR sont engagés dans des hostilités complètes et ouvertes et que la Garde présidentielle lance fréquemment des attaques contre l'UNAMIR. Cette mission n'est pas remplie et n'est ni possible ni viable dans la situation actuelle.
E. Utilisation des APC. Les APC sont utilisés pour les opérations urgentes telles que des opérations de secours et Casevac, au lieu de leur utilisation initiale comme moyen de dissuasion.
F. Surveillance et vérification. Vu la situation actuelle et les événements des dernières 48 heures, la conduite de ces opérations avec des UNMO désarmés ou même avec des troupes légèrement armées constitue un risque inacceptable. De plus, il y a une nouvelle armée dans le pays. Certains éléments de l'ancienne armée ont exprimé leur loyauté envers le gouvernement transitoire encore à former, dans un front contre la Garde présidentielle et l'ancienne Garde armée. On ne sait cependant pas avec certitude quelle attitude cette armée adoptera au cas où le FPR ouvrirait les hostilités. Kigali ne fait donc l'objet d'aucune surveillance (sauf à l'intérieur et à proximité de notre base) ni observation ou vérification.
G. Sécurité des individus. C'est devenu la principale mission de l'UNAMIR. Mais compte tenu de la situation, cela n'a pas permis de sauver la vie du Premier ministre Agathe ni des autres ministres enlevés, mais le dispositif fonctionne pour d'autres VIP. Comme L'UNAMIR tente d'organiser un cessez-le-feu, cette mission nécessitera des escortes, des gardes et une protection générale. Compte tenu des événements des dernières 24 heures, cette mission exposera la vie du personnel de l'UNAMIR. Ce risque doit être mis en balance avec la nécessité de sauver les derniers moyens de mettre en place le BBTG et de sauver le processus de paix. Ce risque sera accepté.
H. Sécurité de l'aéroport. Une sous-unité de la compagnie est à l'aéroport de même qu'une poignée de membres de la Garde présidentielle et un nombre plus important de combattants de troupes gouvernementales incertaines. L'aéroport peut être mis sous surveillance mais il est impossible d'en assurer la sécurité. Vu la taille de la zone d'intérêt de l'aéroport, la présente force ne peut accomplir cette mission dans la situation actuelle. En effet, la piste est bloquée par des membres de la Garde présidentielle.
I. Protection de la communauté UN et des expatriés. Cette communauté est en sécurité jusqu'ici dans les maisons ou localisations (à l'exception de l'UNDP). Cependant, une fois que les réserves d'eau et de nourriture seront épuisées, l'UNAMIR risque de devoir évacuer ces personnes vers un ou plusieurs endroits. Vu la situation actuelle dans les rues, cette évacuation risque d'être entravée ou retardée et très dangereuse. Un plan d'évacuation a été élaboré et coordonné mais il repose sur l'hypothèse que l'UNAMIR sera autorisée par les parties à mettre ce plan à exécution, en comptant sur un aéroport sûr et opérationnel jouissant de l'immunité contre les attaques. Cette mission sera possible à la condition que certaines conditions préalables soient réunies.
15. Soutien. La mission manque cruellement de soutien logistique et opérationnel de base. Les réserves demandées par les Nations Unies pour cette mission n'ont soit pas été fournies par les troupes des États participants, soit n'ont pas été fournies à cette mission. Il faut se rendre compte que Kigali est une ville en état de guerre. L'économie locale ne fonctionne pas. Les magasins, stations-service, fournisseurs, etc. sont fermés et leurs propriétaires et leur personnel se cachent. La mission est actuellement en train d'évaluer ses réserves logistiques. La compagnie logistique et un des principaux dépôts ou sont stockées les fournitures sont coupés de l'extérieur et le personnel logistique au QG de la force est bloqué à l'Hôtel Méridien malgré des tentatives de les amener à forcer le QG à fournir son appui à ce processus, étant donné que la majorité des combats se déroulent le long de la route. Selon une estimation optimiste, l'UNAMIR dispose des réserves suivantes :
A. Eau potable. 20 litres par homme. Cette eau est malheureusement située dans une réserve inaccessble pour la plupart des membres de la Force. La plupart des unités ont une réserve d'eau potable de 1 à 2 jours. Des mesures de rationnement ont été décrétées.
B. Eau à usage général. Les toilettes et les douches dans la plupart des localisations ne fonctionnent plus. L'eau à usage général sera bouillie en vue de pouvoir être bue et une quantité minimale sera utilisée à des fins d'hygiène. Cette situation est acceptable à court terme mais provoquera des problèmes de santé à long terme.
C. Rations. Les unités varient entre néant au QG de la force et 2 jours à RUTBAT. Des mesures de rationnement ont été décrétées. La force dispose d'une réserve de 3 jours par homme et la compagnie logistique à KIBAT d'une réserve de 10 jours par homme. Malheureusement, ces réserves se trouvent dans des endroits coupés de l'extérieur pour la plupart des unités. Si l'UNAMIR a accès à ces endroits, elle disposera de réserves de nourriture permettant de tenir un peu moins de deux semaines.
D. Carburant. Le carburant sera notre principale difficulté. La force dispose d'une réserve de 20 000 litres d'essence et de 40 000 litres de diesel à la compagnie logistique. Cet endroit est inaccessible pour la plupart des unités. La plupart des unités pensent disposer de réserves pour deux à trois jours. Comme l'électricité est coupée, les générateurs à carburant sont cruciaux pour fournir un éclairage limité, alimenter les radios et les pompes. Même moyennant un rationnement, les réserves seront épuisées en moins d'une semaine.
E. Munitions. Ce poste critique compte tenu de notre situation actuelle et de notre futur incertain est notre plus grande faiblesse. Un inventaire complet du stock est en cours et les chiffres ne sont pas encore disponibles. Cette mission ayant été conçue comme une opération de maintien de la paix, nous ne disposons que d'armes légères et d'une quantité très limitée de munitions pour armes légères. L'UNAMIR pourra se défendre pendant une durée limitée.
F. Réserves défensives. Ces réserves n'ont pas encore été fournies par le système d'appui des Nations Unies. Les unités de réserve sont épuisées. L'UNAMIR peut appliquer des mesures ad hoc à titre temporaire mais ne pourra pas assurer une défense à long terme.
G. Fournitures médicales. Déjà épuisées par les programmes d'aide à la population civile. L'utilisation des réserves d'unité pour le traitement de notre personnel avant le 6 avril et l'absence de réapprovisionnement de ces fournitures rendent la situation critique en cas de pertes lourdes. À titre conservatoire, nous avons cessé de fournir un traitement d'urgence à la population civile et nous les transférons à l'hôpital de Kigali.
H. Communications. Le réseau téléphonique local ne fonctionne plus. L'UNAMIR dispose d'un Inmarsat avec fax au QG et à KIBAT. Ce sont nos seuls liens avec le monde extérieur et ils sont protégés et entretenus comme réserves critiques de la mission.
I. Transport. L'UNAMIR souffrait déjà d'un manque de véhicules avant le début des hostilités. Cette situation s'est aggravée par la perte de véhicules, la pénurie de carburant prévue et l'indisponibilité des sources locales en raison du conflit. L'UNAMIR ne peut s'aéroporter, sans parler de toute personne supplémentaire. Nous disposons des ressources suffisantes pour des mouvements de navette à condition de disposer de carburant.
16. L'UNAMIR a été conçue, mise en place et développée logistiquement comme une force de maintien de la paix. Elle ne dispose donc pas de réserves d'articles cruciaux pour un scénario de conflit prolongé. De plus, une grande partie de ces réserves sont séparées des autres localisations en raison des difficultés d'hébergement à Kigali. L'aspect positif de la situation logistique est qu'environ la moitié de la force est hors de Kigali et qu'elle peut, au besoin, subvenir à ses besoins par l'intermédiaire de l'économie locale qui continue à fonctionner dans un calme relatif. L'UNAMIR consacrera une grande partie de ses efforts et de ses ressources à l'amélioration de notre capacité de subsistance mais il faut souligner que nous sommes confrontés à des pénuries critiques qui réduiront notre capacité et mettront la force en danger dans quelques jours.
17. Les dirigeants RGF ont demandé au FPR (via l'UNAMIR) de consentir à un cessez-le-feu et à un retrait (désengagement) étant donné qu'ils essaient d'obtenir la même chose de la Garde présidentielle. Nous avons passé le message au FPR qui nous a dit être prêt à signer un cessez-le-feu si la Garde présidentielle fait de même. Les négociations ont été freinées par la coupure du réseau téléphonique local. D'importantes échauffourées se poursuivent, les axes de communication sont bloqués, des barrages routiers barrent la route et empêchent tout mouvement dans la ville, les balles et cartouches perdues, les ricochets et parfois les tirs directs et indirects requièrent de prendre des mesures défensives et retardent les activités, en particulier les déplacement à pied ou à bord d'un véhicule non protégé. Nous essayons d'assurer la sécurité du QG de la force et de la zone du stade Amahoro pour en faire le point de départ de nos opérations, mais les combats en cours entre le FPR et la Garde présidentielle dans cette région ont empêché de mener cette opération à bien. (...) D'autres localisations à Kigali sont sur la défensive et ont réduit leurs activités au minimum et aux activités vitales ou de maintien de la paix.
18. Le FC de l'UNAMIR doit connaître les intentions des principaux pays concernant une évacuation éventuelle, en particulier des expatriés et des Nations Unies ou de l'UNAMIR. Nous avons une compagnie légère à l'aéroport mais nous ne contrôlons pas les routes et la sécurité n'est pas garantie sur le parcours jusqu'à l'aéroport. L'aéroport ne permet pas d'atterrir ou de décoller en sécurité étant donné que nous ne connaissons pas les instructions des forces adverses ni à qui va leur loyauté.
19. Le FC de l'UNAMIR a assisté à une réunion du comité de crise (...). Nous ne connaissons pas les détails de ce plan ni son calendrier d'exécution.
20. L'UNAMIR reste attachée à son mandat bien que la situation actuelle ne permette pas à notre mission de remplir les tâches qui nous ont été assignées ou pour lesquelles nous avons été créés. Mais il ne fait aucun doute que la situation à Kigali aurait été pire sans la présence de l'UNAMIR. Tous les efforts visent à présent à assurer notre propre protection, la survie et la sécurité des personnes clés du processus de paix, une aide humanitaire limitée et l'utilisation de toutes nos compétences pour amener les parties à un cessez-le-feu et à se rasseoir à la table de négociation pour faire avancer le processus politique.
21. Nous vous tiendrons informés de l'état d'avancement de la situation.
22. Bien à vous. »
Bruxelles n'a pas reçu ce rapport. Selon le major Maggen, c'est parce que le général Dallaire aurait rédigé lui-même ce situation report et « s'est opposé à la transmission d'une copie du rapport SITREP à Bruxelles. Il voulait que son SITREP soit uniquement envoyé à New York. » (80c)
Dans un télégramme daté du 7 avril 1994 adressé à Bruxelles et à différentes ambassades, M. Noterdaeme écrit :
« Selon l'analyse du général Dallaire, la menace vient de la garde présidentielle et de certains éléments des forces armées rwandaises (FAR)(...)
Le représentant du secrétaire général de l'ONU, M. Booh-Booh essaye d'établir un comité de crise englobant la Gendarmerie, la MINUAR, les FAR...
Selon Dallaire, au moins 3 soldats belges de la MINUAR ont été tués (le général a vu les corps). Dix autres soldats belges de la MINUAR sont toujours détenus (désarmés) par la garde présidentielle responsable du meurtre des 3 soldats belges.(...) L'aéroport et le C-130 belge qui s'y trouve, sont sous contrôle de la garde présidentielle et ne sont donc pas accessible à la MINUAR à Kigali, une partie du bataillon FPR se bat dans les rues. Dans la zone démilitarisée, des éléments armés du FPR (non qualifiés par le Secrétariat) se dirigent vers Kigali, ce qui accroît le risque d'une déflagration militaire majeure. » (81c)
Dans ces réponses écrites aux questions soumises par la commission le général Dallaire, celui-ci déclare: « Le 7 avril 1994, le commandant de la Force de la MINUAR était informé que RTLM faisait de la propagande anti-belge en déclarant que les gardiens de la paix belges de la MINUAR avaient aidé le FPR à abattre l'avion présidentiel. »
Lors d'une interview de la RTBF par téléphone d'un Belge qui vit au Rwanda, celui-ci décrit la situation en fin de matinée du 7 avril 1994 à 13 heures : « Chacun est claquemuré chez soi à la maison et entend des coups de feu, (...). Mais il est évident que l'insécurité est grande et nul ne sait de quoi sera faite la prochaine heure ». Ce même jour à 17 heures, la RTBF a en ligne Bernard Schijns, représentant de la Croix-Rouge à Kigali. Il déclare: « Ils cassent les fenêtres à coup de crosse, ils rentrent dans les maisons et liquident tout ce qui passe. Moi je n'ai évidemment pas vu directement ce qui se passait à l'intérieur puisque je me garde bien de sortir. Actuellement les militaires rwandais viennent d'investir mon stock qui se trouve juste en-dessous de ma maison où se trouve tous les ... et je ne sais absolument pas ce qui s'y passe. Ça tire dans tous les coins, des grenades explosent partout, la situation est très tendue. La MINUAR est complètement absente, nous nous sentons tout à fait non protégés et en grand danger. Voilà en clair mes impressions pour le moment. »
La journaliste Colette Braeckman a, elle aussi, tenté de rallier Kigali le 6 avril. Elle témoigne que les rumeurs anti-belges ont été répandues non seulement par RTLM, mais aussi par l'ambassade de France : « Le 6 avril, j'ai essayé d'aller à Kigali par le Burundi. Je me suis rendue à Butare et j'ai rencontré le premier convoi qui fuyait les tueurs de Kigali. Les Belges se sont fait passer pour des Anglais ou des Américains car ils avaient entendu les rumeurs anti-belges. Certains d'entre eux étaient bouleversés car des Tutsis avaient été retirés du convoi pour être assassinés. La rumeur disait que les Belges avait pris contact avec les ambassades belge et française pour connaître la situation exacte. À l'ambassade de France, une voix leur a dit que c'étaient des Belges qui avaient tiré sur l'avion du président. La rumeur anti-belge provenait donc de deux sources : les Français et la radio des Milles Collines. » (82c)
Le 8 avril à 8 heures, la RTBF, annonce : « Il y a eu des tueries entre Hutus et Tutsis hier, des règlements de compte, on ne connaît pas le bilan des victimes.(...) Pour le colonel Marchal, porte parole des Casques bleus belges sur place, les Rwandais vont régler les choses entre eux et les Casques bleus ne devront pas s'interposer entre les deux ethnies. »
Le climat anti-belge ne fait que de s'amplifier. Mme Els De Temmerman témoigne devant la commission :
« Le 10 avril, j'ai parcouru la ville avec un convoi français qui était chargé de l'évacuation. C'était le chaos, les rues étaient parsemées de vêtements et de cadavres (...) D'autres journalistes m'ont raconté qu'ils avaient été arrêtés et qu'on leur avait demandé, en leur mettant la machette sur la gorge, s'ils étaient Belges. Je voulais donc laisser tous les signes de ma nationalité à l'aéroport. Comme j'avais oublié de le faire, j'ai eu peur au cours du trajet avec le convoi français (...) Comme ma nationalité belge constituait un problème, je suis retournée avec les premières voitures (...) Un Néerlandais, Albert Broom, m'a accompagné dans l'avion. Il a quitté l'aéroport et a été tué. Des témoins ont signalé que le fait qu'il portait un gilet pare-balles belge y était pour quelque chose. J'ai néanmoins essayé de retourner. Un convoi de la Croix-Rouge a refusé de m'emmener au Rwanda en raison de ma nationalité belge (...) Vers le 9 mai, j'ai réservé à Nairobi une place dans un avion de l'ONU. Je me suis présentée comme étant Suédoise et je disposais d'un passeport suisse. Au dernier moment, on m'a débarquée de l'avion parce que mon nom était connu à Kigali et qu'on voulait m'assassiner ». (83c)
Quand on demande, le 20 juin, au cours de son troisième passage devant la commission, à l'ambassadeur Swinnen de procéder à une reconstitution des événements dramatiques des 6 et 7 avril, il souligne qu'il a refusé la protection du colonel Marchal pour la raison suivante :
« Devant la campagne anti-belge qui se déroulait alors de manière violente, j'ai pris la décision de ne pas accepter cette protection. Je craignais que, loin de nous apporter la sécurité, la présence de la MINUAR risque d'avoir l'effet contraire. »
(...) « La haine était crachée tous les jours sur les ondes de RTLM. A ce moment-là, la campagne anti-belge battait son plein et il était difficile de laisser les troupes belges sur place. » (84c)
| Datum. Date | Kigali | New York | Brussel. Bruxelles |
| Woensdag 6 april 1994. Mercredi 6 avril 1994. | Het presidentieel vliegtuig wordt 's avonds neergehaald (barricaden in de stad). L'avion présidentiel est abattu le soir (barricades dans la ville). | ||
| Donderdag 7 april 1994. Jeudi 7 avril 1994. | Tussen 9 en 13 uur. Entre 9 heures et 13 heures.
moord op 10 Belgische blauwhelmen assassinat des dix casques bleus Belges moord op eerste minister Agathe en andere Rwandese vooraanstaanden assassinat de la Première Ministre Agathe et de personnalités rwandaises Na 14 uur. Après 14 heures. Generaal Dallaire ontmoet kolonel Bagasora en de chef van de rijkswacht. Le général Dallaire rencontre le colonel Bagasora et le chef de la gendarmerie. Beiden wijzen erop dat de blauwhelmen gevaar lopen. Tous deux soulignent que les casques bleus courent un danger. 16 uur. 16 heures. het FPR verlaat de kampen en de gevechten barsten opnieuw los le FPR sort des camps et les combats reprennent telefonisch onderhoud tussen generaal Dallaire en Kofi Annan over de toestand ter plaatse (ten minste drie gedode Belgische soldaten...) entretien téléphonique entre le général Dallaire et M. Kofi Annan à propos de la situation sur place (au moins trois soldats Belges tués...) |
11.30 uur (plaatselijke tijd). 11 h 30 (heure locale).
onderhoud tussen Kofi Annan en ambassadeur Noterdaeme entretien entre Kofi Annan et M. Noterdaeme schriftelijk verslag in telegram 94/00623 rapport écrit télégramme 94/00623 |
Voormiddag. Avant-midi.
Vergadering op Buitenlandse Zaken. Réunion avec les Affaires étrangères. de toestand in Rwanda maar ook in Burundi is zeer gespannen situation tendue au Rwanda-Burundi eerste maatregelen in verband met de crisissituatie worden getroffen prise des premières mesures situation de crise er wordt een nota doorgefaxt aan minister Claes die in Boekarest is note transmise au ministre Claes qui se trouve à Bucarest 12.46 uur. 12 h 46. Telex van minister Claes (452) naar Washington. Télex du ministre Claes (452) à Washington 17.29 uur. 17 h 29. Ontvangst telegram DELBELONU van ambassadeur Noterdaeme : Réception télégramme DELBEL-ONU de M. Noterdaeme : drie Belgische soldaten vermoord trois soldats Belges assassinés de presidentiële wacht houdt tien (ontwapende) soldaten gevangen dix retenus (désarmés) par la garde présidentielle vlieghaven + Belgische C 130 in handen van de presidentiële wacht aéroport + le C 130 belge aux mains de la garde présidentielle |
| 20.40 uur. 20 h 40.
de Belgische autoriteiten vernemen de moord op de tien Belgische blauwhelmen les autorités Belges apprennent la mort des dix casques bleus Belges (CRA p. 3) |
|||
| 21.20 uur. 21 h 20.
Vergadering van het kernkabinet (voorgezeten door min. Van Rompuy). Réunion cabinet restreint (présidence min. Van Rompuy). reactie op de dood van de tien para's en op de vermoedelijke dood van drie burgers (te Gisenyi) réaction à la suite de la mort des dix paras et de sans doute trois civils (à Gisenyi) Buitenlandse Zaken moet contact opnemen met de VN om de veiligheid van de Belgen te waarborgen les Affaires étrangères doivent prendre contact avec l'ONU pour assurer la sécurité des Belges |
|||
| 22.30 uur. 22 h 30.
Informatie van SGR (3692 verslag ad hoc blz. 129). Information du SGR (3692 rapport ad hoc p. 129). talrijke slachtpartijen nombreux massacres |
|||
| 23.12 uur (Belgische tijd). 23 h 12 (heure belge).
Washington. Washington. laat weten dat de USA hun ambassadepersoneel willen terugroepen (doc. SGR 4158 verslag ad hoc blz. 129) fait savoir que les USA veulent rappeler leur personnel d'ambassade (doc. SGR 4158 rapport ad hoc p. 129) vraagt wijziging van de ROE teneinde de buitenlanders te beschermen demande modification des ROE pour protéger les étrangers |
|||
| Vrijdag 8 april 1994. Vendredi 8 avril 1994. | Code cable van de heer Booh-Booh naar de heer Kofi Annan : UNAMIR bevindt zich in een kritieke toestand : « This is a defensive survival exercice for UNAMIR » Code cable de M. Booh-Booh à M. Kofi Annan : La MINUAR se trouve dans une situation critique :
« This is a defensive survival exercice for UNAMIR ». 12.30 uur-14.15 uur. 12 h 30-14 h 15. aankomst van de RPF-troepen in Kigali (zij bevonden zich op 25 km) arrivée des troupes FPR dans Kigali (elles se trouvaient à 25 km) |
Sitrep. van de militaire attaché van de Franse ambassade in Washington overgemaakt aan SGR waarin melding wordt gemaakt van slachtingen, binnen en buiten Kigali, van Tutsi's en van opposanten van het Rwandese regime. Sitrep. de l'attaché militaire de l'Ambassade française à Washington transmis au SGR qui fait état de massacres à l'intérieur et à l'extérieur de Kigali, commis contre des Tutsis et des opposants au régime rwandais.
00.06 GMT. 00 h 06 GMT. Telex van N.Y. naar ambassadeur Noterdaeme. Télex de N.Y. à l'ambassadeur Noterdaeme. |
De minister van Buitenlandse Zaken heeft deze code cable niet ontvangen (BV minister Claes 24.06.1997, blz. 838). Le ministre des Affaires étrangères n'a pas reçu ce code cable (CRA M. Claes 24.06.1997, p. 820).
15 uur-17 uur. 15 heures17 heures. Kernkabinet onder het voorzitterschap van premier Dehaene luitenant-generaal Charlier is aanwezig. Cabinet restreint - Présidence M. Dehaene le lieutenant général Charlier est présent. beslissing om de Belgische burgers te evacueren décision d'évacuer les civils belges |
| gevechten-plunderingen moorden combats-pillage assassinats
In de namiddag. Dans l'après-midi. de Belgen mogen hun huis niet verlaten les Belges ne peuvent pas quitter leur maison generaal Dallaire kan de ambassadeurs geen escorte bezorgen le général Dallaire ne peut pas fournir d'escortes aux ambassadeurs vergadering van acht MRND-ministers bij de Franse ambassadeur om een burgerregering te vormen réunion de huit ministres MRND chez l'ambassadeur de France pour former un gouvernement civil de troepen van KIBAT hebben zich geleidelijk teruggeplooid en gehergroepeerd in een kleiner aantal kantonnementen les troupes de KIBAT se sont progressivement repliées et regroupées dans un nombre plus limité de cantonnements |
de Veiligheidsraad wijzigt het mandaat niet le Conseil de sécurité ne transformera pas le mandat.
hij stelt zich vragen over het nut in de gegeven omstandigheden van het behoud van UNAMIR il s'interroge sur l'utilité dans les circonstances actuelles du maintien de la MINUAR. 17.20 uur. 17 h 20. Versturen telex 633. Envoi du télex 633 18.19 GMT. 18 h 19 GMT. Telex van Noterdaeme naar Brussel (190) : « UNO denkt aan evacuatie van hun burgerpersoneel indien Brussel de beslissing tot evacuatie neemt ». Télex de Noterdaeme à Bruxelles (190) : « ONU pense évacuer son personnel civil si une décision d'évacuation devait être prise à Bruxelles ». |
vraag aan Boutros Ghali om het mandaat uit te breiden en MINUAR te versterken maar niet met Belgische troepen demande à M. Boutros Ghali d'élargir le mandat et de renforcer la MINUAR mais pas par des troupes Belges 17.52 uur. 17 h 52. Bericht uit New York : « Rwanda verzet zich tegen Belgische interventie » (geruchten suggereren de betrokkenheid van de Belgen bij de aanslag op het vliegtuig) « Garde présidentielle ne permet pas aux Belges d'utiliser aéroport de Kigali » « attitude plus conciliante vis-à-vis des Français » (Telex DELBELONU van ambassadeur Noterdaeme). Message en provenance de New York : « Le Rwanda s'oppose à l'intervention belge » (rumeur implication des Belges dans l'attentat de l'avion) « Garde présidentielle ne permet pas aux Belges d'utiliser aéroport de Kigali » « attitude plus conciliante vis-à-vis des Français » (Télex DELBELONU de l'ambassadeur Noterdaeme) (633). |
|
| 22.30 uur GMT. 22 h 30 GMT.
Telex 676 van ambassadeur Noterdaeme naar Minafet verslag gesprek met Kofi Annam die zegt : Télex 676 de Noterdaeme à Minafet Rapport conversation avec Kofi Annan qui dit : geen evacuatie via UNAMIR want te duur pas dévacuation via la MINUAR car trop cher nationaal optreden is mogelijk doch in overleg met VN. intervention nationale est possible si coordonnée avec l'ONU |
|||
| Zaterdag 9 april 1994. Samedi 9 avril 1994 | 3.43 uur. 3 h 43.
de eerste Franse militairen landen in Kigali les premiers militaires français atterrissent à Kigali |
Ochtend. Matin.
zeven C130 vertrekken naar Nairobi sept C130 partent pour Nairobi |
|
| 7 uur. 7 heures.
het RPF zet het offensief in in het noorden le FPR passe à l'offensive dans le nord |
17.45 uur. 17 h 45.
Futur de la MINUAR sera discuté la semaine prochaine « Le Nigeria a cependant relevé la nécessité de maintenir et de renforcer la MINUAR » Futur de la MINUAR sera discuté la semaine prochaine « Le Nigeria a cependant relevé la nécessité de maintenir et de renforcer la MINUAR » |
16.30 uur. 16 h 30.
twee Boeing 727 met militairen deux Boeing 727 avec des militaires |
|
| De blauwhelmen hergroeperen zich en doen tal van evacuaties. Les casques bleus se regroupent et procèdent à de nombreuses évacuations. | 20.50 uur. 20 h 50.
één Boeing 727 un Boeing 727 |
||
| Zondag 10 april 1994. Dimanche 10 avril 1994. | Het RPF deelt mee dat het de stad Kigali bezet en dat in geval van een nederlaag (van het RPF) de Belgen in gevaar zijn. Le FPR fait savoir qu'il occupe la ville et signale qu'en cas de défaite (du FPR) les Belges seront en danger. | 10 uur-12 uur. 10 heures à 12 heures.
Kernkabinet maakt een stand van zaken op over de evacuatie. Cabinet restreint fait le point sur l'évacuation. |
|
| 14.43 uur. 14 h 43
de Belgische vliegtuigen krijgen toestemming om te landen autorisation pour les avions Belges d'atterir |
|||
| 16.45 uur. 16 h 45.
eerste C130 landt premier C130 atterrit |
|||
| 's avonds. le soir.
aankomst van 250 para's in Kigali arrivée de 250 paras à Kigali |
|||
| Maandag 11 april 1994. Lundi 11 avril 1994. | de evacuatieoperatie is aan de gang opération évacuation en cours
alle blauwhelmen worden gehergroepeerd op de luchthaven tous les casques bleus sont regroupés à l'aéroport de Fransen kondigen aan dat zij zich zullen terugtrekken vanaf 18 uur (bericht uit Ambabel Nairobi) les Français annoncent qu'ils se retireront à partir de 18 heures (message d'Ambabel Nairobi) slachtpartijen in Don Bosco massacres à Don Bosco |
4.15 uur. 4 h 15.
Aankomst van de eerste expats in Brussel. Arrivée des premiers expatriés à Bruxelles. 10 uur-12 uur. 10 heures à 12 heures. Kernkabinet Cabinet restreint 400 para's ter plaatse 400 paras sur place de minister van Buitenlandse Zaken wordt verzocht Boutros Ghali te ontmoeten naar aanleiding van zijn rondreis in Europa le ministre des Affaires étrangères est invité à rencontrer M. Boutros Ghali à l'occasion de sa visite en Europe |
|
| 14 uur. 14 heures.
Debat in de Kamer Débat à la Chambre Premier Dehaene legt uit dat de regering geen eenzijdige maatregelen t.o.v. de VN zal nemen, maar dat niet langer aan de voorwaarden is voldaan om de Belgische troepen in Rwanda te houden. M. Dehaene dit « que le gouvernement ne prendra pas de mesures unilatérales à l'égard de l'ONU, mais que les conditions pour le maintien des troupes Belges ne sont plus réunies ». |
|||
| Dinsdag 12 april 1994. Mardi 12 avril 1994. | ultimatum van het FPR (de Belgen hebben 60 uren om zich terug te trekken) (telex 227 van Nairobi). ultimatum du FPR (60 heures pour se retirer) (télex 227 de Nairobi)
14.30 uur. 14 h 30. Telefoongesprek tussen ambassadeur Swinnen, minister Claes en de heer Roelants. Entretien téléphonique entre MM. Swinnen, Claes et Roelants. Sluiting van de Belgische ambassade. Fermeture de l'Ambassade belge. 16.17 uur. 16 h 17. De UNAMIR verkrijgt van FAR en RPF de toelating om de buitenlanders gedurende 48 uren te evacueren (er is geen staakt-het-vuren). La MINUAR obtient des FAR et du FPR l'autorisation d'évacuer les étrangers pendant 48 heures (ce n'est pas un cessez-le-feu). |
15.27 uur. 15 h 27 GMT.
Telegram uit New York van Noterdaeme die rapporteert over Amerikaanse houding : Télégramme de New York de Noterdaeme faisant rapport sur l'attitude américaine : UNAMIR kan mandaat niet vervullen la MINUAR ne peut pas remplir son contrat UNAMIR moet zich uit Rwanda terugtrekken la MINUAR doit évacuer le Rwanda 16.17 uur GMT. 16 h 17 GMT Bericht via DELBELONU uit New York en van het Secr. gen. Message par l'intermédiaire de DELBELONU à New York et du Secr. gén. de interimregering verlaat Kigali « as fighting between the armed forces and the RPF intensified » le gouvernement intérimaire quitte Kigali « as fighting between the amed forces and the RPF intensified » |
9.40 uur. 9 h 40.
SGR bericht over massale slachtingen probleem Don Bosco wordt gemeld (SGR 3664). Le SGR fait état de massacres; l'on mentionne le problème de Don Bosco (SGR 3664). 10.30 uur-12.30 uur. 10 h 3012 h 30. Kernkabinet in aanwezigheid van de ministers Delcroix en Derycke. Cabinet restreint en présence de MM. Delcroix et Derycke. beslissing dat minister Claes de ambassade mag sluiten décide que M. Claes pourra fermer l'ambassade voorbereiding van de ontmoeting Claes-Boutros Ghali te Bonn (terugtrekking van de Belgische troepen) préparation de la rencontre de M. Claes avec M. Boutros Ghali à Bonn (retrait des troupes Belges) er wordt een telex gestuurd naar de ambassade te Washington (nr. 181) waarin het standpunt van België over UNAMIR wordt uitgelegd |
| 17 uur GMT. 17 heures GMT.
Bericht DELBELONU New York : « Le secrétariat ne devrait recevoir que demain l'évaluation relative à la sécurité de la MINUAR que le représentant Booh-Booh et le général Dallaire devraient lui soumettre » (telex 327). Message DELBELONU New York: « Le secrétariat ne devrait recevoir que demain l'évaluation relative à la sécurité de la MINUAR que le représentant Booh-Booh et le général Dallaire devraient lui soumettre » (télex 327). 's avonds. Le soir. Uit Washington komt nog een precisering van de Amerikaanse houding (telex 1479). Un télégramme de Washington précise l'attitude américaine (télex 1479) de VS volgen de houding van de troepenleveranciers ook in hun wens om hun troepen terug te trekken les USA partagent le point de vue des pays qui fournissent des troupes et qui souhaitent retirer celles-ci |
envoi à l'ambassade de Washington d'un télex (nt 181) expliquant le point de vue de la Belgique concernant la MINUAR
Te Bonn : ontmoeting tussen minister Claes en Boutros Ghali À Bonn : rencontre entre M. Claes et M. Boutros Ghali. minister Claes pleit voor terugtrekking : le ministre Claes développe les arguments en faveur du retrait : UNAMIR-aanwezigheid is zinloos geworden la MINUAR est devenue sans objet UNAMIR is in gevaar la MINUAR est en danger er heerst een anti-Belgisch klimaat il règne un climat anti-belge Claes stelt dus voor de gehele UNAMIR terug te trekken donc propose la suspension et le retrait de la MINUAR De heer Boutros Ghali : « Je partage votre analyse » M. Boutros Ghali : « Je partage votre analyse » |
||
| Woensdag 13 april 1994. Mercredi 13 avril 1994. | brief van Boutros Ghali aan de Veiligheidsraad verslag van zijn gesprek met minister Claes (Blue Book blz. 259) : « puisque les Belges s'en vont et que je me rends compte que je ne pourrai pas les remplacer, j'en tire toutes les conséquences »
lettre de M. Boutros Ghali au Conseil de sécurité concernant les arguments développés en vue d'un éventuel retrait de la MINUAR rapport de sa conservation avec M. Claes (Bleu Book p. 259) : « puisque les Belges s'en vont et que je me rends compte que je ne pourrai pas les remplacer, j'en tire toutes les conséquences »
brief van de Belgische permanente vertegenwoordiger gericht aan de voorzitter van de Veiligheidsraad van de VN : kondigt de evacuatieoperatie aan. lettre du représentant permanent belge au président du Conseil de sécurité des Nations unies : annonce l'opération d'évacuation 23.57 uur. 23 h 57. Telegram Noterdaeme nr. 674 : Télégramme Noterdaeme nº 674 |
Kernkabinet in afwezigheid van minister Claes. Cabinet restreint en l'absence de M. Claes
er wordt gevraagd de diplomatieke inspanningen om de opschorting van het mandaat te verkrijgen te intensifiëren (BV vergadering van het kernkabinet van 13.4.1994) demande d'intensifier les efforts diplomatiques pour aboutir à la suspension du mandat (CRA réunion du cabinet restreint 13.4.1994). |
|
| Donderdag 14 april 1994. Jeudi 14 avril 1994 | Ultimatum van de h. Booh-Booh aan de stafchef van FAR (onmiddellijke hervatting van de onderhandelingen over de Arusha-akkoorden). Ultimatum de M. Booh-Booh au chef d'État major des FAR (reprise immédiate des négociations sur les accords d'Arusha).
Namiddag. Après-midi. Vergadering in hotel Méridien generaal Dallaire met FAR en FPR. Réunion à l'hôtel Méridien général Dallaire avec FAR et FPR. Gevechten met zware wapens te Kigali. Combats à l'arme lourde à Kigali. |
Geen beslissing van de Veiligheidsraad over de toekomst van UNAMIR er zijn slechts informele vergaderingen. Pas de décision du Conseil de sécurité sur l'avenir de la MINUAR des réunions ne sont qu'informelles.
Boutros Ghali legt de Veiligheidsraad twee opties voor : M. Boutros Ghali soumet deux options au Conseil de sécurité : een beperkte kern (zonder de Belgen) behouden voor een beperkte periode maintenir un noyeau (sans les Belges) pour une période limitée totale terugtrekking met behoud van een vertegenwoordiger van de VN en de « Force commander » die als tussenpersonen kunnen optreden bij onderhandelingen retrait total avec maintien d'un représentant de l'ONU et le Force commander pour servir d'intermédiaire dans les négociations Beide opties veronderstellen een staakt-het-vuren. Ces deux options supposent un cessez-le-feu. |
8.30 uur-10.30 uur. 8 h. 3010 h 30.
Kernkabinet. Cabinet restreint. bespreking van de diplomatieke besprekingen die plaatshebben in de Veiligheidsraad commentaire des discussions diplomatiques qui ont lieu au sein du Conseil de sécurité de VN overwegen het behoud van een kleine troepenmacht om de vrede te handhaven en vragen België te zorgen voor logistiek en experts. Het kernkabinet weigert om experts ter plaatse te houden maar aanvaardt voor logistiek te zorgen. les Nations unies envisagent un maintien d'un noyau pour maintenir la paix et demanderaient à la Belgique de fournir du matériel et des experts. On exclut de maintenir sur place des experts mais on accepte de fournir le matériel 16.30 uur-17.30 uur. 16 h 3017 h 30. Kernkabinet. Cabinet restreint. men bestudeert de mogelijke evacuatie van UNAMIR on étudie l'évacuation possible de la MINUAR minister Claes deelt mee dat de meeste leden van de Veiligheidsraad het Belgische standpunt goedkeuren le ministre Claes fait savoir que la plupart des pays membres du Conseil de sécurité approuvent le point de vue de la Belgique |
| Vrijdag 15 april 1964. Vendredi 15 avril 1994. | 12 uur. 12 heures.
de evacuatie van de burgers is beëindigd évacuation des civils est terminée de Belgische interventiemacht zit in Nairobi la force d'intervention belge se trouve à Nairobi de toestand is zeer moeilijk geen staakt-het-vuren la situation est très difficile Pas de cessez-le-feu de UNAMIR en het vliegveld worden verder beschoten la MINUAR et l'aérodrome sont toujours pris pour cible |
Vergadering van de Veiligheidsraad. Réunion du Conseil de sécurité. | 9.30 uur-10.30 uur. 9 h 30 à 10 h 30.
Kernkabinet. Cabinet restreint. de minister van Buitenlandse Zaken wordt gevraagd een brief te schrijven naar de secretaris-generaal van de VN en naar de Veiligheidsraad waarin gezegd wordt dat het mandaat zinloos is geworden en dat het niet langer mogelijk is voor de Belgische troepen om deel te nemen aan die operatie (brief Blue Book, blz. 261) le ministre des Affaires étrangères est chargé d'écrire au secrétaire général et au Conseil de sécurité que le mandat est devenu inutile et qu'il n'est plus possible pour les troupes Belges de participer à cette opération (lettre Blue Book p. 261) |
| de minister van Landsverdediging krijgt de opdracht contact op te nemen met generaal Dallaire en met kolonel Marchal om de terugtrekking van de Belgische blauwhelmen voor te bereiden. le ministre de la Défense doit se charger de prendre contact avec le général Dallaire et le colonel Marchal pour préparer le retrait des Casques bleus Belges | |||
| 10.39 uur. 10 h 39.
Minister Claes stuurt een telegram (402) naar de betrokken ambassadeurs om de beslissing tot terugtrekking uit te leggen en verspreidt daarna een perscommuniqué. Le ministre Claes envoie un télégramme (402) aux ambassaseurs concernés pour expliquer la décision du retrait et puis il diffuse un communiqué de presse. |
|||
| Ambassadeur Noterdaeme brengt verslag uit over de besprekingen die in de Veiligheidsraad hebben plaatsgehad (telex 691 van New York van 16.04.94). L'ambassadeur Noterdaeme fait rapport des discussions qui ont eu lieu au Conseil de sécurité (télex nº 691 de New York du 16.04.94). | 14 uur-15 uur. 14 heures 15 heures
Kernkabinet. Cabinet restreint. neemt kennis van de beslissingen van de Veiligheidsraad « Council members took note of and fully understood Belgium's decision to withdraw its troops UNAMIR at the same time that it is repatriating troops that have been providing security for the evacuation of foreign nationals » prend connaissance des décisions du Conseil de sécurité « Council members took note of and fully understood Belgium's decision to withdraw its troops UNAMIR at the same time that it is repatriating troops that have been providing security for the evacuation of foreign nationals » |
||
| Zaterdag 19 en zondag 20 april 1994. Samedi 19 et dimanche 20 avril 1994. | Evacuatie van de Belgische blauwhelmen. Évacuation des casques bleus Belges | ||
| Maandag 21 april 1994. Lundi 21 avril 1994. | De Veiligheidsraad neemt zijn beslissing en keurt resolutie 912 goed die UNAMIR reduceert tot een symbolische aanwezigheid in Kigali Le Conseil de sécurité prend sa décision et adopte la résolution 912 qui réduit la MINUAR à une présence symbolique à Kigali. |
Suite aux événements du 6 avril 1994, le gouvernement belge a été amené à prendre une série de décisions. On a vu la chronologie de celles-ci. En synthèse, il a décidé l'évacuation des ressortissants civils belges, en insistant auprès du Secrétaire général de l'ONU pour que la sécurité des forces de l'ONU soit renforcée. Il a ensuite décidé de retirer les troupes belges participant à la MINUAR.
3.8.3.1. Les tentatives de modifier le mandat et l'évacuation des ressortissants
Suite à l'attentat qui a entraîné la mort du président Habyarimana, le ministre Claes adresse à Washington et à New York le 7 avril 1994 à 12 heures 46 GMT (soit avant d'avoir en connaissance de la mort des 10 paracommandos) le télex suivant :
« 1. En raison de l'insécurité actuelle à Kigali, le personnel de l'ambassade ne peut pas atteindre le bâtiment de la chancellerie. Dès que ce sera possible, l'on pourra faire rapport des événements par télex à intervalles réguliers.
2. Il n'est pas exclu que l'attentat commis le 6 avril 1994 contre l'avion dans lequel se trouvaient les présidents du Rwanda et du Burundi débouche sur un coup d'état militaire ou sur des massacres généralisés entre les différents rivaux.
S'il devait y avoir de nombreux morts, l'opinion publique ne comprendrait pas que la MINUAR reste passive, se réfugiant derrière la limitation de son mandat.
3. J'apprécierais que Washington, New York et Paris interrogent les autorités respectives au sujet de leur point de vue sur le rôle que devrait jouer la MINUAR dans une telle hypothèse.
4. J'estime que la MINUAR doit pouvoir, sur la base des listes existantes des hommes politiques connus au Rwanda, offrir une protection aux intéressés sans pour cela prendre parti.
Force est de se demander si ceci sera en accord avec le mandat tel qu'il figure aux points 3a et c de la résolution 872, qui sont rédigés comme suit :
a. Contribuer à assurer la sécurité de la ville de Kigali, notamment à l'intérieur de la zone libre d'armes établie par les parties s'étendant dans la ville et dans ses alentours;
c. Superviser les conditions de la sécurité générale dans le pays pendant la période terminale du mandat du gouvernement de transition, jusqu'aux élections.
5. J'aimerais également connaître l'avis de l'ONU sur la possibilité, pour la Belgique, de faire appel de manière bilatérale aux casques bleus belges afin de prêter assistance, si nécessaire, aux Belges et aux étrangers en danger, par exemple en cas d'évacuation.
En effet, il ne semble pas possible, si la sécurité des Belges était effectivement menacée, que les militaires belges ne prêtent pas assistance à leurs compatriotes en danger. » (traduction) (85c)
Moins de cinq heures après, soit à 17 h 29 GMT, parvient la réponse de notre délégué permanant aux Nations Unies, M. Noterdaeme.
« 1. En l'absence du Secrétaire général et conformément à vos instructions, j'ai recontré ce matin à 11 h 30 le secgen adjoint chargé du Peacekeeping, M. Kofi Annan. Son adjoint, le sous-secgen Riza, venait d'avoir eu le général Dallaire en ligne et disposait donc de renseignements de première main.
2. Selon l'analyse du général Dallaire, la menace principale vient de la Garde présidentielle et de certains éléments des forces armées rwandaises (FAR). La gendarmerie serait restée loyale et tenterait de calmer le jeu. Le représentant personnel du Secgen, Booh-Booh, essaye d'établir un Comité de crise englobant la gendarmerie, la MINUAR, les FAR...
3. Selon Dallaire, au moins 3 soldats belges de la MINUAR ont été tués (général Dallaire a vu les corps). 110 autres soldats belges de la MINUAR sont toujours détenus (désarmés) par la Garde présidentielle responsable du meurtre des 3 soldats belges. Dallaire n'a pas été autorisé à contacter ces 10 autres soldats. Le Premier ministre, dont la protection était assurée par ces 13 soldats belges, aurait également été tuée (mais cela n'est pas confirmé).
4. L'Aéroport et le C-130 belge qui s'y trouve sont sous contrôle de la Garde présidentielle et ne sont donc pas accessibles à la MINUAR. À Kigali, une partie du bataillon FPR se bat dans les rues. Dans la zone démilitarisée, des éléments armés du FPR (non quantifiés par le secrétariat) se dirigent vers Kigali, ce qui accroit le risque d'une déflagration militaire majeure.
5. J'ai posé à M. Kofi Annan les questions contenues dans VT 452.
5.1. Protection des politiciens rwandais.
Bien que cela ne fasse pas partie du mandat, la MINUAR, dans la limite de ses moyens, se chargera de protéger les politiciens. Cette protection a d'ailleurs déjà débuté puisque le Premier ministre était protégée par des soldats belges de la MINUAR. De même, Kofi Annan estime que la MINUAR fera tout ce qui est en son pouvoir pour essayer de prévenir ou de diminuer les massacres.
5.2. Rôle des Casques bleus belges pour venir en aide aux civils belges (assistance ou évacuation).
Kofi Annan a clairement rapelé que toute décision en la matière ne peut être prise que par le commandant de la Force, le général Dallaire. C'est à lui et à lui seul qu'il appartient d'évaluer la situation et de décider, en fonction de nombreux paramètres, ce qui est faisable. Ces paramètres sont principalement liés à la sécurité des soldats de la MINUAR. En d'autres termes, il évitera de créer une situation risquant d'engendrer des représailles pouvant compromettre la sécurité ou la vie des Casques bleus. Annan a cependant déjà donné instruction au général Dallaire de prendre contact avec notre Ambassadeur à Kigali afin d'étudier avec lui la coopération possible entre la MINUAR et officiels belges pour l'éventuelle évacuation des civils.
Kofi Annan a rappelé que tout ce qui précède ne peut se faire que dans le cadre des règles d'engagement existantes. Ces règles d'engagement, comme c'est le cas pour toute opération de maintien de la paix n'étant pas sous chapitre VII, n'autorisent à tirer qu'en cas d'auto-défense. Il n'est donc pas possible pour les Casques bleus d'intervenir de manière offensive, s'ils ne sont pas eux-mêmes menacés, pour sauver des Belges. Par contre, sous les ordres de Dallaire, ils pourraient intervenir pour libérer des Belges dans le cadre de « négociations pacifiques » avec les parties.
5.3. Renforcement du mandat de la MINUAR.
Le renforcement du mandat des Casques bleus pourrait impliquer deux types de décisions : un renforcement en effectifs de la MINUAR pour la mettre mieux à même de faire face à la nouvelle situation et une modification du mandat permettant une attitude plus offensive. Ce renforcement prendrait des jours car il implique une décision du Conseil de Sécurité. Il ne faut pas oublier qu'il n'est pas aisé de passer à une opération sous le chapitre VII. Une semblable décision modifierait, en effet, complètement l'environnement de l'opération originale qui n'était déjà appuyée que du bout des lèvres par les Américains, les Britanniques et les Russes et qui ne dispose que de moyens défensifs. On ne peut, de plus, oublier qu'il faudrait l'accord des Gouvernements des pays-contributeurs de troupes (Ghana, Bangladesh...). Enfin, il serait politiquement délicat de limiter cette extension du mandat à la protection d'étrangers. Elle devrait bien sûr concerner l'ensemble de la population rwandaise.
5.4. J'ai bien sûr souligné auprès de Kofi Annan les pressions insupportables de l'opinion publique belge au cas où le massacre de Belges se poursuivrait. Àcet égard, je l'ai sondé informellement sur une éventuelle décision belge d'envoyer unilatéralement un bataillon de Belgique. Kofi Annan n'a pas rejeté cette idée. Il a évidemment souligné l'importance dans une telle hypothèse d'une coordination très étroite entre le bataillon belge, qui aurait pour mission de protéger et éventuellement d'évacuer la colonie internationale, et la MINUAR, qui a évidemment d'autres priorités » (86c).
Au niveau administratif, les services compétents des Affaires étrangères se réunissent, ce même jour, sous la présidence du secrétaire général.
À la fin de cette réunion, une note informative est établie à l'attention du ministre Claes à Bucarest.
« Iº Kigali
1. Personnel
Ceux qui sont en congé sont rappelés.
Cela concerne : Le nº 2 Colyn.
Le chancelier Fonteyn.
L'ambassadeur doit rappeler le personnel local s'il est en congé sur place.
2. Communication
Vu les tirs, il n'y a personne à la chancellerie.
Le département a un contact téléphonique avec l'ambassadeur.
On lui demandera s'il peut envoyer quelqu'un à la chancellerie pour assurer de la radio.
3. Nombre de Belges au Rwanda
1 520 dont : 38 ayant un lien avec l'ambassade;
78 militaires;
324 ayant un lien avec l'AGCD;
214 religieux;
240 ayant un lien avec les ONG
890
+ 630 autres
1 520 Belges
4. Liaisons
Aujourd'hui, il y a un avion de ligne normal de la Sabena à Bujumbura;
Un C-130 se trouve à Nairobi;
Les routes de sortie mènent :
- Au Burundi;
- À la Tanzanie;
- Au Zaïre (Goma).
5. Les postes en Tanzanie et au Kenya sont mis en « stand-by ».
6. Il est pris contact avec Kinshasa (l'ambassadeur Coenen) pour voir comment il pourrait obtenir du personnel à Goma si des Belges devaient y avoir besoin d'aide.
7. En Tanzanie, il n'y a qu'un chancelier. L'ambassadeur est en congé de maladie à cause d'un arrêt cardiaque. Maricou est mis en stand-by pour éventuellement se rendre en Tanzanie.
IIº Burundi
Les congés sont supprimés.
Belges présents : 1 370.
IIIº Généralités
1. Il faut élaborer immédiatement des instructions à l'intention de Kigali et de Bujumbura concernant l'attitude à adopter à l'égard des demandeurs d'asile.
2. Il faut mettre un briefing clair à la disposition du service de presse concernant leur rôle.
3. Le centre de crise doit être mis en stand-by. Il faut établir des listes de permanence pour les week-ends également et contrôler le matériel, pour qu'il puisse fonctionner immédiatement.
4. Il faut définir une ligne de décision politique. C'est surtout important en cas de grands massacres. » (traduction) (87c)
Le 7 avril à 21 h 30, le Conseil des ministres se réunit d'urgence sous la présidence du vice-Premier ministre, M. Van Rompuy.
Le Gouvernement s'est immédiatement rendu compte de la gravité de la situation et s'est préoccupé principalement de la sécurité des ressortissants belges : il adopte la déclaration suivante :
« 1. Le communiqué ci-joint est adopté.
2. Le ministre de la Défense est chargé de prendre les mesures nécessaires pour préparer un départ éventuel pour le Rwanda, à court terme, des militaires belges. Ces derniers seraient engagés au cas où la vie de ressortissants belges serait davantage menacée.
3. Le ministre des Affaires étrangères est chargé d'intervenir immédiatement auprès des Nations unies pour que les troupes belges au Rwanda puissent intervenir en vue de garantir la sécurité des ressortissants belges.
4. L'on demande au commandant des troupes belges de l'ONU au Rwanda de se préparer à assurer du mieux possible la protection des Belges. » (88c)
Le 8 avril, à 0 heure 06 GMT, M. Noterdaeme adresse au Ministre Claes le télex (89c) suivant :
« 1. Le Conseil de sécurité a adopté ce soir une déclaration présidentielle relative aux récents événements survenus au Rwanda. Cette déclaration invite le Secrétaire général à faire rapport au plus tôt au Conseil sur les circonstances ayant entraîné la mort des Présidents du Burundi et du Rwanda.
Le Conseil condamne la reprise des combats au Rwanda et la mort des 10 soldats belges.
Il demande aux forces armées rwandaises et aux autres factions que toutes les mesures soient prises pour renforcer la sécurité à travers le pays.
Le Conseil, extrêmement préoccupé, demande au Secrétaire général de faire rapport et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du personnel de l'ONU.
Enfin le Conseil appelle toutes les parties et factions à ne pas recourir à la violence et à respecter la sécurité de la population civile et des communautés étrangeres vivant au Rwanda.
2. Suite à ma discussion avec le Secrétaire général de notre Département, je vais essayer de vous redessiner le cadre conceptuel dans lequel pensent et agissent les diplomates de l'ONU. La MINUAR est une opération de maintien de la paix. Les Nations Unies ont ainsi 17 opérations de maintien de la paix regroupant 70 000 peacekeepers. Les mandats de ces opérations, à de très rares exceptions près, confient aux casques bleus le maintien de la paix dans le cadre d'un processus de paix agréé par les parties. Pour respecter sa mission, l'ONU est donc amenée à observer une neutralité maximale. On a vu, en Somalie (une opération pourtant sous le Chapitre VII), où pouvait mener une politique trop volontariste faisant fi de cet objectif de neutralité.
En d'autres termes, l'ONU a toujours adopté une gestion prudente en matière de maintien de la paix et ce pour au moins 4 raisons :
éviter de créer dans une opération un précédent qui ne manquerait pas d'avoir des répercussions sur d'autres opérations de maintien de la paix (OPM);
éviter de prendre position contre une partie, sous peine de perdre sa neutralité et d'etre mis dans une position militaire difficile;
s'agissant d'OPM, elles sont en effet équipées de faibles moyens défensifs et constituées pour observer et établir la confiance plutôt que pour des missions offensives;
tout risque inconsidéré en la matière peut donc mettre les casques bleus dans une position difficile vis-à-vis de parties supérieures en nombres et en armes.
3. C'est dans ce contexte qu'il faut analyser l'action des casques bleus au Rwanda. Comme le relèvent les directives adressées aux pays contribuant à la MINUAR, la présence militaire de l'ONU doit contribuer à la sécurité du pays, contrôler le respect des cessez-le-feu, le cantonnement des troupes, enquêter à la requête des parties, assister à la coordination de l'aide humanitaire...
Dans les circonstances actuelles, les troupes de l'ONU ne peuvent qu'essayer de rassurer, par leurs mouvements et leurs patrouilles, les populations.
Elles doivent aussi assurer la protection des NU et de ses agences. Cela peut apparaître comme état peu, mais de nouveau, l'ONU n'a pas les moyens en troupes et en armes pour faire grand chose de plus.
4. J'ai informé ce soir le sous-SecGen pour les OPM (M. Riza) de l'état d'esprit des autorités belges à l'issue du Conseil des Ministres. J'ai notamment souligné l'incompréhension qui résulterait d'un manque de protection par les casques bleus belges de civils belges en danger de mort. M. Riza a exprimé sa compréhension face à ce probleme politique sensible. Il a cependant attiré mon attention sur le problème grave et sérieux que causerait une action unilatérale (hors-mandat) de contingents belges (sous l'autorité de l'ONU) visant à s'occuper du rapatriement de leurs concitoyens. M. Riza m'a suggére de chercher à modifier le mandat de la MINUAR. Je pourrais donc demain sonder quelques membres du Consécur sur une possible priorité (lorsque le besoin s'en fera sentir) du rapatriement de toutes les communautés étrangères.
5. En tout état de cause, plusieurs membres permanents du Conseil m'ont déjà informé que le Conseil ne transformera pas le mandat actuel de la MINUAR (peacekeeping) en un mandat d'imposition de la paix (peace enforcement). Le mandat original était destiné à accompagner un processus politique. Son effondrement fait perdre beaucoup de son sens au maintien de la force. Plusieurs membres occidentaux du Conseil s'interrogent d'ailleurs sur l'utilité, dans les circonstances actuelles, du maintien de la MINUAR. »
Le 8 avril, le Gouvernement se réunit à 15 heures, sous la présidence du Premier ministre Dehaene, et en présence du lieutenant général Charlier, sur la base de notes préparatoires de M. F. Roelants, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. La première note est rédigée comme suit :
« L'on peut justifier une intervention au Rwanda de la manière suivante :
1. Les autorités locales demandent une intervention. Normalement, il s'agit du Gouvernement. Actuellement, la situation à Kigali est la suivante :
il y a encore des ministres de l'ancien Gouvernement. lls sont en contact avec l'ambasssadeur de France;
l'on a formé un comité de crise de militaires, qui est en réunion. L'on ne sait pas si des partis politiques y participent. Notre ambassadeur a des contacts avec le colonel Rusatira, qui est membre de ce comité.
Notre ambassadeur estime qu'il est peu probable que l'une de ces autorités demande une intervention.
Cette intervention n'est pas non plus jugée opportune car elle conduirait en fin de compte à ce que nous nous ingérions dans des conflits internes rwandais.
2. Une protection et une évacuation sur la base du mandat existant de la MINUAR, pour lesquelles l'on pourrait invoquer les points 3a et 3c de ce mandat.
Point 3.a) : « Contribuer à assurer la sécurité de la ville de Kigali, notamment a l'intérieur de la zone libre d'armes établie par les parties s'étendant dans la ville et dans ses alentours »;
Point 3.c) : « Superviser les conditions de la sécurité générale dans le pays pendant la période terminale du mandat du gouvernement de transition, jusqu'aux élections. »
Ce mandat a toutefois été accordé sur la base du chapitre VI de la Charte des Nations unies, qui se fonde sur l'intervention pacifique. L'on a demandé à notre poste à New York d'obtenir une interprétation large. L'on a contacté la France; elle nous soutient en la matière. Les Douze ont été informés de la préoccupation belge. Nos postes dans les pays membres du Conseil de sécurité ont également été informés.
Obtenir un nouveau mandat sur la base du chapitre VII, permettant aux Nations unies de recourir à la force, prendra beaucoup de temps. Le Conseil de sécurité est en outre réticent à appliquer le chapitre VII.
3. Une action humanitaire d'unités belges et d'unités provenant d'autres pays, menée hors du cadre de l'ONU. Pour cela, il faut :
informer l'ONU;
informer les autorités locales, sans demander leur accord, mais en escomptant qu'elles ne s'y opposeront pas. Selon notre ambassadeur à Kigali, c'est l'option la plus réaliste car il s'avère que l'option nº 1 mentionnée ci-dessus est moins réaliste et peu opportune. » (traduction).
Une autre note résumant la situation à 12 heures 30 du même jour, fournit en son point 5, des précisions à propos de l'attitude française face à une éventuelle opération d'évacuation (90c). Suite à ses contacts avec le Quai d'Orsay, M. Roelants résume l'état d'esprit de la France :
« Pour justifier l'intervention vis-à-vis notamment des Nations unies, l'on ne manquera pas de trouver une solution » (traduction).
En ce qui concerne les Américains, le 7 avril, le Département d'État demande si la Belgique peut approuver une modification, par l'ONU, des règles d'engagement, de maniere à permettre à la force de maintien de la paix de l'ONU de protéger et d'évacuer les étrangers se trouvant au Rwanda (91c).
À ce Conseil des ministres, il est également fait rapport de l'entretien téléphonique avec M. Boutros-Ghali et il est également question de sa lettre adressée au Conseil de sécurité, dans laquelle il a demandé un renforcement de la MINUAR dans la perspective d'une évacuation (cf. ci-dessus).
Selon le lieutenant général Charlier, une intervention belge n'est pensable que si les ressortissants belges sont en danger. Le Gouvernement estime que le risque est grand de voir la situation évoluer négativement. Suit une discussion sur la question de savoir s'il faut ou non envoyer des troupes pour évacuer les Belges et, dans l'affirmative, si cela doit se faire sous la bannière de l'ONU; à ce propos, on prend note de la demande adressée par Boutros-Ghali au Conseil de sécurité en vue d'accroître l' effectif de la MINUAR.
Après discussion, il s'avere que tout le monde est partisan d'une opération d'évacuation séparée.
Le Premier ministre résume comme suit la décision d'exécuter une brève mission humanitaire :
« Il convient de faire la remarque suivante à l'adresse des Nations unies :
l'opinion publique belge est traumatisée par la mort des dix paras belges. La poursuite de la participation belge à la MINUAR est, dès lors, remise en question. La prolongation de la mission dépendra de la capacité des troupes de l'ONU à pouvoir mieux se défendre. La Belgique demande par conséquent une amélioration qualitative de la MINUAR (davantage d'armes) et une extension du mandat. En aucun cas, la Belgique ne pourra marquer son accord sur un renforcement des troupes de la MINUAR au moyen de soldats belges.
La Belgique procédera à une mission d'évacuation humanitaire de courte durée qu'il faudra considérer comme totalement indépendante de la participation belge à la MINUAR » (92c) (traduction).
Le ministre Claes envoie ensuite à la délégation diplomatique belge à New York un télégramme qui servira de base aux discussions avec le secrétariat du Conseil de sécurité.
« Ce soir, le Conseil des ministres a examiné la situation au Rwanda. La mort de dix Casques bleus belges et vraisemblablement de trois civils suscite beaucoup d'émoi en Belgique.
Si le désordre devait persister et si d'autres victimes belges étaient encore à déplorer, il ne serait pas acceptable, aux yeux de l'opinion publique belge, que le contingent de l'ONU, et plus particulièrement les troupes belges qui en font partie, garde une attitude passive. Le moins que l'on puisse escompter dans ces conditions, est que ce contingent s'efforce de protéger les étrangers d'une manière non agressive. À cet égard, il convient en outre de prendre en considération le fait que cette passivité des troupes belges dans ces conditions pourrait également avoir pour résultat que la participation belge à de telles opérations ne pourrait plus guère compter, à l'avenir, sur la sympathie de l'opinion publique belge. Je vous demande par conséquent de continuer à attirer l'attention des autorités des Nations unies sur cette question.
Pour votre information personnelle, si la situation sur place devenait réellement dramatique pour les Belges, ce qui n'est pas encore le cas pour l'instant, il n'est pas exclu que le commandant belge reçoive directement du gouvernement l'ordre de protéger les Belges. Je suis pleinement conscient que cela nous placerait dans une position extrêmement délicate vis-à-vis de l'ONU (93c) » (traduction)
Certains témoins ont déclaré que les tentatives de modifier le mandat l'avait été uniquement en vue de permettre l'évacuation de expatriés. C'est ce que confirment un certain nombre de témoins devant la commission.
M. Brouhns est clair à ce sujet : « Il existe une certaine confusion, que j'ai même retrouvée, ce matin (25 juni 1997), dans les comptes-rendus de certains journaux. Lorsqu'on a parlé, a partir du 7 ou 8 avril 1994, d'un renforcement possible de la MINUAR, tant dans les instructions reçues de Bruxelles que dans les discussions au sein du secrétariat ou en marge du Conseil de sécurité, il s'agissait d'un renforcement en vue de permettre l'évacuation. (94c) »
M. Brouhns a confirmé explicitement que tous les efforts pour modifier le mandat, y compris la demande d'adaptation des ROE, ont été faits exclusivement pour le cas où une évacuation de compatriotes aurait lieu (95c).
C'est aussi l'avis d'Alison Des Forges, qui dit à la commission : « Maintenant, je suis convaincue que la discussion, à cette époque, sur l'élargissement du mandat a eu lieu pour justifier la collaboration de la MINUAR dans l'opération d'évacuation des étrangers. Il ne s'agissait pas d'élargir le mandat pour protéger les Rwandais. La question était plutôt : est-il nécessaire d'élargir le mandat pour évacuer plus vite nos propres ressortissants ? (96c) »
Toujours, selon M. Brouhns, notre représentant permanent à New York a, de sa propre initiative, tâté le terrain pour renforcer le mandat dans le cadre d'une protection plus globale de la population rwandaise.
« J'ai pris l'initiative car la question n'était pas posée d'interroger le secrétariat et différents membres sur la possibilité du renforcement du mandat pour pouvoir faire éventuellement face à une protection générale, population rwandaise incluse. La mission a pris l'initiative d'ajouter aux deux points demandés par Bruxelles la question d'un renforcement de la MINUAR dépassant le cadre de l'évacuation.
Ce point a suscité immédiatement des réactions extrêmement réservées. (97c) »
Le Premier ministre Dehaene a déclaré devant la commission : « Ce que nous avons envisagé à un moment, c'est de savoir si les troupes belges au sein de l'UNAMIR pouvaient être disponibles pour organiser une évacuation du côté belge. (98c) »
Le ministre Claes déclare quant à ses efforts en vue de modifier le mandat : « Il est exact que j'ai plaidé pour un renforcement du mandat, principalement en vue d'assurer tant la sécurité de nos compatriotes et de nos propres troupes que celle des acteurs rwandais. C'est dans ce contexte que la Belgique a plaidé pour un élargissement du mandat. Cela pouvait aller d'une interprétation très large des ROE à un renforcement du mandat incluant le chapitre VII, en passant par un apport de troupes. (99c) »
Il dit également qu'à ce moment-là, il a : « téléphoné quasiment dans le monde entier, mais que personne n'était prêt à renforcer le mandat. (100c) »
Ce même 8 avril à 18 h 19 notre représentant Noterdaeme adresse au ministre Claes le télex suivant : « M. Benon Sevan, secretaire général adjoint, coordinateur sécurité, m'a approché en début d'apres-midi pour me demander si le gouvernement belge avait décidé d'envoyer des troupes pour assurer l'évacuation des Belges au Rwanda. Je lui ai répondu qu'aucune décision n'avait été prise. Il m'a demandé de vous informer du désir de l'ONU de voir son personnel civil international bénéficier de l'aide et des facilités belges si une décision d'évacuation devait être prise à Bruxelles.
2. Il s'agirait de 190 personnes (agents et familles) que les Nations unies essaient de regrouper à Kigali. C'est le souhait de M. Sevan que ces 190 personnes puissent rallier un éventuel convoi d'évacuation de Belges en profitant de la protection armée qui lui serait donnée. » (101c)
Suit un deuxieme télex toujours de M. Noterdaeme à Minafet qui dit : « 1. Mon collègue francais m'a aimablement informé du contenu d'un entretien qu'il a eu avec l'ambassadeur Jean Damascène Bizimana, representant permanent du Rwanda auprès de l'ONU et siégeant actuellement au Conseil de sécurité. L'ambassadeur Bizimana est un proche de feu le président Habyarimana.
2. Pour Bizimana, les Belges sont impliqués dans l'attentat qui a coûté la vie aux présidents du Rwanda et du Burundi. Cette action s'inscrit dans la tradition belge d'ingérence dans les affaires intérieures du Rwanda en faveur des Tutsi. L'ambassadeur a fait état de rumeurs concernant une intervention militaire imminente de la Belgique sous couverture de pseudo raisons humanitaires. Pour Bizimana, il vaut mieux que les Belges n'interviennent pas au Rwanda pour évacuer leurs ressortissants car ils y ont perdu tout crédit. Par contre, les Rwandais adopteront une attitude plus conciliante vis-à-vis des Français, si ces derniers intervenaient au Rwanda pour des raisons humanitaires. Il a rappelé à cet egard que la Garde présidentielle ne permettra pas aux Belges d'utiliser l'aéroport de Kigali.
Dans la perspective d'un éventuel renforcement de la MINUAR, Bizimana s'oppose à ce que les Belges fassent partie de ces éventuels renforts. Il considère aussi que, pour stabiliser la situation, le contingent belge devrait immédiatement être remplacé à Kigali.
3. Mon collègue français a qualifié l'hypothèse de travail de son interlocuteur de non raisonable. Comme membre du Consécur, Bizimana risque évidemment de propager ce genre de commentaires peu amènes, qui contribueront à isoler davantage mon collègue rwandais dont le crédit diplomatique est assez bas à New York.
4. Le Secgen n'a toujours pas adressé de lettre au Conseil de sécurité et il n'est donc pas certain que la question du renforcement de la MINUAR soit traitée aujourd'hui. Un tel renforcement exigera vraisemblablement une résolution qui, à mon avis, pourrait difficilement être adoptée avant le début de la semaine prochaine (pour autant qu'elle recueille un consensus de tous les membres) » (102c).
Enfin, à 22 heures 30 GMT, M. Noterdame adresse à Minafet un troisième télex dont le contenu suit : « 1. Le SecGen-adjoint pour les opérations de maintien de la paix, M. Kofi Annan, a convoqué une petite réunion en début d'après-midi avec des représentants des missions française, américaine et Belge pour évaluer la situation au Rwanda.
M. Kofi Annan a distingué deux « tracks » en matière d'évacuation des ressortissants étrangers du Rwanda.
1.1. La première piste est celle décrite dans la lettre du SecGen au président du Consécur (voir fax). Dans cette lettre, le SecGen estime que l'évacuation du personnel civil de l'ONU et des étrangers pourrait devenir inévitable. La MINUAR, dans sa composition actuelle, ne pourrait pas faire grand chose eu égard à son mandat et à ses règles d'engagement. Si le Conseil devait cependant confier à la MINUAR cette évacuation, cela demanderait son renforcement par deux ou trois bataillons. Cette solution, coûteuse en argent, en hommes et en temps, ne me semble pas fort intéressante.
1.2. Une deuxième piste réside dans une intervention nationale (par un ou plusieurs pays). Pour Annan, cette approche est de loin la plus efficace pour autant qu'elle soit coordonnée avec l'ONU Annan a cependant clairement ajouté qu'une telle intervention humanitaire devrait s'occuper également du rapatriement de tous les étrangers, du personnel civil de l'ONU et des 2 500 soldats de la MINUAR. Annan estime, en effet, que le maintien de la MINUAR s'avèrera impossible en cas d'intervention militaire. Cette dernière risque en effet de miner l'action de la MINUAR ou de provoquer des représailles à son encontre.
2. À l'issue des consultations informelles du Consécur, le représentant de la France a informé le président du Consécur de l'éventualité d'une réunion d'urgence du Consécur ce week-end afin que le Conseil donne sa « bénédiction » à une action militaro-humanitaire franco-belge avec l'assistance des États-Unis. Mon collègue français aurait sondé les membres du Consécur et ceux-ci n'auraient pas d'objection pourvu que le Conseil soit tenu informé, que l'action soit brève et strictement humanitaire. Mon collègue français n'a pas été clair sur le caractère antérieur, concomittant ou postérieur à l'action humanitaire de cette action du Conseil. Lors d'une éventuelle réunion publique du Conseil, je me propose de ne prendre la parole que si d'autres membres du Consécur la prennent. J'apprécierais toutes informations nécessaires afin de me permettre de préparer une éventuelle intervention.
3. Le secrétariat m'informe ce soir qu'un gouvernement intérimaire a été mis sur pied et qu'un cessez-le-feu tient vaille que vaille depuis 8 heures du soir. Ce cessez-le-feu implique que les parties retournent sur leurs positions d'avant l'accident aérien. S'il était respecté, il devrait permettre la réouverture de l'aéroport. Pour le secrétariat, cette situation modifierait radicalement les données du problème. » (103c)
Divers commissaires ayant demandé dans quelle mesure la Belgique a plaidé en faveur d'une modification du mandat, d'une modification des ROE ou, à tout le moins, d'une application de l'article 17 des ROE de manière à permettre à la MINUAR d'intervenir contre les massacres ethniques, le ministre Claes donne une réponse évasive, voire ambigüe (104c). Cela explique la réaction d'étonnement de M. Brouhns aux articles de presse parus le lendemain du témoignage du ministre Claes, qui rapportent les efforts faits par la Belgique pour renforcer le mandat de la MINUAR.
Après que, le 9 avril, les services compétents eurent donné les directives nécessaires relatives à l'évacuation, le cabinet restreint se réunit le 10 avril pour dresser un premier état de la situation en ce qui concerne cette opération. Il décide que priorité doit être donnée à l'évacuation des ressortissants belges (105c).
Le 11 avril, le cabinet restreint se réunit à nouveau pour évaluer la situation et demande au ministre des Affaires étrangères d'insister auprès de l'ONU pour accroître la sécurité des troupes belges des Nations unies. Une rencontre sera également organisée avec Boutros Ghali, vu sa présence en Europe, le 12 avril, le ministre Claes donne, lors d'un entretien téléphonique avec l'ambassadeur Swinnen, l'autorisation d'évacuer le personnel rwandais de l'ambassade et des membres de l'ambassade. En ce qui concerne l'évacuation d'autres rwandais, la situation est complexe :
« Nous nous préoccupons surtout :
du personnel qui a travaillé pour nous;
de certaines personnalités associées au processus de démocratisation;
des ecclésiastiques. (106c) »
Finalement, l'opération « Silver Back » débutera le 10 avril et se terminera le 15 avril, lorsque les derniers civils belges auront quitté le Rwanda.
3.8.3.2. Le retrait des troupes belges
Lors de l'audition du 18 juin 1997, le ministre Delcroix déclare : « Lorsque, dans la soirée du 7 avril, nous commencions à nous faire une idée de la situation, le souci unanime du gouvernement était de retirer les troupes. La décision de retrait n'a été prise que le 15 avril » (107c).
Quoi qu'il en soit, dès la seconde réunion du conseil du cabinet restreint, le 8 avril, le Premier ministre résume une situation qu'il considère d'une manière très pessimiste et, comme on l'a vue plus haut, « met en question la participation (belge) à la MINUAR » tout en demandant un élargissement du mandat ». Lors de sa dernière audition, le Premier ministre a affirmé que « notre intention (de retirer les casques bleus belges) était clairement formulée à l'avant veille de la rencontre (du ministre Claes avec Boutros Ghali) à Bonn », c'est-à-dire le 10 avril (108c).
Le 12 avril 1994, le cabinet restreint, en préparation de la rencontre Willy Claes-Boutros Ghali, discute de l'avenir de la MINUAR.
Le cabinet décide que « le ministre des Affaires étrangères est chargé de remettre en question, auprès des Nations Unies, la poursuite de la participation des troupes belges à la MINUAR, et ce, vu que les accords d'Arusha ne sont plus respectés et que les conditions générales d'une opération des Nations Unies ne sont plus remplies. Le ministre Claes doit demander formellement à Boutros-Ghali de faire rapport aux Nations Unies, comme le prévoit la résolution 909. La MINUAR est actuellement devenue sans objet et un renforcement du mandat et des effectifs sont des options peu réalistes. Les Nations Unies devraient se contenter d'un rôle d'observation en attendant des temps meilleurs » (109c).
Les arguments invoqués au cours de la réunion ont été résumés de la manière suivante par le ministre Claes : « Welke argumenten schoof de Belgische regering naar voren ? Ten eerste, elke basis voor de toepassing van de Arusha-akkoorden is stukgeschoten. De algemene voorwaarden voor het vervullen van een peace-keeping-opdracht van de VN wordt niet langer voldaan. Het gevaar voor nieuwe dodelijke ongelukken met blauwhelmen in het algemeen, maar in het bijzonder met Belgische blauwhelmen, is niet denkbeeldig. Reeds op 8 april schreef Boutros Ghali in een brief aan de Veiligheidsraad dat de evacuatie van de burgers, en meer specifiek van het burgerlijk VN-personeel, onvermijdelijk was geworden.
Het kernkabinet maakte uit de demarches die onze ambassadeur Noterdaeme had kunnen doen bij de Verenigde Naties in New York en bij de leden van de Veiligheidsraad op dat was niets nieuw; wij wisten dat in feite al dat er voor de Veiligheidsraad geen sprake was om het mandaat hoofdstuk 6, peacekeeping, te veranderen in een mandaat hoofdstuk 7.
Bovendien werd vastgesteld en dat bleek uit de verslagen die wij kregen via onze ambassade en via Landsverdediging dat de blauwhelmen niet bij machte waren de situatie terug onder controle te krijgen.
Vandaar dat de Belgische regering tot de conclusie kwam dat men het best tot nader order de Angolese formule zou toepassen. Met andere woorden, voorlopig het mandaat terugplooien tot een gewone observatiepost, zoals dat in Angola was gebeurd, en de diplomaten aan het werk zetten om de partijen terug aan tafel te krijgen.
Bovendien werd het anti-Belgisch klimaat zeer ernstig genomen : het hield een dubbel gevaar in voor de Belgische blauwhelmen en de Belgische burgers. Dit werd bevestigd door het bericht nr. 633 dat op 8 april toekwam. De leden van de commissie kennen overigens deze telex. Via de Franse ambassadeur bij de Verenigde Naties moesten we vernemen dat de Rwandese ambassadeur België verantwoordelijk had gesteld voor de aanslag op het vliegtuig.
De situatie werd dus meer dan bedenkelijk. Vandaar dat onze militaire autoriteiten generaal Charlier trouwens reeds als mogelijkheid opperden een evacuatie via Tanzanië, eerder dan een evacuatie via de lucht. Op dat ogenblik was het immers duidelijk dat zelfs de blauwhelmen niet meer bij machte waren het vliegveld in Kigali te controleren. De pistes waren op dat ogenblik trouwens geblokkeerd door de presidentiële garde » (110c).
Au cours de la journée du 12 avril, M. Claes rencontre M. Boutros Ghali à Bonn et un télex 181 est envoyé à l'ambassade belge à Washington pour expliquer la position belge.
Dans ce télex, le ministère exprime son opinion selon laquelle les accords d'Arusha ont définitivement échoués. Puisqu'Arusha constituait la raison d'être de l'opération MINUAR, cette mission devient sans objet pour la Belgique. « Pour la Belgique, il est évident que la poursuite de l'opération MINUAR est devenue sans objet. Il est donc hors de question que la Belgique participe à une opération MINUAR II renforcée ou maintenue dans son format actuel. »
Seule une présence limitée de l'ONU (cf . l'Angola) est encore acceptable.
La Belgique veut retirer ses troupes aussi rapidement que possible et menace même de renoncer à l'avenir à toute participation à des missions de paix.
« Pour sa part, la Belgique souhaite d'autant plus retirer son contingent de Casques bleus du Rwanda que celui-ci a été durement touché par les événements (massacre de 10 soldats) et qu'en raison de la propagande d'une faction politique extrémiste, les ressortissants belges sont à présent particulièrement menacés. Toute aggravation du bilan des pertes belges pourrait éloigner pour très longtemps notre pays de toute participation à des OMP. »
M. Claes résume ainsi sa rencontre avec le Secrétaire général :
« De heer Boutros Boutros Ghali was al enkele dagen in Europa en ik kan mij dan ook perfect indenken dat hij op dat ogenblik niet op de hoogte was van alle details van de situatie. Ik heb hem het volgende gezegd : « Het loopt volkomen fout; in onze optiek heeft de UNAMIR-opdracht geen waarde meer. Er bestaat een diplomatiek en politiek vacuüm, het Arusha-proces is kapot geschoten. De regering is gevlucht; alle ambassades zijn gesloten. Het staakt-het-vuren heeft geen stand gehouden. Het FPR rukt met versterking verder op naar Kigali en geeft ons nog 48 uur de tijd om te evacueren. » De UNAMIR is machteloos en heeft zich teruggetrokken op de luchthaven. Ik heb er zelfs aan toegevoegd dat hij zelfs een deel van zijn troepen kwijt was. Ik wist via een Belgische militaire bron, dat Bengalese of Ghanese troepen op de vlucht waren geslagen voor het geweld. Verder heb ik aan de heer Boutros Boutros Ghali gezegd dat zelfs onze ambassade geen telefonische verbindingen meer had met zijn militair commando en dat dit alleen nog via Intersat New York kon communiceren met diplomaten. Een derde element in mijn betoog verwees naar het anti-Belgisch klimaat. België werd verantwoordelijk gesteld voor het neerhalen van het presidentieel vligtuig; het zou pro-FPR zijn. Men had het gemunt op de Belgische troepen. Het risico was dus niet denkbeeldig dat, als onze blauwhelmen niet worden teruggetrokken, er nog para's zouden sneuvelen. Bovendien liepen andere UNAMIR-troepen praktisch dezelfde gevaren als de Belgen omdat ze in Kigali dreigden gekneld te raken tussen de twee strijdende groepen. Ik heb de heer Boutros Boutros Ghali gezegd : « U weet beter dan ik dat een versterking van het mandaat er niet in zit. Het is ons oordeel dan u er beter aan doet alle UNAMIR-troepen wijselijk terug te trekken, vooraleer er nieuwe slachtoffers vallen. In elk geval, dat moet ik u melden in naam van de Belgische regering, kunnen de Belgische troepen niet blijven. Wij overwegen een terugtrekking via Tanzanië over de grond omdat de risico's van een luchtevacuatie veel te groot zijn. In de telex, waar verslag wordt gegeven over deze ontmoeting en dat opgesteld werd door de heer Van Daele, kunt u lezen dat de heer Boutros Boutros-Ghali gezegd heeft : « Je partage votre analyse. » Hij zei mij dat hij wel het verslag van generaal Dallaire diende af te wachten vooraleer hij rapport kon uitbrengen aan de Veiligheidsraad. Hij gaf mij de raad inmiddels diplomatieke demarches in die richting te doen via de leden van de Veiligheidsraad en de troepenleveranciers. Dit is in het kort de weergave van het gesprek dat ik met de heer Boutros Boutros-Ghali had in Bonn tijdens die fameuze nacht. De heer Boutros Boutros-Ghali had wel zijn twijfels over mijn mededeling alsof een deel van de UNAMIR-troepen op de vlucht waren. Hij zou het controleren en mij de volgende ochtend opbellen. 's Anderendaags ochtend belde hij mij op en zei : « Met alle respect, maar ik denk dat uw gegevens fout zijn. Je crois que vous ne disposez pas de tous les renseignements. Le général Dallaire dispose encore de toutes ses troupes. » Diezelfde avond, ik meen dat Boutros Ghali intussen in Barcelona of Madrid verbleef, belde hij mij opnieuw op. Hij heeft mij toen gezegd : « Je dois partiellement revenir sur ma communication de ce matin et je dois avouer que plusieurs de vos données ont été confirmées entre-temps par ma cellule, à New York. » (111c)
Ce récit est similaire au rapport que le ministre des Affaires étrangères a fait de l'entretien avec Boutros Ghali à Bonn le 12 avril 1994; au point 3, il signale que le Secrétaire général des Nations unies partage le point de vue belge. « Je partage votre analyse » fut, selon le rapport, la réaction du Secrétaire général des Nations Unies, M. Boutros Ghali (112c).
Mais dans son compte-rendu des événements, le Secrétaire général déclare :
« I voiced my disagreement and asked that the Belgian troops at least leave their heavy weapons in Rwanda so they could be used by other UNAMIR contingents.
It was my view, which I communicated to the Security Council, that the continued discharge by UNAMIR of its mandate would become untenable unless the Belgian contingent was replaced by other, equally well-equiped troops, or unless the Government of Belgium reconsidered its decision. » (113c)
Le secrétaire général estime en effet que les troupes de la MINUAR ont leur utilité sur le terrain, même si leurs possibilités sont limitées.
« The mission possessed neither the mandate nor the force to coerce the two sides into ending the violence. »
Mais leur présence a un sens :
« UNAMIR dedicated itself to efforts to secure a cease-fire; protect civilians and United Nations Staff, as far as was possible; rescue individuals and groups trapped in the fighting; and provide humanitarian assistance. Within days, thousands of civilians sought refuge in and around United Nations positions. UNAMIR attempted to offer protection and provide food, supplies and medical care to these groups. » (114c)
M. Brouhns pense que cette contradiction peut s'expliquer de la manière suivante :
« (...) rencontre Claes-Boutros, où on expose le point de vue belge; on croit comprendre, à Bruxelles, que Boutros partage ce point de vue, et puis il y a cette lettre qui arrive, et qui dit « sans les Belges, la MINUAR ne peut pas exercer effectivement sa tâche, et donc son mandat deviendra intenable. Il faut que la Belgique soit remplacée par un bataillon de qualité équivalente, ou que le Gouvernement belge reconsidère sa décision de retirer son contingent. » Y-a-t-il contradiction entre cela et l'information que j'ai reçue de Bruxelles sur cette entretien Claes-Boutros, je dirais pas nécessairement. Au fond, Boutros tire les conséquences radicales de la décision du Gouvernement belge. » (115c)
La lettre du 13 avril, que M. Boutros Ghali avait promis d'adresser au Conseil de sécurité et dans laquelle il fait rapport de sa conversation avec M. Claes, sème la consternation dans les milieux diplomatiques belges.
Elle indique de manière sincère les conséquences de la décision belge :
« He (= Claes) informed me that the Government of Belgium has decided to withdraw its contingent serving with UNAMIR at the earliest possible date. In the light of the decision by the Government of Belgium, it is my assessment that it will be extremely difficult for UNAMIR to carry out its tasks effectively. The continued discharge by UNAMIR of its mandate will become untenable unless the Belgian contingent is replaced by another, equally well equipped contingent or unless the Government of Belgium reconsiders its decision to withdraw its contingent. In these circumstances, I have asked my Special Representative and the Force Commander to prepare plans for the withdrawal of UNAMIR, should this prove necessary, and send their recommendations to me in this regard. » (116c)
Dans son témoignage, M. Brouhns décrit comme suit les réactions à cette lettre :
« Au fond, M. Boutros tire les conséquences absolues de la décision du Gouvernement belge et, en responsable d'une organisation internationale, dit : « puisque les Belges s'en vont et que je me rends compte que je ne pourrai pas les remplacer, j'en tire toutes les conséquences ». Évidemment, cela n'a pas été dit de manière fort élégante et agréable pour le Gouvernement belge. » (117c)
Le Conseil de sécurité n'acceptera pas cette formulation et estimera qu'il faut en trouver une autre.
Au cours des consultations du Conseil de sécurité du 14 avril, le secrétaire général et son conseiller spécial se disent une nouvelle fois opposées à un retrait global de la MINUAR :
« An option I viewed as neither advisable as faisable. » (118c)
(3) La réaction des militaires sur place, l'état-major et les troupes
Le général Dallaire s'opposait à la cessation de l'opération. Quant au colonel Marchal, il fait état dans son rapport confidentiel de mai 1995, des conversations qu'il avait eues en tant que chef de la MINUAR pour le secteur de Kigali avec le représentant spécial des Nations unies, M. Booh Booh, et son conseiller, M. Khan : « Je conserve un pénible souvenir de l'entrevue au cours de laquelle j'ai communiqué (...) que le Gouvernement belge avait décidé de retirer son contingent, suite à l'assassinat de dix de ses Casques bleus.
La réponse (...) fut cinglante et je ne suis pas prêt de l'oublier : parce que la Belgique a eu dix morts, elle se fout pas mal (textuel) des milliers de noirs qui vont être assassinés. » (119c)
Le colonel Marchal a exprimé avoir été déçu par la décision de retrait prise par le gouvernement.
De nombreux militaires, qui ont été entendus par la commission, ont confirmé que, même s'il est vrai qu'ils avaient été fortement impressionnés par l'assassinat de leurs camarades, ils étaient certainement en mesure, d'un point de vue psychologique, de rester sur place et d'intervenir pour éviter les massacres.
Parmi ces militaires, la commission a notamment entendu le premier caporal-chef Pierard, qui a déclaré :
« Évidemment nous étions très déçus de ne pas être intervenus. Mais je ne crois pas que cela ait pu diminuer le potentiel combatif, au contraire. » (120c)
L'adjudant Boequelloen a lui aussi confirmé cette affirmation :
« Je confirme. En ce qui me concerne, je ne voulais pas retourner parce que nous avions perdu dix compagnons et il fallait continuer à travailler. » (121c)
Les hommes sur le terrain étaient donc très certainement disposés à rester, et l'on ne peut dès lors justifier le retrait des Casques bleus belges en invoquant le « moral » du contingent belge.
3.8.3.3. La campagne de la Belgique visant à convaincre les membres du Conseil de sécurité de suspendre entièrement l'opération MINUAR
À partir du 12 avril 1997, la Belgique a insisté sur le retrait intégral de la MINUAR. Dans son télex du 13 avril à DELBELONU relatant son entrevue avec M. Boutros-Ghali, M. Claes confie à la délégation Belge une mission complémentaire qu'il définit comme suit : les postes se trouvant dans les pays qui sont membres du Conseil de sécurité ou qui fournissent des troupes doivent informer d'urgence leurs interlocuteurs de l'analyse faite au point 1 (retrait), de manière que ces pays nous aident dans la mesure du possible à obtenir des Nations Unies une décision rapide de retrait des troupes de la MINUAR.
Au cours de son audition du 25 juin 1997, M. Brouhns déclare : « Le même jour, la mission informe les cinq membres permanents du Conseil de sécurité ainsi que la mission d'Espagne, qui siégeait comme membre non permanent. Ces démarches se sont effectuées au niveau du conseiller politique de la mission. Le même jour, l'ambassadeur Noterdaeme recontre le chargé d'affaires américain pour lui faire part de la position belge telle que communiquée par M. Claes à M. Boutros-Ghali.
Le 13 avril, a lieu à New York une réunion des pays contributeurs de troupes à la MINUAR. Durant celle-ci, l'ambassadeur Noterdaeme intervient pour communiquer la position belge. Le même jour, il adresse une lettre au président du Conseil de sécurité pour rappeler, par écrit, la position du Gouvernement belge.
Le 15 avril, l'ambassadeur Noterdaeme a effectué une démarche auprès du numéro deux de l'ONU, Kofi Annan, en l'absence de M. Boutros-Ghali, auprès du président du Conseil de sécurité et auprès des cinq membres permanents ainsi que de l'Espagne, de l'Argentine et du Pakistan, trois membres nonpermanents du Conseil de sécurité. Il s'agissait d'un effort diplomatique important, de démarches formelles, préparées et concertées sur base d'instructions de Bruxelles, avec un message précis transmis par le Gouvernement belge. Ces démarches ont été souvent doublées par les contacts directs entre Bruxelles et les capitales membres du Conseil de sécurité...
Nous n'avons pas abordé, dans nos contacts, les pays dont nous savions que la position était opposée à celle du Gouvernement belge. Nous avons évité d'effectuer des démarches auprès des pays africains. Les positions des membres du Conseil de sécurité étaient les suivantes : la position américaine a évolué entre le retrait total et le maintien limité et symbolique d'une présence de la MINUAR sur place. La position du Royaume-Uni était relativement semblable à celle des Américains, au début pour un retrait total et ensuite une évolution vers le maintien d'une présence limitée de la MINUAR, pour observer symboliquement et passivement la situation sur le terrain. La Russie et l'Espagne suivaient plus ou moins le train anglo-saxon. La Chine est restée relativement silencieuse durant ces débats. La France a été directement partisane du maintien de la MINUAR sans les Belges, sans plaider pour un renforcement de cette MINUAR. » (122c)
Pourquoi cette volonté d'obtenir le retrait ?
Le ministre Claes a donné à la Commission l'explication suivante : « De grondslag voor het mandaat was verdwenen; er was geen sprake meer van peacekeeping; van de Arusha-akkoorden bleef niets over; er was complete chaos : geen regering meer, geen ambassades meer, geen telefonische infrastructuur meer, het vliegveld was niet meer onder controle, er was geen staakt-het-vuren, de verschillende troepen vochten met elkaar, er werd geplunderd en de Blauwhelmen liepen zonder uitzondering zware risico's. Indien de regering toen had beslist de troepen daar te houden, zou u mij nu wellicht, als er meer doden waren gevallen, de vraag stellen wat wij nog meer nodig hadden om troepen terug te trekken. Naast de vaststelling dat de Blauwhelmen onder geen enkel beding incidenten en moordpartijen konden stoppen en naast het feit dat in de Veiligheidsraad er helemaal geen politieke wil bestond tot versterking van het mandaat, moet nog een ander element vermeld, namelijk de brief van Boutros-Ghali, gericht aan de Veiligheidsraad de dag na mijn gesprek in Bonn. » (...)
« Ik heb het over het rapport van 8 april van de heer Booh-Booh aan de heren Kofi Annan en Goulding. » (123c)
Le ministre Claes concluait que le rapport du 8 avril confirmait son analyse. Selon ce rapport, les troupes en étaient réduites à l'autodéfense et des combats étaient en cours entre le FPR et la garde présidentielle. L'utilisation de l'aéroport n'était pas garantie et les troupes ne pouvaient se procurer de l'eau potable. En plus, il n'y avait plus de téléphone. La conclusion de M. Booh Booh était que les troupes avaient une mission de maintien de la paix et qu'elles n'étaient sûrement pas préparées à un conflit de longue durée (124c).
En réponse à une question d'un commissaire qui souhaitait savoir pourquoi la Belgique avait fait tant d'efforts pour obtenir le retrait complet de la MINUAR, le ministre Claes déclara que « la crainte de perdre la face » avait très certainement joué un rôle, surtout après la lettre malheureuse de M. Boutros-Ghali dans laquelle celui-ci justifiait le retrait de la MINUAR en avançant pour seule raison la décision du Gouvernement belge de rappeler son contingent. « Het feit dat die brief geschreven en gekend was, heeft ons psychologisch verplicht erop te wijzen hoe zwak de positie van UNAMIR was geworden en hoe weinig grond er nog was voor het vervullen van welke zinnige taak ook. » (125c)
Le Cabinet restreint du 13 avril 1994, auquel le ministre des Affaires étrangères n'était pas présent, conclut :
« In afwachting van de eerstvolgende vergadering van de Veiligheidsraad worden de diplomatieke inspanningen om de opschorting van de MINUAR te bekomen geïntensifieerd. De regering blijft bij haar standpunt dat tegen de achtergrond van het bestaande mandaat (Resolutie nr. 909) de huidige zending zinloos is en er zeker geen rol is voor België in de zending. De uiteindelijke Belgische houding zal bepaald worden in functie van de evolutie van de besprekingen in de VN. » (126c)
L'opération d'évacuation est annoncée le 13 avril par une lettre du représentant permanent de la Belgique au Conseil de sécurité. Il y souligne une nouvelle fois que, pour la Belgique, maintenir la MINUAR n'a pas de sens, et il parle de « widespread massacres » et de grand chaos : « It is obvious that under these conditions the continuation of the UNAMIR operation has become pointless within the terms of its present mandate. In any event, the continued presence of the Belgian contingent would expose it to unacceptable risks.
In conclusion the Belgian Government is of the opinion that it is imperative to suspend the activities of UNAMIR forces without delay. » (127c)
Au Cabinet restreint du 14 avril, New York envisage le maintien d'un noyau pour maintenir la paix. Il est demandé à la Belgique de fournir du matériel logistique et des experts. Le cabinet restreint reste fermement attaché à l'option selon laquelle la Belgique est disposée à fournir la logistique, mais pas les experts.
« Indien deze optie niet wordt weerhouden zal nagegaan worden wat « logistiek » kan gedaan worden om MINUAR-zending verder « aan te kleden », wel te verstaan dat dit zonder Belgische experten dient te gebeuren. » (128c)
Le cabinet restreint se réunit à nouveau le 14 avril, en début de soirée. À cette occasion, le ministre Claes fait savoir que la plupart des pays membres du Conseil de sécurité approuvent le point de vue de la Belgique.
L'armée serait disposée à abandonner un matériel d'une valeur de 220 millions de francs.
Il faut poursuivre les efforts sur le plan diplomatique, pour faire admettre l'« option angolaise », suivant laquelle l'ONU serait chargée uniquement d'une mission politique limitée.
Au cas où l'ONU déciderait de rester malgré tout, il faudrait veiller à abandonner le moins de matériel possible (129c).
Le 15 avril 1994, le Cabinet restreint charge instamment le ministre Claes d'intervenir par écrit auprès du Secrétaire général de l'ONU, des membres du Conseil de sécurité et des fournisseurs de troupes pour communiquer le point de vue selon lequel le mandat est devenu sans objet, que la Belgique ne peut plus participer et qu'elle ne peut pas envoyer d'experts, mais qu'elle est disposée à offrir un soutien logistique si des troupes de l'ONU restaient sur place.
Le cabinet restreint charge également les militaires de préparer l'évacuation des Casques bleus belges. La décision définitive de retrait est encore postposée de quelques jours.
Selon les termes du ministre Claes, la position des autres membres du Conseil de sécurité est la suivante : « Nigeria pleit voor behoud en zo mogelijk versterking van het mandaat. Het spreekt namens een groep Afrikaanse staten. Ik weet niet of u ervan in het bezit bent, maar er bestaat een persbericht, « Statement of the African group on the situation in Ruanda and Burundi », dat werd uitgegeven door het executief secretariaat van de UNO. Daarin wordt inderdaad gepleit voor een versterking van het mandaat. De Fransen zijn van oordeel dat UNAMIR niet bij machten is bij te dragen tot de pacificatie, maar vragen zich af of het voorlopig niet mogelijk is ons in te graven, op en rond het vliegveld. Groot-Brittannië zegt, vrijblijvend, want London had geen standpunt ingenomen, dat het wijs zou zijn UNAMIR terug te trekken. Verenigde Staten : idem. Zij stellen zelfs voor Booh Booh onmiddellijk te vragen Rwanda te verlaten en een post te kiezen in een buurland. Spanje : terugtrekken. Rusland : terugtrekken. Argentinië : UNAMIR moet in een ander land worden ontplooid. Rwanda, lid van de Veiligheidsraad : no comment. Ik heb het nu over 12 april. Nieuwe-Zeeland was voorzitter en probeert telkens opnieuw een gemeenschappelijk noemer te vinden. Het gaat dus noch de ene noch de andere richting uit. » (130c)
Au cours de la réunion du cabinet restreint du 15 avril, le ministre Claes a fait rapport des discussions qui ont eu lieu au Conseil de sécurité, et aux termes desquelles aucune décision n'avait encore été prise (131c).
Les priorités étaient les suivantes :
mettre un terme, aussi vite que possible, à l'opération « Silver Back »;
donner à KIBAT des positions qui lui permettent de partir;
à cet égard, on ne savait toujours pas si le départ des Belges se ferait dans le cadre d'un retrait général ou non.
Il a été convenu des démarches suivantes :
au niveau diplomatique, il y aurait une nouvelle intervention auprès du secrétaire général des Nations unies, auprès du président et des membres du Conseil de sécurité, ainsi qu'auprès des pays fournisseurs de troupes, pour leur expliquer que le mandat des Nations unies au Rwanda est inutile d'un point de vue politique et intenable d'un point de vue militaire;
au niveau militaire, le colonel Marchal reçoit l'instruction de préparer concrètement le retrait. La décision de partir, « le go final », sera prise le lendemain (16 avril).
Le 16 avril, l'ambassadeur Noterdaeme fait rapport des discussions qui ont eu lieu au Conseil de sécurité (132c) : l'on n'est pas parvenu à un accord concernant la cessation des activités de la MINUAR en raison de l'opposition commune des pays africains et du secrétariat. M. Noterdaeme a fait comprendre au secrétariat que la décision d'évacuer les Casques bleus belges sera mise en oeuvre sans délai, quelle que soit la décision du Conseil de sécurité.
Cette nouvelle n'a pas rencontré l'enthousiasme du secrétariat :
« J'ai relevé que le secrétariat me semblait ne pas avoir une évaluation correcte de ces risques.
Kofi Annan m'a écouté avec civilité sans vraiment réagir quant au fond.
Le président du Conseil de sécurité a souligné que les efforts et les motivations de la Belgique étaient appréciés par les membres du Conseil. Il a répété sa compréhension face au retrait belge. Le seul problème, a-t-il ajouté, dans la gestion de cette crise réside dans la différence d'évaluation entre la Belgique et le secrétariat ».
Bien qu'il ne soit pas possible d'aboutir à un consensus, la Belgique a continué à insister pour un retrait total. L'ambassadeur est intervenu une fois de plus auprès des divers membres du Conseil de sécurité « pour les travailler dans le sens d'une suspension des activités de la MINUAR ».
Si le secrétariat s'oppose au retrait de la MINUAR, c'est surtout parce qu'il se préoccupe du sort de la population locale : « Le secrétariat a déconseillé l'option 2 (forte réduction de la MINUAR) prétextant qu'elle provoquerait un drame humanitaire ... Mon collègue américain estime inacceptable l'argument du drame humanitaire qui, s'il était généralisé, rendrait impraticable la gestion des opérations de maintien de paix.»
Les efforts diplomatiques intensifs ont en fin de compte malgré tout eu un certain résultat.
Dans un communiqué de presse du secrétariat, publié à la suite des diverses consultations, on peut lire:
« Council Members took note and fully understood Belgium's decision to withdraw its troops in UNAMIR at the same time that it is repatriating the troops that have been providing security for the evacuation of foreign nationals. »
Grâce aux interventions amicales des partenaires européens et de la Russie, le communiqué de presse qui a été diffusé n'était pas trop négatif pour la Belgique : « Ce passage a été obtenu grâce aux interventions amicales de nos trois partenaires européens (France, Espagne, Royaume Uni) et des États-Unis . » (133c)
Bien que le Conseil de sécurité n'ait pas approuvé formellement la décision belge, M. Noterdaeme conclut qu'il y avait une base suffisante pour quitter le Rwanda : « Il me semble fournir un cadre onusien suffisamment adéquat à la décision prise ce matin par le Gouvernement belge. » (134c)
Il ajoute de manière laconique que les missions diplomatiques de nos partenaires européens ont été très utiles à la défense de nos intérêts.
Le cabinet restreint se réunit dans l'après-midi du 16 avril et accorde une attention particulière au communiqué de presse susvisé.
Le Premier ministre Dehaene en conclut que les Nations unies donnent le feu vert au retrait des Casques bleus belges du Rwanda : les conditions politiques sont réunies et, à partir de là, l'opération devient une question purement militaire (135c).
La position de la Belgique quand au retrait total des troupes n'était pas partagée par le secrétariat des Nations Unies. Selon M. Brouhns : « Essentiellement, le secrétariat des Nations Unies travaillait dans l'idée d'un échec temporaire d'un processus de paix, et estimait qu'un cessez-le-feu, une renégociation entre les parties, et la remise sur rail d'Arusha restaient possibles, et pour cela il fallait rester. En Belgique, on estimait que cette chance n'était plus crédible, et qu'on allait vers un accroissement des affrontements.
Vraag : Mais je suppose que l'analyse du Secrétariat reposait, en grande partie, sur les contacts de terrain, sur Booh Booh et Dallaire, parce que je ne vois pas comment autrement ... Je vous pose la question : à votre avis, qui faisait cette évaluation, puisqu'on sait très bien que New York en tant que telle n'a pas les moyens de faire cette évaluation ?
Réponse : Essentiellement, Dallaire. Je me rappelle d'un entretien cela m'avait frappé qu'on a eu : Dallaire était à New York le 30 mars, une semaine avant l'attentat. Il rencontre le Secrétariat, les membres du Conseil de sécurité, et le discours qu'il tient est relativement optimiste. Dallaire, à l'époque, est considéré pour nous à New York comme l'un des hommes les mieux renseignés sur la situation au Rwanda.
Que nous dit-il ? Il y a trois points dans sa communication. Il croit encore en la bonne foi des dirigeants des deux parties, sans cependant exclure qu'il y ait des individualités radicales dans l'un ou l'autre camp. Ensuite, il estime que le Rwanda est effectivement à la croisée des chemins, que les divergences politiques deviennent minimales entre les parties, et que donc on se rapproche d'un accord, mais que si ce n'est pas le cas, on va avoir un sérieux problème. Trois, Dallaire estime qu'il n'existe chez aucune des parties et là je cite un « masterplan » secret. Il est intéressant de se dire que, l'homme le mieux informé, pour les Nations Unies, au sujet du Rwanda, qui vient à New York les 30-31 mars, diffuse ce message au Conseil de Sécurité et au Secrétariat. Il est clair qu'à partir du moment où l'attentat éclate, les diplomates et les gens au Secrétariat ont pour information principale cet entretien. Ils se disent que c'est un dérapage, parce que Dallaire a tenu huit jours auparavant un langage optimiste. Le Secrétariat travaille dans cette optique de reconstruction possible, et c'est pour cela qu'il veut maintenir la MINUAR, alors qu'apparemment, à Bruxelles, on estime que ce scénario n'est plus tenable. » (136c)
Le 13 avril 1994, le secrétaire général adresse au président du Conseil de sécurité une lettre dans laquelle il explique le point de vue de la Belgique développé par le ministre Claes lors de sa rencontre à Bonn :
« He informed me that the Government of Belgium has decided to withdraw its contingent serving with UNAMIR at the earliest possible date » . (137c)
Suite à la position de la Belgique, le Secrétaire général recommande le retrait de la MINUAR, étant donné qu'il ne croit pas à la perspective d'un remplacement du contingent belge par un contingent d'une qualité équivalente :
« In the light of this decision by the Government of Belgium, it is my assessment that it will be extremely difficult for UNAMIR to carry out its tasks effectively. The continued discharge by UNAMIR of its mandate will become untenable unless the Belgian contingent is replaced by another equally well equipped or unless the Government of Belgium reconsiders its decision to withdraw its contingent.
In these circumstances, I have asked my Special Representative and the Force Commander to prepare plans for the withdrawal of UNAMIR, should this prove necessary, and send their recommendations to me in this regard. (...) » (138c)
La lettre du secrétaire est inacceptable pour le Conseil de sécurité qui estime qu'on ne peut lier une décision du Conseil de sécurité à une décision du gouvernement belge (139c).
La position de la Belgique n'a pas été suivie par le Conseil de sécurité. Le 16 avril 1994, dans une déclaration à la presse, le Conseil de sécurité exprime sa compréhension de la position belge mais reste divisé sur l'opportunité du retrait (140c).
Ce ne sera que le 21 avril 1994 que, dans sa résolution 912, le Conseil de sécurité décide un ajustement du mandat de la MINUAR et autorise une réduction de ses effectifs (141c).
Un des éléments du rapport du secrétaire général qui est communiqué au Conseil fait clairement état de ce que le retrait belge a « introduit un élément critique dans la détérioration de la situation » (142c).
À la question de savoir si l'attitude de la Belgique dans le dossier Rwanda a conduit à une certaine déception de la part des autorités des Nations unies, le représentant permanent belge, M. Brouhns répond :
« Il est clair que cela a créé un certain froid dans nos contacts avec le secrétariat. Il faut se mettre à leur place : leur travail n'était pas rendu tellement plus facile par notre conduite.
Il est clair qu'il y a eu des manifestations desquelles on pouvait tirer la conclusion qu'il y avait peut-être une certaine perte ou une baisse temporaire de crédibilité » (143c).
3.8.4.1. Non-application de l'article 17 des ROE
La MINUAR est restée impuissante et passive devant les massacres à grande échelle qui se sont déroulés sous ses yeux. Pourtant, l'article 17 de la directive énonçant les règles d'engagement permettait d'intervenir lorsque des crimes contre l'Humanité sont commis : « There may also be ethnically or politically motivated criminal acts committed during this mandate which will morally and legally require UNAMIR to use all available means to halt them. Examples are executions, attacks on demobilised soldiers, etc. During such occasions, UNAMIR military personnel will follow this rod outlined in this directive, in support of UNCIVPOL and local authorities or in their absence, UNAMIR will take the necessary action to prevent any crime against humanity. (...) »
Mme Des Forges déclare lors de son audition : « Le paragraphe 17 stipulait clairement que durant l'exercice de son mandat, la MINUAR pourrait être confrontée à des actes criminels motivés par des considérations ethniques ou politiques qui l'obligeraient moralement et légalement à intervenir, avec ou sans la collaboration des autorités locales pour éviter que ne soient commis des crimes contre l'humanité.
Les autorités de l'ONU m'ont expliqué que le mandat avait priorité sur ce document, ce qui expliquerait pourquoi la MINUAR n'a pu intervenir pour empêcher le génocide. » (144c)
M. Reyntjens confirme les propos de Mme Des Forges en expliquant : « Il est en tout cas établi que New York craignait une réapparition de situations à la somalienne et voulait à tout prix éviter d'impliquer les casques bleus dans une guerre civile. » (145c)
Pendant la période du 7 au 10 avril 1994, le gouvernement belge a non seulement invoqué le chapitre VII auprès des instances de l'ONU, mais également les règles d'engagement, comme base d'une intervention possible. La réponse de l'ONU fut négative.
Selon M. Claes : « On nous faisait toutefois remarquer qu'une telle approche risquait d'hypothéquer les autres opérations de maintien de la paix. Un renforcement des troupes demande en outre du temps.(...) Nous avons plaidé pour l'application des règles d'engagement. L'ONU a répondu qu'il incombait à Dallaire de prendre la décision.
Ce dernier ne disposait pas des moyens nécessaires et n'était même pas en mesure d'offrir une protection militaire pour une réunion avec le nonce apostolique et les ambassadeurs français, italien et américain. » (146c)
Dans le point 11 du « Rapport d'ensemble enseignements tirés de la mission des Nations unies pour l'assistance au Rwanda (MINUAR) octobre 1993-avril 1996 », on peut lire : « Certaines personnes ont avancé l'argument selon lequel la MINUAR aurait pu avoir recours à ses règles d'engagement, dont un paragraphe a été interprété comme autorisant la mission à prendre toutes les mesures nécessaires, y compris l'utilisation de la force afin de protéger les civils en danger. D'autres ont déconseillé toute tentative visant à usurper les pouvoirs du Conseil de Sécurité , qui, en vertu de la Charte des Nations Unies, est le seul organe habilité à décider des mandats des opérations de maintien de la paix. »
Comme cela a déjà été abordé dans le chapitre 3.4, l'application sur le terrain de l'article 17 par les militaires n'a jamais eu lieu.
Quant à leur connaissance par les troupes, le colonel Dewez déclare devant la commission: « Ces règles d'engagement comptent seize pages. Au niveau du bataillon on a diffusé une sorte de condensé reprenant les principes généraux. La totalité de ces règles d'engagement n'était donc pas diffusée, si bien que cette partie de l'article prévoyant d'intervenir contre des crimes comme un génocide a été un peu passée sous silence. » (147c)
Quant à leur application, le major Choffray déclare : « Nous recevions tous les ordres du secteur. Nous ne devons pas nous immiscer dans les affaires internes. Je n'ai pas de noms. Je ne pourrais dire qui exactement. Nous avons reçu l'ordre de ne pas intervenir dans les massacres. Je suppose que les autres hommes de la campagnie l'ont confirmé. » (148c)
Le major Bodart explique lui aussi, lors de son audition, que le fait d'intervenir dans les massacres aurait mis en péril la vie des ressortissants belges et qu'il comprenait la décision du colonel Dewez de non-intervention. (149c)
3.8.4.2. Impact sur le génocide
Alison Des Forges a fait une déclaration dure devant la commission au sujet, d'une part de l'impact qu'a eu la décision belge sur le déroulement du génocide et, d'autre part, de la responsabilité de la Belgique (150c) : « Sur le Plan international, il fut décidé de ne plus soutenir les officiers modérés, de ne pas utiliser les troupes d'évacuation qui auraient pu, en collaboration avec la MINUAR, empêcher le génocide. Les troupes belges furent également retirées du Rwanda tout comme la MINUAR. Cette série de décisions a un lien évident avec la survenance du génocide car on a abandonné les victimes Tutsi et les Hutu modérés après les avoir encouragés sur la voie de la démocratie.
Il ne faut bien entendu pas minimiser la responsabilité des Rwandais mais dans un monde aussi international que le nôtre, et vu notre implication dans le processus de paix, nous sommes aussi responsables parce que nous n'avons rien fait pour empêcher le génocide. »
Mme Suhrke, rapporteur du « Joint evaluation of emergency assistance to Ruanda » ne partage pas le même avis : « Je pense qu'on a perdu l'opportunité d'éviter le génocide fin 1992 début 1993. Il y avait à l'époque moyen de faire pression sur le président. Malheureusement, on ne se préoccupait que des accords d'Arusha. On pensait qu'un gouvernement nouveau pourrait rapidement être mis en place. On s'occupait donc de la problématique des extrémistes. Je pense que si la MINUAR était restée, cela n'aurait pas influencé la situation car elle manquait de tout. Elle n'avait plus de munitions, de vivres ni même de sacs de sable. » (151c)
Le 9 avril 1994 M. Reyntjens accordait une interview publiée dans Le Soir du 11 avril dans laquelle il dit : « Si on retire les nos troupes, on court droit à la catastrophe. » (152c)
Toujours selon M. Reyntjens, le rapport des forces entre les troupes étrangères et les troupes rwandaises devait permettre une intervention : « Nous disposions de 410 hommes des KIBAT, de 450 hommes de la brigade para, plus une réserve de 800 à Nairobi, 450 Français, de 80 Italiens et 800 hommes des Spécial Force américaines stationnée à Bujumbura, de 200 Ghanéens présents dans le secteur plus 600 en réserve et enfin 60 Tunisiens (...). Au total nous disposions donc de quelques 2 500 hommes. »
M. Reyntjens déclare qu'étant donné le nombre d'hommes que la Belgique avait sur place, c'était à elle de prendre l'initiative de réunir toutes les troupes.
Cependant, il ajoute : « Het FPR heeft het ons niet gemakkelijk gemaakt. het heeft het ultimatum uitgesproken dat als de buitenlandse troepen die geland waren om buitenlanders te evacueren binnen de 48 uren het land niet hadden verlaten, ze als tegenstander zouden worden beschouwd. Dat was geen behulpzame verklaring. Ze bemoeilijkt de zaken maar vormde geen volddoende reden om te zeggen : « Wij doen het niet. » De hoofdmacht van het FPR bevond zich op dat moment nog ver van Kigali en in Kigali zelf was het FPR best nog controleerbaar. Als het de bedoeling was om het Rwandese leger of haar dodende elementen te neutraliseren zou het FPR omwille van de public relations en het FPR kende daar iets van dit ultimatum niet gesteld hebben. Ik moet hieraan toevoegen dat het voor een onderzoeker gemakkelijk is dit te zeggen. Ook op het moment zelf heb ik de situatie zo ingeschat.
Je zou kunnen zeggen dat mijn inschatting van de situatie achteraf juist bleek. De positie van degene die de verantwoordelijkheid op zich neemt en in dat geval ging het om een regeringsbeslissing ligt natuurlijk veel moeilijker. U weet dat ik de beslissing van de regering bestreden heb, maar vanuit mijn positie kan ik gemakkelijker een streng standpunt innemen dan iemand die geconfronteerd wordt met de veiligheid van zijn militairen en van zijn burgers. Deze laatste staat voor een moeilijke beslissing. » (153c)
On peut lire dans « History of a genocide » de M. Prunier que le gouvernement belge voulait intervenir sous l'égide des Nations Unies et que Paris s'était opposé à une intervention internationale.
Le ministre Claes a confirmé ces faits : « C'était la teneur de mon entretien avec M. Boutros Ghali à Bonn. Paris n'était partisan que d'une intervention humanitaire de courte durée, et non d'une intervention comme quelques années auparavant. Le professeur Reyntjens, lui rêvait d'une force avec un noyau belge et avec des soldats de l'Italie, de la France et des États-Unis. Mais Paris disait résolument non et les Américains n'y songeaient même pas. »
Le professeur Reyntjens et Alison Des Forges ont répété ce point de vue lors de leurs auditions respectives: « À partir du 7 avril, et certainement depuis que nous avions, comme les Français et les Italiens des troupes sous notre drapeau, et que nous ne devions pas nous soucier d'un quelconque mandat, j'estime scandaleux j'utilise un terme fort que nous ne soyons pas restés, que nous n'ayons neutralisé Kigali et empêché l'extension, ce qu'on aurait pu faire jusqu'au 12 ou 13 avril. Je trouve cela parfaitement scandaleux. Je n'ai pas seulement tenu ces propos après coup, je les avais déjà tenus à l'époque. » (154c)
Un membre a fait remarquer à Mme Des Forges qu'elle a rappelé « que le général Dallaire avait contacté New York afin de demander un élargissement du mandat et un renforcement des effectifs. Elle a écrit dans un article que, si la MINUAR avait pu intervenir rapidement et fermement en avril, les massacres ne seraient jamais devenus un génocide. Sur quels éléments s'appuie-t-elle pour affirmer cela alors qu'elle reconnaît aussi que la MINUAR était sous-équipée ? »
La réponse de Mme Des Forges fut la suivante : « Le général Dallaire m'a convaincue qu'il aurait été hasardeux de faire passer la MINUAR à l'attaque si elle avait été seule. Mais, la première fin de semaine, des forces d'élite belges et françaises étaient sur place, des soldats américains se trouvaient à Bujumbura et que des soldats italiens ainsi que d'importants renforts belges étaient en Afrique de l'Est. Si toutes ces troupes avaient été mises ensemble, on aurait pu maîtriser la situation et le génocide aurait été manqué. » (155c)
Mme Des Forges a encore ajouté l'élément suivant : « Au mois de juillet de l'année dernière, j'ai rencontré un responsable de la mission belge à l'ONU. Je lui ai dit que j'étais convaincue qu'on savait déjà qu'un génocide se tramait lorsque la MINUAR se retira du Rwanda. Ce monsieur m'a répondu que c'était évident, mais qu'on n'aurait pas pu envoyer une armée blanche pour faire la guerre à une armée noire. » (156c)
Malgré ses recherches , la commission n'a pas eu de confirmation des propos de « ce monsieur. »
Le 10 avril 1994, le ministre Claes se refuse encore à parler de génocide mais est conscient de l'existence de tueries à grande échelle qui avaient été préparées : « ..., de nombreuses dépêches confirmaient des tueries à grande échelle. Cependant, des données contradictoires apparaissaient également en la matière. J'ai ici un article publié durant le même week-end des 9 et 10 avril dans Le Soir, que vous considérerez peut-être comme une source non fiable. Il reprend des questions posées à un Casque bleu belge à Kigali. À la remarque selon laquelle les organisations humanitaires évoquaient des milliers de morts, le Casque bleu répond : « Des milliers de morts, c'est peut-être beaucoup. Des blessés, en tout cas, il y en a plein (...). Mais, ils ne nous attaquent pas, à l'exception de cette grenade que nous avons reçue tout à l'heure. » Cela démontre que si d'un côté, des dépêches confirmaient des tuerais à grande échelle, d'un autre côté, des témoignages semaient le doute. de là à conclure qu'un génocide était en cours ... C'est un pas que je n'ai pas franchi et je me refuse encore à franchir aujourd'hui. » (157c)
Le Gouvernement belge, lors de la décision de retrait, mesurait-il le fait que ce retrait pouvait signifier la poursuite des massacres ?
La réponse du ministre Claes est nuancée. Après avoir rappelé que l'ambassadeur Swinnen était également arrivé à la conclusion selon laquelle le retrait était inévitable et que la MINUAR n'était pas capable d'arrêter les massacres, il s'exprime en ces termes :
« (...) j'ai reçu des rapports me décrivant les risques pris par nos paras pour dégager des personnes quasiment prisonnières. Si ces risques s'étaient prolongés, nous aurions eu de nouvelles victimes dans nos rangs. Ces deux éléments nous ont amenés à prendre la décision du retrait tout en sachant que les massacres allaient se prolonger et cela avec ou sans la présence de la MINUAR.
Le 17 avril, après l'évacuation, j'ai parlé d'un plan préparé et dénoncé le caractère systématique des exécutions.
Je ne peux pas préciser la date à partir de laquelle j'ai eu la conviction d'un génocide. Ce n'était pas lorsque nous avons quitté le Rwanda. »
Il est incontestable que les autorités avaient conscience du déroulement sur le terrain de massacres à grande échelle. Dès le 12 avril, on évoque l'existence de ceux-ci dans le télex envoyé à Washington pour expliquer le point de vue de la Belgique. Plusieurs documents officiels belges évoqueront ces massacres.
La question des dangers encourus par les réfugiés suite au départ de la MINUAR est soulevée aussi. Dès le 13 avril, dans un télégramme reprenant l'entretien qu'il a eu avec le chargé d'affaires américain, l'ambassadeur Noterdaeme, pose la question « quid des 5 000 civils rwandais actuellement sous la protection de la MINUAR ? » Et il affirme : ils devraient être remis dans un « safe environment. »
À cette époque, l'opération Silver Back est en cours. Son départ était prévu pour le 15 avril. Le gouvernement belge n'a-t-il jamais envisagé la possibilité, de sa propre initiative, de laisser Silver Back sur place afin de protéger la population civile rwandaise ou de le proposer à l'ONU ?
Le ministre Claes : « Vous rendez-vous compte que le FPR nous avait posé un ultimatum en disant que si nous n'étions pas partis le jeudi, il attaquerait ? ! Le FPR nous avait dit très clairement qu'il était d'accord pour une opération d'évacuation humanitaire à courte durée, mais qu'il ne fallait pas essayer de transformer le peace keeping en un peace making, sinon, il nous considérait comme des ennemis. (...) Dans le rapport que je viens de vous faire et dans mon contact avec l'ONU, j'ai bien mentionné cet élément qui était d'une importance militaire capitale. Toute l'évacuation se faisait par avion, en partant de Kigali, et rien n'est plus facile que de descendre un avion. C'était un élément capital qui a joué dans les prises de décision au niveau gouvernemental et dans les concertations avec l'ONU. » (158c)
Au cours de l'opération d'évacuation belge, quelques personnes appartenant au monde politique rwandais ont été évacuées.
Des critères objectifs ont-ils été définis par le gouvernement belge dans le choix d'évacuer ou de ne pas évacuer telle ou telle personne ?
Apparemment pas. Si le Premier ministre Dehaene ne se souvient plus de cette question de manière précise (159c), le ministre Claes a apporté la réponse suivante : « Er waren Rwandese vluchtelingen en politiek personeel op de Belgische ambassade. Ook onze diplomaten beschikten over Rwandees personeel, dat eveneens gevaar liep. Bovendien wist de heer Swinnen van de aanwezigheid van vluchtelingen op bevriende, eveneens gesloten ambassades. Ik heb Swinnen gevraagd alles in het werk te stellen om alle personaliteiten die hij in gevaar achtte en waarvan hij wist waar ze verbleven, te evacueren naar het vliegveld en ten minste op het vliegtuig naar Kenia te zetten. Daar zouden zij alleszins voorlopig veilig zijn. » (160c)
Le choix des personnes en danger qui pouvaient être évacuées sans compromettre la sécurité des Belges a été laissé à la libre appréciation de l'ambassadeur Swinnen. Le nombre de personnes évacuées par la Belgique est relativement restreint.
3.8.4.3. Réactions en Belgique
Suite aux événements du 7 avril, se sont tenues deux séances publiques de la commission des affaires extérieures de la Chambre (11 avril 1994 et 27 avril 1994) et une séance plénière au Sénat le 22 avril 1994. La commission constate qu'au cours de ces débats, aucun parlementaire n'a mis en cause les décisions du gouvernement belge d'évacuer nos ressortissants et de retirer le contingent belge de la MINUAR, quoique quelques parlementaires aient souhaité son remplacement par un contingent d'un autre pays.
(2) La presse et l'opinion publique
En général, la commission peut constater, en relisant les revus de presse de l'époque que les réactions à l'assassinat des dix paras et le sort des ressortissants belges résidant au Rwanda ont masqué le génocide qui s'y perpétrait.
La presse belge est relativement unanime sur la nécessité du retrait. Le titre de l'éditorial de La Dernière Heure est on ne peut plus explicite : « Laissons-les se débrouiller. » « C'est triste à dire pour nos coopérants, qui sont certainement pleins de bonnes intentions », écrit son auteur, Michel Marteau, « mais, ONU ou pas, nous n'avons strictement plus rien à faire au Rwanda. Si les ethnies locales (sic) ont envie de se trucider mutuellement pour la dixième ou quinzième fois en vingt ans, c'est leur affaire, pas la nôtre » (161c). « Assistance, foutaise !, commente dans un éditorial similaire, Jean Guy dans Le Peuple. « Pour quels intérêts particuliers a-t-on envoyé (nos paras) au casse-pipe ? Pour quels objectifs stratégiques ou autres les a-t-on expédiés en enfer ? » (162c)
Seule, La Libre Belgique se prononcera à plusieurs reprises jusqu'au 17 avril pour un « devoir de s'interposer au Rwanda » pour empêcher que « la boucherie actuelle se prolonge » (163c), pour protéger, vite les Rwandais » (164c), pour éviter « le précédent dangereux de forcer une décision qui appartient au Conseil de Sécurité et d'(organiser) un retrait pour morts d'hommes » (165c). Le 17, lorsque la décision a été entérinée, ce journal opère un repli prudent en actant simplement la décision du gouvernement : « La participation belge à la mission de l'ONU va prendre fin : elle n'a pas été moins glorieuse. Nos casques bleus ont parfaitement rempli leur mandat. » (166c)
Quant au rédacteur en chef du Soir , Guy Duplat, il titre son édito du 12 avril par un « ne pas abandonner » (167c), mais ne fera plus de commentaires dans les jours qui suivent et lorsque la décision du retrait est devenue publique. Ses journalistes se concentreront principalement sur l'évacuation des expatriés et des casques bleus, cette dernière « exfiltration à l'anglaise » étant saluée comme une « coup de maître » par un des envoyés spéciaux du journal à Kigali (168c).
Il est difficile de savoir avec précision quel est le puls de l'opinion publique belge. Assez curieusement, les deux enquêtes d'opinion qui ont lieu à cette époque ne montrent pas que cette opinion appuie totalement le gouvernement. Selon un sondage Dimarso-Gallup réalisé pour Het Volk immédiatement après le début du drame auprès de plus de 400 personnes, si plus de 80 % de personnes sondées en Flandre estiment que le gouvernement belge ne doit plus envoyer de militaires belges pour s'interposer dans le conflit rwandais, ils sont 51 % à être d'avis que la Belgique doit encore participer aux opérations de maintien de la paix demandées par les Nations unies (169c).
Par contre les chiffres sont différents selon un sondage organisé entre le 11 et le 13 avril par le bureau Survey & Action auprès d'un échantillon plus important (980 personnes de 18 ans et plus). Dans ce cas-ci, on trouve 40 % de personnes qui estiment que l'enjeu actuel au Rwanda pourrait justifier le risque de nouvelles pertes militaires en vies humanes, tandis que 48 % sont pour le maintien et l'envoi de militaires belges supplémentaires afin de contribuer au rétablissement de la paix (170c).
3.8.4.4. Évaluation de la décision
La problématique de l'évaluation des actes posés par les autorités politiques peut-être résumée par cette simple question posée aux acteurs politiques principaux : referait-on la même chose aujourd'hui ?
Le Premier ministre Dehaene, a affirmé lors des auditions : « Je vous répondrai avec l'autre exemple. Connaissant la situation au Kivu, nous avons pris la décision de ne pas participer à une opération de l'ONU dans cette région. »
Toujours à propos de l'exemple du Kivu, M. Dehaene a encore ajouté : « Nos efforts auraient été plus effectifs si nous avions annoncé notre participation. Je suis d'ailleurs persuadé que la MINUAR n'aurait jamais existé si nous n'y avions pas participé. Au vu de la situation du moment, notre décision est similaire à celle de ne pas envoyer des troupes au Kivu. J'en prends l'entière responsabilité. Mais, compte tenu des risques et du mandat qui rendait nos troupes inutiles, nous avons pris la décision que vous connaissez. » (171c)
M. Dehaene a encore précisé que, même s'il avait su qu'il s'agissait d'un génocide, la décision belge n'aurait pas été différente parce que l'ONU ne pouvait prendre parti : « Én van de moeilijkheden voor een VN-opdracht, en dat hebt u ook gezien in Joegoslavië, is dat de VN quasi onmogelijk een positie in één kamp kan innemen. De situatie van onmacht die vaak ten toon gespreid werd in Joegoslavië vloeit daaruit voort. » (172c)
Le ministre Claes ajoute à cela : « Notre préoccupation consistait à éviter à tout prix que d'autres Belges soient tués, après que les dix paras furent été assassinés. (...) On peut dire que c'est inadmissible mais telle était la préoccupation non seulement du gouvernement, mais aussi du parlement et de l'opinion publique. (...) Dans ce débat tragique, personne n'a raison. Je ne suis pas ici pour prétendre que le gouvernement a vu juste et qu'il ne mérite aucune critique. Il y a des leçons à tirer pour l'avenir. La leçon la plus importante est que, dans le cadre d'une politique préventive, plus structurée et nécessaire pour éviter la répétiotion de tels événements tragiques, on doit cesser de faire cette distinction théorique et bureaucratique entre des opérations de peace keeping et de peace making; par ailleurs, en cas d'envoi de troupes, un mandat suffisamment large doit être donné, avec un armement suffisamment rassurant et permettant de répondre à tout scénario imaginable ! Il s'agit du worst case scenario. »
Même si cela n'a rien à voir avec le dossier dont nous parlons, j'ajouterai que, apparemment, la communauté internationale n'a pas encore tiré cette leçon ou n'est pas prête à accepter les responsabilités d'une telle politique préventive. Il suffit de voir ce qui s'est passé depuis quelques semaines au Zaïre, aujourd'hui le Congo : malgré le vote d'une résolution décidant de l'envoi de militaires pour accompagner les opérations d'aide humanitaire, il a suffi que Washington se dise désintéressée et que l'Europe toute entière, aussi grande qu'elle soit ou prétendre l'être, regarde de l'autre côté pour qu'aucun soldat ne soit envoyé. Nous sommes donc encore loin de cette politique préventive dans le chef de la communauté internationale pour éviter la répétition des conflits. Personnellement, j'avais tiré cette conclusion immédiatement après le drame. J'ai donné l'ordre à un diplomate belge de défendre cette thèse dans une commission de l'ONU et j'ai prononcé le discours dont vous avec eu connaissance devant l'assemblée générale quelques mois plus tard à New York.
Je ne dis pas qu'on n'aurait pas dû prendre une autre position, celle que vous venez de formuler, c'est-à-dire d'envisager le retrait des Belges uniquement si ceux-ci étaient remplacés. Mais le Conseil de sécurité était tout à fait incapable de prendre une quelconque décision, j'ai encore essayé de vous l'expliquer aujourd'hui. De plus, il n'y avait pas de candidats. Chez nous, en Belgique, la préoccupation d'éviter de nouvelles victimes parmi nos militaires l'a emporté. C'est une question à laquelle ni vous ni moi ne pouvons donner de réponse. Je ne suis pas certain que cette question n'aurait pas été posée. Il sera très difficile d'arriver à un accord sur la grande vérité dans ce dossier. Nous avons agi en âme et conscience dans des circonstances très complexes. » (173c)
Le 14 avril 1994, le ministre Claes a déclaré qu'il était préoccupé par la situation des Rwandais, notamment ceux retenus dans le stade Kigali et à l'hôpital Fayçal. Le ministre percevait donc très bien la situation mais affirme qu'il n'avait pas les moyens d'y trouver une solution : « Oui, encore aujourd'hui la question est posée. Avec quel moyen aurions-nous pu évacuer les 10 000 Rwandais. » (174c)
Lors de son audition du 18 mai 1997, le ministre Delcroix a apprécié de manière suivante la décision du retrait. « Dans l'opinion publique ainsi que dans les milieux journalistiques et politiques, l'unanimité autour du retrait des troupes était telle qu'elle fit taire les quelques voix discordantes (...) Je n'ai jamais dit que c'était une décision correcte. Je constate seulement qu'à cette époque, personne dans le monde politique et dans les médias n'a contesté cette décision. » Il ne souhaitait pas porter lui-même un jugement sur le dossier rwandais : il laissait la commission le faire (175c).
La commission constate que les événements de l'ETO sont antérieurs à la décision de retrait des troupes belges de la MINUAR et concommittente à la décision d'évacuer des expatriés. La décision de quitter l'ETO relève d'une décision militaire, dont la commission a tenté de déterminer l'origine.
Entre le 7 avril 1994 et le 11 avril 1994, deux mille personnes avaient trouvé refuge à l'ETO au quartier de Kicukiro, dans l'est de la capitale rwandaise.
Le capitaine Lemaire commandait une compagnie du bataillon belge de la MINUAR, cantonnée à l'ETO.
Le 1er octobre 1997 le capitaine Lemaire a été entendu par le Tribunal International d'Arusha comme témoin à charge dans le procès de l'ancien vice-président des milices Interahamwe, Georges Rutaganda, accusé de génocide et de crimes contre l'humanité.
Plusieurs témoins à charge rwandais ont affirmé avoir vu Georges Rutaganda le 11 avril lors de leur fuite de l'ETO et lui avoir en vain demandé protection.
Selon le compte rendu de l'audition : « Dans un premier temps, la MINUAR nous a demandé de ne pas accueillir de réfugiés. Mais les pères salésiens étaient maîtres chez eux » a notamment expliqué l'officier belge. Très vite de nombreux habitants des environs craignant pour leur sécurité sont venus chercher refuge. « Toute la commune et toutes les couches sociales étaient représentées. »
Selon le capitaine Lemaire, la MINUAR ne s'attendait pas à une crise de cette ampleur « on pensait revivre une crise comme en février, et qu'il y avait donc des personnes directement menacées (...) nous ne pouvions pas sortir, nous avons donc fortifié l'ETO, sans savoir s'il fallait attendre une attaque directe ».
Selon les déclarations du témoin, sa compagnie ne disposait que de moyens limités pour défendre l'ETO. De plus , sa mission souffrait d'un mandat trop étroit. D'après le capitaine Lemaire, certains types d'armes, comme une mitrailleuse lourde de 50 mm installée sur une position défensive, aurait requis l'autorisation expresse du secrétaire général des Nations Unies avant de pouvoir être utilisée. Les jours passant, des groupes d'extrémistes hutu se sont enhardis à se montrer, témoignant d'une agressivité croissante. Des rafales d'armes automatiques ont été tirées contre les positions belges de l'ETO, a précisé le témoin.
Dès le 9 avril, la compagnie belge de l'ETO a dû aller chercher des expatriés en ville ». Nous avons reçu l'ordre du colonel Marchal de n'évacuer que les blancs » a indiqué le capitaine Lemaire. « Nous lui avons répondu que c'était impossible et que de toute façon nous avions déjà évacué les autres (...). Si nous avions reçu des ordres, l'ETO serait restée une position militaire et non pas un camp de réfugiés » a poursuivi le témoin , soulignant le « flou » dans lequel le commandant de la MINUAR l'avait laissé face à une situation d'urgence.
Une évacuation des réfugiés de l'ETO aurait requis des moyens logistiques dont la MINUAR ne disposait pas. En outre , leur évacuation sur le seul site de la ville l'aéroport international de Kigali aurait à nouveau posé problème de leur sécurité, dès lors que le mandat de la MINUAR restait inchangé et que son retrait était programmé.
Hors du mandat onusien , l'intervention française du 11 avril 1994 à Kigali, pour évacuer les expatriés, a donné lieu à un incident que l'officier belge a relaté en détail : « Ils sont arrivés à l'ETO le 11 au matin. L'officier français ne voulait récupérer que trois Français et les Italiens. Nous avions recensé 150 expatriés, des Blancs et des Africains, des employés de l'ONU et des religieux, et préparé des véhicules ».
« Nous avons répondu aux Français : « Si c'est comme ça, les Français partiront en dernier (...). Vous les Français, vous pouvez profiter de vos liens privilégiés avec les Forces Armées Rwandaises (FAR) pour passer les barrages et emmener tout le monde . »
147 réfugiés ont finalement été conduits à l'École Française, selon Luc Lemaire. Quant aux autres, ils ont été livrés à eux-mêmes, a affirmé l'officier belge.
Avec une tension perceptible dans la voix, le témoin a raconté comment il a caché aux réfugiés de l'ETO les préparatifs de départ de sa compagnie « pour ne pas avoir à tirer sur ces réfugiés lors de leur repli » a-t-il expliqué. « Tout était prêt, et une demi-heure après l'ordre de repli, nous étions partis » a indiqué l'officier belge. « Seuls les hommes de la dernière jeep ont dû tirer en l'air pour se dégager, quand les réfugiés se sont rendus compte que l'on partait (...). » (176c)
Selon le capitaine, au départ des soldats belges, les réfugiés, livrés à eux-mêmes, ont tenté de quitter l'ETO pour le stade Amahoro. Bloqués par des barrages, la plupart se sont fait massacrer au carrefour de Nyanza (177c).
Mme Mukesshimana, veuve de Boniface Ngulinzira(ancien ministre des Affaires Étrangères qui a participé activement à la négociation des accords d'Arusha en avril 1992 et juillet 1993) a déposé plainte contre la MINUAR pour non-assistance en danger (178c). Elle a fournit le témoignage suivant à la commission : « Le 6 avril, vers 20 heures, un ami nous a téléphoné pour nous dire que le président aurait été assassiné. Peu après, la Radio des Mille Collines diffusait la même information. Nous pressentions le drame. Vers 5 heures du matin, nous avons entendu les premiers tirs dans le camp de la garde présidentielle. La radio a diffusé un communiqué enjoignant à la population de rester à la maison. C'était de mauvais présages. Les bourreaux allaient pouvoir trouver facilement leurs victimes. Les Casques bleus belges nous ont appris que le ministre du Travail et des Affaires sociales avait été assassiné. Les massacres avaient commencé. Les Casques bleus nous ont alors évacués, cachés dans des camions, ver un endroit plus sûr qui s'est avéré être l'ETO dirigée par les pères salésiens où se trouvait un détachement important de Casques belges de la MINUAR. Les réfugiés affluaient de plus en plus nombreux car les miliciens assassinaient partout les Tutsis et les opposants au régime (...). Le 9 avril, les militaires belges commencent à évacuer. Le chef des militaires belges ne veulent pas prendre le risque d'évacuer un ministre, membre d'un parti d'opposition. Ils le condamnent ainsi à mort et refusent même de le reconduire à notre maison.
Le 11 avril, le père supérieur de l'ETO nous a demandé de dégager les chambres individuelles pour installer l'état-major de la MINUAR. Entre-temps, un détachement de militaires français était venu aider les Belges pour l'évacuation. Le chef de ce détachement avait accepté de conduire mon mari chez l'ambassadeur de France où il serait en sécurité. Le chef militaire belge s'est interposé. Les Français se sont inclinés. Pourtant, ils ne risquaient rien. Plus tard, tous ceux qui ont été abandonnés là, ont été assassinés. Ensuite, nous avons vu revenir les Casques bleus belges et les militaires français. Tous ceux-ci nous ont alors abandonnés (...).
Depuis le 11 avril 1994, date de l'assassinat de mon mari, je me pose des questions. A-t-il été assassiné parce que les Casques bleus belges ont refusé de l'évacuer alors qu'il était menacé ? Pourquoi avoir abandonné tous ceux qui avaient reçu des menaces ? La Belgique respecte les droits de l'homme et est historiquement liée au Rwanda. Pourquoi donc a-t-elle laissé le peuple rwandais alors même que celui-ci avait besoin de la Belgique ? Son attitude allait influencer la Communauté internationale. La Belgique souhaitait le retour du multipartisme et de la paix au Rwanda. Elle souhaitait que les accords d'Arusha soient mis en application. Pourquoi avoir laissé massacrer ceux qui voulaient la paix ? » (179c)
Le colonel Marchal a déclaré, lors de l'audition du 10 juin 1997, qu'il s'agissait dans ce cas d'un abandon : « Le problème des réfugiés trouve une solution de facto puisqu'ils envahissent les cantonnements et qu'ils ne les ont pas quittés. Nous n'avions d'ailleurs pas la force d'appliquer l'ordre d'évacuation. Cependant, le 9, le détachement qui se trouve à Don Bosco sera utilisé pour reprendre pied à l'aérodrome. Il n'avait pas mission d'abandonner les réfugiés de Don Bosco mais de se rendre à l'aéroport. En réalité, cela équivalait à un abandon. » (180c)
Le capitaine Lemaire précise les propos du colonel Marchal : « Le colonel Dewez m'a donné l'autorisation [d'abandonner les réfugiés] avec l'accord du colonel Marchal. »
Ce drame met en lumière les conséquences des décisions prises à différents niveaux, et leurs conséquences sur le drame rwandais.
Ces décisions relèvent des autorités de l'O.N.U., des autorités des différents pays concernés, membres du Conseil de Sécurité, particulièrement les USA et la France, et des autorités politiques et militaires belges.
Dans le cas de l'ETO, il apparaît à la commission que la décision de quitter l'école relève de l'autorité militaire. L'évacuation d' l'ETO aurait dû se faire en offrant des garanties au réfugiés rwandais.
Il ressort de l'aperçu des activités parlementaires concernant les événements du Rwanda que le Parlement belge s'est toujours intéressé au Rwanda. La commission constate toutefois également qu'après les événements des 6 et 7 avril 1994, les interventions parlementaires concernant le Rwanda se sont intensifiées.
3.9.1. La période du 1er janvier 1993 au 19 novembre 1993 (date de la prise de décision de la Belgique de participer à la MINUAR)
Interpellations sur :
- Les déclarations du président Habyarimana du 15 novembre 1992 concernant les accords d'Arusha (181c);
- La violation des droits de l'homme au Rwanda (182c);
- La situation au Rwanda et aide belge au développement (183c);
- Le danger de voir la Belgique adopter une politique différente au Rwanda et au Zaïre, en ce qui concerne l'aide au processus de démocratisation en Afrique centrale (184c);
- La coopération technique militaire avec le Rwanda (185c);
Questions écrites sur :
- Le Fonds de soutien aux élections (186c);
- L'envoi d'observateurs militaires (MONUOR) à la frontière entre le Rwanda et l'Ouganda (187c);
- L'octroi de bourses d'études belges au Rwanda (188c);
- L'aide humanitaire urgente, entre autres pour le Zaïre, le Burundi et le Rwanda (189c);
3.9.2. La période du 20 novembre 1993 (participation de la Belgique à la MINUAR) au 5 avril 1994.
Il a été question, à la Chambre des représentants et au Sénat confondus, de la décision de la Belgique de participer à la MINUAR et ce, à l'occasion des activités parlementaires suivantes :
Débats sur le budget de 1994 : en Commission des Affaires étrangères, en Commission de la Coopération au Développement et en Commission de la Défense du Sénat (190c) ainsi qu'en Commission des Affaires étrangères et en Commission de la Défense de la Chambre des représentants (191c);
Interpellations sur :
- L'assurance des militaires belges engagés dans des opérations de l'ONU (192c);
- La situation au Zaïre, au Rwanda et au Burundi et la présence belge : mise en oeuvre des accords d'Arusha et déroulement de l'opération MINUAR : dégradation du climat politique et signaux de réactions antibelges (193c);
- Des déclarations du ministre de la Défense nationale à la suite de son voyage au Rwanda : menace de retrait des troupes belges au cas où le Rwanda n'appliquerait pas les accords d'Arusha (194c);
- La fonction des Casques bleus belges dans le processus de démocratisation du Rwanda : mise en oeuvree des accords d'Arusha (195c);
Questions écrites sur :
- La surveillance, par la gendarmerie, des ambassades de Belgique à Kigali et à Bujumbura (196c);
- Le statut des forces armées belges chargées de l'exécution des mesures prises par le Conseil de sécurité des Nations unies (197c);
- Le désarmement de l'armée rwandaise par les troupes de l'ONU (198c);
- La coopération technique militaire avec le Rwanda (199c).
Après les événements des 6 et 7 avril 1994, le nombre de débats parlementaires concernant la question rwandaise a augmenté nettement :
Débat au sein de la Commission des Relations extérieures de la Chambre des représentants, à l'occasion de la communication gouvernementale consacrée aux événements du Rwanda (200c);
Hommage aux victimes en séance plénière de la Chambre des représentants (201c);
Hommage aux paras belges tombés au Rwanda et aux victimes du génocide en séance plénière du Sénat (202c);
Interpellations, questions écrites et orales :
- concernant l'assassinat des dix paras belges au Rwanda (203c);
- les collaborateurs ONG qui ont perdu la vie (204c);
- information des familles des victimes civiles belges (205c);
- condoléances du Gouvernement belge aux gouvernements rwandais et burundais à la suite de la mort des présidents de ces deux pays (206c).
L'on a également consacré de nombreux débats parlementaires au génocide du Rwanda :
Débat au sein de la Commission des Relations extérieures de la Chambre des représentants à la suite de la communication gouvernementale consacrée aux événements du Rwanda (207c);
Hommage aux victimes en séance plénière de la Chambre des représentants (208c);
Hommage aux paras belges tombés au Rwanda et aux victimes du génocide en séance plénière du Sénat (209c);
Interpellations concernant le génocide au Rwanda (210c);
Question orale à propos de l'assassinat des dix paras belges au Rwanda (211c);
Question orale sur l'installation, dans la caserne de Flawinne, d'une plaque commémorative à la mémoire des soldats assassinés au Rwanda (212c);
Questions écrites relatives à l'indemnisation pour la mort des paras à Kigali et à l'indemnisation pour la perte d'effets personnels (213c);
Question écrite concernant les collaborateurs ONG qui ont perdu la vie au Rwanda (214c).
L'inquiétude des parlementaires quant à l'éventuel retrait de la MINUAR ou, du moins, de ses éléments belges, s'est traduite par une série d'initiatives, dont les plus caractéristiques étaient les suivantes :
1. Dans son interpellation du 15 février 1994 (215c), M. Van Peel dit craindre que le processus de paix n'échoue, en raison notamment des dissensions réciproques au sein d'un certain nombre de partis importants (MDR, Parti Libéral, PSD). Il y a des tensions ethniques. Est-il exact que le président Habyarimana bloque sciemment les accords ? Les sentiments antibelges reviennent-ils en force ? Quelle incidence cela a-t-il sur la MINUAR ? Il y a déjà eu un léger incident.
Le ministre Claes confirme les dissensions au sein du MRD et du PL, qui n'ont permis la mise en place ni du gouvernement transitoire ni du Parlement.
Il a signalé aux forces de l'entourage de la présidence et du FPR que les risques de polarisation ne sont pas imaginaires. Les ambitions personnelles et les rivalités ethniques freinent le processus de paix. Le secrétaire général de l'ONU en a été averti.
La présence de Casques bleus belges n'est pas une opération belge. La MINUAR est placée sous le commandement du général Dallaire.
Cette mission de l'ONU était une condition pour que le FPR participe au processus de paix et elle constitue un facteur stabilisateur.
Il confirme néanmoins que des réactions antibelges se déclenchent régulièrement et que la radio a dit pis que pendre des Casques bleus belges.
Il espère que toutes ces difficultés ne seront que temporaires.
2. Dans son interpellation du 29 mars 1994 (216c), M. Van Belle dit craindre que le retrait annoncé de la MINUAR n'ait des conséquences dramatiques, tant pour la population que pour nos compatriotes. « Het geweld zal in alle hevigheid losbarsten », déclare-t-il. Et « De Tutsi-minderheid zou meedogenloos worden afgeslacht ». Il dénonce l'attitude laxiste de la Belgique face à l'invasion du FPR.
Parmi les intérêts qui jouent un rôle, outre les questions ethniques, il cite la lutte entre les élites hutues.
Il se demande également quel rôle le FPR joue, puisqu'il refuse manifestement la participation du CDR à la formation des institutions. N'est-ce pas là une forme d'obstruction ?
Il demande une enquête sur place, à l'occasion de rumeurs selon lesquelles les assassinats du leader du CDR Bucyana et du ministre hutu Gatabazi favorable aux Tutsis auraient été organisés par les rebelles pour aggraver les clivages ethniques.
Selon des déclarations antérieures du ministre des Affaires étrangères, les troupes de l'ONU disposent d'un mandat de désarmement qui n'entrera en vigueur qu'une fois que le gouvernement transitoire aura été installé.
De nombreux gendarmes et soldats de l'armée régulière ont toutefois d'ores et déjà volontairement rendu les armes, alors que les rebelles ne sont pas inquiétés.
Un retrait dans ces circonstances représenterait une catastrophe pour les Tutsis. L'interpellateur a dès lors posé expressément la question : « Zult u dan overgaan tot de terugtrekking van de Belgische blauwhelmen, wetende welke dramatische gevolgen dit zal hebben ? »
Le ministre Delcroix promet une prolongation du mandat de l'ONU de deux à trois mois, avec une mission renforcée.
Le président constitue la seule instance qui fonctionne encore. Le gouvernement et le parlement transitoire ne sont pas encore à l'oeuvre.
La prolongation de la présence belge dépend de l'exécution des accords d'Arusha.
La Belgique ne peut pas enquêter sur des meurtres politiques. Ce sont la gendarmerie et la police rwandaises qui sont compétentes en la matière, de même que la police civile de l'ONU.
Nos militaires n'ont pas été chargés d'une mission de désarmement. Des armes sont malgré tout saisies régulièrement, mais à des postes de contrôle mixtes MINUAR-gendarmerie.
Il a plaidé par ailleurs sur place, à Kigali, pour un élargissement des compétences du commandant de l'ONU, le général Dallaire.
En ce qui concerne l'attitude des militaires, ces derniers ont dû s'adapter, à leur arrivée, à une mission de peacekeeping, mais il prétend que la formation et les exercices sont bons, y compris les instructions sur le droit humanitaire, la situation locale et la langue.
Il est possible de donner des cours et une préparation supplémentaires, mais au détriment de la rapidité d'intervention.
Il n'est pas question de mettre fin à la coopération technique militaire, parce que notre présence constitue également un facteur de stabilité pour les armées locales. Nos militaires sont souvent les seuls à exercer une influence sur les armées locales.
En ce qui concerne le renforcement du mandat de la MINUAR, il a utilisé cette possibilité dans ses conversations avec les autorités rwandaises comme moyen de pression en vue d'une solution politique. Avec fruit, puisque la demande d'une plus grande modération de la part d'une radio locale a été reçue favorablement.
M. Van Belle dit être rassuré, car il a été confirmé que les troupes des Nations unies ne se retireront pas le 4 avril, mais que leur mandat sera prolongé de deux à trois mois.
3. Dans sa question écrite du 14 février 1994 (217c) adressée au ministre des Affaires étrangères, M. Van Belle se plaint du fait que les troupes des Nations unies adoptent une attitude unilatérale dans le désarmement des belligérants. Il affirme que les troupes du Front patriotique rwandais ne sont pas inquiétées.
Le ministre répond, le 15 mars 1994, que le désarmement ne figure pas parmi les missions de la MINUAR. Tout au plus peut-elle aider les autorités rwandaises dans leur mission, qui est de parvenir à une fusion des deux armées.
À cet égard, le ministre regrette que l'on distribue des armes à la population civile et aux milices de certains partis politiques, ce contre quoi seules les autorités rwandaises peuvent intervenir.
4. Exposé du Gouvernement concernant les événements du Rwanda à la Commission des Affaires étrangères de la Chambre, le 11 avril 1994.
Le Premier ministre Dehaene déclare que depuis l'attentat contre les présidents du Rwanda et du Burundi et la mort des paras, le Gouvernement a suivi la situation de près.
Il a été convenu avec le secrétaire général des Nations unies qu'il fallait renforcer les conditions de sécurité pour nos Casques bleus.
L'on envisage, en dehors du cadre des Nations unies, une mission humanitaire alliée avec la France et les États-Unis, visant à rapatrier les Belges. L'armée sera chargée de son exécution et en sera responsable.
Le ministre Claes donne un aperçu des événements depuis le 6 avril.
Les contacts avec le secrétaire général des Nations unies montrent que l'on n'envisage pas d'élargissement du mandat de la MINUAR à court terme. Seule une réduction des effectifs est possible.
Il confirme la difficulté de l'opération de rapatriement, notamment en raison de l'attitude antibelge provoquée par les extrémistes hutus.
C'est à cause de cette attitude que les Belges n'ont pas reçu l'autorisation d'atterrir à Kigali. Entre-temps, l'on est quand même parvenu à obtenir cette autorisation grâce à l'ambassadeur Swinnen, à l'ambassadeur de France et au nonce apostolique.
Il s'agit d'une évacuation de l'ensemble des civils de nationalité étrangère qui le souhaitent.
Nos Casques bleus belges ont reçu l'autorisation du général Dallaire de collaborer à cette opération et notamment à la protection de notre chancellerie où il fallait maintenir coûte que coûte le centre de communication en état.
Deux semaines plus tôt, il avait convoqué l'ambassadeur du Rwanda pour lui demander avec insistance de mettre fin à l'intoxication contre les Belges diffusée par les radios libres.
Il se pose maintenant la question de savoir si la création de la MINUAR et la participation belge n'étaient pas une erreur.
Le 7 janvier 1994, la décision a été prise par le Conseil de sécurité de l'ONU.
Le 5 avril 1994, l'on a autorisé une prolongation de quatre mois.
Le Belges n'ont fourni que la moitié des 800 hommes demandés et ont refusé le commandement.
À la mi-février 1994, il a tenté en vain d'obtenir un élargissement du mandat.
Quant à lui, il ne connaît pas la réponse à la question de savoir s'il faut retirer les troupes belges de la MINUAR.
Le ministre Delcroix décrit le déroulement de l'opération humanitaire en cours.
En ce qui concerne la mort des paras, une enquête approfondie doit déterminer dans quelle mesure cette section a agi de manière indépendante, et comment elle communiquait avec le commandement.
Dans le débat qui a suivi, M. Gol met la responsabilité au niveau de l'entourage du président Habyarimana qui a laissé pourrir le processus de paix.
Il n'estime pas recommandable de participer à une mission ONU dans des pays où nous avons un passé de colonisateur et des compatriotes sur place. Il rappelle que la décision a été prise jadis avec trop d'empressement.
Il rappelle l'opposition libérale à la politique gouvernementale et à toute forme d'aide sur le plan militaire et sur le plan de la sécurité.
M. Eyskens fait une comparaison avec l'opération de 1990, alors qu'il n'y avait pas de présence de l'ONU, ni de noyau dur hutu qui agissait contre les Belges. Malgré la détérioration de la situation, il reste opposé à une rupture avec le Rwanda.
Il estime néanmoins que le mandat des Nations unies est insuffisant. La force de paix des Nations unies doit pouvoir disposer d'armes perfectionnées et non d'armes qu'elle ne peut pas utiliser.
Force est de se demander ce que l'on fera si le génocide prend de l'extension. Devons-nous rester les bras croisés ?
Il n'est pas partisan d'une politique curative, qui présente beaucoup de risques et coûterait, en outre, beaucoup d'argent.
M. Beaufays rappelle l'existence d'un noyau dur opposé aux accords d'Arusha.
Il constate l'élimination à Kigali de gens qui figurent sur les listes établies en 1990 par la Sûreté rwandaise.
Il incrimine la caste au pouvoir et la fameuse Radio Mille Collines.
Il note l'impossibilité de l'élargissement du mandat ONU, qui ne doit pas empêcher la mise en oeuvre de moyens assurant la sécurité de l'évacuation des Belges.
Il prône une recomposition de la MINUAR par d'autres nationalités.
M. Chevalier souligne qu'il faut constater que l'accord d'Arusha est presque enterré.
Nous devons nous demander ce que nous faisons encore dans cette partie de l'Afrique.
Si nous voulons procéder malgré tout à une intervention militaire dans le cadre d'un mandat des Nations unies, nous devons assortir cette intervention de conditions. Si ces conditions ne devaient pas être remplies, nous devons renoncer à poursuivre notre participation.
En outre, nous ne pouvons pas nous permettre de procéder chaque fois à de nouvelles opérations d'évacuation et, dans l'ensemble, nous devons nous en tenir à l'aide humanitaire à la population.
Mme Aelvoet affirme que l'attitude antibelge est due en partie à l'affirmation, diffusée par Radio Mille Collines, selon laquelle les Belges auraient abattu l'avion des présidents.
L'influence de cette radio va beaucoup plus loin que Kigali. La radio officielle n'a jamais démenti ces informations. Cela en dit long sur ceux qui ont les rênes en mains. Une enquête des Nations unies pourrait tirer tout cela au clair.
On ne peut pas nier que, parallèlement à l'assassinat des Belges, on ait organisé une chasse aux Tutsis et aux opposants hutus ainsi qu'aux responsables des organisations de défense des droits de l'homme et d'aide au développement.
On assassine surtout des Tutsis. C'est l'oeuvre de la garde présidentielle, des unités de l'armée et des milices. Comment ont-elles obtenu ces armes ?
Le CDR achète des armes aux Russes et aux Chinois grâce au trafic de drogues.
La même députée estime que c'était une erreur que de fournir des troupes à la MINUAR dans un pays dont on a été le colonisateur. Il serait préférable de remplacer les Belges au Rwanda par des troupes issues d'autres pays.
M. Harmegnies appuie la demande d'une enquête à effectuer par l'ONU, que le gouvernement adressera à son secrétaire général.
Il entend également faire contredire les fausses rumeurs selon lesquelles les Belges sont impliqués dans l'attentat contre le président Habyarimana.
Il appuie l'envoi d'une opération humanitaire. Si les conditions politiques sont réunies, nous pouvons plaider pour un renforcement du mandat des Casques bleus. Sinon nous ne pouvons pas les maintenir sur base du mandat actuel.
Il entend également faire contredire les fausse rumeurs selon les Belges sont impliqués dans l'attentat contre le président Habyarimana.
Il appuie l'envoi d'une opération humanitaire. Si les conditions politiques sont réunies, nous pouvons plaider pour un renforcement du mandat des Casques blues. Sinon nous ne pouvons pas les maintenir sur base du mandat actuel.
M. Sleeckx insiste pour que le gouvernement rwandais rétablisse la vérité quant à la responsabilité de l'attentat perpétré contre le président Habyarimana.
Il estime que la Belgique a encore une mission très importante à remplir sur place, afin de ramener la paix.
Il soutient l'action humanitaire. En ce qui concerne les Casques bleus, il faut mieux les protéger; en effet, ils ne peuvent pas se défendre avec leurs armes légères. Une telle condition doit être une condition sine qua non de participation.
M. Van Grembergen estime qu'il faut évacuer les Belges le plus rapidement possible.
Pour ce qui est des Casques bleus, il est convaincu qu'il faut les retirer, si leur mandat reste identique.
Cela n'exclut pas que les Belges puissent encore travailler ailleurs dans le cadre de l'ONU.
Il condamne les trafics d'armes, qui ont notamment contribué au malheur du Rwanda.
Le retrait des troupes belges de la MINUAR a également fait l'objet des initiatives parlementaires suivantes :
Débat relatif au budget 1995, avis de la commission des Relations extérieures de la Chambre des représentants (218c) concernant la reconstruction du Rwanda : aide de la Belgique sur les plans de la justice et des soins de santé;
Interpellation sur la situation dramatique et intolérable qui prévaut au Rwanda (219c);
Question écrite sur le matériel militaire vendu et perdu lors du retrait des troupes belges de la MINUAR (220c).
3.9.6. Évaluation des événements et de la politique belge à l'égard de l'Afrique et conclusions politiques à leur propos
La majeure partie des initiatives parlementaires ont porté sur l'évaluation des événements qui ont eu lieu au Rwanda et l'évaluation de la politique que la Belgique a adoptée à l'égard de l'Afrique à la suite desdits événements :
Interpellations, questions orales et écrites à propos :
- des interventions ratées des organismes internationaux dans les régions à conflits, comme le Rwanda, la Bosnie (221c), ...;
- de la politique belge à l'égard de l'Afrique et de son avenir (222c);
- de la participation belge aux opérations de l'ONU après les événements du Rwanda (223c);
- de la coopération technique militaire avec le Rwanda (224c).
Interpellations, questions orales et questions écrites à propos des thèmes connexes suivants :
- réfugiés et demandeurs d'asile rwandais en Belgique et membres des milices Interahamwe (225c);
- livraisons d'armes à des bandes rwandaises (226c);
- enquête pénale relative aux activités du présentateur de radio belge de Radio Mille Collines à Kigali (227c);
- surveillance de l'ambassade belge au Rwanda par des gendarmes (228c);
- intervention militaire française au Rwanda (229c);
- danger de voir le drame rwandais s'étendre au Burundi (230c).
Il convient d'examiner l'attitude de l'actuel ministre de la Défense nationale et du ministre des Affaires étrangères à cet égard. Il faut, en effet, répondre à la question de savoir de quelle manière ils ont informé le Parlement. Le 22 novembre 1995, les deux ministres ont, en effet, été interrogés par la Commission de la Défense nationale de la Chambre des représentants qui leur a demandé s'ils savaient éventuellement au préalable qu'un génocide et des attaques contre les soldats belges allaient se produire.
Ainsi le député Harmegnies, parmi d'autres, a-t-il interrogé très concrètement le ministre de la Défense : « Il s'avère aujourd'hui que notre renseignement militaire a pu collecter, en janvier 1994, des informations alarmantes sur la préparation du génocide, de l'assassinat des Casques bleus et peut-être de l'attentat contre le président rawandais. » (231c)
Pourtant, la note du 2 février 1994 mentionne qu'« un des buts poursuivis par ces milices serait de viser en particulier les Mil (BE) participant à la mission UNAMIR, afin de provoquer le retrait du DET (BE), (...) », alors qu'elle dit du rôle des Interhamwes qu'« ils auraient notamment reçu la mission de localiser toutes les familles tutsies. Des assassinats de Tutsis seraient prévus dans les zones où ils sont concentrés. » (232c) Bien que la note en question relativise aussi, dans un long commentaire, l'importance des Interhamwes et les résultats de leurs actions, il convient malgré tout de se demander pourquoi le ministre a privé le Parlement des informations (dures) que contenait la note.
Lors de cette même réunion, le ministre des Affaires étrangères a déclaré au sujet de l'information reçue concernant un possible attentat contre les Casques bleus belges : « D'autres informations de même source relataient le fait que les Interahamwe utilisaient du matériel de communication de l'armée et l'existence d'un plan visant à tuer ou blesser des militaires belges afin de provoquer le retrait des détachements belges ou même de la MINUAR. Je tiens à souligner ici que les informations concernant un possible attentat contre les Casques bleus n'apparaissent qu'une seule fois dans les messages en provenance de notre ambassade.
Elles émanent d'un seul informateur et n'ont pu être vérifiées. Il serait d'ailleurs peu sérieux de faire le lien avec le drame du 7 avril. Nos paras n'ont en effet pas été assassinés afin de provoquer le retrait de leur détachement ou de la MINUAR, car il était trop tard pour cela, mais dans l'exécution d'une mission s'opposant au plan des Interahamwes. » (233c)
Cependant, la commission a constaté que des informations provenaient de plusieurs sources (entre autres du lieutenant Nees) et que cette information était parfaitement vérifiable.
Le 27 juin 1996, les deux ministres ont aussi dû répondre à des questions similaires au Sénat, devant la Commission des Affaires étrangères. À cette occasion, le ministre de la Défense nationale a bien mentionné les informations précitées, mais il en a tiré la conclusion contradictoire que rien n'indiquait que des assassinats de militaires belges pourraient être commis. (234c)
Ce chapitre aborde la manière dont s'est déroulée l'annonce aux familles de la mort des paracommandos, la manière dont ils ont pu assurer l'adieu aux défunts et quel fut ensuite l'accompagnement prodigué par l'armée belge.
La commission constate que les familles des victimes n'ont pas eu l'occasion de dire adieu à leurs proches assassinés.
Les dix paracommandos ont été assassinés dans la matinée du 7 avril 1994. Cette nouvelle n'est arrivée que tardivement au SGR Selon certaines sources, à 15 h 30, une radio belge annonce la mort de deux observateurs militaires belges de l'ONU. Il est demandé au C Ops de vérifier cette nouvelle. À 20 h 10, l'assassinat de trois militaires et la disparition de dix autres sont annoncés. Cette information a transité par New York. À 20 h 30, le colonel Dewez signale au C Ops qu'il déménage son QG et qu'il ignore tout de la mort de ses hommes.
À 20 h 45, une liaison radio avec le colonel Dewez est établie. Celui-ci informera un peu plus tard le C Ops qu'il est sans nouvelle du peloton Mortiers. Ce n'est qu'à 21 h 30 que le C Ops a connaissance de la liste des paracommandos assassinés.
Lors de son audition, Mme Dupont déclare : « Déjà à ce moment (après l'annonce de la mort du président Habyarimana), un témoin à Kigali parlait de la mort de trois personnes. Les médias ont continué à diffuser des informations de plus en plus inquiétantes. J'ai alors téléphoné à la cellule de crise, où l'on m'a assuré qu'aucun soldat n'était prisonnier. J'ai appris plus tard qu'on m'avait menti. » (235c)
La commission constate que, par manque de communication interne, le C Ops à Bruxelles n'a été informé qu'en dernier lieu de ce qui s'était passé à Kigali.
Les membres des familles des paracommandos assassinés ont tous été informés de l'assassinat de leur époux ou de leur fils entre 22 h 00 et 4 h 00. Ce sont des militaires « disponibles » qui ont été chargés de cette pénible mission. Ils se sont contentés de leur lire le contenu d'un télégramme. Mme Dupont déclare lors de son audition :
« À trois heures du matin, une personne s'est présentée et m'a lu un télégramme faisant état de l'assassinat du caporal Debatty ainsi que de neuf autres soldats belges alors qu'ils tentaient de couvrir la fuite du Premier ministre. Les autorités belges étaient au courant dès 22 h 40. » (236c)
Quant à M. Leroy, il s'est exprimé aussi à ce sujet : « C'est un officier qui m'a informé, de manière peu diplomatique que mon fils était mort au Rwanda. Il était trois heures du matin. Ce militaire m'a expliqué que mon fils était un militaire, parti volontairement dans ce pays et qu'il y avait été abattu alors qu'il essayait de s'enfuir. (...) Plus tard, j'ai également été informé que, contrairement à ce qu'on m'avait dit, certains militaires s'étaient battus pendant plusieurs heures avant de mourir. Je ne m'explique pas pourquoi on m'a menti ainsi. » (237c)
Pour Mme Lotin, l'annonce s'est faite avec plus de tact : « En ce qui me concerne, quand l'émissaire de l'armée a vu que j'étais enceinte, il a pris beaucoup de ménagements et l'annonce du décès de mon mari s'est passée correctement. » (238c)
Ce n'est que le 8 avril que les corps des victimes ont pu être reconnus.
Mme Dupont déclare : « Dès que le colonel Dewez s'est rendu chez les familles, il nous a dit que rien n'avait pu être fait, qu'il avait vu les corps et que chacun des hommes avait été tué d'une balle dans la tête. Nous faire cette déclaration était une erreur. Il devait savoir qu'un jour ou l'autre nous saurions la vérité. Le général Dallaire et le colonel Marchal n'ont vu à la morgue qu'un tas de dépouilles. Il a fallu attendre le 8 avril pour que les militaires qui les connaissaient puissent reconnaître nos hommes. Les familles ont d'abord été prévenues sur base du fait que leurs hommes manquaient à l'appel, qu'ils étaient portés disparus. » (239c)
La commission a demandé aux témoins si le colonel Dewez, lors de sa visite aux familles, avait donné d'autres informations officielles pour corriger les premières.
M. Leroy déclare : « Non, j'ai rencontré pour la première fois le colonel Dewez lors de la première commémoration du 5 juin 1994. » (240c)
Mme Lotin s'est exprimée en ces termes : « Il est de règle dans l'armée que le chef du bataillon dont certains hommes sont morts rencontre les familles de celui-ci. C'est ainsi que le colonel m'a rencontrée ainsi que ma belle-famille à l'égard de laquelle il a eu une attitude particulièrement cavalière, arrivant en bermuda et lui demandant ce qu'elle avait à dire. (...) Pas une seule fois, le colonel Dewez n'a eu un geste de compréhension ou de condoléances. Jamais il n'a admis qu'il y avait un problème. Il dormait sur ses deux oreilles. » (241c)
Toujours en ce qui concerne l'attitude du colonel Dewez, Mme Dupont déclare : « (...) Il nous a annoncé avec un sourire jusqu'aux oreilles la manière dont étaient morts nos maris. On ne peut pas dire qu'il ait été à la hauteur d'un point de vue humain. Il a nié ensuite avoir dit qu'ils étaient morts tués d'une balle dans la tête. J'ai cependant la preuve de cette déclaration, car j'ai enregistré cette visite avec un dictaphone et le système de surveillance de mon bébé. Il continue à nier, mais j'ai la preuve. » (242c)
La commission constate que les membres des familles ont été informés de la pénible nouvelle de manière inconvenante et sans le moindre soutien moral, à l'exception de Mme Lotin dont le mari était officier. La commission constate que les autorités militaires ont eu des réactions différentes selon que le militaire assassiné était officier ou non.
En outre, à aucun moment, les autorités militaires n'ont estimé que les familles étaient en droit de connaître la vérité sur les circonstances exactes de la mort de leurs proches.
Mme Lotin déclare à ce propos : « Il est évident que l'armée ne voulait nous donner aucune information. Ce n'est que lorsque l'a.s.b.l. « In memoriam » fut créée que nous avons appris certains détails. Un clivage s'est vite dessiné au sein de l'armée entre ceux qui soutenaient notre action et les autres. » (243c)
La commission a demandé à Mme Lotin si les familles avait eu accès au rapport d'enquête circonstancié établi par la force terrestre. Mme Lotin a répondu : « Le colonel Jacqmain nous a effectivement informés de son existence et autorisé à en prendre connaissance. » (244c)
Les familles déplorent n'avoir pu trouver d'écoute ni de la part du Premier ministre, ni du ministre de la Défense nationale, ni d'ailleurs de l'ensemble des partis. Après beaucoup d'insistance, elles ont été reçues par M. Dehaene pendant une vingtaine de minutes.
Mme Lotin déclare : « Nous n'avons rien obtenu du Gouvernement. Certains ministres sont venus à la cérémonie du 15 juin, visiblement contre leur volonté. M. Delcroix portait une cravate rose, ce qui est du plus mauvais effet dans une cérémonie comme celle-là. » (245c)
Les membres des familles se disent profondément blessés parce qu'il ne leur a pas été possible de se recueillir dans l'intimité devant les dépouilles de leurs défunts.
Mme Dupont a déclaré devant la commission : « Lors de la cérémonie nationale, nous avions demandé à pouvoir aller jusqu'à l'avion qui rapatriait les corps de nos paras. Ceci nous fut d'abord refusé. La veille de l'enterrement, nous avons toutefois obtenu l'accord de nous rendre à Neder-Over-Heembeek. Lorsque nous sommes arrivés sur le tarmac, des officiers nous ont dit que les corps avaient été transférés. C'est faux. Nous n'avons jamais pu voir les corps ni même nous recueillir dans l'intimité. » (246c)
Quant à l'organisation de la cérémonie, Mme Dupont déclare : « À Saint-Aubain, nous avons dû demander l'autorisation de l'évêque pour le choix des musiques. On nous a empêchés, au nom du protocole, de déposer les fleurs des enfants sur les cercueils... : (247c)
Mme Lotin témoigne : « Nous n'avons même pas eu le droit d'organiser les messes comme nous l'entendions. Personnellement, je me suis fâchée qu'on veuille mettre les personnalités au premier rang, à la place des familles. » (248c)
La commission constate qu'en raison du protocole et de règles strictes, les familles n'ont pas eu la possibilité de dire adieu aux leurs. En outre, elles n'ont pas été associées à l'organisation du service à la mémoire de leurs proches assassinés.
L'accompagnement social a été mis en cause par différents témoignages.
Mme Dupont : « Du point de vue social, l'armée a manqué aussi à son devoir. L'assistante sociale en charge de la province de Namur n'a pas été à la hauteur. (...) Avant même la cérémonie, elle nous a fait signer des documents sans nous prévenir que, dès lors, nous ne pouvions plus nous porter partie civile contre l'État ou contre les responsables éventuels. L'armée ne nous a pas apporté d'aide du point de vue de la santé. Le Dr Quintin, du service psychiatrique de l'armée, s'est contenté de voir un petit garçon et de le trouver en bonne santé, un mois après les faits. » (249c)
Pour M. Meaux, « dans le Tournaisis, l'assistante sociale a été au-dessus de tout éloge. » (250c)
Au procès Marchal, les familles n'ont pas pu se constituer partie civile. En effet, elles avaient signé des documents qui, sans qu'elles n'en soient averties, les en empêchaient :
Mme Lotin : « Ces documents ont été signés dans les quinze jours à trois semaines après les événements. Après un tel choc, j'étais K.-O. Malgré ma bonne mémoire, je ne me souviens pas de ce que j'ai signé. » (251c)
M. Leroy : « Nous ne possédons pas de doubles des documents qu'on nous a fait signer. »
Mme Debatty : « L'assistante sociale nous a dicté une lettre le 25 avril et nous avons signé les documents au même moment. J'ai peut-être une copie à la maison. » (252c)
Ces documents étaient destinés à solliciter l'indemnité prévue en cas d'attentat et pour les victimes d'actes de violence. En acceptant cette indemnité, on renonce à tout recours.
La commission constate que l'armée n'a pas mis tout en oeuvre pour soutenir les familles et les accompagner après le drame qu'elles avaient vécu.
En outre, le fait de ne pouvoir officiellement consulter ni le rapport d'enquête ni le rapport d'autopsie n'a pas aidé les familles à réaliser leur deuil.
Mme Lotin souligne enfin qu'à aucun moment l'ONU ne s'est manifestée : « Nous avons reçu des télégrammes de condoléances des autorités militaires mais rien de l'ONU. » (253c)
La législation est discriminatoire à l'égard des veuves des victimes. Celles qui travaillaient à temps plein ont dû soit renoncer à leur travail, soit travailler à temps partiel. Les veuves ne peuvent pas non plus se remarier parce que cela nuirait aux enfants orphelins.
L'assistante sociale a pris contact avec les veuves avant le rapatriement des corps, afin de leur faire signer des formulaires relatifs à la pension de réparation et à la pension de survie. Elles n'en ont même pas reçu une copie.
En ce qui concerne l'indemnité au titre d'aide aux victimes, les veuves ont dû, pour l'obtenir, envoyer par recommandé une lettre écrite de leur main, alors que cette indemnité leur revient de droit.
Mme Lotin n'a pas bénéficié de la pension de survie, parce qu'elle était enceinte à ce moment-là.
La commission constate que les dispositions prises à l'égard des proches parents ont été déficientes.
Dans ce chapitre, la commission fera une série de constatations au sujet du rôle qu'a joué cette radio libre rwandaise qui a été créée en avril 1993 et a commencé ses émissions le 8 juillet 1993 (c'est-à-dire avant les accords d'Arusha) dans la propagation d'une campagne antibelge et la préparation et l'incitation au génocide. La commission constatera également qui sont les acteurs principaux au sein de RTLM et quels sont ses contacts en Belgique. Dans une troisième partie, la commission examinera dans quelle mesure, en Belgique, les autorités politiques et militaires étaient informées de l'influence néfaste de cette radio et des liens qu'elle avait avec les cercles dirigeants au Rwanda. Enfin, la commission examinera ce que les autorités belges ont fait de cette information, tant au niveau diplomatique que sur le plan militaire.
La commission constate également que plusieurs télex annoncent que radio Muhabura, la radio contrôlée par le FPR, utilise, elle aussi, un langage agressif, même si celui-ci n'a jamais eu la même consonance ethnique que le langage tenu par RTLM. À cet égard, c'est surtout la Première ministre Agathe Uwilingiyimana qui se plaint de la rudesse du ton de radio Muhabura. Elle dit ainsi « dat radio Muhabura de president ervan beschuldigt de Arusha-akkoorden die hij aanvankelijk weinig genegen was, te exploiteren voor eigen politiek prestige en profijt. » (254c)
L'ambassadeur trouve que le langage utilisé par Radio Muhabura pose en tout cas suffisamment de problèmes pour faire l'objet d'une remarque lors de la conversation Martens/Kagame : « L'ambassadeur insiste sur la nécessité d'information objective et constructive de toutes parts. Il évoque le cas de radio Muhabura. Le FPR s'engage à rester vigilant à ce sujet. » (255c) Enfin, il faut encore mentionner que le capitaine De Cuyper, S2 à Kibat II, annonce, le 22 mars, que « les émissions politiques de la voix du FPR (radio Muhabura) ne font que diffuser depuis un certain temps des chants de combattants du FPR et font passer des chroniques politiques qui incitent à la méfiance. » (256c)
La commission fera un certain nombre de constatations au sujet du rôle que RTLM a joué dans la propagation d'un climat antibelge, tant dans la période qui précède les événements du 6 avril qu'entre le 6 avril et le 16 avril, date à laquelle l'émetteur sera détruit par le FPR. Cette radio a joué en effet, un rôle crucial dans la création d'un climat antibelge : les Belges eux-mêmes faisaient l'objet de menaces spécifiques, RTLM contribuant à répandre la rumeur suivant laquelle les Belges auraient abattu l'avion présidentiel. Dans une deuxième partie, la commission s'attachera à examiner le rôle joué par RTLM dans la préparation du génocide, et, après le 6 avril, dans sa mise en oeuvre.
L'ambassadeur Swinnen a pris conscience pour la première fois de l'influence néfaste de cette radio vers la fin de 1993. (257c)
Certains témoins confirment l'importance de radio RTLM en tant que principal média de masse au Rwanda dans la période 1993-1994. Le major Choffray signale que pour beaucoup de personnes Radio Mille Collines était l'unique source d'information.
M. Bougard, ancien sénateur, témoigne que tout le monde parlait de la grande influence négative de RTLM. Selon lui, cet émetteur était quasiment le seul média de masse et on a sous-estimé son importance (258c).
La commission constate que cette radio a beaucoup gagné en importance, surtout après la conclusion des accords d'Arusha, et qu'elle jouissait d'un taux d'écoute très élevé à la fin de 1993 et au début de 1994 grâce notamment à son programme musical attrayant.
3.11.1.1. Le rôle de RTLM dans le développement d'une campagne antibelge et anti-MINUAR
(1) La période allant de fin 1993 au 6 avril 1994
Les témoignages des militaires présents au Rwanda comme ceux des autorités politiques et militaires en Belgique montrent qu'à tous les échelons, on est conscient du fait que RTLM diffuse une campagne agressive d'incitation à la haine contre les Belges.
Durant la période de KIBAT I déjà, des incidents se produisent qui démontrent que RTLM a commencé à mener cette campagne à la fin de 1993 et au début de 1994.
Le lieutenant Nees, l'officier de renseignements de KIBAT I, raconte devant la commission comment RTLM a déformé la vérité à propos d'un incident impliquant un hélicoptère belge : « Pour le citoyen rwandais, la MINUAR était synonyme de présence belge. C'est le KIBAT qui a introduit le bataillon FPR à Kigali. À partir de janvier, le nombre et le caractère des messages de RTLM ont dès lors augmenté. Avant, les commentaires sur RTLM étaient limités, mais à partir de ce moment-là, la radio profitait de chaque occasion pour discréditer la Belgique. Il y a eu un certain nombre d'incidents où KIBAT était intervenu de façon correcte et où RTLM a abusé de la situation. Je pense à l'hélicoptère belge qui aurait soi-disant braqué des mitrailleuses sur la résidence présidentielle. Le 20 janvier, nous étions présents à une rencontre avec M. Twagiramungu. Les Belges furent obligés de tirer en l'air pour évacuer M. Twagiramungu. À RTLM, on a dit que les militaires belges avaient tiré dans le tas et qu'il y avait eu des morts. » (259c)
Le capitaine De Cuyper, officier de renseignements à KIBAT II, atteste de deux informations dirigées spécifiquement contre les Belges et diffusées par RTLM : « RTLM a fourni, le 28 mars, deux informations à l'encontre des Belges. La première était que « M. Hans » aurait dit que les Belges se mêlaient de choses qui ne les regardaient pas. La seconde concernait l'existence d'une lettre au secrétaire général de l'ONU qui contenait des critiques concernant les Belges. » (260c)
Le responsable des opérations de KIBAT II, le major Choffray, souligne en outre que RTLM était une source d'information importante et faisait de la propagande antibelge : « Tout d'abord, la Belgique est depuis plusieurs décennies très liée avec le Rwanda : le détachement belge, dans le cadre de la mission ONU, était surtout considéré comme des Belges et non militaires ONU. La radio Mille Collines diffusait une propagande anti-belge; tout le monde en était bien conscient et cette radio était le seul moyen d'information de la population rwandaise. Il nous était, bien entendu, impossible, dans le cadre du mandat, de contrer l'influence néfaste de ces émissions. » (261c)
Le commandant de secteur, le colonel Marchal, a déclaré devant la commission que RTLM visait différentes cibles, et, au sein de la MINUAR, particulièrement les Belges et le général Dallaire. Il a déclaré avoir trois témoignages qui concordent à ce sujet. (262c)
Le colonel Balis, officier d'état-major de la Force, confirme que la radio RTLM parlait effectivement « een heel eigenaardige taal » (263c), mais il n'avait pas l'impression qu'elle était prise au sérieux par une des parties (le gouvernement rwandais et le FPR). Il déclare, en outre, que RTLM faisait des déclarations hostiles tant à la MINUAR qu'aux Belges.
Le major Podevijn, attaché à la Force, a lui aussi témoigné que RTLM menait une campagne antibelge. Selon ses termes : « on reprochait aux Belges de ne plus avoir voulu fournir d'armes en 1990 et d'être favorables au FPR. » (264c)
Le général Dallaire était, lui aussi, au courant des émissions antibelges diffusées par RTLM : « At about the same time, there were some anti-Belgian broadcasts over the « Radio Télévision Libre des Mille Collines » (RTLM) the hard-line Hutu radio station. The sporadic anti-Belgian sentiments were, however, part of a wider campaign against UNAMIR, in general, and the Force Commander, in particular, but were not of such a scale as to render the presence of UNAMIR, as a neutral force, compromised or ineffective. » (265c)
Au SGR à Evere, l'analyste du Rwanda, le major Hock, réalise qu'un profond sentiment antibelge avait pris naissance et que le rôle joué à cet égard par RTLM était capital : « Ce sentiment (antibelge) s'est précisé après la signature des accords d'Arusha, des tensions éclatant entre les opposants aux accords, généralement issus de la mouvance présidentielle, et ses partisans. Un sentiment hostile s'est de plus en plus développé après le déploiement de nos forces, sentiment répercuté notamment par la radio Mille Collines. On assiste parallèlement à un développement du phénomène Interahamwe. C'est pourquoi j'ai rédigé mon complément d'information du 2 février. » (266c)
Le général major Verschoore, chef adjoint du SGR, confirme le rôle joué par RTLM en tant que vecteur de haine à l'égard des Belges : « Radio Mille Collines stigmatisait les Belges et la MINUAR. Toute opération militaire présente des risques semblables. » (267c) ... « Personnellement, je situe les émissions de RTLM, les formations ainsi que la distribution d'armes à la fin décembre 1993, début janvier 1994. » (268c)
Ces témoignages de militaires, en poste tant au Rwanda qu'à Evere, montrent que l'on était au courant de la campagne antibelge menée par RTLM.
Notre ambassade à Kigali aussi avait informé le département des Affaires étrangères du rôle néfaste de cette radio propageant la haine.
L'ambassadeur Swinnen a déclaré devant la commission que RTLM menait une campagne de haine et que radio Rwanda ne sensibilisait pas assez la population au sujet des accords d'Arusha (269c).
Dans son télex nº 90 du 1er février 1994 adressé à Minafet Bruxelles, l'ambassadeur Swinnen écrit : « de opruiende taal van de omroep wordt steeds meer als een belangrijke factor van een mogelijk destabiliseringsscenario gezien. » (270c)
Le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Willy Claes, confirme devant la commission que RTLM émettait des propos haineux : « Selon le télex nº 1057, des incidents ont eu lieu à Kigali, qui ne présentent toutefois pas un caractère exclusivement antibelge. Il s'agissait d'une manifestation générale. RTLM a toutefois mené une campagne de haine assez virulente.» (271c). Le 1er avril, cinq jours avant les événements fatals, le ministre Claes envoie un télégramme à l'ambassadeur Swinnen, dans lequel il se plaint une nouvelle fois de RTLM : « Étant donné tout ce que nous faisons pour le Rwanda, il est incompréhensible que cette radio, dont nous connaissons le système de financement, mène une campagne antibelge scandaleuse. » (272c)
L'ancien Premier ministre, Wilfried Martens, s'est rendu au Rwanda au début de 1994 : « J'ai eu une interview à Kigali avec des journalistes de la radio Mille Collines qui se sont montrés très agressifs et qui ont dénoncé la « trahison » belge de 1990. » (273c)
L'ancien sénateur Bougard souligne lui aussi le rôle important que RTLM a joué dans l'émergence du climat antibelge : « Tout le monde évoquait également l'importance de l'action négative de RTLM. Il s'agissait quasiment du seul média et on a sous-estimé son importance (...) Il est clair que la propagande de RTLM a joué un rôle dans le développement du climat antibelge et plus précisément de l'animosité antibelge de la MINUAR. Les démocrates rwandais étaient également pris pour cible par RTLM. » (274c)
Éric Gillet, coauteur du rapport de la fédération internationale des ligues de droits de l'homme (FIDH) témoigne que : « depuis 1990, un groupe d'hommes occupe toutes les fonctions importantes, organise les massacres, parle de rejeter les Tutsis, arme les milices, crée le CDR et RTLM et se trouve à la source de la propagande antibelge. » (275c)
La journaliste Colette Braeckman a été invitée le 5 décembre 1993 à interviewer Mme Agathe, la Première ministre : « Mme Agathe m'a reçue le lendemain matin et m'a expliqué que le climat était tendu, que RTLM multipliait les attaques contre les Belges et qu'elle-même avait reçu des menaces de mort. » (276c) Selon Mme Braeckman, la population ne se retournait pas contre les Belges. Mais, selon elle, il y a bien eu, en haut de l'échelle sociale, un ressentiment à l'encontre des militaires belges et surtout de leur comportement. « Des intellectuels, des gens du parti, répercutaient les propos de radio Mille Collines. » (277c)
Un Rwandais, le procureur Nsanzuwera, ancien procureur de la république rwandaise, a lui aussi déclaré devant la commission que RTLM, notamment, était à la base d'une campagne antibelge. Il a même raconté un incident qui a eu lieu le 26 janvier 1994 : « Une campagne antibelge existait mais il ne s'agissait pas d'un climat généralisé. Elle était menée par les leaders du MRND et du CDR et par la radio des Mille Collines. Je vous donne un exemple. (...) Chaque matin, RTLM énumérait les différents incidents impliquant les Casques bleus belges. Je ne sais pas si ces incidents se sont réellement passés. Ainsi, le 26 janvier, RTLM a fait beaucoup de bruit autour d'un incident qui aurait éclaté lors du contrôle de la fille de l'ancien chef de l'état-major par l'armée de la MINUAR. » (278c)
Ce procureur rwandais répète devant la commission qu'en ce qui concerne le climat antibelge, il renvoie à la campagne de haine qui a été menée à l'égard des Belges par des journalistes d'origine belge. « La campagne antibelge » , témoigne-t-il, « a, en effet, été menée par l'émetteur Mille Collines ». (279c)
Il ressort de tous ces témoignages, sans que cela soit démenti une seule fois, que RTLM a joué dès l'automne un rôle très important dans la propagation d'une campagne de haine contre la présence belge au Rwanda.
(2) La période postérieure au 6 avril 1994
Dans ce chapitre, la commission va examiner de manière plus approfondie le rôle qu'a joué RTLM en ce qui concerne l'information selon laquelle les Belges étaient responsables de la mort du président Habyarimana. Cette information jouera un rôle crucial dans les événements qui ont donné lieu à l'assassinat des dix Casques bleus belges.
Le major Choffray (S3 à KIBAT II) témoigne devant la commission que la nouvelle selon laquelle les Belges étaient soupçonnés d'avoir abattu l'avion présidentiel lui est parvenue deux heures après les faits. Selon lui, cette rumeur a été répandue par RTLM.
D'après le colonel Vincent, responsable de la coopération technique militaire et, en outre, conseiller militaire de l'ambassadeur Swinnen, les dix civils belges, dispersés dans tout le pays, ont été assassinés à la suite de la diffusion de cette nouvelle diffusée par RTLM : « Selon moi, la ou les personnes qui ont répandu sur les ondes de RTLM l'information selon laquelle les Belges avaient participé à la mort d'Habyarimana, ont provoqué ces massacres. » (280c)
La journaliste Els De Temmerman témoigne du rôle joué par RTLM après le 10 avril : « Ik zal u een aantal citaten geven. Op 10 april roept radio Mille Collines de bevolking op om de Belgische patrouilles aan te vallen. Op 29 april zegt radio Mille Collines « de Belgen hebben informatie over strategische posten van het leger in Kigali doorgespeeld aan het FPR. Daardoor stemt het aanvalsplan van het FPR overeen met het verdedigingsplan van de stad. » Over de rol van de Belgen bij de aanslag zegt radio Millle Collines : « De veiligheid van de luchthaven was de verantwoordelijkheid van UNAMIR. Uiteraard is het vliegtuig dus neergehaald door de Belgen. » Eind april zegt radio Rwanda : « De Rwandese minister van Defensie heeft bij de Veiligheidsraad een klacht ingediend over de wapenleverancies van België aan het FPR. » Op 4 mei zegt radio Mille Collines dat « de president is neergeschoten door een groep Belgische VN-soldaten onder leiding van luitenant Marc Nees. Het plan was alle Interahamwe te doden, een regering van Tutsisympathisanten te installeren en radio Mille Collines, de radio die de mensen de waarheid vertelt, te vernietigen. Met dat doel hebben de Belgen in alle communes jonge Tutsi-informanten gerecruteerd.
Op 15 juni beslisten de Fransen om in te grijpen in Rwanda. Minister Delcroix zegde in een reactie dat België dit initiatief met voorzichtigheid moet behandelen. Radio Rwanda zegt dan over Delcroix : « Deze minister bezocht Rwanda net voor de moord op de president om te controleren hoever het stond met het plan om Habyarimana uit de weg te ruimen. » Volgens radio Rwanda had Delcroix op dat moment een onderhoud met « generaal Dallaire, de FPR-huurling, die toen bevestigde dat het plan eindelijk uitgevoerd zou worden. » Ik heb het hier over 15 juni 1994. De hetze tegen de Belgen is dus maandenlang doorgegaan. Ook in de kampen moest ik mij uitgeven voor een Nederlandse, tenzij op een bepaald moment in Goma toen bleek dat mijn naam dezelfde was als die van Luc De Temmerman, de advocaat van kolonel Bagosora. Ik heb daar toen handig gebruik van gemaakt.
Ook de hulpverleners moesten zeggen dat zij geen Belgen waren. Ik kan de vraag moeilijk beantwoorden, maar ik denk dat de hetze tegen de Belgen zeer ver ging.
Men staart zich altijd blind op radio Mille Collines. Het was soms zo extremistisch dat de mensen het uitschaterden. Het werd niet onmiddellijk ernstig genomen. Radio Rwanda heeft volgens mij veel meer kwaad berokkend omdat zij hetzelfde op een meer diplomatische manier zei. De president en de premier werden regelmatig opgevoerd. Daardoor nam men wat daar gezegd werd, au sérieux. Ik meen dat radio Rwanda een grotere impact heeft gehad. » (281c)
La journaliste Colette Braeckman a, elle aussi, tenté de rallier Kigali le 6 avril. Elle témoigne que les rumeurs antibelges ont été répandues non seulement par RTLM, mais aussi par l'ambassade de France : « À l'ambassade de France, une voix leur a dit que c'étaient des Belges qui avaient tiré sur l'avion du président. La rumeur antibelge provenait donc de deux sources : les Français et la radio des Mille Collines. » (282c)
Enfin, le père Theunis témoigne que RTLM est même allée jusqu'à promettre 100 000 francs de prime par cadavre belge. Selon le père Theunis, cet appel n'a pas pu être diffusé avant avril 1994 : « Un autre élément qu'il faut mentionner est l'influence néfaste de la radio RTLM parce qu'il est évident que toute une idéologie s'est installée et elle a eu des effets pervers. Je ne me rappelle plus exactement de quand date cet appel à RTLM. Certains me l'ont donné et cela ne m'étonnerait pas que cela se retrouve dans le livre de Jean-Pierre Chrétien sur les médias du génocide parce que ce sont des affirmations très claires et qui frappent l'imagination : cent mille francs pour un cadavre ...
Ce message date non pas d'avant avril. C'est après le début des événements pour autant que je sache, enfin il faudrait vérifier. Peut-être cela se trouve-t-il dans le livre de M. Chrétien. Ce n'est pas pensable avant avril, de façon aussi précise. Je ne pourrais pas vous dire la date exactement mais on pourrait la retrouver. » (283c)
La commission constate qu'après la crise des 6 et 7 avril 1994, et après l'assassinat des dix paras belges, RTLM s'est sentie plus forte encore qu'auparavant et a excité la population, en des termes très incisifs, à s'en prendre directement à tout Belge.
D'une manière générale, la commission constate que RTLM a joué, tant avant et surtout après le 6 avril 1994, un rôle très important dans le développement d'une campagne antibelge agressive au Rwanda.
3.11.1.2. Le rôle de RTLM en ce qui concerne le génocide
Radio Mille Collines ne s'est pas attachée uniquement à la campagne de haine contre les Belges; elle a également oeuvré à préparer progressivement sur le plan psychologique la population au génocide, qu'elle a finalement soutenu elle-même, le 7 avril, en des termes non équivoques.
Le lieutenant Nees déclare devant la commission qu'avec radio RTLM, les assassins disposaient en tout cas d'un médium très influent. Le lieutenant Nees : « Je suis convaincu que, si nous étions parvenus à liquider RTLM, nous aurions peut-être pu éviter ou en tout cas limiter le génocide. » (284c)
Dans son rapport, le général major Uytterhoeven souligne qu'il est convaincu que les actions de Radio Mille Collines ont constitué une des causes majeures des massacres (285c).
Le 26 novembre 1993 déjà, l'ambassadeur Swinnen envoie un télex à Minafet Bruxelles, dans lequel il signale que RTLM a appelé à assassiner la Première ministre, Mme Agathe, et le ministre du gouvernement de transition désigné dans le cadre des accords d'Arusha, M. Twagiramungu (286c).
Le télex du 1er mars 1994, envoyé lui aussi par l'ambassadeur Swinnen au Ministère des Affaires étrangères à Bruxelles, est rédigé en des termes nettement plus tranchants et plus clairs. On y mentionne que la chaîne RTLM créée par la CDR diffuse « des déclarations inflammatoires appelant à la haine voire même l'extermination de l'autre composante ethnique de la population » (287c).
Le télex de synthèse de l'ambassadeur Swinnen, concernant la visite de M. Delcroix au Rwanda, montre les inquiétudes qu'éprouvait aussi le ministre Delcroix à propos de RTLM : « On promit au ministre Delcroix que l'on veillerait à ce que RTLM modère le ton de ses émissions. La Première ministre Agathe partageait son inquiétude au sujet de RTLM. Elle était d'avis que Habyarimana avait une part de responsabilité dans les événements. Elle insista pour que la communauté internationale intensifie ses pressions sur le président. Le ministre Delcroix mit l'accent sur des « échéances » importantes » (288c).
Quelques hommes politiques rwandais témoignent également devant la commission que RTLM diffusait de la propagande à connotation ethnique et se réjouissait de pouvoir annoncer nommément l'assassinat de certains politiques haut placés rwandais. L'ancien Premier ministre M. Dismas Nsengiyaremye déclare: « Il y a eu émergence d'une propagande « ethnisante » notamment au niveau de la Radio des Mille Collines; lorsque de tels discours sont répétés à longueur de journée, ils finissent par faire basculer une partie de la population et par lui inculquer de telles idées. Le langage de la radio Muhabura était, quant à lui, non violent mais tout aussi insidieux : il appelait à l'armement et à la résistance à l'autre. On préparait donc un affrontement des deux côtés. Ces différents éléments montrent, selon moi, qu'il y a eu des facteurs favorisant l'éclosion et l'extension d'une guerre civile aux conséquences incalculables » (289c) (...) « Les milices Interahamwe ont également participé. La garde présidentielle s'est mise en action, de l'avis de la plupart des gens. Celle-ci a participé physiquement aux massacres avec l'aide de quelques éléments d'autres unités. Si, au niveau intérieur, on cherchait dans ces groupes, on pourrait arriver à un résultat. Il est aussi question de la Radio des Mille Collines. Ces appels à la haine ethnique, aux massacres, etc. ne sont pas des appels innocents mais criminels. » (290c)
Le Premier ministre Faustin Twagiramungu, lui aussi, a déclaré que les médias ont joué un grand rôle dans l'incitation au meurtre : « RTLM a dit aux gens : « Vous tuez, n'épargnez personne », après l'accident de l'avion du président. Deuxièmement, il y a la culture d'une impunité séculaire. » (291c) (...) « On vous dit que le travail fait par RTLM est regrettable, mais il est extraordinaire en termes d'incitation des bourgmestres, des conseillers et autres à tuer. » (292c)
Mme Mukeshimana, veuve de l'ancien ministre des Affaires étrangères du Rwanda, fait le récit choquant du meurtre de son mari le 11 avril : « Le 6 avril, vers 20 heures, un ami nous a téléphoné pour nous dire que le président aurait été assassiné. Peu après, la Radio Mille Collines diffusait la même information. Nous pressentions le drame. (...) six militaires de la garde présidentielle ont emmené mon mari. Je ne l'ai jamais revu. J'ai appris sa mort par la radio Mille Collines, qui se réjouissait de l'extermination des complices du FPR. » (293c)
M. Gasana Ndoba, représentant du Comité pour le Respect des Droits de l'homme et de la Démocratie au Rwanda (CRDDR), a déclaré devant la commission que « les médias de la haine, en particulier la radio des Mille Collines, jouèrent un rôle déterminant dans la consolidation de la haine naissante . » (294c)
M. Degni-Segui, rapporteur spécial de l'ONU en matière de droits de l'homme, relève différents éléments concernant la préparation et l'exécution du génocide, parmi lesquels le rôle important de RTLM : « Mon rapport préliminaire indiquait un faisceau d'indices concordants quant à une planification. Ces indices sont au nombre de quatre :
l'incitation à la haine ethnique par la Radio Mille Collines;
la distribution d'armes en provenance de dépôts; en outre, les miliciens Interahamwe étaient entraînés;
la célérité exceptionnelle avec laquelle les événements se sont produits; le gouvernement intérimaire a été constitué et les barricades dressées en l'espace selon les informations que j'ai reçues de 30 à 45 minutes;
enfin, des listes de personnes qui devaient être arrêtées circulaient.
Il convenait d'effectuer des vérifications à propos de l'ensemble de ces indices.
Les investigations faites par les observateurs déployés sur le terrain et par les observateurs du Tribunal pénal international ont abouti à la découverte de fosses communes, de documents, de cassettes audio de radio Mille Collines incitant à la haine. La traduction de ces enregistrements montrant une distinction entre les émissions diffusées en Kiruyawanda, ces dernières amenant à se prononcer sur l'assassinat. » (295c) « J'en viens à présent aux causes du génocide; j'en vois essentiellement trois ou quatre, car je pourrais également parler des causes économiques et socio-culturelles.
La troisième cause était l'incitation à la haine ethnique. Vous avez entendu de nombreux experts dans le cadre de cette commission d'enquête et ils ont dû vous parler de la radio-télévision Mille Collines qui incitait à la haine ethnique et ne s'en cachait pas. » (296c)
Mme Alison Des Forges déclare : « La radio RTLM fut d'ailleurs créée tout de suite après pour contrecarrer l'exécution des accords. Entre le mois d'août et la fin de l'année 1993, les Interahamwes achetèrent un grand nombre de machettes à Kigali. Un homme d'affaires et financier important de RTLM en fit même importer 25 tonnes de l'extérieur. Il est donc clair qu'il existait déjà à ce moment un projet de recommencer la guerre en prenant des civils pour cibles. » (297c)
Dans « Les Médias du Génocide », M. Jean-Pierre Chrétien fait une comparaison plus détaillée entre Radio Rwanda et RTLM : « Quelle fut l'influence de ces médias sur la population ? Les journaux visaient l'élite, dont on ne peut éluder le rôle important dans le génocide. RTLM visait les détenteurs de postes. Un docteur allemand raconte comment un médecin fut massacré quelques jours après avoir été dénoncé par RTLM comme sympathisant du MPLR. » (298c) (...) « Nous avons étudié le contenu de l'information radiophonique à partir d'enregistrements faits durant le génocide. Trois quarts de ces enregistrements proviennent de RTLM; il y en a aussi de Radio Rwanda. Durant cette période, il y a alignement idéologique des deux radios et dans des styles différents, plus classique pour radio Rwanda, plus interactif et musical pour RTLM. Avant le génocide, le contenu informatif des deux radios n'est pas le même. La radio officielle offre des informations plus équilibrées. D'ailleurs, quand, en mars 1992, elle dérape, il y a un concert de protestations. ... Mais la radio n'est pas seule à construire l'opinion publique; il faudrait étudier aussi la presse, l'enseignement, la formation paroissiale, les discours dans les sections du parti unique. Il me semble que la population rwandaise a eu beaucoup de mal à résister à une opposition ethnique constamment mise en scène. Combattre cette mise en scène était un objectif intellectuel que s'étaient fixé des enseignants au Rwanda. Mais il était clair que l'opinion était enfermée dans l'obsession ethnique. Pourtant, radio Rwanda n'était pas aussi raciste que RTLM. » (299c)
Le professeur Prunier estime que l'on a créé un climat de tension et que l'angoisse régnait : « Il est vrai que le climat était extrêmement lourd et que, dans ce cas, des actes extrêmes se produisent plus facilement que dans un climat détendu. Il faut dire que, pendant toute cette période, des attentats inexpliqués se multipliaient. On jetait par exemple tout à coup une grenade dans un marché. Une mine sautait sur une route, non dans une zone de combat car il n'y avait plus de combats depuis février 1993. Ces attentats n'étaient jamais revendiqués. Évidemment, la radio des Mille Collines et la machine de propagande du noyau dur des génocidaires était au travail. Ils disaient : « Vous allez voir, il va se passer des choses terribles. » Certaines chansons populaires ont même été composées en ce sens en disant : « Vous allez voir, on va se réveiller un matin et il va se passer quelque chose. » Un climat de paranoïa se développait. (300c) À la limite, même quand vous étiez un étranger comme moi, vous le sentiez et vous aviez peur sans que cette peur soit bien identifiable. Vous aviez peur d'une atmosphère comme dans un film d'épouvante dans lequel on sait qu'il va se passer quelque chose de terrible mais on ne sait pas quoi. Que dans ce climat, il y ait une sorte de détente nerveuse dans le fait de passer à l'action et de tuer, je peux le concevoir, mais cela ne veut pas dire que je l'approuve. Cela a été un soulagement pour certains. Enfin, cette chose innommée et innommable que nous attendions depuis des mois est enfin arrivée. Mais là, ce n'est plus de la psychologie, c'est de la politique. » (301c)
La journaliste Els De Temmerman affirme aussi que RTLM diffusait la théorie du double génocide afin de soulever la population : « De versie dan van de dubbele genocide. Allereerst moet ik zeggen dat dat de kern was van het propaganda-apparaat. Op Radio Mille Collines werd constant gezegd dat het RPF overal moordpartijen uitvoerde. In de vluchtelingenkampen van Ngara was ik getuige van het feit dat 250 000 vluchtelingen op een etmaal de grens met Tanzania overstaken.
Het was geen massa die in paniek, hals over kop, op de vlucht geslagen was. Deze mensen hadden al hun bezittingen bij, matrassen, geiten, graanzakken, kookgerei. Zij waren ook niet getraumatiseerd, hadden geen bloed aan de kleren, hadden al hun kinderen bij zich. Er klopte iets niet. » (302c)
La commission constate que les médias et, en particulier, RTLM, ont joué un rôle déterminant dans la préparation et dans le déclenchement immédiat du génocide. Au cours des premiers jours et même des premières semaines du génocide de 1994, RTLM allait continuer à exciter la population, si bien qu'il devint impossible d'arrêter les atrocités.
Dans cette sous-section, la commission examine quand, par qui et avec quels moyens la radio RTLM a été fondée. Elle fait ensuite une série de constatations concernant d'éventuels liens avec les plus hautes sphères au Rwanda même, ainsi que d'éventuels contacts avec des partis ou des groupements politiques belges et européens.
3.11.2.1. La fondation de RTLM
L'ambassadeur Swinnen fait à ce sujet un témoignage très précis : « La radio RTLM a été fondée en avril 1993 et a émis le 8 juillet 1993 pour la première fois, c'est-à-dire avant les accords d'Arusha. Je ne me souviens pas qu'ils aient conspué les accords dès le départ. Nous avons pris conscience de l'influence néfaste de cette radio vers la fin de l'année. » (303c)
M. Pierre Houtmans, qui s'occupe de Radio Contact en Belgique et qui tente également de mettre sur pied des stations radiophoniques à l'étranger, a déclaré devant la commission qu'il avait été contacté par quelques Rwandais en 1992 à propos d'une collaboration éventuelle à la fondation de RTLM : « En novembre 1992, j'ai été contacté par des responsables rwandais qui avaient l'intention de monter une radio devenue ensuite Radio Mille Collines. Ces deux personnes étaient M. Ferdinand Nahimana et M. Joseph Serugendu. Ils nous ont téléphoné à Bruxelles puisqu'ils étaient sur place avec l'intention de voir quelles étaient les possibilités de fournir un matériel pour organiser une radio au Rwanda. M. Ferdinand Nahimana s'est présenté comme l'ancien directeur de l'office rwandais de l'information et comme professeur d'université. M. Serugendu Joseph comme directeur technique d'ORINFOR qui est en fait l'office rwandais de l'information, le ministère de l'information de l'époque. J'ai, de leur écriture, leurs propres informations. L'objet de leur demande du 11 novembre 1992 était assez précis : les possibilités d'organiser de manière matérielle, la mise sur pied d'une radio à Kigali, avec des réémetteurs dans deux autres points du Rwanda. Ceci était lié au fait, selon eux, de la libéralisation des ondes qui allait s'organiser au Rwanda. Ils souhaitaient pouvoir développer un média privé par rapport aux médias officiels. En tant que société commerciale, nous avons donc traité cette offre comme une autre. Nous avons été en relations commerciales avec ces deux personnes entre novembre 1992 et juin 1993. M. Nahimana et M. Serugendu sont venus régulièrement à Bruxelles dans le but de développer ce projet. Dans l'intervalle nous avons eu de nombreux fax et correspondances téléphoniques avec ces deux personnes ainsi que des réunions à Bruxelles. Chaque fois que MM. Nahimana et Serugendu étaient à Bruxelles, ils logeaient dans différents hôtels, notamment l'hôtel Résidence du groupe WTC et l'hôtel Palace. Les réunions ont eu lieu dans ces hôtels ou au siège de Radio Contact à Bruxelles. Diverses offres, contre-offres ont été faites, j'ai à votre disposition un certain nombre de fax émanant du Rwanda ainsi que les réponses. Au fur et à mesure des discussions, nous avons mis au point ce projet de radio. Subitement le 1er mai 1993, ils nous ont dit qu'ils ne voulaient pas donner suite à notre offre. Ils avaient acheté des émetteurs en Allemagne, mais ils voulaient poursuivre leurs relations avec nous pour des studios. Notre dernière offre date du 22 juin 1993. Suite à cela, j'ai reçu un coup de fil du Rwanda. Ils avaient trouvé mieux ailleurs concernant notre offre radio. On a alors arrêté toute relation commerciale avec ces deux personnes fin juin 1993. J'ai été informé à l'automne 1993, de la mise sur pied de la radio par M. Siméon Musengimana qui s'occupait d'un centre de recherche-action et de formation des agents de développement. La radio émettait sur 106.4 à Kigali et du matériel avait été livré au départ de la Belgique par des fournisseurs belges. À l'époque je ne connaissais pas leur nom, mais la spécification du matériel qui m'a été donnée par cette personne me fait dire que les studios ont été fournis par la firme Van Rompaey à Malines.
Ceci évidemment d'après les informations de la personne que je viens de citer. Je n'ai jamais été en Afrique, je ne me suis jamais rendu au Rwanda, donc je n'ai pas pu le vérifier de visu. » (304c) (...) « Le budget en discussion était de l'ordre de neuf millions de francs belges. » (305c) (...) « On nous a demandé de fournir du matériel pour une station de radio. Nous avons fait une offre pour fournir ce matériel.
Le contenu, c'est la responsabilité de l'entreprise qui l'organise. Ce n'est pas nous qui faisons la radio là-bas. On est des fournisseurs d'équipements, de know-how. Comment les gens l'utilisent, c'est clairement le problème de la ligne éditoriale. Quand je me suis rendu compte, comme vous tous, j'ai été atterré quand j'ai appris, en avril 1994, pas avant - ce qui s'était passé.
Nous avons demandé les informations puisqu'au début des discussions qui ont eu lieu fin novembre 1992, la société RTLM n'était pas créée. Nous avons demandé quel allait être l'interlocuteur qui allait acheter ce matériel physiquement, et ce n'est qu'en mai 1993 que nous avons disposé des statuts, du « business plan », et de la demande formelle visant à un achat éventuel de matériel. Au départ, deux personnes physiques venaient discuter d'un éventuel projet.
Il y a eu plusieurs versions des statuts. J'ai reçu une version que j'ai remise à la gendarmerie. Je n'ai plus de copie. » (306c)
3.11.2.2. Les liens éventuels entre RTLM et les plus hautes sphères de Kigali
La commission dispose d'une annexe aux statuts de RTLM signée le 7 avril 1993, dans laquelle se trouve une liste de 50 fondateurs. Parmi ceux-ci, nous notons les noms suivants :
Jean-Bosco Barayagwiza, directeur aux Affaires étrangères (CDR)
Ferdinand Nahimana, ancien directeur d'ORINFOR et de Radio Rwanda
Felicien Kabuga, industriel, président du conseil d'administration de la RTLM et l'un des principaux bailleurs de fonds
Le pasteur Musabe
Télesphore Bizimuingu
André Ntagurura, ministre
Jean Habyarimana, président du MRND Kigali
À la demande de la Commission spéciale Rwanda, des comptes ont été vérifiés à la BBL, pour donner une meilleure idée des fonds dont disposait RTLM. Le 27 août 1993, on trouve sur ce compte une somme de 49 990 francs, qui résulte de 42 actions. Parmi les actionnaires, nous retrouvons :
Eugène Nahimana (3 actions)
Georges Ruggiu (2 actions représentant 2 380 francs)
Paulin Murayi (2 actions)
détenteurs du compte : Papias Ngaboyamahina et Joseph-Désiré Ruhigira.
Le colonel Vincent, chef du CTM à Kigali, estime que RTLM a été fondée dans un cadre anti-MINUAR et que la propagande était une propagande de très bas niveau. Il confirme que : « certains des fondateurs de RTLM gravitaient dans l'entourage du président . » (307c)
L'ambassadeur Swinnen déclare qu'il était conscient des liens de RTLM : « Dès janvier, j'ai signalé que M. Kabuga était manifestement actionnaire de RTLM et que M. Ferdinand Nahimana, que l'on proposait comme ministre de l'enseignement supérieur du gouvernement de transition, jouait un rôle important dans cette radio. M. Barayagwiza, qui occupait des fonctions importantes au ministère des Affaires étrangères et qui était un des fondateurs du parti extrémiste CDR, jouait aussi un rôle à RTLM. Selon certaines informations, M. Kabuga était un important bailleur de fonds du MRND. » (308c)
Au cours de son séjour au Rwanda, divers représentants de la communauté internationale avaient communiqué à M. Willy Claes, le ministre des Affaires étrangères de l'époque, que RTLM était gérée et financée par le beau-frère du président. (309c)
M. Leo Delcroix, son collègue de la Défense nationale, avait de fortes présomptions que le président était lui-même actionnaire de RTLM : « dat waren vermoedens. Ik weet niet vanwaar die informatie kwam. » (310c)
Par contre, certaines personnes actives dans le mouvement rwandais de défense des droits de l'homme ont déclaré formellement dans le cadre de leur témoignage que le président était lui-même directement lié à RTLM.
M. Gasana Ndoba, représentant du CRDDR, a déclaré devant la commission qu'il avait émis un communiqué de presse à l'occasion de la présence du président Habyarimana à l'enterrement du roi Baudouin le 6 août 1993 : « Ce communiqué soulignait également que le président Habyarimana jouait manifestement un double jeu. Il était notoirement l'actionnaire majoritaire de la Radio « Mille Collines. » (311c) ... « En ce qui concerne la RTLM, les liens avec le président sont bien établis. Son nom a pu être relevé sur certains documents bancaires. Les noms d'autres personnes y figurent également. Il y a, parmi celles-ci, des personnes qui sont domiciliées en France et d'autres qui le sont au Canada . » (312c)
« Les documents que M. Gasana Ndoba a remis à la commission montrent que le 25 août 1993, 1 970 personnes au moins ont souscrit, auprès des banques rwandaises BACAR, BCR et BK, au capital de la RTLM, et ce pour un montant total de 16 607 000 francs rwandais. Les montants les plus importants venaient du président Habyarimana (1 000 000) (6 %), de M. Basoboso (600 000) et de MM. Bagaragaza, Kabuga et Rwabukumba (chacun 500 000). Ce document montre également qu'avec cet argent, l'on a acheté des pylônes d'émission, un émetteur et du matériel de studio. »
M. Nsanzuwera souligne lui aussi le lien existant entre RTLM et le président : « Pour les Rwandais, il est évident que le président avait partie liée avec la RTLM. Le président du conseil d'administration était d'ailleurs un de ses parents. Le propriétaire de la radio appartenait au mouvement MRND, tout comme certains journalistes. Je n'ai aucune preuve concernant le financement de la radio par des personnes extérieures, mais il est apparu que la RTLM utilisait souvent les fréquences de la radio nationale. » (313c)
Jean-Pierre Chrétien, chercheur au CNRS (Paris) et auteur du livre « Rwanda, les médias du génocide », déclare que RTLM était directement liée au MRND et au CDR : « Le journal Kangura et la RTLM sont des médias du secteur privé, mais ils ne sont pas marginaux. Il s'agit en fait d'instruments officieux de la propagande officielle. Le mensuel de l'Interahamwe reprit ce rôle dès le mois d'octobre 1989. Les liens de Kangura avec la sûreté sont évidents. Ceux de la RTLM avec le pouvoir sont encore plus manifestes. La liste des cinquante actionnaires illustre les liens avec le MRND et le CDR. L'on observe aussi des échanges de services entre les médias gouvernementaux et les médias privés. C'est ainsi que le principal technicien de la radio nationale passera à la RTLM. Il y a également les problèmes financiers. Le journal Kangura les résout en ne payant pas ses fournisseurs. La RTLM les résout en ne réglant pas ses factures d'électricité. Il y a d'ailleurs eu bien des difficultés en ce qui concerne le capital de départ de cette radio. L'on peut, en effet, se demander si M. Ferdinand Nahimana n'a pas repris cette radio à caractère rural pour la faire évoluer dans le sens qu'il souhaitait. » (314c)
3.11.2.3. Existe-t-il des liens entre la RTLM et des acteurs belges ou européens ?
Dans cette partie du rapport, la commission fait une distinction entre l'implication directe du Belge Georges Ruggiu dans la création et les activités de la RTLM, la formation des techniciens rwandais à Bruxelles et la participation de partis et de groupements politiques belges et européens au financement de ce média qui incite à la haine ainsi qu'au soutien qui lui est donné.
Le lieutenant Nees, officier de renseignement de KIBAT II, a appris pour la première fois le 16 janvier qu'un collaborateur important de radio RTLM était Belge : « L'on m'a toutefois transmis un faux nom. Par la suite, le même informant m'a raconté que le nom était Ruggiu. Cette information a été confirmée par la suite par des pères belges, mais nous n'avons jamais eu de preuves formelles. » (315c)
Le 31 janvier 1994, le télex nº 86 de l'ambassadeur Swinnen au Ministère des Affaires étrangères à Bruxelles signale que F. Kabuga et F. Nahimana, des amis du président Habyarimana, étaient actionnaires de RTLM. Ce télex évoque également, pour la première fois, la possibilité que le journaliste concerné puisse être de nationalité belge. Il parle avec un « léger accent belge » (316c).
Quelques semaines plus tard, le 1er mars 1994, l'ambassadeur fait savoir, dans le télex nº 172 adressé au Ministère des Affaires étrangères à Bruxelles, que « Ruggiu Georges » est le nom du journaliste de RTLM en question et il demande que l'on transmette toutes les données le concernant dont on dispose en Belgique. (317c)
La Sûreté de l'État suivait les activités d'un groupe de réflexion rwando-belge, dont Georges Ruggiu, Paulin Murayi et Eugène Nahimana faisaient partie. À propos de la manière dont Ruggiu est arrivé à la RTLM, M. Tallier, secrétaire à la Sûreté de l'État, déclare ce qui suit : « Ruggiu a d'abord tenté de se faire incorporer comme volontaire dans les rangs de la Croix-Rouge pour aller au Rwanda. La Croix-Rouge a estimé qu'il n'avait pas les qualités requises pour être ambulancier et a rejeté sa candidature.
Ruggiu s'est alors lancé avec Murayi dans des campagnes de réflexion sur la cause rwandaise. Certains disaient qu'on voulait donner au FPR 50 % de chances alors qu'il ne représentait en réalité que 10 à 15 % de la population. Cela permettait de brandir le drapeau de la démocratie en disant que le FPRL voulait être surreprésenté. De là, à transposer dans le conflit belgo-belge ...Ruggiu et Murayi ont donné des conférences d'importance mineure. Plus tard, Ruggiu a été engagé par RTLM. Eugène Nahimana est aussi une figure ... Toutefois, en réalité, il exploitait le népotisme à la mode à Kigali. Il invoquait son statut de beau-neveu de la famille Habyarimana pour faire des promesses à d'autres étudiants, notamment en termes d'hypothétiques postes futurs à pourvoir ... Ses condisciples le croyaient ... Les gens qui soutenaient RTLM en Belgique étaient peu nombreux. Nous en avons obtenu la liste à la suite d'une perquisition de l'auditorat militaire. Elle comportait une douzaine de personnes. Le principal actionnaire était le fameux Papias Ngabuyamahimana qui détenait une douzaine d'actions, si je ne m'abuse. Les autres se contentaient d'une ou deux actions à mille francs et n'avaient strictement rien à dire. Leur but était de faire valoir leurs efforts quand ils rentraient au pays. » (318c)
À un commissaire qui confronte M. Paulin Murayi (actionnaire de RTLM) aux déclarations de M. Degni-Segui, selon lequel les fondateurs et les animateurs de RTLM sont responsables du génocide, celui-ci répond comme suit : « Ainsi que je l'ai déjà expliqué lors de mon audition auprès du juge Vandermeersch, une radio privée dotée de statuts propres a été créée au Rwanda. Lorsque j'ai eu connaissance de ce projet, ces derniers étaient déjà définis. M. Ferdinand Nahimana s'est rendu en Belgique afin de trouver des actionnaires et entreprendre des démarches pour se procurer des émetteurs et tout le matériel nécessaire. Ensuite, il a convoqué une réunion de Rwandais qu'il considérait comme influents dans ce milieu, ainsi que moi-même. Au cours de cette assemblée, il nous a présenté les statuts de la radio et ses objectifs : j'avoue que j'ai peut-être été un peu naïf, mais à la lecture de ces statuts et d'après les propos de M. Ferdinand Nahimana, il s'agissait d'un bon projet pour l'ère démocratique annoncée au Rwanda. J'ai participé à cette radio privée et commerciale, non pas pour faire fructifier les 2 000 francs que j'y avais investis, mais plutôt pour encourager une initiative des médias privées.
Au vu des statuts, en tout cas au moment où j'ai cotisé, je ne savais pas ce qu'allait devenir la radio. Quant à Georges Ruggiu, je l'ai connu parce qu'il habitait à cent mètres de chez moi. Je l'ai connu par un ami rwandais, un étudiant qui était à Liège pour faire un stage en imprimerie et qui avait noué une amitié avec lui. Cet étudiant était de ma région natale au Rwanda, de Gisenyi. Avant de partir, il m'avait présenté Georges Ruggiu parce qu'il avait vraiment sympathisé avec lui. D'ailleurs, il l'a invité en 1992 deux fois. Georges Ruggiu est allé au Rwanda rendre visite à ce garçon pendant les vacances d'été de 1992. À ce moment, nous n'avions pas encore créé le groupe de réflexion.
Cet étudiant s'appelait Ernest Theonest. Il faudrait que je retrouve l'autre nom, c'est-à-dire son nom exact. Georges est allé lui rendre visite. Il avait tellement apprécié son séjour au Rwanda qu'il avait commencé à construire une maison à Kigali, à Remera, avec cet étudiant-là. Ils avaient cotisé pour construire une maison à Remera. Je crois que si vous posez la question à ses parents, ils vous le confirmeront parce qu'il m'a dit, quand il était encore ici, que ses parents étaient opposés au fait qu'il investisse au Rwanda. Après son retour au Rwanda, cet étudiant qui avait de la famille très haut placée au Rwanda son frère était lieutenant-colonel et avait des fonctions importantes au pays avait pris des contacts; il connaissait beaucoup de gens. Quand il est revenu, c'est lui-même qui m'a contacté parce qu'il savait que j'étais actif. À l'époque, j'étais le président de la communauté des étudiants rwandais en Belgique. Il m'a contacté pour me demander qu'on fasse un groupe concret, un groupe de réflexion. Lors de son séjour au Rwanda, il s'était rendu compte que les Rwandais n'étaient pas de mauvaise foi mais qu'ils ne savaient pas s'exprimer de façon à ce que ce soit compréhensible en Occident. C'est lui qui me l'a demandé. » (319c)
M. Jean-Pierre Chrétien affirme ne pas comprendre l'attitude de M. Ruggiu. Voici ce qu'il dit : « Il faut espérer que M. Georges Ruggiu aura à s'expliquer un jour devant la justice. La transcription d'émissions dont nous disposons, ne suffit pas. Il faut entendre les paroles de haine vis-à-vis de ses compatriotes qu'il a exprimées. Je ne sais pas pourquoi il a agi de cette manière. Il faudra examiner cette question de plus près et essayer de savoir quels étaient les milieux avec lesquels il entretenait des contacts en Belgique. Il fait partie des gens qui adhèrent à la logique de la majorité, et ce pour des raisons plutôt idéologiques que financières. » (320c)
(2) La formation à Bruxelles de techniciens en communication rwandais
M. Ferdinand Nahimana, le directeur d'ORINFOR de l'époque (l'Office d'information du Rwanda), qui était déjà désigné, dans le télex nº 86 du 31 janvier 1994, comme étant l'un de ceux qui avaient pris des initiatives en vue de la mise sur pied de RTLM, dirigeait un groupe de techniciens de télévision rwandais dans le cadre de deux programmes de formation auprès de la BRTN et de la RTBF. La commission constate que ces programmes se sont déroulés respectivement en novembre 1990 et en août 1991, que leur coût (2 fois 25 millions de francs) a d'ailleurs été financé par l'AGCD. Outre M. Ferdinand Nahimana, l'une des personnes qui avaient suivi une formation dans le cadre de ce projet (J. B. Karimero) est devenue membre de la RTLM (321c).
(3) L'implication de groupes politiques belges et européens
Au cours de ses auditions, la commission a examiné à plusieurs reprises la question de savoir si l'Internationale démocrate-chrétienne a contribué à la création de la radio RTLM, ou si elle en a encouragé ou financé la création.
Deux personnes accusent l'IDC et/ou la fondation Konrad Adenauer, également de tendance chrétienne-démocrate, d'avoir contribué activement à la création de cette radio. La commission n'a recueilli aucun autre élément permettant d'étayer ces accusations.
Une série d'autres témoins, qui étaient responsables, à l'époque, des activités des organisations en question, nient toute implication de l'IDC et des partis démocrates-chrétiens belges dans la fondation et le financement de RTLM.
Pour la commission, le point de repère, c'est le télex nº 270 que l'ambassadeur Swinnen a envoyé à Bruxelles le 31 mars 1994 et dont le contenu est le suivant :
« 1. Tijdens een recent onderhoud met Frans ambassadeur drukte minister van defensie Bizimana zijn verwondering uit over het ongenoegen dat minister Delcroix over RTLM had verwoord : 'Puisque son propre parti avait, à l'époque, encouragé le président à mettre sur pied une radio libre qui pourrait former un contrepoids à la propagande de Radio Muhabura (FRPR) ', dixit Bizimana. 2. Persoonlijk beschik ik over geen enkele indicatie als zou een Belgische politieke formatie een rol gespeeld hebben bij de oprichting van RTLM. Wel zou RTLM zelf in een recente uitzending beweerd hebben dat de IDC (Internationale Démocrate Chrétienne) tot haar geldschieters behoort. » (322c).
Le lendemain, le ministre des Affaires étrangères envoie un télégramme à l'ambassadeur Swinnen, dans lequel il se plaint de RTLM : « Étant donné tout ce que nous faisons pour le Rwanda, il est incompréhensible que cette radio, dont nous connaissons le système de financement, mène une campagne antibelge scandaleuse. »
Le contenu de ces télex, qui figuraient également dans le rapport du groupe ad hoc Rwanda, a été examiné très attentivement au cours des travaux de la commission d'enquête.
L'on a d'abord vérifié si, dans son télégramme où figuraient les mots « dont nous connaissons le financement » , le ministre visait le contenu du télex nº 270 (l'Internationale démocrate-chrétienne) ou celui du télex nº 86, qui indique que MM. Kabuga et F. Nahimana, amis du président Habyarimana, sont des actionnaires de RTLM. Cette question a trouvé sa réponse dans la déclaration que le ministre a faite devant notre commission (323c) :« Au cours de mon séjour au Rwanda, divers représentants de la communauté internationale m'avaient fait savoir que RTLM était gérée et financée par le beau-frère du président. » (324c)
Les deux témoins qui accusent la Fondation Konrad Adenauer d'avoir financé RTLM sont les suivants :
Le professeur Jean-Pierre Chrétien estime lui aussi que les fonds de départ de RTLM proviennent de la Fondation Adenauer : « La mise en place d'une radio comme RTLM exigeait d'importants investissements. Nous n'avons que des indices à propos de l'aide initiale et ces indices correspondent à ce que j'ai lu dans le rapport du groupe ad hoc. Un journaliste rwandais qui travaille en Allemagne affirme que les fonds de départ provenaient de la Fondation Adenauer, ce qui indique qu'il peut y avoir implication de l'Internationale démocrate-chrétienne. Il faudrait toutefois procéder à une enquête précise et essayer d'obtenir des informations exactes concernant le paiement du matériel. Si nous ne disposons pas de ces données, ce n'est pas faute de les avoir cherchées. » (325c)
M. Christian Terras, chroniqueur au magazine Golias, le répète et souligne l'importance de la Fondation Adenauer : « L'Internationale démocrate-chrétienne est un lobby puissant et disposant d'un réseau étendu dans lequel la Fondation Adenauer joue un rôle capital. C'est cette fondation qui fournit à l'IDC l'essentiel de ses fonds. Il ressort d'une enquête menée par un journaliste que M. Ferdinand Nahimana y a recouru en 1993 pour le financement d'un émetteur de RTLM. (...) M. Ferdinand Nahimana a demandé, avec l'aide de MM. Molte et de Pristil, des fonds à la démocratie chrétienne allemande pour créer sa propre radio. (...) Nous cherchons les contrats qui ont été établis entre Ferdinand Nahimana et ses bailleurs de fonds. Nous sommes sûrs qu'ils existent. »
À la question de savoir s'il pouvait donner une idée du montant dont il s'agit, M. Terras a répondu ce qui suit : « Je n'ai ni chiffres, ni preuves, mais je dispose d'un ordre de grandeur : 3 millions de francs français. »
À la question de savoir si c'est l'IDC ou la Fondation Adenauer qui finançait RTLM, il a répondu comme suit : « L'IDC via la Fondation Adenauer mais pas directement. »
La commission a donné la parole à ce sujet à des responsables de l'IDC de l'époque. Plusieurs témoins de l'IDC concèdent que les partis démocrates-chrétiens belges et allemands avaient des contacts avec des partis politiques rwandais, mais nient que RTLM ait été financée par l'IDC.
Il faut d'abord noter que l'IDC a contredit, dès le début du mois de mai 1994, la rumeur en provenance de Kigali; « De Christen Democratische Internationale ontkent met aandrang de informatie opgevangen uit Belgische diplomatieke bron, volgens dewelke geruchten de ronde doen in Rwanda dat de CDI de financiering van « Radio Mille Collines » op zich zou hebben genomen. De CDI heeft geen enkele financiële of materiële hulp aan Radio Mille Collines gegeven, evenmin als aan eender welke Rwandese politieke beweging. Tot op heden telt de CDI geen enkele Rwandese partij als lid. Daarbij komt nog dat zij op constante wijze alle oproepen tot geweld afgekeurd heeft. » (326c)
M. André Louis, vice-président, à l'époque, de l'Internationale démocrate-chrétienne, en témoigne devant la commission : « Il n'y a jamais eu, à aucun moment, un financement de l'IDC dans RTLM. Par ailleurs, quand ce poste a commencé à dévier dans des appels à la violence il y a eu le 4 mai 1994 un communiqué de l'IDC extrêmement précis condamnant toutes les violences, d'où qu'elles viennent et citant expressément Radio Mille Collines » (327c)
En ce qui concerne les rumeurs faisant état d'un soutien financier à RTLM, la réponse de M. André Louis est la suivante : « Moest men daarop kunnen antwoorden dan zou men natuurlijk heel wat problemen vermijden. Ik weet niet waarvan die geruchten komen. Ik heb gelezen dat Radio Mille Collines zelf zou gezegd hebben dat zij financiële steun ontving. Dat staat ergens in een papier van onze ambassade destijds in Kigali. Uiteraard kunnen ze dat vrijblijvend zeggen. Er is echter absoluut niets van aan. Dergelijke dingen herhaalt men steeds weer. » (328c)
À la question de savoir s'il est au courant que RTLM aurait pu être financée par la la fondation Konrad Adenauer, il répond : « Cela me paraît exclu, mais je n'en sais rien. » (329c)
Concernant l'affirmation de RTLM selon laquelle elle avait reçu de l'argent de l'IDC, M. Léon Saur, ancien secrétaire international du PSC, déclare ce qui suit : « RTLM disait être aidée par la fondation. J'en doute. En tout cas, le PSC n'a jamais financé RTLM. » (...) (330c) « Je ne crois pas que l'IDC, en tant que telle, ait financé RTLM dans la mesure où, si j'ai bonne mémoire, l'internationale démocrate chrétienne avait à l'époque de gros problèmes de financement. » (331c)
À la question de savoir si des partis membres de l'IDC auraient pu financer RTLM, M. Léon Saur répond : « Je pense que cette possibilité existe. Rien n'obligeait un parti politique démocrate-chrétien au sens européen du terme à passer par l'IDC pour financer un projet de ce type. » (332c)
Pour le reste, M. Saur affirme qu'il ne dispose d'aucun renseignement relatif au financement de RTLM : « Je ne pense à aucun parti. Je pense simplement à la totalité des partis démocrates-chrétiens avec lesquels le MRND pouvait avoir des relations. Le MRND avait une section en Belgique, en France, en Allemagne ... Il y avait une kyrielle de partie démocrates-chrétiens susceptibles d'être sollicités. » (333c)
Concernant les tentatives éventuelles de RTLM d'obtenir des fonds du PSC, M. Léon Saur déclare ce qui suit : « Non, pas en ce qui concerne RTLM. Par contre, il est vrai que M. Dismas Nsengiyaremye est passé en Belgique au terme de son mandat de premier ministre le mandat de son gouvernement de transition étant échu à la date du 16 juillet 1993 après avoir été remplacé par Mme Uwilingiyimana. À cette occasion, je l'ai rencontré et il m'a dit être à la recherche de fonds pour lancer une radio pour le compte du MDR. Il ne s'agissait certainement pas de radio Mille Collines, puisqu'il disait que le MRND avait déjà sa propre radio RTLM et qu'il souhaitait, en qualité de premier vice-président du MDR, disposer d'une station pour émettre quelques heures par semaine. Il agissait en qualité de président faisant fonction du MRND. Je crois mais je ne saurais l'affirmer avec certitude que mon alter ego du CVP était présent. De son côté, fort probablement, M. Dismas Nsengiyaremye était accompagné du représentant de son parti pour le Benelux. » (334c)
« Toutefois, au cours de cette réunion, M. Dismas Nsengiyaremye a fait allusion à une autre réunion qui s'était tenue quelques jours plus tôt à l'IDC avec André Louis, Alain De Brouwer et Rika De Backer. Il était question de l'aide des partis chrétiens au MDR, notamment pour la création d'une station radio. Mais il n'y avait aucune confusion possible avec RTLM, puisque RTLM existait déjà ou était sur le point de commencer à émettre. » (335c)
En ce qui concerne le PSC, M. Saur affirme qu'il a reçu communication d'une telle demande, mais qu'il n'y a donné aucune suite : « Je recevais cette demande à titre personnel de manière positive parce que je pense qu'il avait montré, par son engagement dans Arusha, sa volonté de voir le processus aboutir. Aucune suite n'a été donnée parce que les événements ont commencé à se précipiter. » (336c)
Après qu'un commissaire lui a présenté un document relatif à une réunion à laquelle il aurait participé avec un Premier ministre rwandais et où la question relative au financement d'une radio aurait été posée, M. André Louis déclare ce qui suit : « C'est possible. Je ne me souviens pas de cela. C'est la première fois que je l'entends. J'ai peut-être été là. Ne fût-ce que pour souhaiter la bienvenue au Premier ministre. Je ne veux pas prétendre que je n'étais pas là. » (337c)
Interrogée sur la question de savoir si elle est au courant du financement de RTLM par l'IDC, Mme Rika De Backer, ancienne trésorière de l'EVP répond comme suit : « Ik heb dat overal trachten na te trekken en te onderzoeken, maar ik heb daarvan geen enkel spoor teruggevonden. Iedereen ontkent dat op de meest stellige manier. Ik geloof er dus niet in. Ik zat daar natuurlijk niet middenin, maar ik ben ervan overtuigd dat ze dat niet hebben gedaan. » (338c)
Pour préciser les choses, elle déclare néanmoins ce qui suit : « RTLM is een vrije radio die ontstaan is bij het zich ontwikkelen van de vrije radio's in de derde wereld. In Burundi waren er ook. Er was Muhabura in het bezet gebied en radio RTLM.
Toen RTLM in oktober 1993 is beginnen uitzenden, was die heel convenabel. Ik heb hem toen niet gehoord, want ik was toen niet in Rwanda, maar de uitzendingen verslechterden naar de periode januari-februari toe, toen ik ze zelf heb gehoord.
Men heeft in oktober geprobeerd hier geld bijeen te rapen bij de Rwandezen. Men is gekomen tot een som van 40 000 frank, die men zelfs nooit heeft doorgestuurd omdat men beschaamd was dat het zo weinig was.
Dat is gezegd door iemand van de oude MRND. Hij heeft mij gezegd dat hij dat heeft gevonden op de fameuze bankrekening van Gembloux. » (339c)
À la question de savoir de qui elle a reçu cette information concernant la collecte de fonds pour RTLM en Belgique pour le montant de ces 40 000 francs, Mme De Backer répond comme suit : « Ik heb dat, denk ik, van Murayi gehoord. » (340c)
Enfin, M. Paulin Murayi, à l'époque président du MRND-Belgique, déclare également que l'IDC n'a pas accepté la demande de soutien financier de M. Georges Ruggiu : « Pour autant que je sache, il a payé lui-même. Il a essayé d'obtenir des financements, mais il n'y est pas parvenu. Il écrit, entre autres, à l'IDC, afin de lui demander de supporter le coût du billet, ce que l'IDC n'a pas fait. » (341c)
Pour le reste, la commission a fait usage de son pouvoir d'enquête pour faire la clarté sur cette question.
Comme on l'a déjà dit, à la demande de la commission spéciale, les comptes que RTLM avait ouverts à la BBL de Gembloux en vue de son financement au départ de la Belgique ont été vérifiés. Il ressort de cette enquête que l'on a souscrit en Belgique à 42 actions de RTLM au total, représentant un montant de 49 990 francs. Ces 49 990 francs n'ont jamais été versés à Kigali. Parmi les souscripteurs, on ne retrouve aucun Belge, à l'exception de M. Georges Ruggiu, qui avait souscrit à deux actions, pour un montant de 2 380 francs. À l'occasion de cette enquête, l'on a également vérifié les comptes personnels en Belgique des titulaires de ce compte de RTLM et l'on n'a pu mettre au jour aucun financement par des Belges ou par une organisation belge, européenne ou internationale.
La commission d'enquête a ensuite demandé aux autorités judiciaires d'examiner si des liens éventuels avec le Rwanda pouvaient être établis dans l'affaire des « Milieuboxen Hermes Communications ». L'on avait contrôlé à cette occasion et la comptabilité du CVP, et celle de cette S.A. spécialisée dans les questions de communications.
Par lettre du 20 octobre 1997, le procureur général d'Anvers a fait savoir que le juge d'instruction L. Jans avait confirmé qu'il n'avait pas découvert d'éléments présentant un lien direct ou indirect avec les événements du Rwanda dans ces deux dossiers, et cela ni à l'occasion de ces perquisitions, ni à la suite d'autres devoirs d'enquête.
M. Houtmans, le directeur de Radio Contact, a mis la commission sur la trace d'une firme belge qui, selon lui, aurait fourni les studios de Radio Mille Collines. M. Eddy Lemmens, conseiller près la Cour d'appel d'Anvers, a, à la demande de la commission, contrôlé la comptabilité de cette firme et a effectivement constaté que M. Simeon Musengimana avait acheté à cette firme un émetteur et un studio au profit de deux organisations agricoles rwandaises, « Intergroupement Tuzamuke Twese » et « Intergroupement Paysan Isangano ». L'objectif était de créer, grâce à cet émetteur et à ce studio, une radio qui ferait de la formation agricole. L'achat a d'ailleurs été cofinancé, dans le cadre d'un projet de développement, par le F.O.S. (Fonds voor Ontwikkelingssamenwerking). Ce matériel radio n'a toutefois été livré que le 28 mars 1994, si bien qu'en raison des événements qui ont eu lieu au Rwanda après le 6 avril 1994, le transport vers le Rwanda n'a jamais été effectué. Dès lors, il est établi que le matériel radio vendu par la firme belge concernée n'a jamais pu être utilisé par Radio Mille Collines. La puissance de l'emetteur vendu par cette firme belge est nettement inférieure à celle dont disposait RTLM au Rwanda.
Sur la base des documents dont la commission dispose, des témoignages qu'elle a entendus et des actes d'instruction auxquels elle a procédé, la commission constate qu'elle ne dispose pas de preuves tendant à indiquer que le CVP, le Parti social-chrétien ou l'Internationale démocrate-chrétienne étaient associés à la création ou au financement de l'émetteur rwandais RTLM, semeur de haine. Des indices existent que la Fondation Konrad Adenauer avait donné suite à la demande de soutien financier émanant de RTLM.
L'ambassadeur Swinnen a adressé à Bruxelles à plusieurs reprises des informations sur les actions et l'influence néfaste de RTLM. Il a pris conscience de l'influence néfaste de RTLM vers la fin de 1993. Il s'est plaint de ne pas disposer d'un effectif suffisant pour écouter ou traduire toutes les émissions. De nombreuses émissions ont toutefois été enregistrées et l'on a été informé de leur contenu à Bruxelles. Lorsque M. Bruno Angelet, diplomate, est venu renforcer le personnel de l'ambassade en janvier 1994, il a été chargé d'écouter RTLM et d'envoyer à Bruxelles des extraits d'émissions. L'on écoutait principalement les émissions en français et les éditoriaux, avant d'en informer Bruxelles par télex. L'ambassadeur Swinnen ne croit pas pouvoir disposer de l'enregistrement, étant donné que M. Bruno Angelet n'a pas pu repasser à sa résidence lorsqu'ils ont été évacués vers l'aéroport. (342c)
La presse a fait aussi état du problème posé par RTLM.
Le 23 février 1994, Knack a publié l'article suivant : (traduction) « Le CDR, un parti extrémiste hutu, proche de l'aile droite des fidèles du président, qui a le vent en poupe, mène une campagne agressive, soutenue en cela par la radio libre « des mille collines » dont le taux d'écoute est très élevé et qui, en diffusant les rumeurs les plus folles et les plus exagérées, est souvent à l'origine d'échauffourées et d'incidents. Les Casques bleus belges en ont eux aussi déjà été victimes à plusieurs reprises. »
Le ministre Delcroix confirme qu'il était au courant de l'influence néfaste de RTLM et déclare qu'il a entrepris différentes démarches contre cette station. (343c)
Il ajoute qu'après les événements du 6 avril, le Conseil des ministres et le cabinet restreint ont eu des discussions concernant RTLM :
« Er wordt een globale stand van zaken gegeven. Er wordt een weergave gegeven van de besprekingen in het Parlement en er wordt gesproken over de voorbereiding van de ministerraad van vrijdag. Ik kreeg de opdracht om met S drie zaken te bespreken. Ten eerste moest ik, zoals ik vroeger in deze commissie al heb verklaard, mij bezig houden met het probleem RTLM.
Op 12 april was er opnieuw kernkabinet. Er werd door mij een stand van zaken gegeven over de rol van radio RTLM, ... » (344c)
Le Premier ministre Dehaene est, lui aussi, très formel à ce sujet : « Il est clair que nous étions conscients qu'il y avait des réactions antibelges mais on ne pouvait parler d'un climat général défavorable. Il y avait effectivement des actions menées par une minorité, qui étaient amplifiées par RTLM. » (345c)
Savait-on plus précisément en Belgique que le parti gouvernemental MRND et le président Habyarimana étaient associés à RTLM ?
À un commissaire qui lui a demandé si elle savait que le président était actionnaire de RTLM, Mme Rika De Backer répond ce qui suit : « Zowel de heer Delcroix als ikzelf hebben tegen president Habyarimana gezegd dat het zo niet verder kon. Zelf heb ik tot tweemaal toe tegen de president gezegd : « Dat is onmogelijk. » (346c)
Elle ajoute cependant que son intervention auprès du président était motivée principalement par le fait qu'elle croyait que celui-ci pouvait, en tant que président, agir pour faire cesser ces principes.
Le ministre Delcroix savait, lui aussi, qu'il y était associé, puisqu'il a posé des questions au président à ce sujet lors de sa visite au Rwanda. Cela a d'ailleurs donné lieu à quelques réactions agressives de la part du président et de son entourage. Le ministre Claes confirme que la présidence rwandaise a réagi avec nervosité : « En ce qui concerne RTLM, je dispose de plusieurs télex des ministres Delcroix et Claes et de l'ambassadeur Swinnen, dans lesquels cette affaire est exposée au président et au ministre de l'information. La présidence a d'ailleurs réagi avec une certaine nervosité aux multiples interventions de la Belgique ». (347c)... « Au cours de mon séjour au Rwanda, divers représentants de la communauté internationale m'avaient communiqué que RTLM était gérée et financée par le beau-frère du président. Je ne savais pas que le président finançait lui-même radio Kigali ». (348c)
La commission constate que les deux ministres étaient informés de l'influence néfaste de RTLM, de son attitude antibelge, de ses incitations à la haine ethnique et aux massacres et des liens que cet émetteur entretenait avec le président Habyarimana et son entourage.
Dans ce chapitre, la commission fait une distinction entre les démarches diplomatiques qui ont été effectuées et les moyens militaires dont on disposait pour empêcher RTLM d'émettre.
3.11.4.1. Actions diplomatiques
Il ressort des citations qui précèdent que, dans les télex qu'il adressait au Ministère des Affaires étrangères à Bruxelles, l'ambassadeur Swinnen a attiré plusieurs fois l'attention sur le problème que posait RTLM. C'est ainsi qu'il fait état, dans son télex du 1er février 1994, du fait que cette radio tient des propos subversifs qui constituent de plus en plus un facteur important dans le développement d'un scénario de déstabilisation. (349c) Dans un télex du 3 mars figure le rapport d'un entretien entre l'ambassadeur et le président Habyarimana, au cours duquel les plaintes belges à l'égard de RTLM ont été réitérées. (350c) Le 15 mars, l'ambassadeur envoie un télex dans lequel il déclare que M. Habyarimana a promis à M. Delcroix que RTLM allait modérer ses commentaires. Deux semaines plus tard exactement, l'ambassadeur fait savoir, dans un nouveau télex, qu'il doute de la sincérité de cette promesse du président. (351c)
L'ambassadeur a également tenté d'organiser une série d'actions sur le terrain à Kigali même. C'est ainsi qu'en mars 1994, l'on a organisé un séminaire pour journalistes à l'ambassade de Belgique. La journaliste Colette Braeckman y a pris part parmi d'autres. Voici ce qu'elle déclare : « J'ai participé, à l'ambassade de Belgique, à un séminaire organisé pour les journalistes sur l'objectivité de la presse. Participaient à ce séminaire, des collègues de la presse d'État, de la presse privée, la radio Muhabura, la radio des Mille Collines ainsi que trois journalistes belges. Nous avons discuté pendant trois jours ». (352c) (...) « La section de coopération de l'ambassade de Belgique, qui avait organisé ce séminaire avec la collaboration du révérend père Theunis, avait jugé qu'il fallait inviter la radio Mille Collines étant donné que c'était une radio privée. L'ambassade entretenait pourtant de mauvaises relations avec cette radio, qui rendait mal ses messages et qui donnait systématiquement une mauvaise image de la coopération belge par rapport à la coopération française qu'elle magnifiait. Par la suite, la radio du FPR a également été invitée; de la sorte, on faisait participer des extrémistes des deux camps. » (353c)
Le père Theunis a lui aussi rencontré M. Ferdinand Nahimana au cours du séminaire et il lui a déclaré que la déontologie de RTLM était inadmissible : « À ce moment, nous préparions le séminaire-débat organisé par l'ambassade de Belgique. C'est dans ce cadre que je suis allé trois fois à RTLM. Mon propos était de rencontrer Monsieur Ruggiu. Comme il n'était pas présent, les trois fois la première fois, comme je le comprends, car c'était à l'improviste, je n'avais pas prévenu de ma venue. Mais les deux autres fois, nous avions fixé des rendez-vous et je m'attendais à voir Monsieur Ruggiu. Or, il se fait que je ne l'ai pas rencontré mais que, par hasard, les deux fois, j'ai rencontré Monsieur Nahimana. Que voulez-vous que je lui dise, sinon lui parler du séminaire-débat organisé par l'ambassade de Belgique ? Et de faire peut être l'un ou l'autre commentaire sur RTLM. Ceux qui me connaissent savent que je n'ai pas peur de dire la vérité et que je trouvais que la qualité de cette radio, journalistiquement, était bonne mais déontologiquement était inadmissible. Je pense l'avoir dit à Monsieur Nahimana car je savais bien qu'il ne figure pas dans l'organigramme de RTLM qu'il y avait un rôle essentiel. » (354c)
L'ambassadeur Swinnen considérait que combattre RTLM était un facteur important de réussite des accords d'Arusha, étant donné que cette radio était opposée aux efforts de paix : « Nous étions conscients de ces liens et nous n'avons ménagé aucun effort pour encourager les hommes politiques à ne pas miner le processus de paix. Ces efforts s'adressaient aussi au FPR. » (355c)
Comme indiqué ci-dessus, mission sera donnée au diplomate Bruno Angelet d'écouter activement RTLM et de communiquer régulièrement ses conclusions à Bruxelles. (356c)
Comme on l'a déjà dit, le ministre Claes confirme qu'il dispose de plusieurs télex d'où il ressort que le ministre Delcroix, l'ambassadeur Swinnen et lui-même ont exposé le problème de RTLM au président et au ministre de l'Information. Selon M. Claes, la présidence a d'ailleurs réagi avec une certaine nervosité aux multiples interventions de la Belgique. (357c)
L'ancienne sénatrice Nelly Maes fournit l'appréciation suivante à propos des démarches diplomatiques qui ont été faites : « L'ambassadeur a confirmé le rôle joué par radio Mille Collines. Les tentatives entreprises en vue d'imposer le silence à cette radio ou de contrecarrer ses activités n'ont pas été suivies d'effets. » (358c)
Les témoignages qui suivent révèlent que les militaires sur place, et le ministre de la Défense, M. Leo Delcroix, ont tenté, principalement par la voie diplomatique, de mettre fin aux communiqués négatifs de RTLM. Plusieurs témoins ont cependant déclaré que l'ONU disposait du matériel nécessaire pour brouiller activement les émissions de RTLM ou pour supprimer l'émetteur manu militari .
D'après le capitaine Claeys, officier de renseignements à la Force, la MINUAR n'a jamais envisagé de neutraliser RTLM : « Neen, maar kolonel Leroy ere wie ere toekomt heeft er wel geregeld op aangedrongen dat er door de UNO zo veel mogelijk vlugschriften zouden worden verspreid om duidelijk te maken dat wij daar kwamen doen en dat er, naar het voorbeeld van Somalië, een UNO-radiozender zou worden opgericht die op geregelde tijdstippen en op een door de regering ter beschikking gestelde frequentie, berichten zou uitzenden in het Kinyarwanda, het Frans en het Engels over wat de UNO kwam doen.
Ik heb ook geregeld naar de lokale radio geluisterd en naar de televisie gekeken, maar het probleem was dat er weinig uitzendingen in het Frans waren. Het grootste deel van de uitzendingen waren in het Kinyarwanda, dus voor ons niet te begrijpen. Wij konden alleen naar de uitzendingen in het Frans luisteren en die waren nooit zo sterk als deze in het Kinyarwanda, zoals later bleek.
We hebben het met tolken geprobeerd, maar zij waren ook niet altijd even betrouwbaar. In de UNO-staf waren verscheidene Rwandezen tewerkgesteld maar wij vermoedden dat zij tot verschillende partijen behoorden. We waren dus niet altijd zeker van hun eerlijkheid en overtuiging. » (359c)
Le lieutenant Nees (KIBAT I) a tenté, avec des moyens limités, d'écouter les émissions de RTLM pour recueillir des renseignements : « À KIBAT I et KIBAT II, quelques sous-officiers maîtrisaient le kinyarwanda. Ces personnes écoutaient sporadiquement RTLM. J'ai chargé mon informateur principal de prêter surtout attention à RTLM, mais nous n'avions ni suffisamment de personnes, ni suffisamment de moyens pour écouter en permanence. J'ai en tout cas demandé si cela pouvait être réglé. » (360c)
Le colonel Marchal était bien conscient du problème que posait RTLM puisqu'il avait mis en garde le général Dallaire dès le mois de décembre 1993 : « Selon l'interprétation de mes notes par l'auditorat général, il apparaît que j'ai exprimé des craintes dès le mois de décembre ». (361c) ... « J'ai également exprimé officiellement mes préoccupations au général Dallaire concernant les conséquences des émissions de Radio Mille Collines. » (362c)
Le colonel Marchal déclare que KIBAT II avait emmené son propre émetteur radio, mais ajoute que l'on n'a pas essayé de brouiller les émissions de RTLM à l'aide de celui-ci : « KIBAT II est arrivé avec une radio. Dans le but d'entretenir le moral des troupes, nous avons obtenu une fréquence, mais après un jour ou deux d'émission, nous avons enregistré une réclamation du ministre de l'Information. Nous avons donc changé la fréquence, mais cette radio n'avait pas pour but de brouiller RTLM. » (363c)
Le ministre Delcroix a aussi pris quelques initiatives diplomatiques comme l'organisation d'une entrevue personnelle avec M. Habyarimana et l'accomplissement d'une démarche auprès de l'ambassadeur du Rwanda en Belgique : « La Belgique était au courant de l'influence pernicieuse de RTLM et a fait diverses démarches contre cette station. Au cours d'un entretien personnel avec le président Habyarimana, je lui ai demandé d'user de sa propre influence et d'intervenir auprès de RTLM. À ce moment-là, je lui ai également demandé s'il était réellement actionnaire de RTLM. Il m'a répondu qu'il n'était pas lui-même actionnaire, mais que certaines personnes de son parti l'étaient. Il m'a toutefois promis de faire valoir son influence auprès de RTLM. Il est probable que l'ambassadeur n'a pas apprécié ma démarche. Cependant, les relations entre le président et l'ambassadeur n'étaient pas optimales. Selon le président, il penchait trop vers le FPR.
En ce qui concerne RTLM, nous avons également fait une démarche auprès de l'ambassadeur rwandais en Belgique. À la demande du chef de cabinet du ministre Claes, je me suis également associé à une réaction du ministre des Affaires étrangères. » (364c)
Pourtant, les témoignages suivants révèlent que les militaires avaient la possibilité de fournir une autre information à la population au moyen de leurs propres émetteurs, de brouiller avec ces équipements les émissions de RTLM, voire de neutraliser manu militari RTLM.
Le général-major Uytterhoeven a déclaré ce qui suit devant notre commission : « C'était (faire cesser les émissions de RTLM) difficile à réaliser dans le cadre où nous travaillions, c'est-à-dire l'ONU. Nous disposions cependant de nos propres émetteurs qui permettaient de diffuser d'autres informations à destination de la population. » (365c)
Le colonel Marchal compare la situation à celle de la Somalie, où l'on a brouillé des émissions, ce qui est donc techniquement possible : « L'ONU dispose d'ailleurs d'un matériel adéquat. Beaucoup de remarques à ce sujet ont été faites à tous les échelons. Mais le président répondait que l'on ne pouvait pas supprimer la liberté de la presse, etc. d'autant moins qu'il était lui-même critiqué par RTLM. Cette radio a donc continué à émettre. Pour moi, l'ONU était responsable. Les émissions de RTLM étaient contraires au protocole d'accord entre le Rwanda et l'ONU. D'autre part, nous ne disposions pas sur place de tous les moyens utilisables. Nous avons obtenu un temps d'antenne sur Radio Rwanda et je crois que l'utilisation de celui-ci pouvait avoir des effets positifs sur les événements. » (366c)
Était-il possible, du point de vue technique et militaire, de neutraliser, de saboter facilement RTLM ?
L'adjudant Boequelloen, responsable des transmissions de KIBAT II, est particulièrement formel à cet égard : « Radio Mille Collines était une radio FM. Il suffit de repérer sa puissance et de mettre à portée convenable une autre radio qui émet, sur la même puissance, un signal perturbé. On ne doit pas brouiller tout le temps, mais seulement au moment où des émissions spécifiques commencent à être émises. Ils sont alors dans les pires difficultés.
La distance d'émission d'une telle radio est directement proportionnelle à sa puissance d'émission. Si vous souhaitez brouiller, il faut voir de quelle puissance vous disposez; il faut être plus puissant que l'autre. Si vous êtes beaucoup plus puissant, vous pouvez émettre bien plus loin. Si vous êtes de la même puissance, vous vous mettez entre cet autre et son interlocuteur.
On ne m'a pas transmis la puissance exacte. Je l'estime à 400 ou 500 watt. » (367c) Selon des données dont la commission dispose, KIBAT pouvait utiliser au maximum 100 watt pour brouiller les émissions de RTLM. Cela suffit pour brouiller un émetteur d'une puissance de 400 à 500 watts comme RTLM, à condition, du moins, que cet émetteur soit situé à l'endroit correct.
Le ministre Delcroix déclare qu'il a demandé au lieutenant-général Charlier de brouiller RTLM (368c).
La réplique du lieutenant-général Charlier à cette affirmation est on ne peut plus claire : « Le ministre Delcroix n'a pas suggéré de bombarder ou de détruire physiquement l'émetteur de RTLM. Après le 7 avril, il m'a demandé si nous avions la possibilité de faire taire cette station par des moyens électroniques. Je lui ai répondu que la compagnie avait été supprimée en 1981 et que nous ne disposions donc plus des moyens adéquats. 24 heures après que le FPR avait fait tomber l'antenne de RTLM, les émissions reprenaient. » (369c)
À première vue, cette déclaration du chef d'état-major Charlier semble contraire à la déclaration précitée de l'adjudant Boequelloen. La commission constate toutefois qu'il s'agit de deux principes totalement différents concernant le brouillage actif d'appareils d'émission. Le lieutenant-général Charlier renvoie à la compagnie spécialisée qui a existé jusqu'en 1981 au niveau du corps et qui était responsable du brouillage des radios de combat du Pacte de Varsovie durant la guerre froide. L'adjudant Boequelloen dit qu'un émetteur radio classique peut parfaitement être brouillé par un autre émetteur classique. La commission constate dès lors que ces deux déclarations sont, non pas contraires, mais complémentaires.
Cependant, il ressort des documents du SGR que la MINUAR transmettra le 8 avril 1994 au C Ops, à la demande du lieutenant-général Charlier (JS), les coordonnées de l'endroit où se trouve l'émetteur de RTLM : « Localisation de l'émetteur Mille Collines RTLM Rue du Commerce à Nyarugenge en Coord 0650.8490 ». (370c) Cependant, à ce moment-là, les dix Casques bleus belges ont déjà été assassinés et le génocide a déjà éclaté dans toute sa violence.
Enfin, la commission précise qu'un très grand nombre d'heures d'émission de RTLM ont été enregistrées. Ces enregistrements ont été conservés et sont disponibles à Kigali. Le gouvernement rwandais confirme qu'ils ont été mis à la disposition du Tribunal international d'Arusha.
La commission constate que les milieux politiques belges et rwandais entretenaient des contacts autres que ceux qui s'établissaient entre la Belgique et le Rwanda par le biais des canaux officiels arrêtés par les deux gouvernements dans le cadre d'accords de nature politique et technique et militaire.
Ces contacts ont notamment été concrétisés au sein d'institutions politiques internationales telles que l'Internationale démocrate-chrétienne.
Par ailleurs, les milieux rwandais avaient également des contacts avec des partenaires belges qui leur étaient utiles, en vue d'exercer une pression sur le processus décisionnel des autorités belges.
Dans le cadre de l'accomplissement de sa mission, la commission a examiné les divers canaux officieux existant entre certains milieux politiques en Belgique et au Rwanda ainsi que leur influence sur la politique rwandaise comme sur la politique belge. Compte tenu d'un certain nombre de passages figurant dans les documents consultés et compte tenu de la disponibilité des documents, la commission s'est limitée à l'examen des points de vue de l'Internationale démocrate chrétienne. Elle n'a consacré aucun examen aux points de vue et relations des autres tendances politiques. La commission a ainsi constaté, entre autres, que l'Internationale démocrate-chrétienne a, pendant des années, entretenu des contacts avec la plupart des partis politiques, principalement le MRND et le président Habyarimana, mais aussi avec d'autres partis comme le MDR. Afin de mieux comprendre l'attitude et le mode de pensée que les deux partis ont adoptés avant, mais aussi après, les événements dramatiques d'avril 1994 vis-à-vis du processus de démocratisation au Rwanda, la commission a entendu M. Léon Saur, ancien secrétaire international du PSC, et M. André Louis, ancien secrétaire général, puis vice-président, de l'IDC. La commission a également demandé à Mme Rika De Backer, ancienne ministre CVP familiarisée avec les problèmes rwandais, d'expliquer son attitude.
La commission a constaté par ailleurs que l'avocat Johan Scheers, qui défendait en Belgique les intérêts du président Habyarimana, et Eugène Nahimana, représentant du MRND en Belgique et homme de confiance du président, ont également pris des initiatives visant à influencer la politique rwandaise de la Belgique.
La commission constate que la démocratie chrétienne entretenait des contacts particuliers avec les représentants de la plupart des partis politiques et surtout avec le MRND du président Habyarimana mais aussi avec d'autres partis, comme le MDR. L'on a eu des contacts à plusieurs niveaux. En attendant que des élections aient lieu, le MRND et le MDR ont été invités aux congrès de l'IDC et à son bureau politique annuel, alors qu'ils n'en étaient pas membres.
Il ressort des différents témoignages ainsi que des nombreux documents de l'IDC dont la commission a pu disposer que l'IDC voulait amener ses interlocuteurs rwandais à modifier leur point de vue. En ce qui concerne le processus de démocratisation au Rwanda, circulaient des écrits politiques dont le contenu s'écartait en partie des premiers accords d'Arusha et qui prévoyaient la création d'un système multipartite et l'organisation d'élections pour pouvoir faire jouer pleinement le principe de la majorité avant de procéder à ce que l'on a appelé le « partage du pouvoir » prévu dans les accords d'Arusha.
Interrogé sur les rapports entre les différentes formations politiques internationales, André Louis a confirmé la forte présence de l'IDC au Rwanda : « Natuurlijk zijn er landen waar de Christen-Democratische Internationale beter geplaatst was om te werken. Dit was bijvoorbeeld het geval in Rwanda »(371c).
Quant aux accords d'Arusha II, André Louis a déclaré qu'il n'y était pas favorable. « J'ai encore rencontré le président le mardi 21 juillet 1992, au Stuyvenberg, ici. Il était en visite à Bruxelles. J'étais accompagné de Rika De Backer à ce moment-là. Je lui ai dit tout le mal que je pensais de l'accord Arusha I, avec les dangers qui pesaient sur l'avenir du pays et du processus de démocratisation. C'était juste après la signature de l'accord d'Arusha I » (372c). « Het is juist dat we geprobeerd hebben de akkoorden van Arusha te verbeteren. Ik herhaal nogmaals dat ik tweemaal in Kigali ben geweest en er gewerkt heb. Dat was voor de ondertekening van Arusha I. Ik heb de president in totaal vier keer ontmoet, dus ook tweemaal na de ondertekening van Arusha-I en ook na Arusha-V. Op een ogenblik dat het al te laat was en alles in kannen en kruiken was. We hebben als Internationale dus voortdurend geprobeerd de akkoorden te verbeteren zolang dat mogelijk was, ook door de mensen attent te maken op de gevaren ervan en op de mogelijkheden om ze te verbeteren »(373c).
Ce témoignage est confirmé dans un document du 4 août 1994 de André Louis, intitulé « Rwanda, genèse d'un drame ». Dans ce document, M. Louis écrit qu'il a rencontré le président à Bruxelles le 21 juillet 1992 et qu'il a attiré son attention sur la logique curieuse du processus décisionnel des accords d'Arusha qui, selon l'auteur, sont contraires à « la logique de la démocratisation et devraient normalement conduire à une aggravation de la crise, au lieu de la résoudre .
Or, l'accord d'Arusha I prévoit déjà « un partage de pouvoir », ce qui est condamnable de manière absolue et constitue la négation même de la démocratie. Les accords ultérieurs prévoient l'installation de systèmes transitoires de gouvernement.
Proclamant officiellement la caducité des accords d'Arusha dès le 9 avril 1994, le surlendemain de l'assassinat des présidents du Rwanda et du Burundi, il (le FPR) a mis en application sa stratégie de prise de pouvoir, provoquant sciemment et systématiquement, par son comportement terroriste, la fuite de deux millions de personnes.
Il convient avant tout d'imposer un désarmement général. Ce qui suppose, durant un certain temps, un quadrillage militaire relativement dense. À cette condition les populations réfugiées pourraient rentrer au pays et elles le feront. Après cela, il conviendra d'organiser, sous contrôle international, des élections au suffrage universel direct dans un délai raisonnablement bref.
Les accords d'Arusha sont bel et bien enterrés, avec les 500 000 cadavres qu'ils ont engendrés. Il faut chercher certes une solution politique, mais elle sera nécessairement tout autre.
C'est la logique même des accords d'Arusha qui est condamnable : celle du « partage du pouvoir ». Le pouvoir n'est pas à partager. Il appartient au peuple. Il faut donner la parole à celui-ci. »
La commission a pris connaissance de nombreux documents et lettres qui ont été envoyés et distribués au cours des périodes qui ont précédé et suivi le mois d'avril 1994, par MM. André Louis et Alain De Brouwer. Dans ces documents et ces lettres, la commission a constaté que l'IDC s'était intéressée de très près au Rwanda et qu'elle avait d'abord voulu influencer les autorités politiques belges. À cet égard, la commission a constaté aussi que l'IDC avait souligné, à l'occasion de ses contacts avec les membres du gouvernement e.a., que le régime de M. Habyarimana était « incontournable ». La commission a constaté en outre que l'IDC avait accompli nombre de démarches en direction du Rwanda, mais aussi que ses partenaires présents au Rwanda étaient informés des efforts « de la Belgique ».
La commission a retenu les documents suivants :
(1) La période antérieure aux accords d'Arusha
la lettre du 28 janvier 1991 que M. Alain De Brouwer, conseiller politique de l'IDC, adressa à M. Wilfried Martens, Premier ministre :
« La délégation du MRND du Rwanda qui a participé, en qualité d' invité, aux travaux du Bureau politique de l'IDC les 17 et 18 janvier derniers, a été très heureuse de pouvoir vous rencontrer lors de l'inauguration de la plaque commémorative d'Aristides Calvani et de la réception que vous avez donnée dans les locaux de l'Internationale.
Comme cette délégation rwandaise n'a pu rencontrer le ministre Eyskens lors du déjeuner offert à Val-Duchesse, le lendemain, nous avons résumé les conclusions les plus importantes tirées lors des échanges avec nos amis du Rwanda » (374c).
une lettre du 28 januari 1991 que M. Alain De Brouwer adressa à M. Marc Eyskens, ministre des Affaires étrangères, et dans laquelle il lui fait part « des vives préoccupations des milieux démocrates chrétiens à l'égard de la participation grandissante de l'Ouganda dans les attaques meurtrières dont le Rwanda est victime ».
« En effet, une délégation rwandaise conduite par M. Enoch Ruhigira, membre de la Commission nationale de synthèse, et par M. Faustin Munyazesa, président de la Commission chargée de la restructuration du MRND dans la perspective du multipartisme, a participé en qualité d'invité au Bureau politique de notre Internationale les 17 et 18 janvier derniers.
Cette délégation rwandaise a eu de nombreux échanges avec les milieux démocrates chrétiens, et a rendu visite aux présidents du CVP et du PSC MM. Van Rompuy et G. Deprez. Elle a même eu la possibilité, dans le cadre du Bureau politique de l'IDC, d'avoir un entretien approfondi avec le ministre des Affaires étrangères de l'Ouganda Paul Ssemogerere, vice-président de l'Internationale. »
M. Alain De Brouwer terminait la note qu'il adressait au ministre des Affaires étrangères par les considérations suivantes :
« 1. le Rwanda s'engage résolument dans une démocratisation multipartite
2. l'ouverture du Rwanda à la cooperation régionale et à une solution concrète des problèmes des réfugiés de toute la région des Grands Lacs.
3. le Front Patriotique Rwandais, FPR, n'est pas intéressé par l'ouverture du régime rwandais ni de s'intégrer dans le multipartisme en préparation
4. la perpétuation d'une guerre non déclarée vise à bloquer les efforts concrets en faveur des problèmes des réfugiés et à déstabiliser le Rwanda
5. le gouvernement du président Museyeni refuse d'appliquer toutes les mesures de pacification aux frontières
6. le régime du président Museyeni apparaît de plus en plus dictatorial et belliciste
7. le gouvernement du président Museyeni tente d'exporter ses tensions et ses conflits vers le Rwanda
8. l'absence de pression diplomatique suivie sur l'Ouganda empêche le retour de la paix dans la région et mine les politiques de coopération au développement de l'Europe
9. le Rwanda a fait des efforts considérables pour améliorer la situation des droits de l'homme
Les détenus liés à l'attaque du 1er octobre dernier et à l'existence d'un plan de soulèvement à Kigali (caches d'armes...) ne peuvent pas être assimilés, pour une très grande part, à des « prisonniers d'opinion » selon la définition donnée par les statuts d'Amnesty International, puisqu'ils ont « usé de violence ou préconisé son usage ». Malgré cela, le Rwanda a ouvert ses prisons à la Croix-Rouge, aux diplomates et aux missions parlementaires, comme jamais un pays d'Afrique ne l'a fait jusqu'ici.
À part quelques bavures ne relevant pas d'une politique délibérée du gouvernement, le Rwanda s'engage dans des procès conformes aux normes internationales reconnues. »
un document du 14 juin 1991, que M. Alain De Brouwer adressa à M. Leo Delcroix et dans laquelle il l'informait de la visite d'une délégation restreinte du MRND et lui communiquait une proposition de programme.
« Cher Leo, Rika De Backer me demande d'adresser au CVP le dossier relatif à la visite à Bruxelles du 22 au 29 juin de un ou deux ministres rwandais à l'invitation commune du groupe PPE et du CVP lui-même.
M. Munyazesa nous a fait savoir qu'il préférait venir avec une petite délégation du MRND et discuter concrètement la coopération avec le CVP et le PSC sur la base de sa lettre du 20 avril apportée par Spérancie Mutwe.
Enfin, lors de ce séjour, il y aurait intérêt à prévoir une rencontre avec les présidents Van Rompuy et Deprez et avec les présidents du Sénat et de la Chambre. »
un document interne du 1er août 1991, signé par André Louis, secrétaire général de l'IDC, et intitulé « Le Rwanda, nouvelles étapes vers la démocratie », dans lequel le MRND est présenté comme le seul parti qui puisse garantir le succès du processus de démocratisation au Rwanda :
« le MRND, ancienne formule, bénéficiait d'un financement significatif à charge de l'État. Le parti a établi son siège dans un bâtiment construit par la coopération belge, qui appartient à l'État. Il dispose aussi de certains biens, tels que véhicules, etc.
Le MRND évacuera le bâtiment d'État qu'il occupe en ce moment dès que la construction de l'immeuble que lui offre la Fondation Konrad Adenauer sera terminée. Il a été envisagé aussi que le MRND donne à l'État les biens qu'il possède ou certains de ceux-ci. Cette idée est pour le moins discutable.
C'est incontestablement le MRND qui est l'artisan et le garant du processus de démocratisation en cours au Rwanda. Le travail réalisé antérieurement par le MRND est impressionnant. Il a été sans aucun doute l'animateur de cette mobilisation de la nation qui a conduit le pays vers une forme de développement étonnante. Le Rwanda est un modèle unique de ce qu'il est possible de réaliser avec des moyens pauvres, beaucoup d'imagination, de travail et de solidarité nationale et internationale. Il faudra un jour analyser scientifiquement l'expérience rwandaise afin qu'elle puisse bénéficier à d'autres peuples.
Le MRND n'a pas démérité.
C'est donc légitimement qu'il ambitionne d'être reconduit dans sa fonction gouvernementale au terme d'un vote populaire d'autant plus clair du fait qu'il sera cette fois contradictoire.
Il convient que toutes les organisations qui, dans le passé, ont aidé le MRND dans sa difficile tâche, non seulement maintiennent leur aide et leur appui, mais de surcroît l'amplifient à la mesure des défis que le mouvement doit affronter à l'avenir.
Ceci ne signifie pas qu'il faille laisser sans aide les nouvelles forces politiques naissantes. Il serait toutefois injuste de ne pas tenir compte des mérites acquis par le MRND et des besoins accrus nés du pas décisif vers la démocratisation, qu'il a d'ailleurs franchi avec nos pressants encouragements ! »
une lettre du 17 janvier 1992 du secrétaire général de l'IDC André Louis, adressée à M. Alexis Nsabimana, délégué du MDR/Benelux. Le MDR se profilait comme membre de la démocratie chrétienne. Dans sa réponse à M. Alexis Nsabimana, le secrétaire général de l'IDC déclare qu'il ne doute aucunement de la sincérité du président Habyarimana concernant la poursuite du processus de démocratisation au Rwanda. Le président et son parti, le MRND, peuvent, dès lors, compter sur le soutien de l'IDC :
« Afin d'éviter toute interprétation quant à l'attitude de l'Internationale démocrate-chrétienne, je désire préciser que la réforme de l'État constitue à nos yeux l'objectif prioritaire pour votre pays.
Selon notre expérience, la transformation d'un régime autoritaire en un régime démocratique particulièrrement dans un pays affecté par la guerre (cfr. El Salvador, Guatemala, Philippines) doit s'effectuer de manière résolue, au terme d'un calendrier raisonnablement bref dont il convient de poursuivre l'exécution avec rigueur.
Nous n'avons au stade actuel aucune raison de douter de la loyauté du président de la République, du gouvernement ainsi que des dirigeants du MRND. Nous les appuyerons en conséquence et continuerons de les appuyer aussi longtemps qu'ils maintiendront leur ligne de conduite actuelle. Nous ne ferons rien qui puisse contrarier leur méritoire effort.
L'opposition recevra notre appui dans la mesure où elle s'engagera de manière vraiment crédible dans le processus de démocratisation en prenant de vraies responsabilités. Ce qui n'est malheureusement pas le cas jusqu'à présent.
Personne ne prétendra que tout soit parfait au Rwanda en ce moment. Que des abus de pouvoir puissent encore être commis, notamment au niveau local, cela paraît vraisemblable. Il faut bien entendu les combattre avec fermeté, sans toutefois perdre de vue que l'objectif primordial de démocratisation est en cours de réalisation. »
Le soutien au président Habyarimana et au MRND est réitéré dans un document du 8 février 1992, signé par M. André Louis et intitulé « La Démocratisation du Rwanda » :
« La détermination du président Juvénal Habyarimana à conduire la République rwandaise vers un système démocratique multi-partis constitue un élément clé permettant de considérer l'avenir avec un certain degré de confiance.
Le processus de transition a toutefois déjà duré trop longtemps.
Le MRND a poursuivi systématiquement sa réforme interne, en organisant des élections aux différents niveaux de parti (secteurs, communes). Plusieurs centaines de réunions ont déjà eu lieu. Un congrès national couronnant ce processus aura lieu prochainement.
Il est incontestablement le parti dont l'effort d'organisation interne est le plus important et le plus avancé.
Le président Habyarimana est et restera le leader effectif du MRND. Afin de rencontrer l'objection légale concernant l'incompatibilité entre la qualité de militaire et la fonction de chef de parti, le président a désigné un ministre de la défense (qui relève du Premier ministre) et un chef d'état-major général. Il reste bien entendu le chef constitutionnel de l'armée, comme le président Mitterrand ou le Roi des Belges le sont également dans leur pays.
C'est avec une certaine surprise que l'on prend connaissance d'un document publié par des prêtres du diocèse de Kabgayi, le 1er decembre 1991.
Il s'agit d'un pamphlet politique, enrobé de phraséologie pseudo-religieuse, qui attaque le gouvernement de manière partiale sur des points aussi limités que la manière dont il conduit ses consultations politiques. C'est pour le moins étrange !
La conférence épiscopale catholique du Rwanda a publié peu après un document positif et nuancé.
Il n'y a toujours pas d'alternative au MRND.
La situation des partis, par comparaison avec ce qu'elle était lors de notre précédente visite du 1er août 1991, s'est plutôt détériorée.
Le schéma optimum pour le Rwanda est celui d'une configuration du MRND dans sa fonction gouvernementale au terme d'élections parlementaires à tenir dans un délai de 4 à 5 mois, élections conduisant à une présence honorable (20 % à 35 % semblent prévisibles) de l'opposition au sein du Parlement. »
Dans une lettre du 5 mars 1992 qu'il adressait à M. Nkundabagenzi, ministre de l'information aux bons soins du directeur d'Orinfor, M. F. Nahimana, M. Alain De Brouwer fait savoir que l'IDC est intervenue au niveau des services diplomatiques belges en vue d'augmenter la pression diplomatique sur les amis du FPR (Ouganda).
« Nous avons touché les Affaires étrangères belges et la Représentation permanente de la Belgique auprès de la CEE, afin d'insister sur la nécessité urgente de réactiver les pressions diplomatiques à l'encontre de l'Ouganda qui sert de sanctuaire et de ravitaillement aux terroristes du FPR, mais aussi de poursuivre une aide humanitaire en faveur des personnes déplacées.
Nous nous permettons également de vous suggérer une campagne d'information plus complète sur les changements judiciaires intervenus au Rwanda (application des lois d'amnistie, meilleure protection des détenus et des droits de la défense, etc.) car une récente conférence de presse de maître André Jadoul, avocat au barreau de Bruxelles et envoyé au Rwanda par la Ligue des droits de l'homme (27 février 1992) s'est sans doute trop focalisée sur les tragiques massacres des Bagogwe, rendant actuels pour les médias des événements qui se sont déroulés il y plus d'un an et surtout occultant le caractère provocateur des attaques du FPR et sa stratégie machiavélique de susciter des affrontements interethniques pour déstabiliser la société rwandaise.
Encore une fois, nous vous remercions, monsieur Nahimana, pour toutes les informations envoyées. »
Dans un fax du 5 janvier 1993 envoyé à Papias Ngaboyamahina, Alain De Brouwer écrivait notamment : « Comment peut-on envisager de donner le ministère de l'Intérieur au FPR, alors qu'il faut essayer de confier les minstères sensibles dans la transition à des personnalités non partisanes et non candidates aux élections (hauts magistrats...), donnant à tous la garantie d'une gestion juste et indépendante? ».
Dans sa réponse à une lettre du 10 janvier 1993 de MM. Paulin Murayi et Georges Ruggiu dans laquelle ceux-ci faisaient part de leurs doutes à propos des accords d'Arusha, A. De Brouwer reconnaît le bien-fondé des objections qui ont été formulées à l'encontre des accords :
« Dans l'attente du texte officiel demandé à l'ambassadeur du Rwanda, nous devons bien reconnaître la justesse des observations contenues dans votre message, notamment sur le fait que la future Assemblée nationale de transition soit nommée et non élue, cela sur base de critères discriminatoires à l'égard des 11 partis non membres du gouvernement actuel, sur la composition du futur gouvernement transitoire et l'adoption de ses décisions au 2/3 des voix, et sur l'absence de procédure démocratique de ratification de ces accords adoptés sans débat au CND et sans référendum populaire.
Malgré tous les reproches et critiques sur la longue période du parti unique, le président de la République garde un rôle éminent dans la conduite du processus démocratique à bon port c'est-à-dire des élections libres et justes sous observation internationale. »
Dans une lettre du 20 janvier 1993 qu'il avait adressée à M. Mathieu Ngirumpatse, secrétaire général du MRND, M. De Brouwer réagit au contenu des accords d'Arusha III dont il qualifie certains aspects d'antidémocratiques.
« Permettez-moi de vous adresser nos voeux les plus sincères pour 1993 de la part de l'IDC : nous souhaitons ardemment que votre cher pays puisse retrouver la paix intérieure et extérieure et le développement et aboutir enfin à des élections démocratiques sans heurts.
Nous aussi à l'IDC nous sommes effarés par certains aspects antidémocratiques d'Arusha III et le manque de légitimité des futures institutions de la transition, sans parler du péril représenté par l'octroi du poste de ministre de l'intérieur à la partie attaquante.
Mais comment remettre toutes ces démarches diplomatiques dans un cadre plus acceptable pour le peuple rwandais et où l'attaquant du départ, le FPR, ne soit plus dans la situation de pouvoir départager MDR et MRND et de les enfermer dans un gouvernement de transition sans droit de veto en cas d'atteinte aux droits vitaux du pays ?
Nous souhaitons garder confidentielles ces démarches car nous pensons qu'il y a déjà eu trop d'interférences internationales malheureuses et que l'enjeu véritable n'est plus d'abord d'attendre « la vérité proclamée d'Arusha » où la stratégie de division et de prise de pouvoir du FPR domine, mais de construire un nouvel axe de réconciliation interne MRND-MDR qui, seul, peut sauver le pays et le conduire à des accords extérieurs équilibrés. »
Une résolution du 10e congrès de l'IDC du 8 février 1993, relative à la situation dramatique au Rwanda à la suite des attaques du 8 février 1993; le document est signé par André Louis ainsi que par Brian Palmer, secrétaire général adjoint de l'IDC :
« L'IDC condamne également toutes les violences intérieures et demande à l'ensemble des forces politiques et sociales du pays de s'unir pour conduire jusqu'au bout les processus de paix et de démocratisation.
Après la conclusion des accords d'Arusha, l'IDC a pris nettement et publiquement position en faveur de l'application de ceux-ci. Dans ses contacts avec les forces politiques rwandaises, elle a souligné le caractère précaire de ces accords, dont la réalisation n'était garantie par aucune autorité et dépendait entièrement de la seule bonne volonté des parties en présence, recommandant notamment de raccourcir les délais et d'avancer le processus électoral. L'IDC a réaffirmé cette position, notamment lors d'un entretien avec le FPR qui a eu lieu le 24 novembre 1993.
(...) L'IDC condamne avec horreur les tueries qui ont été perpétrées au Rwanda, quels qu'en étaient les auteurs...
L'IDC rappelle à l'armée de la République rwandaise que son devoir sacré et imprescriptible consiste à protéger indistinctement tous les citoyens rwandais quelle que soit leur ethnie. »
une note interne du 8 mars 1993 que M. Alain de Brouwer adressait à M. André Louis. Cette note fait suite aux allocutions que firent le président Habyarimana à Ruhengeri le 15 novembre 1992 et M. Léon Mugesera, vice-président du MRND, à Gisenyi, le 22 novembre 1992.
Dans une réaction à la première remarque de M. Alain De Brouwer à propos de l'allocution que fit le président Habyarimana, le 15 novembre 1992, à Ruhengeri, et, en particulier, au reproche adressé au président à propos de sa déclaration selon laquelle : « Les accords d'Arusha (375c) sont un chiffon de papier, ce n'est pas la paix » et que son ministre des Affaires étrangères « ne doit pas truquer certaines choses et dire qu'en ramenant un chiffon de papier, il ramène la paix » , M. André Louis répond :
« 1. Il faudrait pouvoir contrôler l'authenticité du document.
2. Même en se basant sur le texte disponible, il s'agit d'un discours de meeting particulièrement modéré.
L'utilisation du terme « chiffon » de papier dans la traduction française est une évidente manipulation occidentale pour discréditer le président en établissant une analogie avec le fameux terme de « chiffon de papier », par lequel Hitler qualifiait les accords de Munich.
Le président a voulu dire un « bout de papier », « un morceau de papier » et il a raison de souligner que cela ne suffit pas pour garantir la paix. »
Dans une deuxième remarque relative à l'allocution que M. Léon Mugesera fit devant les militants du MRND et dans laquelle il appelait ouvertement à l'extermination de la population tutsie, M. De Brouwer déclare à M. André Louis :
« Ce discours donne le ton de l'intolérance politique meurtrière, même s'il se situe dans un climat généralisé de violence, de provocation et d'intimidation.
Il faut y ajouter les nouvelles des Pères Blancs (5 janvier 1993) qui ont relevé les passages de ce discours incendiaire consacré au renvoi des Tutsis en Éthiopie « via la rivière Nyabarongo en voyage express ».
Je pense que l'IDC doit protester auprès du secrétaire général Ngirumpatse et demander que l'auteur de ce discours soit désavoué et sanctionné par son parti. »
Dans sa réponse du 12 mars 1993, M. André Louis excuse à nouveau cette attitude du MRND.
« 1. Il faudrait pouvoir contrôler l'authenticité du document.
2. En se basant sur le texte disponible et en faisant abstraction des outrances verbales inhérentes à ce genre de discours pour ne retenir que l'essentiel, il faut constater :
la volonté de voir déférer devant les tribunaux les traîtres à la patrie (les complices du FPR) est une exigence on ne peut plus légitime.
l'appel à la résistance et à une mobilisation bien organisée est légitime et élémentaire dans la perspective de la guerre civile de plus en plus inévitable, imposée par le FPR.
l'appel aux élections est étonnamment positif. »
(2) La période postérieure à Arusha V et antérieure aux événements du 7 avril 1994
un télex de l'ambassadeur Swinnen à Minafet (878) du 27 août 1993 :
« Internationale Démocrate Chrétienne : Alain De Brouwer, PSC, a rencontré au nom de l'IDC les partis MRND, MDR et PSD. Reproche adressé au MRND pour son action qualifiée de coup d'état civil ayant conduit à la division du MDR et à l'affaiblissement de l'opposition politique intérieure. »
un communiqué de presse du 22 octobre 1993 de M. Emilio Colombo, président de l'IDC, et de M. Bryan Palmer, secrétaire général adjoint, qui mettent en garde contre les menaces qui pèsent sur les accords de paix d'Arusha.
« L'IDC dénonce l'appui direct d'une puissance étrangère, à travers le FPR, aux putchistes et la menace que cet appui persistant fait peser sur l'application des accords de paix d'Arusha et sur le renforcement de la démocratisation au Rwanda. »
la lettre du 9 mars 1994 de M. Alain De Brouwer, à M. Georges Thuysbaert, chef de cabinet adjoint du ministre de la Défense nationale, dans laquelle il est fait référence à une lettre antérieure du représentant du MRND en Belgique. Tout blocage du processus de démocratisation est attribué au FPR ou à l'intervention personnelle de M. Faustin Twagiramungu.
« Suite à la lettre du 8 mars 1994 du président du MRND en Belgique au ministre Leo Delcroix, dont nous avons reçu copie ce jour à l'IDC, nous ne pouvons qu'appuyer l'essentiel de cette démarche.
En effet, les blocages politiques actuels sont causés essentiellement par le FPR qui a rejeté le compromis politique négocié le 27 février 1994 par l'ensemble des partis membres de la coalition gouvernementale actuelle. Le compromis permettrait de surmonter les problèmes internes de deux de ces partis : le MDR et le Parti libéral.
Deuxième source de blocage de la situation : le jeu personnel de l'ancien président du MDR Faustin Twagiramungu qui s'est autoproclamé candidat Premier ministre et qui a été exclu de la présidence de son parti par un congrès extraordinaire en juillet dernier. M. Twagiramungu prétend, malgré un compromis négocié avec l'appui des églises, désigner lui-même les ministres et les députés MDR, sans respecter les décisions du Congrès et des organes directeurs de ce parti populaire.
M. Faustin Twagiramungu s'est toujours vu reprocher sa politique d'alliance étroite avec le FPR, au mépris de l'opinion dominante au sein de ce parti.
Mme Agathe Uwilingiyimana, Premier ministre actuel et alliée de M. Twagiramungu, a la lourde responsabilité de la paralysie du gouvernement actuel.
Si la Belgique a eu raison de se montrer stricte en matière de respect des droits de l'homme, nous devons bien constater qu'elle a eu plus de succès auprès des dirigeants du MRND qui ont dû accepter de mettre fin à certaines pratiques douteuses, qu'auprès du FPR qui continue à développer une stratégie de prise de pouvoir au mépris de ces droits et libertés. »
(3) La période de l'attentat contre l'avion présidentiel
un communiqué de presse du 7-8 avril 1994 de l'IDC, signé par Bryan Palmer, secrétaire général adjoint de l'IDC, et André Louis, vice-président, qui condamne le meurtre des présidents du Burundi et du Rwanda. Dans ce communiqué de presse, l'IDC rappelle « qu'elle a contribué activement au processus de démocratisation dans les deux pays ».
(4) La période qui a suivi le génocide
Le point de vue officiel de l'IDC, exposé dans un communiqué du 4 mai 1994, est le suivant :
« L'IDC s'est efforcée depuis 1989 d'accompagner le processus de démocratisation au Rwanda.
Depuis 1991, en particulier, après la modification, le 10 juin, de la Constitution rwandaise dans le sens du multipartisme et la promulgation, le 18 juin, de la loi sur les partis politiques, elle a maintenu un contact constant avec indistinctement toutes les forces politiques rwandaises.
Dès ce moment, l'IDC a recommandé avec grande insistance tant au président de la république qu'au MRND et aux partis d'opposition, l'adoption rapide d'une loi électorale et l'organisation d'élections dans un délai raisonnablement bref, attirant en outre l'attention sur le danger qu'une excessive prolongation des délais ferait courir au processus de démocratisation lui-même.
L'IDC déplore que ses conseils répétés n'aient pas été suivis par les intéressés.
Dès l'ouverture des négociations d'Arusha en 1992, l'IDC a attiré l'attention de toutes les parties sur les dangers inhérents à la prolongation des délais et à l'établissement de systèmes transitoires par définition non-démocratiques pour une durée trop longue.
Après la conclusion des accords d'Arusha, l'IDC a pris nettement et publiquement position en faveur de l'application de ceux-ci.
Dans ses contacts avec les forces politiques rwandaises, elle a souligné le caractère précaire de ces accords, dont la réalisation n'était garantie par aucune autorité et dépendait entièrement de la seule bonne volonté des parties en présence, recommandant notamment de raccourcir les délais et d'avancer le processus électoral.
L'IDC a réafirmé cette position, notamment lors d'un entretien avec le FPR qui a eu lieu le 24 novembre 1993.
Dès le 7 avril 1994, l'IDC a condamné avec indignition et tristesse le lâche assassinat des présidents du Rwanda et du Burundi et lance « un appel au calme afin que les forces politiques en présence évitent de recourir à la violence et tout au contraire se concertent pour la remise en route des processus en cours ».
Malgré que le FPR ait proclamé la caducité des accords d'Arusha le 9 avril 1994, dans un communiqué officiel lu par le commandant Kagame à Radio Muhabura, l'IDC a continué à insister en vue d'une solution politique du drame rwandais. Cette position n'a pas changé.
L'IDC condamne avec horreur les tueries qui ont été perpétrées au Rwanda, quels qu'en aient été les auteurs, et lance un appel pressant en faveur du respect des droits de l'homme et de la protection des organisations qui en prennent la défense.
L'IDC rappelle à l'armée de la république rwandaise que son devoir sacré et imprescriptible consiste à protéger indistinctement tous les citoyens rwandais, quelle que soit leur ethnie.
L'IDC demande aux armées en présence de respecter les règles de la Convention de Genève sur le droit de la guerre et condamne sans réserve l'annonce officielle par le commandant du FPR, Paul Kagame, de l'exécution de prisonniers de guerre. »
La commission constate cependant que l'IDC, ou, en tout cas, MM. Louis et De Brouwer, ont également maintenu leurs contacts avec certains milieux rwandais et plus particulièrement avec le gouvernement intérimaire Kambanda, extrémiste hutu, après les événements dramatiques du 7 avril 1994 et le génocide. La commission constate également que l'IDC poursuit en Belgique aussi son oeuvre de lobbying à l'égard des partis gouvernementaux.
un document projet de communiqué de presse du 5 mai 1994 intitulé « Simple exercice de style » envoyé par le fax de l'IDC (ID : PPE IDC). Selon Eugène Nahimana, responsable de presse du MRND en Belgique, ce texte a été écrit après une concertation avec un conseiller politique de l'IDC.
1. « Le gouvernement de la République fait observer qu'à aucun moment il n'a fait sienne la thèse selon laquelle l'avion du président Habyarimana aurait été abattu par des Casques bleus belges. »
2. « Si des déclarations en ce sens devaient avoir été faites par des fonctionnaires rwandais, le gouvernement de la République rwandaise se devrait de présenter sans hésiter ses excuses au gouvernement belge. »
Variante
2bis « Des déclarations en ce sens ayant été faites par des fonctionnaires rwandais, le gouvernement de la République rwandaise souligne que celles-ci ne reflètent pas le point de vue officiel et en conséquence présente sans hésiter ses excuses au gouvernement belge. »
une lettre du 30 mai 1994 d'André Louis adressée à Léon Saur et Paul Willems, secrétaires internationaux respectivement du PSC et du CVP, qui met en cause la politique du ministre des Affaires étrangères Willy Claes.
« Je me pose de plus en plus de questions concernant la politique étrangère de Willy Claes.
Rwanda : À la Commission des Affaires étangères de la Chambre, Willy Claes continue à se référer aux accords d'Arusha dont le FPR a proclamé la caducité le 9 avril 1994 ! Il faudrait savoir.
Si un jour il devait y avoir une solution politique ce qu'il faut souhaiter ce sera sur base d'un nouvel accord, sûrement pas en fonction de ceux d'Arusha.
Où en est le temps où la Belgique avait une politique étrangère qui marquait le monde ? »
un document interne du 31 mai 1994 de la main d'Alain De Brouwer, intitulé « La Politique rwandaise de la Belgique » dans lequel l'auteur formule des observations critiques concernant l'attitude du Gouvernement belge à l'égard du FPR.
« La Belgique donne de plus en plus l'impression de choisir le FPR, sans qu'il y ait eu concertation au sein du gouvernement.
Le ministre Claes devait sans aucun doute réagir aux accusations non fondées portées contre la Belgique par l'ambassadeur du Rwanda à Kinshasa et exiger les rectificatifs nécessaires, alors que notre gouvernement comme celui du Rwanda exigeait une enquête internationale neutre sur les responsabilités dans l'attentat du 6.04.94. Mais fallait-il pour autant humilier ce gouvernement intérimaire en le qualifiant d'autoproclamé, en lui déniant toute liberté de manoeuvre par rapport aux militaires et en empêchant tout contact officiel à aucun niveau (même par le biais humanitaire) ?
La Belgique n'a-t-elle pas ainsi encouragé le FPR à s'en tenir à la logique de la guerre et à repousser les appels au dialogue et à la relance du processus de paix lancés par le ministre des Affaires étrangères Jérôme Bigamumpaka ? »
une lettre du 10 juin 1994 d'Alain De Brouwer à Johan Van Hecke, président du CVP, et Gérard Deprez, président du PSC, dont l'objet est « Rwanda et demande d'audience de l'ambassadeur M. François Ngrarukiyintwuali ». Dans cette lettre, De Brouwer demande que les démocrates-chrétiens fassent entendre au sein du Gouvernement belge d'autres voix que celles qui attendent un coup d'État du FPR.
« J'ai adressé le 6 avril 94 aux responsables internationaux du CVP et du PSC une note et une analyse de la politique rwandaise de la Belgique : je vous la soumets en annexe en prévision de la visite de l'ambassadeur du Rwanda. »
Celui-ci connaît nos critiques sur les pratiques de certains milieux de l'ancien parti unique et nos positions claires et nettes sur les massacres perpétrés par les milices et la garde présidentielle et sur les odieuses répressions ethniques.
Mais n'est-il pas temps que la démocratie chrétienne au sein du Gouvernement belge fasse entendre, dans l'esprit de l'interpellation du 27 mai 1994 de M. Van Peel, d'autres voix que celles qui attendent la prise de pouvoir par le FPR, un mouvement ayant depuis près de 4 ans prôné la violence et engagé la société rwandaise dans la militarisation totale et dans les divisions fatales ?
On peut même se demander si la politique de la diplomatie belge d'isolement strict du gouvernement intérimaire (1) n'a pas encouragé le noyau militaire du FPR (qui avait dénoncé Arusha dès le 9 avril 94) à rejeter toute négociation avec la partie gouvernementale pour la reprise des accords de paix, et donc à poursuivre la guerre jusqu'à la victoire totale. C'est ce qui a permis le prolongement des premiers massacres des milices et leur extension à l'ensemble du pays.
[(1) Cette politique d'isolement est telle que le ministre Claes a fait rayer du personnel diplomatique accrédité à Kigali le représentant du ministre Lebrun, M. Jean Ghiste, pour avoir participé à une mission strictement humanitaire dans la zone gouvernementale !]
Enfin, il est difficile de passer sous silence le rôle de la démocratie chrétienne dans l'histoire de ce pays ami : tout comme l' Église, elle a appuyé la révolution sociale de 1959. »
une lettre du 1er septembre 1994 de M. André Louis à M. Gérard Deprez, président du PSC, dans laquelle le principe du « partage du pouvoir » consacré par les accords d'Arusha est une fois de plus décrié.
« Je découvre le communiqué sur le Rwanda, daté du 23 avril 1994, publié par notre ministre des Affaires étrangères.
Ce communiqué révèle que notre diplomatie n'a toujours pas tiré les leçons du sanglant échec de la politique de « partage du pouvoir » inhérent aux tristes accords d'Arusha. »
un rapport du 2 novembre 1994 de M. Alain De Brouwer adressé au Comité de gestion de l'IDC, contenant un rapport succinct concernant la rencontre de Bukavu sur le thème crucial du retour des réfugiés rwandais, 23-28 octobre 94. Cette rencontre de Bukavu, qui s'est déroulée du 23 au 28 octobre 1994, fut une initiative du comité rwandais d'actions pour la démocratie, en collaboration avec l'ONG ACT et avec le soutien du PPE. Faisaient, entre autres, partie de la délégation européenne, Mme Rika De Backer, le sénateur Jan Van Erps, le père Serge Desouter, le parlementaire européen Bernard Stasi en Alain De Brouwer. Au cours de cette mission, les membres de la délégation ont notamment rencontré Jean Kambanda, Premier ministre du gouvernement de transition et cité à comparaître par le tribunal d'Arusha, et Jérôme Bicamumpaka, ministre des Affaires étrangères de ce même gouvernement de transition. Selon Alain De Brouwer, la délégation a été présidée par le ministre néerlandais de la Coopération au développement Pronk.
Dans son rapport, M. De Brouwer écrit que ces deux personnes lui ont laissé « une impression de grande ouverture que l'on retrouve aussi dans le mémorandum du 14 octobre 94 ci-annexé ». Selon Alain De Brouwer, ces deux hommes reconnaissent « les faits très négatifs de la campagne antibelge qui s'est développée à Kigali et aussi le caractère excessif de certaines accusations à l'encontre du Gouvernement belge ». « Jean Kambanda a adressé une lettre d'excuses à propos de ces accusations injustes au Premier ministre belge en juillet dernier mais trop tard. »
Dans ses « Premières conclusions », M. De Brouwer écrit que « la rencontre de Bukavu a démontré qu'il existait dans les camps des groupes raisonnables prêts au dialogue et que même l'ancien gouvernement intérimaire avait fait son autocritique et avait pu se restructurer sur des bases nouvelles : voir en annexe le mémorandum du 14 octobre 94 et la composition de l'équipe ministérielle de Jean Kambanda, rajeunie et réduite à huit portefeuilles ».
D'après Léon Saur, ancien secrétaire international du PSC, entendu à sa propre demande par la commission le 30 mai 1997, il y avait des liens privilégiés entre l'IDC, le CVP et le MRND. Léon Saur a déclaré que la collaboration avec le régime était basée sur des contacts réciproques, l'IDC jouant le rôle d'organe de liaison. Léon Saur a, en outre, souligné que le PSC se démarquait de l'IDC, du moins en ce qui concerne le Rwanda, par son soutien aux accords d'Arusha ainsi que par le fait que, le 8 avril 1994, tout contact avec les représentants du MRND-Belgique ainsi qu'avec des représentants du pouvoir intérimaire ont été rompus. « Dès le mois de janvier 1991, nous avons été approchés, par l'intermédiaire de l'Internationale démocrate-chrétienne, par le MRND qui souhaitait développer des liens avec les partis sociaux-chrétiens belges, néerlandophones et francophones, et être aidé à transformer, lui-même, le pays au printemps 1991 » (376c).
Lorsqu'on lui demanda si l'IDC avait l'intention d'influencer la politique belge à l'égard du Rwanda, Léon Saur l'a confirmé en répondant : « Ce dont je suis sûr en tout cas, c'est que fort probablement l'Internationale démocrate-chrétienne a voulu exercer un rôle d'influence. Dans quelle mesure a-t-elle eu une influence, cela c'est un autre débat. Ce dont je suis certain en tout cas, c'est que ce n'était pas l'Internationale démocrate-chrétienne qui faisait la politique belge, ni la politique du Gouvernement belge. Cela, c'est très clair. De manière assez évidente, dans le cas qui nous occupe, autant manifestement le secrétaire général de l'Internationale démocrate-chrétienne était réticent au contenu des accords d'Arusha, autant la diplomatie belge s'est engagée en faveur de ces accords. Or, que je sache, les diplomates belges agissent sur ordre du Gouvernement belge, dans le mandat que leur donne le Gouvernement belge. Dans le cas qui nous occupe, il est clair qu'il y a probablement et même sûrement eu volonté de rôle d'influence auprès du Gouvernement belge, mais manifestement cela n'a pas porté de fruits » (377c).
Léon Saur confirme, en outre, qu'après le 7 avril 1994, l'IDC a établi des contacts avec le gouvernement intérimaire et a également tenté d'obtenir le soutien du PSC à cet effet. « Il est certain que l'Internationale démocrate chrétienne, plus précisément Alain De Brouwer, essayait désespérément de convaincre les interlocuteurs belges moi en tout cas d'avoir des contacts avec le gouvernement intérimaire, et ce dans la logique que j'expliquais tout à l'heure, à savoir qu'il pensait que si le gouvernement intérimaire perdait la guerre, le FPR allait s'emparer du pouvoir. Oui, il y avait des contacts entre l'Internationale démocrate chrétienne, Alain De Brouwer, et le gouvernement intérimaire » (378c) et M. Saur d'ajouter : « (...) il était clair que le MRND, pour l'essentiel, et en tout cas sa section belge, était manifestement compromis dans le génocide » (379c).
La commission a en outre constaté que l'annuaire 1995 de l'IDC mentionne, sous la rubrique « Rwanda », le « Mouvement Républicain National pour la Démocratie et le Développement » avec la mention (invité-invitado-invited). M. Mathieu Ngirumpatse en est le secrétaire général.
Le 16 juin 1995, Léon Saur a adressé une lettre au secrétaire général de l'IDC :
« ... j'ai été très surpris de constater en parcourant l'Annuaire 1995 de l'Internationale (p. 61), distribué à l'occasion du Congrès, que le MRNDD était répertorié comme parti rwandais invité à l'IDC.
D'une part, factuellement, il m'étonnerait que l'adresse mentionnée soit encore d'actualité. Beaucoup plus grave, sinon le MRNDD en tant que tel, en tout cas nombre de ses dirigeants, sont fortement soupçonnés d'avoir joué un rôle actif dans la préparation et la conduite du génocide d'avril 1994. Certains d'entre eux sont même expressément accusés d'avoir en ces jours dramatiques appelé au meurtre.
Plus précisément, Mathieu Ngirumpatse, en qualité de président du MRNDD, a cosigné l'accord politique instituant ce gouvernement intérimaire (constitué après l'assassinat des présidents Habyarimana et Ntariamira) qui n'a pas su ou voulu empêcher le génocide. De même, ce gouvernement n'a jamais clairement dénoncé le génocide, pas plus qu'il n'a exprimé de regrets, de remords ou de repentir.
À ces titres, Mathieu Ngirumpatse aura fort probablement tôt ou tard des comptes à rendre devant la justice internationale.
Par ailleurs, s'il est tout à fait exact que le MRNDD était, avant les événements, un parti « invité » au sens où il avait posé sa candidature à l'IDC et a été invité à ce titre au XIe congrès de mars 1993, il est tout aussi vrai qu'il n'est pas le seul parti rwandais dans le cas : le MRD avait également déposé une demande d'adhésion et a également été invité au Xe congrès.
J'aimerais donc connaître les raisons pour lesquelles il a été décidé :
(soit) de maintenir le MRNDD dans l'annuaire de l'IDC
(soit) de ne pas y insérer le MDR
de maintenir des contacts avec le MRNDD et/ ou Mathieu Ngirumpatse plus généralement; je pense qu'il est temps que l'IDC, maintenant remise sur les rails, réexamine sa politique rwandaise à la lumière de sa résolution du Xe Congrès sur le Rwanda et définisse une ligne de conduite claire et non « ambiguë », c'est-à-dire entre autres non brouillée par le maintien de certaines relations avec certaines personnes dont le rôle avant, pendant et après le génocide ont été (et sont encore parfois) fortement douteux.
En effet, tant l'éthique que le souci d'une lutte efficace contre les dérives et les excès de plus en plus évidents des actuelles autorités de Kigali nécessitent que l'ensemble des démocrates-chrétiens mondiaux soit irréprochable dans sa politique rwandaise et donc se distancie clairement et définitivement de tous ceux qui, de près ou de loin, peuvent à bon droit être soupçonnés d'avoir trempé dans le génocide. »
La commission constate que l'IDC a été très active dans le dossier rwandais et que ses interventions visaient à influencer, d'une part, les autorités belges, à la fois directement et à travers le CVP et le PSC entre autres par l'intermédiaire d'André Louis qui était, en tant que responsable de l'IDC, invité aux réunions du comité directeur et, d'autre part, les autorités ou les partis rwandais, comme en témoignent les nombreuses démarches de l'IDC dans ce sens.
La commission constate que l'IDC ou à tout le moins MM. Louis et De Brouwer a continué à avoir des contacts avec le pouvoir rwandais. Cette confiance se manifeste après le génocide dans le soutien donné au « gouvernement intérimaire » en la personne de Jean Kambanda, le Premier ministre de ce gouvernement, et de Mathieu Ngirumpatse, le secrétaire général du MNRD. Sur la base des documents et témoignages, l'attitude de l'IDC peut être résumée comme suit :
Avant les accords d'Arusha V : opposition au principe du partage du pouvoir, instauration d'un système multipartite, organisation, à terme, d'élections libres (380c).
À partir de la signature des accords d'Arusha, l'IDC souhaitait voir exécuter les accords intégralement, en insistant plus particulièrement sur l'organisation d'élections dans les plus brefs délais.
Méfiance très marquée envers la doctrine et les méthodes (« marxistes ») du FPR.
Relations amicales avec les partis MRND et MDR à partir du moment où ceux-ci s'engagent dans la voie du multipartisme et de la démocratisation. Aussi longtemps que les élections libres n'auront pas été organisées au Rwanda, ces partis obtiennent le statut d'invités et ne peuvent devenir membres de l'IDC.
Condamnation le 4 mai 1994 des massacres massifs.
Soutien au « gouvernement de transition » de M. Kambanda.
La commission constate que l'IDC n'est pas parvenue à modifier fondamentalement la position que le Gouvernement belge et les partis politiques belges affiliés à l'IDC (CVP, PSC) avaient adoptée au sujet des accords d'Arusha.
Ce constat s'impose de manière moins nette pour ce qui est de l'influence qu'a eue la position de l'IDC sur les milieux politiques rwandais, c'est-à-dire tant sur les partisans des accords d'Arusha que sur ceux qui y étaient opposés et qui ont ainsi été encouragés dans leur refus.
Quoi qu'il en soit, selon les termes de M. André Louis, cette influence aurait été limitée. Au cours de son audition devant la commission, il a déclaré qu'il avait fait de nombreuses recommandations au président Habyarimana au sujet de la situation au Rwanda. Aucune n'aurait été suivie par celui-ci.
Sur la base des divers témoignages et des nombreux documents dont elle dispose, la commission constate que l'IDC a, pendant des années, fait pression tant sur le Gouvernement belge afin d'influencer la politique belge à l'égard du Rwanda, d'ailleurs sans résultat, que sur les autorités politiques au Rwanda. La commission a en outre constaté que pendant et après le génocide, l'IDC apporte son appui au gouvernement intérimaire de Kambanda. Il faut se demander si, dans son appréciation de la situation politique et sociale au Rwanda, l'IDC a accordé suffisamment d'importance au rapport qui dénonçait les violations des droits de l'homme au Rwanda.
Mme De Backer a été entendue par la commission le 14 mai 1997 à propos de ses points de vue concernant le Rwanda et les contacts qu'elle entretenait en Belgique : « ... met betrekking tot de eerste vraag over de parallelle diplomatie moet men eerst een definitie geven over « parallelle diplomatie ». Ondanks het feit dat ik niets onwettig en denigrerend zie in deze term waarin ik trouwens op dezelfde lijn zit als de huidige staatssecretaris voor ontwikkelingssamenwerking heb ik niet de indruk dat ik aan parallelle diplomatie heb gedaan. Ik was van 1984 tot 1989 lid van het Europees Parlement en ik werd daar woordvoerder coördinator zoals men dat noemt voor de fractie van de commissie ontwikkelingssamenwerking en van het paritair comité ACPCE, African Caribian Pacific Comittee EU. Tijdens deze periode heb ik de kans gehad om ongeveer alle subsaharische landen te bezoeken en er missies te begeleiden of voor te zitten naar bepaalde projecten van de Europese Unie en om de politieke toestand daar te bekijken. Dit heeft mij de kans gegeven om te praten met ongeveer iedereen, met de landbouwers uit de heuvels, met de ambtenaren, met de handelaars uit de steden, de afgevaardigden van de Europese Unie en de ambtenaren aldaar. Ook had ik gesprekken met de verschillende autochtone politici van die verschillende landen, zowel met de ambtenaren, burgemeesters en prefecten als met de ministers en presidenten. Ik had tevens de gelegenheid te praten met de ambassadeurs en de verantwoordelijken voor ontwikkelingssamenwerking in die verschillende landen. Dat gaf me dan weer de mogelijkheid andere mensen van de civiele gemeenschap te benaderen omdat zij goed wisten wie iets belangrijks kon zeggen. Terug in België heb ik de verschillende ministeries die daarin geïnteresseerd waren ingelicht over mijn ervaringen in de verschillende landen. Dat was zowel Buitenlandse Zaken als Ontwikkelingssamenwerking en Landsverdediging. Omdat ik in verschillende landen kwam waar de situatie erg moeilijk was dat was niet alleen Rwanda en Burundi maar dat was bijvoorbeeld ook Madagascar en een aantal andere landen nam ik vóór mijn vertrek naar die landen contact op met de kabinetten van Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking en Landsverdediging. Ik bezocht deze landen dus als lid van het Europees Parlement en dit gebeurde in overeenstemming en na overleg met vooral Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking. Men kan zich natuurlijk afvragen waarom ik deze landen nog bezocht nadat ik het Europees Parlement had verlaten. Ik was namelijk adviseur van de Afrika-stichting en in die hoedanigheid werd ik vaak op pad gestuurd, wanneer het voor de Europese Parlementsleden wegens andere verplichtingen niet mogelijk was om deze vrij langdurige missies te ondernemen. »
En ce qui concerne son point de vue sur le fond, Mme De Backer a déclaré :
« Ik vond de akkoorden van Arusha een goede poging om ondanks alles de vrede te herstellen, maar ik heb ze tegelijk altijd zeer moeilijk uitvoerbaar geacht. Dat is achteraf trouwens ook gebleken. Ik stond met deze mening trouwens niet alleen, ook ministers vonden de akkoorden moeilijk uitvoerbaar. Eenmaal ze getekend waren, heb ik mijn uiterste best gedaan samen met minister Claes, minister Derycke en met minister Delcroix om de hinderpalen bij het installeren van de overgangsinstellingen op te lossen. Wij waren daarin bijna helemaal geslaagd op het ogenblik dat de president werd vermoord.
Om terug te komen op mijn onderhoud met de heer Jaenen : het langste onderhoud dat ik ooit met hem heb gehad was toen er pogingen werden ondernomen om ten minste bepaalde verkiezingen te organiseren na de grondwetsherziening en de invoering van het pluripartisme. Of die verkiezingen op het gemeentelijk niveau dan wel presidentsverkiezingen moesten zijn, daar hadden wij het nog niet over. Het belangrijkste leek ons dat er verkiezingen plaatsvonden. Het is trouwens nog altijd mijn mening dat het zelfs in een land in oorlog beter was verkiezingen te organiseren.
Sommigen, zoals de heer Jaenen, vonden dat geen goede uitweg, omdat dit een overwinning voor het MRND zou bezorgen. Persoonlijk was ik ervan overtuigd dat niet de MRND, maar de NDR de verkiezingen zou hebben gewonnen.
Achteraf bleek ook dit een onjuiste inschatting. Ondanks de vele plannen voor verkiezingen en voor het installeren van de democratie die we hadden uitgewerkt ik begrijp best dat wij daarin niet werden gevolgd, wie zijn wij per slot van rekening is daar niets van in huis gekomen. Dat was alleszins een van de belangrijkste items die ik met de heer Jaenen heb besproken (...). » (381c)
En ce qui concerne l'opinion selon laquelle la Belgique aurait excessivement pris parti pour le FPR, Mme De Backer a déclaré :
« Voor de Arusha-akkoorden was dit zeker niet het geval. Toen stelden Belgische regering en de Belgische ambassade zich veel meer neutraal op. Dat is heel duidelijk. Tijdens de Arusha-besprekingen wist het RPF zeer goed dat het in een democratisch regime met democratisch spelregels nooit aan de bak zou komen. Daarom wilde het bepaalde waarborgen, wat best te begrijpen valt. Zij dreven hun waarborgen echter altijd maar op, zodat men uiteindelijk gekomen is tot een bijna fifty-fifty-verhouding RPF-gezinden en presidentsgezinden, « mouvance présidentielle et mouvance FPR ». Dat heeft precies de uitvoering van de akkoorden onmogelijk gemaakt. Men kan moeilijk 15% van de bevolking de helft of liefst meer dan de helft van de macht toekennen. Dat was mijn kritiek. Toen de akkoorden echter eenmaal getekend waren, heb ik ze ten volle verdedigd en alles gedaan om ze ten uitvoer te laten brengen» (382c).
M. Jaenen a déclaré devant la commission que « Selon Mme De Backer notre politique favorisait trop le FPR. (...) C'était ce qu'elle pensait de l'ensemble de la politique belge au Rwanda » (383c).
M. Léon Saur a déclaré : « ... Il y avait sûrement une volonté de faire passer les idées du MRND en Belgique et de conseiller celui-ci. L'IDC s'y est attachée et, plus spécialement, André Louis et Rika De Backer. (...) Au moins jusqu'au mois d'octobre 1994 » (384c).
Dans son télex nº 107 du 7 février 1994 adressé au ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Swinnen écrit : « Mevrouw De Backer wil vermijden dat de MRND en de president het programma (van het bezoek van Wilfried Martens) ingrijpend bepalen en omkaderen. Daarom wordt liefst niet ingegaan op het eventueel aanbod van présidence of partij om vervoermiddel permanent ter beschikking te stellen. Voor het leggen van contacten met andere politieke gesprekspartners wordt beroep op de ambassade gedaan (...). Het bezoek van ex-premier Martens gaat uw bezoek met nog geen tien dagen vooraf. Zonder afbreuk te willen doen aan het eigen doch ondergeschikte karakter van het eerste bezoek, dienen tegenstrijdige signalen vermeden te worden, daarbij rekening houdend met de uiterst delicate en kritieke toestand waarin het land zich bevindt en met de exploitatie van de Belgische factor door sommige Rwandese partijen. Daarom lijkt het mij aangewezen dat de heer Martens met u of uw kabinet/administratie een voorafgaand gesprek voert betreffende zowel inhoudelijke als praktische aspecten. Mevrouw De Backer deelt mijn mening en zal de heer Martens in die zin per telefoon adviseren. »
Mme De Backer a été invitée à donner des précisions en ce qui concerne la conversation téléphonique qu'elle a eue avec Eugène Nahimana en préparation de la visite de Leo Delcroix au Rwanda, conversation qui a été reproduite dans le fax ainsi que dans le brouillon de celui-ci « destination MRND Kigali- copie pour information Presirep-confidentiel ». Mme De Backer a elle-même déclaré à cet égard : « Op een bepaald moment word ik opgebeld door een Rwandees student in Brussel. Die zegde : « Het is de gewoonte als iemand de president bezoekt, dat de president weet met wie hij te maken heeft. Kunt u daar enkele details over geven ? » Ik heb daar niet veel over kunnen geven. Hij vroeg ook of er zaken waren die benadrukt moesten worden. Het voornaamste dat ik gezegd heb en dat staat niet in de fax is « verspil uw tijd niet aan bepaalde details die de ronde doen over het minder goede gedrag van de Belgische Blauwhelmen. Ten eerste omdat minister Delcroix dat weet en ten tweede omdat hij zijn voorzorgen heeft genomen en de mensen die daarbij betrokken waren terug naar België zijn gegaan. » Ik zei verder dat hij dat kon zeggen, maar daar niet de nadruk hoefde op te leggen om zo geen heel slecht beeld op te hangen van de Belgische Blauwhelmen. Wat volgens mij wel moest gezegd worden, was dat er een grote wrevel bestaat vanwege de Rwandezen omdat bij het vervoeren van de FPR-soldaten van Malindi naar het Parlement, die vergezeld waren door Belgische Blauwhelmen er volgens hen er veel meer zijn meegekomen dan volgens de akkoorden van Arusha mocht. In plaats van de afgesproken 600 zijn er veel anderen meegeglipt, beweert men. Dit heeft bij de Rwandezen veel kwaadheid teweeggebracht. Ik heb gepleit om de gesprekken in positieve zin te voeren om daaraan iets te kunnen doen. Men heeft mij dan gevraagd : « Wie gaat er mee in de delegatie van minister Delcroix? » In alle eerlijkheid, ik wist niets over de samenstelling en ik heb hem dat ook gezegd. Ik heb gezegd : « Dat heeft geen belang, want men moet alle parlementsleden en alle journalisten op dezelfde manier behandelen. » Er werden enkele vragen gesteld over de partijen waartoe sommigen behoorden. Zij hadden een lijst, ik niet. Die opdeling in categorieën heb ik zeker niet gemaakt. Ik heb ook niet gezegd die is zo en die is zo. Dat moet worden toegeschreven aan de speurdersmogelijkheden van degene die mij telefoneerde, dus niet degene die de fax stuurde, maar daar ben ik pas later achtergekomen. Murayi heeft de fax verstuurd, maar niet getelefoneerd. Het enige wat er geweest is, is een telefoongesprek, maar ik heb daarin geen appreciaties gegeven van de mensen. Trouwens wie mijn opvattingen kent, ziet als hij de lijst bekijkt, dat de aanwijzingen niet overeenstemmen met mijn opvattingen » (385c). En ce qui concerne l'origine de ces documents, ils portent tous deux la signature de M. Paulin Murayi, « pour la section MRND Belgique ». M. Murayi nie cependant formellement être concerné en quoi que ce soit par ce fax. La commission constate qu'il ressort peut-être de la comparaison des signatures que le fax n'a pas été signé par M. Murayi, mais bien par Eugène Nahimana.
Dans le fax adressé au MRND, dont une copie a été transmise au président Habyarimana, figurent non seulement une liste d'appréciation individualisée et détaillée des parlementaires et journalistes qui font le voyage avec le ministre (favorables, non favorables, ami de Mme De Backer, etc.), mais aussi un appel à cacher au ministre l'attitude antibelge existante que certains membres du MRND adoptaient à l'égard des militaires belges qui se trouvaient au Rwanda.
« Avons contacté Mme De Backer pour de plus amples renseignements sur la délégation qui accompagne le ministre Delcroix. Après un long entretien avec Mme De Backer, il convient :
(1) d'encadrer au plus haut niveau si possible M. Delcroix récemment nommé au Ministère de la Défense et ancien secrétaire général du parti social-chrétien flamand, le CVP, proche et favorable au MRND. D'après Mme De Backer, M. Delcroix se bat au gouvernement pour que celui-ci continue à aider le Rwanda.
(2) d'éviter de lui montrer durant son séjour le mépris et la méfiance de certains de nos militants (MRND) envers les Casques bleus belges. Le ministre n'appréciera pas qu'on puisse dire du mal des militaires belges. Il est très conscient qu'il y a eu des dérapages et que certains militaires belges de jeune âge peuvent être entraînés à de mauvais comportements mais, de grâce, Mme De Backer nous conseille de ne pas insister sur ces comportements des Casques bleus belges. Elle aimerait que ce soit les autres instances comme la présidence, le Minadef qui y fassent allusion mais sans trop manifester qu'on est totalement contre les militaires belges. »
Eu égard à la longueur du fax et aux informations précises qu'il contient, la commission constate que ce message peut difficilement être la reproduction d'une conversation téléphonique qui n'aurait duré que « quelques minutes » d'après Mme De Backer, « de trois à quatre minutes » d'après M. E. Nahimana. Cependant, Eugène Nahimana a déclaré devant la commission que le contenu du fax ne correspond en aucun cas avec la conversation qu'il a eue avec Mme De Backer.
La commission a également entendu d'autres personnes dont les activités peuvent être classées sous la dénomination « diplomatie parallèle ». La commission a également constaté que ces personnes ont été chargées, par le Rwanda et par les autorités rwandaises, de défendre certains intérêts en Belgique.
L'avocat Johan Scheers, qui s'est présenté comme étant le conseiller juridique du président Habyarimana, a été interrogé le 24 juin 1997 par la commission au sujet de son rôle exact, qui semble aller au-delà de la fonction de conseiller juridique du président.
Il ressort du témoignage de M. Johan Scheers et des documents que celui-ci a transmis à la commission qu'il plaidait notamment auprès des partis démocrates-chrétiens, auprès du sénateur Willy Kuypers, dans les divers cabinets et départements ministériels ainsi qu'auprès de l'ambassade à Kigali et de l'état-major de l'armée à Bruxelles en faveur de la position adoptée par Habyarimana et de la politique qu'il menait. De plus, comme le Roi Albert venait de succéder à son frère le Roi Baudouin, M. Scheers prétend qu'il devait veiller à rétablir pour le président Habyarimana les contacts avec la Cour.
Dans une lettre du 22 décembre 1993, adressée au président Habyarimana, M. Scheers s'engage à obtenir la réhabilitation du président ou, comme il l'a déclaré lui-même à la commission : « Het ging erom het imago van de president op te poetsen, hem vrij te pleiten » (386c).
« Une autre suggestion est de former en Belgique un groupe composé de personnes aptes à vous soutenir, tenant compte du fait qu'elles ont connu le Rwanda avant octobre 1990, et les multiples efforts que vous avez fournis pour contribuer à son épanouissement.
Il serait également utile d'étendre cette initiative aux politiciens belges se trouvant dans les mêmes conditions. Je pense au CVP, et plus particulièrement à M. Wilfried Martens et M. Leo Tindemans. Ce dernier a eu l'occasion de rédiger un rapport lors de la guerre de 1990, qui n'avait certainement pas une portée critique telle que celle que l'on retrouve dans les derniers rapports.
Je pense, par ailleurs, également à l'Union des démocrates chrétiens, et à l'Église catholique.
Voilà les quelques suggestions que je désirais vous proposer, après une première approche des problèmes qui vous préoccupent fortement.
Depuis mon retour en Belgique, comme déjà annoncé dans mon courrier du 21 décembre, j'ai contacté Sa Majesté le Roi Albert II, le cabinet du Premier ministre, le cabinet du ministre de la Défense nationale, le cabinet du ministre des Affaires étrangères et le cabinet du ministre de la Coopération.
J'ai également pris contact directement avec M. Wilfried Martens, ancien Premier ministre de la Belgique.
Je ne manquerai pas de vous tenir informé scrupuleusement de l'évolution de ces pourparlers.
Je vous confirme également, sans pouvoir vous mentionner la source par voie écrite, que votre réhabilitation pourrait se faire rapidement, si vous aviez l'occasion de lancer personnellement, ou, par l'intermédiaire d'une personne compétente, un message public, précisant que vous êtes au courant de certains abus qui ont été commis depuis la guerre, et que, dès maintenant, vous veillerez à ce que le renouvellement de pareils actes soit poursuivi et réprimé, en accentuant le fait que personne ne se trouve être au-dessus de la loi.
Il va de soi que je reste à votre entière disposition et que je ne manquerai pas de vous transmettre d'autres suggestions et possibilités qui se dégageront très certainement lors des démarches qui seront effectuées dans les jours prochains. » (387c)
Les télex qui figurent déjà dans le rapport du groupe ad hoc Rwanda font également apparaître que Johan Scheers tentait effectivement de jouer le rôle d'intermédiaire entre le président Habyarimana et les autorités et milieux politiques belges.
Dans le « Journal rwandais » de M. Johan Scheers au sujet duquel on peut cependant s'interroger quant à la date à laquelle il a été rédigé , la commission a trouvé de nombreuses indications qui font état des tentatives d'infiltration de M. Scheers dans certains milieux belges, notamment à la Cour.
En décembre 1993, le président Habyarimana avait fait savoir à M. Johan Scheers qu'il ne jouissait plus, depuis le décès du Roi Baudouin, de l'appui de la Cour de Belgique : « Maintenant que le roi Baudouin est décédé, même là, je n'ai plus aucun soutien » (388c).
Les indications suivantes font apparaître que la mission de M. Scheers consistait à rétablir de manière optimale la communication avec la Cour, grâce à ses contacts avec des personnes de l'entourage de la Cour.
(1) Johan Scheers a cherché à entrer en contact avec M. De Lentdecker, à l'époque chef de cabinet du ministre de la Justice. Le 4 décembre 1993, Me Scheers écrit dans son journal : « Entretien avec De Lentdecker à propos d'une mission au Rwanda. Le soutient totalement et communique que le cabinet du Roi l'appuie. »
À la date du 20 décembre 1993 , le même journal mentionne : « Entretien avec De Lentdecker. Aperçu complet des entretiens avec le président. En informe le cabinet du Roi. »
D'après le même journal, il est mis fin aux contacts avec De Lentdecker le 10 janvier 1994 : « Téléphoné à De Lentdecker. Demande d'arrêter toute nouvelle initiative, surtout à l'adresse du cabinet du Roi. Tout doit à présent passer par les Affaires étrangères. »
Réagissant aux démarches de l'avocat Scheers, le ministre Claes signale, le 7 février 1994, à Ambabel Kigali : « Je pense qu'il nous faut faire preuve de beaucoup de prudence à l'égard de ces intermédiaires qui, pour des raisons non connues, ont toujours essayé de l'une ou l'autre façon de donner l'impression qu'elles étaient associées aux relations entre la Belgique et le Rwanda » (389c).
(2) M. Scheers a estimé trouver en M. Durand, premier président de la Cour militaire, un deuxième contact avec la Cour. M. Scheers signale, dans son journal, le 1er février 1994 : « Entretien avec Durand. Transmet message à GSO et à van Ypersele. »
(3) Le Père Boets est le troisième contact qu'aurait utilisé M. Scheers pour faire parvenir certaines informations à la Cour. Le 1er février 1994, M. Johan Scheers note dans son journal : « Entretien avec Boets. Après consultation du Palais, il suggère que le Prince Philippe rencontre Habyarimana en Côte-d'Ivoire le 7 février 1994 (funérailles président de Côte-d'Ivoire). Le même soir, appelé le président (Habyarimana). Réponse pour le vendredi 4 février. »
Au cours de son témoignage devant la commission, M. Scheers a déclaré que l'initiative de cette rencontre avait été prise par le Palais.
En fin de compte, pour des raisons de sécurité, le président n'a pas accepté cette invitation. M. Scheers a déclaré devant la commission: « Je lui ai dit, monsieur le président, j'espère que vous avez de sérieuses raisons car je ne peux le justifier. Il m'a alors fait savoir : « Je crains que quelque chose n'arrive si je quitte le territoire. » (390c)
Enfin, M. Scheers a confirmé aux membres de la commission que, selon lui, les contacts qu'il entretenait avec le président Habyarimana et avec le Palais avaient leur place dans une stratégie de « diplomatie parallèle ». Il entretenait aussi, à cet effet, des rapports avec M. Eugène Nahimana, le responsable pour la presse du MRND en Belgique. M. Scheers a déclaré devant la commission qu'il avait peut-être, en tant qu'antenne du président Habyarimana en Belgique, participé à une stratégie dirigée contre l'État belge.
« Je me demande aujourd'hui si je n'ai pas été manipulé par certaines personnes. On savait que j'avais en Belgique un certain nombre de contacts politiques, tout d'abord avec Willy Kuijpers et ensuite avec d'autres hommes politiques. On savait probablement que je pouvais laisser infiltrer certaines informations, qui cadraient peut-être à la perfection dans une politique menée contre l'État belge et contre les paras belges et qui prenait de plus en plus forme au Rwanda au cours de cette période » (391c).
À une réunion de travail de la commission du 26 septembre 1997, M. De Smet, commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, donne une description de la procédure d'asile actuelle en Belgique.
L'octroi de la qualité de réfugié est réglé par les articles 48 et suivants de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
La procédure d'asile se décompose en deux étapes : la recevabilité de la demande d'une part, son fondement, d'autre part.
L'étranger qui entre dans le Royaume et désire obtenir le statut précité doit, lors de son entrée ou dans les 8 jours ouvrables de celle-ci, se déclarer réfugié. Cette déclaration est examinée par l'Office des étrangers, département qui ressort au ministère de l'Intérieur.
Le premier examen auquel se livre l'Office des étrangers est donc relatif à la recevabilité de la demande. Si la demande de statut est estimée recevable, le dossier sera immédiatement transmis pour examen quant au fond auprès du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Si l'examen de la demande se solde par un refus, l'intéressé a le droit d'introduire ce que l'on appelle un recours urgent auprès des services du Commissaire général.
Le recours urgent doit être introduit dans un délai de 3 jours par l'intéressé ou de 24 heures s'il est maintenu à Zaventem; légalement, le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dispose d'un mois pour statuer sur le recours urgent; aucune sanction n'assortit cependant le dépassement de ce délai.
L'issue du recours urgent est double : soit le commissaire général arrive à la conclusion qu'un examen ultérieur s'impose, décision au terme de laquelle l'intéressé est autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume, soit il confirme le refus d'accès à la procédure, ce qui emporte parallèlement et automatiquement confirmation de l'ordre de quitter le territoire.
Lorsque le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides confirme l'irrecevabilité d'une demande d'asile, il peut, dans sa décision, recommander qu'un étranger ne soit pas reconduit dans son pays d'origine. La considération précitée n'est cependant qu'un avis, auquel le ministre de l'intérieur n'est pas obligé d'adhérer.
Le commissaire général De Smet a révélé qu'en règle générale, l'Office des étrangers suit néanmoins à cet égard son avis.
Lorsqu'une décision de confirmation de refus est rendue, l'intéressé dispose d'un recours au Conseil d'état qui est double; il peut en effet introduire un recours en suspension et en annulation de la décision ainsi rendue. Comme tel cependant, ce recours n'est toutefois pas suspensif de l'ordre de quitter le territoire.
Lorsque la demande est déclarée recevable ou que le recours urgent a été déclaré fondé, va s'amorcer l'étude du bien fondé de la demande d'asile. Il n'est pas inutile d'attirer l'attention sur le fait qu'il n'existe pas de délai légal imposant au commissaire général de statuer. Les dossiers sont traités au cas par cas.
Si, à l'issue de l'enquête réalisée par le commissaire général, celui-ci déclare fondée la demande d'asile de l'intéressé, le ministre de l'Intérieur dispose d'un délai de 15 jours pour introduire un recours contre cette décision devant la commission permanente de recours.
On notera cependant que cette procédure n'a été utilisée jusqu'ici que sept fois. (Ces recours toutefois sont étrangers au dossier dit rwandais.)
Lorsque le commissaire général refuse le bien-fondé de la demande, l'intéressé dispose également d'un délai de 15 jours pour introduire un recours devant la commission permanente de recours. Ce recours est suspensif et permet donc à l'intéressé de se maintenir sur le territoire belge.
La procédure instituée devant le commissaire général n'est pas à proprement parler contradictoire. Elle est appliquée par les fonctionnaires du CGRA qui est une instance administrative. Ainsi par exemple, l'examen des dossiers se fait entre l'intéressé et le juriste du CGRA assisté de son conseil, d'un interprète et en ce qui concerne le mineur en présence de son représentant légal.
La commission permanente de recours, en revanche, est une juridiction administrative. La question du respect des droits de la défense et de la contradiction des débats doit donc être respectée. Soulignons cependant qu'il n'existe pas non plus, devant cette instance, de délais fixes endéans lesquels la commission permanente de recours doit rendre ses décisions.
Interrogé sur l'acheminement des dossiers qui lui parviennent de l'Office des étrangers, le commissaire général De Smedt a évoqué le fait qu'il arrivait que des dossiers lui parviennent incomplets et nécessitaient à cet égard diverses interpellations. Il serait même arrivé qu'un dossier disparaisse ou qu'il soit perdu. Dans le cadre des dossiers dits rwandais, aucun cas de ce genre n'a cependant été noté.
Il n'est pas inutile de relever à cet égard qu'il n'existe par ailleurs, à ce stade de la procédure, aucun inventaire des pièces qui constituent le dossier ainsi soumis au commissaire général.
À l'occasion de ses investigations, il peut être opportun pour le commissaire général d'obtenir communication et, le cas échéant, copie de certaines pièces de dossiers répressifs en cours d'information ou d'instruction.
La loi de 1980 susvisée ne contient aucune disposition qui donne au commissaire général aux réfugiés et aux apartides un accès automatique aux dossiers dits judiciaires. La question est donc traitée conformément à l'article 57/7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers laquelle dispose, dans son alinéa 2, « qu'il a le droit de se faire communiquer par toute autorité belge tous documents et renseignements utiles à l'exercice de sa mission ».
En l'espèce, il ressort que le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a sollicité, à diverses reprises semble-t-il, des accès aux dossiers répressifs. Ses demandes ont dû être réitérées pour être, in fine, accueillies.
Lorsque la commission permanente de recours statue à l'égard d'une demande, sa décision est elle-même susceptible d'un recours en annulation devant le Conseil d'État. Il convient de relever que le ministre de l'Intérieur n'a jamais introduit un tel recours en annulation. L'inverse n'est évidemment pas vrai, l'intéressé se voyant confirmer un refus pouvant introduire un recours devant le Conseil d'État. Ce recours n'est cependant pas suspensif.
Le Conseil d'État statue alors de la même manière que la Cour de cassation, à savoir qu'il ne prend pas une décision sur le fond, mais que s'il casse la décision rendue par la commission permanente de recours, cette cassation donne lieu à un renvoi devant la commission permanente de recours, laquelle, étant toutefois autrement composée, examine à nouveau le recours.
La procédure de retrait, évoquée à l'article 57/6 de la loi du 15 décembre 1980, permet au commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de retirer la qualité de réfugié dès lors qu'il surviendrait des éléments nouveaux permettant d'infirmer la qualité de réfugié de l'étranger.
Ces éléments nouveaux ne doivent pas être d'une nature particulière; ils doivent cependant avoir été révélés après que le statut a été obtenu. Le commissaire général De Smet a notamment soulevé le fait que des éléments nouveaux pourraient d'ailleurs émaner des travaux de la commission.
La décision doit cependant être motivée; en effet, elle est elle-même susceptible d'un recours devant la commission permanente de recours. On notera que, durant l'examen du recours éventuel de l'intéressé, la décision de retrait est suspendue; ainsi, aucune mesure d'éloignement ne peut être prise contre l'intéressé.
Le commissaire général De Smet précise qu'aucune procédure de retrait n'existait à ce jour en ce qui concerne les réfugiés rwandais.
Interrogé sur les éventuelles protections dont auraient bénéficié des demandeurs d'asile rwandais aux divers stades de la procédure, le commissaire général De Smet n'a pu répondre, pour des raisons évidentes, expliquant son ignorance et celle de ses services quant au contenu de l'instruction menée par l'Office des étrangers et par la commission permanente de recours.
Au stade de l'Office des étrangers en effet, c'est-à-dire au premier stade de la recevabilité de la demande, le commissaire général De Smet ne dispose d'aucun moyen qui permette à ses services d'éprouver ou de mettre en doute la probité des fonctionnaires de l'Office des étrangers.
Au commissariat général même, instance indépendante, le commissaire général est catégorique et n'évoque aucune tentative d'intervention malencontreuse. Tout au plus, évoque-t-il quelques lettres ou appuis divers, lesquels se résument à des démarches qu'il ne considère manifestement pas comme étant des moyens de pression. Il est en revanche dans l'incapacité de fournir, à juste titre, des renseignements précis pour ce qui se passe devant la commission permanente de recours.
M. De Smet ne peut donc fournir des renseignements plus précis sur les délais d'étude manifestement fort longs des recours introduits par MM. Murayi, Rwabukumba et Ndindiliyimana. Les décisions de refus de leur statut datent en effet respectivement des mois de mars, avril et mai 1996.
Il attire l'attention sur le fait que, pour un certain nombre de demandeurs d'asile rwandais, il est arrivé à la conclusion de refuser la qualité de réfugié en appliquant la clause d'exclusion prévue par l'article 1 F de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié.
Le commissaire général De Smet a enfin été interrogé à l'effet de savoir s'il avait tenu ou non compte de la liste des génocidaires présumés qui avait été transmise à la fin de la l'année 1995 par le gouvernement rwandais. Le Commissaire a répondu à cette question en arguant de son indépendance, d'une part, et de la nécessité de tenir compte d'un ensemble d'éléments le plus complet possible, d'autre part.
Il a enfin été fait référence au nombre de candidatures de réfugiés rwandais; le commissaire général De Smet a évoqué le fait que le Rwanda venait en septième position et représentait entre 3,5 et 4,5 % des demandes de statut. Le Rwanda prend néanmoins la troisième position (après la Turquie et l'ex-Zaïre) en ce qui concerne le nombre des réfugiés reconnus par le commissaire général.
Le nombre de demandes d'asile rwandaises depuis le 1er avril 1994 est communiqué à la commission, ainsi que la liste des demandes d'asile par pays en 1997.
Demandes d'asile rwandaises depuis le 1er avril 1994 :
Enregistrées par l'Office des étrangers : 1730
recevables : 783 (45 %);
irrecevables : 876 (51 %);
sans décision : 71 (4 %).
Nombre de recours urgents auprès du CGRA : 824
recevables 702 (85 %);
irrecevables 101 (12 %);
sans décision 21 (3 %).
Nombre de décisions prises quant au fond par le CGRA : 1485
reconnus : 979 (66 %);
refus : 77 (4 %);
sans décision : 429 (30 %).
Demandes d'asile en Belgique en 1997
| Code | Land Pays |
Zone | Jan. Jan. |
Feb. Fév. |
Ma. Mar. |
Apr. Avr. |
Mei Mai |
Juni Juin |
Juli Juil. |
Aug. Août |
Sep. Sep. |
Okt. Oct. |
Nov. Nov. |
Dec. Déc. |
Totaal Total |
| AL | Albanië. Albanie | Europa. Europe | 33 | 40 | 89 | 126 | 65 | 75 | 84 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 |
| KOS | Kosovo | Ex-Yoe. Ex-Jou | 121 | 90 | 95 | 91 | 68 | 39 | 32 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 |
| ARM | Armenië. Arménie | Europa. Europe | 82 | 61 | 45 | 86 | 39 | 40 | 50 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 |
| ZRE | Zaïre | Afrika. Afrique | 97 | 71 | 87 | 88 | 36 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 |
| CGO | Congo | Afrika. Afrique | 0 | 1 | 2 | 14 | 46 | 98 | 108 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 |
| R | Roemenië. Roumanie | Europa. Europe | 51 | 83 | 39 | 34 | 17 | 40 | 42 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 |
| TR | Turkije. Turquie | Azië. Asie | 65 | 46 | 35 | 47 | 33 | 37 | 38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 |
| RWA | Rwanda | Afrika. Afrique | 29 | 22 | 36 | 39 | 47 | 57 | 43 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 |
| BOS | Bosnië. Bosnie | Ex-Yoe. Ex-Jou. | 60 | 65 | 46 | 38 | 23 | 16 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 |
| PAK | Pakistan | Azië. Asie | 43 | 49 | 39 | 40 | 20 | 19 | 27 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| BG | Bulgarije. Bulgarie | Europa. Europe | 58 | 40 | 33 | 29 | 16 | 21 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 |
| IND | India. Inde | Azië. Asie | 19 | 24 | 22 | 32 | 17 | 32 | 33 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 |
| DZ | Algerije. Algérie | Afrika. Afrique | 18 | 19 | 27 | 20 | 21 | 17 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| GEO | Georgië. Géorgie | Europa. Europe | 23 | 14 | 19 | 25 | 14 | 7 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| SER | Servië. Serbie | Ex-Joe. Ex-Jou | 41 | 33 | 11 | 22 | 11 | 15 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| IRQ | Irak. Iraq | Azië. Asie | 17 | 13 | 14 | 18 | 18 | 17 | 27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| RUS | Russische federatie. Fédération russe | Europa. Europe | 18 | 13 | 13 | 19 | 31 | 15 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| SLQ | Slovakije. Slovaquie | Europa. Europe | 29 | 37 | 17 | 16 | 19 | 1 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| LB | Liberia. Libéria | Afrika. Afrique | 11 | 26 | 26 | 15 | 26 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| RU | Burundi | Afrika. Afrique | 17 | 15 | 10 | 16 | 18 | 14 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| GUI | Guinea. Guinée | Afrika. Afrique | 19 | 8 | 12 | 18 | 18 | 6 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| WAL | Sierra Leone | Afrika. Afrique | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | 25 | 33 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| MON | Montenegro. Monténégro | Ex-Joe. Ex-You | 8 | 2 | 3 | 8 | 1 | 8 | 34 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| UKR | Ukraïne. Ukraine | Europa. Europe | 9 | 11 | 10 | 7 | 12 | 7 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| WAN | Nigeria. Nigéria | Afrika. Afrique | 11 | 8 | 14 | 13 | 6 | 6 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| BIE | Belarus. Biélorussie | Europa. Europe | 4 | 14 | 4 | 16 | 12 | 5 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| AFG | Afghanistan | Azië. Asie | 8 | 6 | 7 | 6 | 14 | 7 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| KAZ | Kazakhstan | Europa. Europe | 2 | 4 | 12 | 10 | 3 | 12 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| CL | Sri Lanka | Azië. Asie | 6 | 7 | 7 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| MAC | Macedonië. Macédonie | Ex-Joe. Ex-You | 14 | 6 | 7 | 11 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| SOM | Somalië. Somalie | Afrika. Afrique | 7 | 4 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| SUD | Sudan. Soudan | Afrika. Afrique | 6 | 7 | 6 | 5 | 11 | 11 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| RIM | Mauritanië. Mauritanie | Afrika. Afrique | 12 | 7 | 4 | 11 | 8 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| AN | Angola | Afrika. Afrique | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 3 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| SYR | Syrië. Syrie | Azië. Asie | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| IR | Iran | Azië. Asie | 7 | 7 | 2 | 13 | 7 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| C | Kameroen. Cameroun | Afrika. Afrique | 4 | 4 | 9 | 9 | 7 | 3 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| MOL | Moldavië. Moldavie | Europa. Europe | 11 | 9 | 5 | 5 | 5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| GH | Ghana | Afrika. Afrique | 5 | 10 | 6 | 8 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| BH | Bhutan. Bhoutan | Azië. Asie | 6 | 6 | 8 | 4 | 1 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| CS | Tsjechië. Tchèque | Europa. Europe | 8 | 2 | 6 | 3 | 3 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| TG | Togo | Afrika. Afrique | 8 | 5 | 2 | 10 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| RL | Libanon. Liban | Azië. Asie | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| BGD | Bangladesh | Azië. Asie | 0 | 3 | 9 | 7 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| YU | Joegoslavië. Yougoslavie | Ex-Joe. Ex-You | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| CRO | Kroatië. Croatie | Ex-Joe. Ex-You | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| SN | Senegal. Sénégal | Afrika. Afrique | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| IL | Israël | Azië. Asie | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| RCB | Congo | Afrika. Afrique | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| AZE | Azerbeidzjan. Azerbaïdjan | Europa. Europe | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| PE | Peru. Pérou | Amerika. Amérique | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| CO | Colombia. Colombie | Amerika. Amérique | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| ETH | Ethiopië. Éthiopie | Afrika. Afrique | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| C | Cuba | Amerika. Amérique | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| CN | China. Chine | Azië. Asie | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| EG | Egypte. Égypte | Afrika. Afrique | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| CI | Ivoorkust. Côte d'Ivoire | Afrika. Afrique | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| EC | Ecuador. Équateur | Amerika. Amérique | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| VN | Vietnam. Viêt-nam | Azië. Asie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| EAK | Kenya | Afrika. Afrique | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| NIG | Niger | Afrika. Afrique | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| SU | USSR. URSS | Europa. Europe | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| HKJ | Jordanië. Jordanie | Azië. Asie | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| HV | Burkina Faso | Afrika. Afrique | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| MA | Marokko. Maroc | Afrika. Afrique | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| PL | Polen. Pologne | Europa. Europe | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| EAU | Uganda. Ouganda | Afrika. Afrique | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| NEP | Nepal. Népal | Azië. Asie | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| WAG | Gambia. Gambie | Afrika. Afrique | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| LAR | Libië. Libye | Afrika. Afrique | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| LET | Letland. Lettonie | Europa. Europe | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| LIT | Litouwen. Lituanie | Europa. Europe | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| OP | Palestina. Palestine | Azië. Asie | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| RB | Birma. Birmanie | Azië. Asie | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| SA | Zuid-Afrika. Afrique du Sud | Afrika. Afrique | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| RMM | Mali | Afrika. Afrique | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| TRK | Turkmenistan. Turkménistan | Europa. Europe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| AAA | Staatloos. Apatride | Andere. Autre | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ER | Eritrea. Erythrée | Afrika. Afrique | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TN | Tunesië. Tunisie | Afrika. Afrique | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TSJ | Tsjaad. Tchad | Afrika. Afrique | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| XSU | Ex-Rusland. Ex-Union soviétique | Europa. Europe | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| DY | Benin | Afrika. Afrique | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| EAT | Tanzania. Tanzanie | Afrika. Afrique | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ME | Mongolië. Mongolie | Azië. Asie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TAD | Tadzjikistan. Tadjikistan | Europa. Europe | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| VOI | Voivodina. Voivodine | Ex-Joe. Ex-You | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| DJ | Djibouti | Afrika. Afrique | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EST | Estland. Estonie | Europa. Europe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| H | Hongarije. Hongrie | Europa. Europe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JA | Jamaïca. Jamaïque | Amerika. Amérique | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| P | Portugal | Europa. Europe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RCA | Centrafr. Rep.. Rép. Centrafr. | Afrika. Afrique | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RH | Haïti | Amerika. Amérique | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RI | Indonesië. Indonésie | Azië. Asie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RM | Madagaskar. Madagascar | Afrika. Afrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RP | Filipijnen. Philippines | Azië. Asie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SLO | Slovenië. Slovénie | Ex-Joe. Ex-Jou | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TAH | Tahiti | Oceanië. Océanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TB | Tibet | Azië. Asie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| USA | Verenigde Staten. États-Unis | Amerika. Amérique | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| YU | Ex-Joegoslavië. Ex-Yougoslavie | Ex-Joe. Ex-You | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Source : Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides 1997.
Demandes d'asile en provenance de Rwandais
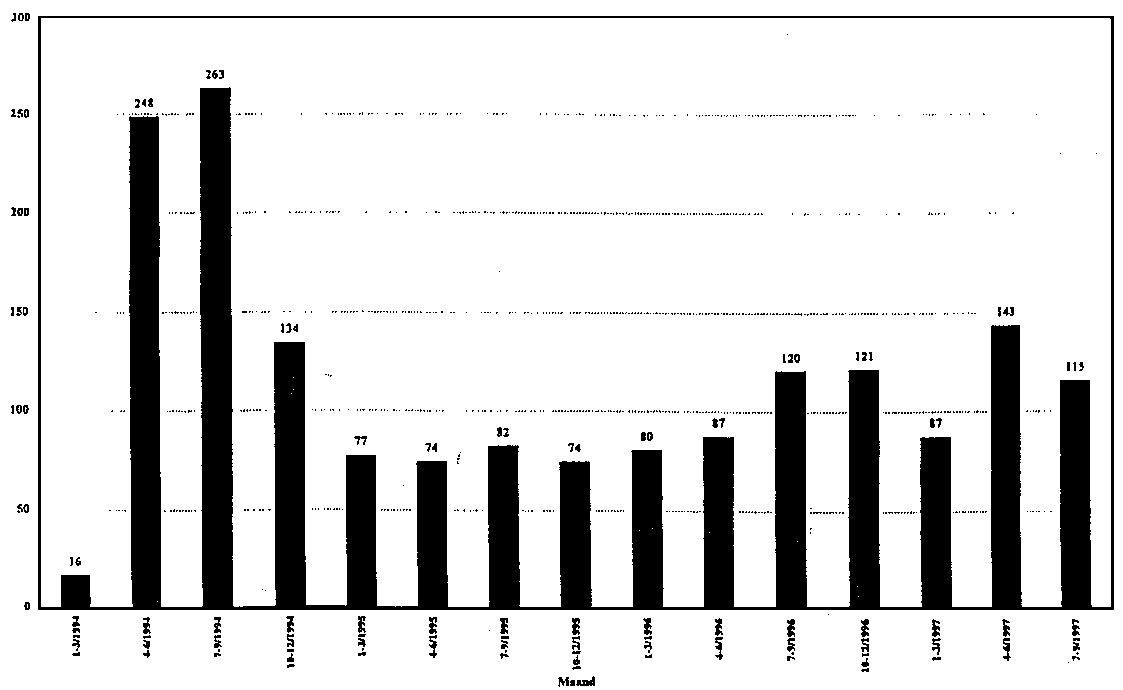
Maand/Mois
3.13.2. Les dossiers judiciaires relatifs aux Rwandais en Belgique
La commission, dans le cadre de sa mission et sans qu'il soit question dans son chef de remettre en cause ou d'empiéter sur les compétences spécifiques et particulières des autorités judiciaires, a souhaité être informée de la manière la plus précise sur le travail réalisé par le pouvoir judiciaire dans le cadre des dossiers relatifs aux événements du Rwanda.
L'intérêt que la commission porte aux dossiers judiciaires est notammemnt motivé par le fait que de nombreux Rwandais, présents sur notre territoire, font l'objet d'enquêtes pénales non clôturées ce jour, soit plus de trois ans après les faits dont l'étude est confiée à la commission.
1. Méthode de travail
a) En un premier temps, soit le 15 avril 1997, la commission s'est adressée au ministre de la Justice afin d'obtenir de M. le procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles des renseignements relatifs aux dossiers en cours d'information, d'une part, et ceux mis à l'instruction, d'autre part.
Par courrier du 13 mai 1997, le procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles répondait de manière circonstanciée au ministre que 10 dossiers avaient été mis à l'instruction dans le cabinet de M. Vandermeersch, 16 autres notices étant restées à l'information.
Cette lettre, transmise par le ministre de la Justice au président de la commission, indiquait de manière succincte l'état d'avancement des procédures en cours. Ces informations seront restituées ultérieurement sous le point A.
b) En un deuxième temps et par deux fois, soit les 6 mai et 26 septembre 1997, la commission a auditionné de manière circonstanciée le juge d'instruction Vandermeersch.
Dans le souci de respecter la bonne fin de sa mission, le juge d'instruction a attiré l'attention de la commission sur la nécessité de rester discrets à l'égard de plusieurs éléments d'enquête. L'une de ses instructions est en effet toujours en cours et de nombreuses informations lui parviennent encore quotidiennement.
La commission tient compte à l'occasion du présent rapport du souhait légitime du magistrat instructeur. Ce préalable doit être compris dans le cadre de la mission générale de la commission d'enquête, dont les pouvoirs d'investigation et la restitution des informations récoltées à l'occasion de ceux-ci ne peuvent porter préjudice, dans un but d'intérêt général, aux enquêtes en cours.
Grâce à ses dépositions, la commission a pu apprécier le travail d'instruction réalisé par le magistrat. Les réponses de M. Vandermeersch lui ont permis de comprendre les difficultés multiples auxquelles le juge d'instruction a été confronté dans ce type de dossier. Le travail de M. Vandermeersch, les éclaircissements qu'il a pu fournir et les conclusions qu'il convient d'en tirer, seront abordés au point B.
c) Le 26 septembre 1997, le juge d'instruction Vandermeersch a transmis à la commission une liste actualisée des dossiers mis à l'instruction ainsi que l'état actuel de ces instructions.
A. Note du procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles du 13 mai 1997
La note transmise par le ministre de la Justice à la commission par lettre du 19 juin 1997 reprend synthétiquement l'état d'avancement des diverses enquêtes en cours.
Cette note permet de réaliser les constatations suivantes :
dix dossiers ont été mis à l'instruction;
seize notices ont été mises à l'information.
Les poursuites ont été entamées sur injonction du ministre de la Justice, conformément à l'article 274 du Code d'instruction criminelle.
Les plaintes se fondent essentiellement sur les articles 1er , 2, 3 et 4 de la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des infractions graves aux conventions internationales de Genève du 12 août 1949 et aux protocoles additionnels I et Il du 8 juin 1977 à ces conventions.
1. Affaires mises à l'instruction :
1. Dossier nº 34/95 (4 classeurs) (mise à l'instruction : 2 mars 1995).
Inculpé : R.E., ancien directeur de cabinet de l'ex-président Habyarimana.
Il est soupçonné de s'être associé aux préparatifs des massacres ou, à tout le moins, ce qui reste pénalement répréhensible, de n'avoir rien fait pour les empêcher.
Le dossier a été communiqué au parquet à toutes fins le 1er août 1996.
Constatation : ce dossier n'a pas évolué depuis plus de 15 mois.
2. Dossier nº 35/95 (14 classeurs) (mise à l'instruction : 2 mars 1995).
Inculpé : N.A., ancien chef d'état-major de la gendarmerie.
Le dossier était pratiquement terminé au mois de mai 1997.
Le procureur général souhaitait connaître les intentions d'évocation éventuelle du TPI avant de clôturer la procédure. L'instruction a permis de dégager des indices de culpabilité relatifs à une /omission d'agir » face à des crimes de droit international que l'intéressé avait pour mission de prévenir.
Une copie officieuse du dossier a été adressée au TPI pour lui permettre d'apprécier les suites qu'il convenait d'y réserver.
Constatation : l'audition du 26 septembre 1997 du juge d'instruction a permis d'apprendre que le dossier avait été communiqué au parquet durant l'été 1997. On en retient que le TPI n'a pas souhaité évoquer la procédure.
3. Dossier nº 36/95 (11 classeurs) (mise à l'instruction : 2 mars 1995).
Inculpés :
N.E., beau-neveu de l'ex-président,
B.S., ancien fonctionnaire du ministère de la Jeunesse et membre des Interahamwe,
M.S. (ex-Jean-Marie), ancien ministre de l'Industrie,
R.G., (de nationalité belge), animateur de la radio RTLM.
Le TPI a souhaité évoquer cette procédure et un arrêt de désaisissement a été rendu par la Cour de cassation le 9 octobre 1996.
Constatation : treize mois après la communication officielle de l'entièreté de la procédure, l'affaire n'est pas encore fixée à l'une des audiences du TPI.
4. Dossier nº 37/95 (32 classeurs) (mise à l'instruction : 2 mars 1995).
Inculpés :
N.V., chercheur à l'U.C L.,
H.A., ancien ministre MRND, directeur d'usine à Butare,
M.A., épouse de Higaniro Alphonse, et fille du médecin de l'ex-président,
K.J., ancien bourgmestre de Ngoma,
N.E., ancien bourgmestre de Muganza.
Ce dossier a donné lieu à quatre arrestations en Belgique. Les deux derniers cités ont été transférés le 8 novembre 1996 au TPI après 499 jours de détention préventive en Belgique.
Les deux premiers ont été remis en liberté provisoire par les juridictions d'instruction : N.V. après le dépôt d'un réquisitoire de non-lieu; H.A. après que le TPI ait refusé, faute de charges suffisantes, de confirmer l'acte d'accusation qui le concernait.
L'arrêt de désaisissement de la Cour de cassation est donc intervenu pour trois inculpés le 31 mai 1996.
La chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles a rendu une ordonnance de prise de corps et d'envoi du dossier à M. le procureur général le 22 juillet 1996.
Le dossier remis à l'instruction pour H.A. a été communiqué à toutes fins au parquet le 25 septemre 1996.
Constatations : bien qu'il soit probable que le procureur général ait souhaité réunir les deux inculpés dont les procédures avaient un temps été disjointes, on remarque que la décision judiciaire coulée en force de chose jugée relative à M. N.V. n'a toujours pas fait l'objet du suivi normal qu'il convenait de lui réserver. À ce jour, la chambre des mises en accusation n'a en effet toujours pas été saisie du dossier qui le concerne, au mépris de l'autorité de la chose jugée, d'une part, et de l'article 217 du code d'instruction criminelle dont les délais ne sont cependant pas prescrits à peine de nullité, d'autre part. La situation est inquiétante dès lors que la Commission a pu apprendre que le dossier de M. H.A. est communiqué à l'Office du procureur du Roi depuis plus de 16 mois. Il apparaît que l'office de M. le procureur du Roi a disposé de plus d'une année pour mettre l'affaire en état conformément au souhait de jonction implicitement émis par le parquet général.
Si la procédure aboutit, les intéressés devraient comparaître devant la Cour d'assises de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, seule juridiction compétente dans notre pays pour statuer en matière criminelle.
5. Dossier nº 38/95 (6 classeurs) (mise à l'instruction : 02/03/1995).
Inculpés :
R.P-C., colonel des forces armées rwandaises, M.S., député et ancien bourgmestre de la commune de Saké,
X (inconnu).
Le premier est décédé le 21 juin 1995 au Cameroun, ce qui éteint l'action publique contre lui.
Le second, soupçonné d'avoir été le patron des Interahamwe de sa commune, serait impliqué dans la confection des listes des personnes à abattre et aurait participé à plusieurs meurtres. Il se trouverait en Zambie ou au Cameroun. Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international.
Copie du dossier a été transmise au TPI à qui il revient de prendre attitude dans le sens d'une éventuelle évocation.
Constatation : ce dossier est toujours en cours d'instruction et la confidentialité des derniers devoirs d'enquête réalisés se justifie afin d'éviter des fuites préjudiciables à la bonne fin de l'enquête.
6. Dossier nº 39/95 (3 classeurs) (mise à l'instruction : 02/03/1995).
Inculpés :
M. M.-Ch., religieuse dirigeant un couvent à Ndera, commune de Rubungo, dans la préfecture de Kigali,
X (inconnus).
La religieuse est soupçonnée d'avoir livré ses consoeurs Tutsies aux miliciens Interahamwe qui les ont violées et massacrées.
L'instruction a été communiquée à l'office du procureur du Roi à toutes fins le 7 décembre 1995. Au stade actuel de la procédure, le procureur du Roi pense rédiger un réquisitoire de non-lieu pour insuffisance de charges. Le dossier a été joint au dossier nº 37/95 précité.
Constatations : le réquisitoire d'éventuel non-lieu qui doit être soumis aux juridictions d'instruction et, à tout le moins, à la Chambre du Conseil qui reste libre d'apprécier en connaissance de cause les suites qu'il convient de donner au réquisitoire, n'est toujours pas rédigé près de 2 ans après la communication du dossier au parquet du procureur du Roi. Indépendamment de la complexité de l'affaire, l'obligation de respecter la règle du délai raisonnable indique l'urgence d'aboutir au stade du parquet.
7. Dossier nº 48/95 (12 classeurs) (mise à l'instruction : 11/03/1995).
Inculpés : R.S. et son épouse, U.I.
L'instruction est toujours en cours; elle concerne des détournements à mettre éventuellement en rapport avec le dossier relatif à l'assassinat des 3 coopérants belges (voir infra ).
Constatation : compte tenu de l'attente d'informations à venir, notamment du Rwanda, il est concevable que le dossier reste à l'information et que le magistrat instructeur puisse continuer celle-ci en toute sérénité et sans être gêné par des divulgations qui pourraient compromettre la suite favorable de l'enquête en cours.
8. Dossier nº 57/95 (39 classeurs) (mise à l'instruction : 21/04/1995).
Inculpés :
B. T., chef de cabinet du ministre rwandais de la Défense en avril 1994,
N. B., major dans l'armée rwandaise,
S. J.-L., adjudant-chef dans l'armée rwandaise.
B. T. a été arrêté le 10 mars 1996 à son domicile, sur la base du mandat d'arrêt délivré le 29 mai 1995 par le juge d'instruction. Il a été transféré au TPI où il est actuellement détenu suite à l'arrêt de désaisissement de la Cour de cassation du 9 juillet 1996.
Un mandat d'arrêt international a été lancé contre N. B. ce même 19 mai 1995. Il a été transmis à l'appui d'une demande d'extradition vers la Belgique au ministre de la Justice. Divers rappels ont été adressés par le procureur général au ministre de la Justice, en l'espèce les 28 novembre et 20 décembre 1995 ainsi que le 3 janvier 1997.
Par courrier du 23 décembre 1996, le ministre de la Justice a fait savoir qu'il était prêt à solliciter son collègue des Affaires étrangères afin que tout soit mis en oeuvre aux fins d'exécuter l'ordre de capture.
L'intéressé est actuellement localisé en Zambie et des démarches diplomatiques s'avèrent manifestement nécessaires pour obtenir un prompt suivi de la procédure précitée. Monsieur le procureur général déplore vivement cette situation. Il préfère, ce qui est légitime, une procédure contradictoire à un procès par contumace.
Dans le cadre de cette procédure, le juge d'instruction a enregistré, le 23 juin 1995, une plainte des familles des 10 victimes paracommandos contre le général canadien Roméo Dallaire, commandant de la MINUAR, en avril 1994. La Belgique n'est pas compétente pour poursuivre le général Dallaire. Le procureur général a donc transmis la plainte au ministre de la Justice le 6 octobre 1995 en vue d'en assurer l'acheminement aux autorités canadiennes (compétentes pour entamer des poursuites sur la base de l'accord entre l'ONU et le gouvernement de la République rwandaise sur le statut de la MINUAR, fait à New York le 5 novembre 1993).
La Belgique n'a jamais réussi à obtenir l'exécution d'une commission rogatoire directe permettant d'obtenir l'audition directe du général Dallaire. L'ONU a en effet opposé à l'État belge une fin partielle de non-recevoir; seule, une déclaration écrite du général Dallaire a été transmise au juge d'instruction; celle-ci n'a pu être réalisée en présence du magistrat.
Constatation : il est urgent de réaliser une démarche diplomatique auprès des autorités zambiennes afin d'obtenir l'exécution du mandat d'arrêt international en vue d'extradition délivré il y a plus de 2 ans déjà par le juge d'instruction Vandermeersch.
9. Dossier nº 58/95 (5 classeurs) (mise à l'instruction : 21/04/1995).
Inculpés :
Ce dossier est relatif à l'assassinat des trois coopérants belges : Olivier Dulieu, Antoine Godfriaux et Christine André, abattus le 7 avril 1994 dans la commune de Rambura. Le dossier porte également sur des détournements de subventions entre l'O.N.G. belge « Nord-Sud Coopération » et l'A.S.B.L. rwandaise ADECOGIKA.
Le dossier a été communiqué au parquet en vue de disjonction le 24 novembre 1995; celle-ci est intervenue le 28 avril 1997. Compte tenu du fait qu'une enquête était ouverte au Rwanda et qu'un suspect s'y trouvait détenu, la procédure devait être transmise au Rwanda, pays avec lequel aucun traité d'extradition n'avait été conclu en l'espèce. La dénonciation a été réalisée à la fin de l'été 1997.
L'aspect financier de l'instruction reste cependant soumis au juge belge qui poursuit ses investigations, investigations qu'il ne convient pas de restituer afin d'éviter des fuites inopportunes et préjudiciables à l'enquête. L'assurance de la poursuite effective du travail du magistrat instructeur a été obtenue par celui-ci en cours d'audition.
Constatation : la commission n'a pas connaissance du suivi réservé à cette dénonciation. Il conviendrait de réaliser une démarche à tout le moins diplomatique pour s'assurer du suivi réel réservé à la procédure au Rwanda et ce dans le respect des droits de l'homme.
10. Dossier nº 62/95 (5 classeurs) (mise à l'instruction : 03/08/1995).
Inculpés :
M. G., soeur supérieure rwandaise de l'abbaye de Sovu à Butaré,
K. M., religieuse,
M. M., journaliste belge.
La soeur a été inculpée du chef de crime de guerre par le juge d'instruction et remise en liberté. Elle vit en Belgique. Elle aurait ordonné aux réfugiés de quitter son couvent, les livrant ainsi aux milices Interahamwés qui les auraient massacrés.
Le journaliste a fait l'objet d'une plainte en diffamation.
Le dossier a été communiqué à toutes fins au parquet du pocureur du Roi le 15 mai 1996.
Constatation : indépendamment du caractère délicat du dossier, la commission n'aperçoit aucune raison à l'absence de rédaction de réquisitoire dans ce dossier communiqué depuis 18 mois.
Remarque :
Le courrier de M. le procureur général ne fait pas référence au dossier ouvert chez M. le juge d'instruction Vandermeersch le 22 mai 1995 et portant le numéro de référence 60/95.
Inculpés :
Dès lors que ce dossier a été joint au dossier nº 37/95, précédemment évoqué, on peut en déduire qu'il ne s'agit pas d'une erreur ou d'une omission volontaire.
2. Dossiers à l'information :
16 notices sont à l'information.
La commission pense bien faire de restituer le résumé analytique que lui a adressé M. le procureur général par l'intermédiaire du ministre de la Justice dans son courrier du 13 mai 1997.
La commission n'est cependant pas en mesure en l'état actuel de ces procédures de tirer des conclusions à l'égard de celles-ci. Les informations sont en effet secrètes. La mise en cause éventuelle de certaines personnes bénéficiant d'un privilège de juridiction (les ministres Willy Claes et Leo Delcroix) doit de plus s'apprécier avec une prudence extrême compte tenu du discrédit possible, et le cas échéant non fondé, que des interrogations pourraient déjà induire dans l'esprit du public.
Il n'est par ailleurs pas apparu des travaux parlementaires que le parquet général de Bruxelles ait fait l'objet de pressions dans le cadre de ces informations. L'étude de cet aspect des choses ne ressortait cependant pas de la mission première de la Commission qui n'a donc pas spécifiquement enquêté à cet égard.
Aperçu des dossiers à l'information
1. Notices de 1995
Ce dossier recueille les plaintes des familles des dix soldats belges contre les anciens ministres Willy Claes et Leo Delcroix à qui il est reproché une omission d'agir dans les limites de leurs possibilités alors qu'ils avaient connaissance d'ordres en vue de l'exécution de crimes de droit international ou de faits qui en commendent l'exécution ou alors qu'ils pouvaient en empêcher la consommation ou y mettre fin (art. 1-9º et 4 de la loi du 15 juin 1993).
Ce dossier est à rapprocher des deux suivants.
2. Notices de 1997
Ce dossier, ouvert à charge de Willy Claes, sur base de plaintes déposées par différentes victimes rwandaises, zaïroises et belges, fait l'objet d'actes d'information exécutés à la requête du procureur général près la Cour de cassation, conformément à l'article 3 de la loi du 17 décembre 1996.
3. Notices de 1997
Ce dossier, ouvert à charge de Leo Delcroix, sur base de plaintes déposées par différentes victimes, est à l'information dans les mêmes conditions que le précédent.
4. Notices de 1995
Il s'agit de l'assassinat de l'abbé Paul Késenne le 14 juillet 1994.
5. Notices de 1995
Il s'agit d'une plainte déposée le 10 mai 1995 par Eugène Rurangwa en Jean-Baptiste Murenzi contre le FPR pour l'assassinat d'une série de personnes.
6. Notices de 1995
Ce dossier accueille une plainte de l'avocat, Me De Temmerman, concernant « l'autre génocide », c'est-à-dire les massacres que les Tutsis auraient commis sur les Hutus.
7. Notices de 1995
La plainte vise les exactions commises par le FPR.
8. Notices de 1996
La plaignante se nomme Elena Kabiligi. Elle a déposé plainte le 7 décembre 1995, notamment contre A. N., un fonctionnaire de l'ONU, pour la mort de son mari le 7 avril 1994, à Gisenyi.
9. Notices de 1996
Ce dossier contient une plainte déposée le 5 décembre 1995 contre le FPR pour l'assassinat de Mme Daphrose Nyirangaruye.
10. Notices de 1996
Il s'agit d'une plainte déposée contre T. R., F. F. et E.B. K., contre le gouvernement rwandais, pour la déportation de personnes rapatriées au Rwanda depuis la Zambie.
11. Notices de 1996
Cette plainte a été déposée par Innocent Zitoni contre inconnu pour le meurtre de son épouse, de ses enfants et de sa famille, le 15 avril 1994, à l'évêché de Kibungo.
12. Notices de 1997
Ce dossier concerne Médiatrice Niwenamuha qui réside en Belgique et dont le nom apparaît sur une liste de planificateurs du génocide au Rwanda. Le parquet a en fait été saisi par la plainte de l'intéressée elle-même contre cette inscription qu'elle juge calomnieuse.
13. Notices de 1997
Ce dossier vise Paulin Rukebesha qui habite en Belgique, dont le nom apparaît sur la même liste et qui s'en plaint.
14. Notices de 1997
Le plaignant, Gasana Ndoba, dénonce R. M. N., qui réside en Belgique, comme étant mêlé à l'enlèvement des enfants de la famille Karenzi hors du couvent où ils s'étaient réfugiés pour échapper aux massacres. Ce dossier constitue un développement séparé de l'instruction visée au nº 4 du présent inventaire.
15. Notices de 1997
Il s'agirait d'un trafic de faux passeports en cause de Maurice Bagaragaza qui réside à Louvain. Les gens ayant bénéficié de ces faux passeports seraient impliqués dans le génocide rwandais.
16. Notices de 1995
S'agissant notamment d'une plainte déposée par V. N. contre Gasana Ndoba du chef de diffamation, ce dossier est tributaire du sort qui sera réservé à l'action publique intentée contre le plaignant dans l'instruction nº 37/95 (dossier nº 4 du présent inventaire).
Le procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles a souligné que les instructions dont il a été fait état étaient traitées prioritairement.
B. Le témoignage du juge d'instruction Damien Vandermeersch
Le témoin a informé la commission de ce que la majeure partie des instructions, dont il a été ou reste chargé, sont la suite directe d'injonctions positives de poursuites du ministre de la Justice.
La compétence du juge d'instruction belge est basée sur la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des infractions graves aux conventions de Genève, laquelle prévoit en son article 7 la compétence universelle du juge belge pour des faits commis à l'étranger et ce, indépendamment du lieu de refuge de l'auteur de ceux-ci.
Cette application de la compétence universelle est une première en matière procédurale, en Belgique. La commission n'a pas connaissance de l'exercice effectif de cette compétence et de la mise en oeuvre de poursuites dans les autres pays qui ont adopté un système similaire de compétence.
Le TPI fait de plus partie de l'ordre juridique belge (loi du 22 mars 1996 relative à la reconnaissance du tribunal international pour l'ex-Yougoslavie et du tribunal international pour le Rwanda et à la coopération avec ces tribunaux).
La juridiction internationale peut, sur base de cette loi, dans les affaires qu'elle détermine souverainement, évoquer les procédures internes, c'est-à-dire se les faire soumettre par priorité afin d'en poursuivre les auteurs présumés.
L'article 6 de la loi du 22 mars 1996 dispose en effet que lorsqu'une demande de désaisissement des juridictions nationales est formulée par le tribunal à propos d'un fait relevant de sa compétence, la Cour de cassation, sur réquisition du procureur général, et après audition de la personne intéressée, prononce le désaisissement de la juridiction belge saisie du même fait, après avoir vérifié qu'il n'y a pas erreur sur la personne.
L'article 7 de la loi dispose que l'arrêt de désaisissement empêche la poursuite de la procédure en Belgique, sans préjudice de l'application de l'article 8.
Le désaisissement ne fait pas obstacle au droit de la partie civile de demander réparation. L'exercice de ce droit est cependant suspendu tant que l'affaire est pendante devant le TPI
Au terme de l'article 8 précédemment évoqué, lorsque le TPI fait savoir, après désaisissement de la juridiction belge, que le procureur a décidé de ne pas établir d'acte d'accusation, que le TPI ne l'a pas confirmé, ou que le TPI s'est déclaré incompétent, la Cour de cassation, sur réquisition du procureur général et après l'audition de la personne intéressée, règle la procédure, et s'il y a lieu, prononce le renvoi de cette personne devant la cour, le tribunal ou la juridiction d'instruction compétents.
Les critères retenus par l'office du procureur du Roi pour mettre les affaires à l'instruction depuis le 2 mars 1995 peuvent se répertorier comme suit :
1º l'injonction positive de poursuites du ministre de la Justice conformément à l'article 274 du Code d'instruction criminelle;
2º l'impossibilité matérielle d'instruire contre toutes les personnes impliquées;
3º l'existence d'un lien avec la Belgique :
soit lorsque des personnes impliquées se sont trouvées sur le territoire belge (on pense au dossier 58/95 relatif à l'assassinat des 3 coopérants belges),
soit lorsque l'on se trouvait en présence de victimes belges (on pense au dossier 57/95 relatif à l'assassinat des dix paracommandos belges).
Ce dossier a, en un premier temps, été instruit à l'auditorat militaire. Cependant, la compétence limitée de cette juridiction ne permettait pas un examen de la responsabilité pénale éventuelle des militaires belges. La nécessité d'enquêter sur d'autres personnes, et plus particulièrement, des « civils », a déterminé le parquet à désigner un magistrat instructeur civil. D'emblée, le juge d'instruction Vandermeersch a souligné la parfaite collaboration qui s'est instaurée entre l'auditorat militaire et ses enquêteurs. Le substitut près l'auditorat militaire Verelst a par ailleurs été délégué au parquet du procureur du Roi dans un souci de meilleure efficacité d'enquête. Devant les juridictions militaires, l'enquête s'est clôturée après le procès du colonel Marchal, justiciable, de par son grade, de la Cour militaire. La collaboration avec l'auditorat général semble s'être bien déroulée bien qu'ayant été peu développée au moment des auditions.
Le dossier relatif à l'assassinat, le 7 avril 1994, des 3 coopérants belges (dossier nº 58/95) lui a aussi été confié au juge d'instruction sur la base de ce critère de rattachement.
soit lorsque l'auteur présumé d'un fait pouvait être de nationalité belge.
Le juge d'instruction a ainsi spécifiquement évoqué les investigations menées à l'encontre de M. Georges Ruggiu dans le cadre de ses activités à la radio RTLM.
4º la compétence universelle des juridictions belges susvisée (et ce à titre exceptionnel);
Cette instruction concerne un dossier dans lequel les plaignants étaient belges. L'une des personnes visées par la plainte était susceptible de se rendre sur notre territoire (dossier nº 38/95).
Le juge d'instruction a expliqué que la répartition des affaires en 10 dossiers distincts permettait une meilleure gestion procédurale. De la sorte, les instructions qu'il estimait terminées pouvaient être transmises au procureur du Roi dans l'espoir d'un suivi et sans devoir attendre que toutes les enquêtes soient clôturées.
Chaque dossier d'instruction est par ailleurs complet, le juge ayant pris soin de déposer les copies de chaque procès-verbal intéressant son enquête dans le dossier concerné par celle-ci.
L'objet de son travail est, en qualité de juge qui instruit à charge et à décharge, de recueillir un maximum d'éléments qui pourront, le cas échéant, fonder ultérieurement des preuves de culpabilité.
L'objectif d'une instruction est de permettre la tenue d'un procès et non de légitimer obligatoirement des condamnations. Le juge d'instruction a ainsi rappelé à la commission qu'un verdict d'acquittement est aussi une manière de rendre la justice.
Le magistrat a disposé d'une cellule de 5 enquêteurs de la police judiciaire, tandis que le substitut de l'auditorat militaire Verelst était délégué au parquet du procureur du Roi dans un souci d'efficacité. Le travail réalisé par les enquêteurs et par les magistrats est d'une ampleur considérable. Le dossier relatif à l'assassinat des 10 paracommandos (dossier nº 57/95) contient à lui seul près de 40 classeurs.
Globalement, les devoirs d'enquête ont été les suivants :
audition de nombreux témoins en Belgique où la communauté rwandaise est importante,
audition des plaignants,
3 séjours au Rwanda sous forme de commission rogatoire : 15 jours en mai 1995, 3 semaines en juin 1995 et 3 semaines en septembre et octobre 1995 (visite des lieux et très nombreuses auditions),
1 commission rogatoire en décembre 1995 au Togo à l'effet d'auditionner le capitaine togolais Apedo (audition dans le cadre de l'assassinat de 10 paracommandos : le capitaine Apedo, en sa qualité de représentant de l'ONU avait un bureau au camp de Kigali et avait pour mission de contrôler les armes; il disposait de la clé de l'armoire où celles-ci devaient être entreposées; cette armoire avait été forcée le 7 avril 1994 avant l'assassinat des 10 militaires),
1 commission rogatoire ayant abouti à l'audition de soldats ghanéens et ce, toujours en relation avec l'assassinat des 10 paracommandos,
d'autres commissions rogatoires ont été diligentées et réalisées; elles concernaient l'ensemble des dossiers d'instruction (on pense notamment à celle acheminée à l'ONU concernant l'audition du général Dallaire).
Le magistrat a signalé avoir rencontré diverses difficultés dans le cadre de l'exécution des commissions rogatoires au Rwanda. Ces difficultés étaient liées à l'instabilité politique dans ce pays. Indépendamment de ces difficultés, le magistrat et ses enquêteurs ont disposé d'une grande liberté d'action et de mouvement pour exécuter les devoirs qu'ils estimaient opportuns de réaliser. Le rythme de travail était très élevé et la première commission rogatoire a permis la rédaction de plus de 100 auditions.
Le travail réalisé par le magistrat et par son équipe était, selon lui cependant, difficilement traduisible au travers de procès-verbaux à l'occasion desquels la restitution d'un contexte se heurte à la faiblesse des mots...
Le magistrat a travaillé dans plusieurs enquêtes en parallèle avec le TPI. Son travail a fait l'objet d'une transmission régulière au TPI à la première demande de celui-ci. À plusieurs reprises, une copie des dossiers a été mise à la disposition du TPI de manière officieuse et ce, dans un but de rapidité, d'efficacité et de bonne coopération réciproque. De son côté en effet, le juge d'instruction souhaite être éclairé sur les devoirs d'enquête réalisés à l'initiative du TPI. Ainsi, une double commission rogatoire a été adressée au TPI de manière officielle par l'intermédiaire du ministre des Affaires étrangères, d'une part, de manière pragmatique auprès du bureau du procureur général du TPI, d'autre part, et ce, afin de ménager d'éventuelles susceptibilités.
Le TPI a donc repris lui-même certaines enquêtes en vue de poursuites :
ainsi, le TPI a évoqué les poursuites à charge de M. Bagosora, inculpé par le juge d'instruction, et qui a fait l'objet d'un mandat d'arrêt international dans le cadre du dossier relatif à l'assassinat des 10 Casques bleus (dossier nº 57/95).
La Cour de cassation a dessaisi le juge d'instruction par arrêt du 9 juillet 1996 et le TPI semble vouloir fixer cette affaire au mois de septembre 1998.
Le juge d'instruction reste cependant saisi des faits relatifs aux autres personnes concernées par son instruction, notamment M. N.B.; le TPI appartient en effet à l'ordre juridique belge et ce n'est donc qu'à l'égard du colonel Bagosora que le juge d'instruction est formellement dessaisi; une copie intégrale du dossier répressif a été transmise sans désemparer au TPI; c'est sur la base du mandat d'arrêt international délivré précédemment par le juge Vandermeersch que le TPI a pu faire écrouer M. Bagosora à Arusha.
Le TPI a évoqué l'ensemble du dossier qui concerne RTLM dans lequel Georges Ruggiu avait été inculpé (dossier nº36/95). La Cour de cassation avait dessaisi le magistrat belge par arrêt du 6 octobre 1996. Suite à cette évocation, un complément d'enquête est réalisé par le TPI; il a permis l'arrestation de Ferdinand Nahimana. M. Georges Ruggiu fut, quant à lui, arrêté à Nairobi, au Kenya, au mois de juillet 1997.
Le dossier relatif aux faits de Butaré (dossier nº 37/95) a fait l'objet d'une évocation partielle. À l'occasion de son instruction, le magistrat avait décerné 4 mandats d'arrêt. Le TPI a évoqué le dossier pour 3 d'entre eux : M. Higaniro Alphonse, M. Kanyabashi Joseph et M. Ndayambaye Elie. L'arrêt de dessaisissement a été prononcé par la Cour de cassation le 31 mai 1996. Le TPI a cependant réorienté ultérieurement M. Higaniro vers la Belgique. Ces détours procéduraux ont entraîné une scission des poursuites dans la mesure où, entre-temps, la chambre du conseil avait été saisie d'un réquisitoire de non lieu à l'encontre de M. Vincent Ntezimana. Une ordonnance de prise de corps, suite au réquisitoire verbal de renvoi réalisé par le substitut Verelst, a en effet été rendue contre lui par la chambre du conseil le 22 juillet 1997.
En ce qui concerne M. Higaniro, l'enquête a repris pour se terminer par une communication à toutes fins au parquet le 27 septembre 1996. En ce qui concerne ce dernier volet, aucun réquisitoire du parquet n'a été rédigé à ce jour. Comme il a déjà précédemment été expliqué, cette absence de réquisitoire bloque de fait le suivi de la procédure contre M. Ntezimana dès lors que le parquet général souhaite qu'il soit statué par un seul et même arrêt sur le renvoi éventuel des intéressés devant la Cour d'assises de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles-Capitale.
Globalement, le magistrat instructeur, à 2 ou 3 exceptions près, estimait son travail terminé lors de sa première audition par la commission d'enquête, soit en mai 1997. L'ensemble des dossiers terminés, se trouvait déjà transmis à toutes fins au procureur du Roi, comme le veut le prescrit de la loi pénale.
En ce qui concerne l'exécution de sa mission, le juge d'instruction a attiré l'attention de la commission sur les recherches réalisées par lui en soulignant qu'il n'avait pas limité celles-ci à la détermination d'éventuels exécutants matériels des assassinats commis sur les 10 Casques bleus. Il a, avec ses enquêteurs, tenté de dégager d'autres responsabilités pénales éventuelles, lesquelles se situent à d'autres niveaux. Ses investigations ont tenu compte du contexte fort large dans lequel les événements se sont déroulés au Rwanda et qui ont été qualifiés, par certains, de génocide, dimension dont les enquêteurs belges ont tenu compte dans le cadre de leur enquête.
C. En ce qui concerne la détermination à mener à terme les procès en Belgique
Le magistrat instructeur a fait état de ses craintes réelles quant à une volonté de mener les procès en Belgique. Il relève, au-delà de l'important travail réalisé, qu'un verdict d'acquittement est aussi une manière de rendre la justice. Son souhait n'est autre que de voir le juste aboutissement, au travers d'un débat contradictoire, du travail d'instruction réalisé jusqu'ici. Le magistrat a signalé à la commission qu'il avait eu le sentiment de servir d'alibi et de gêner, par sa détermination, les instigateurs habituels des procédures judiciaires.
Les exemples qu'il a donnés en commission pour étayer son propos peuvent être déduits des éléments suivants :
les dossiers communiqués au parquet, souvent depuis 1996 et parfois, même, 1995, n'ont pas fait l'objet de réquisitoires;
le dossier de Butare (nº 37/95) a donné lieu à une ordonnance de la chambre du conseil au mois de juillet 1996; la deuxième partie du dossier a été clôturée deux mois plus tard, soit en septembre 1996 : là aussi, aucun réquisitoire ne permet d'avancer;
trois dossiers ont été transférés au TPI sans qu'aucune interpellation quant à une date réelle de fixation n'ait été demandée par les autorités belges;
le substitut Verelst a été chargé des dossiers qui concernent l'ex-Yougoslavie et lui-même, dès le mois de décembre 1995, soit après 7 mois d'enquête, s'est vu confier de nouvelles affaires; 400 nouveaux dossiers ont ainsi été déférés à son cabinet en 1996. Évoquant les dossiers du Rwanda, le magistrat se demande dès lors comment il est encore possible de les qualifier de dossiers prioritaires. Cette surcharge de travail, certes légitime quand on connaît l'encombrement des juridictions bruxelloises touchées par un manque d'effectifs réel, suscite néanmoins son scepticisme et sa déception;
c'est, in fine , le seul dossier relatif à l'assassinat de trois coopérants belges (dossier nº 58/95) qui a jusqu'ici abouti, les faits ayant été régulièrement dénoncés aux autorités rwandaises après enquête en vue de poursuites.
Le magistrat s'est vu opposer des remarques relatives aux difficultés matérielles d'organiser les procès en Belgique. De fait, les procédures devant la Cour d'assises sont des procédures orales et la comparution des témoins pose des questions d'organisation et de financement réelles.
D. En ce qui concerne les suites d'enquête au cours des six derniers mois
Le 26 septembre 1997, le juge d'instruction Vandermeersch a à nouveau été appelé par la commission d'enquête, qui souhaitait connaître l'évolution des dossiers en cours.
Globalement, aucune évolution significative n'a été notée. Tout au plus, le juge d'instruction a-t-il fait savoir que l'enquête se poursuivait activement dans le cadre du dossier, demeuré belge, qui concernait l'assassinat de trois coopérants (dossier nº 58/95).
En ce qui concerne les réquisitoires attendus depuis les communications des dossiers à toutes fins, le juge d'instruction a fait état de la désignation d'un nouvel avocat général pour l'ensemble des dossiers. Il s'agit de M. Wynant, qui succède ainsi à M. de Codt, nommé conseiller à la Cour de cassation au mois de juin 1997.
Les suites réelles d'enquête pour les autres dossiers se résument à ce qui suit :
le dossier nº 48/95 : des informations arrivent quotidiennement au magistrat et font l'objet d'analyses; des informations concernant M. Rwabukumba sont donc à l'étude;
le dossier relatif à M. Bagosora (dossier nº 57/95) : le juge d'instruction s'est mis en rapport avec le magistrat national Duinslaeger qui assure la transmission des dossiers entre autorités judiciaires et Ministère des Affaires étrangères. En effet, M. Ntuyahaga, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international délivré par le juge d'instruction, a été localisé en Zambie.
Le magistrat craint le peu d'intérêt des Zambiens dans le cadre de cette affaire et a même fait appel au pouvoir politique de la commission d'enquête pour tenter de rendre cette procédure réellement prioritaire;
24 personnes sont actuellement détenues à Arusha et le magistrat souhaiterait en interroger une dizaine. Parmi les auditions importantes, il pense à celles de M. Ferdinand Nahimana, responsable de RTLM, du colonel Bagosora par rapport à l'assassinat des Casques bleus, de M. Georges Ruggiu, toujours dans le cadre de RTLM. Il a ainsi rédigé une commission rogatoire destinée à obtenir l'audition de 12 personnes. Celle-ci fut envoyée deux fois par la voie officielle du Ministère des Affaires étrangères dans un premier temps, au TPI. Le juge d'instruction a reçu le feu vert du procureur du Roi, du procureur général et du ministre de la Justice dans le cadre de cette commission. Il attend à l'heure actuelle le feu vert des autorités tanzaniennes et du TPI. Ses craintes viennent du fait que le TPI est déjà apparu « jaloux de ses informations préférant les utiliser dans ses procès publics avant de les divulguer aux autres autorités concernées. Les procès du TPI étant longs, le délai risquerait alors de compromettre sérieusement la bonne fin de la mission du juge d'instruction. Celui-ci a donc préféré à titre presque diplomatique solliciter des auditions à titre de simples renseignements dont le formalisme est moins long. Un récent entretien avec le président Kama du TPI lui a paru de bonne augure. Mme le procureur général Harbor ne lui a cependant pas encore réservé de réponse favorable. Officieusement, le juge, malgré un scepticisme que la position de Mme Harbor justifie, espérait se rendre à Arusha dans le courant du mois de décembre 1997.
Entre 1990 et 1994 la Belgique a entretenu avec le Rwanda une politique de coopération au développement très importante.
Dans son audition du 26 mars 1997 le ministre E. Derycke déclare :
« Le budget pour le Rwanda n'était d'ailleurs pas négligeable. L'aide prise en compte par l'OCDE pour le calcul de la norme de 0,7 % était de 1,528 milliard en 1990, de 1,927 milliard en 1991 et respectivement de 1,4 et 1,2 milliard en 1992 et 1994. Ce montant comprend entre autres les coûts administratifs ainsi que la coopération militaire et financière » (392c).
La commission s'est interrogée sur la répartition des aides octroyées pendant cette période.
Elle s'est penchée aussi sur l'utilisation des fonds mis à disposition par le régime rwandais.
3.14.1.1. Coopération multilatérale et coopération internationale
Cette coopération reprend entre autres les organisations internationales, la Banque africaine de développement, les aides alimentaires, etc.
Les dépenses en millions de francs de 1990 à 1994 se sont élevées à :
3.14.1.2. Coopération bilatérale directe
À savoir, projets et interventions, coopération financière, Office national du Ducroire , bourses, etc.
Les dépenses en millions de francs de 1990 à 1994 se sont élevées à :
En outre en 1990 et 1993 il y a eu un programme spécial d'assistance dont la contribution belge était :
Une aide à la balance de paiement de 500 millions (dont 200 millions de 1989 avec effet rétroactif).
Dans le cadre de SPA II :
un virement de 400 millions à la Banque mondiale et 200 millions d'aide directe au Rwanda avec notification.
Ce qui fait un total de 1 milliard 100 millions dont 700 millions directement contrôlés par la Belgique.
On doit ajouter aussi le financement de la MINUAR pour un montant de 200 millions de francs en 1994.
3.14.1.3. Coopération bilatérale indirecte
Ce budget couvre les dépenses des ONG, de l'APEFE/VVOB, la coopération universitaire, l'aide d'urgence etc.
Le total de ces dépenses s'élève à (en millions de francs) :
La commission s'est plus particulièrement intéressée au nombre d'ONG présentes sur le terrain de 1990 à 1994 et à leurs dépenses.
Ci-après figure la liste des ONG (et leur nature) :
| Jaar Année |
GPP | Nr. Dos Nº Dos |
NGO ONG |
Omschrijving Libellé |
Lokale partner Partenaire local |
Bedrag Montant |
| 1990 | 1127/21 | 85/037 | AGAT | Construction, équipement artisans handicapés / Gatagara | 223 256 | |
| Total | 1 | 223 256 | ||||
| 1631/06 | 89/000 | AADC | Maternité / Gisenyi | 7 499 362 | ||
| 1619/27 | 89/007 | AADC | Amélioration matériau construction argile préfab. / Gisenyi | 1 811 865 | ||
| 1619/29 | 89/009 | AADC | Artisanats divers 12 menuiseries & 6 forges / Gisenyi | 3 046 779 | ||
| 1407/68 | 87/000 | AADC | Construction marché couvert / Kabaya | 3 564 165 | ||
| 1619/28 | 89/008 | AADC | Construction de 5 magasins et 2 silos / Gisenyi | 1 680 690 | ||
| Total | 5 | 17 602 861 | ||||
| 1537/26 | 88/012 | BD | Sociale Inzet en Dienstverlening / Kigali | 876 898 | ||
| 1284/65 | 86/004 | BD | Centrum Ontwikkeling / Gikoro | 2 411 162 | ||
| 1353/84 | 87/003 | BD | Centre de formation permanente / Rutongo | 1 930 645 | ||
| 1629/97 | 89/019 | BD | Watervoorraad / Mwendo-Satinsyi-Nyakabanda-Muganza | 4 459 318 | ||
| 1353/31 | 86/008 | BD | Landelijke Animatie / Gisenyi/Kibuye/Cyangugu | 1 679 858 | ||
| 1029/69 | 84/002 | BD | Uitrusting Centrum Beroepsvorming / Caculiro Kigali | 2 614 110 | ||
| Total | 6 | 13 971 991 | ||||
| 1407/66 | 87/034 | DELIPRO | Bicep Rwanda | 1 420 650 | ||
| 1543/69 | 88/016 | DELIPRO | Adduction d'eau centre / Kabuga | 611 197 | ||
| Total | 2 | 2 031 847 | ||||
| 1537/60 | 88/039 | NCOS | Verbeterde Baksteen- en Dakpannenproductie / Kigali | 2 264 495 | ||
| 1537/62 | 88/040 | NCOS | Streekontwikkeling / Zuid-Gisaka | 4 465 450 | ||
| 1670/14 | 89/056 | NCOS | 4 Vormingscentra Alfabetizering / Kigembe | 1 218 680 | ||
| 1403/55 | 87/021 | NCOS | Inrichting Kleine Bronnen | 7 095 602 | ||
| Total | 4 | 15 044 227 | ||||
| 1543/83 | 88/013 | CP | Appui agriculture construction silo /Karama | 429 825 | ||
| Total | 1 | 429 825 | ||||
| 1350/32 | 86/011 | COOPIBO | Uitrusting Dienstencentrum Coöperatieven / Gitarama | 2 887 087 | ||
| 1352/30 | 86/012 | COOPIBO | Landbouwontwikkeling / Muganza | 2 888 250 | ||
| 1350/32 | 86/011 | COOPIBO | Uitrusting Dienstencentrum Coöperatieven / Gitarama | 3 307 837 | ||
| Total | 3 | 9 083 174 | ||||
| 1631/58 | 89/000 | CRBAI | Centre formation agro-pastoral / Kacyiru II | 4 252 500 | ||
| 1671/60 | 89/038 | CRBAI | Transfusion sanguine sida / Kigali | 3 675 000 | ||
| 1631/59 | 89/037 | CRBAI | Centre social éducatif / Kacyiru I | 3 675 000 | ||
| Total | 3 | 11 602 500 | ||||
| 1127/53 | 85/028 | KBA | Vorming Basisanimatoren / Ruhengeri/Nyumba | 3 150 000 | ||
| Total | 1 | 3 150 000 | ||||
| 1351/79 | 88/050 | SOLPROT | Centre polyvalent développement agricole / Rubavu | 2 085 943 | ||
| Total | 1 | 2 085 943 | ||||
| 1248/67 | 85/050 | SM | Construction, équipement centre formation CECOTRAD / Kigali | 7 500 000 | ||
| 687/85 | 83/029 | WS | Bouw Uitrust. Werking 8 Vormingscentra / Kigali | 184 983 | ||
| Total | 2 | 7 684 983 | ||||
| 1543/54 | 88/033 | SOSF | Vulgarisation apiculture | 1 901 026 | ||
| 1543/55 | 88/034 | SOSF | Adduction d'eau / Mukura | 2 809 855 | ||
| Total | 2 | 4 710 881 | ||||
| 1351/71 | 86/044 | SOSPG | Centre socio-pastoral / Cyangugu | 2 024 900 | ||
| Total | 1 | 2 024 900 | ||||
| 1631/66 | 89/075 | SOSL | Centre de santé de Mudasamwa / Gikongoro | 441 000 | ||
| Total | 1 | 441 000 | ||||
| 1350/23 | 86/044 | VIWOS | Landbouwontwikkeling jonge landbouwers Rutongo | 571 315 | ||
| Total | 1 | 571 315 | ||||
| 1544/57 | 88/016 | CARAES | Meisjesinternaat / Butare | 1 221 525 | ||
| Total | 1 | 1 221 525 | ||||
| 795/04 | 89/001 | ACT | Onthaal- en vormingscentrum kansarmen / Kigombe | 5 800 227 | ||
| 1631/13 | 89/002 | ACT | Beroepsvorming Vrouwen / Ngoma/Butare | 769 261 | ||
| Total | 2 | 6 569 488 | ||||
| Total | 1990 | 37 | 98 449 716 | |||
| 1991 | 1816/96 | 90/052 | ABRWA | Dispensaire Muyunzwe Masango | 2 274 821 | |
| 1816/95 | 90/056 | ABRWA | Centre de santé / Rusatira | 4 296 519 | ||
| Total | 2 | 6 571 340 | ||||
| 1631/06 | 89/000 | AADC | Maternité / Gisenyi | 3 750 718 | ||
| Total | 1 | 3 750 718 | ||||
| 1537/26 | 88/012 | BD | Sociale Inzet en Dienstverlening / Kigali | 974 185 | ||
| 1619/23 | 89/017 | BD | Centrum ontwikkeling en permanente vorming / Rubungo | 2 258 865 | ||
| 1537/01 | 88/011 | BD | Centre communal pour développement & formation / Kanombe | 1 654 296 | ||
| 1029/69 | 84/002 | BD | Uitrusting Centrum Beroepsvorming / Caculiro Kigali | 2 922 412 | ||
| Total | 4 | 7 809 758 | ||||
| 1619/31 | 88/000 | DELIPRO | Construction pont / Ruhondo | 415 944 | ||
| Total | 1 | 415 944 | ||||
| 1537/62 | 88/040 | NCOS | Streekontwikkeling / Zuid-Gisaka | 2 536 718 | ||
| 1402/47 | 87/020 | NCOS | Watervoorzieningen 6 Gemeenten | 6 126 486 | ||
| Total | 2 | 8 663 204 | ||||
| 1543/83 | 88/013 | CP | Appui agriculture construction silo / Karama | 436 500 | ||
| Total | 1 | 436 500 | ||||
| 1352/30 | 86/012 | COOPIBO | Landbouwontwikkeling / Muganza | 2 304 562 | ||
| 1670/12 | 89/029 | COOPIBO | Versterking van coöperatieve groepen / Cyangugu | 4 317 566 | ||
| Total | 2 | 6 622 128 | ||||
| 795/02 | 88/001 | COMIDE | École technique / Kicukiru | 1 417 500 | ||
| 1619/10 | 89/032 | DMOS | Winning Van Zonnebloemolie / Kanama | 1 575 315 | ||
| 1619/12 | 89/033 | DMOS | Vormingscentrum / Gisenyi | 2 481 662 | ||
| 795/02 | 88/001 | COMIDE | École technique / Kicukiru | 1 417 500 | ||
| Total | 4 | 6 891 977 | ||||
| 1781/45 | 90/024 | FAR | Atelier fabrication de chaussures / Kanama | 631 219 | ||
| Total | 1 | 631 219 | ||||
| 1537/27 | 88/036 | KBA | Vorming plattelandsanimatrices / Kinazi | 945 000 | ||
| Total | 1 | 945 000 | ||||
| 1543/61 | 88/025 | OXFAM | Production & stockage pommes de terre Kanana Mutara Mukingo | 1 526 250 | ||
| Total | 1 | 1 526 250 | ||||
| 1629/04 | 89/000 | SOLPROT | Adduction d'eau / Gitesi | 835 446 | ||
| 1671/76 | 90/073 | SOLPROT | Watervoorziening / Kigituntu-Mwendo | 3 719 474 | ||
| 1671/92 | 90/074 | SOLPROT | Watervoorziening / Nyakabingo-Gitesi | 3 690 288 | ||
| 1671/85 | 90/000 | SOLPROT | Adduction eau Shyorongi / Muhondo Bwenda | 3 454 936 | ||
| Total | 4 | 11 700 144 | ||||
| 1797/86 | 90/004 | WS | Promotie Kansarme Vrouwen / Nyamirambo | 1 013 337 | ||
| Total | 1 | 1 013 337 | ||||
| 1817/12 | 90/010 | WV | Oprichting ophtalmologogische afdeling / Kabinda | 318 937 | ||
| Total | 1 | 318 937 | ||||
| 1619/81 | 89/040 | EF | Amélioration des pâturages / Gikongoro | 1 134 788 | ||
| Total | 1 | 1 134 788 | ||||
| 1816/97 | 90/059 | FR | Reprise accélération vaccination polio | 6 316 994 | ||
| Total | 1 | 6 316 994 | ||||
| 1816/94 | 90/040 | SLCD | 6 adductions d'eau potable : Volet 6 / Nyabisusa | 2 389 376 | ||
| 1781/25 | 90/036 | SLCD | 6 adductions d'eau potable : Volet 2 / Kayange | 2 757 572 | ||
| 1671/88 | 90/034 | SLCD | 6 adductions d'eau potable : Volet 5 / Ntarabana | 661 034 | ||
| 1671/73 | 90/032 | SLCD | 6 adductions d'eau potable : Volet 3 / Kajagi | 951 134 | ||
| 1671/89 | 90/000 | SLCD | 6 adductions d'eau potable : Volet 4 / Rwinzovu | 363 979 | ||
| 1781/26 | 90/037 | SLCD | 6 adductions d'eau potable : Volet 1 / Kivumu | 475 870 | ||
| Total | 6 | 7 598 965 | ||||
| 1629/13 | 89/017 | CIFCD | Promotion centre scouts / Kigali | 3 126 750 | ||
| 1543/79 | 88/000 | CIFCD | Promotion scouts Développement rural | 2 611 571 | ||
| 1781/72 | 90/053 | CIFCD | Centres scouts de développement rural / Ruhengera | 2 519 550 | ||
| Total | 3 | 8 257 871 | ||||
| 1407/70 | 89/051 | NORDSUD | Institut St. Fidèle (87/54) / Gisenyi | 1 188 839 | ||
| 1630/88 | 89/051 | NORDSUD | Formation d'infirmières / Kabaya | 3 176 250 | ||
| Total | 2 | 4 365 089 | ||||
| 795/06 | 89/060 | OCIRIZ | Landbouwontwikkeling Volwassenen / Kamonyi | 1 266 678 | ||
| Total | 1 | 1 266 678 | ||||
| 1817/03 | 90/023 | FAED | Appui à action de formation agricole / Kansi Butare | 1 811 895 | ||
| 1817/01 | 90/000 | FAED | Formation jeunes désoeuvrés / Rwamagana, Rutonde | 1 007 613 | ||
| Total | 2 | 2 819 508 | ||||
| Total | 1991 | 42 | 89 056 349 | |||
| 1992 | 944/02 | 89/054 | AGAT | Renforcement des soins et formation handicapés | 3 257 176 | |
| 1127/21 | 85/037 | AGAT | Construction, équipement artisans handicapés / Gatagara | 308 503 | ||
| Total | 2 | 3 565 679 | ||||
| 1998/60 | 90/129 | DAM | Nationaal programma lepra- en TBC bestrijding / Kigali | 3 683 475 | ||
| Total | 1 | 3 683 475 | ||||
| 1816/96 | 90/052 | ABRWA | Dispensaire Muyunzwe Masango | 2 264 012 | ||
| 1543/83 | 88/013 | CP | Appui agriculture construction silo / Karama | 462 600 | ||
| Total | 2 | 2 726 612 | ||||
| 1619/30 | 89/000 | AADC | Marché couvert / Ngororero | 4 789 776 | ||
| Total | 1 | 4 789 776 | ||||
| 1619/23 | 89/017 | BD | Centrum ontwikkeling en permanente vorming / Rubungo | 2 040 534 | ||
| 56002/14 | 22/014 | BD | Nat. Vormingsprogr. Landbouwers & Landbouwanimatoren | INADES | 3 294 000 | |
| 56002/15 | 22/015 | BD | Uitbouw 3 Gemeentel. Centra Voor Ontw. & Perm. Vorm. / Kigali | 4 490 795 | ||
| 1619/78 | 89/018 | BD | Beroepsopleiding Drukkers / Kigali | 469 822 | ||
| 1816/36 | 90/014 | BD | Beroepsopleiding marginale Jongeren / Gisenyi | 3 535 277 | ||
| 1816/38 | 90/015 | BD | Ambachtelijke Coöperatieve Kiaka / Kanama | 2 580 660 | ||
| Total | 6 | 16 411 088 | ||||
| 1537/60 | 88/039 | NCOS | Verbeterde Baksteen- en Dakpannenproductie / Kigali | 2 377 558 | ||
| 56006/23 | 26/023 | NCOS | Steun Aan Lokale Organisaties CCOAIB | 2 461 732 | ||
| 56006/22 | 26/022 | NCOS | Gedelegeerd Fondsen voor ARDI | 4 520 799 | ||
| Total | 3 | 9 360 089 | ||||
| 56003/12 | 23/012 | COOPIBO | Uitwisselingsseminarie duurzame landbouw / Butare | 1 407 506 | ||
| 56003/14 | 23/014 | COOPIBO | Landbouwprojekt Muganza | Gemeente Muganza | 4 387 901 | |
| 1670/12 | 89/029 | COOPIBO | Versterking van coöperatieve groepen / Cyangugu | 5 031 121 | ||
| Total | 3 | 10 826 528 | ||||
| 1631/58 | 89/000 | CRBAI | Centre formation agro-pastoral / Kacyiru II | 1 784 885 | ||
| 1631/59 | 89/037 | CRBAI | Centre social éducatif / Kacyiru I | 3 675 000 | ||
| 1671/60 | 89/038 | CRBAI | Transfusion sanguine sida / Kigali | 3 675 000 | ||
| Total | 3 | 9 134 885 | ||||
| 1781/48 | 90/054 | COMIDE | Action sanitaire nationale / Bufmar | 4 616 850 | ||
| 1781/73 | 90/019 | COMIDE | Centre formation jeunesse désoeuvrée / Ngoma | 3 582 351 | ||
| Total | 2 | 8 199 201 | ||||
| 1821/75 | 92/113 | DISOP | Beroepsopleiding Vrouwen / Ngoma | 308 685 | ||
| Total | 1 | 308 685 | ||||
| 1781/45 | 90/024 | FAR | Atelier fabrication de chaussures / Kanama | 757 380 | ||
| Total | 1 | 757 380 | ||||
| 56005/28 | 25/028 | FOS | Plattelandsontwikkeling Via Boerenorganisaties | 1 733 805 | ||
| Total | 1 | 1 733 805 | ||||
| 1537/27 | 88/036 | KBA | Vorming plattelandsanimatrices / Kinazi | 945 000 | ||
| Total | 1 | 945 000 | ||||
| 1543/61 | 88/025 | OXFAM | Production & stockage pommes de terre / Kanana Mutara Mukingo | 800 250 | ||
| Total | 1 | 800 250 | ||||
| 1671/85 | 90/000 | SOLPROT | Adduction eau Shyorongi / Muhondo Bwenda | 1 359 938 | ||
| 1351/79 | 88/050 | SOLPROT | Centre polyvalent développement agricole / Rubavu | 1 041 856 | ||
| Total | 2 | 2 401 794 | ||||
| 1998/70 | 89/000 | SM | Poulailler / Runda | 1 726 624 | ||
| Total | 1 | 1 726 624 | ||||
| 1816/70 | 90/058 | SOSF | Promotion élevage caprin et appui apiculture / Musambira | 626 807 | ||
| 1816/69 | 90/057 | SOSF | Promotion petit élevage système de crédit | 846 870 | ||
| 1543/54 | 88/033 | SOSF | Vulgarisation apiculture | 2 044 901 | ||
| Total | 3 | 3 518 578 | ||||
| 1350/23 | 86/044 | VIWOS | Landbouwontwikkeling jonge landbouwers Rutongo | 582 305 | ||
| Total | 1 | 582 305 | ||||
| 1619/81 | 89/040 | EF | Amélioration des pâturages / Gikongoro | 1 058 400 | ||
| Total | 1 | 1 058 400 | ||||
| 1543/81 | 88/003 | CIFCD | Briques menuiserie /Kibogora | 507 375 | ||
| 1781/70 | 90/051 | CIFCD | École santé publique / Mudende | 4 764 318 | ||
| Total | 2 | 5 271 693 | ||||
| 1629/99 | 89/050 | NORDSUD | Extension du collège technique / Kibihekane Rambura | 2 764 250 | ||
| 1671/74 | 90/050 | NORDSUD | Adduction en eau potable / Cyavumu-Cyangugu | 7 282 260 | ||
| 1630/88 | 89/051 | NORDSUD | Formation d'infirmières / Kabaya | 3 671 250 | ||
| 1629/99 | 89/050 | NORDSUD | Extension du collège technique / Kibihekane Rambura | 4 075 000 | ||
| Total | 4 | 17 792 760 | ||||
| 56001/11 | 21/011 | ACT | Produktie Samengestelde Kindervoeding / Kansi | 1 737 456 | ||
| 795/04 | 89/001 | ACT | Onthaal- en vormingscentrum kansarmen / Kigombe | 1 066 505 | ||
| Total | 2 | 2 803 961 | ||||
| 795/06 | 89/060 | OCIRIZ | Landbouwontwikkeling Volwassenen / Kamonyi | 443 635 | ||
| Total | 1 | 443 635 | ||||
| 1629/06 | 89/000 | FAED | Cuisines / Gatagara | 1 563 899 | ||
| 1817/02 | 90/055 | ASO | Formation professionnelle des jeunes | 1 659 257 | ||
| Total | 2 | 3 223 156 | ||||
| Total | 1992 | 47 | 112 065 359 | |||
| 1993 | 944/02 | 89/054 | AGAT | Renforcement des soins et formation handicapés | 3 599 266 | |
| 1127/21 | 85/037 | AGAT | Construction, équipement artisans handicapés / Gatagara | 285 761 | ||
| Total | 2 | 3 885 027 | ||||
| 56004/19 | 24/019 | DAM | Lepra- en tuberculosebestrijding / Rwanda | 1 711 198 | ||
| Total | 1 | 1 711 198 | ||||
| 1816/95 | 90/056 | ABRWA | Centre de santé / Rusatira | 1 198 700 | ||
| Total | 1 | 1 198 700 | ||||
| 1619/22 | 89/016 | BD | Bouw en uitrusting CCDFP / Muganza | 548 809 | ||
| 56002/14 | 22/014 | BD | Nat. Vormingsprogr. Landbouwers & Landbouwanimatoren | INADES | 3 458 700 | |
| 1619/78 | 89/018 | BD | Beroepsopleiding Drukkers / Kigali | 2 277 026 | ||
| 1537/01 | 88/011 | BD | Centre communal pour développement & formation / Kanombe | 960 675 | ||
| Total | 4 | 7 245 210 | ||||
| 56006/18 | 26/018 | NCOS | Koördinatie mensenrechtenorganisaties | 2 820 040 | ||
| 56006/22 | 26/022 | NCOS | Gedelegeerd Fondsen voor ARDI | 3 885 051 | ||
| 56006/23 | 26/023 | NCOS | Steun Aan Lokale Organisaties CCOAIB | 3 112 412 | ||
| 56006/49 | 26/049 | NCOS | Opzetten mini-bedrijven voor vrouwen DUTERIMBERE | 2 127 766 | ||
| 1670/14 | 89/056 | NCOS | 4 Vormingscentra Alfabetisering / Kigembe | 1 024 982 | ||
| 1537/62 | 88/040 | NCOS | Streekontwikkeling / Zuid-Gisaka | 3 921 112 | ||
| 56006/18 | 26/018 | NCOS | Koördinatie mensenrechtenorganisaties | 2 820 040 | ||
| 56006/22 | 26/022 | NCOS | Gedelegeerd Fondsen voor ARDI | 5 439 782 | ||
| 56006/23 | 26/023 | NCOS | Steun Aan Lokale Organisaties CCOAIB | 3 112 412 | ||
| Total | 9 | 28 263 597 | ||||
| 56003/14 | 23/014 | COOPIBO | Landbouwprojekt / Muganza | Gemeente Muganza | 3 080 491 | |
| 56003/23 | 23/023 | COOPIBO | Versterking landbouwcoöperaties Gitamara | 4 687 950 | ||
| 56003/25 | 23/025 | COOPIBO | Netwerk voor landbouwdeskundigheid | 845 006 | ||
| 56003/26 | 23/026 | COOPIBO | Socio-economisch steunprogramma vrouwen / Byumba | 2 102 202 | ||
| Total | 4 | 10 715 649 | ||||
| 795/02 | 88/001 | COMIDE | École technique / Kicukiru | 1 417 500 | ||
| Total | 1 | 1 417 500 | ||||
| 56005/28 | 25/028 | FOS | Plattelandsontwikkeling Via Boerenorganisaties | 1 389 916 | ||
| Total | 1 | 1 389 916 | ||||
| 1537/27 | 88/036 | KBA | Vorming plattelandsanimatrices / Kinazi | 945 000 | ||
| Total | 1 | 945 000 | ||||
| 2138/75 | 92/020 | OXFAM | Coopérative agricole Haute Altitude / N-Rwanda | 1 632 777 | ||
| Total | 1 | 1 632 777 | ||||
| 1818/28 | 92/051 | SOLPROT | Adduction d'eau / Kamanga-Shyorongi | 1 122 298 | ||
| 1999/76 | 92/109 | SOLPROT | Watervoorziening / Muzimu-Gatare | 3 738 921 | ||
| 1351/79 | 88/050 | SOLPROT | Centre polyvalent développement agricole / Rubavu | 510 943 | ||
| 1998/82 | 91/051 | SOLPROT | Adduction d'eau / Kumubuga-Bwakira | Coforwa | 1 066 171 | |
| 1999/83 | 92/052 | SOLPROT | Adduction d'eau / Rohondo-gitesi | 3 601 882 | ||
| Total | 5 | 10 040 215 | ||||
| 2138/35 | 92/000 | SOSPG | Centre formation professionelle Frère Joséphites | 2 446 838 | ||
| Total | 1 | 2 446 838 | ||||
| 1817/12 | 90/010 | WV | Oprichting ophtalmologogische afdeling / Kabinda | 433 125 | ||
| Total | 1 | 433 125 | ||||
| 1781/70 | 90/051 | CIFCD | École santé publique / Mudende | 4 698 000 | ||
| Total | 1 | 4 698 000 | ||||
| 1630/88 | 89/051 | NORDSUD | Formation d'infirmières / Kabaya | 3 485 625 | ||
| 1671/75 | 90/060 | NORDSUD | Pont de MAZA / Rutsira-Butare | 1 700 987 | ||
| Total | 2 | 5 186 612 | ||||
| 56001/11 | 21/011 | ACT | Produktie Samengestelde Kindervoeding / Kansi | 1 633 072 | ||
| 56001/11 | 21/011 | ACT | Produktie Samengestelde Kindervoeding / Kansi | 3 225 000 | ||
| Total | 2 | 4 858 072 | ||||
| 795/06 | 89/060 | OCIRIZ | Landbouwontwikkeling Volwassenen / Kamonyi | 465 168 | ||
| Total | 1 | 465 168 | ||||
| Total | 1993 | 38 | 86 532 604 | |||
| 1994 | 2192/22 | 92/021 | AGAT | Infrastructure pour formation professionnelle | 4 565 228 | |
| Total | 1 | 4 565 228 | ||||
| 1816/36 | 90/014 | BD | Beroepsopleiding Marginale Jongeren / Gisenyi | 896 527 | ||
| 56002/14 | 22/014 | BD | Nat. Vormingsprogr. Landbouwers & Landbouwanimatoren | INADES | 3 721 635 | |
| Total | 2 | 4 618 162 | ||||
| 1670/12 | 89/029 | COOPIBO | Versterking van coöperatieve groepen / Cyangugu | 3 917 121 | ||
| 56003/14 | 23/014 | COOPIBO | Landbouwprojekt Muganza | Gemeente Muganza | 2 817 997 | |
| 56003/23 | 23/023 | COOPIBO | Versterking landbouwcoöperaties Gitarama | 4 129 500 | ||
| 56003/25 | 23/025 | COOPIBO | Netwerk voor landbouwdeskundigheid | 1 136 702 | ||
| 56003/26 | 23/026 | COOPIBO | Socio-economisch steunprogramma vrouwen Byumba | 1 415 596 | ||
| Total | 5 | 13 416 916 | ||||
| 56005/28 | 25/028 | FOS | Plattelandsontwikkeling via Boerenorganisaties | 1 626 628 | ||
| Total | 1 | 1 626 628 | ||||
| 2192/28 | 93/051 | SOLPROT | Coordination solidarité / Kigali | 1 234 075 | ||
| Total | 1 | 1 234 075 | ||||
| 1543/54 | 88/033 | SOSF | Vulgarisation apiculture | 1 019 604 | ||
| Total | 1 | 1 019 604 | ||||
| Total | 1994 | 11 | 26 480 613 | |||
| 1995 | 1998/60 | 90/129 | DAM | Nationaal programma lepra- en TBC-bestrijding / Kigali | 3 679 425 | |
| Total | 1 | 3 679 425 | ||||
| 56002/14 | 22/014 | BD | Nat. Vormingsprogr. Landbouwers & Landbouwanimatoren | INADES | 3 623 220 | |
| Total | 1 | 3 623 220 | ||||
| 56006/18 | 26/018 | NCOS | Coördinatie mensenrechtenorganisaties | 3 634 109 | ||
| 56006/22 | 26/022 | NCOS | Gedelegeerd Fondsen voor ARDI | 4 448 051 | ||
| 56006/23 | 26/023 | NCOS | Steun aan lokale organisaties CCOAIB | 4 042 412 | ||
| 56006/49 | 26/049 | NCOS | Opzetten mini-bedrijven voor vrouwen DUTERIMBERE | 3 825 000 | ||
| 56006/18 | 26/018 | NCOS | Coördinatie mensenrechtenorganisaties | 3 624 771 | ||
| 56006/22 | 26/022 | NCOS | Gedelegeerd Fondsen voor ARDI | 4 385 051 | ||
| 56006/23 | 26/023 | NCOS | Steun aan lokale organisaties CCOAIB | 3 862 412 | ||
| 56006/49 | 26/049 | NCOS | Opzetten mini-bedrijven voor vrouwen DUTERIMBERE | 2 127 766 | ||
| Total | 8 | 29 949 572 | ||||
| 56003/31 | 23/031 | COOPIBO | Duurzame landbouwontwikkeling | 3 778 650 | ||
| Total | 1 | 3 778 650 | ||||
| 1631/58 | 89/000 | CRBAI | Centre formation agro-pastoral / Kacyiru II | 1 942 500 | ||
| 1631/59 | 89/037 | CRBAI | Centre social éducatif / Kacyiru I | 3 675 000 | ||
| 1631/58 | 89/000 | CRBAI | Centre formation agro-pastoral / Kacyiru II | 1 907 500 | ||
| Total | 3 | 7 525 000 | ||||
| 56005/28 | 25/028 | FOS | Plattelandsontwikkeling Via Boerenorganisaties | 1 500 000 | ||
| Total | 1 | 1 500 000 | ||||
| 1537/27 | 88/036 | KBA | Vorming plattelandsanimatrices / Kinazi | 945 000 | ||
| Total | 1 | 945 000 | ||||
| Total | 1995 | 16 | 51 000 867 | |||
| 1996 | 1127/21 | 85/037 | AGAT | Construction, équipement artisans handicapés / Gatagara | 284 051 | |
| 944/02 | 89/054 | AGAT | Renforcement des soins et formation handicapés | 3 207 008 | ||
| Total | 2 | 3 491 059 | ||||
| 56004/19 | 24/019 | DAM | Lepra- en tuberculosebestrijding / Rwanda | 8 229 542 | ||
| Total | 1 | 8 229 542 | ||||
| 56002/14 | 22/014 | BD | Nat. Vormingsprogr. Landbouwers & Landbouwanimatoren | INADES | 2 612 633 | |
| Total | 1 | 2 612 633 | ||||
| 2527/88 | 94/106 | SOLPROT | Drinkwater / Gitesi | 4 760 545 | ||
| Total | 1 | 4 760 545 | ||||
| 1816/97 | 90/059 | FR | Reprise accélération vaccination polio | 2 621 194 | ||
| Total | 1 | 2 621 194 | ||||
| 2586/30 | 95/001 | SLCD | Appui à la COFORWA | 5 382 450 | ||
| Total | 1 | 5 382 450 | ||||
| 795/06 | 89/060 | OCIRIZ | Landbouwontwikkeling volwassenen / Kamonyi | 487 311 | ||
| Total | 1 | 487 311 | ||||
| Total | 1996 | 8 | 26 584 734 | |||
| 1997 | 3043/92 | 96/167 | ABRWA | Appui aux agriculteurs / Karama | Commune de Karama |
1 633 840 |
| Total | 1 | 1 633 840 | ||||
| 56002/14 | 2 022/014 | BD | Nat. Vormingsprogr. Landbouwers & Landbouwanimatoren | INADES | 3 259 649 | |
| Total | 1 | 3 259 647 | ||||
| 56006/66 | 2 026/066 | NCOS | Coördinatie Regio Grote Meren | NCOS Rwanda |
2 565 000 | |
| 56006/49 | 2 026/049 | NCOS | Opzetten mini-bedrijven voor vrouwen DUTERIMBERE | Duterimbere | 3 152 285 | |
| 56006/23 | 2 026/023 | NCOS | Steun aan lokale organisaties CCOAIB | Conseil concertation organis. initiatives | 3 725 000 | |
| 56006/22 | 2 026/022 | NCOS | Gedelegeerd Fondsen voor ARDI | Ardi ass. rwand. promotion dév. intégré | 3 097 600 | |
| 56006/18 | 2 026/018 | NCOS | Coördinatie mensenrechtenorganisaties | Cladho (Coll. ligues et défenses droit) | 3 608 400 | |
| Total | 5 | 16 148 285 | ||||
| 1670/12 | 89/029 | COOPIBO | Versterking van coöperatieve groepen / Cyangugu | 4 103 496 | ||
| Total | 1 | 4 103 496 | ||||
| 2834/32 | 95/171 | CRBAI | École formation technique / Kacyiru | 5 227 270 | ||
| 2834/30 | 95/169 | CRBAI | Pouponnières et écoles pré-primaires / Kacyiru | 4 653 765 | ||
| 2834/31 | 95/170 | CRBAI | Prise en charge enfants non accompagnés / Kacyiru | 6 853 586 | ||
| Total | 3 | 16 734 621 | ||||
| 2794/20 | 95/054 | OXFAM | Mission permanente de surveillance des droits de l'homme | 6 300 000 | ||
| Total | 1 | 6 300 000 | ||||
| 1999/76 | 92/109 | SOLPROT | Watervoorziening / Muzimu-Gatare | 3 571 060 | ||
| Total | 1 | 3 571 060 | ||||
| 3043/57 | 96/126 | EF | Unité de production (communication) / Kigali | Ligue des Droits | 6 466 830 | |
| Total | 1 | 6 466 830 | ||||
| Total | 1997 | 14 | 58 217 779 | |||
| 213 | 549 388 021 |
Les dépenses consacrées aux projets et actions ONG cofinancés au Rwanda pour cette période s'élève (en millions de francs) à:
3.14.1.4. Coopération militaire
Selon la déclaration du ministre Derycke, « quant à la coopération militaire, elle était inscrite au budget de la Coopération au développement, malgré que cela fait partie de la Défense nationale. Elle était pour les années 1992, 1993, 1994 de respectivement 197,4 millions et deux fois 196 millions ».
Il ajoute : « Aux Affaires étrangères, il y avait également un poste pour les bourses destinées à des militaires rwandais qui étudiaient en Belgique. Ce poste s'élevait en 1993 à 42 millions » (393c).
Des documents consultés, il résulte que la CTM était composée de 23 personnes dont :
3 à l'état-major de l'armée rwandaise;
3 à l'École supérieure militaire;
6 (dont un officier médecin) au Centre d'entraînement commando de Bigogwe.
À propos du camp de Bigogwe, la commission n'a pas pu vérifier si les coopérants militaires belges avaient été en 1992 témoins des massacres commis contre les Bagogwe.
La commission mixte de coopération militaire belgo-rwandaise n'a pu être organisée que fin juin 1993, à la suite des événements de février (offensive FPR) et de mars (rapport de la Commission des droits de l'homme).
La délégation belge était conduite par l'amiral de division, M. Verhulst, adjoint au chef d'état-major général, responsable des opérations.
De plus, il avait été convenu en 1993 que la partie rwandaise introduirait deux demandes officielles auprès des autorités belges. L'une en vue d'augmenter le nombre de coopérants militaires, l'autre portant sur une augmentation de l'ordre de 200 le nombre de mois de stage en Belgique mis annuellement à la disposition des Forces armées rwandaises.
La partie belge avait réaffirmé sa volonté de participer au processus d'intégration devant conduire à la constitution de la nouvelle armée rwandaise, point important des Accords d'Arusha.
Le lieutenant général Charlier lors de son audition du 21 avril 1997 déclare :
« Le colonel Vincent était le chef de la coopération technique militaire. Il était là avant le déploiement de la MINUAR. La CTM était source d'informations importantes sur ce qui s'était passé dans le pays entre 1990 et 1993. Lorsque la MINUAR a été installée, nous avons veillé à ce qu'elle garde ses distances envers la CTM qui soutenait les FAR.
La MINUAR devait être neutre dans ses contacts avec les FAR et le FPR. Nous avons donc demandé que les contacts entre les responsables belges de la MINUAR et ceux de la CTM soient évités. Mes contacts avec le colonel Vincent n'étaient pas fréquents. Nous avons simplement eu quelques échanges téléphoniques » (394c).
La neutralité était donc considérée comme très importante.
La commission constate que la présence simultanée d'une coopération militaire officielle et d'un contingent belge de la MINUAR pouvait être source d'interprétation ambiguë sur la neutralité de la Belgique.
La commission n'a pas trouvé de traces démontrant que l'opportunité du maintien de la CTM ait été évoquée lors de la décision de participation à la MINUAR.
3.14.2.1 Coopération multilatérale
La commission a pu entendre M. P. Galand co-auteur avec M. Michel Chossudovsky (expert en finance internationale) d'un rapport sur « L'usage de la dette extérieure du Rwanda (1990-1994). La responsabilité des bailleurs de Fonds » (voir annexe).
Cette mission a été effectuée à la demande de l'actuel gouvernement rwandais afin d'évaluer les possibilités de rééchelonnement de la dette qui atteint 90 % du produit intérieur brut.
Lors de son audition (16 mai 1997) M. P. Galand a déclaré : « Avant 1990, la structure de la dette est classiquement fondée sur des prêts à projets. Par contre, durant la deuxième période, les prêts étaient destinés à faciliter les ajustements de la balance des paiements permettant ainsi des décaissements rapides pour effectuer des achats à l'extérieur. C'est là qu'on constate une dérive dans les dépenses du Rwanda » (395c).
Au cours de la période 1990-1994, on peut penser que l'effectif de l'armée rwandaise est passé de 5 000 à 55 000 hommes. Il faut ajouter 17 000 membres de la milice civile.
Lors de son audition, M. Galand précise : « Pour ce faire, les dirigeants ont bénéficié de l'appui inconscient de bailleurs de fonds internationaux, dont la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Quant à la Belgique, le ministre Derycke a expliqué qu'elle avait fait deux décaissements de 500 et 600 millions qui avaient transité par la Banque mondiale. »
La Banque mondiale a précisé les biens qui pouvaient être achetés avec les fonds prêtés en excluant les dépenses d'armements.
« Or, dès 1990, le budget de la défense nationale va croître très vite de 3 à 8 milliards de francs rwandais à tel point qu'en 1992, les créanciers internationaux feront pression sur le Rwanda.
Le directeur de cabinet du ministre du plan attirera l'attention du gouvernement sur les risques de dépassement de la limite de 8 milliards de francs pour le budget de la défense. Afin d'éviter que la Banque mondiale ne mette un terme à l'avance de fonds, le Rwanda inscrivit alors un budget maximum de 8 milliards qui fut dépassé pour atteindre 14 milliards en fin d'année.
Les créanciers internationaux exigèrent alors que le Rwanda procède à des corrections d'ajustements de son budget, ce qu'il fit effectivement mais uniquement sur les budgets sociaux. À la même époque , le responsable africain de la Banque internationale continuait à avoir des discours rassurants quant aux efforts réalisés par le Rwanda.
C'est ainsi que la communauté internationale couvrira 90 % du déficit structurel de la balance des paiements. En 1993, 71 % du budget étaient engagés dans les dépenses d'armements. »
On peut s'interroger sur le contrôle effectué sur les dépenses par les organismes internationaux.
« Les bailleurs de fonds ont affirmé qu'en raison de la fongibilité des fonds, ils ne savaient pas ce que le Rwanda faisait effectivement des sommes prêtées. Ils se contentaient de surveiller la conformité des factures alors qu'ils auraient pourtant dû mettre sur pied un comité de suivi des ajustements structurels. Un audit indépendant était chargé d'étudier la validité des pièces fournies.
Ces études ont été faites et dénonçaient déjà à l'époque des manoeuvres du Rwanda qui présentait systématiquement la même facture à plusieurs bailleurs de fonds ou affirmait que ces fonds seraient utilisés à des biens étrangers à l'armée. On assiste à de nombreux détournements dans la présentation des chiffres du budget.
Il était ainsi courant de budgétiser des camions militaires sur le secteur du transport civil. (...)
Notre étude porte ensuite sur les documents de décaissements destinés à couvrir les dépenses d'armements durant la guerre. Il ressort de ceux-ci que les fonds qui y ont été affectés sont passés de 83 à 133 millions de dollars pour l'achat d'armes pendant la période de guerre.
Il y a eu des achats massifs, en 1992 et surtout en 1993, d'armes blanches: machettes, haches, bêches et tournevis. Le niveau de ces achats dépasse largement celui des années antérieures, ce qui permet d'établir un lien avec la préparation du génocide. En étudiant les commandes de machettes, on trouve que de nombreux civils non spécialisés dans l'achat de matériel agricole, ont servi d'intermédiaire dans ces achats. (...)
Entre 1992 et 1994, 580 tonnes d'outils ont été acquis par des commerçants non spécialisés en agriculture pour environ 725 000 dollars. On a recueilli dans les champs des génocidaires pour plus de 4 tonnes d'armes blanches. Une machette pèse à peu près un kilo. (...)
La Belgique devait s'assurer que la Banque mondiale assurait bien son contrôle. Mais nos experts financiers, notamment ceux de la coopération, n'ont pas été vigilants. La Suisse est dans le même cas. (...) »
La commission a demandé à M. Galand si l'argent de l'aide internationale avait servi à financer des génocidaires.
M. Galand de répondre : « Oui, j'en ai la certitude. Les bailleurs de fonds internationaux ont été au moins inattentifs. L'étude de la balance des comptes aboutit inexorablement à cette conclusion. Cela a été possible grâce à la fongibilité des fonds, tous les crédits étant versés au Trésor, ce qui permet aujourd'hui à chacun de prétendre que ce n'est pas sa partie du financement qui a servi mais celle des autres. »
3.14.2.2. Coopération bilatérale
Au niveau de la coopération financière et du fonds de réemploi, le chef de section Robert Schiewer, dans son rapport de la SBC (section belge de coopération) du 10 avril 1997, fait le commentaire suivant :
« La totalité des opérations et leur comptabilité ont pu être reconstituées après la guerre.
La SBC dispose de toutes les factures originales. Les sondages effectués tant par la SBC sur le plan bilatéral que par l'UE sur le plan du FBC ont toujours conclu à la matérialité et à la conformité des dépenses. Il n'y a donc pas de détournement décelable de l'aide. » (...)
Au niveau des projets, en régie ou en cogestion, le commentaire est le suivant :
« De 1990 au 7 avril 1994 aucune opération détournée des projets belges qui auraient pu être utilisés à des fins politiques extrémistes ou en liaison avec la préparation du génocide ne peut être mise en évidence.
Un incident à relever concerne une rumeur lancée à l'encontre de M. Pascal Komayombi, directeur du projet couvoir national de Rubilizi.
Au courant des années 1993-1994, la radio du FPR Muhabura a accusé cette personne d'être membre de la CDR et d'avoir distribué des machettes aux Interahamwe. Cela n'a pu ni être confirmé ni infirmé.
D'avril à septembre 1994 des comptes de la coopération ont été victimes d'opérations frauduleuses ou douteuses (escroqueries limitées pendant la débâcle) » (...)
Le chef de section termine son rapport comme suit :
« Avis général de la SBC sur d'éventuels détournements de l'aide bilatérale directe dans les événements de 1994.
Ma conviction, partagée par les collaborateurs qui se sont succédé à la section depuis le premier retour au Rwanda le 2 août 1994, est que l'aide bilatérale belge n'a pas pu être détournée de façon significative de sa destination. Les mécanismes de suivi et de contrôle, la vigilance des responsables belges dont toutes les informations jointes et les archives de la section sont les témoins, auraient fait apparaître une dérive. »
La commission s'est interrogée sur le rôle des ONG.
Le ministre Derycke fait remarquer lors de son audition que « les ONG ont uniquement été subventionnées et qu'elles ne se sont pas laissé dicter leur politique. (...)
L'aide bilatérale concernait 5 projets dans 50 secteurs avec 38 ONG et il y avait également des programmes de coopération dans le cadre de l'Europe et de l'ONU » (396c).
Lors de son audition du 16 mai 1997, à la question de savoir si certaines ONG servaient de couverture à une aide à l'armée, M. Galand répond :
« Il est grave de dire que les ONG ont pu être complices du génocide. Les ONG ont financé des rapports afin de nous alerter sur la situation au Rwanda. Elles bénéficient aussi d'une expertise historique qui a contribué à améliorer la situation sur place.
À la question de savoir si des ONG ont pu couvrir par inadvertance des gens qui se sont révélés des génocidaires, je réponds positivement (...) » (397c).
La commission s'est penchée plus particulièrement sur l'ONG Nord-Sud.
Parmi ses projets, cette ONG avait notamment celui d'envoyer des coopérants dans un collège situé dans le village natal du président Habyarimana. Ce collège était présidé par M. Bagosora. Le minerval élevé pratiqué par ce collège laissait entendre qu'il était réservé à des élites sur le plan de la fortune.
Ce projet ne paraît pas répondre à ce qu'on pourrait s'attendre d'une aide de coopération au développement.
Une instruction judiciaire est actuellement en cours concernant l'ASBL Nord-Sud. En accord avec les autorités judiciaires, la commission a décidé de ne pas interférer avec l'enquête en cours afin de ne pas gêner celle-ci.
La commission a interrogé le ministre Derycke sur ce type de coopération bilatérale directe, qui, selon certaines informations, ne serait pas un cas isolé et sur la nature exacte de certaines actions, fort éloignées de l'esprit de la coopération au développement, mais néanmoins menées par des ONG.
Le ministre Derycke répond : « La volonté du Parlement belge a été que les ONG aient beaucoup de ressources sans responsabilités. L'AGCD dut financer des projets avec contrôle post factum si possible. C'est une question de confiance.
Grosso modo, je suis partisan des ONG mais, parfois, elles ont leur agenda politique et ne sont pas neutres. Je sais très bien que les 38 ONG présentes au Rwanda avaient une certaine philosophie et que, après le changement de régime, d'autres ONG relevant d'une autre philosophie sont venues sur le terrain » (398c).
Lors de cette même audition, le ministre déclare :
« Certaines ONG étaient profondément solidaires avec la population hutue. » (...)
« Les ONG belges sont philosophiques ou politiques. Certaines ONG se sentaient mieux sous un régime plutôt qu'un autre. C'est leur droit. » (399c)
3.14.2.4. Coopération militaire
La commission s'interroge sur la possibilité d'être neutre ou d'apparaître comme tel, quand une CTM continue à exister.
Lors de son audition du 21 avril 1997, la commission a demandé au lieutenant général Charlier s'il considérait qu'une coopération technique et militaire était compatible avec une participation à une opération de « peace keeping ». « Dès août 1993, certains ministres ont déclaré que la coopération technique militaire serait développée au Rwanda après l'achèvement du processus d'Arusha. La participation belge à la MINUAR devait être un tremplin à cet effet. Mais il y avait une ambiguïté qui nous forçait à garder nos distances avec la CTM » (400c).
À la question de savoir s'il avait envisagé le retrait de la CTM, il répond : « Non, la CTM, c'était 20 personnes pour un hôpital, l'école supérieure militaire et le camp de Bigogwe » (401c).
La commission lui fait alors remarquer que s'il n'y avait pas d'intervention directe de la CTM à Bigogwe, les troupes rwandaises y subissaient cependant un entraînement, même si c'était les Français qui le dispensaient. Six Belges s'y trouvaient.
Le lieutenant général Charlier de répondre : « Oui, il y avait ambiguïté. »
La commission a alors fait remarquer au lieutenant général qu'on aurait pu suspendre la CTM. Le lieutenant général d'acquiescer.
Quant à l'efficacité de la CTM et son rôle à partir d'octobre 1990, le colonel Vincent déclare :
« En octobre 1990, la guerre éclate et les relations se refroidissent. La coopération technique et militaire belge est reléguée à un rôle de figuration. »
Le colonel Vincent va même jusqu'à préciser que les officiers et sous-officiers ne faisaient « rien ou presque » et qu'ils espéraient que « le processus de paix débloquerait la situation » (402c).
Compte tenu de tout ce qui précède, la commission s'interroge sur l'opportunité du maintien de la CTM.
La commission a également examiné l'évaluation et la présentation a posteriori, au sein de l'armée, des événements tragiques du Rwanda.
Retenons à cet égard :
la constatation qu'il n'y a eu aucun débriefing au sein des états-majors;
En tout cas, l'on n'a jamais demandé au colonel Marchal ni au colonel Dewez de participer à une ou plusieurs réunions au cours desquelles l'on a tiré les leçons des événements. Le lieutenant général Berhin a répondu devant la commission à la question de savoir si des débriefings ont été organisés : « Pas que je sache. » (403c)
la limitation de l'enquête Uytterhoeven aux militaires présents au Rwanda;
le lieutenant général Berhin a déclaré à ce sujet au cours de son audition du 29 avril 1997 : « Le ministre à l'époque a demandé au lieutenant général Charlier une enquête sur les fautes éventuelles commises au Rwanda » et « le lieutenant général Charlier était d'accord qu'il fallait chercher la cause des problèmes au Rwanda, pas au-delà » (404c); à l'exception d'une audition sommaire de l'amiral Verhulst, personne du C Ops ni, moins encore, parmi les responsables de la logistique, de la force terrestre ou de l'état-major général, n'a été interrogé; par ailleurs, la commission Uytterhoeven s'est basée exclusivement sur des auditions et n'a consulté aucun document du SGR ou du C Ops;
la constatation que cette enquête interne à la force terrestre a précisément été effectuée par le lieutenant général Uytterhoeven, qui a été impliqué dans l'opération MINUAR, puisqu'en février 1994, il a rédigé sur place un rapport d'inspection axé surtout sur les problèmes de discipline qui existaient sur place parmi les troupes belges; le lieutenant général Berhin n'y vit aucun inconvénient (405c);
la constatation que la note d'évaluation du 12 octobre 1994 a été élaborée par la division opérations de l'état-major général sous la direction de l'amiral Verhulst, sans que l'on ait pris contact, du moins selon les affirmations du colonel Marchal, avec les commandants de secteur ou de bataillon. À une question à ce sujet de la part d'un commissaire, le lieutenant général Charlier a répondu : « Si cela n'a pas été fait, c'est une erreur. » (406c) Il n'est donc pas étonnant que la note d'évaluation ne contienne pas la moindre critique sur le fonctionnement de l'état-major général ou du C Ops à Evere;
la constatation que l'aumônier Quertemont a été jusqu'à employer le mot intimidation quand il parlait des pressions exercées pour que les hommes ne dévoilent pas tout (407c); il convient encore de vérifier si l'on vise ici la même chose que le « débriefing » qu'a donné le colonel Jacqmin plus tard aux troupes : « Le colonel Jacqmin est venu faire un débriefing au niveau du bataillon. En fait, c'était plus un exposé qu'une discussion », après quoi un membre de la commission conclut : « C'était donc plutôt une justification de ce qui avait été dit ou fait. » (408c)
Enfin, la commission mentionne le rapport « Militaire studie Rwanda Kritische analyse van het verslag van de ad-hocgroep » établi le 29 août 1997 par une commission dirigée par le lieutenant général Van Hecke à la demande du ministre de la Défense nationale.
Il faut retenir de ce rapport :
la constatation que le rapport « Van Hecke » est présenté comme une analyse critique du rapport du groupe ad hoc, et ce, alors que les auteurs se sont surtout concentrés sur l'existence ou l'absence d'un climat antibelge et la menace contre les Casques bleus belges. Outre le fait que le rapport du groupe ad hoc ne mentionne nulle part un « climat antibelge général ou généralisé », la commission fait observer qu'il manque dans le rapport du chef d'état-major Van Hecke un certain nombre de documents importants (entre autres, le rapport de la mission Recce, l'allocution du général Dallaire à l'occasion de l'installation de la MINUAR, ...);
la constatation que dans un deuxième volet du rapport Van Hecke, on aborde amplement l'aspect de la collecte et du traitement d'informations. En complément des travaux de la commission, ce rapport esquisse une image claire du fonctionnement des différents services de renseignement, des différents canaux et sources d'information dont l'armée disposait, de la capacité d'analyse aux différents niveaux et des lacunes et limitations inhérentes à la structure propre de l'armée. C'est ainsi que nous lisons dans le rapport, par exemple, que : « In het geval « Jean-Pierre » worden via Ambabel Kigali en de Sect Comd de door Kapt. Claeys ontvangen informaties (na RV met de informant) aan C- Ops en SGR overgemaakt. Uit de daaropvolgende analyse op SGR blijkt dat in eerste instantie de informant als weinig geloofwaardig wordt beschouwd. Niet alleen wordt dit niet aan de afzenders (Marchal en Claeys) gemeld, maar ze vinden ook geen sporen van effectieve pogingen van SGR om die zaak eventueel op te helderen. Wel maakt SGR in het « rapport Hock » melding van de moeilijkheid om op het terrein over geloofwaardige informanten te beschikken. » (409c);
la constatation que, dans une troisième partie, le « rapport Van Hecke » tente, dans une large mesure, de répondre aux griefs des familles des paras assassinés. Fournir des renseignements et une aide aux proches parents des victimes et développer un réseau social convenable au sein de l'armée sont ici des recommandations pour l'avenir.
La mission de la commission parlementaire d'enquête consistait à examiner quelle politique les autorités belges et internationales ont menée, plus particulièrement quelles actions elles ont entreprises, et à formuler éventuellement des conclusions concernant les responsabilités et les mesures qui devraient être prises dans le futur.
La commission attire l'attention sur le fait que, pendant plusieurs mois durant l'année 1997, elle a entendu plus d'une centaine de témoignages et consulté d'innombrables documents. Il faut bien entendu tenir compte du fait que cela s'est fait en étant au courant des événements qui se sont déroulés il y a plus de trois ans au Rwanda. La commission a cependant essayé d'éviter le piège d'une interprétation à posteriori et de replacer, autant que possible, les documents dans leur contexte temporel original avant d'émettre un jugement.
Dans ce chapitre, la commission constate, entre autres, un certain nombre de dysfonctionnements et de responsabilités, en courant le risque que, de cette manière, n'apparaissent plus les éléments positifs. La commission souhaite souligner que de nombreuses personnes et organisations, tant civiles que militaires, ont fait preuve d'un véritable engagement et d'une grande compétence.
Lors de la rédaction de son rapport, la commission ne s'est pas fondée sur des considérations politiques, mais elle a estimé que plus de trois ans après les événements dramatiques, il était temps de constater les manquements et de reconnaître les erreurs qui ont été commises à différents niveaux. En dehors du constat que de nombreux acteurs ont bien fait leur travail, l'intention de la commission n'est pas de montrer du doigt des individus, mais d'examiner quelles ont été les erreurs commises d'août 1993 à avril 1994, pour que l'on puisse tirer des leçons pour l'avenir et éviter de commettre à nouveau les mêmes erreurs qu'hier. C'est le meilleur hommage que l'on puisse rendre aux dix paracommandos assassinés et à l'ensemble des victimes du génocide au Rwanda, afin que leur mort n'ait pas été totalement inutile.
La commission rappelle tout d'abord que l'assassinat des dix paracommandos belges et le génocide ont été commis par des Rwandais. En ce qui concerne le génocide, la commission est d'avis qu'il a été préparé, initié et orchestré par des responsables rwandais faisant partie d'un cercle restreint gravitant autour du pouvoir. Ce génocide a été exécuté par des membres de la garde présidentielle, des FAR, de la gendarmerie et des deux milices (les Interahamwe et les Impuzamugambi).
Des civils y ont participé, attisés par les injonctions haineuses de responsables politiques et d'autorités civiles, par exemple des préfets et des bourgmestres, et excités dans le même sens par RTLM. C'est le rôle de la justice d'identifier et de punir les coupables. C'est donc à cette tâche que doivent se consacrer le Tribunal international pour le Rwanda (créé par le Conseil de sécurité des Nations unies par ses résolutions 808, 827 et 955) et les autorités judiciaires rwandaises et belges. Tous les moyens doivent etre mis à l'accomplissement de cette mission et aucun obstacle ne peut y etre opposé. L'impunité est elle-même source de violence.
La commission constate que la communauté internationale n'a pas pris suffisamment en compte, pour des motifs divers, les informations concernant les atteintes aux droits l'homme et la préparation des massacres.
En ce qui concerne l'assassinat des Casques bleus, la commission a relevé de nombreux indices qui permettent de penser que cet assassinat s'est inscrit dans un plan visant à provoquer le départ de la MINUAR en s'attaquant à sa composante la plus forte. Il n'est cependant pas exclu que cet assassinat soit la conséquence des rumeurs attribuant aux Belges l'attentat contre l'avion présidentiel, rumeurs s'inscrivant elles-mêmes dans une campagne contre les Belges. En tout état de cause, l'assassinat des dix paracommandos a été perpétré par des soldats rwandais avec la complicité active et passive de la garde présidentielle, sans qu'il entraîne de réaction de l'état-major de l'armée, ni de la gendarmerie rwandaises. Enfin, il faut noter que ces événements se sont inscrits dans un contexte de conflit armé, latent ou déclaré suivant les moments, dans lesquels les belligérants ont une responsabilité.
Ensuite, la commission est convaincue qu'outre les responsables rwandais, des autorités politiques et militaires de la Belgique, des Nations unies et de l'ensemble de la communauté internationale sont directement ou indirectement responsables de certains aspects des événements dramatiques postérieurs au 6 avril 1994 au Rwanda. À cet égard, ce n'est pas une seule instance et encore moins une seule personne qui en porte l'entière responsabilité.
C'est un concours de circonstances, de négligences, de mauvaises évaluations et également d'erreurs qui ont mené au drame qui s'est déroulé au cours des mois d'avril et de mai 1994 au Rwanda. La commission a examiné ces responsabilités à la lumière de la note du Service des Affaires juridiques et de la documentation du Sénat, intitulée « L'appréciation des responsabilités politiques par une commission d'enquête du Sénat. » (d1)
Par ailleurs, la commission estime que les suites du drame rwandais n'ont été traitées de manière adéquate, ni par les autorités militaires, ni par les autorités politiques (le Gouvernement et le Parlement). En outre, la commission déplore au plus haut point le refus du Secrétaire général des Nations unies, M. Kofi Annan, de laisser témoigner devant la commission des personnes dépendant des Nations unies. Bien que cela ne relève pas de sa compétence, la commission pense qu'il y aurait lieu d'examiner de plus près le rôle joué par la France avant, pendant et après les événements.
La commission estime concrètement qu'il faut relever 17 domaines dans lesquels des erreurs et manquements ont été relevés. À cet égard, la commission a examiné quelles sont les instances ou les personnes qui doivent en porter la responsabilité.
La commission estime que l'on peut constater plusieurs manquements dans le fonctionnement et dans les structures des Nations unies à l'occasion de l'opération MINUAR. Ces lacunes et ces manquements concernent tant la genèse de la décision que le fonctionnement du secrétariat pendant l'opération.
En ce qui concerne la genèse de la décision, la commission estime que les membres permanents du Conseil de sécurité, et en particulier les États-Unis, ont trop pesé dans une décision où la réussite de la mission a été souvent subordonnée aux intérêts propres et souvent contradictoires des membres du conseil. En ce qui concerne la MINUAR, le processus décisionnel n'a pas suffisamment tenu compte des rapports disponibles concernant les violations des droits de l'homme. Le rapport du rapporteur spécial des Nations unies, M. Ndiaye, par exemple, qui date d'août 1993 et dans lequel on utilise pour la première fois, pour qualifier de nombreux massacres, le terme de « génocide », n'a été discuté qu'en mars 1994 au sein des organes ad hoc des Nations unies. Enfin, la grande majorité des membres du Conseil de sécurité ne s'intéressaient guère au dossier rwandais et étaient encore moins disposés à fournir des troupes à la MINUAR.
Tout cela a vidé de sa substance le mandat tel qu'il avait été prévu dans les accords d'Arusha et entraîné une limitation du nombre d'effectifs engagés.
La commission estime que les gouvernements des pays membres permanents du Conseil de sécurité portent une lourde responsabilité en la matière.
La commission estime que la prise de décision par la Belgique de participer à l'opération de paix MINUAR a présenté des déficiences à divers points de vue (politico-psychologiques et technico-militaires).
Pour ce qui est des facteurs politiques et psychologiques, le Gouvernement est parti essentiellement de la considération que les accords d'Arusha auxquels tout le monde croyait à cette époque devaient réussir, que les deux signataires de ces accords souhaitaient une participation de la Belgique et que celle-ci était le seul pays militairement crédible se montrant disposé à fournir des troupes à court terme dans le cadre de la force de paix prévue par lesdits accords. On ne s'est pas ou pas suffisamment interrogé sur le point de savoir si une participation belge était réellement souhaitable au vu des éléments suivants :
Le passé colonial de la Belgique. En envoyant des Casques bleus belges au Rwanda, les Nations unies même si ce n'était pas la première fois que cela se produisait à leur niveau ont dérogé à une règle non écrite qui veut qu'une force de paix ne comprenne pas de troupes fournies par des pays voisins ou des pays ayant des liens particuliers avec l'État ou la région ou cette force est envoyée. Concrètement, cela signifie que l'on n'envoie normalement pas de Casques bleus venant d'un pays susceptible d'avoir des prétentions territoriales ou d'une ancienne puissance coloniale. En s'écartant de cette règle, on court le risque de voir les troupes envoyées arriver dans un environnement qui leur sera soit hostile soit exagérément favorable, selon les parties impliquées dans le conflit. En pareil cas, il ne pourrait être question ou alors si peu d'« impartialité », condition essentielle à la réussite d'une opération de maintien de la paix.
La présence de nombreux citoyens belges au Rwanda a constitué une des raisons de la participation belge à l'opération MINUAR. Cependant, le mandat initial de l'ONU ne prévoyait pas la possibilité d'une évacuation par la MINUAR des expatriés et les commandants des troupes belges n'ont jamais reçu les directives qu'ils avaient demandées à ce sujet au commandement de l'armée. Il ressort du déroulement des événements ultérieurs que la présence de ces expatriés a, en réalité, paralysé la capacité opérationnelle de la composante belge de la MINUAR. Plusieurs officiers ont en effet déclaré qu'aucune opération de dégagement du groupe Lotin n'aurait pu être exécutée, entre autres en raison des dangers qu'elle aurait fait courir aux citoyens belges résidant au Rwanda.
Le climat antibelge qui régnait au Rwanda, en tout cas au sein des milieux extrémistes hutus liés au président Habyarimana et à son entourage direct. Ce climat était, principalement, la conséquence directe des décisions prises par la Belgique en 1990 de ne pas livrer les munitions que le Rwanda avait payées et de retirer ses troupes, alors que la France était restée sur place et avait soutenu le régime d'Habyarimana face à l'offensive du FPR.
En ce qui concerne les aspects techniques et militaires, le chef de l'état-major général, le lieutenant général Charlier, assumait, malgré la limitation des effectifs, la responsabilité de l'opération; cependant, quand on a pris la décision de participer à la MINUAR, on n'a pas suffisamment accordé d'attention aux points suivants :
le nombre et la nature des tâches susceptibles d'être confiées au bataillon belge (KIBAT) à la suite de la réduction de l'effectif à 450 hommes;
l'absence d'un deuxième contingent crédible, dont la présence était nécessaire, eu égard à la décision de ne fournir qu'un nombre réduit de troupes belges à la MINUAR;
l'absence d'une force d'intervention rapide (Quick Reaction Force QRF) et des véhicules blindés qui doivent équiper une telle force, comme demandé par la Recce et le général Dallaire.
Enfin, il y avait également la portée du mandat qui, à bien des points de vue, avait été atténué par rapport à ce qui était initialement prévu dans les accords d'Arusha et ne permettait plus à la force de l'ONU de remplir la plupart de ses missions sans la collaboration des autorités rwandaises.
La commission constate donc que, tant du point de vue politique que du point de vue technico-militaire, la décision du Gouvernement de participer à la MINUAR était déficiente et a fait l'objet d'une appréciation erronée. Ce constat est d'autant plus à déplorer que l'on aurait pu tirer les leçons des analyses des opérations antérieures. On s'est manifestement trop focalisé sur la recherche d'un compromis entre l'approche politique du dossier rwandais (impliquant une participation plutôt symbolique à la force de paix de l'ONU ainsi que des limitations budgétaires) et les desiderata et préoccupations technico-militaires du général Dallaire et de l'armée belge. La commission constate qu'en raison de ce compromis et de l'absence d'un deuxième contingent crédible, la Belgique a dû former l'épine dorsale de la MINUAR, même si, au départ, le Gouvernement voulait éviter cela à tout prix.
En tout état de cause, la commission estime que, même si la responsabilité de la décision relève de l'ensemble du Gouvernement, le ministre de la Défense nationale, M. L. Delcroix, ne l'a pas informé suffisamment de toutes les conséquences militaires de l'option retenue et des suites qu'elle pouvait avoir sur le terrain.
De son côté, le ministre des Affaires étrangères, M. W. Claes, n'a pas été conscient de l'affaiblissement insidieux du mandat et des conséquences que cela aurait pu avoir sur la réussite ou l'échec de la mission.
Même si notre pays n'était pas membre du Conseil de sécurité, et n'était donc pas en droit de négocier, il n'a pas tiré parti de l'avantage de la position de la Belgique en tant que fournisseur du contingent le plus crédible pour tenter de prévenir cet affaiblissement du mandat.
Enfin, la commission constate que la décision de participer à l'opération de la MINUAR n'a fait l'objet ni d'une communication gouvernementale au Parlement, ni d'un débat d'initiative parlementaire.
La commission estime que, d'un point de vue technico-militaire, si la préparation du contingent belge de paracommandos qui devait participer à l'opération de maintien de la paix MINUAR a été rapide, elle fut déficiente. Cela s'est manifesté dans la quasi-totalité des domaines.
le logement des troupes belges n'était pas réglé au moment de leur départ pour Kigali. Le Force Commander, le général Dallaire, voulait les disséminer dans un maximum d'endroits; au lieu d'être cantonnées, par compagnie, en quelques endroits, elles furent logées dans quatorze cantonnements, ce qui a eu des conséquences graves sur la sécurité et a, par ailleurs, réduit le nombre d'hommes disponibles pour effectuer les missions dont KIBAT était chargé;
même si l'on tient compte de la courte période de préparation, les hommes que l'on a envoyés dans le cadre de KIBAT I auraient dû être mieux préparés; ce manque de préparation portait tant sur la connaissance de la situation au Rwanda que sur la sensibilisation au caractère de maintien de la paix de l'opération; l'officier de renseignements de KIBAT I qui était responsable sur le terrain de la collecte des informations n'avait pas été préparé à sa mission ni formé à cet effet, même s'il a effectué un excellent travail sur le terrain. Par ailleurs, les règles d'engagement n'ont pas été expliquées de manière suffisamment intelligible, bien qu'elles aient été élaborées avec la collaboration des autorités militaires belges;
l'armement des troupes belges de la MINUAR était trop léger, surtout pour pouvoir faire face à un éventuel scénario catastrophe; alors que les directives des Nations unies n'excluaient pas que l'on emporte des mortiers et un armement lourd, KIBAT est parti avec des armes légères, si l'on excepte les six blindés CVRT, qui étaient toutefois en très mauvais état après leur transfert de Somalie et qui n'étaient d'ailleurs pas destinés aux opérations; les munitions pour les deux CVRT, qui étaient équipés d'un canon de 30 mm, faisaient défaut; il en allait de même pour les projectiles de l'arme antichar MILAN;
la quantité et la distribution du matériel de transmission et de communication ne satisfaisaient pas aux exigences de la mission à accomplir; un matériel radio militaire portable et autonome faisait plus particulièrement défaut, ce qui a notamment eu pour effet que le lieutenant Lotin n'a pu entrer en contact avec sa chaîne hiérarchique dès qu'il s'est éloigné des ses véhicules. De plus, la Force et le Secteur ne disposaient que d'un système Motorola civil, qui ne permettait pas d'entrer directement en communication avec les échelons inférieurs de KIBAT;
le mandat a été mal interprété; les autorités militaires qui avaient préparé l'opération en Belgique étaient convaincues, à tort, que la MINUAR pourrait consigner des armes de sa propre autorité;
le conseiller en droit des conflits armés de KIBAT I n'est arrivé qu'après le déploiement des troupes belges à Kigali et il était, en outre, insuffisamment préparé à sa tâche;
le manque d'un plan d'évacuation et de directives en cas de graves difficultés.
La commission estime que la responsabilité de cette préparation défectueuse incombe à l'ensemble de la hiérarchie militaire, et plus particulierement à l'état-major général et au C Ops, à l'état-major de la force terrestre, à la brigade paracommando (formation et préparation des hommes) et au SGR. En ce qui concerne les responsables au C Ops et à l'état-major général, on renvoie au point 4.5.
En ce qui concerne le fonctionnement du secrétariat des Nations unies et du DPKO au cours de la mission, la commission constate les manquements suivants :
une approche exagérément centralisée du DPKO; le DPKO a interprété de manière trop restrictive le mandat ainsi que les règles d'engagement (ROE), y compris les dispositions qui relevaient clairement de la responsabilité des hommes de terrain; le Force Commander , le général Dallaire, a, par conséquent, adopté une attitude trop réservée, ce qui est notamment apparu quand on a découvert des caches d'armes : le DPKO a refusé l'autorisation de les démanteler;
l'absence d'un centre d'opérations au sein du DPKO : bien qu'il existe une « situation room » , on peut se demander s'il ne devrait pas y avoir absolument un véritable centre d'opérations au sein de ce DPKO;
l'absence d'un service de renseignements spécifique aux Nations unies et l'interdiction de constituer sur le terrain un service de renseignements lors d'une mission de paix relevant du chapitre VI de la Charte;
l'absence d'un responsable de l'information ou d'une cellule d'information chargé(e) de développer des actions en vue d'informer la population locale de la portée de l'opération de paix concernée des Nations unies;
l'absence sur place pendant la majeure partie de la mission d'un conseiller juridique ou d'une cellule juridique capable de fournir, dans le cadre de la mission, une assistance dans l'interprétation du mandat, des règles d'engagement et du contenu et de la portée des accords d'Arusha;
le manque de coordination entre les divers départements Secrétariat des Nations unies, principalement en ce qui concerne le suivi des rapports de la Commission des droits de l'homme;
l'absence des mécanismes préventifs voulus au sein des Nations unies.
La commission estime que la structure d'organisation des Nations unies, particulièrement en ce qui concerne les missions de maintien de la paix, le Conseil de sécurité, le Secrétariat général, dirigé à l'époque par M. Boutros Boutros-Ghali, et le DPKO, dirigé à l'époque par M. Kofi Annan, portent une responsabilité dans ces manquements.
La commission a constaté que du côté belge, la MINUAR a été confrontée à toute une série de difficultés technico-militaires qui auraient dû être résolues dans le cadre du centre d'opération d'Evere, des états-majors et de l'état-major général. Dans la pratique, des problèmes importants ont été traités tardivement ou n'ont pas été résolus. Cependant, toutes ces instances ont été informées de la plupart de ces problèmes directement par le(s) commandant(s) de secteur et de bataillon présents à Kigali. En outre, elles ont recu les rapports du major Guérin (31 janvier 1994) et du lieutenant général Uytterhoeven (25 février 1994) qui énuméraient et analysaient l'ensemble des difficultés se présentant sur le terrain.
La commission constate qu'il s'agit en l'occurrence de manquements graves, qui servirent d'arguments pour justifier l'impossibilité pratique de délivrer le groupe Lotin le 7 avril 1994.
Il s'agit plus particulièrement des difficultés suivantes :
la dispersion des troupes belges en quatorze cantonnements; bien que le commandant de KIBAT I ait d'emblée fortement insisté sur la nécessité de réduire le nombre de cantonnements, il n'y a pas eu de réaction efficace; ce n'est que quatre mois plus tard, le 24 mars 1994, que l'on a élaboré un plan visant à regrouper partiellement les cantonnements par la construction de Kigalodge;
l'absence d'une force d'intervention rapide (QRF); une fois que le colonel Marchal eut constaté que le RUTBAT ne pouvait pas fournir de QRF opérationnelle au niveau de la force, comme le général Dallaire l'avait prévu, il a demandé le 8 décembre 1993 au C Ops de lui envoyer des blindés pour constituer ainsi une force d'intervention propre en attendant que le RUTBAT soit opérationnel. L'état-major général n'a pas réagi; toutefois, les témoins ont presque tous déclaré que c'est précisément l'absence de force d'intervention rapide dotée de véhicules blindés qui a rendu du point de vue militaire une action visant à délivrer le groupe Lotin très risquée, sinon impossible;
le retard dans la livraison des munitions lourdes supplémentaires demandées par les commandants de secteur et de bataillon; alors que la première demande date du 15 janvier 1994, ce n'est que le 28 mars que le C Ops donne l'ordre à sa division logistique de livrer, pour le 20 avril, une partie des munitions demandées;
le fait que l'on n'ait pas rendu les CVRT opérationnels : malgré plusieurs demandes adressées au C Ops de remettre ces véhicules et leur armement en état, Bruxelles n'est pas parvenu à prendre les mesures pour ce faire;
les erreurs dans la préparation de KIBAT II; à la suite des difficultés rencontrées avec KIBAT I, dont l'action était jugée, parfois à raison, mais souvent à tort, trop agressive, on a mal interprété dans la préparation de KIBAT II l'aspect « maintien de la paix » de l'opération, et bon nombre d'hommes s'imaginaient que leurs possibilités d'intervention étaient réduites à un minimum.
La commission constate en outre que l'état-major général et le C Ops d'Evere n'ont jamais utilisé complètement le contingent de 450 hommes qui était autorisé. En dépit du fait qu'il existait sur le terrain un problème manifeste de manque d'hommes, entre autres de chauffeurs et de canonniers pour les CVRT, on n'a jamais engagé plus de 428 hommes. Enfin, la commission est d'avis que l'état-major général a également commis des erreurs dans la sélection des officiers d'état-major que la Belgique a envoyés à l'ONU. Ces officiers ont été recrutés sur la base de leur propre candidature et l'état-major général n'a pas cherché les candidats les plus aptes à exercer ces fonctions importantes.
La commission constate que les opérations sont sous la responsabilité directe de l'état-major général, qu'il s'agisse de leur préparation, de l'appui ou du suivi de leur exécution.
La commission juge notamment que le lieutenant général Charlier, l'amiral Verhulst, le colonel Flament et le lieutenant-colonel Briot, en tant qu'autorités hiérarchiques coiffant le centre d'opérations, portent la responsabilité des manquements constatés.
Ils n'ont pas ou pas suffisamment tenu compte des leçons tirées des opérations antérieures.
La commission constate qu'outre l'absence d'un service de renseignements propre à l'ONU, on eut à déplorer, pour ce qui est de la collecte et du traitement indispensables des informations, des déficiences, tant sur le terrain qu'en Belgique. S'il est vrai que les autorités civiles et militaires belges disposaient d'une masse d'informations sur la situation au Rwanda, on n'a informé les acteurs de terrain de ces analyses et de ces renseignements, ni sur place ni à Bruxelles.
La commission estime que cette situation résulte de déficiences à trois niveaux, à savoir :
(1) D'abord sur le terrain même, ou l'on ne disposait d'aucun service de renseignements spécifique, si bien que les officiers de renseignements de KIBAT et de la Force ont dû effectuer des analyses politiques en sus de la collecte d'informations d'intérêt tactique. Cette situation a encore été aggravée par l'absence quasi totale de coopération entre l'officier de renseignements de KIBAT, l'officier de renseignements de la Force, la CTM-MTS, l'ambassade et les officiers belges qui travaillaient à la Force auprès du général Dallaire. Il y avait en outre une méconnaissance de la langue locale, le Kinyarwanda, en manière telle que certains faits n'ont pas été relevés. On constate enfin qu'il y a eu une absence totale de feedback. Les responsables sur le terrain ont effectivement transmis des informations aux échelons supérieurs, mais ceux-ci ne leur ont envoyé que très rarement les informations qu'ils avaient obtenues grâce à d'autres sources sur la situation réelle sur place.
(2) Deuxièmement, en ce qui concerne le service du renseignement militaire (SGR), il a failli à sa mission dans la crise du Rwanda. Le SGR disposait ou pouvait disposer de tous les renseignements nécessaires pour réaliser des analyses sérieuses de ce qui se passait au Rwanda. Le SGR était la seule instance en Belgique à être informée, et par les officiers de renseignements, et par la CTM-MTS, et par les officiers rattachés à la Force; il était aussi la seule instance à avoir connaissance de tous les rapports journaliers établis au niveau du bataillon, du secteur et de la Force. Il faut ajouter à cela qu'il recevait aussi une copie de la plupart des télex envoyés par notre ambassade à Kigali.
En dépit de toutes ces informations, le SGR n'a produit aucun ou quasiment aucun diagnostic pertinent, ce qui, selon la commission, est dû aux éléments suivants :
le manque d'effectifs et le manque de flexibilité qui n'étaient pas adaptés aux nécessités d'une opération sur le terrain; un seul analyste traitait les informations, si bien que l'objectivité des évaluations a été menacée;
on a donné davantage d'importance à la source des informations qu'au contenu de celles-ci; il en fut incontestablement ainsi pour ce qui est des informations en provenance de la coopération technique militaire (CTM-MTS), informations qui étaient souvent assez apaisantes par rapport aux nombreuses informations souvent inquiétantes venant d'autres sources, comme l'ambassadeur et les officiers de renseignements de KIBAT I et II;
l'action en retour (feedback) était inexistante; les quelques analyses que le SGR a réalisées ne sont jamais parvenues à Kigali.
(3) Troisièmement, le Gouvernement belge ne dispose d'aucun instrument d'analyse et de coordination pour préparer sa politique, par la collecte, l'analyse et la transposition en recommandations des informations émanant des diverses sources de renseignements disponibles (Affaires étrangeres, SGR, Sûreté de l'État et autres). En ce qui concerne plus particulièrement le Rwanda, la cellule « Afrique » du département des Affaires étrangères n'est pas équipée pour cette mission et, de surcroît, elle manque d'effectifs. Elle n'est, par conséquent, pas en mesure d'émettre les analyses approfondies et les recommandations nécessaires en temps de crise.
En ce qui concerne le manque de coordination sur le terrain, la commission estime que le général Dallaire et, dans une moindre mesure, le commandant de secteur, le colonel Marchal, n'ont pas pris suffisamment d'initiatives pour pallier cette carence. En ce qui concerne le fonctionnement du SGR, la commission est d'avis que l'analyste du Rwanda, le major Hock, a accordé une attention trop unilatérale aux renseignements émanant de la coopération technique militaire au Rwanda. Quant à ses supérieurs, le général-major Verschoore et le général-major Delhotte, ils n'ont pas réussi à adapter le fonctionnement de leur service en fonction des exigences de la participation belge à l'opération MINUAR. Enfin, la commission estime que les Gouvernements successifs ont accordé trop peu d'attention au développement d'une cellule « Afrique » efficace au sein du département des Affaires étrangères, et n'ont pas débloqué suffisamment de moyens pour pouvoir créer une telle cellule.
L'informateur « Jean-Pierre », auteur d'informations essentielles en ce qui concerne la menace contre les Belges et la préparation du génocide, avait demandé asile et protection pour lui et pour sa famille en garantie d'informations qu'il s'engageait à continuer à donner.
La commission constate que ni les ambassades occidentales ni les Nations unies n'ont accepté d'accorder cette protection.
La commission ne comprend pas la manière dont la communauté internationale, en l'occurrence les Nations unies, les USA, la France et la Belgique, a traité le problème de cette source d'informations, qui allaient par la suite être confirmées par les faits.
Bien qu'en vertu de l'arrêté royal du 19 décembre 1989, la mise en condition des troupes et la conduite des opérations soient du ressort de l'état-major et bien qu'il y ait eu en outre des contacts réguliers entre le chef d'état-major, le lieutenant général Charlier, et le ministre de la Défense nationale, M. L. Delcroix, et/ou son chef de cabinet, M. Schellemans, la commission estime que l'échange d'informations entre l'état-major et le cabinet n'a pas été optimal. C'est ainsi que les rapports du briefing journalier du chef d'état-major n'ont pas été tous transmis quotidiennement au ministre. Force est de constater aussi que le cabinet n'a donné que peu ou pas de missions spécifiques à l'état-major général en rapport avec les informations qu'il a effectivement reçues.
La commission a constaté qu'au niveau politique, la coordination entre les deux départements s'est presque exclusivement limitée à un contact régulier entre les deux chefs de cabinet. En principe, il y a bel et bien eu, au cours du déroulement d'une ou de plusieurs opérations, des réunions de coordination hebdomadaires entre les deux départements; y assistaient également le cabinet du Premier ministre et celui de la Coopération au développement. Ces réunions se sont toutefois déroulées à un échelon trop bas que pour pouvoir assurer la coordination nécessaire sur le plan politique. D'ailleurs, on peut déduire des rapports en question que ces réunions traitaient presque uniquement de problèmes ponctuels et pratiques.
À part les communications hebdomadaires du ministre des Affaires étrangères, M. W. Claes, concernant la situation internationale, le Rwanda n'a pas figuré à l'ordre du jour du Conseil des ministres entre fin novembre 1993 et fin mars 1994, à l'exception de la communication du 4 mars du ministre des Affaires étrangères à propos du Rwanda, du Burundi et du Zaïre.
La commission s'étonne que le ministre de la Défense nationale, M. L. Delcroix, n'ait pas jugé utile de demander d'inscrire le Rwanda à l'ordre du jour, soit parce que son information était incomplète, soit parce que son appréciation de la situation n'était pas exacte.
La commission constate que le Gouvernement belge et, plus particulièrement, le ministre des Affaires étrangères, M. W. Claes, ont déployé des efforts visant à modifier le mandat de la MINUAR au cours de l'opération.
Si cette modification n'a pas eu lieu avant les événements dramatiques des 6 et 7 avril 1994, c'est tout d'abord en raison du refus des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies.
Néanmoins, la commission estime que les efforts fournis par le Ministère des Affaires étrangères ont été insuffisants. En effet, force est de se demander pourquoi, vu la menace spécifique qui pesait sur les para-commandos belges, le Ministère des Affaires étrangères s'est accommodé d'un renforcement, somme toute limité, de l'action dans le cadre du mandat existant (le transfert à Kigali de soldats ghanéens de la MINUAR qui étaient cantonnés au Nord du Rwanda), au lieu d'exiger une « modification » ou un « élargissement » du mandat ou un « renforcement plus poussé de l'action dans le cadre du mandat » par une interprétation moins restrictive de celui-ci et des règles d'engagement. Pourquoi, avant le 5 avril, date à laquelle le Conseil de sécurité devait prolonger le mandat de la MINUAR, n'a-t-on pas lancé une offensive diplomatique, puisque à peine dix jours plus tard, on a bel et bien déclenché une telle offensive vis-à-vis des membres du Conseil de sécurité, à l'occasion du retrait des Casques bleus belges ?
Bien que la commission reconnaisse que nombre d'efforts ont été fournis, elle reste d'avis que le ministre des Affaires étrangères, M. W. Claes, n'a pas exploité toutes les possibilités dont il disposait pour renforcer le mandat ou, du moins, les moyens d'action disponibles dans le cadre du mandat existant.
Les auteurs de l'horrible assassinat des paracommandos sont des Rwandais. La commission est d'avis que ceux qui doivent être tenus pour coupables de ce crime ne sont pas seulement ceux qui ont porté la main contre nos militaires, mais aussi certaines autorités politiques et militaires rwandaises et tous ceux qui ont mené la campagne antibelge, qui a commencé dès avant le déploiement de nos troupes et qui a culminé après l'assassinat du président. Il appartient à la justice de juger les coupables.
La commission rappelle à cet égard que nos soldats ont été assassinés dans l'enceinte d'une caserne de l'armée rwandaise, donc dans un édifice public sous la protection des autorités d'un pays « ami » avec lequel nous entretenions une forte coopération au développement et une coopération technique militaire. La commission rappelle également qu'à quelques centaines de mètres du drame, la quasi-totalité des officiers supérieurs des FAR étaient rassemblés pour une réunion de crise en présence du général Dallaire.
La commission est d'avis qu'un grand nombre des événements du 7 avril 1994 s'expliquent par le constat que la MINUAR I n'a accompli que partiellement les missions qui lui ont été confiées. Dans la région de Kigali, notamment, elle n'a effectué qu'un nombre limité d'actions de désarmement. Par ailleurs, l'attitude militaire qu'elle a adoptée avant le 7 avril 1994 a joué un role important. Cette attitude a fait, entre autres, que la MINUAR est devenue de moins en moins crédible aux yeux des Rwandais (par exemple en s'abstenant de liquider les caches d'armes, en ne réagissant pas à de nombreuses provocations, ...), lesquels, de ce fait, ont eu l'impression qu'ils pouvaient entraver inpunément l'action de la MINUAR. Pour les hommes de celle-ci, cette attitude passive, conjuguée à la « crainte de la bavure », a produit un état de désarmement psychologique. En outre, l'interprétation restrictive qui était faite des ROE a provoqué chez certains la perte du réflexe normal de légitime défense. De plus, la confiance que la MINUAR plaçait dans les forces armées rwandaises a fait que les Casques bleus ne se sont pas méfiés suffisamment des troupes et des gendarmes rwandais. Il est probable que cela explique en partie pourquoi le lieutenant Lotin s'est laissé désarmer et pourquoi on n'a pas envisagé une action armée pour le dégager. C'est l'ONU et le général Dallaire qui portent la responsabilité pour ce qui est des constatations susvisées Les commandants militaires belges sur place assument également une partie de cette responsabilité.
La commission a dû constater tout d'abord, dans son analyse des événements, qu'il n'y avait eu aucune coordination à quelque niveau que ce soit et moins encore de scénario qui aurait permis de faire face aux événements dramatiques du 7 avril 1994.
La commission estime ensuite que le représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies, M. Booh Booh, ainsi que plusieurs officiers supérieurs de la MINUAR ont mal apprécié la portée des événements dans la nuit du 6 au 7 avril. Cette mauvaise appréciation a amené les officiers concernés à adopter une attitude passive alors que le groupe Lotin, qui était chez la Première ministre rwandaise, était en difficulté. On a maintenu cette attitude après que le groupe Lotin eut été fait prisonnier et qu'il eut été lynché au Camp Kigali.
La commission estime que dans les moments critiques de la crise rwandaise, les personnes suivantes n'ont pas réagi aux événements de manière adéquate et, pour certaines, qu'elles n'ont pas réagi de manière professionnelle.
M. Booh Booh, représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies. La commission estime que le représentant spécial n'a pas été à la hauteur de sa mission. À partir du 6 avril, il a été totalement passif. Concrètement, cela a eu pour conséquence que le général Dallaire, le Force Commander, a dû s'occuper également des aspects politiques de la mission MINUAR, l'aspect militaire ayant été relégué au second plan.
Le général Dallaire, Force Commander. La commission estime que les escortes des personnalités politiques, et plus particulièrement de la Première ministre, étaient nécessaires et ne pouvaient être réalisées que par les soldats de la MINUAR. La commission estime également qu'il était imprudent et peu professionnel de la part du général Dallaire, dans ces circonstances, de les faire effectuer le 7 avril avec aussi peu de précautions militaires. C'est d'autant plus vrai que, comme le montre son témoignage écrit, le général Dallaire était parfaitement au courant du fait que l'homme fort du régime, le colonel Bagosora, était opposé à ce que l'on accompagne Mme Agathe Uwilingiyimana, la Première ministre rwandaise, à Radio Rwanda. Par ailleurs, la commission ne comprend pas pourquoi le général Dallaire, qui avait aperçu les corps des Casques bleus au camp Kigali, n'en a pas parlé immédiatement aux officiers supérieurs des FAR à la réunion de l'École supérieure et n'a pas exigé l'intervention urgente des officiers rwandais présents. Cela semble traduire une grande indifférence de sa part. D'ailleurs, le général Dallaire a également négligé d'informer son commandant de secteur de ce qu'il avait observé et de lui donner les instructions nécessaires.
Le major Maggen, membre de la cellule opérations au quartier général de la Force, a fait des déclarations contradictoires devant les diverses instances d'enquête. Selon la commission, il est exclu que le major Maggen n'ait rien vu ni entendu lorsqu'il est passé, en compagnie du général Dallaire, devant le camp Kigali où les paracommandos belges se battaient pour sauver leur vie. Il est incompréhensible et répréhensible que le major Maggen n'ait pas confronté, dans la matinée du 7 avril, le général Dallaire avec ce qu'il avait vu et entendu le matin même et plus particulièrement avec l'information, vers 9 h 30, selon laquelle il y aurait eu plusieurs morts au camp Kigali.
Le colonel Marchal, commandant de secteur, a mal apprécié la situation au moment des événements tragiques. Il a continué à croire à la volonté de collaborer et à la bonne foi des forces armées et de la gendarmerie rwandaises pensant qu'elles allaient résoudre l'incident concernant le peloton Mortiers du lieutenant Lotin, même si, tôt dans la matinée du 7 avril 1994 déjà, il s'est avéré que cette confiance n'était pas fondée et que les hommes couraient un grave danger.
Le colonel Dewez, commandant de KIBAT II, a lui aussi mal évalué la situation pendant les événements tragiques. Il a également continué à croire à la volonté de collaborer et à la bonne foi des forces armées et de la gendarmerie rwandaises même si, tôt dans la matinée du 7 avril 1994 déjà, il s'est avéré que cette confiance n'était pas fondée et que les hommes couraient un grave danger.
De plus, selon sa propre lettre du 4 juillet 1997 adressée à la commission, le colonel Dewez n'a pas eu « une réaction normale pour un militaire » au moment des faits. Il a commis l'erreur de ne pas donner les directives claires nécessaires au lieutenant Lotin.
Dans la nuit du 6 au 7 avril 1994, lui-même et le major Choffray ont eu le tort de ne pas prendre les mesures nécessaires pour distribuer aux compagnies de KIBAT les munitions et les armes plus lourdes entreposées à Rwandex.
Pour ce qui est de l'accueil et de l'accompagnement des membres des familles des victimes, la commission a constaté plusieurs lacunes graves.
Les familles se sont plaintes de la façon dont elles ont été traitées par les autorités internationales et nationales.
Le fonctionnement du service social de l'état-major général a présenté des insuffisances flagrantes dans de nombreux domaines, et au niveau humain et au niveau matériel. Ainsi la mort des hommes a-t-elle été communiquée sans aucune diplomatie ni aucun tact aux membres de la famille. En outre, la commission ne peut que réprouver l'attitude du commandant de bataillon, le colonel Dewez, qui a fourni de manière distante des informations erronées concernant la mort des paracommandos. Pour qu'un processus de deuil puisse se faire convenablement, il est très important que les intéressés obtiennent une version exacte des faits. De plus, les membres de la famille n'ont pas eu l'occasion de prendre congé de leurs morts de manière digne et dans l'intimité, en raison des règles strictes et du protocole de l'armée. La commission estime que les services (et les personnes) compétents de l'état-major ont négligé l'accompagnement des membres des familles, tant du point de vue médico-social que du point de vue psychologique. Les formalités nécessaires se sont déroulées de manière particulièrement lacunaire. La commission estime que l'état-major général porte une lourde responsabilité en la matière.
La commission ne peut accepter que des documents aient été soumis pour signature par les services de l'armée à des membres des familles sans que ceux-ci aient été informés des conséquences de leur signature pour leurs droits futurs.
La décision de retrait des troupes belges de la MINUAR a été prise par le Gouvernement après qu'il eut pris contact avec les autorités des Nations unies, en particulier avec le Secrétaire général, le secrétaire général adjoint (DPKO) et avec des membres du Conseil de sécurité. Des contacts ont eu lieu dans une grande confusion en raison des difficultés de communication entre New York, Kigali et Bruxelles, ce qui ressort notamment de déclarations contradictoires de M. Boutros Boutros-Ghali et du ministre des Affaires étrangères, M. Willy Claes. Finalement, la décision des Nations unies et celle du Gouvernement belge ne sont pas allées dans le même sens.
La décision du retrait des troupes belges a été précédée de démarches diplomatiques entreprises en vue de déterminer ce que serait le rôle de la MINUAR en cas de massacres massifs et pour savoir si le mandat permettait d'assurer la protection de responsables politiques rwandais connus. On a en outre demandé s'il était possible d'engager les troupes de la MINUAR en vue de l'évacuation des expatriés. Il est apparu qu'il était impossible de réinterpréter le mandat et le rôle de la MINUAR dans ce sens. Finalement, on a envoyé des troupes françaises et belges, en dehors du cadre des Nations unies, pour procéder à l'évacuation des expatriés. Cette décision d'évacuation était justifiée par les menaces spécifiques dont faisaient l'objet les Belges, à qui on attribuait la responsabilité de l'attentat contre l'avion présidentiel, et qui s'ajoutaient à celles dont les Belges avaient fait l'objet précédemment.
En ce qui concerne les événements dramatiques qui ont eu lieu après le 7 avril 1994, la commission estime qu'ils relèvent d'une responsabilité collective.
D'abord de la responsabilité de la communauté internationale, plus précisément du Conseil de sécurité des Nations unies, qui a omis, dès le début du drame rwandais, de modifier, de renforcer ou d'élargir le mandat. À aucun moment, les autorités de l'ONU ou les autorités militaires sur place n'ont pris la décision d'appliquer l'article 17 des ROE qui stipule :
« Des actes criminels motivés ethniquement peuvent également être perpétrés pendant ce mandat et demanderont moralement et légalement que la MINUAR utilise tous les moyens disponibles pour y mettre fin. Exemples : exécution, attaques contre des personnes déplacées ou réfugiées, émeutes ethniques, attaques contre des soldats démobilisés, etc. À ces occasions, le personnel militaire de la MINUAR suivra les ROE élaborées dans cette directive, en appui de la UNCIVPOL et des autorités locales ou en leur absence, la MINUAR prendra l'action nécessaire pour empêcher tout crime contre l'humanité. »
Même s'il apparaît que la situation sur le terrain justifiait l'application de cet article 17 et que le droit international permettait, voire imposait, une réaction militaire pour empêcher les massacres, il faut évaluer quels étaient les rapports de force sur le terrain. Même s'il est apparu, à de très nombreuses reprises, que la MINUAR, et particulièrement sa composante belge, s'est trouvée en difficulté sur le terrain, la mise en commun de l'ensemble des forces militaires occidentales disponibles à Kigali ou dans les pays voisins aurait permis d'éviter l'ampleur du génocide.
La commission estime qu'en plus de la communauté internationale, notre pays porte également une responsabilité dans les événements. La décision de retrait unilatéral de la composante belge de la MINUAR a été prise par le Gouvernement en raison de son analyse, à savoir que les Nations unies ne voulaient pas modifier le mandat, qu'il considérait que les troupes belges se trouvaient en danger et étaient devenue inutiles et que la Belgique ne pouvait agir seule. Le Premier ministre, M. Jean-Luc Dehaene, a déclaré devant la commission que si la même situation se reproduisait, il prendrait la même décision.
Cette décision a été prise après que les Casques bleus belges eurent quitté l'école Don Bosco, où 2 000 Rwandais se trouvaient sous la protection de la MINUAR. La communauté internationale et les autorités belges étaient au courant des multiples assassinats politiques et des massacres systématiques de la population civile tutsie. En plus, cette décision de retrait de la composante belge de la MINUAR n'a pas été assortie de la garantie de son remplacement par un autre contingent.
La commission estime que la responsabilité de cette décision de retrait unilatéral des troupes incombe au Gouvernement. Le Parlement porte également une responsabilité en la matière. Cette décision du Gouvernement n'a soulevé aucune protestation. Au contraire, les divers groupes parlementaires, à l'exception de quelques membres qui ont lié le retrait à certaines conditions, ont soutenu la décision de retrait des Casques bleus. Cela ne peut s'expliquer qu'en partie, en raison d'un manque d'information et par l'émotion que l'assassinat des dix paracommandos a provoquée dans l'opinion publique belge.
En tout cas, la commission ne peut comprendre l'offensive diplomatique belge qui, parallèlement à la décision de retrait, a voulu mettre fin à l'ensemble de l'opération MINUAR, notamment pour des raisons d'ordre psychologique.
En tout état de cause, et avec le recul, la communauté internationale, et certaines de ses composantes, dont la Belgique, ont failli en avril 1994.
La commission constate que les autorités belges savaient que le président Habyarimana ou, du moins, son entourage direct, contrôlait cet émetteur qui véhiculait la haine raciale. La commission constate également que le Gouvernement belge est intervenu à plusieurs reprises auprès du président rwandais en vue de mettre fin aux émissions antibelges, mais sans résultat.
Cependant, pendant la période allant de novembre 1993 au 7 avril 1994, personne n'a décidé de brouiller ni d'empêcher les émissions de RTLM, alors que c'était techniquement possible.
Étant donné la menace que présentait cet émetteur, la commission s'étonne que cette possibilité n'ait pas fait l'objet, de la part du Gouvernement belge, d'une demande auprès de l'ONU à New York ou à la MINUAR. Elle ne comprend pas davantage qu'une telle initiative n'ait pas été prise par l'ONU elle-même, ni par le Force Commander , le général Dallaire.
La commission constate que divers milieux et personnalités politiques ont interféré dans la position officielle des autorités belges vis-à-vis du problème rwandais. La commission est d'avis que ces immixtions ont eu lieu de deux manières. D'une part, on a tenté, dans les hautes sphères dirigeantes du Rwanda, de développer des canaux parallèles pour la concertation diplomatique, afin d'influencer l'attitude de certains milieux politiques belges et de la Cour. D'autre part, l'Internationale démocrate-chrétienne a fait, en tout cas avant le 4 août 1993, des démarches et vis-à-vis du Gouvernement belge et vis-à-vis de certains milieux politiques du Rwanda, afin d'obtenir l'organisation rapide d'élections libres, contrairement à ce qui était prévu dans les accords d'Arusha au sujet du partage du pouvoir. La commission constate que ces tentatives n'ont pas influé sur la position du Gouvernement belge, lequel a continué à exiger l'application inconditionnelle des accords d'Arusha. On ne peut toutefois pas exclure que cette manière de voir la question ait encouragé dans leur refus les milieux politiques rwandais qui étaient opposés aux accords d'Arusha.
La commission est d'avis qu'après les événements dramatiques du 7 avril 1994, les autorités militaires ont tenté de faire admettre une version des faits qui ne correspondait pas à la réalité.
La commission estime inadmissible que l'armée ait uniquement enquêté sur les fautes et les erreurs qui auraient été commises par le détachement belge engagé au Rwanda. À aucun moment, les défaillances éventuelles qui auraient pu se produire au niveau des autorités militaires en Belgique (état-major général, C Ops, SGR, état-major de la Force terrestre, état-major de la brigade paracommandos, etc.) n'ont été examinées. En tout cas, on n'a jamais demandé au colonel Marchal ou au colonel Dewez de participer à une ou des réunions au cours desquelles on aurait tiré les leçons des événements. Ce n'est qu'en 1997 que l'actuel ministre de la Défense nationale, Jean-Pol Poncelet, a confié une telle mission au lieutenant général Van Hecke, qui a transmis son rapport à la fin août 1997 à la commission d'enquête parlementaire.
La commission a constaté que, pendant et après les événements au Rwanda, de très nombreuses demandes de reconnaissance en tant que réfugiés politiques ont été introduites par des Rwandais. D'après ses informations, aucune modification n'est intervenue dans la manière d'envisager la recevabilité, l'acceptation ou le rejet de ces demandes au niveau du Commissariat général aux réfugiés.
La commission constate cependant qu'en ce qui concerne trois candidats réfugiés politiques particuliers ayant fait l'objet d'une décision de rejet, la Chambre permanente de recours n'a pas pris de décision sur les recours qu'ils ont introduits, alors que près de deux ans se sont écoulés depuis la décision du Commissariat général aux réfugiés.
Par ailleurs, la commission a constaté que de nombreux dossiers de ressortissants rwandais résidant actuellement en Belgique ou à l'étranger font l'objet de procédures judiciaires. La Cour de cassation a rendu un certain nombre d'arrêts de dessaisissement en faveur du Tribunal pénal international d'Arusha.
Un nombre important de dossiers ont fait l'objet de conclusions adressées au parquet par le juge d'instruction. La commission ne peut que constater la faiblesse des moyens mis à la disposition de l'instruction dans ces affaires. Elle constate, en outre, que le parquet de Bruxelles n'a pas fait ou ne fait pas preuve de diligence en ce qui concerne la suite de la procédure, qui paraît bloquée au stade actuel.
Enfin, la commission n'a pas obtenu de réponse à la question de savoir quelles ont été les raisons qui ont poussé l'avocat général à prononcer, dans l'affaire Vincent N., un réquisitoire contraire à ses propres conclusions et à la position prise depuis de longs mois par le parquet.
Outre ces manquements, la commission estime que la communication entre le Gouvernement et le Parlement à propos du dossier Rwanda a laissé beaucoup à désirer. Certes, le Parlement, du moins pendant la mission de paix, a-t-il fait preuve à quelques exceptions près de trop peu d'intérêt pour la question rwandaise. Mais le Gouvernement l'a insuffisamment informé. Tant avant qu'après les événements du 7 avril, le Gouvernement n'était pas suffisamment disposé à fournir cette information et les ministres des Affaires étrangères et de la Défense nationale de l'époque et actuels ont donné au Parlement une description incomplète et donc imprécise de la connaissance qu'avait le Gouvernement belge pendant la période en question, de novembre 1993 à avril 1994.
En conclusion de ses travaux, la commission retient les recommandations suivantes :
L'armée belge étant régulièrement engagée dans des opérations de maintien de la paix à l'étranger, elle doit consacrer une attention particulière à l'accueil et à l'accompagnement des familles des victimes éventuelles.
1. Lorsqu'il y a des victimes à déplorer dans le cadre desdites opérations, les membres de leur famille ont toujours le droit de connaître toute la vérité sur les événements. Il y a lieu, dès lors, d'adapter la procédure d'information des familles. Il importe que les familles soient averties du décès de leurs proches avant toute diffusion à la presse. Il faut, en outre, le faire de manière digne et humaine. L'armée belge doit permettre à la famille du défunt de voir celui-ci si elle le désire, et veiller à la préparer suffisamment à affronter cette épreuve.
2. Les membres de la famille ont en outre pleinement le droit de rendre hommage à leurs défunts de la manière qu'ils choisissent. Les règles du protocole doivent à cette occasion céder le pas aux souhaits des proches.
3. Il faut que les familles puissent bénéficier de l'assistance d'un personnel social, médical et psychologique spécialement formé pour gérer les situations difficiles de ce type. Les familles doivent être informées par des documents clairs.
4. La décision de prendre part à une opération de paix de l'ONU doit résulter d'une analyse approfondie qui tienne compte des aspects humanitaires, politiques et militaires de l'opération. Cette analyse doit constituer le fondement du processus décisionnel. En tout cas, le Gouvernement doit veiller, en cas de participation à une mission, à ce qu'une série de conditions soient remplies, de manière que la sécurité des troupes soit assurée au maximum et que les chances de réussite de la mission soient optimalisées.
5. Dans le cadre d'une participation à une opération de l'ONU, il ne peut pas y avoir de confusion, ni pour les pays participants, ni pour le pays visé par l'opération, entre, d'une part, la mission de l'ONU et, d'autre part, les liens passés et présents qui existent entre les pays concernés. C'est pourquoi, il serait souhaitable que la Belgique ne fournisse plus de contingent aux opérations de l'ONU menées dans des pays avec lesquels elle a entretenu jadis des relations coloniales. Cependant, cela ne saurait empêcher la Belgique de mener, en cas de besoin, de sa propre initiative, des missions d'évacuation dans ces pays.
6. La commission juge qu'il n'est pas souhaitable que la Belgique mène une coopération technique militaire simultanément avec une opération de paix de l'ONU. En effet, ce faisant, elle crée ainsi des situations équivoques, voire conflictuelles, ce qui n'est pas favorable à une bonne coopération sur place. Il convient de suspendre complètement la CTM, le cas échéant, pour la durée de l'opération.
7. La commission estime que le Gouvernement doit définir une série de principes et de critères pour la participation de notre pays à de futures opérations de paix de l'ONU, et qu'il doit en assurer l'application et l'évaluation. Pour définir ces principes et critères, il faut s'inspirer des propositions qui ont été formulées dans des rapports d'évaluation antérieurs.
8. Il y a lieu de vérifier si les moyens en personnel, en équipement et en armement ainsi que les moyens financiers nécessaires sont suffisants. Les moyens dont on dispose dès le début de l'opération doivent permettre réellement d'assurer au maximum la protection et la sécurité du personnel.
9. Il faut prévoir un nombre suffisant d'hommes (qui ne doivent pas nécessairement tous être Belges, mais qui doivent être des partenaires opérationnels et crédibles) et un armement suffisant pour que le contingent belge puisse faire face à toutes les éventualités (« worst case »). Dans sa proposition, l'état-major général doit toujours veiller à ce que le détachement belge puisse créer sa propre réserve mobile.
10. À ce sujet, il serait souhaitable que l'on s'assure de la fiabilité et de la capacité opérationnelle des partenaires éventuels à la mission de paix. L'on doit veiller de près à ce que les autres contingents étrangers avec lesquels on doit coopérer, soient suffisamment crédibles et disposent eux-mêmes de l'appui logistique nécessaire. Bien qu'un accord de principe puisse être signifié au préalable, la Belgique ne pourra en aucun cas encore envoyer des Casques bleus en mission avant de connaître la composition complète de la force de l'ONU et qu'il y ait un engagement officiel concernant la contribution de tous les pays participants. Il faut éviter à tout prix de reproduire une situation dans laquelle on est obligé de chercher un contingent supplémentaire qui soit suffisamment crédible, alors même que les troupes belges sont sur place et que la composition incomplète ou déséquilibrée de la force de l'ONU leur fait courir des risques superflus.
11. En ce qui concerne le nombre et la nature des missions, l'état-major général devra toujours, lorsque l'opération de la force d'intervention internationale mixte comprend une mission de QRF, s'efforcer systématiquement de confier cette mission à un détachement belge. Il ne pourra déroger à ce principe que dans les cas où un partenaire absolument crédible fournira ladite QRF.
12. Le mandat conféré dans le cadre d'une opération de maintien de la paix est défini par le Conseil de sécurité des Nations unies. Les pays qui fournissent des troupes en vue de ce type d'opération doivent être associés à la définition du mandat. Le mandat doit d'ailleurs être conçu de manière que les missions puissent être modifiées au cas où l'une des parties concernées n'en respecterait pas l'exécution.
13. Du point de vue politique belge, cela signifie qu'en cas de décision de participer à une opération de maintien de la paix, il y a lieu de tenir compte non seulement de la situation telle qu'elle se présente, mais aussi de l'éventualité d'un scénario « worst case ». Du point de vue militaire, cela signifie que l'on doit tenir compte, pour ce qui est du choix de l'armement et dans le cadre de la préparation des troupes, de l'éventualité d'une aggravation de la situation, même si rien ne l'annonce au moment de la préparation.
14. Les règles d'engagement doivent être simples, claires et explicites. En outre, le commandement de la force de maintien de la paix et, au besoin, le commandement du contingent belge doivent les traduire en directives militaires compréhensibles à l'usage des troupes. Les règles d'engagement doivent être suffisamment souples pour pouvoir être adaptées à la détérioration de la situation.
15. Nos troupes doivent recevoir une formation adaptée à la mission qui sera la leur dans le cadre des opérations de maintien de la paix. Chaque détachement doit recevoir un entraînement spécifique, pendant le temps nécessaire, en vue de la mission qu'il aura à accomplir à l'étranger. Cette formation doit comprendre un briefing complet sur leur mission et un exposé détaillé et pratique concernant les règles d'engagement, le comportement à adopter sur place et la situation qui règne dans le pays où les troupes seront envoyées.
16. La commission propose, par analogie avec ce qui se fait dans les pays scandinaves, que la Belgique dispense aux cadres et éventuellement aux troupes des forces armées et/ou de la future mission de maintien de la paix, une formation spéciale qui leur permettra de jouer leur nouveau rôle de « peacekeepers » et de « peace-enforcers« . La formation pourrait être dispensée, dans un cadre plus large, comme celui de l'UEO, de l'OTAN ou de l'ONU.
Cette préparation ne peut pas se faire au détriment de l'entraînement militaire normal. Elle ne peut pas compromettre ni du point de vue matériel, ni du point de vue psychologique, la possibilité d'engager les troupes en cas de conflit armé. Les « missions de police » ne peuvent pas hypothéquer le caractère opérationnel et militaire.
17. Il y a lieu d'expliquer et de commenter en langage clair le mandat et les règles d'engagement à l'état-major et aux hommes jusqu'aux échelons inférieurs du contingent. L'on ne peut pas se contenter d'une information « en cascade » comme celle qui a lieu au sein de la MINUAR.
18. Il faut prévoir un laps de temps nécessaire à la préparation des cadres militaires avant leur départ pour une mission de paix des Nations unies. En effet, ces cadres militaires, appelés à entrer directement en contact avec l'administration des Nations unies, devront recevoir des briefings (leçons) détaillés pour qu'ils puissent se familiariser avec les procédures budgétaires, financières, administratives et logistiques des Nations unies.
19. Avant qu'un détachement belge ne parte en mission au service des Nations unies, le logement des troupes doit avoir été réglé de manière que la sécurité et les besoins opérationnels de la mission ne puissent être compromis. Un contrôle devra être effectué sur place par des militaires belges.
20. Lorsqu'un détachement belge accomplit une mission à l'étranger, les troupes doivent pouvoir disposer de tous les moyens opérationnels modernes qu'elles ont utilisés au cours de leur formation et de leur entraînement. Les responsables ne peuvent pas invoquer des raisons budgéraires pour engager nos troupes avec du matériel vétuste.
21. Le matériel de transmission et de communication doit être adapté aux exigences de la mission à accomplir. Nos troupes à l'étranger doivent disposer de radios de combat modernes et de suffisamment de moyens de communication mobiles, et ce, jusqu'aux échelons les plus bas.
22. Les unités qui participent à des opérations de l'ONU doivent au moins pouvoir disposer de leur armement organique complet. La qualité de leur armement doit être au moins égale à celle des belligérants (potentiels). L'ONU peut fixer les modalités d'utilisation de certains systèmes d'armement, mais les unités belges se réservent le droit d'acheminer sur place tous les systèmes d'armement qu'elles jugent nécessaires ou utiles à leur propre sécurité dans les situations difficiles. En cas de légitime défense, les unités en question doivent avoir expressément le droit de se défendre avec toutes les armes disponibles.
23. Lorsque le commandant d'un détachement belge à l'étranger adresse une demande au centre d'opérations à Evere en vue d'obtenir des munitions ou du matériel, cette demande doit être examinée le plus rapidement possible et, le cas échéant, exécutée dans le délai demandé.
24. La commission estime qu'il est indiqué que le mandat de la mission de paix consacre une attention particulière aux campagnes médiatiques de dénigrement et, plus précisément, aux appels à la déstabilisation et à la violence.
25. L'une des premières tâches du détachement sur place est de prévoir un plan d'évacuation applicable militairement et un scénario « worst case ». Ce plan et ce scénario doivent être communiqués le plus rapidement possible jusqu'aux échelons inférieurs, et il y a lieu d'organiser le plus rapidement possible un exercice pour le cas où ce plan devrait être mis en oeuvre ou pour le cas où ce scénario se produirait.
26. Dans des situations de crise, les responsables militaires de la mission de paix sur le terrain doivent pouvoir interpréter le mandat ou les ROE, si ceux-ci ne sont pas suffisamment clairs pour que l'on puisse réagir à la situation.
27. Les conseillers en droit des conflits armés doivent recevoir une formation de haut niveau. Leur capacité à communiquer avec le personnel et à lui fournir des explications didactiques doit être évaluée. Ces personnes doivent être hautement qualifiées et satisfaire à des critères sévères.
28. L'ONU doit mettre en place son propre service de renseignements, tant à New York que sur le terrain. Ce service se consacrerait notamment à l'alerte rapide (early warning) , c'est-à-dire la détection précoce, sur la base des éléments disponibles, des sources possibles de conflit. À cet effet, il y a lieu de mettre en place un réseau d'experts, qui recueillerait les informations. L'on pourrait également avoir recours à la coopération avec les organisations internaitonales de sécurité régionale existantes (OUA, OSCE, etc.).
29. Le contingent belge doit toujours disposer d'un réseau de renseignement solide qui lui soit propre, composé d'officiers de renseignements suffisamment formés et maîtrisant, si possible, la langue du pays. À défaut, on doit disposer en permanence d'interprètes dignes de confiance.
30. Pour l'analyse des renseignements, le SGR doit disposer de suffisamment d'analystes, qui évalueront le contenu de chaque information. En outre, il doit y avoir un retour d'information systématique à l'adresse des unités sur le terrain.
31. L'ONU doit disposer sur le terrain d'une cellule d'information chargée d'expliquer la mission de la force de paix à la population locale et d'entretenir les contacts avec les médias locaux et internationaux.
32. Il faut créer, à l'échelon des interforces, une structure de commandement responsable, devant le chef d'état-major général, de toutes les activités afférentes à la préparation, à l'exécution, au contrôle et au suivi des opérations.
33. Le centre d'opération doit disposer du personnel le plus compétent et le plus expérimenté, ainsi que des techniques les plus modernes, en matière de télécommunications et d'informatique.
34. Les états-majors des diverses forces et les commandants hiérarchiques des unités désignées doivent être directement associés à la coordination et la direction des opérations.
35. Il faut désigner avec précision les compétences et les responsables des divers échelons. Il faudra en outre fixer avec soin la répartition des compétences et des responsabilités entre l'autorité nationale et le commandement de l'ONU.
36. Il convient de réformer le service du renseignement militaire (SGR), notamment en tenant compte de la nouvelle loi sur les services de renseignements et de sécurité. Ce service doit avant tout devenir un instrument efficace et cohérent de soutien pour les responsables des opérations tant au niveau de l'état-major général que pour les responsables sur le terrain. Il convient d'améliorer considérablement les capacités d'analyse et, de plus, de les mettre à profit pour élaborer des options politiques à l'intention des responsables. On devra veiller à assurer la diversité des sources d'information et le caractère contradictoire des analyses. Il importe en outre d'organiser un retour d'information permanent entre le SGR et les commandants responsables sur le terrain. Le SGR doit être informatisé et pouvoir fonctionner avec rapidité, précision et souplesse.
37. Le SGR doit pouvoir renforcer les unités déployées sur le terrain dans le domaine du renseignement; notamment par la mise à disposition d'équipes de personnel spécialisé ou par des moyens techniques.
38. Il faudra dispenser une formation spécifique aux officiers de renseignements qui pourront faire une partie de leur carrière en tant que spécialistes en la matière au sein de la branche 2.
39. Il faut optimiser la transmission des informations entre l'état-major et le cabinet de la Défense nationale. Les rapports des briefings du chef d'état-major général au centre d'opérations d'Evere doivent être envoyés quotidiennement au ministre. Le ministre doit assurer, si besoin, le suivi des informations qu'il reçoit de cette manière.
40. En ce qui concerne la décision de participer à une mission de paix des Nations unies ainsi que la préparation et le déroulement de cette opération, il serait opportun que le Gouvernement dispose de l'avis écrit du chef d'état-major général.
41. La commission estime que la coordination entre les ministères des Affaires étrangères et de la Défense nationale ne peut pas se limiter à des questions de second ordre et à des contacts ponctuels. Elle doit être organisée de manière structurelle et au plus haut niveau politique.
42. La commission suggère qu'un représentant du département des Affaires étrangères assiste aux réunions quotidiennes du centre d'opérations, particulièrement au briefing du SGR, chaque fois que la Belgique participe à une opération militaire à l'étranger.
43. Le Gouvernement belge doit disposer d'un instrument d'analyse et de coordination pour préparer la politique par la collecte, l'analyse et la transposition de recommandations des informations émanant des diverses sources de renseignements disponibles (Affaires étrangères, SGR, Sûreté de l'État et autres). Concrètement, en ce qui concerne l'Afrique, il est urgent de prêter plus d'attention au renforcement de la cellule « Afrique » du département des Affaires étrangères, et de prévoir davantage de moyens pour accroître son efficacité.
44. Les officiers d'état-major que l'armée belge délègue dans les quartiers généraux opérationnels de l'ONU doivent être sélectionnés sur la base de leur compétence professionnelle pour la fonction requise, et doivent être aptes à fonctionner dans le cadre d'une équipe internationale. Il y a lieu de sélectionner par priorité les officiers qui maîtrisent la langue du milieu de travail.
45. Si le Force Commander est un officier de l'armée belge, il doit pouvoir faire des recommandations concernant la désignation des officiers belges de son état-major.
46. Toute fonction exercée dans un quartier général de l'ONU doit offrir au moins autant de possibilités de promotion qu'une carrière classique au sein des forces armées.
47. Il convient de procéder à un débriefing approfondi et détaillé après chaque opération militaire à l'étranger. Dans la perspective de missions ultérieures, il faudra traduire en directives opérationnelles les constations que ce débriefing aura permis de faire et les transmettre à toutes les instances militaires concernées et au Gouvernement.
48. En ce qui concerne les Nations unies, la commission s'est bornée à examiner les aspects du fonctionnement de cette organisation qui sont liés aux missions de maintien de la paix du type de celles du Rwanda.
Elle renvoie au « Rapport d'ensemble sur les enseignements tirés de la mission des Nations unies pour l'assistance au Rwanda », publié par le département des opérations de la paix de l'ONU en décembre 1996, ainsi qu'à l'étude du « Joint Évaluation of Emergency Assistance to Rwanda » (publié en mars 1996).
La commission invite par ailleurs la commission des Affaires étrangères du Sénat à se pencher, dans les meilleurs délais, sur la question des nécessaires réformes qu'il convient d'apporter aux structures et au fonctionnement des Nations unies et de son Conseil de sécurité en ce qui concerne les situations de crise et les opérations de paix.
49. Dans l'attente des suggestions de réformes de la commission des Affaires étrangères, la commission estime, en tout état de cause, que le Conseil de sécurité doit être tenu d'examiner immédiatement les rapports de la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Il faut tenir compte de ces rapports et entendre les rapporteurs spéciaux sur les droits de l'homme dans le cadre d'une prise de décision relative à l'envoi d'une mission de paix.
50. Il est indiqué que chacun des pays qui ont été, d'une façon ou d'une autre, associés aux événements du Rwanda, et les Nations unies elles-mêmes en fassent une analyse et une évaluation approfondies. Aussi le Sénat de Belgique demande-t-il aux parlements des différents pays d'examiner ce problème.
51. Après chaque mission, l'ONU doit immédiatement constituer une cellule d'évaluation dans laquelle siègent les pays participants. Le rapport de cette cellule est transmis aux divers gouvernements qui peuvent le mettre à la disposition de leur Parlement pour évaluation. À la demande du parlement, le rapporteur de l'ONU peut être entendu à ce sujet.
Enquête internationale sur l'assassinat des présidents du Burundi et du Rwanda en avril 1994
52. Les nations unies doivent prendre l'initiative de mener une enquête internationale sur l'assassinat des présidents du Burundi et du Rwanda en avril 1994.
53. La commission estime qu'il y a lieu d'intégrer dans le droit pénal interne des dispositions sanctionnant les crimes contre l'humanité, et particulièrement le crime de génocide.
54. Lorsque notre pays participe à une mission à l'étranger, un groupe de travail de la commission des Affaires étrangères du Sénat en suivra les développements de près et en informera le Parlement.
55. La commission invite le Gouvernement à faire rapport au Sénat, une fois par an pendant les cinq années à venir, sur les progrès qui auront déjà été faits dans l'exécution des présentes recommandations.
A. Membres effectifs
Le chapitre 1er a été adopté à l'unanimité par les 15 membres effectifs.
B. Membres ayant voix consultative
Les 3 membres ont émis un avis positif au sujet du chapitre 1er .
A. Membres effectifs
Le chapitre 2 a été adopté à l'unanimité des 15 membres effectifs.
B. Membres ayant voix consultative
Les 3 membres ont émis un avis positif au sujet du chapitre 2.
A. Membres effectifs
Le chapitre 3 a été adopté à l'unanimité des 15 membres effectifs.
B. Membres ayant voix consultative
Les 3 membres ont émis un avis positif au sujet du chapitre 3.
A. Membres effectifs
L'introduction du chapitre 4 a été adoptée à l'unanimité des 15 membres effectifs.
B. Membres ayant voix consultative
Les 3 membres ont émis un avis positif au sujet de l'introduction du chapitre 4.
A. Membres effectifs
Le titre 4.1 a été adopté à l'unanimité des 15 membres efffectifs.
B. Membres ayant voix consultative
Les 3 membres ont émis un avis positif au sujet du titre 4.1.
A. Membres effectifs
Le titre 4.2 a été adopté par 14 membres effectifs et 1 abstention.
B. Membres ayant voix consultative
Les 3 membres ont émis un avis positif au sujet du titre 4.2.
A. Membres effectifs
Le titre 4.3 a été adopté à l'unanimité des 15 membres effectifs.
B. Membres ayant voix consultative
Les 3 membres ont émis un avis positif au sujet du titre 4.3.
A. Membres effectifs
Le titre 4.4 a été adopté par 11 membres effectifs et 4 abstentions.
B. Membres ayant voix consultative
Les 3 membres ont émis un avis positif au sujet du titre 4.4.
A. Membres effectifs
Le titre 4.5 a été adopté à l'unanimité des 15 membres effectifs.
B. Membres ayant voix consultative
Les 3 membres ont émis un avis positif au sujet du titre 4.5.
A. Membres effectifs
Le titre 4.6 a été adopté à l'unanimité des 15 membres effectifs.
B. Membres ayant voix consultative
Les 3 membres ont émis un avis positif au sujet du titre 4.6.
A. Membres effectifs
Le titre 4.7 a été adopté par 14 membres effectifs et 1 abstention.
B. Membres ayant voix consultative
Les 3 membres ont émis un avis positif au sujet du titre 4.7.
A. Membres effectifs
Le titre 4.8 a été adopté à l'unanimité des 15 membres effectifs.
B. Membres ayant voix consultative
Les 3 membres ont émis un avis positif au sujet du titre 4.8.
A. Membres effectifs
Le titre 4.9 a été adopté à l'unanimité des 15 membres effectifs.
B. Membres ayant voix consultative
Les 3 membres ont émis un avis positif au sujet du titre 4.9.
A. Membres effectifs
Le titre 4.10 a été adopté à l'unanimité des 15 membres effectifs.
B. Membres ayant voix consultative
Les 3 membres ont émis un avis positif au sujet du titre 4.10.
A. Membres effectifs
Le titre 4.11 a été adopté à l'unanimité des 15 membres effectifs.
B. Membres ayant voix consultative
Les 3 membres ont émis un avis positif au sujet du titre 4.11.
A. Membres effectifs
Le titre 4.12 a été adopté à l'unanimité des 15 membres effectifs.
B. Membres ayant voix consultative
Les 3 membres ont émis un avis positif au sujet du titre 4.12.
A. Membres effectifs
Le titre 4.13 a été adopté à l'unanimité des 15 membres effectifs.
B. Membres ayant voix consultative
Un membre a émis un avis positif au sujet du titre 4.13; 2 membres se sont abstenus.
A. Membres effectifs
Le titre 4.14 a été adopté à l'unanimité des 15 membres effectifs.
B. Membres ayant voix consultative
Les 3 membres ont émis un avis positif au sujet du titre 4.14.
A. Membres effectifs
Le titre 4.15 a été adopté à l'unanimité des 15 membres effectifs.
B. Membres ayant voix consultative
Les 3 membres ont émis un avis positif au sujet du titre 4.15.
A. Membres effectifs
Le titre 4.16 a été adopté à l'unanimité des 15 membres effectifs.
B. Membres ayant voix consultative
Les 3 membres ont émis un avis positif au sujet du titre 4.16.
A. Membres effectifs
Le titre 4.17 a été adopté à l'unanimité des 15 membres effectifs.
B. Membres ayant voix consultative
Les 3 membres ont émis un avis positif au sujet du titre 4.17.
A. Membres effectifs
Le dernier paragraphe du chapitre 4 a été adopté à l'unanimité des 15 membres effectifs.
B. Membres ayant voix consultative
Un membre a émis un avis positif au sujet du dernier paragraphe du chapitre 4; 2 membres se sont abstenus.
A. Membres effectifs
L'ensemble du chapitre 4 a été adopté à l'unanimité des 15 membres effectifs.
B. Membres ayant voix consultative
Un membre a émis un avis positif sur l'ensemble du chapitre 4; 2 membres se sont abstenus.
A. Membres effectifs
Le chapitre 5 a été adopté à l'unanimité des 15 membres effectifs.
B. Membres ayant voix consultative
Les 3 membres ont émis un avis positif au sujet du chapitre 5.
A. Membres effectifs
Les 15 membres effectifs ont approuvé le présent rapport à l'unanimité.
B. Membres ayant voix consultative
Un membre a émis un avis positif au sujet du rapport; 2 membres se sont abstenus.
| Les rapporteurs,
Philippe MAHOUX. Guy VERHOFSTADT. |
Le président,
Frank SWAELEN. |
(1) Sénat, proposition Coveliers, Doc. 1-234-1.
(2) Sénat, proposition Destexhe, Doc. 1-259-1.
(3) Voir annexe.
(4) Doc. Sénat, 1996-1997, 1-611/1.
(5) Doc. Sénat, 1996-1997, 1-611/2.
(6) CRA, Sénat, 1996-1997, p. 1578.
(7) Doc. Sénat, 1996-1997, 1-611/3.
(8) Doc. Sénat, 1996-1997, 1-611/4.
(9) Doc. Sénat, 1996-1997, nº 1-611/1.
(10) CRA nº 1-1, Sénat, 1996-1997.
(11) CRA nº 1-2, Sénat, 1996-1997.
(12) CRA nº 1-2, Sénat, 1996-1997.
(13) CRA nº 1-96, Sénat, 1996-1997.
(14) Voir annexe.
(15) Art. 4, § 1er de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires
(16) Art. 4, § 2 de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires.
(17) Art. 4, § 4 de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires
(18) Art. 4, § 3 de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires.
(19) Art. 4, § 5 de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires.
(20) Art. 4, § 6 de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires.
(21) Doc. Sénat, 1996-1997, 1-526/1, Sénat, Annales, 1996-1997, 23 janvier 1997, p. 2336.
(22) Voir annexe.
(23) Communiqué Belga du 24 septembre 1997.
(24) « Le coupable de faux témoignages, ... seront punis d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et privés de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. »
(25) PRUNIER G., The Rwandese crisis (1959-1994), London, Hurst, 1995.
(26) Le chiffre de 90,4 % de Hutus figure dans le « Joint evaluation report », tandis que l'édition 1996 de « Africa south of the Sahara » évoque le chiffre de 85 %.
(27) ANDRÉ Catherine, « Économie Rwandaise : d'une économie de subsistance à une économie de guerre, vers un renouveau ? » dans MARYSSE, S. en REYNTJENS, F., (éd.) L'Afrique des Grands Lacs, Annuaire 1996-1997, Paris-Montréal, l'Harmattan, 1997.
(28) MATON J., Développement économique et social au Rwanda entre 1980 et 1993. Le dixième décile en face de l'apocalypse, Gand, Université de Gand, novembre 1994, p. 29.
(29) MAY J.-F., Urgences et Négligences : Pression Démographique et Réponses Politiques au Rwanda (1962-1994). Thèse de doctorat de démographie, Tome 1, Paris, Université Paris V René Descartes, 1996.
(30) MARYSSE S., DE HERDT T., NDAYAMBAJE E., « Rwanda Appauvrissement et ajustement structurel », Cahiers Africains, nº 12, Bruxelles, Institut Africain-CEDAF, Paris, L'Harmattan, 1994, p. 27.
(31) MARYSSE S., DE HERDT T., NDAYAMBAJE E., op. cit., tableau p. 31.
(32) MARYSSE S., DE HERDT T., NDAYAMBAJE E., op. cit., tableau p. 35.
(33) SELLSTRÖM T., WOHLGEMUTH L., Joint evaluation of emergency assistance to Rwanda, the international response to conflict and genocide, lessons from the Rwanda experience, study 1, Historical Perspective : some explanatory factors, mars 1996.
(34) Ibidem.
(35) INTERNATIONAL MONETARY FUND, International Financial Statistical Yearbook, vol. XLIX, Washington, 1996, p. 163.
(36) GOUVERNEMENT DU RWANDA, op. cit., p. 16.
(37) MATON, J., op. cit., pp. 35-36.
(38) MARYSSE, S., DE HERDT, T., NDAYAMBAJE, E., op. cit., tableau p. 34.
(39) Ibidem.
(40) MARYSSE, S., DE HERDT, T., NDAYAMBAJE, E., op. cit., tableau p. 53.
(41) MATON, J., op. cit., p. 36.
(42) MARYSSE, S., « Income Distribution and Political Economy of Rwanda », EUROPEAN ASSOCIATION OF DEVELOPMENT RESEARCH AND TRAINING INSTITUTES, Emerging Development Patterns : European Contributions, Budapest, Institute for World Economy of the Hungarian Academy of Sciences, 1983, p. 205.
(43) SECRÉTARIAT PERMANENT DU COMITÉ DE CRISE À KIGALI ET UNICEF, « Rwanda/Burundi », Bulletin d'Information Aides d'Urgence. Rwanda-Burundi, nº C 4, Kigali, 1 avril 1994, pp. 1-3.
(44) Pour le texte complet voir : Audition de M. Degni-Segui, CRA, CER, Sénat, 1996-1997, 17 juin 1997, p. 760.
(45) MATON, J., op. cit.
(46) MIGEOTTE, F., dans son article « L'émergence d'un marché de location du bétail dans les conditions de forte pression démographique », Cahiers de la Faculté des Sciences Economiques et Sociales, nº C 163, Namur, Facultés Universitaires de la Paix, 1996, montre comment le bétail associé à l'agriculture représente un moyen d'intensification mais aussi de quelle manière sa fonction et sa perception ont changé dans un contexte de forte pression démographique de la région du Nord de Gitarama.
(47) AUSTIN, G., The effects of the Governement Policy on the Ethnic Distribution of Income and Wealth in Rwanda : a Review of Published Sources, London, Departement of Economic History, London School of Economics, 1996.
(48) MARYSSE S., DE HERDT T., NDAYAMBAJE E., op. cit.
(49) ANDRE, C., PLATTEAU, J.-P., « Land Tenure under Unendurable Stress : Rwanda Caught in the Malthusian Trap » Journal of Economic Behavior and Organization, 1997 (à paraître), mais déjà disponible dans Cahiers de la Faculté des Sciences Economiques et Sociales, nº C 164, Namur, Facultés Universitaires de la Paix, January 1996; ANDRE, C.; « Les Femmes et la Terre », DE LAME D. (ed.), Collines rwandaises au Crépuscule. L'étude comparative de Communautés Rurales, Tervuren, Musée Royal de l'Afrique Centrale, 1997 (à paraître).
(50) SELLSTRÖM T., WOHLGEMUTH L., op. cit., p. 16.
(51) Ibidem, p. 16.
(52) SELLSTRÖM T., WOHLGEMUTH L., op. cit., p. 39.
(53) REYNTJENS, F., L'Afrique des Grands Lacs en crise, Karthala, Paris, 1994, p. 167.
(54) SELLSTRÖM T., WOHLGEMUTH L., op. cit., p. 40.
(55) MATON, J., op. cit. , p. 10.
(56) MATON, J., ibidem, REYNTJENS, F., op. cit. , p. 117.
(57) Pour plus d'informations, voir KAGABO, J. et MUDANDAGIZI, V. , Complainte des gens de l'argile. Les Twa du Rwanda, dans Cahier d'études africaines, 1974, pp. 75-87.; D'HERTEFELT, M. et GANSEMANS, J., Omtrent de Twa van Rwanda. Een vraaggesprek, dans Africa, Tervuren, 1981, nº C 1, p. 1-18.
(58) VANSINA, J., L'évolution du royaume Rwanda, des origines à 1900, Bruxelles, ARSOM, 1962; DE HEUSCH, L., Le Rwanda et la civilisation interlacustre, Bruxelles, ULB, Institut de Sociologie, 1966.
(59) D'HERTEFELT, M., Le clan du Rwanda ancien, Tervuren M.R.A.C., 1971, p. 85.
(60) VANSINA, Évolution du royaume Rwanda des origines à 1900, Bruxelles, A.R.S.O.M., 1962, p. 56.
(61) NEWBURY C., The Cohesion of oppression. Clientship and ethnicity in Rwanda 1860-1960 , New York, Columbia University Press, 1988.
(62) D'HERTEFELT, M., Les royaumes de la zone interlacustre dans D'HERTEFELT, TROUBORST et SCHERER (Eds), Les anciens royaumes de la zone interlacustre méridionale : Rwanda - Burundi, BUHA, 1962, VANSINA, J., op. cit.
(63) MAIR, L.P., Native policies in Africa, London, George ROUTLEDGE and Co., 1936, p. 118.
(64) JAMOULLE, M., Notre mandat sur le Ruanda-Urundi, in Congo, 1927, p. 487.
(65) SANDERS, E.R., The Hamitic Hypothesis : its origin and functions in time perspective , dans Journal of African history, 1969, p. 521.
(66) LEMARCHAND, R., Rwanda and Burundi, London, Pall Mall Press, 1970, p. 138
(67) HARROY, J.-P, Rwanda. De la féodalité à la démocratie , Bruxelles-Paris, Hayez, Académie des sciences d'Outre-mer, 1984, p. 292.
(68) GASANA, K., La guerre, la paix et la démocratie au Rwanda, in. GUICHAOUA, A., Les crises politiques au Burundi et au Rwanda (1993-1994), Lille/PARIS, UST/Kartala, 1995.
(69) Au sujet de la révolution rwandaise voir ATTERBURY, C., Revolution in Rwanda, Madison, African studies programs, 1970; LEMARCHAND, Rwanda and Burundi, Londres, Pallmann press, 1970, pp. 344-347; J.P HARROY, Rwanda..., op. cit pp. 299-332; REYNTJENS, F., Pouvoir et Droit au Rwanda. Droit public et évolution politique, 1916-1973, Musée royal de l'Afrique centrale, Tervueren, Belgique, 1985, pp. 233-304.
(70) GUICHAOUA, A., Le problème des réfugiés rwandais et des populations banyarwanda dans la région des Grands Lacs africains, Genève, HCR, mai 1962, pp. 16-19.
(71) REYNTJENS, F., L'Afrique des Grands Lacs en crise, op. cit., p. 27.
(72) L'expression est de J.-P. CHRÉTIEN, Rwanda. Les médias du Génocide, Karthala, Paris, p. 12.
(73) Discours du président KAYIBANDA reproduite dans Le Président KAYIBANDA vous parle , 1964, pp. 83-84 et dans « Décolonisation et indépendance du Rwanda et du Burundi, chronique de politique étrangère », 1963, p. 482.
(74) REYNTJENS, F., Pouvoir et Droit..., op. cit., pp. 454-473-498.
(75) CHRÉTIEN, J.-P., Rwanda. Les médias du génocide, op. cit., p. 11.
(76) REYNTJENS, F., L'Afrique des grands lacs en crise, op. cit., pp. 27-28.
(77) SELLSTRÖM, T., WOHLGEMUTH, L., op. cit.; voir également : CHRÉTIEN, J.-P., « Pluralisme démocratique, ethnisme et stratégies politiques », Conac (éd.) : L'Afrique en transition vers le pluralisme politique : pp. 139-147.
(78) Audition du professeur Reyntjens, CRA, CSR, Sénat, 1996-1997, 26 février 1997, p. 25.
(79) SELLSTRÖM T., WOHLGEMUTH, L., Joint evaluation of emergency assistance to Rwanda, the international response to conflict and genocide, lessons from the Rwanda experience, stydy 1, Historical Perspective : some explanatory factors.
(80) Audition du professeur Reyntjens, CRA, CSR, Sénat, 1996-1997, 26 février 1997, p. 30.
(81) Publié dans La Relève, nº 154 du 28 décembre 1992.
(82) Résumé en français publié dans le rapport de la Commission nationale de synthèse sur les affrontements politiques au Rwanda, Kigali, mars 1991, p. 96.
(83) The United Nations and Rwanda, 1993-1996, The United Nations Blue Books Series, Volume X, doc. 19, p. 169.
(84) Ibidem, doc. 6, p. 153.
(85) Ibidem, doc. 19, p. 169.
(86) Sauf tout à la fin, le Préfet de Butare, qui fut tué durant le génocide.
(87) Savoir y faire avec les étrangers constituait un atout important, compte tenu du nombre élevé de projets d'aide et des importants effectifs d'expatriés qui y étaient affectés. Les hommes tutsis savaient comment traiter les employeurs blancs, et leurs femmes étaient même expertes en la matière. Les relations inter-raciales et les mariages entre femmes rwandaises et hommes expatriés étaient fréquents et, dans plus de 95 % des cas, ces femmes étaient des Tutsis, fait qui provoqua une forme de jalousie (étant donné les avantages sociaux et financiers) et une espèce d'humiliation pour les autres ethnies : la préférence des Blancs pour la beauté et l'élégance des Tutsis rappelait aux autres ethnies l'époque où les Blancs méprisaient les « vilains primitifs » Hutus.
(88) Tout le monde portait une carte d'identité mentionnant l'appartenance ethnique de son titulaire (ubwoko) . Toute falsification visant à changer illégalement de classification ethnique (abaguze ubwoko ) était passible d'une peine de prison et/ou d'une amende.
(89) Déclaration du président Habyarimana au journaliste français Philippe Decraene du Monde (7 octobre 1982).
(90) Pfarrer Herbert Keiner, « Allmahlich schwand die Bewunderung für « Habis » « Regime », Frankfurter Randschau (5 novembre 1992).
(91) Slogan officiel de la « campagne électorale ».
(92) République Rwandaise, Mémoire présenté à la Deuxième Conférence des Nations unies sur les Pays les moins avancés , Paris (3-14 septembre 1990), p. 6. Il faut garder à l'esprit qu'en 1991, quelque 57,5 % de la population rwandaise était âgée de moins de 20 ans (Ministère du Plan, Recensement, op. cit., décembre 1991). Une partie de la violence du génocide s'explique par le fait qu'à la fin des années 1980, un grand nombre de jeunes chômeurs désoeuvrés s'était massé à Kigali et, dans une moindre mesure, dans les plus petites villes.
(93) André Guichaoua, Travail non rémunéré et développement rural au Rwanda : pratiques et perspectives , Genève, OIT, 1990.
(94) Alain Hanssen, Le désenchantement de la coopération. Enquête au pays des mille coopérants , Paris, L'Harmattan, 1989.
(95) À cet égard, il est intéressant de faire une lecture attentive de la revue catholique Dialogue . Son équivalent Kinyarwanda intitulé Kinyamaseka est devenu plus critique dans les années 1980.
(96) Le Rwanda arrivait en tête des pays bénéficiant de l'aide publique de la Suisse.
(97) Herbert Keiner, op. cit.
(98) Entretien de l'auteur avec un ancien fonctionnaire (Kigali, 4 juillet 1994). La raison pour laquelle on a laissé Kayibanda mourir de faim plutôt que de l'assassiner serait liée à la crainte superstitieuse du Président Habyarimana que son serment de fidélité envers l'ancien chef-d'État ne se retourne contre lui si l'ex-Président était mort dans une effusion de sang.
(99) Chronique d'Amnesty International , nº 118 (décembre 1985). Ces meurtres ne furent dévoilés que parce que Lizinde lui-même était tombé en disgrâce du régime après une tentative de renverser le Président Habyarimana en avril 1980. Après avoir passé quelques années en prison, son jugement en 1985 leva le voile sur les dessous sanglants du régime.
(100) « Le Rwanda, pays des vertes collines », Le Monde (1er mars 1973).
(101) Pierre Erny, Rwanda 1994 , Paris, L'Harmattan, 1994, est un parfait exemple de cet état d'esprit. Le livre du professeur Erny oscille entre une perplexité larmoyante sur l'inhumanité de l'homme envers l'homme, un plaidoyer pour le régime d'Habyarimana et une tentative de faire jouer au FPR le rôle de Satan pénétrant dans le jardin d'Éden. Le professeur Erny semble aussi croire qu'Amnesty International est une organisation dirigée par les francs-maçons (p. 226), ce qui rend ses déclarations nulles et non avenues pour les « esprits religieux ». Témoignant ainsi d'un manque évident de correction politique oecuménique, cet auteur considère que la différence d'attitude entre deux chrétiens pro-Habyarimana comme le pasteur Keiner et le Professeur Erny est imputable à leur religion respective. Le protestantisme s'est traditionnellement montré plus strict sur l'examen moral indépendant et l'autocritique que l'église romaine et en l'espèce, ses liens historiques avec le régime MRND sont moins marqués. Il ne faut pas oublier que jusqu'en décembre 1989, lorsque Rome lui intima l'ordre de démissionner, l'évêque de Kigali, Monseigneur Vincent Nsengiyumva, fut un membre actif au sein du comité central du MRND.
(102) République rwandaise, Mémoire présenté par le Rwanda à la Deuxième Conférence des Nations unies sur les Pays les moins avancés, op. cit., p. 3.
(103) « La petite maison ». Dans le Rwanda pré-colonial, c'était le nom donné au cercle réunissant les courtisans les plus proches du roi.
(104) On pourrait même dire que c'était plus que cela. C'était une revanche historique du Rwanda marginalisé, anti-royaliste et résolument pro-Hutu. C'est à cette revanche du nord que l'historien engagé Ferdinand Nahimana voulait donner ses lettres de noblesse intellectuelles. C'est aussi parce que ceux du nord ont eu si longtemps le sentiment d'être traités comme des citoyens de seconde zone que l'affaiblissement du pouvoir en 1993-94 les conduisit aux extrémités atroces du génocide.
(105) Thèse de Jean Shyirambere Barahinyura dans Le Général-Major Habyarimana (1973-1988). Quinze ans de tyrannie et de tartufferie au Rwanda, Frankfurt-am-Main: Izuba Verlag, 1988, p. 143. Bien que ce livre soit ni plus ni moins un véritable tract politique, il permet de mieux comprendre les rouages du régime.
(106) De ce point de vue, le cas du colonel Alois Nsekalije est, lui aussi, digne d'intérêt: il s'agissait d'un ami personnel du président, né dans sa région et ministre de longue date. Il fut finalement évincé du pouvoir parce qu'il était étranger au clan de Mme Habyarimana. Dans le même ordre d'idées, le sort du colonel Elie Sagatwa, un membre du clan de Madame qui changea par la suite de camp , n'est pas non plus sans intérêt (voir chapitre 7).
(107) André Guichaoua, Le problème des réfugiés rwandais, op. cit., p. 11.
(108) La famine de 1988-89 était due bien sûr à la marginalité extrême de l'agriculture rwandaise dans un contexte de déforestation, d'érosion du sol, de pression démographique, de sous-fertilisation et de choix difficiles des cultures. Mais elle est due également aux caprices politiques du marketing alimentaire et de la politique des prix. Voir Johan Pottier, « Taking stock: Food marketing in Rwanda (1982-1989) », African Affairs, nº 92, (1993), pp. 5-30.
(109) André Guichaoua, Le problème des réfugiés rwandais, op. cit., p. 12.
(110) Communication personnelle à l'auteur, Paris, 2 août 1994. Après avoir dénoncé une série de pratiques de corruption dans le projet Gebeka, notre informateur a dû se protéger contre des tentatives d'assassinat en recourant aux services de membres de sa famille enrôlés dans l'armée pour lui servir de gardes du corps.
(111) Voir Le Monde (20 juillet 1983 et 29 avril 1984). Ces arrestations constituaient une revanche personnelle contre des femmes qui éveillaient la jalousie. En 1984, l'ambassadeur des États-Unis a dû menacer de quitter le pays afin de faire libérer sa secrétaire gardée en détention.
(112) Amnesty International, Republic of Rwanda: a spate of detentions and trials in 1990 to suppress Fundamental Rights, London: A.1 (Octobre 1990).
(113) Au cours des quinze dernières années, la France s'était graduellement substituée à la Belgique dans le rôle de puissance tutélaire du Rwanda parce que ce pays offrait des garanties financières et surtout militaires que la Belgique ne pouvait offrir. En 1975, Paris signa avec Kigali un accord de coopération et de formation (mais pas un accord en matière de défense, ce qui rend illégale l'intervention française d'octobre 1990) et renforça régulièrement son aide économique. La France maintint plus de 400 coopérants au Rwanda et son aide au développement arrivait juste après celle de la Belgique avec USD 37,2 millions en 1990 (sources OCDE citées dans Economist Intelligence Unit, Rwanda: Country Profile, London: EIU, 1993, p. 18).
(114) Effrayé par les effets de son discours de La Baule en faveur de la démocratisation, le président Mitterrand changea radicalement de discours au cours des dix-huit mois suivants. Pour une analyse des contradictions de la politique de la France en Afrique, voir Antoine Glaxer et Stephen Smith, L'Afrique sans Africains, Paris: Stock, 1994.
(115) Le campus de Ruhengeri fut le théâtre d'une grève de solidarité et de nombreuses manifestations de sympathie.
(1a) Audition de M. Brouhns, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 28 février 1997, p. 46.
(2a) La représentation était composée des personnes suivantes : Baron P. Noterdaeme, ambassadeur, représentant permanent, 14 novembre 1987 M. H. Portocarero, Conseiller à la représentation, 17 août 1992 M. A. Brouhns, Premier Secrétaire de la Représentation, 30 octobre 1990 M. A. Cools, Premier Secrétaire de la Représentation, 29 août 1988 M. B. Dereymaeker, Premier Secrétaire de la Représentation, 1er septembre 1988 Mme J. Zikmundová, Premier Secrétaire de la Représentation, 4 septembre 1989, Mlle M. Fostier, Secrétaire de la Représentation, 29 août 1988 Mme N. Rossignol, Secrétaire de la Représentation, 2 juin 1993 M. G. Sleeuwagen, Secrétaire de la Représentation, 31 août 1992 M. B. Charlier, Secrétaire de la Représentation, 30 août 1992 M. P. Maddens, Attaché de la Représentation, 23 août 1992 M. F. Van De Craen, Attaché de la Représentation, 6 septembre 1992 M. O. Belle, Attaché de la Représentation.
(3a) Audition de M. Brouhns, CRA , Sénat, CSR, 1996-1997, 28 février 1997, p. 45.
(4a) Audition de MM. A. Brouhns et A. Cools, CRA , 28 février 1997, p. 45.
(5a) Ibid .
(6a) Ibid .
(7a) « Le Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales » (article 39).
(8a) An Agenda for Peace: Preventive Diplomacy, Peacemaking and Peace-Keeping , paragraph 20, 1992, Doc ONU A/47/277- S/24111.
(9a) M. Flory, L'Organisation des Nations unies et les opérations de maintien de la paix, A.F.D.I. , 1965, p. 446.
(10a) Marrack Goulding, « The evolution of UN Peace-keeping », International Affairs , 1993, vol. 69, nº 3, p. 455.
(11a) Résolution dite « Acheson », adoptée en 1950 à l'occasion de la guerre de Corée. « Mais, en fait, sur les 37 opérations mises sur pied par l'ONU au 15 octobre 1993, toutes, à l'exception de la FUNU I, résultaient d'une résolution du Conseil de sécurité. Et mis à part MONUIK et ONUSOM II, toutes ont été mises sur pied sur la base du chapitre VI, c'est-à-dire avec le consentement de l'État sur le territoire duquel l'opération devait accomplir sa mission ». (David Ruzié, « Maintien, construction, et imposition de la paix: Une perspective juridique », Lettre de l'UNIDIR , nº 24, décembre 1993, pp. 68-69.)
(12a) Rapport du Secrétaire général, paragraph 7 c, Doc. ONU S/5950 (1964).
(13a) Marrack Goulding, art. cit., pp. 456 à 460.
(14a) Cf. supra la liste des membres du Conseil de sécurité à ce moment.
(15a) Audition de M. Brouhns, CRA , Sénat, CSR, 1996-1997, 28 février 1997, p. 44-45.
(16a) Voir annexe 6 du Rapport du groupe ad hoc Rwanda (annexe 2 du présent rapport).
(17a) Cf. Blue Books , pp. 169-174.
(18a) Cf. Blue Books , pp. 151 et 162.
(19a) Cf. Blue Books , pp. 165-167.
(20a) SELLSTRÖM et WOHLGEMUTH, Joint Evaluation of Emergency Assistance to Rwanda, The International Respons to conflict and genocide : lessons from the Rwanda Experience, Study 1, Historical perspective : Some explanatory factors, Mars 1996, pp. 41 à 49.
(21a) Voir The United Nations and Rwanda , 1993-1996, Blue Books Series , Volume X, pp. 18-20.
(22a) Ibidem , documents 4 et 5, pp. 151-152.
(23a) Interim report of the Secretary-General on Rwanda, recommending the establishing of a United Nations Observer Mission Uganda-Rwanda (UNOMUR) , S/25810, 20 mai 1993, and addendum S/25810/Add. 1, 2 juin 1993; reproduit in The United Nations and Rwanda , 1993-1996, Blue Books Series, Volume X, document 15, pp. 162-164.
(24a) Reproduite in The United Nations and Rwanda , 1993-1996, Blue Books Series , Volume X, document 17, pp. 167-168.
(25a) The United Nations and Rwanda , 1993-1994, Blue Books Series , Volume X, p. 23, § 60.
(26a) Ibidem , pp. 25 à 27.
(27a) Adelman, H., Suhrke, A., Joint evaluation of emergency assistance to Rwanda, The international response to conflict and genocide, lessons from the Rwanda experience, study 2, Early warning and conflict management, mars 1996, p. 36.
(28a) Adelman, H., Suhrke, A. op. cit., p. 39.
(29a) Ibidem , blz. 89.
(30a) Ibidem .
(31a) Ibidem .
(32a) Audition de M. Cools du 28 février 1997, CRA, Sénat, 1996-1997, p. 49.
(33a) Audition du Premier ministre Dehaene du 5 mars 1997, CRA, Sénat, 1996-1997, p. 104.
(34a) Audition du ministre Claes du 5 mars 1997, CRA, Sénat, 1996-1997, pp. 83-84.
(35a) Audition de M. Brouhns du 28 février 1997, CRA, Sénat, 1996-1997, p. 48.
(36a) Ibidem.
(37a) Audition de M. Ndiayé du 13 avril 1997, CRA, Sénat, 1996-1997, p. 274.
(38a) Ibidem.
(39a) Ibidem, p. 277.
(40a) Texte officiel anglais dans The United Nations and Rwanda , 1993-1996, Blue Book Series, Volume X, S/Res/872 (1993), 5 octobre 1993, pp. 231 à 233.
(41a) Audition de M. Cools, CRA , Sénat, CSR, 28 février 1997, pp. 45-46.
(42a) Ibidem.
(43a) Audition de M. Cools, CRA, CSR, Sénat, 1996-1997, 28 février 1997, p. 45.
(44a) Audition du colonel Engelen, CRA, CSR, Sénat, 1996-1997, 16 avril 1997, pp. 280 et 281.
(45a) Auditions de M. Delcroix, p. 92 et du Premier ministre, M. Dehaene p. 99, CRA, CSR, Sénat, 1996-1997, 5 mars 1997.
(46a) Audition du Premier ministre, M. Dehaene, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 5 mars 1997, p. 99.
(47a) Le Premier ministre Dehaene a remis la notification du Conseil des ministres du 8 octobre 1993 et la notification de la réunion du 19 novembre à la commission parlementaire le 25 juin 1997. Le groupe ad hoc ne disposait d'aucun document relatif aux réunions du Conseil des ministres pour la période août-novembre 1993. À la question d'un commissaire, qui voulait savoir si les décisions relatives au Rwanda avaient été prises sur une base orale, M. Dehaene a répondu lors de la réunion du 5 mars 1997 que les délibérations avaient eu lieu sur la base d'un rapport oral des ministres (Audition de M. Dehaene, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 5 mars 1997, p. 100).
(48a) Audition de M. Cools, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 28 février 1997, p. 52.
(49a) Dans un télégramme daté du 5 novembre, communication a été faite d'une liste des pays qui outre la Belgique entraient en ligne de compte pour une participation. Il s'agissait du Bangladesh, de l'Égypte, du Ghana, du Malawi, de la Tunisie, de l'Uruguay, du Togo et du Canada (Auditions de MM. Cools et Brouhns, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 28 février 1997, pp. 50-51).
(50a) Lors de la réunion du 5 mars 1997, le Premier ministre, M. Dehaene, a confirmé, lors de son audition sur les éléments qui ont joué un rôle dans le processus décisionnel, qu'il y avait lieu de mettre fin à la présence en Somalie: « Nous estimions d'autre part qu'il n'était pas possible de répondre favorablement à la demande des Nations Unies tant qu'elles continuaient à faire pression pour que nous restions en Somalie, alors qu'il avait été convenu que notre intervention ne durerait qu'un an » (Audition de M. Dehaene, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 5 mars 1997, p. 99).
(51a) Au cours de son audition le 28 mars 1997, le lieutenant-général Charlier a déclaré devant la commission qu'il avait fait savoir au ministre qu'il ne prenait pas la responsabilité opérationnelle de cette mission avec moins de 450 hommes. (Audition du lieutenant-général Charlier, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 28 mars 1997, p. 269).
(52a) Lettre du 3 novembre 1993 du lieutenant-général Charlier au ministre de la Défense, p. 2.
(53a) Audition de M. Claes, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 5 mars 1997, p. 80.
(54a) M. Dehaene a remis, le 25 juin 1997, la proposition de M. Delcroix ainsi que les conclusions du Premier ministre du 10 novembre 1993 à la commission d'enquête.
(55a) Rapport du groupe ad hoc Rwanda à la Commission des Affaires étrangères, 7 janvier 1997, p. 110.
(56a) Le 25 juin 1997, le Premier ministre a remis à la commission d'enquête les procès-verbaux du Conseil des ministres, point 21 du ministre de la Défense nationale concernant le Rwanda - MINUAR 93A05330.085, du 19 novembre 1993. Le groupe ad hoc Rwanda, qui a mené, sur la base des documents disponibles, une enquête sur les événements qui se sont déroulés au Rwanda du mois de novembre 1993 au mois d'avril 1994, n'avait pas pu consulter ce document.
(57a) Voir document du Conseil des ministres, 19 novembre 1993, communication.
(58a) Audition de M. Martens, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 26 février 1997, p. 37.
(59a) Ibidem, p. 37.
(60a) Ibidem.
(61a) Ibidem, p. 40.
(62a) Réunion publique de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense nationale, Ann. parl., Chambre, session ordinaire 1989-1990, C087, pp. 3-4.
(63a) Ibidem.
(64a) Ibidem.
(65a) Débats en séance plénière, Ann. Parl., Chambre, séance plénière du mardi 9 octobre 1990; Ann.Parl., Sénat de Belgique, séance plénière du mardi 9 octobre 1990, p. 141.
(66a) Ann. Parl., Chambre., séance plénière du mardi 9 octobre 1990, p. 141.
(67a) Audition de M. Martens, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 26 février 1997, p. 38.
(68a) Audition de Mme De Backer, Sénat, CER , 1996-1997, 14 mai 1997, PV, p. 31/3.
(69a) Audition du colonel Vincent, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 7 mars 1997, p. 124.
(70a) Audition de Mme De Temmerman, Sénat, CER , 1996-1997, 28 mai 1997, PV, p. 40/8.
(71a) Audition de M. Jean-Luc Dehaene, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 5 mars 1997, p. 104.
(72a) Audition de l'ambassadeur Swinnen, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 12 mars 1997, pp. 132 et 133.
(73a) Audition du professeur Reyntjens, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 26 février 1997, pp. 24 et 27.
(74a) Audition de M. Dehaene, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 5 mars 1997, p. 98.
(75a) Ibidem .
(76a) Budget des voies et moyens pour l'exercice 1994 séance du 3 novembre 1993 section 14 Affaires étrangères et Commerce extérieur crédits Affaires étrangères pp. 139/11/1178/4, 92/93.
(77a) Audition du lieutenant-général Charlier, CER , Sénat, 1996-1997, 28 février 1997, PV, p. 11 (sic. ).
(78a) Audition du lieutenant-général Charlier, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 28 février 1997, pp. 64-65.
(79a) Audition de l'ambassadeur Swinnen, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 12 mars 1997, p. 133.
(80a) Audition de l'ambassadeur Swinnen, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 12 mars 1997, p. 133.
(81a) Audition de M. Jean-Luc Dehaene, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 5 mars 1997, p. 98.
(82a) Ibidem, p. 99.
(83a) Audition de M. Derycke, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 26 mars 1997, pp. 250-251.
(84a) Audition de M. Gillet, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 19 mars 1997, pp. 189.
(85a) Ibidem, p. 189.
(86a) Ibidem, p. 192.
(87a) Audition du professeur Reyntjens, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 26 février 1997, pp. 25 et 27.
(88a) En principe : actionnaire principal, voir chapitre 3.10.
(89a) Audition de M. Gasana Ndoba, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 19 février 1997, p. 16.
(90a) Services généraux confidentiel Rwanda synthèse 16 avril 1993, p. 10.
(91a) Audition de M.Jean-Luc Dehaene, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 5 mars 1997, p. 101.
(92a) Audition de M. N'Diaye, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 16 avril 1997, p. 276.
(93a) Lettre de M. W. Kuijpers, octobre 1993.
(94a) De Standaard, mercredi 6 octobre 1993, Ax. B.
(95a) Audition de Mme Beckers, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 19 février 1997, p. 13.
(96a) Rwanda Synthèse SGR 15 avril 1993, pp. 6 et 27.
(97a) Audition de M. J.-L. Dehaene, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 5 mars 1997, p. 98.
(98a) Rapport du groupe ad hoc Rwanda à la Commission des Affaires étrangères, 7 janvier 1997, p. 20.
(99a) Audition de M. Willy Claes, CER , Sénat, 24 juin 1997, PV, pp. 18/7 et 21/5.
(100a) Rapport du groupe ad hoc Rwanda à la Commission des Affaires étrangères, 7 janvier 1997.
(101a) Idem, p. 21.
(102a) Audition du Premier ministre Jean-Luc Dehaene, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 5 mars 1997, p. 99.
(103a) Audition de l'ambassadeur Swinnen, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 12 mars 1997, p. 134.
(104a) Ibidem .
(105a) Audition de M. Claes, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 5 mars 1997, p. 79.
(106a) Ibidem , p. 80.
(107a) Audition du lieutenant-général Charlier, CRA, CSR, Sénat, 1996-1997, 28 février 1997, pp. 65 et 66.
(108a) Id. p. 66.
(109a) Audition de M. Gasana Ndoba, CRA, CSR, Sénat, 1996-1997, 19 février 1997, p. 16.
(110a) Audition du Premier ministre Jean-Luc Dehaene, CRA, CSR, Sénat, 1996-1997, 5 mars 1997, p. 104.
(111a) Audition du lieutenant général Charlier, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 28 février 1997, p. 65 et audition du Premier ministre Dehaene, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 5 mars 1997, p. 98.
(112a) Rapport du groupe ad hoc Rwanda, Sénat, 7 janvier 1997, p. 20.
(113a) Audition du lieutenant général Charlier, CRA , CSR, 1996-1997, 28 février 1997, p. 65.
(114a) Audition du Premier ministre Dehaene, CRA , CSR, 1996-1997, 5 mars 1997, p. 99.
(115a) Audition du lieutenant général Charlier, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 28 février 1997, p. 70.
(116a) Audition du lieutenant général Charlier, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 16 avril 1997, p. 282.
(117a) Audition du lieutenant général Charlier, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 28 mars 1997, p. 269.
(118a) Rapport groupe ad hoc Rwanda, Sénat, 1996-1997, 7 janvier 1997, p. 109 et suivantes.
(119a) Voir annexe.
(120a) Audition du colonel Flament, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 28 février 1997, p. 58.
(121a) Audition du lieutenant-colonel Briot, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 28 février 1997, p. 62 et 63.
(122a) Audition du lieutenant général Charlier, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 28 février 1997, p. 65; audition du lieutenant général Charlier, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 21 avril 1997, p. 309.
(123a) Audition du lieutenant-colonel Leroy, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 24 mars 1997, p. 225.
(124a) Audition de général-major Schellemans, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 12 mars 1997, p. 151.
(125a) Audition de colonel Flament, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 28 février 1997, p. 59 et 61.
(126a) Ibidem, p. 57.
(127a) Audition du lieutenant général Charlier, CRA, CSR, Sénat, 1996-1997, 28 février 1997, p. 67.
(128a) Audition du colonel Engelen, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 16 avril 1997, p. 281.
(129a) Audition du Premier ministre Dehaene, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 5 mars 1997, p. 99.
(130a) Audition de M. Delcroix, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 5 mars 1997, p. 92 et 94.
(131a) Audition de M. Claes, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 5 mars 1997, p. 80.
(132a) Audition du lieutenant-général Charlier, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 28 février 1997, p. 71.
(133a) Note d'évaluation du 12 juillet 1994 rédigée par le lieutenant-général Charlier.
(134a) NDLR : Les motifs sociaux dont fait état le ministre Delcroix concernent le roulement des troupes. Selon le ministre, l'on ne disposait pas de suffisamment d'effectifs pour assurer un roulement normal, et la vie familiale et sociale des hommes risquait de souffrir des missions à l'étranger, qui étaient multiples et qui se succédaient à un rythme rapide. Cependant, ceci est en rapport étroit avec la réduction des effectifs voulue par le ministre Delcroix lui-même (ce que l'on appelle le plan Charlier).
(135a) Audition de M. Delcroix CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 5 mars 1997, p. 80 et audition du général-major Schellemans, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 12 mars 1997, p. 152.
(136a) Voir annexe.
(137a) Rapport du groupe ad hoc Rwanda, Sénat, 1996-1997, 7 janvier 1997, p. 110.
(138a) Audition du lieutenant-général Charlier, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 28 février 1997, p. 67.
(139a) Audition de lieutenant-général Charlier, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 21 avril 1997, p. 311.
(140a) Audition de lieutenant-général Charlier, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 28 février 1997, p. 67.
(141a) Audition du colonel Marchal, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 7 mars 1997, p. 109.
(142a) Audition du lieutenant-général Charlier, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 28 février 1997, p. 67.
(143a) Audition de lieutenant-général Charlier, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 21 avril 1997, p. 310.
(144a) Audition de lieutenant-colonel Briot, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 28 février 1997, p. 62.
(145a) Audition de lieutenant-général Charlier, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 5 mars 1997, p. 93.
(146a) Audition de lieutenant-général Charlier, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 5 mars 1997, p. 94.
(147a) Audition de général-major Schellemans, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 12 mars 1997, p.152.
(148a) Audition du lieutenant-général Charlier, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 28 février 1997, p.155.
(149a) Audition du lieutenant-général Charlier, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 28 février 1997, p. 70.
(150a) Audition du lieutenant-colonel Leroy, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 24 mars 1997, p. 235.
(151a) Audition de l'amiral Verhulst, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 23 avril 1997, p. 344.
(152a) Réponse du 18 juin 1997 du général-major Schellemans à la lettre du Président de la Commission d'enquête parlementaire sur les événements du Rwanda.
(153a) Audition du lieutenant-général Charlier, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 28 mars 1997, p. 269.
(154a) Audition du lieutenant Nees, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 5 mars 1997, p. 89.
(155a) Audition de M. Brouhns et de M. Cools, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 28 février 1997, pp. 50 et 51.
(156a) Voir annexe.
(157a) Audition du Premier ministre Dehaene, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 5 mars 1997, pp. 101 et 102.
(158a) Audition de M. Delcroix, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 5 mars 1997, p. 95.
(159a) Rapport groupe ad hoc Rwanda, Sénat, 1996-1997, 7 janvier 1997, p. 109.
(160a) Rapport groupe ad hoc Rwanda, Sénat, 1996-1997, 7 janvier 1997, p. 111.
(161a) Audition du colonel Marchal, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 7 mars 1997, p. 109.
(162a) Audition du colonel-major Kesteloot, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 28 février 1997, p. 61.
(163a) Audition du lieutenant-colonel Briot, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 28 février 1997, p. 62 : « Personne n'a demandé d'aller vérifier au Bangladesh ces éléments. »
(164a) Annales parlementaires , Sénat, 29 mars 1997, p. 1765.
(165a) Audition du général-major Schellemans, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 12 mars 1997, p. 153.
(166a) Auditions du lieutenant-général Charlier, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 28 mars 1997, p. 264 et 21 avril 1997, p. 310.
(167a) Rapport des réunions de coordination Affaires étrangères et Défense nationale.
(168a) Auditions du lieutenant-général Charlier, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 28 mars 1997, p. 264 et 21 avril 1997, p. 310.
(169a) Audition du lieutenant-général Charlier, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 28 mars 1997, p. 265.
(170a) Audition du général-major Schellemans, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 12 mars 1997, p. 153.
(171a) Audition du lieutenant-général Charlier, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 21 avril 1997, p. 310.
(172a) Audition du lieutenant-général Charlier, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 28 mars 1997, p. 264.
(173a) Auditions de M. Cools, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 28 février 1997, p. 50 et 29 avril 1997, p. 402.
(174a) Audition du lieutenant-colonel Leroy CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 24 mars 1997, p. 233.
(175a) Audition du colonel Marchal, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 7 mars 1997, p. 109. Le colonel Leroy, commandant de KIBAT I, confirme qu'en cas de manifestation, une partie des hommes affectés aux activités logistiques abandonnent celles-ci pour faire la garde des cantonnements. En cas de trouble majeur, ce sont les 75 personnes de la logistique qui sont engagées. Audition du lieutenant-colonel Leroy, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 24 mars 1997, p. 227.
(176a) Audition du colonel Marchal, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 14 mars 1997, p. 176.
(177a) Audition du lieutenant général Berhin, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 29 avril 1997, p. 390.
(178a) Audition du lieutenant général Charlier, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 28 février 1997, p. 66.
(179a) Audition du lieutenant général Charlier, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 28 février 1997, p. 70 et audition du lieutenant-colonel Briot, CRA , CSR, 1996-1997, 28 février, 1997, p. 64.
(180a) Audition du lieutenant général Charlier, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 21 avril 1997, p. 309.
(181a) « Answers to questions submitted to Major-General Dallaire by the Judge-Advocate General of the Military Court » , p. 28, points 60 et 61.
(182a) Audition du colonel Marchal, Sénat, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 7 mars 1997, p. 110.
(183a) Audition du Premier ministre Jean-Luc Dehaene, CER , Sénat, 7 juin 1997, PV, p. 9/14, p. 10/1 en p.10/3.
(184a) Audition du colonel Marchal, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 14 mars 1997, p. 176.
(185a) Audition du colonel Marchal, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 7 mars 1997, p. 110.
(186a) « Answers to questions submitted to Major-General Dallaire by the Judge-Advocate General of the Military Court » , p. 3, point 4.
(187a) Audition du colonel Marchal, CRA , CSR, 1996-1997, 14 mars 1997, pp. 175 et 176.
(188a) Sénat Rapport groupe ad hoc Rwanda 7 janvier 1997, p. 121 et suivantes.
(189a) Pour des raisons de neutralité, le CTM était déchargé du soin des cantonnements. « Implantation de KIBAT », rapport du lieutenant-général Uytterhoeven du 16 novembre 1994, p. 16.
(190a) Audition du lieutenant-colonel Leroy, CRA , CSR, Sénat, 24 mars 1997, p. 227.
(191a) Audition du général-major Uytterhoeven, CRA , CSR, Sénat, 25 avril 1997, pp. 358 et 359.
(192a) Audition du lieutenant-général Charlier, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 28 mars 1997, PV, pp. 6/3 et 6/4.
(193a) Audition du lieutenant-général Charlier, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 28 mars 1997, p. 267.
(194a) Audition de l'amiral Verhulst, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 23 avril 1997, pp. 346 et 347.
(195a) Général Dallaire répondait la suivante : « ... Deployed in platoon and company size locations they, of course, had their own self-defence needs to cater for. Their dispersed deployment had been a mixture of the tactical needs of the « presence » aspect of their tasks, and the unresolved accomodation problem between me, the contingent, the UNAMIR Chief Administration Officer. » Question 62, questions et réponses du général Dallaire.
(196a) Audition du lieutenant-général Charlier, CRA , CSR, Sénat, 28 février 1997, p. 66.
(197a) Audition du lieutenant-général Charlier, CRA , CSR, Sénat, 21 avril 1997, p. 309.
(198a) Audition du colonel Marchal, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 14 mars 1997, p. 176.
(199a) Voir document en annexe « Accord entre l'ONU et le Gouvernement de la République Rwandaise sur le statut de la Minuar » point 16 « Le gouvernement fournira à la Minuar, dans la mesure de ses possibilités, les emplacements destinés au quartier général, aux camps (...) » .
(200a) Audition du colonel Marchal, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 14 mars 1997, p. 176.
(201a) Sénat Rapport du groupe ad hoc Rwanda 7 janvier 1997 p. 113.
(202a) Sénat Rapport du groupe ad hoc Rwanda 7 janvier 1997 p. 116.
(203a) Sénat Rapport du groupe ad hoc Rwanda 7 janvier 1997 p. 116.
(204a) Audition du lieutenant-colonel Briot, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 28 février 1997, pp. 72-74.
(205a) Audition de l'amiral Verhulst, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 23 avril 1997, p. 348.
(206a) Audition du lieutenant-colonel Briot, CRA , CSR, 1996-1997, 28 février 1997, p. 71, audition de l'amiral Verhulst, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 23 avril 1997, p. 348.
(207a) Audition de l'amiral Verhulst, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 23 avril 1997, p. 349.
(208a) Audition de l'amiral Verhulst, CRA , CSR, Sénat, 23 avril 1997, p. 349.
(209a) Voir document en annexe p. 12 point g.
(210a) Voir document en annexe pp. 40, 41 et 42 points Q et R.
(211a) Audition du colonel Engelen, CRA , CSR, 1996-1997, Sénat, 1996-1997, 16 avril 1997, pp. 283-284.
(212a) Sénat Rapport du groupe ad hoc Rwanda 7 janvier 1997 Annexe nº 5 p. 3 point 8.
(213a) Rapport du colonel Malherbe relatif à UNPROFOR 21 août 1992 p. 1 point 3c.
(214a) Audition du colonel Marchal, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 14 mars 1997, p. 176.
(215a) « Answers to questions submitted to Major-General Dallaire by the Judge-Advocate General of the Military Court » p. 8 point 18 voir dossier auditorat-général près la Cour militaire Not. nº 01.00009.95 p. (...).
(216a) Voir document en annexe et Sénat Rapport du groupe ad hoc 7 janvier 1997 p. 116 et suivantes.
(217a) Voir document en annexe point 4a.
(218a) La préparation de KIBAT II et la mesure dans laquelle on a tiré à cette occasion les leçons de KIBAT I sont traitées au point 3.3.4.
(219a) Les officiers d'informations sont entraînés du point de vue tactique plus que du point de vue stratégique. Le rôle des officiers S2 du bataillon consiste à recueillir des informations tactiques. Ils n'étaient pas chargés de recueillir des informations opérationnelles.
(220a) Opération MINUAR - Rwanda 1993, EMG : JSO-P, novembre 1993.
(221a) Audition du lieutenant-colonel Leroy, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 23 avril 1997, p. 349.
(222a) Audition du général-major Roman, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 25 avril 1997, p. 375.
(223a) Audition du lieutenant-colonel Leroy, commandant de KIBAT I, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 24 mars 1997, p. 237.
(224a) Audition du lieutenant-colonel Leroy, commandant de KIBAT I, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 24 mars 1997, p. 237.
(225a) Audition du lieutenant-colonel Leroy, commandant de KIBAT I, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 24 mars 1997, p. 237.
(226a) Audition du colonel Marchal, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 19 mars 1997, p. 18/5.
(227a) Audition du lieutenant Nees, officier de renseignement de KIBAT I, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 7 mars 1997 p. 116; des plaintes analogues au sujet du travail d'information du SGR ont été formulées par le colonel Dewez, commandant de KIBAT II, voir point 2.3.4.
(228a) Audition du colonel Marchal, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 14 mars 1997, p. 178.
(229a) Audition du général-major Schellemans, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 12 mars 1997, p. 148.
(230a) Audition du lieutenant-colonel Leroy, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 12 mars 1997, p. 224.
(231a) Audition du colonel Marchal, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 7 mars 1997, p. 109.
(232a) Ibidem .
(233a) Audition du colonel Dewez, commandant de KIBAT II, Sénat, CER, 10 juin 1997, CRA, p. 685.
(234a) Audition du général major Roman, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 25 avril 1997, p. 370.
(235a) Audition du lieutenant-colonel Leroy, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 24 mars 1997, p. 227 et 234.
(236a) Sénat, Rapport du groupe ad hoc Rwanda, 7 janvier 1997, p. 81; pour plus de précisions sur l'évidement du mandat durant la période entre la conclusion des accords d'Arusha et l'approbation de la résolution nº 872, voir la deuxième partie de « The Joint Evaluation of Emergency Assistance to Rwanda » .
(237a) Audition de M. Cools, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 29 avril 1997, pp. 398 et 399.
(238a) Télex NY 93/01336, 9 août 1993.
(239a) Audition de M. Claes, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 5 mars 1997, p. 83.
(240a) Audition de M. Brouhns, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 28 février 1997, p. 48.
(241a) Audition de M. W. Claes, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 5 mars 1997, pp. 80 et 84, et de M. Willems, 18 mars 1997, p. 182.
(242a) Audition de M. W. Claes, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 5 mars 1997, p. 84
(243a) Sénat, Rapport du groupe ad hoc Rwanda, 7 janvier 1997, pp. 83 et 84.
(244a) Le texte intégral des ROE ainsi que leur résumé tel qu'il a été diffusé parmi les troupes figurent aux annexes nºs 5, 6 et 7 du rapport du groupe ad hoc Rwanda du 7 janvier 1997; il en va de même de la « Procédure opérationnelle pour l'établissement de la zone de consignation d'armes de Kigali » (annexe nº 8).
(245a) Audition du colonel Engelen, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 16 avril 1997, p. 284, ainsi que du lieutenant-général Charlier et le ministre de la Défense nationale, 21 avril 1997, pp. 310 et 31/*idem.
(246a) Sénat Rapport du groupe ad hoc Rwanda, 7 janvier 1997, pp. 81, 82 et 83.
(247a) Audition du lieutenant-général Berhin, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 29 avril 1997, p. 393 (« C'est l'ONU qui a rédigé le projet. Il a ensuite été transmis à nos services juridiques et à l'auditorat militaire, pour avis. S'il y a discussion, il pouvait être renvoyé à New York »), pp. 396 et 402 (« Il est exact qu'un attaché militaire est compétent pour les aspects militaires. Les règles d'engagement ont toutefois été négociées à Kigali et le colonel Engelen n'était nullement impliqué ») .
(248a) Audition du général-major Roman, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 25 avril 1997, p. 370.
(249a) Audition du colonel Marchal, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 14 mars 1997, p. 169.
(250a) Sénat, Rapport du groupe ad hoc Rwanda, annexe nº 5, p. 7, point 17.
(251a) Audition du colonel Marchal, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 14 mars 1997, p. 170.
(252a) Audition de l'amiral Verhulst, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 23 april 1997, p. 350.
(253a) Audition du colonel Marchal, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 14 mars 1997, p. 169.
(254a) Voir document en annexe.
(255a) Voir document en annexe.
(256a) Voir document en annexe.
(257a) Voir document en annexe.
(258a) SITREPS Ops. COLUMBUS des 5 novembre, 2 décembre, 19 décembre, 21 décembre, 24 décembre et 29 décembre 1994.
(1b) Audition du professeur Reyntjens, CRA , CSR, 1996-1997, 26 février 1997, p. 25.
(2b) Ibid., p. 26.
(3b) Audition de M. Ndiaye, CRA , CER, 1996-1997, 16 avril 1997, p. 276.
(4b) Audition de M. Nsanzuwera, CRA , CER, 1996-1997, 22 avril 1997, pp. 320 et 321.
(5b) Audition du lieutenant-général Uytterhoeven, CRA, CER, Sénat, 1996-1997, 25 avril 1997, p. 359.
(6b) Audition de l'ambassadeur Swinnen, CRA , CSR, 1996-1997, 12 mars 1997, p. 133.
(7b) Audition de M. Jaenen, CRA , CER, Sénat, 1996-1997, 23 avril 1997, p. 336.
(8b) La visite du ministre Claes a eu lieu du 18 au 23 février 1994.
(9b) Audition du ministre Claes, CRA , CER, Sénat, 1996-1997, 18 avril 1997, pp. 296 et 297.
(10b) « La situation au Zaïre, au Rwanda et au Burundi », par Willy Claes, réponse à l'interpellation de Marc Van Peel, 15 février 1994, p. 22.
(11b) Ibidem, p. 24.
(12b) Le Blue Book date la lettre du ministre Claes au secrétaire général des Nations unies du 14 mars 1994. En réalité, cette lettre date du 11 février 1994. Elle a d'ailleurs fait l'objet d'une réponse de notre ambassadeur Noterdaeme par un télex daté du 14 février 1994.
(13b) Audition du colonel Marchal, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 14 mars 1997, p. 170.
(14b) Ibid.
(15b) Audition de l'ambassadeur Swinnen, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 12 mars 1997, p. 135.
(16b) Ibidem , p. 135.
(17b) Audition de l'ambassadeur Willems, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 18 mars 1997, p. 182.
(18b) Audition du ministre Claes, CRA , CER, Sénat, 1996-1997, 18 avril 1997, p. 304.
(19b) Ibidem , p. 304.
(20b) Ibidem , p. 297.
(21b) Rapport Nees, 16 mars 1994.
(22b) Audition de M. Ndiayé, CRA , CER, Sénat, 1996-1997, 16 avril 1997, p. 275.
(23b) Audition de l'ambassadeur Swinnen, CRA, CSR, Sénat, 1996-1997, 12 mars 1997, p. 136.
(24b) Audition de M. Derycke CRA, CSR, 26 mars 1994, p. 249.
(25b) Audition de Mme Des Forges, CRA, CSR, Sénat, 1996-1997, 26 février 1997, p. 35.
(26b) Audition de M. Gillet, CRA, CSR, Sénat, 1996-1997, 19 mars, p. 193.
(27b) Audition du ministre Claes, CRA, CER, Sénat, 1996-1997, 18 avril 1997, pp. 296 et suivantes. Audition de l'ambassadeur L. Willems, CRA, 1-12, Sénat, 1996-1997, 18 mars 1997, p. 186. Audition de l'ambassadeur J. Swinnen, CRA, 1-16, Sénat, 1996-1997, 12 mars 1997, p. 133.
(28b) Audition de Mme Braeckman, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 21 mars 1997, p. 200.
(29b) Audition de Mme Braeckman, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 21 mars 1997, p. 200.
(30b) Audition du colonel Leroy, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 24 mars 1997, p. 228.
(31b) Audition de M. Swinnen, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 21 mars 1997, p. 215.
(32b) Audition du major Hock, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 21 mars 1997, p. 208.
(33b) Audition du capitaine Claeys, CER , Sénat, 1996-1997, 13 mai 1997, PV, pp. 67/5, 67/7 et 67/8.
(34b) Audition du capitaine Claeys, CER , Sénat, 1996-1997, 13 mai 1997, PV, pp. 68/2 et 68/3.
(35b) Audition du capitaine Claeys, CER , Sénat, 1996-1997, 13 mai 1997, PV, pp. 67/10.
(36b) Audition du capitaine Claeys, CER , Sénat, 1996-1997, 13 mai 1997, PV, p. 71/2.
(37b) Dossier Marchal de l'Auditorat-général auprès de la Cour militaire, Pro Justitia du 2 juin 1995 du capitaine Claeys, p. 252.
(38b) Audition du colonel Marchal, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 7 mars 1997, p. 108.
(39b) Audition du colonel Marchal, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 7 mars 1997, p. 106.
(40b) Audition du capitaine Claeys, CER , Sénat, 1996-1997, 13 mai 1997, PV, p. 76/2.
(41b) Audition du capitaine Claeys, CER , Sénat, 1996-1997, 13 mai 1997, PV, p. 71/3.
(42b) Audition du colonel Marchal, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 7 mars 1997, p. 112.
(43b) Audition à huis clos de M. Twagiramungu, CER , Sénat, 1996-1997, 30 mai 1997, PV, p. 30/3.
(44b) Audition du général-major Verschoore, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 12 mars 1997, p. 147.
(45b) Audition du major Hock, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 21 mars 1997, p. 207.
(46b) Audition du colonel Dewez, CER , Sénat, 1996-1997, 30 juin 1997, PV, p. 31/1 et 31/2.
(47b) Audition du lieutenant Lecomte, CER , Sénat, 1996-1997, 7 mai 1997, PV, p. 1/10 et p. 1/12.
(48b) Audition du capitaine Claeys, CER , Sénat, 1996-1997, 13 mai 1997, PV, pp. 74/9 et 74/10.
(49b) Rapport du lieutenant-général Uytterhoeven du 16 novembre 1994 exposé du capitaine Claeys, Tome II, Ann. A, App., p. 4, p. 2.
(50b) Audition du capitaine Claeys, CER , Sénat, 1996-1997, 13 mai 1997, PV, pp. 74/11 et 74/12.
(51b) Dossier Marchal de l'Auditorat général auprès de la Cour militaire, Pro Justitia du 2 juin 1995 du capitaine Claeys, p. 252.
(52b) Audition du lieutenant Nees, CRA, CSR, Sénat, 1996-1997, 7 mars 1997, p. 117.
(53b) Audition du lieutenant Nees, CRA, CSR, Sénat, 1996-1997, 7 mars 1997, p. 117.
(54b) Audition du capitaine De Cuyper, CRA, CSR, Sénat, 1996-1997, 14 mars 1997, p. 166.
(55b) Audition du lieutenant Nees, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 7 mars 1997, p. 119.
(56b) Rapport du lieutenant-général Uytterhoeven, du 16 novembre 1994 exposé du major Podevijn, tome II Ann. A, App., p. 9, p. 1.
(57b) Audition du major Podevijn, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 7 mars 1997, p. 122.
(58b) Audition du colonel Vincent, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 7 mars 1997, p. 124.
(59b) Audition du colonel Vincent, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 7 mars 1997, p. 126.
(60b) Ibidem , p. 127.
(61b) Rapport du lieutenant-général Uytterhoeven du 16 novembre 1994, exposé du lieutenant colonel BEM Duvivier, Ann. A, App., p. 16, p. 2.
(62b) Audition du colonel Leroy, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 24 mars 1997, p. 229.
(63b) Télécopie du 1Bn Para UNAMIR à C Ops, 6 février 1994, lieutenant colonel Leroy.
(64b) Audition du colonel Leroy, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 24 mars 1997, p. 232.
(65b) Audition du commandant Noens, CER , Sénat, 1996-1997, 13 mai 1997, PV, pp. 91/7 et 91/8.
(66b) Rapport du lieutenant-général Uytterhoeven du 16 novembre 1994 exposé du colonel Leroy, tome II, Ann. A, App. p. 8, p. 2.
(67b) Ibidem , p. 234.
(68b) Ibidem , p. 232.
(69b) Audition du colonel Dewez, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 16 avril 1997, p. 290.
(70b) Ibidem, p. 290.
(71b) Audition du colonel Dewez,, CER , Sénat, 1996-1997, 30 juin 1997, PV, pp. 30/18 à 31/1.
(72b) Audition du colonel Dewez, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 16 avril 1997, pp. 292 et 293.
(73b) Audition du colonel Balis, CER , Sénat, 1996-1997, 29 mai 1997, PV, pp. 15/9 à 15/11.
(74b) Audition du colonel Balis, CER , Sénat, 1996-1997, 29 mai 1997, PV, pp. 15/13 à 15/16.
(75b) Audition du colonel Balis, CER , Sénat, 1996-1997, 29 mai 1997, PV, pp. 16/7 et 16/8.
(76b) Audition du colonel Balis, CER , Sénat, 1996-1997, 29 mai 1997, PV, p. 16/11.
(77b) Audition du colonel Balis, CER , Sénat, 1996-1997, 29 mai 1997, PV, pp. 19/7 et 19/8.
(78b) Audition du colonel Marchal, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 7 mars 1997, p. 107.
(79b) Audition du colonel Marchal, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 14 mars 1997 et du 7 mars, pp. 168 et 107.
(80b) Audition du colonel Marchal, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 7 mars 1997, p. 107.
(81b) Audition du colonel Marchal, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 14 mars 1997, p. 169.
(82b) Audition du major Maggen, CER , Sénat, 1996-1997, 7 mai 1997, PV, pp. 106/6 à 107/1.
(83b) Audition du major Maggen, CER , Sénat, 1996-1997, 7 mai 1997, PV, pp. 139/4 et 139/5.
(84b) Audition du capitaine Lemaire, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 7 mai 1997, p. 429.
(85b) Dossier Marchal de l'Auditorat général auprès de la Cour militaire, Pro Justitia 15 mars 1995 du capitaine P. Marchal.
(86b) Audition du lieutenant-général Charlier, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 28 mars 1997, p. 265.
(87b) Ibidem, 28 mars 1997, p. 265.
(88b) Audition du lieutenant-général Charlier, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 21 avril 1997, p. 314.
(89b) Ibidem, p. 315.
(90b) Audition du général-major Verschoore, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 12 mars 1997, p. 142.
(91b) Ibidem , p. 143.
(92b) Ibidem , p. 145.
(93b) Ibidem , p. 146.
94C.B.A.? CSR, () Audition du général-major Delhotte, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 21 mars 1997, p. 197.
(95b) Ibidem , p. 198.
(96b) Ibidem , p. 199.
(97b) Audition de M. Swinnen, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 21 mars 1997, p. 222.
(98b) Ibidem.
(99b) Rwanda rapport annuel sur les relations bilatérales 1993 janvier 1994 de l'ambassadeur Swinnen adressé à Willy Claes.
(100b) Audition du Premier ministre Jean-Luc Dehaene, CER , Sénat, 1996-1997, 26 juin 1997, PV, pp. 2/1 et 2/2.
(101b) Ibidem , pp. 2/2- 2/4.
(102b) Ibidem , p. 8/5.
(103b) Audition de M. Delcroix, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 26 mars 1997, p. 260.
(104b) Ibidem , p. 254.
(105b) Audition de M. Delcroix, CER , Sénat, 18 juin 1997, PV, pp. 24/8 et 24/9.
(106b) Ibidem , pp. 19/3 et 19/4.
(107b) Ibidem , pp. 19/3 et 19/4.
(108b) Ibidem , pp. 22/1-22/4 et pp. 22/8-22/10.
(109b) Audition de M. Delcroix, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 26 mars 1997, p. 254.
(110b) Audition de M. Delcroix, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 26 mars 1997, p. 259.
(111b) Ibidem , 16 mars 1997, p. 259.
(112b) Ibidem , pp. 32/2 et 32/3.
(113b) De Standaard, 14 mars 1994, Luc Neuckermans, « Delcroix roept Rwandese president Habyarimana tot de orde ».
(114b) Audition de M. Delcroix, CER , Sénat, 18 juin 1997, PV, pp. 27/6 et 27/7.
(115b) Ibidem , pp. 34/14 et 34/15.
(116b) Émission RTBF; Les oubliés de Kigali, 1996.
(117b) Audition de M. Delcroix, CER , Sénat, 18 juin 1997, PV, p. 34/9.
(118b) Audition du lieutenant-général Schellemans, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 12 mars 1997, p. 150.
(119b) Ibidem , p. 151.
(120b) Ibidem , p. 151.
(121b) Ibidem , p. 149.
(122b) Audition de M. Claes, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 18 avril 1997, p. 305.
(123b) Ibidem , p. 305.
(124b) Audition de Mme DesForges, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 26 février 1997, pp. 33 et 34.
(125b) Audition de Mme Suhrke, CRA, CSR, Sénat, 1996-1997, 22 avril 1997, p. 329.
(126b) Audition du général Rusatira, CRA, CSR, Sénat, 1996-1997, 29 avril 1997, p. 383-384 (propos littéraux).
(127b) Audition de M. Nsanzuware, CRA, CSR, Sénat, 1996-1997, 22 avril 1997, p. 320.
(128b) Audition de Mme De Backer, CER , Sénat, 14 mai 1997, PV, pp. 25/7 et 25/8, pp. 27/1 et 27/2, p. 26/8 et pp. 30/10 et 30/11.
(129b) Audition du lieutenant-général Charlier, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 21 avril 1997, p. 311.
(130b) Lettre du colonel Marchal à la commission.
(131b) La commission est en possession d'une copie du bulletin de commande de KIBAT I.
(132b) Audition du l'amiral Verhulst, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 23 avril 1997, p. 349.
(133b) Ibidem, p. 349.
(134b) Audition du colonel Marchal et lieutenant-colonel Briot, CER, Sénat, 13 juin 1997, PV, p. 19/7 (CRA du 13 juin 1997, p. 736).
(135b) Ibidem, p. 21/2 (CRA du 13 juin 1997, p. 737).
(136b) Answers to questions submitted to Major-General Dallaire by the judge Advocate General of the Military Court - point 18.
(137b) Audition du colonel Marchal et lieutenant-colonel Briot, CER, Sénat, 13 juin 1997, PV, p. 19/10 e.s. (CRA du 13 juin 1997, p. 736).
(138b) Ibidem, p. 21/3 (CRA du 13 juin 1997, p. 737).
(139b) Ibidem, p. 24/6 (CRA du 13 juin 1997, p. 739).
(140b) Audition de l'amiral Verhulst, CRA , CSR, Sénat, 23 avril 1997, p. 348.
(141b) Audition du lieutenant-colonel Briot, CRA , CSR, Sénat, 28 février 1997, p. 72.
(142b) Audition du lieutenant-colonel Briot, CRA, CER, Sénat, 13 juin 1997, p. 732.
(143b) Audition du lieutenant-général Charlier, CRA , CSR, Sénat, 28 mars 1997, p. 264.
(144b) Audition de M. Delcroix, CRA , CSR, Sénat, 26 mars 1997, p. 255.
(145b) Audition du général Schellemans, CRA , CSR, Sénat, 12 mars 1997, p. 150.
(146b) Audition du colonel Dewez, CRA, CER, Sénat, 10 juin 1997, p. 679.
(147b) Audition du capitaine Lemaire, CER, Sénat, 7 mai 1997, PV, p. 49/1 (CRA du 7 mai 1997, p. 431).
(148b) Audition du capitaine Marchal, CRA, CER, Sénat, 13 mai 1997, p. 462.
(149b) Sénat de Belgique Rapport du groupe de travail ad hoc Rwanda, 7 janvier 1997, p. 113.
(150b) Audition du colonel Dewez et du capitaine Theunissen, CER, Sénat, 30 juin 1997, PV, p. 32/7 (CRA du 30 juin 1997, p. 914).
(151b) Audition du capitaine Lemaire, CRA, CER, Sénat, 7 mai 1997, p. 431.
(152b) Audition du colonel Dewez, CER, Sénat, 10 juin 1997, PV, p. 9/8 (CRA du 10 juin 1997, p. 677).
(153b) Ibidem, p. 22/1 (CRA du 10 juin 1997, p. 685).
(154b) Audition du colonel Marchal, CRA, CER, Sénat, 10 juin 1997, p. 701.
(155b) Audition du lieutenant Lecomte, CRA, CER, Sénat, 7 mai 1997, p. 425.
(156b) Ibidem, p. 424.
(157b) Audition du corporal-chef Pierard, CRA, CER, Sénat, 27 juin 1997, p. 880.
(158b) Audition du major Choffray, CER, Sénat, 13 mai 1997, PV, p. 31/10 (CRA du 13 mai 1997, p. 467).
(159b) Audition du major Choffray, CER, Sénat, 13 mai 1997, PV, p. 48/5 e.s. (CRA du 13 mai 1997, p. 471).
(160b) Audition du major Choffray, CRA du 13 mai 1997, pp. 469 et 470.
(161b) Ibidem, p. 470.
(162b) Audition du major Choffray, CER, Sénat, 13 mai 1997, PV, p. 45/1 (CRA du 13 mai 1997, p. 469).
(163b) Audition du major Choffray, CER, Sénat, 13 mai 1997, PV, p. 45/5.
(164b) Audition du major Choffray, CER, Sénat, 13 mai 1997, PV, pp. 45/3 et suiv.
(165b) Audition du major Choffray, CER, Sénat, 13 mai 1997, PV, p. 45/5 (CRA du 13 mai 1997, p. 470).
(166b) Rapport Van Hecke, B, IIe partie, 2., e) .
(167b) Audition du lieutenant-général Behrin, CRA 29 avril 1997, p. 397.
(168b) Audition de l'amiral Verhulst, CRA , CSR, Sénat, 23 avril 1997, p. 351.
(169b) Ibidem , p. 532.
(170b) Ibidem , p. 351.
(171b) Audition du lieutenant-général Charlier, CRA , CSR, Sénat, 21 avril 1997, p. 311.
(172b) Audition du major Choffray, CER , Sénat, 13 mai 1997, PV, p. 64/14 (CRA 13 mai 1997, p. 477)
(173b) N.d.l.r. : même état que les CVRT en Somalie.
(174b) Audition du colonel Marchal, CER , Sénat, 10 juin 1997, PV, p. 33/1 (CRA 10 juin 1997, p. 708).
(175b) Audition du lieutenant-colonel Briot et du colonel Flament, 13 juin 1997, PV, p. 6/1.1 (CRA 13 juin 1997, p. 725).
(176b) Voir aussi audition du lieutenant-général Behrin, CRA , CSR, Sénat, du 29 avril 1997, p. 397.
(177b) Audition du colonel Marchal, CRA , CSR, Sénat, 14 mars 1997, p. 176.
(178b) Audition du colonel Briot et colonel Flament, 13 juin 1997, PV, p. 4/8 e.v. (CRA du 13 juin 1997, p. 724).
(179b) Ibidem , p. 5/10 (CRA du 13 juin 1997, p. 724).
(180b) Audition de l'amiral Verhulst, CRA , CSR, Sénat, 23 avril 1997, pp. 350 et 351.
(181b) Audition du lieutenant-général Charlier, CRA , CSR, Sénat, du 28 mars 1997, p. 267.
(182b) Ibidem , p. 310.
(183b) Audition de l'amiral Verhulst, CRA , CSR, Sénat, 23 avril 1997, p. 345.
(184b) Audition du colonel Dewez, CRA , CSR, Sénat, 10 juin 1997, p. 673.
(185b) Rapport Van Hecke, Ire partie, 1., c) .
(186b) CRA du 7 mars 1997, p. 110.
(187b) Audition du lieutenant-colonel De Loecker, CER , Sénat, 29 mai 1997, PV, p. 1/4 e.s. (CRA du 29 mai 1997, p. 578).
(188b) Audition du colonel Marchal, CRA , CSR, Sénat, 7 mars 1997, p. 110.
(189b) Audition du lieutenant-colonel De Loecker, CER , Sénat, 29 mai 1997, PV, p. 3/1 (CRA du 29 mai 1997, p. 579).
(190b) Ibidem , p. 1/7 (CRA du 29 mai 1997, p. 578).
(191b) Audition du lieutenant-colonel De Loecker, CRA , CSR, Sénat, 7 mars 1997, p. 110.
(192b) Answers to questions submitted to Major-General Dallaire by the Judge-Advocate General of the Military Court, point 65, p. 29, voir le dossier de l'auditorat général près la Cour militaire.
(193b) Audition du colonel Marchal, CRA , CSR, Sénat, 7 mars 1997, p. 110.
(194b) Answers to questions submitted to Major-General Dallaire by the Judge-Advocate General of the Military Court, point 58, p. 27, voir le dossier de l'auditorat général près la Cour militaire.
(195b) Answers to questions submitted to Major-General Dallaire by the Judge-Advocate General of the Military Court, point 61, p. 28, voir le dossier de l'auditorat général près la Cour militaire.
(196b) Audition du colonel Marchal, CER , Sénat, 10 juin 1997, PV, p. 33/1 e.s. (CRA du 10 juin 1997, p. 694).
(197b) Audition du lieutenant-colonel De Loecker, CER , Sénat, 29 mai 1997, PV, p. 2/2 (CRA du 29 mai 1997, p. 578-580).
(198b) Audition du colonel Marchal, CER , Sénat, 10 juin 1997, PV p. 26/8 (CRA du 10 juin 1997, p. 690).
(199b) Audition du colonel Briot et colonel Flament, CER , Sénat, 13 juin 1997, PV, p. 4/3 (CRA du 13 juin 1997, p. 740).
(200b) Ibidem , p. 4/3 (CRA du 13 juin 1997, p. 724).
(201b) Ibidem , p. 4/5 (CRA du 13 juin 1997, p. 724).
(202b) The United Nations and Rwanda, 1993-1996, Department of Public Information, The United Nations Blue Book Series, Volume X, p. 247.
(203b) Audition du lieutenant-général Charlier, CRA , CSR, Sénat, 28 mars 1997, blz. 267.
(204b) Audition de l'admiral Verhulst, CRA , CSR, Sénat, 23 avril 1997, p. 344.
(205b) Answers to questions submitted to Major-General Dallaire by the Judge-Advocate General of the Military Court, point 58, p. 27, voir dossier de l'auditeur général près la Cour militaire.
(206b) Audition du colonel Marchal, CER , Sénat, 10 juin 1997, PV, p. 34/12 (CRA du 10 juin 1997, p. 695).
(207b) SGR nº 1232 et suivants.
(208b) Document C Ops nº 1526 dans le dossier de l'auditeur général près la Cour militaire, farde d'enquête B, Note nº 01.00009.95-1376.
(209b) Audition du capitaine Theunissen, CER , Sénat, 6 juin, PV, p. 15/12 e.s. (CRA du 6 juin 1997, p. 668).
(210b) Audition de l'admiral Verhulst, CRA , CSR, Sénat, 23 avril 1997, p. 346.
(211b) (CRA , p. 358).
(212b) Rapport de la visite du lieutenant-général Uytterhoeven du 25 février 1994, p. 2.
(213b) Audition du capitaine Marchal, CER , Sénat, 13 mai 1997, PV, p. 14/1 (CRA du 13 mai 1997, p. 459).
(214b) Audition du capitaine Lemaire, CER , Sénat, 7 mai 1997, PV, p. 34/11 e.s. (CRA du 7 mai 1997, p. 428).
(215b) Audition du major Choffray, CRA , CSR, Sénat, 13 mai 1997, p. 468.
(216b) Audition du colonel Leroy, CRA , CSR, Sénat, 24 mars 1997, p. 227.
(217b) Audition du colonel Dewez, CRA , CSR, Sénat, 16 avril 1997, p. 293.
(218b) Document C Ops, nº 23869.
(219b) Documents C Ops nº 24923 dans le dossier Auditorat général près la Cour militaire - farde enquête D - not. nº 01.00009.95-1337.
(220b) Documents SGR 1232 et suivants.
(221b) Rapport commission ad hoc Rwanda, pp. 122-123.
(222b) Audition du lieutenant-général Charlier, CRA , CSR, Sénat, 21 avril 1997, p. 309.
(223b) Audition du colonel Balis, CER , Sénat, 29 mai 1997, PV, p. 10/4 e.s. (CRA du 29 mai 1997, p. 585).
(224b) Ibidem , p. 11/3 e.s. (CRA du 29 mai 1997, p. 585).
(225b) Ibidem, p. 170.
(226b) Audition du capitaine Theunissen, CRA , CER , Sénat, 6 juin 1997, p. 664.
(227b) Audition du major Choffray, CRA , CER , Sénat, 13 mai 1997, p. 459.
(228b) Audition de l'amiral Verhulst, CRA , CSR, Sénat, 23 avril 1997, p. 350.
(229b) Audition du colonel Balis, CER , Sénat, 29 mai 1997, PV, p. 12/4 e.s. (CRA du 29 mai 1997, p. 586).
(230b) Audition du colonel Marchal, CER , Sénat, 10 juin 1997, PV, p. 40/14 e.s. (CRA du 10 juin 1997, p. 699).
(231b) Audition du capitaine Lemaire, CER , Sénat, 7 mai 1997, PV p. 45/3 (CRA du 7 mai 1997, p. 430).
(232b) Rapport du lieutenant-général Uytterhoeven, 16 novembre 1994, p. 41.
(233b) Audition du colonel Balis, CER , Sénat, 29 mai 1997, PV, p. 10/24 e.s. (CRA du 29 mai 1997, pp. 585 et 586).
(234b) Audition de l'amiral Verhulst, CRA , CSR, Sénat, 23 avril 1997, p. 350.
(235b) Rapport ad hoc , p. 42.
(236b) Audition du colonel Marchal, CRA, CSR, Sénat, 14 mars 1997, p. 169.
(237b) Audition du colonel Marchal, CRA , CSR, Sénat, 14 mars 1997, p. 169.
(238b) Audition de l'amiral Verhulst, CRA , CSR, Sénat, 23 avril 1997, p. 350.
(239b) Rapport Uytterhoeven, Ann. B, App 2, sous app. 1, p. 3.
(240b) Rapport ad hoc, p. 93.
(241b) Audition du capitaine Lemaire, CRA , CER, Sénat, 7 mai 1997, p. 429.
(242b) Audition du lieutenant-général Charlier, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 28 mars 1997, p. 268.
(243b) Audition du colonel Dewez, CER, Sénat, 30 juin 1997, PV, pp. 10/13 e.s. (CRA du 30 juin 1997, p. 913).
(244b) Audition du colonel Dewez, CRA , CSR, Sénat, 16 avril 1997, p. 290.
(245b) Ibidem, p. 290.
(246b) Audition du lieutenant-général Charlier, CRA , CSR, Sénat, 21 avril 1997, p. 313.
(247b) Audition du général Roman, CRA, CSR, Sénat, 25 avril 1997, p. 374.
(248b) Audition du caporal-chef Pierard, CER, Sénat, 27 juin 1997, PV, pp. 10/1 (CRA du 27 juin 1997, p. 878).
(249b) Audition de Mme Lotin, CRA, CSR, Sénat, 19 février 1997, p. 5.
(250b) Audition de l'adjudant Boequelloen, CER, Sénat, 27 juin 1997, PV, pp. 9/24 (CRA du 27 juin 1997, p. 878).
(251b) Audition du capitaine Marchal, CER , Sénat, 13 mai 1997, PV, sans page (CRA du 13 mai 1997, p. 463).
(252b) Audition de M. Quertemont, CRA , CER , Sénat, 7 mai 1997, p. 440.
(253b) Audition du colonel Marchal, CRA , CSR, Sénat, 14 mars 1997, p. 173.
(254b) Rapport de la visite du lieutenant-général Uytterhoeven, rapport GSX, 1-3.
(255b) Rapport de la visite du lieutenant-général Uytterhoeven, annexe b, App. 1.
(256b) Audition du colonel Marchal, CER , Sénat, 10 juin 1997, PV, pp. 42/1 et 2. (CRA du 10 juin 1997, p. 699).
(257b) N.d.l.r. : Motorola.
(258b) Audition de l'adjudant Boequelloen, CER , Sénat, 27 juin 1997, PV, pp. 1/5.
(259b) Ibidem , pp. 2/26.
(260b) Ibidem , pp. 3/1.
(261b) Ibidem , pp. 4/14.
(262b) Ibidem , pp. 4/15.
(263b) Ibidem , pp. 5/3.
(264b) Rapport Behrin, p. 34.
(265b) Audition de l'adjudant Boequelloen, CER , Sénat, 27 juin 1997, PV, pp. 10/24.
(266b) Rapport Guérin.
(267b) Audition de l'adjudant Boequelloen, CER , Sénat, 27 juin 1997, PV, pp. 14/12.
(268b) Réponses aux questions présentées au général major Dallaire par le juge avocat général de la Cour militaire, point 1, p. 1.
(269b) Audition du capitain Claeys, CER, Sénat, 13 mai 1997, PV, pp. 71/3 (CRA du 13 mai 1997, p. 481).
(270b) Audition du capitain Claeys, CRA , CER, Sénat, 13 mai 1997, p. 488.
(271b) Audition du major Podevijn, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 7 mars 1997, p. 123.
(272b) Audition du colonel Marchal, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 7 mars 1997, pp. 106-107.
(273b) Audition du colonel Balis, CER , Sénat, 29 mai 1997, PV, pp. 15/10 (CRA du 29 mai 1997, p. 588).
(274b) Audition du général-major Roman, CRA , CSR, Sénat, 25 avril 1997, p. 375.
(275b) Audition du général-major Delhotte, CRA , CSR, Sénat, 21 mars 1997, pp. 20/2 (huis clos).
(276b) Audition du général-major Verschoore, CRA , CSR, Sénat, 12 mars 1997, p. 145.
(277b) Audition du lieutenant Nees, CRA , CSR, Sénat, 7 mars 1997, p. 120.
(278b) Audition du capitaine Claeys, CER , Sénat, 13 mai 1997, PV, p. 68/4 (CRA du 13 mai 1997, p. 479).
(279b) Audition du colonel Marchal, CRA , CSR, Sénat, 7 mars 1997, p. 106.
(280b) Ibidem , p. 107.
(281b) Ibidem , p. 107.
(282b) Audition du lieutenant Nees, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 7 mars 1997, pp. 118-120.
(283b) Audition du colonel Marchal, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 7 mars 1997, p. 107.
(284b) Ibidem , p. 107.
(285b) Audition du capitaine De Cuyper, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 19 mars 1997, p. 18/6 (huis clos).
(286b) Audition du colonel Marchal, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 7 mars 1997, p. 107.
(287b) Ibidem , p. 107.
(288b) Audition du colonel Marchal, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 24 mars 1997, p. 225.
(289b) Ibidem , p. 229.
(290b) Audition du colonel Marchal, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 7 mars 1997, p. 119.
(291b) Audition du lieutenant Nees, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 7 mars 1997, p. 120.
(292b) Ibidem, p. 118.
(293b) Ibidem , p. 121.
(294b) Ibidem , p. 121.
(295b) Ibidem , p. 118.
(296b) Audition du capitaine De Cuyper, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 14 mars 1997, p. 166.
(297b) Ibidem , p. 166.
(298b) Audition du capitaine Lemaire, CER , Sénat, 7 mai 1997, PV, pp. 34/11 (CRA du 7 mai 1997, p. 428).
(299b) Audition du capitaine Lemaire, CER , Sénat, 7 mai 1997, PV, pp. 1/10 e.s. (CRA du 7 mai 1997, p. 424).
(300b) Audition du général Roman, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 25 avril 1997, p. 375.
(301b) Audition du colonel Vincent, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 7 mars 1997, p. 126.
(302b) Rapport du lieutenant-général Uytterhoeven, Ann. A. App. 18, p. 1.
(303b) Audition du colonel Vincent, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 7 mars 1997, p. 126.
(304b) Ibidem , p. 128.
(305b) Ibidem , p. 129.
(306b) Ibidem , p. 129.
(307b) Ibidem , p. 128.
(308b) Audition du major Podevijn, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 7 mars 1997, p. 123.
(309b) Audition du capitaine Claeys, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 13 mai 1997, p. 484.
(310b) Audition du lieutenant Nees, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 7 mars 1997, p. 119.
(311b) Audition du général Delhotte, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 21 mars 1997, pp. 20/2 (huis clos).
(312b) Ibidem , pp. 20/2 (huis clos).
(313b) Ibidem , pp. 20/2 (huis clos).
(314b) Ibidem , pp. 20/2 (huis clos).
(315b) Audition du général Verschoore, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 12 mars 1997, p. 142.
(316b) Audition du major Hock, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 21 mars 1997, p. 207.
(317b) Audition capitaine Claeys, CER, Sénat, 1996-1997, 13 mai 1997, PV, pp. 677/9 (CRA du 13 mai 1997, p. 485).
(318b) Audition du lieutenant Nees, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 7 mars 1997, p. 120.
(319b) Le capitaine De Cuyper n'occupait que depuis deux semaines cette fonction.
(320b) Audition du capitaine De Cuyper, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 14 mars 1997, p. 166.
(321b) Ibidem , p. 167.
(322b) Audition du lieutenant Nees, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 7 mars 1997, p. 116.
(323b) Ibidem , p. 120.
(324b) Ibidem , p. 120.
(325b) Ibidem , p. 121.
(326b) Audition du colonel Leroy, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 24 mars 1997, p. 229.
(327b) Ibidem , p. 230.
(328b) Audition du colonel Dewez, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 16 avril 1997, pp. 291-292.
(329b) Audition du lieutenant Nees, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 7 mars 1997, p. 108.
(330b) Auditionn du capitaine Claeys, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 13 mai 1997, p. 479.
(331b) Audition du major Podevijn, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997,7 mars 1997, p. 122.
(332b) Ibidem , p. 123.
(333b) Audition du capitaine Claeys, CER , Sénat, 13 mai 1997, PV, p. 71/1 e.s., (CRA , 13 mai 1997, p. 481).
(334b) Audition du colonel Vincent, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 7 mars 1997, p. 129.
(335b) Audition de M. Swinnen, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 21 mars 1997, p. 214.
(336b) Audition de M. Swinnen, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 12 mars 1997, p. 139.
(337b) Audition de M. Swinnen, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 21 mars 1997, p. 218.
(338b) Audition du général Roman, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 25 avril 1997, p. 377.
(339b) Ibidem, p. 377.
(340b) Audition du major Hock, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 21 mars 1997, p. 209.
(341b) Ibidem, p. 209.
(342b) Ibidem, p. 210.
(343b) Ibidem, p. 207.
(344b) Dans la classification du SGR, l'appréciation de la source va de A (cote la plus haute) jusque F (note la plus basse) et l'appréciation du contenu va de 1 jusque 6.
(345b) Audition du major Hock, CRA , CSR, 1996-1997, Sénat, 21 mars 1997, p. 210.
(346b) Ibidem, p. 210.
(347b) Ibidem, p. 211.
(348b) Audition du général Verschoore, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 12 mars 1997, pp. 142-143.
(349b) Ibidem, p. 142.
(350b) Ibidem, p. 146.
(351b) Ibidem, p. 144.
(352b) Ibidem, p. 147.
(353b) Ibidem, p. 145.
(354b) Ibidem, p. 145.
(355b) Ibidem, pp. 145-146.
(356b) Audition du général Delhotte, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 21 mars 1997, p. 199.
(357b) Ibidem, p. 199.
(358b) Audition du général Charlier, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 28 mars 1997, p. 268.
(359b) Audition du général Roman, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 25 avril 1997, p. 377.
(360b) Audition du major Hock, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 21 mars 1997, p. 207.
(361b) Ibidem, p. 206.
(362b) Audition du général Verschoore, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 12 mars 1997, p. 146.
(363b) Ibidem, p. 146.
(364b) Ibidem, pp. 142 et 143.
(365b) Ibidem, p. 143.
(366b) Ibidem, p. 147.
(367b) Ibidem, p. 146.
(368b) Ibidem, p. 144.
(369b) Audition du général Delhotte, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 21 mars 1997, p. 197.
(370b) Ibidem, pp. 20/3 (réunion à huis clos).
(371b) Ibidem, pp. 20/3 (réunion à huis clos).
(372b) Audition du major Podevijn, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 7 mars 1997, p. 123.
(373b) Audition du général Verschoore, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 12 mars 1997, p. 145.
(374b) Audition du général Charlier, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 28 mars 1997, p. 264.
(375b) Ibidem, p. 264.
(376b) Ibidem, p. 264.
(377b) Ibidem, p. 264.
(378b) Audition du général Schellemans, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 12 mars 1997, p. 149.
(379b) Ibidem, p. 150.
(380b) Collaborateurs de cabinet chargés du suivi de certains projets.
(381b) Audition du général Schellemans, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 12 mars 1997, p. 149.
(382b) Audition de M. Delcroix, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 5 mars 1997, p. 90.
(383b) Ibidem, p. 90.
(384b) Ibidem, p. 90.
(385b) Audition de M. Delcroix, CRA , CSR, 1996-1997, 26 mars 1997, p. 261.
(386b) Audition du colonel Vincent, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 7 mars 1997, p. 126.
(387b) Ibidem, p. 126.
(388b) Audition de M. Swinnen, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 12 mars 1997, pp. 137-139.
(389b) Audition de M. Swinnen, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 21 mars 1997, p. 215.
(390b) Ibidem, p. 220.
(391b) Ibidem, pp. 211-214.
(392b) Audition de M. Swinnen, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 12 mars 1997, p. 132.
(393b) Audition de M. Swinnen, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 21 mars 1997, p. 220.
(394b) Audition de M. Willems, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 18 mars 1997, p. 182.
(395b) Ibidem, pp. 184-185.
(396b) Audition de M. Delcroix, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 5 mars 1997, p. 81.
(397b) Audition du général Charlier, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 28 mars 1997, p. 264.
(398b) Audition du général Schellemans, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 12 mars 1997, p. 151.
(399b) Audition de M. Delcroix, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 5 mars 1997, p. 91.
(400b) Audition de M. Delcroix, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 5 mars 1997, p. 90.
(401b) Ibidem, p. 81.
(402b) Audition du lieutenant Nees, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 7 mars 1997, p. 119.
(403b) Le capitaine De Cuyper n'occupait cette fonction que depuis deux semaines.
(404b) Audition du capitaine De Cuyper, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 14 mars 1997, p. 171.
(405b) Ibidem, p. 176.
(406b) Audition du colonel Leroy, CRA , CSR, Sénat, 24 mars 1997, pp. 237 à 238.
(407b) Audition du colonel Balis, CRA, CER, Sénat, 1996-1997, 29 mai 1997, p. 585.
(408b) Audition du lieutenant Nees, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 7 mars 1997, p. 119.
(409b) Audition du colonel Marchal, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 14 mars 1997, p. 171.
(410b) Audition du colonel Balis, CRA, CER, Sénat, 1996-1997, 29 mai 1997, p. 589.
(411b) Audition du colonel Marchal, CRA, CER, Sénat, 1996-1997, 7 mars 1997, p. 108.
(412b) Audition du colonel Marchal, CRA, CER, Sénat, 1996-1997, 14 mars 1997, p. 172.
(413b) Audition de M. Willems, CRA, CSR, Sénat, 1996-1997, 18 mars 1997, p. 185.
(414b) Audition du lieutenant Nees, CRA, CSR, Sénat, 1996-1997, 7 mars 1997, p. 117.
(415b) Audition du colonel Leroy, CRA, CSR, Sénat, 1996-1997, 24 mars 1997, p. 232.
(416b) Audition du colonel Marchal, CRA, CSR, Sénat, 1996-1997, 14 mars 1997, p. 171.
(417b) Audition du capitaine Noens, CER, Sénat, 13 mai 1997, PV, p. 91/6 e.s. (CRA du 13 mai 1997, p. 491).
(418b) Audition du colonel Dewez, 10 juin 1997, PV, p. 2/9 e.s. (CRA du 10 juin 1997, p. 673-674).
(419b) Ibidem, p. 4/5 e.s. (CRA du 10 juin 1997, p. 674).
(420b) Audition du colonel Dewez, CRA, CER, Sénat, 1996-1997, 10 juin 1997, p. 675.
(421b) Ibidem , p. 678.
(422b) Audition du colonel Dewez, CER , Sénat, 10 juin 1997, PV, p. 10/13 e.s. (CRA du 10 juin 1997, p. 678).
(423b) Audition du colonel Marchal, CER, CRA , Sénat, 1996-1997, 10 juin 1997, p. 692).
(424b) Rapport Behrin, p. 31.
(425b) Rapport du lieutenant général Uytterhoeven du 16 novembre 1994, tome I, p. 21.
(426b) Audition à huis clos du colonel Marchal, CSR, Sénat, 19 mars 1997, PV, p. 18/3.
(427b) Rapport du lieutenant général Uytterhoeven du 16 novembre 1994, tome I, p. 9 et courrier du lieutenant-colonel Leroy du 30 mars 1994, « Objet : enseignements de l'opération UNAMIR I », annexe A.
(428b) Ibidem.
(429b) Rapport du lieutenant-colonel Leroy du 30 mars 1994, « Objet: enseignements de l'opération UNAMIR I », annexe A.
(430b) Rapport du lieutenant général Uytterhoeven du 16 novembre 1994, tome I, p. 9.
(431b) Audition à huis clos du colonel Marchal, op cit. , PV, p. 18/3.
(432b) Rapport du lieutenant-colonel Leroy du 30 mars 1994, « Objet: enseignements de l'opération UNAMIR I », annexe A.
(433b) Ibidem.
(434b) Ibidem : « même si le sentiment qui prédomine est que les « incidents » au niveau des CHP ont été orchestrés (...) ».
(435b) Audition à huis clos du colonel Marchal, CRA, CSR, Sénat, 1996-1997, 19 mars 1997, p. 18/3.
(436b) Ibidem.
(437b) Audition du lieutenant Nees, CRA , CSR , Sénat, 1996-1997, 7 mars 1997, p. 117.
(438b) Ibidem, p. 119. Sur ce point, voir 3.3.1.
(439b) Audition de M. Van Winsen, CER, CRA , Sénat, 6 mai 1997, PV, p. 411.
(440b) Rapport du lieutenant général Uytterhoeven du 16 novembre 1994, tome I, p. 9.
(441b) Rapport du lieutenant-colonel Leroy du 30 mars 1994, « Objet: enseignements de l'opération UNAMIR I », annexe C.
(442b) Rapport du lieutenant général Uytterhoeven du 16 novembre 1994, tome I, p. 9.
(443b) Rapport du lieutenant général Uytterhoeven du 16 novembre 1994, exposé du lieutenant-colonel Leroy, tome II, annexe A, app. 8, p. 2.
(444b) Ibidem , p. 20.
(445b) Ibidem .
(446b) Ibidem .
(447b) Rapport du lieutenant-général Uytterhoeven du 16 novembre 1994, tome I, p. 21.
(448b) Ibidem .
(449b) Ibidem , p. 51.
(450b) Audition de M. Van Winsen, auditeur militaire émérite au conseil de guerre, CER, Sénat, 6 mai 1997, PV, p. 14 (CRA , p. 412).
(451b) Rapport du lieutenant-général Uytterhoeven du 16 novembre 1994, tome I, p. 22.
(452b) Ibidem , p. 51.
(453b) Rapport du lieutenant-colonel Leroy du 30 mars 1994, « Objet : enseignements de l'opération UNAMIR I », annexe A.
(454b) Audition du capitaine Theunissen, CER , Sénat, 6 juin 1997, PV, pp. 29/4 et 29/5.
(455b) Audition du lieutenant Lecomte, CER , Sénat, 7 mai 1997, PV, pp. 22/11 à 23/2.
(456b) Rapport du lieutenant-général Uytterhoeven du 16 novembre 1994, tome II, Ann. C., App. 3.
(457b) Rapport du lieutenant-général Uytterhoeven du 16 novembre 1994, tome I, p. 22.
(458b) Forces armées État-major Division opération, Ordre général, J/797 B, « Objet: Le conseiller en droit des conflits armés », 8 février 1996.
(459b) Audition du commandant Noens, CER , Sénat, 13 mai 1997, PV, p. 86/1.
(460b) Audition du commandant Noens, CER , Sénat, 13 mai 1997, PV, p. 87/1.
(461b) Audition du commandant Noens, CER , Sénat, 13 mai 1997, PV, p. 91/2.
(462b) Audition du major Bodart, CER , Sénat, 13 mai 1997, PV, p. 97/2-97/4.
(463b) Audition du capitaine Theunissen, CRA , CER , Sénat, 1996-1997, 6 juin 1997, p. 661.
(464b) Audition du caporal-chef Pierard, CRA , CER , Sénat, 1996-1997, 27 juin 1997, p. 879.
(465b) Audition du caporal Kinkin, CRA , CER , Sénat, 1996-1997, 27 juin 1997, blz. 879.
(466b) Rapport du lieutenant-général Uytterhoeven du 16 novembre 1994, partie I, p. 21.
(467b) Ibidem, annexe C.
(468b) Document signé par le lieutenant-colonel Dewez, du 19 mars 1994, intitulé « Liste B KIBAT Objet : Régime des sorties ».
(469b) Rapport du lieutenant-colonel Leroy du 30 mars 1994, « Objet: enseignements de l'opération UNAMIR I », annexe C.
(470b) Ibidem.
(471b) Document daté du 2 avril 1994, à diffusion interne, « Objet: compte rendu d'une réunion CCI du 30 mars 94 ».
(472b) Rapport du lieutenant-colonel Leroy du 30 mars 1994, « Objet: enseignements de l'opération UNAMIR I ».
(473b) Audition du lieutenant-colonel Leroy, CRA, CSR, Sénat, 1996-1997, 24 mars 1997, p. 225.
(474b) Cf. Chrétien, Jean-Pierre (dir), Rwanda. Les médias du génocide, Éditions Karthala, Paris, 1995, p. 366.
475Audition de M. J.-L. Dehaene, CRA , CSR. Sénat, 1996-1997, 8 mars 1997, p. 106.
(476b) Document ONU, S/R 2.872, 5 octobre 1993, § 3.
(477b) Rapport du Secrétaire général sur le Rwanda, document ONU S/26488, 24 septembre 1993.
(478b) Audition de M. Cools, CRA , CER , Sénat, 1996-1997, 29 avril 1997, p. 398.
(479b) Audition de M. Gasana, CRA , CSR , Sénat, 1996-1997, 19 février 1997, p. 16.
(480b) Audition de M. Claes, CRA , CER , Sénat, 1996-1997, 18 avril 1997, p. 296.
(481b) Audition du professeur Reyntjens, CRA , CSR , Sénat, 1996-1997, 26 février 1997, p. 30.
(482b) Audition du professeur Reyntjens, CRA , CER , Sénat, 1996-1997, 18 avril 1997, p. 298.
(483b) Annales parlementaires, Sénat, 29 mars 1994, p. 1765.
(484b) Audition du lieutenant-général Charlier, CRA , CSR , Sénat, 1996-1997, 28 février 1997, p. 65.
(485b) Ibid. , p. 70.
(486b) Audition du colonel Marchal, CRA , CER , Sénat, 1996-1997, 7 mars 1997, p. 110.
487b) Audition du capitaine Lemaire, CER , Sénat, 7 mai 1997, PV, pp. 34/1, 34/2 et 34/4.
(488b) Ibid. , PV, p. 39/4.
(489b) Audition de Mme Des Forges, CRA , CSR , Sénat, 1996-1997, 26 février 1997, p. 35.
(490b) Mission générale de l'UNAMIR (se trouvant dans le dossier Auditorat Général près de la Cour militaire).
(491b) Audition de M. Brouhns, CER, Sénat, 1996-1997, 25 juin 1997, p. 835. PV, pp. 27/20 et 27/21.
(492b) Audition de M. Cools, CRA, CSR, Sénat, 1996-1997, 29 avril 1997, pp. 398 et 399.
(493b) Audition du colonel Marchal, CRA, CSR, Sénat, 1996-1997, 7 mars 1997, pp. 109 et 110.
(494b) Audition du lieutenant général Charlier, CRA, CSR, Sénat, 1996-1997, 28 février 1997, p. 65.
(495b) Ibid., p. 70.
(496b) Ibid., p. 70.
(497b) Dossier Auditorat Général près de la Cour militaire, p. 13, § 29.
(498b) Audition du lieutenant général Berhin, CRA, CSR, Sénat, 1996-1997, 29 avril 1997, p. 389.
(499b) Audition du colonel Marchal, CRA, CSR, Sénat, 1996-1997, 7 mars 1997, p. 169.
(500b) Ibid., p. 109.
(501b) Audition du lieutenant général Berhin, CRA, CSR, Sénat, 1996-1997, 29 avril 1997, p. 389.
(502b) Audition du lieutenant général Uytterhoeven, CRA , CSR , Sénat, 1996-1997, 25 avril 1997, p. 365.
(503b) Audition du commandant Noens, CER , Sénat, 13 mai 1997, PV, pp. 86/1 et 86/2.
(504b) Audition du lieutenant Lecomte, CER , Sénat, 7 mai 1997, PV, pp. 2/5, 2/6 et 2/8.
(505b) Audition du major Bodart, CER , Sénat, 13 mai 1997, PV, pp. 98/2, 98/3 et 98/4.
(506b) Audition du général-major Roman, CRA , CSR , Sénat, 1996-1997, 25 avril 1997, p. 370.
(507b) Audition du caporal-chef Pierard, CER , Sénat, 27 juin 1997, PV, p. 9/10.
(508b) Audition de l'adjudant Boequelloen, CER , Sénat, 27 juin 1997, PV, p. 9/24.
(509b) Audition du caporal-chef Pierard, CER , Sénat, 27 juin 1997, PV, p. 9/24.
(510b) Audition de l'adjudant Boequelloen, CRA , CER , Sénat, 27 juin 1997, PV, p. 9/24.
(511b) Audition du caporal-chef Pierard, CER , Sénat, 27 juin 1997, PV, p. 9/10.
(512b) Audition du colonel Flament, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 28 février 1997, p. 60.
(513b) Ibid.
(514b) Rapport du lieutenant-colonel Leroy, KIBAT I.
(515b) Audition du lieutenant-colonel Briot, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 28 février 1997, p. 63.
(516b) Audition du lieutenant Nees, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 7 mars 1997, p. 119.
(517b) Audition du colonel Marchal, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 7 mars 1997, pp. 110 et 111.
(518b) Audition du lieutenant Nees, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 7 mars 1997, p. 117.
(519b) Audition du colonel Marchal, CRA , CSR , Sénat, 1996-1997, 14 mars 1997, p. 174.
(520b) Audition du commandant Noens, CER , Sénat, 1996-1997, 14 mars 1997, PV, pp. 90/11, 91/1 et 91/2.
(521b) Audition du colonel Marchal, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 7 mars 1997, p. 112.
(522b) Rapport du lieutenant-colonel Leroy, KIBAT I.
(523b) Télex du 25 février 1994 de MINAFET à DELBELONU.
(524b) Télex nº 326 du 28 février 1994 de DELBELONU à MINAFET Bruxelles.
(525b) Télex nº 209 du 15 mars 1994.
(526b) Télex nº 510 NY du 22 mars 1994.
(527b) Télex nº 567 NY du 30 mars 1994.
(528b) Télex nº 578 NY du 30 avril 1994.
(529b) Télex nº 583 NY du 31 mars 1994.
(530b) Dans la matinée du 7 avril, à la demande du général Dallaire, un certain nombre d'hommes ont bel et bien été envoyés à l'endroit où l'avion présidentiel s'est abattu. Un barrage des FAR leur en a toutefois interdit l'accès.
(531b) Audition du professeur Reyntjens, CER , Sénat, 14 mai 1997, PV, p. 9/1 (CRA , p. 502).
(532b) Audition de M. Twagiramungu, CER , Sénat, 30 mai 1997, PV, p. 23/9.
(533b) Audition de M. Nsengiyaremye, CER , Sénat, 18 juin 1997, PV.
(534b) Audition de M. Degni-Segui, CER , Sénat, 17 juin 1997, PV, p. 39/5.
(535b) Audition de M. Van Winsen, CER , Sénat, 6 mai 1997, PV, p. 2/2 e.s. (CRA , p. 406).
(536b) Audition de M. Van Winsen, CER , Sénat, 6 mai 1997, PV, p. 2/2 e.s. (CRA , p. 406).
(537b) Audition de M. Van Winsen, CER , Sénat, 6 mai 1997, PV, p. 3/8 e.s. (CRA , p. 407).
(538b) Audition du commandant De Troy, CER , Sénat, 29 mai 1997.
(539b) Rapport du groupe ad hoc Rwanda, Sénat, 7 janvier 1997, pp. 95-104.
(540b) Audition du capitaine Marchal, CER , Sénat, 13 mai 1997, pp. 24/6 et 24/7.
(541b) Audition du capitaine Marchal, CER , Sénat, 13 mai 1997, pp. 26/8 à 26/10.
(542b) Audition du capitaine Theunissen, CER , Sénat, 6 juin 1997, PV, p. 15/7 (CRA , p. 661).
(543b) Audition du colonel Dewez, CER , Sénat, 10 juin 1997, PV, p. 15/14 e.s.
(544b) Audition du colonel Vincent, CRA, CSR, Sénat, 1996-1997, 7 mars 1997, CRA , p. 126.
(545b) Note confidentielle du colonel Marchal, p. 21.
(546b) Audition du major Choffray, CER , Sénat, 13 mai 1997, PV, p. 31/5 e.s.
(547b) Audition du capitaine Lemaire, CER , Sénat, 7 mai 1997, PV, p. 33/5.
(548b) Audition de M. Scheers, CER , Sénat, 24 juin 1997, PV, p. 4/11 e.v. (CRA , p. 90/3).
(549b) Audition de M. Scheers, CER , Sénat, 24 juin 1997, PV, p. 5/7 à 5/11.
(550b) Eugène Nahimana agissait en qualité de porte-parole de la section belge du MRND. Papias Ngaboyamahina est le président du MRND Belgique jusqu'en avril 1993. Il est le coordinateur de la Radio des mille collines en Belgique. Il est l'auteur d'un communiqué accusant les paracommandos belges de l'assassinat de Habyarimana. Paulin Murayi a fait l'objet d'un refus d'asile politique le 19 avril 1996. Ces personnes étaient toutes trois actionnaires de RTLM. Elles faisaient également partie d'organisations proches du gouvernement rwandais comme la section belge du MRND et la CERB située avenue des Fleurs, 1 à 1050 Bruxelles (adresse de l'ambassade du Rwanda). Elles ont signé, conjointement avec Georges Ruggiu, des pétitions, ont fait des communiqués de presse et ont informé des autorités rwandaises, par exemple le colonel Sagatwa, de leurs activités. Notamment dans un fax du 16 octobre 1992 : « notre travail de désinformation et de propagande est à encourager... » Elles ont poursuivi leurs activités au nom du MRND-Belgique également après les événements des 6 et 7 avril. Outre le communiqué cité ci-dessous du 7 avril 1994, elles ont notamment diffusé le 11 mai 1994 des informations dans lesquelles des organisations de défense des droits de l'homme telles que Africa Watch étaient accusées de subjectivité. Dans une déclaration du MRND-Belgique du 13 mai 1994 signé par Eugène Nahimana, attaché de presse officiel du MRND-Belgique, on retrouve ce qui suit : « (...) à la radio RTLM de ne pas céder aux provocations de l'ennemi et de poursuivre ses objectifs de formation-information de la population rwandaise. » Ensuite : « Le peuple belge qui se souviendrait de la bataille des Éperons d'Or (1302) devrait pouvoir comprendre ce qui se passe actuellement au Rwanda. Devant le danger, les Metiers se levèrent en masse, brandissent leur terrible Goedendag (machettes des Hutus) pour une liberté et une indépendance d'un peuple longtemps frustré. »
(551b) Audition de M. E. Nahimana, CER , Sénat, 17 juin 1997, PV, p. 32/9 e.s.
(552b) Ibidem, PV, p. 33/5 et ss.
(553b) Auditon du général Rusatira, CRA, CSR, Sénat, 1996-1997, 29 avril 1997, p. 381.
(554b) Auditeur-général, B600-19.
(555b) Dossier de l'auditeur général, B618-619.
(556b) Audition de M. Van Winsen, CER, Sénat, 6 mai 1997, p. 19/11).
(557b) Audition du colonel Dewez, CER , Sénat, 10 juin 1997, PV, p. 16/10 e.s.
(558b) Audition du colonel Marchal, CER , Sénat, 10 juin 1997.
(559b) Audition du capitaine Marchal, CER , Sénat, 13 mai 1997, CRA , p. 460 : le « carnet de veille OSCAR » ne mentionne toutefois qu'à 5 h 56 l'information du capitaine Marchal (C6), voir document en annexe p. 16.
(560b) Audition du major Choffray, CER , Sénat, 13 mai 1997.
(561b) Audition du major Bodart, CER , Sénat, 13 mai 1997, CRA , p. 102/8.
(562b) Réponses sur les questions posées par le juge-avocat-général de la cour militaire au général-major Dallaire, p. 22, point 46, dossier auditorat-général près la Cour militaire, Not. nº 01.00009.95.
(563b) Audition du colonel Marchal, CER , Sénat, 10 juin 1997 (CRA p. 690).
(564b) Answers to questions submitted to Major-General Dallaire by the Judge-Advocate General of the Military Court p. 11-12 points 20 et 46 voir dossier auditorat-général près la Cour militaire Not. nº 01.00009.95.
(565b) Réponses sur les questions posées par le juge-avocat-général de la cour militaire au général-major Dallaire, p. 11, point 22, voir dossier auditorat-général près la Cour militaire, Not. nº 01.00009.95.
(566b) Réponses sur les questions posées par le juge-avocat-général de la cour militaire au général-major Dallaire, p. 12, point 23, voir dossier auditorat-général près la Cour militaire, Not. nº 01.00009.95.
(567b) Réponses sur les questions posées par le juge-avocat-général de la cour militaire au général-major Dallaire, p. 12, point 24, voir dossier auditorat-général près la Cour militaire, Not. nº 01.00009.95.
(568b) Audition de M. Rusatira, CRA, CSR, Sénat, 1996-1997, 29 avril 1997, p. 382.
(569b) Réponses sur les questions posées par le juge-avocat-général de la cour militaire au général-major Dallaire, p. 14, point 27, voir dossier auditorat-général près la Cour militaire, Not. nº 01.00009.95.
570Réponses sur les questions posées par le juge-avocat-général de la cour militaire au général-major Dallaire, p. 15, point 28, voir dossier auditorat-général près la Cour militaire, Not. nº 01.00009.95.
(571b) Audition du colonel Marchal, CER , Sénat, 10 juin 1997.
(572b) Audition du colonel Marchal, CER , Sénat, 10 juin 1997.
(573b) Réponses sur les questions posées par le juge-avocat-général de la cour militaire au général-major Dallaire, p. 20, point 41, voir dossier auditorat-général près la Cour militaire, Not. nº 01.00009.95.
(574b) Audition du colonel Marchal, CER , Sénat, 10 juin 1997.
(575b) Réponses sur les questions posées par le juge-avocat-général de la cour militaire au général-major Dallaire, p. 16-17, point 32, voir dossier auditorat-général près la Cour militaire, Not. nº 01.00009.95.
(576b) Réponses sur les questions posées par le juge-avocat-général de la cour militaire au général-major Dallaire, p. 17, point 33, voir dossier auditorat-général près la Cour militaire, Not. nº 01.00009.95.
(577b) Réponses sur les questions posées par le juge-avocat-général de la cour militaire au général-major Dallaire, p. 18, 19, 20 et 21, points 35, 38, 39, 40, 43 et 44, voir dossier auditorat-général près la Cour militaire, Not. nº 01.00009.95.
(578b) Audition du colonel Marchal, CER , Sénat, 10 juin 1997.
(579b) Réponses aux questions posées par le juge-avocat-général de la cour militaire au général-major Dallaire, nº 67, p. 30.
(580b) Réponses aux questions posées par le juge-avocat-général de la cour militaire au général-major Dallaire, nº 71, p. 32.
(581b) Audition du major Maggen, CER , Sénat, 7 mai 1997.
(582b) Dossier de l'auditorat général près la Cour militaire, not. nº 01.00009.95, p. 54.
(583b) Dossier de l'auditorat général près la Cour militaire, not. nº 01.00009.95, pp. 227 et 228.
(584b) Dossier de l'auditorat général près la Cour militaire, not. nº 01.0000.95, pp. 216 et 217.
(585b) Audition du colonel Dewez, CER , Sénat, 10 juin 1997, PV, p. 10/8.
(586b) Audition du colonel Dewez, CER , Sénat, 10 juin 1997, PV, p. 6/10.
(587b) Audition du colonel Dewez, CER , Sénat, 10 juin 1997, PV, p. 9/14 CRA .
(588b) Audition du colonel Dewez, CER , Sénat, 1996- 1997, 10 juini 1997, PV, p. 13/6.
(589b) Audition du colonel Dewez, CER , Sénat, 10 juin 1997 (CRA , pp. 676, 678).
(590b) Audition du colonel Dewez, CER , Sénat, 10 juin 1997 (CRA , p. 911).
(591b) Audition du colonel Dewez, CER , Sénat, 10 juin 1997 (CRA , pp. 675 et 688), le colonel Marchal se souvient encore qu'à cette réunion, le colonel Bagosora n'est pas intervenu. « Le silence du colonel Bagosora m'a surpris, car ce n'était pas son habitude. »
(592b) Audition du colonel Dewez, CER , Sénat, 10 juin 1997, PV, p. 10/3 (CRA , p. 678).
(593b) Audition du colonel Dewez, CER , Sénat, 10 juin 1997, PV, p. 10/13 (CRA, p. 678).
(594b) Audition du colonel Marchal, CER , Sénat, 10 juin 1997 (CRA , p. 689).
(595b) Ibid., p. 693.
(596b) Audition du colonel Dewez, CER , Sénat, 10 juin 1997 (CRA , p. 681).
(597b) Audition du colonel Marchal, CER , Sénat, 10 juin 1997, PV, p. 26/4 (CRA , p. 690).
(598b) Ibid., p. 23/3.
(599b) Audition du major Choffray, CER, Sénat, 13 mai 1997, PV, (CRA , p. 468).
(600b) Voir document en annexe, p. 13.
(601b) Audition du colonel Marchal, CER , Sénat, 10 juin 1997, (CRA , p. 681) et document en annexe, pp. 16 et 17.
(602b) Voir document en annexe, pp. 9-15.
(603b) Voir document en annexe, p. 17.
(604b) Audition du colonel Dewez, CER , Sénat, 10 juin 1997, PV, p. 8/6 e.s.
(605b) Audition du capitaine Marchal, CER , Sénat, 13 mai 1997, (CRA , p. 458).
(606b) Ibid., pp. 460, 461 et 463.
(607b) Audition du major Choffray, CER , Sénat, 13 mai 1997 (CRA , p. 475).
(608b) Dossier de l'auditorat général près la Cour militaire, not. nº 01.00009.95, p. 530.
(609b) Audition du major Choffray, CER , Sénat, 13 mai 1997 (CRA , p. 478).
(610b) Audition du colonel Dewez, CER , Sénat, 10 juin 1997, PV, p. 8/18.
(611b) Audition du colonel Dewez, CER , Sénat, 30 juin 1997.
(612b) Audition du colonel Dewez, CER , Sénat, 10 juin 1997, PV, p. 8/18 (CRA , pp. 680 et 682).
(613b) Audition de l'adjudant Boequelloen, CER , Sénat, 27 juin 1997, PV, p. 6/10.
(614b) Audition du major Choffray, CER , Sénat, 13 mai 1997, PV, p. 55/1 (CRA, p. 475).
(615b) Audition du colonel Dewez, CER , Sénat, 10 juin 1997 (CRA , p. 678).
(616b) Audition du colonel Dewez, CER , Sénat, 10 juin 1997 (CRA , p. 678).
(617b) Audition du colonel Marchal, CER , Sénat, 10 juin 1997, PV, p. 29/12 (CRA , p. 692).
(618b) Audition du colonel Dewez, CER , Sénat, 30 juin 1997, PV, p. 27/16 (CRA , p. 911).
(619b) Voir document en annexe, pp. 24 et 25.
(620b) Audition de l'adjudant Boequelloen, CER , Sénat, 27 juin 1997, PV, p. 15/4.
(621b) Audition du major Choffray, CER , Sénat, 13 mai 1997, p. 468, 469 et 478.
(622b) Audition du major Choffray, CRA, CER , Sénat, 13 mai 1997, p. 471.
(623b) Audition du capitaine Theunissen, CER , Sénat, 6 juin 1997, PV, pp. 2/9 à 2/12 et 3/1 à 3/4.
(624b) Audition du capitaine Theunissen, CER , Sénat, 6 juin 1997, PV, p. 2/9 (CRA, p. 659).
(625b) Audition du caporal-chef Pierard, CER , Sénat, 27 juin 1997, PV, p. 6/11 (CRA , p. 873).
(626b) Audition du colonel Dewez, CER , Sénat, 10 juin 1997, PV, p. 6/11 (CRA , p. 676).
(627b) Audition de l'adjudant Boequelloen, CER , Sénat, 27 juin 1997, PV, p. 6/11 (CRA , p. 873).
(628b) Audition du capitaine Theunissen, CER , Sénat, 30 juin 1997 (CRA , p. 907).
(629b) Audition du colonel Dewez, CER , Sénat, 30 juin 1997, CRA , pp. 907 et 908.
(630b) Audition du colonel Dewez, CER , Sénat, 10 juin 1997, PV, p. 7/11.
(631b) Audition du colonel Dewez, CER , Sénat, 10 juin 1997, PV, p. 8/6 à 10/2.
(632b) Audition du colonel Marchal, CER , Sénat, 10 juin 1997, PV, p. 28/6.
(633b) Audition du colonel Marchal, CER , Sénat, 10 juin 1997, PV, p. 29/4.
(634b) Voir document en annexe, p. 23.
(635b) Audition du colonel Dewez, CER , Sénat, 30 juin 1997, PV, p. 22/9 et ss.
(636b) « Non, pour moi, c'était à l'École royale militaire mais je ne connaissais pas l'endroit exact » et « J'ai entendu, pour la première fois, les termes « camp Kigali » passé midi. » Audition du colonel Marchal, CER , Sénat, 1996-1997, 10 juin 1997 (CRA , pp. 692 et 695).
(637b) Voir document en annexe, p. 24; on retrouve d'ailleurs aussi, exactement à la même heure, à peu près le même message dans le « Carnet de veille OSCAR », « et ?? essayer prendre contact UNO camp Kigali pour sit Y car pas de contact Tf FAR AN ».
(638b) Audition du capitaine Theunissen, CER , Sénat, 6 juin 1997 (CRA , p. 663).
(639b) Audition du colonel Dewez, CER , Sénat, 10 juin 1997, PV, p. 3/11.
(640b) Audition du colonel Marchal, CER , Sénat, 10 juin 1997 (CRA , p. 692).
(641b) Audition du capitaine Theunissen, CER , Sénat, 10 juin 1997, PV, p. (CRA , p. 674).
(642b) Audition du capitaine Theunissen, CER , Sénat, 6 juin 1997, CRA , p. 659 et audition du caporal-chef Pierard, CER , Sénat, 6 juin 1997, PV, CRA , p. 903.
(643b) Audition du colonel Marchal, CER , Sénat, 10 juin 1997 (CRA , pp. 690 et 691).
(644b) Audition du colonel Dewez, CER , Sénat, 30 juin 1997, CRA , p. 911.
(645b) Audition du colonel Dewez, CER , Sénat, 30 juin 1997, PV, p. 28/1 et ss.
(646b) « Réponses sur les questions posées par le juge-avocat-général de la cour militaire au général-major Dallaire, p. 27, point 70, voir dossier auditorat-général près la Cour militaire, Not. nº 01.00009.95.
(647b) Rapport du groupe ad hoc Rwanda, annexe nº 5, Sénat, 7 janvier 1997, pp. 3-7.
(648b) Audition du capitaine Lemaire, CER , Sénat, 7 mai 1997 (CRA , p. 431).
(649b) Voir document en annexe, pp. 9-12.
(650b) Audition du major Choffray, CER , Sénat, 1996-1997, 13 mai 1997 (CRA , p. 469).
(651b) Voir document en annexe, pp. 11-15.
(652b) Audition du major Choffray, CER , Sénat, 13 mai 1997, CRA , p. 469.
(653b) Audition du colonel Dewez, CER , Sénat, 10 juin 1997, PV, p. 10/4 (CRA , p. 678).
(654b) Audition du colonel Dewez, CER , Sénat, 10 juin 1997, PV, p. 10/8 (CRA, p. 679).
(655b) Audition du colonel Dewez, CER , Sénat, 10 juin 1997, PV, p. 11/3.
(656b) Voir document en annexe, pp. 23 et 24.
(657b) Audition du colonel Marchal, CER , Sénat, 10 juin 1997, PV, p. 46/4.
(658b) Audition du colonel Dewez, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 16 avril 1997, p. 290.
(659b) Audition du colonel Dewez, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 24 mars 1997, p. 231.
(660b) Rapport du lieutenant général Uytterhoeven du 16 novembre 1994 tome 1, p. 21.
(661b) Audition de l'aumônier Quertemont, CRA, CER , Sénat, 7 mai 1997, p. 436-437.
(662b) Rapport du lieutenant-général Uytterhoeven du 16 novembre 1994, Ann. C, App. 2, p. 2.
(663b) Rapport du lieutenant général Uytterhoeven du 16 novembre 1994, Ann. F, App. 2.
(664b) Rapport du lieutenant général Uytterhoeven du 16 novembre 1994, Ann. F, App. 3.
(665b) Rapport du lieutenant général Uytterhoeven du 16 novembre 1994, Ann F, App. 4, p. 2.
(666b) Audition du capitaine Theunissen, CER , Sénat, 6 juin 1997, PV, p. 1/4, 2/8 à 2/12 et 3/1.
(667b) Audition du capitaine Theunissen, CER , Sénat, 6 juin 1997, (CRA , p. 661).
(668b) Audition du caporal-chef Pierard, CER , Sénat, 27 juin 1997, PV, p. 8/2, (CRA , p. 877).
(669b) Audition du caporal-chef Pierard, CER , Sénat, 27 juin 1997, PV, p. 10/12, (CRA , p. 878).
(670b) Audition du lieutenant Leconte, CER , Sénat, 7 mai 1997, p. 2/11 et suiv.
(671b) Voir procès-verbal de l'audition du colonel Marchal et du colonel Dewez du 28 décembre 1995 par la commission judiciaire près la Cour militaire - dossier de l'auditorat général près la Cour militaire - Not. nº 01.00009.95 - p. 1499 et suivantes.
(672b) Audition du colonel Dewez, CER , Sénat, 10 juin 1997 (CRA , p. 680).
(673b) Audition du colonel Dewez et du capitaine Theunissen, CER , Sénat, 30 juin 1997 (CRA , p. 910).
(674b) Audition du colonel Dewez et du capitaine Theunissen, CER , Sénat, 30 juin 1997 (CRA , p. 903).
(675b) Audition du major Choffray, CER , Sénat, 13 mai 1997, PV, p. 32/4 e.s.
(676b) Audition du major Choffray, CER , Sénat, 13 mai 1997, PV, p. 48/1.
(677b) Audition du colonel Marchal, CER , Sénat, 10 juin 1997 (CRA , p. 691).
(678b) Audition du colonel Marchal, CER , Sénat, 10 juin 1997 (CRA , p. 694).
(679b) Audition du capitaine Marchal, CER , Sénat, 13 mai 1997 (CRA , pp. 457, 461 et 462).
(680b) Audition du capitaine Lemaire, CER , Sénat, 7 mai 1997 (CRA , pp. 429 et 430).
(681b) Audition du lieutenant Lecomte, CER , Sénat, 7 mai 1997 (CRA , pp. 424 et 427).
(682b) Dossier de l'auditorat général près la Cour militaire, not. nº 01.00009.95, p. 232.
(683b) Audition du capitaine Theunissen, CER , Sénat, 6 juin 1997 (CRA , p. 663).
(684b) Audition du capitaine Theunissen, CER , Sénat, 27 juin 1997 (CRA , p. 668).
(685b) Audition du caporal-chef Pierard, CER , Sénat, 27 juin 1997 (CRA , p. 880).
(686b) Audition de représentants des familles et apparentés des victimes civiles belges, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 19 février 1997.
(687b) Pour plus d'informations concernant l'asbl Nord-Sud et les projets de coopération qu'elle met sur pied à Rambura, voir point 3.13.
(688b) Article 3 des statuts publiés aux annexes du Moniteur belge du 21 mars 1985, p. 131.
(689b) Document de M. Ivan Godfriaux, p. 1.
(690b) Audition de M. Godfriaux, audition de représentants des familles et apparentés des victimes civiles belges, CRA, CSR, Sénat, 1996-1997, 19 février 1997, p. 12.
(691b) Déposition de M. Marc Bohy, le 26 juin 1977, procès verbal nº 28603 du 30 juin 1997, parquet du procureur du Roi de Bruxelles, pp. 2 et 3.
(692b) Ibidem .
(693b) Audition de M. Godfriaux, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 19 février 1997, p. 12.
(694b) Audition de M. Dulieu, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 19 février 1997, p. 12-13.
(695b) Audition de Mme Beckers, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 19 février 1997, p. 13.
(696b) Note datée du 18 février 1997 remise à la commission par Mme Beckers lors de son audition.
(697b) Ibidem .
(698b) Audition du colonel Balis, CER , Sénat, 29 mai 1997, PV, p. 11/4 (CRA, p. 587).
(1c) Audition du colonel Balis, CER , Sénat, 29 mai 1997, PV, p. 11/6 (CRA, p. 587).
(2c) Audition de Mme Mugwaneza, CRA, CSR, Sénat, 1996-1997, 19 février 1997, p. 13.
(3c) Prunier, G., The Rwanda Crisis (1989-1994), History of a Genocide, Kampala, Fountain Publishers, 1995, p. 265.
(4c) Dans son audition du 11 juin 1997, il se réfère au rapport Gersony qui cite ce chiffre, CER , Sénat, 11 juin 1997, PV, p. 29/1.
(5c) Nations Unies, Commission des droits de l'Homme, Rapport sur la situation des droits de l'Homme au Rwanda, soumis par M. Degni-Segui, rapporteur spécial de la commission des droits de l'Homme, en application du § 20 de la résolution 1994 S-3/1 de la commission en date du 25 mai 1994, E/CN.4/1195/7, 28 juin 1994, p. 10.
(6c) Audition du professeur Prunier, CER , Sénat, 1996-1997, 11 juin 1997, PV, p. 15/4 et 15/5.
(7c) Audition du professeur Reyntjens, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 26 février 1997, p. 30.
(8c) Ibid.
(9c) Audition de Mme Desforges, CRA, CSR, Sénat, 1996-1997, 26 février 1997, p. 36.
(10c) Audition du père Theunis, CER , Sénat, 3 juin 1997, PV, p. 6/1-6/3.
(11c) Audition du père Theunis, CER, Sénat, 3 juin 1997, PV, p. 6/5-6/8.
(12c) Jean Chatain, « Deux prêtres témoignent sur les atrocités au Rwanda », L'Humanité (3 May 1994). Although most clergy who died were Tutsi, many Hutu priests who were known supporters of human rights and had denounced government atrocities in the past were also murdered.
(13c) African Rights, Rwanda : Death , op. cit., p. 516.
(14c) Dialogue nº 177 (Aug-Sept. 1994), « Liste des prêtres, religieux, religieuses et laïcs consacrés tués au Rwanda », pp. 123-35.
(15c) See Marie-France Cros, « L'échec de l'Internationale IDC« , La Libre Belgique (11 July 1994).
(16c) Revd Roger Bowen, « The role of the Churches in Rwanda : Anglican Perspectives », mimeographed document dated 8 December 1994. Protestants make up an estimated 15 % of the population in Rwanda. See Tharcisse Gatwa and André Karamaga, Les autres Chrétiens Rwandais. La présence protestante , Kigali : Urwego, 1990.
(17c) See Mark Huband, « Church of the Holy Slaughter », Observer (5 June 1994).
(18c) Revd Jorg Zimmerman of the United Evangelical Mission, quoted in African Rights, Rwanda : Death , op. cit., p. 517.
(19c) Audition de M. Degni-Segui, CRA , CER , Sénat, 1996-1997, 17 juin 1997, p. 760.
(20c) Ibid ., p. 51.
(21c) Ibid ., p. 51.
(22c) Lemarchand, René, Rwanda : The Rationality of Genocide, étude non éditée, 1995.
(23c) Audition du professeur Prunier, CER , Sénat, 11 juin 1997, PV , pp. 12/9, 12/10, 13/1, 13/2 et 13/3.
(24c) Ibid. , pp. 13/6 et 13/7.
(25c) Ibid. , p. 17/10.
(26c) Audition de Mme Desforges, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 26 février 1997, pp. 32 et 33.
(27c) Ibid. , p. 35.
(28c) Audition du professeur Reyntjens, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 26 février 1997, p. 25.
(29c) Ibid. , p. 27.
(30c) Audition du professeur Prunier, CER , Sénat, 11 juin 1997, pp. 18/7 à 18/10.
(31c) Audition de M. Nsengiyaremye, CER , Sénat, 18 juin 1997, PV , p. 3/4.
(32c) Audition de Mme Desforges, CRA, CSR , Sénat, 1996-1997, 26 février 1997, p. 36.
(33c) Audition du professeur Prunier, CER , Sénat, 11 juin 1997, PV, pp. 15/6, 15/9, 15/10 et 15/11.
(34c) Ibid. , pp. 14/12 et 14/13.
(35c) Ibid. , p. 15/1.
(36c) Audition de Mme Desforges, CRA , CSR , Sénat, 1996- 1997, 26 février 1997, p. 35.
(37c) Audition de Mme Suhrke, CRA , CSR , Sénat, 1996-1997, 22 avril 1997, p. 328.
(38c) Le Réseau Zéro. Lettre ouverte à Monsieur le Président du MRND, Ed. Uruhimbi, Kigali, juillet-août 1992, pp. 4 et 5.
(39c) Reyntjens, Filip, L'Afrique des Grands Lacs en crise, Karthala, Paris, 1995, p. 188.
(40c) Note du professeur Reyntjens, septembre 1992.
(41c) Conférence de presse à l'occasion d'une visite de M. Reyntjens et de M. Kuypers au Rwanda du 14 au 26 septembre 1992.
(42c) Données sur les escadrons de la mort, note de Filip Reyntjens, 9 octobre 1992.
(43c) Akazu ou Réseau Zéro, dossier remis par l'ancien sénateur Kuypers à la commission spéciale Rwanda lors de son audition du 14 mars 1997.
(44c) FIDH (Fédération internationale des Ligues des Droits de l'Homme), rapport nº 168, Paris, février 1993.
(45c) Ibid., p. 48.
(46c) Ibid. , p. 50.
(47c) Ibid. , pp. 62 et 63.
(48c) Ibid. , pp. 63 à 66.
(49c) Ibid. , p. 95.
(50c) Ibid.
(51c) Blue Book, document 20.
(52c) Rapport du groupe ad hoc Rwanda, pp. 74 à 79, points 4, 5 et 6.
(53c) Télex de l'ambassadeur Swinnen du 27 mars 1992.
(54c) Audition du ministre Delcroix, CRA, CSR , Sénat, 1996-1997, 5 mars 1997, p. 91.
(55c) Audition du ministre Delcroix, CER , Sénat, 18 juin 1997, PV, pp. 22/3.
(56c) Audition du lieutenant général Schellemans, CRA , CSR , Sénat, 1996- 1997, 12 mars 1997, pp. 149 à 151.
(57c) Ibid., p. 150.
(58c) Audition du ministre Claes, CRA , CSR , Sénat, 1996- 1997, 18 avril 1997, p. ....
(59c) Compte rendu de la réunion du 13 janvier 1994.
(60c) Compte rendu de la réunion du 3 février 1994.
(61c) Audition de M. Dehaene, CER , Sénat, 26 juin 1997, PV, pp. 21/2.
(62c) Audition du ministre Delcroix, CER , Sénat, 18 juin 1997, PV, pp. 22/19.
(63c) Ibid., pp. 23/9.
(64c) Ibid., pp. 23/7.
(65c) Ibid., pp. 33/14.
(66c) Audition du Premier ministre Dehaene, CER , Sénat, 26 juin 1997, PV, p. ....
(67c) Exposé introductif de Mme Des Forges du 26 février 1997, pp. 11, 12 et 14.
(68c) Audition de M. Chrétien, CRA, CSR, Sénat, 1996- 1997, 26 mars 1997, p. 240.
(69c) Note du 26 mars 1997 remise à la commission, p. 5.
(70c) Audition de M. Gillet, CRA, CSR, Sénat, 1996-1997, 19 mars 1997, p. 190-191.
(71c) Audition du lieutenant Nees, CRA, CSR, Sénat, 1996- 1997, 7 mars 1997, p. 117.
(72c) Audition du colonel Balis, CER , Sénat, 29 mai 1997, PV , p. 515/5.
(73c) Audition du colonel Vincent, CRA, CSR, Sénat, 1996- 1997, 7 mars 1997, pp. 126 et 127.
(74c) Audition du général major Verschoore, CRA, CSR, Sénat, 1996- 1997, 12 mars 1997, p. 142.
(75c) Audition de l'ambassadeur Swinnen, CRA, CSR, Sénat, 1996- 1997, 12 mars 1997, p. 139.
(76c) Audition de l'ambassadeur Swinnen, CRA, ..., Sénat, 1996- 1997, ..., p. ....
(77c) Amnesty International, Rwanda : reports of killings and abductions by the Rwandese Patriotic Army, April-August 1994, pp. 2-3.
(78c) Letter from the Secretary-General to the president of the Security Council transmitting the final report of the commission of Experts, Bleu Book Rwanda, UN , p. 416.
(79c) Final report of the commission of Experts established pursuant to Security Council resolution 935 (1994); Blue Book, p. 425.
(80c) Audition du major Maggen, CER, Sénat, 7 mai 1997, PV, p. 139/9 (CRA , p. 452).
(81c) Télex nº 623.
(82c) Audition de Mme Braeckman, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 21 mars 1997, p. 201.
(83c) Audition de Mme De Temmerman, CER , Sénat, 28 mai 1997, PV, pp. 23/5 à 23/11 et pp. 24/1 à 24/4 (CRA , pp. 568-569).
(84c) Audition de l'ambassadeur Swinnen, CRA, CER , Sénat, 1996-1997, 20 juin 1997, pp. 803-804.
(85c) Télex nº 452.
(86c) Télex nº 623.
(87c) Note du secrétaire général du département des Affaires étrangères, M. Roelands du 7 avril 1994.
(88c) Compte rendu du Conseil des ministres du 7 avril 1994.
(89c) Télex nº 628.
(90c) Note du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, M. Roelants, du 8 avril 1994, situation à 12 heures 30.
(91c) Rapport du groupe ad hoc Rwanda, p. 129.
(92c) Compte rendu de la réunion du Conseil des ministres du 8 avril 1994.
(93c) Télex nº 306.
(94c) Audition de M. Brouhns, CER, Sénat, 1996-1997, 25 mai 1997, PV, p. 2F/35.
(95c) Ibidem, 25 juin 1997, PV, pp. 2/10 à 2/13.
(96c) Audition de Mme Des Forges, CER, Sénat, 16 mai 1997, PV, p. 15/15.
(97c) Audition de M. Brouhns, ibidem.
(98c) Audition de M. Dehaene, CER, Sénat, PV, p. 1F/11.
(99c) Audition de M. Claes, CER, Sénat, PV, pp. 24/1-2.
(100c) Ibidem, pp.24/2.
(101c) Télex nº 633.
(102c) Télex nº 635.
(103c) Télex nº 639.
(104c) Audition de M. Claes, CER, Sénat, 24 juin 1997, op. cit.
(105c) Compte rendu de la réunion du cabinet restreint du 10 avril 1994.
(106c) Notes prises de la conversation téléhonique avec l'ambassadeur Swinnen du 12 avril 1997 de 14 h. à 14 h 20.
(107c) Audition de M. Delcroix, CER , Sénat, 18 juin 1997, PV, (CRA , p. 791).
(108c) Audition du Premier Dehaene, CER , Sénat, 26 juin 1997, CRA , p. 868.
(109c) Compte rendu de la réunion du cabinet restreint du 12 avril 1994.
(110c) Audition de M. Claes, CER , Sénat, 24 juin 1997, PV, pp. 18/8, 18/9, 19/1, 19/2 et 19/3 (CRA , p. 818).
(111c) Audition de M. Claes, CER , Sénat, 24 juin 1997, PV, pp. 21/13, 21/14, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5, 22/6 et 22/7 (CRA , p. 820); voir également le Compte rendu du Conseil des ministres du 12 avril 1994.
(112c) Télex du 13 avril 1994 du Minafet Bruxelles à DELBELUNO New York.
(113c) The United Nations and Rwanda, 1993-1996, The United Nations, Blue Book Series, Volume X, op. cit., p. 40.
(114c) Ibidem, p. 38.
(115c) Audition de M. Brouhns, CER , Sénat, 25 juin 1997, PV, pp. 3/5, 3/6 et 3/7 (CRA , p. 836).
(116c) Lettre du 13 avril 1994 du secrétaire général au président du Conseil de Sécurité « concerning developments which may necessitate the withdrawal of UNAMIR », The United Nations and Rwanda, 1993-1996, Blue Book Series, Volume X, op. cit., p. 259.
(117c) Audition de M. Brouhns, CER , Sénat, 26 juin 1997, PV, pp. 3/7 et 3/8.
(118c) The United Nations and Rwanda, 1993-1996, op. cit., p. 41.
(119c) Rapport du groupe ad hoc Rwanda, p. 128.
(120c) Audition de M. Pierard, CER , Sénat, 27 juin 1997, PV, p. 12/1.
(121c) Audition de M. Boequelloen, CER , Sénat, 27 juin 1997, PV, p. 12/4.
(122c) Audition de M. Brouhns, CER , Sénat, 25 juin 1997, PV, p. 1/11, 1/12, 1/13 et 1/14 (CRA, p. 834).
(123c) Audition de M. Claes, CER , Sénat, 24 juin 1997, PV, p. 22/13, 22/14 et 23/2 (CRA, p. 820).
(124c) Ibidem, PV, p. 23/3, 23/4 et 23/5.
(125c) Ibidem, p. 24/9.
(126c) Décisions du Cabinet restreint du 13 avril 1994.
(127c) Letter from the Permanent Representative of Belgium to the United Nations addressed to the President of the Security Council, stating the view of the Belgian Government that it is imperative to suspend the activities of UNAMIR forces without delay, 13 April 1994, Blue Book, p. 258.
(128c) Décision du Cabinet restreint du 14 avril 1994.
(129c) Compte rendu de la réunion du Cabinet restreint du 14 avril 1994.
(130c) Audition de M. Claes, CER , Sénat, 24 juin 1997, PV, pp. 21/11 et 12. (CRA , p. 820).
(131c) Compte rendu de la réunion du Cabinet restreint, 15 avril 1994.
(132c) Télex nº 691 de New York du 16 avril 1994.
(133c) Fax 767/00327 de New York à Bruxelles du 16 avril 1994, p. 3.
(134c) Ibidem .
(135c) Compte rendu de la réunion cabinet restreint 16 avril 1994.
(136c) Audition de M. Brouhns, CER , Sénat, 25 juin 1997, PV, p. 3/16 à 20 (CRA 837).
(137c) The United Nations and Rwanda, 1993-1996, Blue Book Series, Volume X, p. 259.
(138c) Blue Books Series, ibidem .
(139c) Audition de M. Brouhns, CER , Sénat, 25 juin 1997, PV, p. 4/2 (CRA 836).
(140c) Ibidem .
(141c) Security Council resolution adjusting UNAMIR's mandate and authorizing a reduction in its strength, S/RES/912 (1994), 21 April 1994 in Blue Books Series, op. cit. , p. 268).
(142c) Special Report of the Secretary General of the UN Assistance Mission for Rwanda, Doc. S/1994/470, 20 avril 1994.
(143c) Audition de M. Brouhns, Ibidem , p. 3/4.
(144c) Audition de Mme Des Forges, CRA , CRS, Sénat, 1996-1997, 26 février 1997, p. 33.
(145c) Audition du professeur Reyntjens, CER , Sénat, 14 mai 1997, PV (CRA , p. 499).
(146c) Audition de M. Claes, CER , Sénat, 24 juin 1997, PV (CRA p. 824).
(147c) Audition de colonel Dewez, CER , Sénat, 10 juin 1997, PV, p. 21/7 et 21/8 (CRA p. 685).
(148c) Audition du major Choffray, CER , Sénat, 13 mai 1997, PV, (CRA p. 476).
(149c) Audition du major Bodart, CRA, CER , Sénat, 1996-1997, 13 mai 1997, p. 494.
(150c) Audition de Mme Des Forges, CRA, CER , Sénat, 1996-1997, 16 mai 1997, pp. 540 et 541.
(151c) Audition de Mme Suhrke, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 22 avril 1997, p. 33.
(152c) Audition du professeur Reyntjens, CER , Sénat, 14 mai 1997, PV, p. 19/8 (CRA p. 508).
(153c) Ibidem , p. 20/2 à 20/4 (CRA p. 508).
(154c) Audition du professeur Reyntjens, CER , Sénat, 14 mai 1997, PV, p. 18/6 et 18/7 (CRA p. 507).
(155c) Audition de Mme Des Forges, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 26 février 1997, p. 35.
(156c) Audition de Mme Des Forges, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 26 février 1997, p. 35.
(157c) Audition de M. Claes, CER , Sénat, 24 juin 1997, PV, p. 25/10 à 25/12 (CRA p. 822).
(158c) Audition de M. Claes, CER , Sénat, 24 juin 1997, PV, p. 26/3 à 26/5 (CRA , p. 822).
(159c) Audition de M. Dehaene, CER , Sénat, 26 juin 1997.
(160c) Audition de M. Claes, CER , Sénat, 24 juillet 1997, PV, p. 25/4 (CRA , p. 841).
(161c) La Dernière Heure du 9-10 avril 1994.
(162c) Le Peuple du 9-10 avril 1994.
(163c) La Libre Belgique du 13 avril 1994.
(164c) Idem , 14 avril 1994.
(165c) Idem , 15 avril 1994.
(166c) Idem , 17 avril 1994.
(167c) Le Soir, 12 avril 1994.
(168c) Idem , 20 avril 1994.
(169c) Ibidem.
(170c) Le Soir, 16-17 avril 1994.
(171c) Audition de M. Dehaene, CER , Sénat, 26 juin 1997, PV, p. 5/9 et 5/10.
(172c) Ibidem, p. 5/13.
(173c) Audition de M. Claes, CER , Sénat, 24 juin 1997, PV, p. 37/4.
(174c) Audition de M. Claes, CER , Sénat, 24 juin 1997, PV, p. 26/9.
(175c) Audition de M. Delcroix, CER , Sénat, 18 juin 1997, PV (CRA 794).
(176c) Agence de Presse Hirondelle au Tribunal Pénal International d'Arusha pour le Rwanda News du 1er octobre 1997.
(177c) Ibidem.
(178c) Rapport de mission de M. Ph. Mahoux, vice-président de la commission, au Rwanda du 23 au 30 août 1997.
(179c) Audition de Mme Mukesshimana, CRA, CSR, Sénat, 1996-1997, 19 février 1997, pp. 17 et 18.
(180c) Audition du colonel Marchal, CER, Sénat, 10 juin 1997, CRA, p.p. 698-699.
(181c) Interpellation de M. Beaufays, Annales , Chambre, 1992-1993, 6 janvier 1993, p. 15.
(182c) Interpellations de MM. Gol et Harmegnies et de Mme Aelvoet, Annales , Chambre, 1992-1993, 10 février 1993, p. 57.
(183c) Interpellation de M. Van der Sande, Annales , Chambre, 1992-1993, 21 avril 1993, p. 39.
(184c) Interpellation de M. Hasquin, Annales , Sénat, 1992-1993, 22 avril 1993, p. 401 et suiv.
(185c) Interpellation de M. Vermeiren, Annales , Sénat, 1993-1994, 27 octobre 1993, p. 88.
(186c) Question écrite nº 48 de M. Perdieu, bulletin des Questions et Réponses , Chambre, 1992-1993, 27 janvier 1993, p. 3750.
(187c) Question écrite nº 202 de M. Van Belle, bulletin des Questions et Réponses , Sénat, 1993-1994, 12 octobre 1993, p. 3979.
(188c) Question écrite nº 77 de M. Kuypers, bulletin des Questions et Réponses , Sénat, 1993-1994, 16 novembre 1993, p. 4252.
(189c) Question écrite nº 68 de Mme Dillen, bulletin des Questions et Réponses , Chambre, 1992-1993, 4 mai 1993, p. 5858; question écrite nº 107 de M. Viseur, bulletin des Questions et Réponses , Chambre, 1993-1994, 7 décembre 1993, p. 8592; question écrite nº 120 de M. Reynders, bulletin des Questions et Réponses , Chambre, 1993-1994, 25 février 1994, p. 10499.
(190c) Doc., Sénat, 1993-1994, nº 881-8 (pp. 12-13, 22-23), nº 881-10 (p. 13) et nº 881-11 (p. 11).
(191c) Doc., Chambre, 1992-1993, nº 1178/4 (pp. 132-140, 181-183, 190-205).
(192c) Interpellation de M. Vermeiren, Annales , Sénat, 1993-1994, 23 décembre 1993, p. 768.
(193c) Interpellation de M. Van Peel, Annales , Chambre, 1992-93, 15 février 1994, p. 20.
(194c) Interpellation de M. Van Belle, Annales , Sénat, 1993-1994, 29 mars 1994, p. 1761.
(195c) Interpellation de Mme Maes, Annales , Sénat, 1993-1994, 29 mars 1993, p. 1761.
(196c) Question écrite nº 441 de M. Van Belle, bulletin des Questions et Réponses , Sénat, 1993-1994, 11 janvier 1994, p. 4659.
(197c) Question écrite nº 422 de M. Duquesne, bulletin des Questions et Réponses , Chambre, 1993-1994, 11 mars 1994, p. 5148.
(198c) Question écrite nº 268 de M. Van Belle, bulletin des Questions et Réponses , Sénat, 1993-1994, 15 mars 1994, p. 5148.
(199c) Question écrite nº 337 de M. Van Wambeke, bulletin des Questions et Réponses , Sénat, 1993-1994, 12 juillet 1994, p. 6165; question écrite nº 343 de M. Bougard, bulletin des Questions et Réponses , Sénat, 1993-1994, 16 juin 1994, p. 5942.
(200c) Annales , Chambre, 1993-1994, 11 avril 1994, pp. 1-32.
(201c) Annales , Chambre, 1993-1994, 21 avril 1994, pp. 1557-1558.
(202c) Annales , Sénat, 1993-1994, 21 avril 1994, pp. 1762-1766 et 1884.
(203c) Interpellation de M. Draps, Annales , Chambre, 1993-1994, 26 avril 1994, 42; interpellation de M. Van Overmeire, Annales , Chambre, 1993-1994, 26 avril 1994; interpellation de M. Simonet, Annales , Chambre, 1993-1994, 26 avril 1994, 42; question orale de M. Verreycken, Annales , Sénat, 1993-1994, 28 avril 1994, 1973; question écrite nº 472 de M. Knoops, bulletin des Questions et Réponses , Chambre, 1993-1994, 6 juillet 1994, p. 12358; question écrite nº 402 de M. Van den Eynde, bulletin des Questions et Réponses , Chambre, 1993-1994, 18 mai 1994, p. 11120.
(204c) Question écrite nº 120 de M. Dufour, bulletin des Questions et Réponses , Sénat, 1993-1994, 30 août 1994, p. 6479.
(205c) Question écrite nº 401 de M. Van den Eynde, Bulletin des Questions et Réponses , Chambre, 1993-1994, 18 mai 1994, p. 1145.
(206c) Question écrite nº 154 de M. Van den Eynde, bulletin des Questions et Réponses , Chambre, 1993-1994, 18 mai 1994, p. 11296.
(207c) Annales , Chambre, 1993-1994, 11 avril 1994, pp. 1-32.
(208c) Annales , Chambre, 1993-1994, 21 avril 1994, pp. 1557-1558.
(209c) Annales , Sénat, 1993-1994, 21 avril 1994, pp. 1762-1766 et 1884.
(210c) Interpellation de M. Draps, Annales , Chambre, 1993-1994, 26 avril 1994, 42; interpellation de M. Van Grembergen, Annales , Chambre, 1993-1994, 26 avril 1994, 42; interpellation de M. Winkel, Annales , Chambre, 1993-1994, 26 avril 1994, 42; interpellation de Mme Aelvoet, Annales , Chambre, 1993-1994, 27 mai 1994, p. 33.
(211c) Question orale de M. Verreycken, Annales , Sénat, 1993-94, 28 avril 1994, p. 1973.
(212c) Question orale de M. Pécriaux, Annales , Sénat, 1993-1994, 18 mai 1994, p. 2131.
(213c) Question écrite nº 362 de M. Verlinden, bulletin des Questions et Réponses , Sénat, 1993-1994, 12 juillet 1994, p. 6172; question nº 449 de M. Ylieff, bulletin des Questions et Réponses , Chambre 1993-1994, 6 mai 1994, p. 11867 ; question nº 131 de M. Van den Eynde, bulletin des Questions et Réponses , Chambre, 1993-1994, 2 juin 1994, p. 112.
(214c) Question écrite nº 120 de M. Dufour, bulletin des Questions et Réponses , Sénat, 1993-1994, 30 août 1994, p. 6479.
(215c) Annales de la commission de la Chambre, 15 février 1994, pp. 16-17 - Interpellation du 15 février 1994 adressée à M. Claes, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, sur la situation au Rwanda, au Burundi et au Zaïre et la position de la Belgique.
(216c) Interpellation de M. Van Belle du 29 mars 1994 au ministre de la Défense nationale sur les propos qu'il a tenus à l'occasion de son voyage au Rwanda et de Mme Maes sur la fonction des Casques bleus belges dans le processus de démocratisation du Rwanda, Sénat, Annales , p. 1761.
(217c) Question écrite nº 268 de M. Van Belle, Bulletin des Questions et Réponses, Sénat, 1993-1994, 15 mars 1994, pp. 5148-5149.
(218c) Doc., Chambre, 1993-1994, nº 1545/4 pp. 129-133.
(219c) Interpellation de Mme Mayence-Goossens, Annales , Sénat, 1993-1994, 18 mai 1994, p. 1251.
(220c) Question écrite nº 447 de M. Draps, bulletin des Questions et Réponses, Chambre, 1993-1994, p. 11865 et question écrite nº 452 de M. Van den Eynde, bulletin des Questions et Réponses, Chambre, 1993-1994, 18 mai 1994, p. 11869.
(221c) Interpellation de M. Van Grembergen, Annales , Chambre, 1993-1994, 27 avril 1994, p. 42; interpellation de M. Simonet, Annales , Chambre, 1993-1994, 7 juin 1994, p. 1; interpellation de M. Bougard, Annales , Sénat, 1993-1994, 21 juin 1994, p. 1; bulletin des Questions et Réponses , Chambre, 1993-1994, 18 mai 1994, p. 11870 (question nº 454 Van den Eynde); bulletin des Questions et Réponses , Chambre, 1993-1994, 18 mai 1994, p. 11870 (question nº 453 Van den Eynde).
(222c) Interpellation de M. Van Peel, Annales , Chambre, 1993-1994, 26 avril 1994, p. 42; interpellation de M. Van Overmeire, Annales , Chambre, 1993-1994, 26 avril 1994, p. 42; interpellation de M. Colla, Annales , Chambre, 1993-1994, 26 avril 1994, p. 42; interpellation de M. Winkel, Annales , Chambre, 1993-1994, 26 avril 1994, p. 42; interpellation de M. Kempinaire, Annales , Chambre, 1993-1994, 26 avril 1994, p. 42; interpellation de Mme Aelvoet, Annales , Chambre, 1993-1994, 27 mai 1994, p. 33; interpellation de M. Simonet, Annales , Chambre, 1993-1994, 7 juillet 1994, p. 1; interpellation de M. Van Dienderen, Annales , Chambre, 1993-94, 7 juillet 1994, p. 1; interpellation de M. Bougard, Annales , Sénat, 1993-1994, 22 avril 1994, p. 1915; interpellation de M. Van Belle, Annales , Sénat, 1993-1994, 22 avril 1994, p. 1915; interpellation de M. Jonckheer, Annales , Sénat, 1993-1994, 22 avril 1994, p. 1915; interpellation de M. Hasquin, Annales , Sénat, 1993-1994, 22 avril 1994, p. 1931; question orale de Mme Verhoeven, Annales , Sénat, 1993-1994, 6 juillet 1994, p. 2756; question orale de M. Desmedt, Annales , Sénat, 1993-1994, 6 juillet 1994, p. 2756; bulletin des Questions et Réponses , Chambre, 1993-1994, 27 avril 1994, p. 11888 (question nº 133 De Man); bulletin des Questions et Réponses , Chambre, 1993-1994, 1er juillet 1994, p. 13000 (question nº 426 Van Vaerenbergh).
(223c) Interpellation de M. Van Wambeke, Annales , Sénat, 1993-1994, 22 avril 1994, p. 1915; bulletin des Questions et Réponses , Chambre, 1993-1994, 5 juillet 1994, p. 13478 (question nº 470 Hazette); bulletin des Questions et Réponses , Chambre, 1993-1994, 9 juin 1994, p. 11717 (question nº 411 Hazette).
(224c) Question écrite nº 343 de M. Bougard, bulletin des Questions et Réponses , Sénat, 1993-1994, 14 juin 1994, p. 5942.
(225c) Question orale de M. Wymeersch, Annales , Chambre, 1993-1994, 21 avril 1994, p. 1539; question orale de M. Charlier, Annales , Chambre, 1993-1994, 28 avril 1994, p. 1640; question orale de M. Annemans, Annales , Chambre, 1993-1994, 26 mai 1994, p. 1792; question orale de M. Winkel, Annales , Chambre, 1993-1994, p. 2756; question orale de M. Bougard, Annales , Sénat, 1993-1994, 18 mai 1994, p. 2125; question orale de M. Bougard, Annales , Sénat, 1993-1994, 26 mai 1994, p. 2230; bulletin des Questions et Réponses , Sénat, 1993-1994, 28 juin 1994, p. 6183 (question nº 93 Delcourt-Pêtre); bulletin des Questions et Réponses , Sénat, 1993-1994, 30 août 1994, p. 6472 (question nº 583 Dufour); bulletin des Questions et Réponses , Sénat, 1993-1994, 4 octobre 1994, p. 6696 (question nº 303 Dufour); bulletin des Questions et Réponses , Sénat, 1993-1994, 9 août 1994, p. 6538 (question nº 785 Kuijpers); bulletin des Questions et Réponses , Chambre, 1993-1994, 18 mai 1994, p. 12563 (question nº 806 Van den Eynde).
(226c) Questions écrites nº 294 de M. Valkeniers, bulletin des Questions et Réponses , Sénat, 1993-1994, 28 juin 1994, p. 6053 et nº 369 de M. Valkeniers, bulletin des Questions et Réponses , Sénat, 1993-1994, 9 août 1994, p. 6394.
(227c) Question orale de M. Goutry, Annales , Chambre, 1993-94, 21 avril 1994, p. 1541.
(228c) Questions écrite nº 586 de M. Van Belle, bulletin des Questions et Réponses , Sénat, 1993-1994, 30 août 1994, p. 6472.
(229c) Question orale de M. Gol, Annales , Chambre, 1993-1994, 23 juin 1994, p. 2007; interpellation de M. Simonet, Annales , Chambre, 1993-1994, 7 juillet 1994, p. 1.
(230c) Question orale de Mme Lizin, Annales , Chambre, 1993-94, 1er juillet 1994, p. 2075.
(231c) Annales parlementaires, Chambre, 22 novembre 1995, p. 33-44.
(232c) Rapport du groupe ad hoc Rwanda, pp. 46 et 77.
(233c) Annales Parlementaires , Chambre, 22 novembre 1995, pp. 33 à 48.
(234c) Document transmis par le ministre aux membres de la Commission des Affaires étrangères, le 27 juin 1996.
(235c) Audition des représentants des familles et apparentés des dix paracommandos assassinés, CRA, CSR, Sénat, 1996-1997, 19 février 1997, p. 3.
(236c) Ibid., p. 3.
(237c) Ibid., p. 3.
(238c) Ibid., p. 4.
(239c) Ibid., p. 3.
(240c) Ibid., p. 6.
(241c) Ibid., p. 6.
(242c) Ibid., p. 6.
(243c) Ibid., p. 6.
(244c) Ibidem.
(245c) Ibid., p. 5.
(246c) Ibid., p. 3.
(247c) Ibid., p. 8.
(248c) Ibid., p. 7.
(249c) Ibid., p. 3.
(250c) Ibid., p. 4.
(251c) Ibid., p. 8.
(252c) Ibid., p. 8.
(253c) Ibid., p. 8.
(254c) Télex 994 du 4 octobre 1993.
(255c) Télex 130 du 15 février 1994.
(256c) Rapport De Cuyper du 22 mars 1994.
(257c) Audition de M. Swinnen, CRA , CSR , Sénat, 12 mars 1997, p. 135.
(258c) Audition de M. Bougard, CRA , CSR , Sénat, 1996-1997, 14 mars 1997, p. 161.
(259c) Audition du lieutenant Nees, CRA , CSR , Sénat, 1996-1997, 7 mars 1997, p. 117.
(260c) Audition du Capitaine De Cuyper, CRA , CSR , Sénat, 1996-1997, 14 mars 1997, p. 166.
(261c) Audition du major Choffray, CER , Sénat, 13 mai 1997, PV, pp. 31/3 et 31/4.
(262c) Audition du colonel Marchal, CRA , CSR , Sénat, 1996-1997, 7 mars 1997, p. 107.
(263c) Audition du colonel Balis, CER , Sénat, 29 mai 1997, PV, pp. 11/4.
(264c) Audition du major Podevijn, CRA , CSR , Sénat, 1996-1997, 7 mars 1997, p. 122.
(265c) Réponses aux questions soumises au général Dallaire par le juge-avocat général de la Cour militaire, point 2, p. 2.
(266c) Audition du major Hock, CRA , CSR , Sénat, 1996-1997, 21 mars 1997, p. 206.
(267c) Audition du général-major Verschoore, CRA , CSR , Sénat, 1996-1997, 12 mars 1997, p. 142.
(268c) Ibid., p. 145.
(269c) Audition de l'ambassadeur Swinnen, CRA , CSR , Sénat, 1996-1997, 21 mars 1997, p. 212.
(270c) Rapport du groupe ad hoc Rwanda, p. 51.
(271c) Audition de l'ambassadeur Swinnen, CRA , CSR , Sénat, 1996-1997, 5 mars 1997, p. 79.
(272c) Rapport du groupe ad hoc Rwanda, p. 53.
(273c) Audition de M. Martens, CRA , CSR , Sénat, 1996-1997, 26 février 1997, p. 38.
(274c) Audition de M. Bougard, CRA , CSR , Sénat, 1996-1997, 14 mars 1997, p. 161.
(275c) Audition de M. Gillet, CRA , CSR , Sénat, 1996-1997, 19 mars 1997, p. 189.
(276c) Audition de Mme Braeckman, CRA , CSR , Sénat, 1996-1997, 21 mars 1997, p. 200.
(277c) Ibid. , p. 202.
(278c) Audition de M. Nsanzuwera, CRA , CSR , Sénat, 1996-1997, 22 avril 1997, p. 320.
(279c) Audition de M. Nsanzuwera, CRA , CSR , Sénat, 1996-1997, 19 février 1997, pp. 19 et 20.
(280c) Audition du colonel Vincent, CRA , CSR , Sénat, 1996-1997, 7 mars 1997, p. 127.
(281c) Audition de Mme De Temmerman, CER , Sénat, 28 mai 1997, PV, pp. 36/5-36/10.
(282c) Audition de Mme Braeckman, CRA , CSR , Sénat, 1996-1997, 21 mars 1997, p. 201.
(283c) Audition du père Theunis, CER , Sénat, 3 juin 1997, PV, pp. 11/10, 11/15, 11/16 et 11/17.
(284c) Audition du lieutenant Nees, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 7 mars 1997, p. 117.
(285c) Audition du général major Uytterhoeven, CRA, CSR, Sénat, 1996-1997, 25 avril 1997, p. 358.
(286c) Rapport du groupe ad hoc Rwanda, p. 70.
(287c) Ibid ., p. 78.
(288c) Audition de M. Delcroix, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 26 mars 1997, p. 259.
(289c) Audition de M. Nsengiyaremye, CER , Sénat, 18 juin 1997, PV, pp. 3/5 et 3/6.
(290c) Ibid ., pp. 5/3 et 5/4 (CRA , p. 770).
(291c) Audition de M. Twagiramungu, CER , Sénat, 30 mai 1997, PV, p. 4/4.
(292c) Ibid ., p. 8/2.
(293c) Audition de Mme Mukeshimana, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 19 février 1997, p. 17.
(294c) Audition de M. Gasana Ndoba, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 19 février 1997, p. 16.
(295c) Audition de M. Degni-Segui, CER , Sénat, 17 juin 1997, PV, pp. 35/6-35/8.
(296c) Ibid ., pp. 36/2 et 36/4.
(297c) Audition de Mme Des Forges, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 26 février 1997, p. 33.
(298c) Audition de M. Chrétien, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 26 mars 1997, p. 241.
(299c) Ibid ., p. 243.
(300c) Audition de M. Prunier, CER , Sénat, 11 juin 1997, PV, pp. 18/2 et 18/3.
(301c) Ibid ., pp. 18/3 et 18/4.
(302c) Audition de Mme De Temmerman, CER , Sénat, 28 mai 1997, PV, pp. 30/7, 30/9 et 30/10.
(303c) Audition de M. Swinnen, CRA , CSR , Sénat, 1996-1997, 3 juin 1997, p. 135.
(304c) Audition de M. Houtmans, CER , Sénat, 3 juin 1997, PV, p. 33/38.
(305c) Ibid. , p. 33/16.
(306c) Ibid. , pp. 34/9, 34/10 et 34/13.
(307c) Audition du colonel Vincent, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 7 mars 1997, p. 127.
(308c) Audition de l'ambassadeur Swinnen, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 12 mars 1997, p. 135.
(309c) Audition de M. Claes, CRA, CSR, Sénat, 1996-1997, 18 avril 1997, p. 297.
(310c) Audition de M. Delcroix, CER , Sénat, 18 juin 1997, PV (CRA , p. 784).
(311c) Audition de M. Gasana Ndoba, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 19 février 1997, p. 16.
(312c) Ibid. , p. 18.
(313c) Audition de M. Nsanzuwera, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 19 février 1997, p. 18.
(314c) Audition de M. Chrétien, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 26 mars 1997, p. 241.
(315c) Audition du lieutenant Nees, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 7 mars 1997, p. 121.
(316c) Rapport du groupe ad hoc Rwanda, p. 51.
(317c) Rapport du groupe ad hoc Rwanda, p. 51.
(318c) Audition à huis clos de M. Tallier, CER , Sénat, 20 juin 1997, PV, pp. 31/1-31/4.
(319c) Audition de M. Murayi, CER , Sénat, 30 juin 1997, PV, pp. 2/16, 2/17, 3/1, 3/2, 3/3 et 3/4 (CRA , p. 891).
(320c) Audition de M. Chrétien, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 26 mars 1997, p. 243.
(321c) Rapport du groupe ad hoc Rwanda, p. 54.
(322c) Télex de l'ambassadeur de Belgique à Kigali au ministre des Affaires étrangères, nº 270 du 31 mars 1994.
(323c) Rapport du groupe ad hoc Rwanda, p. 53.
(324c) Audition de M. Claes, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 16 avril 1997, p. 297.
(325c) Audition de M. Chrétien, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 26 mars 1997, p. 243.
(326c) Communiqué de presse de l'IDC du 4 mai 1994.
(327c) Audition de M. Louis, CER , Sénat, 3 juin 1997, PV , pp. 17/5-17/7 (CRA , p. 640).
(328c) Ibidem , pp. 23/2 et 23/3 (CRA , p. 644).
(329c) Ibidem , p. 25/16.
(330c) Audition de M. Saur, CER , Sénat, 30 mai 1997, PV, pp. 43/7-43/9.
(331c) Ibidem , p. 43/7-43/9.
(332c) Ibidem , p. 43/10.
(333c) Ibidem , p. 44/3.
(334c) Ibidem , pp. 43/5 et 43/6.
(335c) Ibidem , pp. 43/7-43/9.
(336c) Ibidem , p. 44/1.
(337c) Audition de M. André Louis, CER , Sénat, 3 juin 1997, PV (CRA , p. 651).
(338c) Audition de Mme De Backer, CER , Sénat, 14 mai 1997, PV, pp. 42/4-42/6 (CRA, p. 525).
(339c) Audition de Mme De Backer, CER , Sénat, 14 mai 1997, PV, pp. 42/4-42/6 (CRA , p. 525).
(340c) Ibid. , pp. 42/7 et 42/8.
(341c) Audition de M. Murayi, CER , Sénat, 30 juin 1997, PV, pp. 4/11 et 4/12 (CRA, p. 892).
(342c) Audition de M. Swinnen, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 21 mars 1997, p. 218.
(343c) Audition de M. Delcroix, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 26 mars 1997, p. 260.
(344c) Audition de M. Delcroix, CER , Sénat, 18 juin 1997, PV, pp. 46/10 et 46/14.
(345c) Audition de M. Dehaene, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 5 mars 1997, p. 99.
(346c) Audition de Mme De Backer, CSR , Sénat, 1996-1997, 14 mai 1997, pp. 43/3 et 43/4.
(347c) Audition de M. Claes, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 5 mars 1997, p. 84.
(348c) Audition de M. Claes, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 18 avril 1997, p. 297.
(349c) Rapport du groupe ad hoc Rwanda, p. 51.
(350c) Rapport du groupe ad hoc Rwanda, p. 51.
(351c) Rapport du groupe ad hoc Rwanda, p. 52.
(352c) Audition de Mme Braeckman, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 21 mars 1997, p. 200.
(353c) Ibid. , p. 201.
(354c) Audition du père Theunis, CSR , Sénat, 3 juin 1997, PV, pp. 4/18-4/20.
(355c) Audition de M. Swinnen, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 12 mars 1997, p. 135.
(356c) Ibid. , p. 218.
(357c) Audition de M. Claes, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 5 mars 1997, p. 84.
(358c) Audition de Mme Maes, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 14 mars 1997, p. 159.
(359c) Audition du commandant Claeys, CER , Sénat, 13 mai 1997, PV, pp. 78/8-78/10 (CRA , p. 486).
(360c) Audition du lieutenant Nees, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 7 mars 1997, p. 121.
(361c) Audition du colonel Marchal, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 7 mars 1997, p. 107.
(362c) Ibid., p. 108.
(363c) Audition à huis clos du colonel Marchal, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 19 mars 1997, pp. 18/6.
(364c) Audition de M. Delcroix, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 26 mars 1997, p. 260.
(365c) Audition du général-major Uytterhoeven, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 25 avril 1997, p. 358.
(366c) Audition du colonel Marchal, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 7 mars 1997, p. 113.
(367c) Audition de l'adjudant Boequelloen, CER , Sénat, 27 juin 1997, PV, pp. 7/10, 7/12 et 7/13 (CRA , p. 876).
(368c) Audition de M. Delcroix, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 26 mars 1997, p. 260.
(369c) Audition du lieutenant-général Charlier, CRA, CSR, Sénat 1996-1997, 21 avril 1997, p. 308.
(370c) Rapport du groupe ad hoc Rwanda, p. 53.
(371c) Audition de M. André Louis, CER , Sénat, 3 juin 1997, PV, pp. 23/12
(372c) Ibidem, p. 19/1.
(373c) Audition de M. André Louis, CER , Sénat, 3 juin 1997, PV, pp. 26/1 et 26/2.
(374c) Lettre de Alain De Brouwer à Wilfried Martens du 28 janvier 1991.
(375c) Il s'agit en l'occurrence d'Arusha III et non des accords définitifs.
(376c) Audition de M. Saur, CER , Sénat, 30 mai 1997, PV, p. 33/10.
(377c) Audition de M. Saur, CER , Sénat, 30 mai 1997, PV, pp. 47/6 et 47/7.
(378c) Ibid. , p. 45/2.
(379c) Ibid. , p. 45/4.
(380c) Le principe du partage du pouvoir était au coeur des principes des accords d'Arusha soutenus par l'ensemble de la communauté internationale et en particulier par la Belgique. L'IDC voulait organiser des élections rapidement et avant tout partage du pouvoir. Cette attitude se heurtait à deux obstacles majeurs qui expliquent pourquoi ils n'ont pas été retenus par les négociateurs d'Arusha : Dans un pays où l'ensemble du pouvoir (politique, économique, militaire) a très longtemps été monopolisé par un seul parti, l'organisation d'élections rapides ne permettait pas à l'opposition de faire une campagne digne de ce nom. Des élections dans ses conditions auraient donné un avantage considérable au MRND. Le problème du vote des Rwandais réfugiés dans les pays voisins se posait avec acuité. Pour toutes ces raisons, des élections organisées dans ces conditions risquaient de ne pas être démocratiques et de ne pas mettre un terme à la guerre. Tel était, en tout cas, le sentiment à la fois des représentants de partis modérés et des représentants de la communauté internationale.
(381c) Audition de Mme De Backer, CER , Sénat, 14 mai 1997, PV, pp. 21/4 à 21/8.
(382c) Audition de Mme De Backer, CER , Sénat, 14 mai 1997, PV, pp. 29/8 à 29/12.
(383c) Audition de M. Jaenen, CRA, CSR , Sénat, 23 avril 1997, p. 340.
(384c) Audition de M. Saur, CER , 3 juin 1997, PV, p. 39/9.
(385c) Audition de Mme De Backer, CER , Sénat, 14 mai 1997, PV, pp. 21/11 à 22/4.
(386c) Audition de M. Scheers, CER , Sénat, 24 juin 1997, PV, p. 9/2.
(387c) Lettre du 22 décembre 1993 de M. Scheers à M. Habyarimana.
(388c) Audition de M. Scheers, CER , Sénat, 24 juin 1997, PV, pp. 13/2.
(389c) Rapport du groupe ad hoc Rwanda, p. 137.
(390c) Audition de M. Scheers, CER , Sénat, 24 juin 1997, PV, p. .13N/15.
(391c) Audition de M. Scheers, CER , Sénat, 24 juin 1997, PV, p. .5/4.
(392c) Audition de M. E. Derycke, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 26 mars 1997, p. 248.
(393c) Ibid., p. 249.
(394c) Audition du lieutenant général Charlier, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 21 avril 1997, p. 316.
(395c) Audition de M. P. Galand, CRA , CER , Sénat, 1996-1997, 16 mai 1997, p. 528.
(396c) Audition de M. E. Derycke, op. cit. , p. 248.
(397c) Audition de M. P. Galand, op. cit. , p. 535.
(398c) Audition de M. E. Derycke, op. cit. , p. 250.
(399c) Ibidem , p. 252.
(400c) Audition du lieutenant général Charlier, CRA , CSR , Sénat, 1996-1997, 21 avril 1997, p. 316.
(401c) Ibidem .
(402c) Audition du colonel Vincent, CRA , CSR , Sénat, 1996-1997, 7 mars 1997, p. 125.
(403c) Audition du lieutenant général Berhin, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 29 avril 1997, p. 389.
(404c) Ibidem .
(405c) Audition du lieutenant général Berhin, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 29 avril 1997, pp. 394 et 395.
(406c) Audition du lieutenant général Charlier, CRA , CSR, Sénat, 1996-1997, 28 mars 1997, p. 267.
(407c) Audition de l'aumônier militaire Quertemont, CRA , CER, Sénat, 1996-1997, 7 mai 1997, p. 438.
(408c) Audition du caporal-chef Pierard, CER , Sénat, 1996-1997, 27 juin 1997, PV, pp. 14/11.
(409c) Militaire studie Rwanda Kritische analyse van het verslag van de ad-hocgroep, 29 août 1997.
(d1) Le texte de cette note figure en annexe.