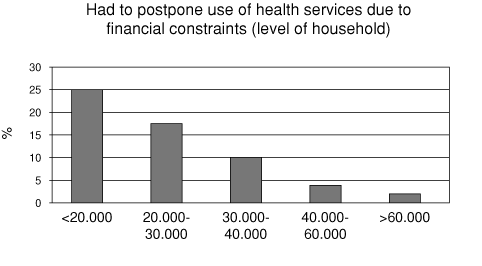
1-1414/1 | 1-1414/1 |
28 AVRIL 1999
Dans un passé récent, la commission des Affaires sociales a été confrontée à plusieurs reprises à des problèmes touchant à l'accès aux soins de santé, qui frappent en particulier les groupes sociaux les plus faibles ainsi que les malades chroniques et les patients souffrant d'une pathologie grave.
Afin de mieux mesurer l'étendue de ces problèmes, la commission a organisé, au cours de l'année écoulée, des auditions de représentants de plusieurs institutions et associations qui ont une responsabilité dans ce secteur.
La première partie de ce rapport rassemble les auditions dont le but était de donner une vue d'ensemble de la question. Comme l'accès aux soins de santé constituait une partie importante du Rapport général sur la pauvreté, de la Fondation Roi Baudouin, on a demandé à cette organisation de situer la problématique dans le cadre plus général de la lutte contre la pauvreté.
Pour avoir une idée de la situation sur le terrain, la commission a aussi procédé à l'audition des CPAS de deux grandes villes (Bruxelles et Anvers) et d'une commune de taille moyenne (Roulers). Par ailleurs, un échange de vues a aussi eu lieu avec les sections d'aide sociale Flandre, Bruxelles et Wallonie de l'Association des villes et communes belges.
Enfin, un échange de vues a eu lieu, dans ce cadre, avec le Conseil national supérieur des handicapés, qui représente un groupe de patients qui nécessitent des soins entraînant des dépenses élevées.
La partie II rassemble les discussions qui ont eu lieu avec les organismes assureurs représentés au sein du collège intermutualiste de l'INAMI, qui ont chacun donné leur vision du problème.
La partie III contient les auditions relatives aux médicaments qui représentent, certainement pour les malades chroniques, une part considérable des dépenses. La commission a eu, à cet égard, un échange de vues avec des représentants du département des Affaires économiques, lequel est responsable du contrôle des prix des médicaments, ainsi que de l'Association générale de l'industrie pharmaceutique.
La partie IV rassemble les auditions de plusieurs représentants des dispensateurs de soins, à savoir l'Association pharmaceutique belge, l'Union professionnelle des bandagistes et orthopédistes de Belgique et, enfin, les organisations de médecins ABSYM et Le Cartel.
Dans la partie V enfin, l'INAMI et la ministre des Affaires sociales donnent leur vision de la question.
La commission est consciente que ses travaux ne mettent pas un point final au débat sur l'accessibilité des soins de santé. Elle espère cependant avoir rassemblé un certain nombre de données et d'opinions qui peuvent s'avérer utiles en vue de la poursuite du dialogue sur cette question.
Depuis la publication du Rapport général sur la pauvreté, la Fondation Roi Baudouin n'a réalisé aucune étude sur le thème de l'accès aux soins de santé. Voilà pourquoi, dans son exposé, le représentant de la Fondation se basera sur le rapport annuel consacré à la situation en matière de pauvreté et d'exclusion dans la Région bruxelloise (1995), pour lequel il a réalisé une évaluation de la politique en matière de pauvreté de dix CPAS bruxellois de communes à problèmes. L'annuaire de la pauvreté et de l'exclusion sociale de l'UFSIA offre également des informations intéressantes sur le sujet.
Il convient également de tenir compte du fait que, dans notre pays, peu d'études systématiques sont consacrées aux inégalités dans le secteur des soins de santé.
Le point de départ du Rapport général sur la pauvreté était le contexte de vie concret du groupe de population qui se trouve au bas de l'échelle sociale. Pour ce groupe, directement concerné par la publication du rapport, quatre domaines étaient essentiels pour une politique de lutte contre la pauvreté. Ces domaines sont, par ordre de priorité :
La famille, le bien-être et la santé;
Le travail et la protection sociale;
L'habitat et le cadre de vie;
La culture et l'enseignement.
Fait important, ces quatre domaines étaient situés par les intéressés dans le secteur des droits fondamentaux. Ils considéraient le droit à la santé, le droit au travail, le droit à une habitation viable comme autant de droits fondamentaux dont chacun devrait pouvoir bénéficier.
L'interaction entre les différents domaines de politique s'avère tout aussi importante. Le droit à la santé ne peut pas être approché de façon isolée du contexte général en matière de pauvreté et d'exclusion sociale. Une politique axée sur l'élimination des inégalités dans le domaine des soins de santé ne peut réussir que si elle a aussi pour but d'enregistrer des progrès dans d'autres domaines vitaux.
Cela signifie qu'à la base d'un débat sur l'accès aux soins de santé, le concept de pauvreté doit être clairement défini. À ce niveau, nous pouvons recourir à la description fournie voici plusieurs années dans l'annuaire « Pauvreté et Exclusion sociale » de Jan Vrancken, dans lequel ce concept était décrit au moyen de cinq composantes essentielles :
1. La pauvreté est un enchevêtrement d'infériorisations; il s'agit donc d'un phénomène dynamique.
2. Cet enchevêtrement porte sur plusieurs domaines de l'existence individuelle et collective des personnes vivant dans un état de pauvreté.
3. La pauvreté s'enracine principalement dans une position marginale par rapport au processus de production.
4. La décomposition de la société qui en découle a pour conséquence que les pauvres se voient exclus des mode de vie généralement acceptés par ladite société.
5. Les pauvres ne sont pas en mesure de combler eux-mêmes le fossé.
Les nombreux faits et témoignages figurant dans le Rapport général procurent une image des difficultés de diverses natures auxquelles les pauvres sont quotidiennement confrontés :
La pauvreté signifie que l'on porte un stigmate social. Le pauvre se voit affublé d'une étiquette qui le marginalise de plus belle et qu'il aura à porter toute sa vie.
Les revenus sont tellement bas que la vie se résume à une lutte pour maintenir la tête hors de l'eau sur le plan matériel.
Le pauvre n'a pas de travail, ou tout au plus une occupation incertaine ou malsaine.
Le pauvre est mal logé.
Les enfants de parents pauvres sont stigmatisés et marginalisés à l'école, ce qui est à l'origine de l'« hérédité » de la pauvreté.
Le pauvre n'a pas accès aux possibilités de détente dont jouissent les autres citoyens. Il ne peut ni partir en vacances ni participer aux événements culturels.
Il subit plus que les autres citoyens les aspects négatifs de la bureaucratie et de l'administration publique.
L'accès au système juridique leur est beaucoup plus difficile qu'aux autres citoyens.
Les problèmes que les pauvres rencontrent sur le plan de la santé ne peuvent être dissociés de ces situations, qui soumettent à une pression constante les personnes qui sont dans le besoin et qui leur causent un stress permanent.
1. Causes des problèmes de santé
Pour quelle raison les problèmes en matière d'inégalité pour ce qui est du bénéfice des soins de santé se manifestent-ils en premier lieu chez les plus démunis ?
a) Les revenus
Il convient de mentionner tout d'abord le problème des revenus. Le minimum d'existence pour une personne isolée est actuellement de 22 000 francs par mois. Un tiers ou une moitié de cette somme est consacrée au logement. Une journée en chambre double dans un hôpital coûte actuellement quelque 1 100 francs, sans parler des honoraires de médecins et du coûts de certains soins. On peut dès lors s'imaginer les problèmes que rencontrent les minimexés qui doivent être hospitalisés huit jours et qui ne sont, bien souvent, pas assurés.
La situation financière est également un obstacle important en matière de soins de santé préventifs. Pour les pauvres, vivre c'est souvent survivre. Leur alimentation est malsaine, ils font peu de sport. Les visites préventives nécessaires chez le médecin ou le dentiste sont systématiquement exclues. Une étude réalisée par une revue médicale a fait apparaître une pratique dans laquelle des personnes téléphonent au médecin pour prendre un rendez-vous, puis ne se rendent pas à celui-ci. Il semblerait qu'elles s'efforcent d'obtenir un minimum de conseils sans devoir payer de consultation.
Lorsqu'elles se rendent quand même chez le médecin, elles sont bien souvent dans l'impossibilité de suivre le traitement ou d'acheter les médicaments prescrits.
Les obstacles financiers ont donc pour conséquence que la personne démunie se retrouve dans un cercle vicieux. En raison du report des soins médicaux et des habitudes alimentaires et de vie malsaines, la santé générale se dégrade et une aide médicale plus importante devient nécessaire. La maladie acquiert un caractère chronique et une hospitalisation s'impose.
Ce phénomène s'aggrave encore chez les personnes qui présentent un risque plus grand au niveau de la santé, comme les enfants ou les personnes âgées. Récemment, l'hôpital du CPAS d'Anvers s'est vu dans l'obligation de refuser un enfant, parce qu'une facture antérieure d'un montant de 190 000 francs était impayée.
b) Problèmes administratifs
Fait presque typique pour les plus démunis, ils sont bien souvent exclus du réseau de prise en charge ordinaire. Pour différentes raisons, les cotisations sociales n'ont pas été payées et ils ne sont pas affiliés auprès d'une caisse d'assurance-maladie. Lorsque, au moment de leur hospitalisation, on s'efforce de régler la situation par le paiement des cotisations en souffrance, c'est bien souvent peine perdue, parce que les montants dus s'élèvent généralement à plusieurs dizaines de milliers de francs.
Les problèmes administratifs se rencontrent en premier lieu chez les groupes difficilement assurables comme les jeunes en décrochage scolaire, les réfugiés, les petits indépendants aux revenus très faibles, les familles décomposées, les sans domicile fixe et les sans-abri...
c) Logement de mauvaise qualité
Le pauvre vit généralement dans un logement manquant de salubrité. Les logements à bas prix sont bien souvent humides, avec un confort minimum au niveau de l'éclairage, des sanitaires et surtout du chauffage. Ces habitations sont par conséquent concentrées dans un environnement malsain, pauvre en opportunités, comme le long des rings urbains. La végétation s'y fait rare, la pollution est élevée, à l'instar du bruit. Il s'agit bien souvent de quartiers à forte densité de population immigrée, ce qui peut déboucher sur des tensions supplémentaires. Ces maisons sont également trop petites pour le nombre d'habitants, ce qui contribue au manque d'hygiène.
d) Absence de travail ou travail peu valorisant
Dans la majeure partie des cas, les problèmes de revenus sont naturellement liés directement au chômage. Si l'on parvient quand même à décrocher un emploi, il s'agit bien souvent d'un job peu valorisant au niveau de la durée du contrat et des conditions de travail. Bien souvent, il s'agit de jobs dangereux ou malsains.
e) Stress permanent
La précarité, au sens littéral du terme, entraîne des tensions permanentes. Celles-ci résultent non seulement du souci de joindre constamment les deux bouts sur le plan financier, mais aussi des problèmes particuliers qui en découlent. Ainsi, bon nombre de familles vivent dans le risque de voir leurs enfants placés en institution pour des problèmes de santé ou autres. L'on constate également une psychiatrisation des pauvres et des exclus.
Conséquence directe de ce stress, une déchéance prématurée. Pierre Hendrick, de la Maison de la Santé de Molenbeek, a ainsi constaté que beaucoup de ces personnes sont déjà vieilles aux environs de 40-45 ans.
f) Pas de loisirs ni d'activités culturelles
Les pauvres ne partent pas en vacances et n'ont pas accès à la culture, ou seulement très peu. Les conséquences se font sentir sur le sentiment général de bien-être et, indirectement, sur la santé.
2. Nature des problèmes de santé
Dans la précédente partie, nous avons déjà évoqué le syndrome de la déchéance prématurée, liée à la pauvreté. Il appert également de l'étude du professeur Louckx de la VUB que certaines maladies sont nettement plus fréquentes dans les milieux socialement défavorisés. Parmi celles-ci, l'on retrouve les affections respiratoires (cf. la récente recrudescence de la tuberculose), le cancer du poumon, les maladies coronariennes, les maladies du système digestif et les problèmes dentaires. Fait encore plus choquant, l'espérance de vie est de quatre à cinq ans plus courte que pour les autres groupes de la population.
En résumé, l'on peut affirmer que différents obstacles influencent la santé des personnes socialement défavorisées. Ces obstacles peuvent être de nature financière, administrative, juridique (pension alimentaire) ou socioculturelle.
La santé n'est pas uniquement influencée par l'accès aux soins médicaux et à la médicalisation : elle l'est aussi par l'enseignement de la santé, la culture générale de la santé et la situation générale de la pauvreté.
M. Neirinckx embraie ensuite sur plusieurs constatations et conclusions de l'Annuaire Pauvreté et Exclusion sociale, 1997, de l'UFSIA.
Il en ressort également que les personnes peu scolarisées avec de faibles revenus vivent moins longtemps, courent davantage le risque d'être atteintes par la maladie et ont moins recours aux soins de santé appropriés. Tout cela doit être envisagé dans le cadre de l'augmentation récente des cas de tuberculose, des manifestations de maladies chroniques et de longue durée face à des cotisations élevées pour les soins médicaux, de la stérilisation des handicapés mentaux aux Pays-Bas et de l'inquiétude sociale que connaît le secteur des soins de santé.
L'annuaire constate également que l'étude portant sur l'accès aux soins de santé est particulièrement pauvre. Parmi les exemples d'études de ce genre, on peut citer :
Le « Steunpunt Gezondheid en Samenleving » , dirigé par le professeur Louckx de la VUB, qui a entre autres constitué une banque de données et qui, chaque année, édite une publication sur les soins de santé et les différences socio-économiques en matière de santé.
L'étude portant sur des groupes spécifiques de De Muynck et Peeters, 1997, et Louckx, 1996. Il ressort d'une telle étude que chez les femmes, les problèmes de santé les plus fréquents se manifestent chez les travailleuses peu formées, les femmes sans travail et les mères isolées avec enfants.
L'étude « Différences de revenus au niveau de la santé et de la consommation de soins médicaux » (De Graeve et Duchesne). Il en ressort également qu'en Belgique, les symptômes sont concentrés dans les groupes à faibles revenus. Des comparaisons internationales font apparaître que la Belgique, située entre l'Espagne et la Grande-Bretagne, n'est pas particulièrement bien lotie pour ce qui est de l'état de santé de ces groupes.
Une étude menée à Edimbourg a fait apparaître que les enfants appartenant aux 15 % des plus démunis avaient jusqu'à 8 fois plus de chances d'être victimes d'un accident de la route. Les causes pourraient être diverses. Les enfants de parents démunis vont plus souvent à pied ou à vélo à l'école, jouent plus en rue par manque de jardin... L'on peut en conclure que les résultats d'une étude similaire réalisée en Belgique feraient apparaître la même tendance.
Les sources précitées font également apparaître plusieurs constatations en rapport avec l'inégalité d'accès aux soins de santé. À première vue, on pourrait s'étonner de la surconsommation relative par les groupes de population plus défavorisés par rapport aux plus nantis. Alors que les groupes de population aux revenus supérieurs se montrent sélectifs et ne se rendent chez le médecin que lorsque cela s'avère strictement nécessaire, la médicalisation des plus démunis peut entraîner une surconsommation de certaines fournitures chez les groupes socialement plus faibles. Ceci ne change rien à la sous-consommation générale de ces groupes.
Si la Belgique n'est pas en queue de peloton pour ce qui est de l'accessibilité aux soins de santé, la nouvelle répartition escomptée de la santé entre les différents groupes de population n'a pas lieu.
1. Propositions de politique dans le Rapport général sur la pauvreté
Dans le Rapport général sur la pauvreté, les pauvres eux-mêmes ont formulé plus de 300 propositions de politique visant à améliorer la situation actuelle. Ces propositions, relatives aux soins de santé, peuvent être réparties en quatre groupes :
a) Généralisation du droit à l'assurance maladie
Le droit à la protection de la santé est un droit fondamental, expréssement garanti par l'article 23 de la Constitution. Le second paragraphe de cet article reconnaît à chacun le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'assistance sociale, médicale et juridique.
Sur la base de cette disposition, plusieurs amendements ont été introduits pour le court et le long terme dans le rapport. L'on y demande ainsi qu'à court terme, les mesures qui s'imposent soient prises afin de redonner le droit à la santé aux personnes qui n'ont plus accès aux soins parce qu'elles ne sont plus en règle avec leur assurance-maladie.
b) Accessibilité financière des soins de santé
Dans le rapport, d'aucuns souhaitent que le système VIPO soit étendu à plusieurs autres groupes comme les minimexés, les groupes à faibles revenus (sur la base des revenus imposables), les personnes sans domicile fixe et les sans abri. On y souhaite également une simplification administrative du système du tiers payant ainsi qu'un élargissement dudit système aux dispensateurs de soins. Enfin, une information plus efficace au niveau des soins (CPAS) devrait éviter que les personnes ne soient plus assurées par méconnaissance des règlements existants.
c) Un meilleur encadrement professionnel des soins de santé
Le rapport sollicite une approche globale des soins de santé ainsi qu'une meilleure coordination entre l'ensemble des acteurs. On y plaide également pour la stimulation des soins accessibles à tous, par exemple via les centres médicaux de quartier et les pratiques de groupe des médecins. Il importe également que des objectifs concrets soient formulés au niveau du développement de la santé et que les plus démunis y soient impliqués.
Comme c'est le cas pour d'autres domaines, les auteurs du rapport souhaitent que des initiatives soient prises pour améliorer les connaissances relatives à la pauvreté chez les dispensateurs de soins.
d) Politique complémentaire
Une amélioration de l'accès aux soins médicaux doit aller de pair avec une politique préventive plus efficace dans laquelle les informations et l'éducation à la santé occupent une position centrale. L'accessibilité de l'assistance familiale et des soins à domicile ainsi que les possibilités d'accueil des enfants pour les parents malades ou hospitalisés doivent être améliorées.
Enfin, la politique en matière de santé doit s'inscrire dans une politique intégrée et structurelle de lutte contre la pauvreté dans tous les secteurs de la société. On en revient au point de départ du rapport sur la pauvreté. La pauvreté est un enchevêtrement d'infériorisations. La politique doit l'aborder en tant que tel.
2. Évolution de la politique depuis la publication du rapport sur la pauvreté
C'est peut-être dans le secteur des soins de santé que les principales avancées ont été enregistrées depuis 1995. Cela se reflète à différents niveaux :
a) La politique en matière de santé est un thème central à l'agenda de la Conférence interministérielle sur la lutte contre la pauvreté.
b) Depuis le 1er juillet 1997, les avantages du statut VIPO ont été étendus à de nouveaux groupes :
Les minimexés, les personnes assimilées et les personnes à charge.
Les enfants donnant droit à des allocations familiales majorées.
Les personnes ayant droit à des revenus garantis pour personnes âgées plus les personnes à charge.
Les personnes ayant droit à une participation aux frais pour les personnes handicapées et les personnes à charge.
Cela signifie que le nombre de personnes ayant droit au statut de VIPO a augmenté de 130 000 unités.
c) L'élargissement de la franchise sociale
Lors du Conseil des ministres du 18 juillet 1997, un projet d'arrêté royal a été approuvé en matière de modalités d'exécution pour l'introduction d'une franchise sociale du ticket modérateur. La franchise sociale est un système en vertu duquel certaines catégories sociales bénéficient du remboursement du ticket modérateur lorsque le montant dépasse 15 000 francs par année calendrier. On ne peut perdre de vue que le ticket modérateur peut peser lourd dans le budget des minimexés longtemps malades. Une personne isolée, par exemple, a droit à un minimum d'existence de 665 francs par jour. Elle paie 220 francs pour une consultation chez un spécialiste.
d) Mesures indirectes
Plusieurs mesures qui ne sont pas directement liées aux soins de santé mais qui peuvent avoir une incidence importante sur la santé des personnes socialement défavorisées, ont été prises. La plus frappante d'entre elles est incontestablement la fourniture minimale garantie d'eau, de gaz et d'électricité.
e) Mesures en préparation
Dans le rapport de progression de la Conférence interministérielle, plusieurs points figurent encore sur la liste d'attente et devraient être réalisés à court terme :
la suppression de la condition de séjour et d'attente obligatoire;
la réforme des systèmes résiduaires;
l'évaluation et l'élargissement de la règle du tiers payant;
la simplification des obligations administratives par l'introduction de la carte d'identité sociale;
un meilleur échange d'informations entre les CPAS et les caisses d'assurance maladie, principalement dans l'optique d'une amélioration de la situation des personnes non assurées.
M. Neirinckx conclut que, sur le plan de l'accès aux soins de santé surtout, un travail de bonne qualité a été fourni ces dernières années et qu'en dépit du chemin restant à parcourir, un certain optimisme est de mise pour l'avenir.
Un membre souligne que dans l'assistance ambulante, le système du tiers payant ne s'applique encore que de façon limitée. Il en résulte un nombre important de comptes non réglés auprès des institutions de soins, lesquelles ont par conséquent moins tendance à prodiguer leurs soins aux personnes qui ne peuvent payer directement. Comment évolue cette situation ?
Un représentant du ministère de la Santé publique répond qu'en marge de la Conférence interministérielle, le règlement du tiers payant a également été abordé lors des discussions entre les médecins et les caisses d'assurance maladie. Sur ce plan, on note une tendance visant à limiter le nombre de prestations relevant de ce règlement tout en introduisant une distinction entre les patients qui ont droit au système du tiers payant pour l'ensemble des prestations et ceux qui sont exclus de ce droit. Il ne faut pas perdre de vue que le système du tiers payant est avant toute chose un droit du dispensateur de soins et non du patient. Le fait que le système soit ou non appliqué dépend de l'initiative de l'institution ou du médecin. L'arrêté royal de 1987 régissant cette matière permet que 20 % des patients entrent en ligne de compte pour le système. En pratique toutefois, on constate qu'au niveau des médecins par exemple, 0,6 % des prestations seulement sont payées par ce biais. Pour les spécialistes, le pourcentage est de 1,1 %.
Voilà pourquoi l'application du système pose problème, non seulement au niveau de l'information mais aussi sur les plans financier et administratif. Les hésitations des médecins sont compréhensibles lorsqu'on sait que près de six mois s'écoulent entre la rédaction de la note de frais et son remboursement.
Si l'on souhaite utiliser le tiers payant comme un moyen de rendre les soins de santé plus accessibles, deux mesures s'imposent. En premier lieu, le système doit être traduit comme un droit du patient qu'il peut revendiquer envers son médecin. De plus, un certain nombre de freins psychologiques et administratifs dans le chef des dispensateurs de soins doivent être éliminés.
Un membre de la commission souligne que le système du tiers payant concerne uniquement la partie remboursable des honoraires. Son introduction ou son élargissement ne change rien au ticket modérateur restant à charge du patient.
Un autre membre estime que cela ne change rien à l'importance d'une intervention en la matière. Certains examens en hôpital coûtent facilement un mois de salaire et tout le monde ne peut se le permettre, même si une partie de la facture est remboursée par la caisse d'assurance maladie.
Une intervenante suivante fait observer que le tiers payant est un élément dans la discussion relative à l'accessibilité des soins de santé pour les personnes socialement défavorisées. Un autre volet, c'est ce qui se passe actuellement à Anvers, où un hôpital du CPAS déplore des factures impayées pour un montant de 250 millions de francs. Cela prouve clairement que des problèmes se posent également au niveau du paiement du ticket modérateur.
M. Neirinckx reconnaît que ces problèmes sont bien réels et qu'ils pèsent lourdement sur les CPAS. Voilà pourquoi dans le rapport récent sur la pauvreté et l'exclusion sociale, l'on demande à nouveau que le financement des CPAS soit assuré par le gouvernement fédéral ou les communautés. Plusieurs communes ne peuvent plus supporter cette pression.
Un membre demande si la Fondation Roi Baudouin a une idée du nombre de personnes échappant totalement aux mailles du filet. Lorsque quelqu'un se rend dans un CPAS, ce dernier régularise automatiquement la situation de l'intéressé au niveau de l'assurance maladie. Les CPAS prennent généralement en charge les factures impayées auprès des dispensateurs de soins.
Il semble pour cette raison que le nombre de personnes totalement privées d'accès aux soins de santé doit être particulièrement limité, ce qui ne signifie pas que celles-ci ne doivent pas être assistées. Si le système actuel de prise en charge par les CPAS offre trop peu de garanties, quelle est la solution ? Cela signifie-t-il qu'il faille suivre la voie d'un droit universel dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité ?
Une seconde question découle de la constatation que la Belgique ne serait que peu performante au niveau de la protection de la maternité. Un certain nombre de femmes bénéficieraient de contrôles et de soins préventifs insuffisants avant la naissance de l'enfant. Existe-t-il des données disponibles sur le sujet ?
Une intervenante antérieure répond que les minimexés sont en effet régularisés par les CPAS. Toutefois, ce groupe représentant environ 3 % de la population, ne peut pas être mis sur un pied d'égalité avec les 6 % de la population répondant à la définition de la pauvreté couramment utilisée. Le rapport général sur la pauvreté traite encore d'un autre groupe, pouvant être décrit comme le quart monde et qui constitue 0,5 % de la population. Ces différentes catégories se chevauchent en partie mais une chose est sûre : tous les pauvres, y compris les plus démunis, ne perçoivent pas le minimex ou ne sont pas assistés d'une autre manière par le CPAS.
Un membre abonde dans ce sens. Le groupe des minimexés en fait déjà partie. Les problèmes en rapport avec les soins de santé se situent au niveau des groupes qui ne s'adressent pas au CPAS et l'on peut se demander ce qui a déjà été réalisé à la lumière des questions posées dans le rapport sur la pauvreté. Les mesures énumérées par M. Neirinckx étaient principalement de nature financière et concernaient les personnes enregistrées d'une manière ou d'une autre dans le système et reconnues comme pauvres.
On en arrive ainsi à la seconde question de l'intervenante précédente. Que peut-on faire pour élargir le plus possible, indépendamment de l'aspect financier, l'accès à certaines formes d'assistance préventive ?
Une intervenante suivante souligne qu'un groupe s'adresse en premier lieu au CPAS avant de faire appel à une assistance médicale. Le CPAS régularisera la situation de ces personnes, ce qui est également avantageux et indispensable pour l'institution. En effet, une bonne partie des dépenses peut être récupérée sur l'assurance maladie.
Un autre groupe toutefois fait appel à l'assistance médicale et ne s'adresse qu'ensuite au CPAS. C'est à ce niveau que des problèmes se posent. Les CPAS n'ont pas d'autre choix que de régler les factures impayées, ce qui hypothèque gravement leur fonctionnement. Ces problèmes pourraient être évités en s'efforçant d'instaurer un droit universel à l'assistance médicale.
Un représentant du ministère de la Santé publique répond que le gouvernement a récemment pris une mesure très importante en la matière. Celle-ci consiste en la simplification et l'extension des règles en matière d'assurabilité. Les frais y afférents désormais directement pris en charge par l'assurance maladie sont estimés à pas moins de 300 millions de francs.
Cette simplification consiste en la suppression du temps d'attente de 6 mois (durée d'établissement) et pour de nombreuses personnes, de la condition de cotisation. Le droit est ouvert dès l'inscription ou est valable dès le paiement de la première cotisation. Par ailleurs, un changement important a été introduit sur le plan de la transition entre les systèmes. Ainsi, les indépendants en faillite, un groupe à risque important, peuvent immédiatement passer au système général.
En matière d'élargissement de l'assurabilité, le gouvernement a été très loin, y compris pour les non-Belges. Les demandeurs d'asile sont intégrés dès que la demande d'asile a été déclarée recevable.
Le maintien du droit a été étendu jusqu'à la fin de l'année suivant celle où les cotisations peuvent ne plus avoir été en ordre.
Sur le plan de l'accessibilité objective à l'assistance médicale, des mesures importantes ont également été prises. Il importe que les CPAS et les caisses d'assurance maladie détectent le plus rapidement possible les ayants droit et régularisent leur situation sur le plan administratif.
Avant d'approfondir le contenu de l'étude, le professeur Van Oyen précise les objectifs et le dessein de l'enquête sur la santé.
Il importe, à cet égard, de noter que l'étude n'était pas sous-tendue par une question scientifique théorique, mais qu'elle avait directement pour but de fournir des données pour la politique.
L'enquête a été menée par une cellule créée à cet effet au sein de l'Institut scientifique de la Santé publique (ISSP), à la demande de la Communauté flamande et de la Communauté française. C'est un fait assez exceptionnel pour la Belgique qui, en comparaison des autres pays européens, accuse un important retard sur le plan de l'information en matière de santé. La cellule travaille sous la dénomination de « Centre de recherche opérationnelle dans la santé publique », en tant qu'élément du département d'Épidémiologie de l'ISSP.
Le point de départ de l'enquête a été une conférence internationale organisée en 1993, au cours de laquelle on avait demandé à un certain nombre de pays environnants, et notamment aussi au Canada, d'indiquer quels étaient, pour chacun d'eux, les motifs politiques d'investir dans ce type de recherche.
À la suite de cette conférence, la Communauté flamande et la Communauté française ont réalisé en 1994 une étude de faisabilité, et un test préliminaire a été financé en 1995. Entre-temps, le pouvoir fédéral a également été intégré au projet. En 1996, tous les commanditaires ont conclu un protocole d'accord qui a permis d'effectuer l'enquête en 1997. Ces commanditaires sont le pouvoir fédéral par le biais des départements de la Santé publique et des Affaires sociales, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région bruxelloise et la Communauté germanophone.
Pour la réalisation de l'étude, un réseau d'organismes a été mis sur pied comprenant, outre la cellule de l'ISSP :
un comité scientifique de 70 membres, provenant de différentes universités et de différentes disciplines (sociologie, politicologie, médecine sociale, etc.), qui ont suivi l'enquête de très près;
un comité des commanditaires.
Sur le plan international, il a été fait usage des instruments élaborés, pour ce type d'enquête, par un groupe de travail de l'OMS. Un groupe de travail d'Eurostat a également apporté son concours.
L'objectif central de l'enquête consistait à rassembler des informations sur l'état de santé de la population, tel qu'il est perçu par celle-ci. C'est précisément sur ce dernier point que l'enquête se distingue des informations existantes au sujet de la santé publique, qui sont basées sur des données relatives à l'utilisation des services de santé.
Dans cet ordre d'idées, un important élément est que, pour ce qui concerne la méthodologie, l'enquête s'est fondée sur une collecte horizontale de données. Les informations disponibles dans le registre du cancer, par exemple, contiennent toutes les données afférentes à cette maladie mais ne renferment pas d'autres données. Dans cette enquête, on a recueilli pour chaque individu concerné des informations sur son environnement social et économique, la santé, les facteurs qui peuvent conditionner la santé (par exemple les habitudes de vie) et la consommation médicale.
Ces données ne peuvent être obtenues qu'en interrogeant directement les personnes incluses dans l'enquête. Elles ne peuvent être déduites des informations disponibles sur l'utilisation des services médicaux.
À cet objectif central s'ajoutaient quelques objectifs spécifiques : essayer d'apporter une réponse aux questions suivantes :
Quels sont les principaux problèmes de santé ?
Y a-t-il des lacunes dans la promotion de la santé et, dans l'affirmative, quelles sont-elles ?
Comment certaines mesures de politique, comme par exemple les campagnes de prévention, peuvent-elles être évaluées ?
Peut-on constater des inégalités sur le plan de la santé ?
Quelle est la relation entre la santé et l'utilisation des services médicaux ?
Pour obtenir une réponse fiable à toutes ces questions, il était nécessaire d'interroger les personnes concernées sur toute une série de domaines, à savoir :
le vécu de la santé (comment perçoit-on sa santé ?) et la présence de plaintes et de symptômes. Cette approche est différente de l'approche strictement médicale, fondée sur les syndromes;
l'état de santé :
· la présence de maladies chroniques;
· les limitations et handicaps physiques;
· la santé mentale;
l'utilisation de services médicaux : services paramédicaux, services sociaux, médecin de famille, spécialistes, etc.;
le mode de vie : par exemple consommation de tabac et d'alcool, vaccination, prévention, connaissance des maladies contagieuses comme le sida et attitude adoptée face à ces maladies;
la situation socio-économique : nationalité, niveau de formation, situation de travail, revenu familial, logement, etc.
Ces informations ont été recueillies auprès d'un groupe de 10 000 personnes représentant 4 500 ménages. Étant donné que les différentes régions ont participé à l'enquête en qualité de commanditaires, il était important d'obtenir des informations fiables non seulement pour toute la Belgique mais aussi pour chacune de ces régions. C'est pourquoi le groupe a été réparti comme suit :
| Région | Planning individus |
Réalisation | |
| Individus | Ménages | ||
| Flandre | 3 500 | 3 536 | 1 508 |
| Bruxelles | 3 000 | 3 051 | 1 544 |
| Wallonie | 3 500 | 3 634 | 1 612 |
| Belgique | 10 000 | 10 221 | 4 664 |
La répartition du groupe ne correspond pas aux chiffres réels de la population des régions. La raison en est de nature purement statistique. Si le nombre de personnes interrogées à Bruxelles avait été limité à 1 000, cela aurait donné un résultat statistique instable. Si on avait constaté 6 infarctus dans un groupe de 1 000 personnes, cela aurait donné un résultat de 3 à 9 pour l'ensemble de la population. Dans un groupe de 3 000 personnes, ces marges peuvent être ramenées par exemple à 5,5 et 6,5.
Il va de soi que, pour le calcul des moyennes sur l'ensemble de la Belgique, les données des différentes régions devaient être repondérées en fonction des chiffres réels de la population.
En ce qui concerne la diffusion des résultats, un rapport complet de l'étude, comportant quelque 1 400 pages, a d'abord été mis à la disposition des commanditaires. Ce document peut être consulté par le public sur Internet : http://www.iph.fgov.be/epidemio. Dans un avenir assez proche cette version sera également distribuée sur CD-ROM à des fins scientifiques.
Un condensé de l'enquête, comptant environ 140 pages, a en outre été distribué à un millier d'exemplaires et un résumé distinct a été fait pour les ménages qui ont participé à l'enquête et pour les personnes qui les ont interrogées.
Les commanditaires reçoivent également le « dataset » complet élaboré pendant l'enquête.
De ce qui précède il se déduit que l'enquête recouvre un large éventail de domaines ayant un rapport avec la santé et les soins de santé. Un de ces domaines est l'accès aux soins de santé. On peut évidemment aborder ce sujet sous différents angles, mais l'enquête portait principalement sur les barrières financières qui rendent difficile, pour certains, l'accès à l'aide médicale.
Il est important à cet égard de savoir non seulement si ces barrières existent mais surtout si elles sont différentes selon les groupes de population. Si de grandes différences sont constatées sur ce plan, on risque d'évoluer vers un système de santé de type dual.
| Dispensateurs de soins Zorgverstrekkers |
Médicaments Geneesmiddelen |
Hospitalisation Opname in een ziekenhuis |
||||
| En termes absolus (francs) In absolute cijfers (frank) |
En termes relatifs In relatieve cijfers |
En termes absolus (francs) In absolute cijfers (frank) |
En termes relatifs In relatieve cijfers |
En termes absolus (francs) In absolute cijfers (frank) |
En termes relatifs In relatieve cijfers |
|
| Niveau d'enseignement. Onderwijsniveau | ||||||
| Sans diplôme. Geen diploma | 1 950 | 5,7 | 1 759 | 5,2 | 1 701 | 3,7 |
| Primaire. Lager onderwijs | 1 810 | 4,1 | 1 179 | 2,8 | 738 | 1,3 |
| Secondaire inférieur. Lager secundair onderwijs | 1 803 | 3,6 | 1 170 | 2,5 | 705 | 1,6 |
| Secondaire supérieur. Hoger secundair onderwijs | 2 282 | 3,8 | 882 | 1,6 | 601 | 1,2 |
| Supérieur. Hoger onderwijs | 2 285 | 3,4 | 931 | 1,3 | 1 001 | 1,3 |
| Total. Totaal | 2 109 | 3,7 | 1 022 | 2,0 | 802 | 1,4 |
| Revenu équivalent (francs). Equivalent inkomen (frank) | ||||||
| < 20 000 | 1 708 | 8,2 | 1 063 | 4,9 | 599 | 2,1 |
| 20 000 - 30 000 | 1 947 | 5,2 | 1 086 | 3,1 | 720 | 1,3 |
| 30 000 - 40 000 | 2 212 | 4,4 | 1 141 | 2,3 | 810 | 1,6 |
| 40 000 - 60 000 | 1 886 | 2,5 | 984 | 1,3 | 1 026 | 1,3 |
| > 60 000 | 2 743 | 2,6 | 871 | 0,7 | 511 | 0,6 |
| Total. Totaal | 2 110 | 3,8 | 1 027 | 2,0 | 809 | 1,4 |
| Type de ménage. Gezinstype | ||||||
| Isolé. Alleenstaande | 1 339 | 3,4 | 645 | 1,9 | 511 | 1,4 |
| Isolé avec enfants. Alleenstaande met kinderen | 2 108 | 5,3 | 1 046 | 2,5 | 676 | 1,5 |
| Couple. Koppel | 2 456 | 4,2 | 1 173 | 2,2 | 894 | 1,6 |
| Couple avec enfants. Koppel met kinderen | 2 551 | 3,3 | 995 | 1,4 | 514 | 0,6 |
| Ménage complexe. Samengesteld gezin | 2 557 | 3,4 | 1 734 | 2,4 | 1 832 | 2,1 |
| Total. Totaal | 2 096 | 3,7 | 1 019 | 1,9 | 789 | 1,4 |
Dans une première colonne, ce tableau fait une distinction entre les utilisateurs de services médicaux d'après le niveau d'enseignement, la catégorie de revenu et le type de ménage. Dans les colonnes suivantes sont mentionnées pour chacune de ces catégories, en termes absolus et relatifs, les dépenses pour les dispensateurs de soins, les médicaments et l'hospitalisation. Pour chacun des critères retenus (niveau d'enseignement, revenu et type de ménage), des différences peuvent être observées sur le plan des dépenses. À mesure que le niveau de formation s'élève, les dépenses augmentent également en chiffres absolus, mais cela ne se traduit pas dans les chiffres relatifs. En ce qui concerne la part du revenu, on constate un mouvement inverse. Dans la répartition selon le revenu, on note que les ménages aux revenus les plus bas en consacrent 15,2 % aux soins de santé, alors que pour les ménages aux revenus les plus élevés cette proportion est de 7,2 %, soit moins de la moitié.
Pour ce qui est des catégories de revenus, on a travaillé avec des revenus équivalents. Afin d'aboutir à des chiffres comparables, le revenu réel a été converti selon le type de ménage. On applique au revenu une opération mathématique attribuant une valeur déterminée à chaque membre du ménage. Dans un ménage complexe comprenant un père, une mère, un grand-père et des enfants, le premier adulte reçoit une valeur de 1, les autres adultes une valeur de 0,5 et le poids de chaque enfant est de un tiers.
Le tableau ci-dessous montre comment les personnes des divers groupes, mentionnées au tableau précédent, perçoivent elles-mêmes leurs dépenses de services médicaux. Pour chaque catégorie est indiqué le pourcentage de difficultés rencontrées pour payer les frais y afférents et le nombre de ménages que ce pourcentage représente.
Perception relative du coût de l'utilisation des services médicaux par ménage, Belgique 1997
| Difficultés de paiement du coût des soins de santé |
% | N (ménages) |
| Niveau d'enseignement | ||
| Sans diplôme | 63,8 | 138 |
| Primaire | 53,3 | 685 |
| Secondaire inférieur | 45,9 | 758 |
| Secondaire supérieur | 31,3 | 1 157 |
| Supérieur | 16,6 | 1 371 |
| Total | 33,4 | 4 109 |
| Revenu équivalent (francs) | ||
| < 20 000 | 67,3 | 291 |
| 20 000-30 000 | 56,9 | 900 |
| 30 000-40 000 | 44,9 | 1 027 |
| 40 000-60 000 | 21,0 | 1 292 |
| > 60 000 | 5,7 | 590 |
| Total | 33,2 | 4 100 |
| Type de ménage | ||
| Isolé | 34,0 | 1 452 |
| Isolé avec enfants | 60,1 | 190 |
| Couple | 32,5 | 1 190 |
| Couple avec enfants | 27,9 | 1 007 |
| Ménage complexe | 34,0 | 436 |
| Total | 33,3 | 4 275 |
On constate que, globalement, un tiers de la population éprouve des difficultés à payer les services médicaux, mais ce chiffre masque de profondes différences. Dans les colonnes du niveau d'enseignement et du revenu, on observe une ligne descendante. Dans la répartition selon le type de ménage, c'est surtout le groupe des isolés avec enfants qui semble rencontrer des problèmes de paiement.
Sur ce point, on note d'ailleurs aussi des différences entre les régions : environ 25 % des Flamands se sont déclarés d'accord de payer les soins de santé, contre 45 % des habitants de la Région bruxelloise et de la Région wallonne.
À la question de savoir s'il existe des barrières financières s'ajoute celle de leurs conséquences. Si elles ont pour effet de différer le recours à l'aide médicale, il peut en résulter des problèmes de santé plus graves et, indirectement, des frais accrus pour les services médicaux. À Bruxelles, on connaît par exemple le cas de femmes étrangères qui sont enceintes, mais qui ne s'adressent qu'en tout dernier recours à un médecin parce que leurs papiers ne sont pas en règle. Il s'ensuit au bout du compte, non seulement une mortalité infantile plus élevée mais aussi des frais de traitement accrus.
L'enquête à ce sujet comportait deux volets : d'une part le coût des services médicaux et la façon dont ce coût est perçu, et d'autre part le comportement qui en est la conséquence : report des contacts avec les dispensateurs de soins, arrêt d'une médication ou remplacement de médicaments par des produits moins coûteux.
D'après le revenu :
Report de l'utilisation des services médicaux
pour raisons financières
Revenu équivalent (francs)
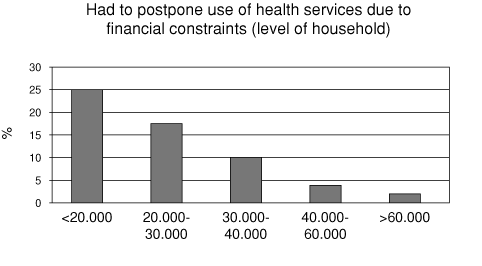
D'après le type de ménage :
Report de l'utilisation des services médicaux
pour raisons financières (en fonction de la
composition du ménage)
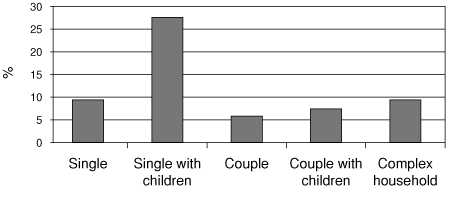
Ce dernier graphique montre à son tour que ce sont les isolés avec enfants qui éprouvent le plus de difficultés financières sur le plan des soins de santé. Ici aussi émergent les disparités régionales marquantes. Alors que pour l'ensemble de la Belgique 8 % des ménages interrogés ont déclaré qu'ils différaient le recours à une aide médicale pour des motifs d'ordre financier, ce taux atteignait 8 % en Flandre, près de 20 % à Bruxelles et 11 % en Wallonie.
Un membre demande comment s'explique ce haut pourcentage pour Bruxelles. Cette région recèle pourtant une ample offre médicale, ce qui devrait favoriser l'accessibilité des soins de santé.
Les questionnaires relatifs à ces données intégraient-ils des contrôles suffisants pour pouvoir formuler des conclusions fiables ?
M. Van Oyen répond qu'il s'agissait uniquement ici d'étudier le report de l'utilisation des services médicaux pour des raisons financières. Le pourcentage élevé pour Bruxelles est probablement lié à la composition de la population de cette région.
Les questions étaient posées orgalement par des personnes spécialement formées pour cette sorte de travail, en collaboration avec l'Institut national de statistique. Les enquêtes étaient d'ailleurs suivies de très près. Les entrevues duraient environ une heure par individu, avec un maximum de 4 personnes par ménage. Les enfants de moins de 15 ans étaient interrogés par l'entremise d'un autre membre du ménage.
Les enquêtes comportaient également une partie écrite pour laquelle les personnes interrogées, en cas de besoin (surtout les plus âgées), étaient assistées par les interviewers. Dans les questionnaires étaient intégrés plusieurs contrôles. Les questions relatives au revenu, par exemple, étaient posées aussi bien au niveau du ménage qu'à titre individuel.
Lorsqu'un enquêteur constate des différences régionales, on doit bien entendu se demander si ces résultats ne sont pas la conséquence de facteurs culturels qui influencent la façon de répondre (par exemple, la fierté flamande). En se référant notamment à une analyse des résultats d'autres parties de l'enquête, on peut conclure que les différences constatées ici reposent sur des bases objectives.
Un membre demande si, dans l'enquête, une comparaison a été faite entre, par exemple, Bruxelles et Anvers, deux villes dont on peut supposer qu'elles sont plus ou moins similaires quant à la composition de la population.
M. Van Oyen répond qu'il y a une forte demande pour ce type de données, et qu'il faudra certainement en tenir compte pour l'avenir. Dans la présente étude, le nombre de personnes interrogées à Anvers (environ 600) et à Gand était trop restreint pour pouvoir formuler des conclusions fiables.
Les disparités régionales qui se font jour ici se manifestent aussi parfois avec plus de force encore dans d'autres domaines. En analysant l'attitude à l'égard des patients atteints du SIDA, par exemple, on constate que les Flamands réagissent de manière plus conservatrice et plus réticente que les francophones et que le problème est aussi beaucoup moins connu en Flandre.
Les tableaux ci-dessous donnent une idée de la mesure dans laquelle les soins de santé sont différés, d'après les catégories sociales. On y retrouve les mêmes tendances. Parmi les ouvriers non qualifiés, 11,4 % déclarent avoir reporté un recours aux services médicaux, contre 4 % pour les managers.
Report de l'utilisation des services médicaux
pour raisons financières
| Oui (%) Ja (%) |
Non (%) Neen (%) |
N | ||
| Niveau d'emploi. Niveau van tewerkstelling | Ouvriers non qualifiés. Niet geschoolde arbeiders | 11,4 | 88,6 | 563 |
| Ouvriers qualifiés. Geschoolde arbeiders | 8,0 | 92,0 | 642 | |
| Employés. Bedienden | 8,4 | 91,6 | 2 417 | |
| Managers | 4,0 | 96,0 | 705 | |
| Total. Totaal | 8,1 | 91,9 | 4 327 | |
| Type de ménage. Samenstelling van het gezin | Isolé. Alleenstande | 9,4 | 90,6 | 1 564 |
| Isolé avec enfants. Alleenstaande met kinderen | 27,5 | 72,5 | 202 | |
| Couple. Koppel | 5,7 | 94,3 | 1 288 | |
| Couple avec enfants. Koppel met kinderen | 7,3 | 92,7 | 1 084 | |
| Ménage complexe. Samengesteld gezin | 9,4 | 90,6 | 473 | |
| Total. Totaal | 8,5 | 91,5 | 4 611 | |
| Niveau d'enseignement. Niveau van opleiding | Sans diplôme. Zonder diploma | 27,3 | 72,7 | 151 |
| Primaire. Lager onderwijs | 9,2 | 90,8 | 725 | |
| Secondaire inférieur. Lager secundair onderwijs | 10,5 | 89,5 | 824 | |
| Secondaire supérieur. Hoger secundair onderwijs | 9,2 | 90,8 | 1 258 | |
| Supérieur. Hoger onderwijs | 4,7 | 95,3 | 1 468 | |
| Total. Totaal | 8,4 | 91,6 | 4 426 | |
| Revenu équivalent (francs). Equivalent inkomen (frank) | < 20 000 | 25,1 | 74,9 | 310 |
| 20 000-30 000 | 17,7 | 82,3 | 962 | |
| 30 000-40 000 | 9,9 | 90,1 | 1 113 | |
| 40 000-60 000 | 3,7 | 96,3 | 1 403 | |
| > 60 000 | 1,9 | 98,1 | 623 | |
| Total. Totaal | 8,6 | 91,4 | 4 411 |
L'enquête a également cherché à connaître le type de service qui était différé pour raisons financières.
Services médicaux non utilisés
pour raisons financières
Dentiste : 47,8 %
Spécialiste : 31,1 %
Lunettes : 21 %
Généraliste : 20,4 %
Médicaments : 19 %
Prothèses dentaires : 14,3 %
Thérapie physique : 14,2 %
Chirurgie : 8,8 %
Radiologie : 7,1 %
Analyse du sang : 5,5 %
Psychothérapie : 3,8 %
Soins à domicile : 3,6 %
La dentisterie arrive largement en tête. Tout aussi important est cependant le fait que la consultation du généraliste, l'achat de médicaments et l'achat de lunettes représentent chacun environ 20 % du total. Il s'agit de trois formes d'aide de base.
Une membre demande si ces chiffres ne doivent pas être fortement différenciés d'après l'âge. En ce qui concerne les soins dentaires, on s'est attaché ces dernières années à changer les mentalités et les jeunes semblent être, sur ce plan, nettement plus sensibles que leurs aînés.
M. Van Oyen répond que l'enquête comprenait un module distinct relatif à la consultation préventive du dentiste. La conclusion générale en a été que le Belge affiche un mauvais score en ce domaine. La moitié seulement des personnes interrogées passent une visite préventive deux fois par an. Il n'y avait en l'occurrence que peu ou pas de différence entre jeunes et personnes d'âge plus avancé.
Les données déjà évoquées montrent que dans le groupe de ceux qui diffèrent les soins de santé pour raisons financières, les isolés avec enfants sont fortement représentés. Il s'agit principalement de personnes jeunes. On ne doit d'ailleurs pas perdre de vue que ces chiffres se rapportent uniquement au report de visites médicales pour motifs d'ordre financier.
Une autre question posée était de savoir si, à la suite d'un relèvement du ticket modérateur, certains médicaments ont été arrêtés ou remplacés.
Sur ce point aussi, le groupe des isolés avec enfants vient au premier plan et on note d'importants écarts régionaux. Le chiffre global pour la Belgique est de 5 %; en Région bruxelloise et en Région wallonne, il est de 9 % et en Flandre de 1,4 %. La répartition d'après le revenu confirme les observations faites pour d'autres questions.
À la question de savoir dans quelle mesure ce changement de médicaments était justifié ou judicieux, aucune réponse n'a pu être fournie parce qu'il est difficile, pour des raisons liées à la protection de la vie privée, d'interroger en profondeur les personnes sur le type de médicaments qu'elles prennent.
Une membre juge important que toutes ces données datent de l'année 1997, à un moment où la franchise sociale et fiscale était pleinement en vigueur. Les différences qui résultent de cette étude montrent qu'en dépit de ces mesures qui devaient favoriser l'accès aux soins de santé pour les groupes plus faibles, il subsiste de grandes différences déterminées par des facteurs sociaux.
M. Mayeur fait remarquer que les CPAS ont indéniablement constaté au cours des dernières années une aggravation des problèmes d'accessibilité aux soins de santé. D'un côté, cette évolution est la conséquence de l'accroissement général de la pauvreté. On constate que le groupe de personnes ne disposant pas de ressources suffisantes pour payer tous les services médicaux nécessaires s'élargit au fil des années. D'un autre côté, il y a le fait que le pouvoir fédéral, notamment dans le cadre des économies requises pour atteindre les normes de Maastricht, a détourné des charges vers les administrations locales. Les CPAS, en particulier ceux qui exploitent un hôpital, ont vivement ressenti les conséquences de cette politique.
Il y a aussi à l'opposé plusieurs mesures politiques favorables. La mesure de la ministre des Affaires sociales, par laquelle la possibilité de s'assurer contre la maladie et l'invalidité a été étendue aux bénéficiaires du minimum de moyens d'existence, a eu des effets particlièrement positifs.
L'importance de cette mesure est encore plus évidente quand on constate qu'entre 1992 et 1995, la prise en charge des soins de santé par le CPAS de Bruxelles, pour un hôpital déterminé, est passée de 90 à 229 millions de francs. Cette tendance s'est normalement poursuivie après 1995, mais a fléchi cette année grâce à l'extension précitée de l'assurabilité.
En pricipe, on peut dire que la législation existante offre pour la prise en charge des soins de santé un certain nombre d'instruments qui fonctionnent convenablement. Un de ces instruments est la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale. Cette loi forme incontestablement avec la loi organique un des principaux instruments légaux des CPAS. En ce qui concerne la prise en charge des soins médicaux, la loi de 1965 fait une distinction entre le CPAS du domicile de secours, à savoir le CPAS sur le territoire duquel se trouve le demandeur, qui reconnaît l'état d'indigence et qui fournit les secours. Si le CPAS du domicile de secours et le CPAS secourant sont les mêmes, il n'y a aucun problème. Dans l'autre cas, le CPAS secourant transmettra la facture au CPAS du domicile de secours, qui réglera les frais.
La loi prévoit en outre la possibilité, pour certains groupes qui ne sont pas inscrits au registre de la population, de faire payer les secours du CPAS par l'autorité fédérale. Sur ce plan, il y a indéniablement quelques problèmes et imprécisions pour des groupes tels que les sans-papiers, les illégaux et les réfugiés politiques qui frappent à la porte des hôpitaux des CPAS.
Pour ce qui est de l'octroi du minimum de moyens d'existence ou de l'assistance sociale, les CPAS sont soumis à des critères légaux très sévères. Comme on l'a dit, l'extension de l'assurabilité et du statut VIPO a considérablement amélioré la situation de ces groupes. Il subsiste toutefois des problèmes. De nombreuses personnes, par exemple les chômeurs, ont un revenu qui dépasse le minimum de moyens d'existence mais qui est insuffisant pour boucler le budget quand on doit faire face à d'importantes dépenses de soins de santé. Les CPAS ont peu de possibilités d'intervenir à l'égard de ces groupes.
En pratique, on constate que les patients qui ont des difficultés financières, qui séjournent illégalement dans le pays, qui n'ont pas de papiers, etc. attendent le tout dernier moment pour s'adresser à un dispensateur de soins. Cela a non seulement de lourdes conséquences pour l'état de santé des intéressés mais est aussi très néfaste du point de vue financier, tant pour le patient que pour le dispensateur de soins et la communauté. Nul n'a intérêt à ce qu'un rhume non soigné dégénère en pneumonie. C'est pourtant ce qui se passe dans la réalité.
Pour faire face le mieux possible à ce genre de situations, un système d'échelonnement impliquant plus de 60 médecins généralistes a été mis en place à Bruxelles. Lorsque le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence ou d'une autre forme d'assistance se présente au CPAS pour des problèmes de santé, il sera renvoyé à un généraliste qui décidera s'il faut recourir à une aide de seconde ligne et, dans l'affirmative, en déterminera la nature.
Ce système évite dans une importante mesure que l'intéressé diffère certains soins, qu'il fasse de l'autodiagnostic ou qu'il passe d'un dispensateur de soins à l'autre. Son principal avantage est cependant qu'il respecte en tous points la vie privée du patient. La communication sur les maladies se fait exclusivement entre médecins.
Ce système comporte toutefois aussi une limitation dans la mesure où il ne peut être appliqué qu'aux patients qui s'adressent au CPAS et ont droit à l'une ou l'autre forme d'aide. C'est précisément là que réside une importante contradiction de notre système de soins de santé. Les personnes qui ont droit au minimum de moyens d'existence ont accès à des formes de soins médicaux qui s'avèrent inabordables pour les chômeurs ne percevant qu'une allocation peu élevée, voire pour les actifs à revenu modeste. Tel est par exemple le cas de certaines formes d'orthodontie, qui ne sont remboursées que dans une très faible mesure ou pas du tout pour les personnes qui ne bénéficient pas de l'un ou l'autre régime d'assistance.
Quoi qu'il en soit, le problème de l'accès aux soins de santé n'est pas résolu par une politique axée exclusivement sur les bénéficiaires d'assistance.
M. Mayeur aborde ensuite le problème des patients chroniques. Les hôpitaux qui relèvent du CPAS de Bruxelles ont été confrontés dans un passé récent à deux catégories de patients dont les problèmes se posent, à cet égard, avec acuité : les patients atteints du sida et les patients souffrant de tuberculose.
Un hôpital du CPAS de Bruxelles qui a acquis une réputation dans ce domaine a soigné récemment un grand nombre de sidatiques. Jusqu'il y a peu, la trithérapie, qui coûte extrêmement cher, n'était pas remboursée par l'INAMI, si bien que le CPAS devait suppléer de grosses sommes. Cette thérapie étant à présent remboursée, le problème a pratiquement disparu, mais les dépenses du passé sont loin d'être apurées.
La recrudescence de la tuberculose est naturellement liée dans une certaine mesure au sida. Les problèmes de ces patients sont actuellement beaucoup plus graves et se situent en bonne partie sur le plan de l'infrastructure. On ne dispose par exemple pas, à l'heure actuelle, de l'infrastructure lourde nécessaire pour soigner en milieu isolé et pendant une longue période des patients qui souffrent de tuberculose multirécidivante. Étant donné que cette infrastructure exige d'énormes investissements, elle ne peut être développée sans un engagement additionnel du département de la Santé publique ou de celui des Affaires sociales.
M. Mayeur pense cependant que malgré les problèmes qui viennent d'être esquissés, le système des soins de santé est assez performant. Les hôpitaux publics soignent tous ceux qui se présentent à leur service de garde et, à la différence des établissements privés, ne font pas de sélection parmi leur clientèle. Ils accueillent du reste aussi les patients qui leur sont envoyés par les hôpitaux privés.
Les problèmes se situent dans certains groupes de population à l'égard desquels il convient de mener une politique de prévention qui les incite à s'adresser plus vite à un dispensateur de soins. À cela s'ajoutent les difficultés de prise en charge, qui sont résolues en bonne partie, mais pas en totalité, par l'extension de l'assurabilité.
Enfin, il souhaite évoquer une matière dont les pouvoirs publics se targuent souvent mais pour laquelle ils mènent en pratique une politique peu conséquente, à savoir l'aide médicale urgente aux étrangers sans papiers. Les hôpitaux qui accueillent ces patients peuvent obtenir le remboursement des frais médicaux proprement dits, mais pas celui des frais de nourriture ou de séjour, qu'ils doivent supporter eux-mêmes.
Se pose en outre la question de savoir ce qu'il faut faire des patients qui sont admis en urgence mais qui, par la suite, ont encore besoin de soins ne pouvant plus être qualifiés d'urgents. Il cite l'exemple d'une famille qui séjourne illégalement en Belgique et vit dans un taudis. Les trois membres de cette famille sont hospitalisés à la suite d'une intoxication à l'oxyde de carbone. Deux de ces personnes se rétablissent, mais la troisième ne sort pas du coma. Cette personne ne peut rester dans un lit d'hôpital et est transférée dans une maison de repos et de soins. La question est de savoir si cet hébergement peut être considéré durablement comme une aide médicale urgente. Dans la négative, l'établissement devra supporter lui-même les frais de séjour, ce qui représente annuellement environ deux millions de francs.
Devant de telles situations, que d'autres villes connaissent probablement aussi, les autorités ne peuvent continuer à fermer les yeux.
Un membre demande si le chiffre de 229 millions de francs que le CPAS a dû prendre en charge peut être ventilé entre bénéficiaires d'assistance sociale et autres patients à revenu modeste.
M. Mayeur répond que cela est possible mais fait observer que ce chiffre se rapporte à l'année 1995 et ne vaut que pour un seul hôpital. Pour être précis, le montant pris en charge était cette année-là de 229 millions de francs pour l'hôpital Saint-Pierre, de 125 millions de francs pour l'hôpital Brugmann, de 46 millions de francs pour l'hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola, de 5 millions pour l'Institut Jules Bordet et de 2 millions pour le centre hospitalier Baron Lambert.
Comme on l'a dit, on peut supposer que cette évolution s'est poursuivie après 1995, mais il serait intéressant de connaître les chiffres de 1998, parce que l'influence de l'extension de l'assurabilité s'est fait pleinement sentir pour la première fois au cours de cette année.
Un membre suppose qu'une partie de ces dépenses peut être récupérée sur les pouvoirs publics. En outre, vu la situation particulière de la ville, Bruxelles a reçu des moyens supplémentaires dans le cadre du programme d'urgence de lutte contre la pauvreté.
M. Mayeur répond que la plupart des problèmes qui se posent à Bruxelles existent sans doute également dans d'autres grandes villes du pays. Il y a cependant aussi quelques facteurs spécifiques. Le fait qu'un grand nombre d'étrangers sont inscrits à Bruxelles par l'Office des étrangers, que le Petit-Château se trouve sur le territoire de la ville, a pour conséquence que les hôpitaux et le CPAS sont plus fortement confrontés à des pathologies lourdes. Il s'agit en effet de personnes qui ont souvent une anamnèse particulière et qui ne recourent qu'en tout dernier ressort à un dispensateur de soins. À l'hôpital Saint-Pierre, par exemple, un grand nombre de femmes qui se présentent pour un accouchement n'ont jamais consulté un médecin durant toute leur grossesse. Dans bien des cas, on est donc confronté à des naissances avant terme.
Tous ces éléments gonflent sensiblement les frais de l'hôpital, mais leur incidence financière précise est difficile à calculer, car ils sont intégrés dans les frais généraux de l'établissement. La prise en charge de patients individuels est déjà l'objet de bagarres interminables avec les pouvoirs publics. Il est quasiment impossible de récupérer ces frais généraux supplémentaires.
On entend souvent dire que le prix de la journée d'hospitalisation à l'hôpital Saint-Pierre est assez élevé et dépasse même celui de l'institut médical Edith Cavell. Au vu de ce qui précède, cela n'a rien d'étonnant. Le premier accueille tous les patients, alors que le second opère une sélection parmi sa clientèle.
M. Mayeur imagine difficilement que la situation de l'hôpital Middelheim à Anvers sait tellement différente de celle de l'hôpital Saint-Pierre.
M. Windey fait remarquer que la situation qui vient d'être décrite est effectivement très semblable à celle d'Anvers. L'approche du service social du CPAS ne paraît cependant pas tout à fait identique.
Si à Bruxelles, le bénéficiaire d'assistance est renvoyé à un médecin généraliste pour ses problèmes de santé, à Anvers il sera plutôt invité à se rendre aux consultations des hôpitaux.
Toute personne qui reçoit une forme d'assistance du CPAS et qui a des problèmes de santé peut se présenter dans un des 10 hôpitaux du CPAS de la région anversoise. Les patients y sont connus comme assistés du CPAS via un système informatique et sont soignés gratuitement. L'hôpital effectue les compensations financières directement avec la mutualité, une méthode qui a été considérablement facilitée depuis que le système du remboursement majoré a été étendu aux bénéficiaires d'assistance.
Ce système n'empêche pas les patients de s'adresser à leur médecin de famille. Ils le paient eux-mêmes, mais peuvent récupérer ce montant auprès du CPAS.
Le remboursement des médicaments est limité aux produits qui sont également admis au remboursement dans la cadre de l'INAMI. Le CPAS a conclu avec la Koninklijke Apothekersvereniging van Antwerpen , qui fait la majeure partie des compensations avec les mutualités. Cet accord implique que les médicaments sont fournis gratuitement aux personnes qui produisent une prescription estampillée dans un centre social ou munie d'une vignette adhésive spéciale. Les pharmaciens effectuent eux-mêmes la compensation du coût avec la mutualité et le CPAS.
Un certain nombre de médicaments qui ne sont pas remboursés dans le cadre de l'INAMI peuvent être indispensables. Le CPAS peut également les prendre à son compte, mais le patient doit avancer le montant chez le pharmacien. Ce peut être le cas des préparations magistrales, qui sont souvent aussi bonnes et moins chères que les spécialités, mais qui hélas étaient auparavant remboursées dans une mesure beaucoup plus grande qu'aujourd'hui par l'INAMI.
Pour les prothèses (lunettes, soins dentaires), les bénéficiaires peuvent s'adresser aux hôpitaux du CPAS sans intervention directe de ce dernier, puisque, comme on l'a dit, ils sont connus de l'hôpital.
M. Windey estime que ce système assure à ce groupe un bon accès aux soins de santé. Il n'est cependant pas applicable aux patients qui séjournent illégalement dans le pays. Pour ce groupe a été conçu, avec les organisations oeuvrant dans ce domaine, un formulaire qui est complété par ces organisations. Le patient qui se présente à l'hôpital muni de ce formulaire sera aidé.
Tout cela coûte naturellement beaucoup d'argent. En 1997, le CPAS a pris en charge 73 millions de francs au titre des soins médicaux en milieu hospitalier, à quoi s'ajoutent 67 millions de frans pour des médicaments et prothèses et 9 millions de francs de frais de médecin. Dans ces montants ne sont pas incluses les factures restées impayées, ni les frais facturés aux pouvoirs publics pour les patients qui ne sont pas inscrits au registre de la population. Ce dernier groupe représente une autre dépense de 96 millions de francs en notes d'hôpital.
Un membre demande si le CPAS dispose de chiffres concernant les personnes qui n'ont pas droit à l'assistance mais ont néanmoins un revenu modeste et doivent recourir à des suppléments pour payer leurs soins de santé.
M. Windey répond qu'on n'a pas de chiffres précis à ce sujet. Il ne peut que confirmer ce qu'a dit l'orateur précédent. Dans certains cas les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence sont mieux lotis que les autres personnes à bas revenu, ne serait-ce que parce qu'ils sont mieux informés des possibilités en matière d'aide financière. Certaines personnes qui auraient droit à tel ou tel supplément du CPAS ne savent tout simplement pas qu'ils sont dans ce cas. Il est difficile de transmettre les informations à cet égard.
Une membre croit pouvoir déceler un ton assez positif chez les deux orateurs. Il y a selon eux des problèmes, mais dans son ensemble le système semble bien fonctionner. Elle craint que cette présentation de la situation ne soit trop teintée de rose. Les CPAS ne voient en effet que les problèmes qui leur sont soumis, et non par exemple les difficultés que les petits revenus du travail éprouvent pour régler leurs soins de santé.
Le représentant du CPAS anversois a déclaré que tous les patients ayant le « label » CPAS ont droit aux soins gratuits dans les hôpitaux de CPAS. A-t-on une idée de la composition de ce groupe en ce qui concerne la part des bénéficiaires du minimum de moyens d'existence et la part des bénéficiaires d'autres formes de secours dispensés par l'intermédiaire du CPAS ?
Il y a en outre le problème des factures impayées. Les nouvelles parues à ce sujet dans la presse donnent pour le moins à réfléchir. Les personnes qui ne peuvent pas régler leur facture d'hôpital sont enregistrées et sont connues dans tous les hôpitaux des CPAS où elles se présenteraient. Outre les questions d'ordre éthique, cela met le doigt sur un très sérieux problème qui doit être à l'origine du phénomène.
Quelle est exactement la situation à l'égard ? A-t-on une quelconque idée de la composition de ce groupe de mauvais payeurs et comment voit-on ces mesures à Bruxelles ?
Enfin, elle voudrait savoir si le « label » de bénéficiaire du CPAS ou de mauvais payeur a une quelconque incidence sur les soins que l'on reçoit à l'hôpital. Une telle étiquette influence-t-elle le comportement des dispensateurs de soins dans les hôpitaux ?
À cette dernière question, M. Windey répond que le « label » de client CPAS n'a certainement aucune influence sur la qualité des soins que l'intéressé reçoit. Il s'agit du reste d'une question purement administrative dont le médecin traitant n'est même pas au courant dans la plupart des cas.
Les hôpitaux du CPAS d'Anvers appliquent en effet depuis quelques années un « embargo » à l'égard des patients qui ne paient pas leurs factures mais dont on présume qu'ils en ont la possibilité. Ces patients ont cependant toujours accès aux soins médicaux urgents.
Ce système ne satisfait personne, mais les hôpitaux sont des établissements qui doivent rendre des comptes et ne peuvent absolument pas répondre de toutes ces factures impayées.
M. Mayeur pense que la question de savoir si les personnes qui bénéficient de l'assistance du CPAS reçoivent un traitement différent de celui des autres patients dans les hôpitaux est purement théorique. Pour les médecins traitants ce sont des patients comme les autres. À cela s'ajoute cependant le fait que les techniques médicales les plus modernes et les plus efficaces sont généralement aussi les moins coûteuses. Elles limitent le séjour en hôpital et un bon traitement a un caractère éminemment préventif. Il n'y a dès lors aucune raison de dénier à certains patients l'accès à ces techniques.
En ce qui concerne les factures impayées, aucune liste de mauvais payeurs n'est établie à Bruxelles. Il va sans dire que des factures ouvertes doivent être régulièrement annulées, ce qui entraîne de lourdes pertes. À l'hôpital Saint-Pierre 11 travailleurs sociaux ont notamment pour tâche d'aider et d'informer les patients sur le plan administratif. Il en résulte évidemment un coût social élevé et le montant annuel de 4 millions de francs que l'établissement reçoit de l'État pour couvrir ce coût est absolument insuffisant.
Depuis quelque temps on observe un glissement de la polyclinique vers l'hôpital. Certaines personnes s'adressent au service des urgences au lieu de se rendre aux consultations de la polyclinique parce qu'elles pensent pouvoir ainsi être soignées gratuitement. Pour 1997 il s'agissait de quelque 2 000 patients. Ce phénomène illustre comment certains patients disposant de moyens réduits essaient de se débrouiller.
Un membre remarque que les patients qui sont enregistrés à Anvers parce qu'ils ont des factures impayées ne peuvent être les bénéficiaires du CPAS puisque le régime du tiers payeur leur est applicable et que le CPAS intervient pour les tickets modérateurs.
Le groupe ne peut par conséquent être constitué que de véritables mauvais payeurs ou de personnes qui ont un revenu minime, ne peuvent effectivement pas régler leurs factures mais ne s'adressent pas, pour l'une ou l'autre raison, au CPAS. À l'égard de ce groupe l'embargo est une chose extrêmement regrettable et l'on peut vraiment parler d'une médecine à deux vitesses.
M. Windey répond que les personnes qui sont envoyées dans les hôpitaux par les CPAS sont pratiquement les patients « les plus sûrs » pour ce qui concerne le paiement des factures. Il n'est pas du tout vrai que les personnes mises sous « embargo » sont brutalement repoussées. Lorsqu'elles reviennent à l'hôpital, leur situation sera discutée afin de trouver un arrangement pour le paiement. Celui-ci peut être très souple et lorsque l'intéressé manifeste la volonté de faire un effort, on a déjà accompli un grand pas.
Il précise qu'un embargo est imposé chaque fois que le Conseil décide d'assigner un mauvais payeur. Avant cela, le mauvais payeur aura reçu en moyenne au moins cinq sommations et aura refusé toute coopération pour rembourser tout ou partie de sa dette. Afin d'éviter des frais inutiles, l'assignation sera précédée d'une enquête de solvabilité (pour autant que les données y afférentes soient disponibles) pour vérifier :
si la personne a déjà été assignée et quelles données l'huissier de justice nous a communiquées;
quelle est sa situation sociale et financière.
Le nombre exact de personnes sous embargo n'est pas connu. Au cours de la période 1988-1997, 14 557 personnes ont été assignées par le CPAS, de sorte que quelque 14 000 personnes sont probablement touchées par l'embargo.
En ce qui concerne le fonctionnement du système d'embargo, il souligne que le patient qui est dans ce cas reçoit au moins les soins médicaux urgents. Comme la notion de « soins médicaux urgents » est difficile à définir en termes concrets, le médecin traitant est en pratique averti lorsqu'un tel patient se présente.
Le système d'embargo est principalement utilisé comme instrument préventif pour :
ne pas admettre des patients en chambre à un lit;
ne pas remettre des notes d'honoraires (sauf paiement comptant);
demander des acomptes;
obtenir des paiements;
faire signer un engagement de paiement.
M. Mayeur trouve que cette question doit être nuancée. S'il a bien compris l'orateur précédent, le service des urgences des hôpitaux du CPAS anversois ne refusera personne. Chacun peut y recourir pour les soins urgents dont il ou elle a besoin.
La situation est différente dans certains hôpitaux privés où le prix de la journée d'hospitalisation est également remboursé par les pouvoirs publics et qui reçoivent en outre des subventions pour l'infrastructure. Il n'est pas rare que dans ces établissements des ambulances doivent faire demi-tour sans que les patients aient été examinés. Ces patients se retrouvent alors dans les hôpitaux publics. Il a même reçu récemment une lettre dans laquelle un responsable d'un hôpital universitaire demandait ce qu'il fallait faire pour diriger les « cas sociaux » qui se présentaient dans cet hôpital vers un hôpital du CPAS.
Pourtant, les hôpitaux publics doivent, au même titre que les établissements privés, rendre des comptes et veiller à ce que leurs bilans soient en équilibre.
M. Decoene est d'accord pour dire que cette question doit être abordée avec un certain sens des réalités. Lorsque se présente à l'hôpital de Roulers un patient qui a une note en suspens, on examinera avec lui les moyens de la régler. Même si certains cas posent vraiment problème, il arrive souvent que les factures soient payées assez rapidement de cette façon.
À son avis, il importe, en cette matière, de prendre la balle au bond. La pratique montre que les patients sont nettement moins enclins à payer lorsque l'hôpital lui-même attend six mois pour envoyer la facture. Par ailleurs, il arrive que des patients soient appelés en conciliation auprès du juge de paix qui peut à son tour imposer un arrangement pour le paiement. C'est à la collectivité que l'on doit que l'hôpital encaisse effectivement les sommes qui lui sont dues, auprès des personnes qui en sont redevables et qui sont en mesure de les acquitter.
Un membre signale un autre problème structurel dans ce contexte. Lorsque les bénéficiaires de l'assistance du CPAS d'une autre commune se font soigner par exemple à Anvers, les frais y afférents peuvent être réclamés au CPAS du domicile du patient. Lors de l'admission on ne sait cependant pas toujours qu'il s'agit d'un bénéficiaire du minimum de moyens d'existence et par la suite il n'est pas toujours possible de retrouver ces personnes.
C. Exposé de M. Decoene, secrétaire
du CPAS de Roulers
M. Decoene fait remarquer que la ville de Roulers compte 51 000 habitants et remplit une fonction de centre pour les communes environnantes. La ville possède un hôpital public de 300 lits.
En considérant les groupes les plus faibles de la société qui ont difficilement accès aux soins de santé, on pense en premier lieu aux personnes qui s'adressent régulièrement au CPAS pour l'une ou l'autre forme d'aide. Il y en a environ 1 500 par an. Sur base annuelle, le CPAS octroie le minimum de moyens d'existence à 441 personnes et assure un accompagnement budgétaire pour 310 ménages.
Qui sont ces personnes ? L'expérience enseigne que dans ce groupe les plus faibles sont largement représentés : les bénéficiaires de revenus de remplacement, les isolés avec enfants et, de plus en plus, les jeunes. En termes financiers, sont considérés en Belgique comme n'ayant pas de sécurité d'existence les isolés dont le revenu est inférieur à 21 000 francs par mois et les ménages qui disposent de moins de 30 000 francs par mois, hors allocations familiales.
Les problèmes d'accès aux soins de santé que le CPAS doit affronter se rapportent tout d'abord aux pathologies qui ne sont pas reconnues par l'INAMI mais qui entraînent néanmoins de gros frais. Des exemples en sont les personnes qui souffrent d'une malformation des vertèbres cervicales, qui ont une dépense mensuelle de 30 000 francs, et les patients avec un anus artificiel, qui supportent pendant des années un coût d'environ 100 000 francs, sans compter une dépense considérable pour l'achat de médicaments.
Il va de soi que de tels montants sont difficiles à débourser, même pour les ménages qui disposent d'un revenu raisonnable. Lorsque le CPAS reçoit des demandes d'aide médicale, il prendra d'abord contact avec le service social de la mutualité concernée. Bien que ces services fonctionnent très bien, il leur faut généralement attendre environ deux ans pour obtenir un résultat. Durant cette période, le CPAS fournira lui-même des secours s'il le juge nécessaire.
Il y a ensuite la suppression du fonds spécial d'assistance pour les cancéreux. Auparavant, le CPAS pouvait aider environ cinq patients par an par cette voie. À présent, il doit supporter lui-même ces frais. C'est là un exemple typique de la manière dont les coûts sont transférés au niveau local.
En troisième lieu, il y a les personnes qui ne sont pas en règle de cotisation auprès de leurs mutualités. En moyenne, le CPAS doit régulariser la situation sur ce plan pour quelque 70 personnes par an. Il essaie de profiter de l'occasion pour leur faire souscrire également une assurance hospitalisation auprès de la mutualité. Ce n'est toutefois pas toujours possible pour les plus de 60 ans ou pour les personnes plus jeunes, mais qui souffrent de pathologies déterminées, de sorte que ces personnes doivent être prises en charge par le CPAS. Cela soulève néanmoins des questions concernant le caractère social de certains organismes qui refusent délibérément toute association avec des assurances privées.
En quatrième lieu vient le problème des quotes-parts personnelles. Celui qui connaît la situation sur le terrain sait que l'expression « ticket modérateur » est très bien choisie pour les groupes financièrement plus faibles. Une quote-part personnelle de 10 000 francs par mois pour l'achat de médicaments n'est pas une exception, même pour la clientèle du CPAS.
Pour une prothèse de la hanche, le patient débourse personnellement, en moyenne, 25 000 à 32 000 francs, et pour une prothèse du genou 13 000 francs. En orthodontie la plupart des soins ne sont pas remboursés et un appareil coûte facilement dans les 50 000 francs. Un séjour en soins intensifs coûte au patient 87 000 francs en moyenne.
Face à ces chiffres, il n'est pas étonnant que des patients feront des choix et différeront le plus possible certaines formes d'aide médicale.
Que fait le CPAS devant de telles situations ?
Les factures d'hôpital en suspens de la clientèle du CPAS sont réglées par le CPAS parce que l'hôpital lui-même se retrouve dans une situation financière impossible. D'autres factures doivent hélas être annulées pour des montants considérables parce qu'elles ne pourront jamais être acquittées par les intéressés.
Aux patients qui ne peuvent payer est cependant proposé un plan de remboursement. Actuellement, 1 444 de ces plans sont en cours (l'hôpital traite environ 20 000 patients par an). Ce système peut offrir une solution dans certains cas, mais souvent les intéressés sont entraînés dans une spirale de dettes et de plans de remboursement.
Avec les généralistes, on tâche de trouver un accord par lequel les patients de ces groupes sont soignés au tarif de remboursement.
À plus long terme, le CPAS s'efforce de mener une politique de prévention axée sur le logement et l'emploi, en exploitant au maximum les possibilités qu'offre la législation existante : l'article 60 de la loi organique, le « maribel » social, ... Une telle politique procure au groupe en cause non seulement un toit et un travail, mais aussi une perspective de vie et la possibilité d'accéder au marché régulier du travail. Les intéressés peuvent améliorer leur qualité de vie. En examinant le groupe cible du CPAS, on trouvera peu de personnes pauvres, isolées et âgées. Ces personnes ont rarement plus de 75 ans.
Un membre constate sur la base des trois exposés que les hôpitaux qui accueillent ces groupes de personnes se heurtent à des problèmes financiers de plus en plus importants, du fait notamment que le nombre de patients qui ne sont pas en mesure de payer leurs factures d'hôpital ordinaires ne cesse de grandir. De plus, ces orateurs confirment ce qui a été déclaré au cours d'auditions précédentes, à savoir que certains patients sont confrontés à des frais tellement élevés qu'ils ne peuvent être supportés même avec un revenu normal.
Il est clair que les deux phénomènes ne peuvent être dissociés. A-t-on une idée précise du type de patients qui ne paient pas les notes ? Lorsqu'à Anvers un plan de remboursement est proposé au cours d'un entretien préliminaire, personne ne le négligera et ne se limitera aux soins urgents.
M. Windey répond que les raisons du défaut de paiement ne sont pas enregistrées. Il existe toutefois d'autres possibilités d'obtenir l'une ou l'autre information sur ces groupes.
Un membre demande quand et comment les CPAS constatent l'état d'indigence des patients qui viennent d'ailleurs et pour lesquels les factures doivent être envoyées à un autre CPAS.
M. Decoene répond que cela se fait au moment où le patient entre à l'hôpital. On connaît par conséquent sa situation dès qu'il est admis.
L'orateur suivant demande qui paie les suppléments résultant par exemple du choix d'une chambre à un lit. Un tel choix donne notamment aux médecins le droit de facturer un supplément d'honoraires.
M. Windey répond que ces suppléments ne sont jamais pris en charge par le CPAS. Si sur ce plan l'hôpital fait une mauvaise évaluation, il doit en supporter lui-même le coût. Si des personnes sont admises en chambres de première classe, les précautions nécessaires doivent être prises en réclamant par exemple des acomptes.
M. Decoene ajoute que le choix d'une chambre à un lit, sauf pour raisons médicales, est fait par le patient. Lors de l'entretien préliminaire, celui-ci est clairement informé des conséquences qui peuvent découler d'un tel choix et qu'il devra supporter.
Un membre souhaite savoir comment les orateurs réagissent à la nouvelle, récemment parue dans la presse, selon laquelle un toxicomane s'est jeté sous une voiture pour être secouru. Il lui était en effet impossible d'obtenir une aide parce que deux CPAS ne parvenaient pas à se mettre d'accord sur sa prise en charge.
M. Windey remarque qu'on en revient, en l'occurrence, à la loi du 2 avril 1965. Cette loi ne comporte que quelques pages, mais une abondante jurisprudence lui a déjà été consacrée. Les discussions à cet égard entre CPAS sont légion et les personnes qui ont besoin d'aide en sont les premières victimes. À son sens, il faudrait élaborer une réglementation en vertu de laquelle, dans de tels différends, les secours seraient de toute manière fournir par les CPAS concernés. Ensuite, ceux-ci pourront vider leur querelle aussi longtemps qu'ils voudront, sans que ces personnes soient obligées d'en attendre l'issue.
Le problème se pose avec moins d'acuité dans le secteur des soins de santé parce que les hôpitaux publics fournissent de toute façon aux patients qui se présentent l'aide dont ils ont besoin.
Un orateur suivant signale qu'un des principaux problèmes concernant la prise en charge réside dans le fait que les CPAS appliquent des critères différents. Certains exigent des preuves irréfutables de l'état d'indigence avant d'intervenir, alors que d'autres sont infiniment plus souples. Un autre problème est la pratique qui consiste à renvoyer simplement des patients à un autre CPAS pour ne pas avoir à supporter soi-même les frais. Une récente modification de la loi devrait cependant enrayer quelque peu cette pratique.
Mme Maximus fait remarquer que l'aide supplémentaire pour soins de santé doit être supportée par le budget du CPAS et doit par conséquent être négociée avec l'administration de la ville. Y a-t-il des difficultés à ce propos ?
M. Windey répond que le budget du CPAS est négocié en termes généraux. S'il y a d'importants glissements dans certains secteurs, ceux-ci seront utilisés comme argument pour une augmentation de la subvention. Pour ces secteurs proprement dits, aucune politique n'est dictée par la ville ou discutée en détail.
M. Decoene déclare qu'à Roulers aussi l'administration de la ville respecte l'autonomie du CPAS et n'engage pas de discussions sur le fond en ce qui concerne l'affectation des moyens, accordés sous la forme d'une enveloppe générale.
Un membre remarque que, notamment dans les interventions parlementaires, des doutes sont régulièrement émis au sujet du plan de répartition pour les étrangers. On constate notamment que les personnes qui sont attribuées à une commune retirent chaque mois leur chèque au CPAS et disparaissent ensuite de la circulation jusqu'au jour de paiement suivant.
M. Decoene est d'accord sur le fait que le plan de répartition consistait jusqu'à présent en une attribution administrative. Certaines personnes habitaient par exemple à Vilvorde mais étaient attribuées à Roulers. Elles venaient y retirer leur chèque (l'indemnité est entièrement remboursée par l'autorité fédérale), mais retournaient ensuite à leur domicile. Dans la nouvelle réglementation la commune d'accueil doit également pourvoir au logement, ce qui n'est cependant pas toujours apprécié par les intéressés.
M. Windey se déclare fort partisan du plan de répartition, mais il y manque selon lui une chose, à savoir l'obligation pour les intéressés d'habiter effectivement dans les communes auxquelles ils sont attribués. Récemment il est apparu que 23 demandeurs d'asile étaient attribués à la ville d'Ypres, mais qu'ils habitaient tous à Anvers. Pour le CPAS d'Anvers, cela n'entraîne pas de gros frais supplémentaires, sauf peut-être dans le cas de l'aide médicale, mais la pression sur la ville s'en trouve accrue et un des buts du plan de répartition était de l'éviter.
M. Windey remet enfin à la commission les données suivantes concernant l'impact financier des soins médicaux et paramédicaux de la clientèle du CPAS d'Anvers :
Impact financier des soins médicaux et
paramédicaux de la clientèle du CPAS
| Assistance Bijstand |
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
| Soins de santé dont garantie soins médicaux pour assistance clientèle CPAS. Geneesk. zorgen waaronder waarborg geneeskundige verzorging voor bijstand OCMW-cliënteel | 49 899 299 | 64 993 692 | 75 849 737 | 79 998 099 | 99 678 291 | 78 726 838 | 79 927 896 |
| (11 959 332) | (13 349 393) | (20 033 175) | |||||
| Médicaments + prothèses. Medicatie + prothese | 40 742 968 | 48 280 782 | 52 450 406 | 61 118 922 | 66 746 879 | 69 712 443 | 77 890 634 |
| Prestations paramédicales. Paramedische verstrekkingen | 6 634 562 | 1 147 968 | 700 433 | 802 395 | 730 447 | 403 706 | 430 831 |
| Interventions de médecins. Tussenkomst dokters | 14 968 434 | 14 609 005 | 14 800 203 | 13 120 457 | 11 471 956 | 14 951 994 | 14 024 768 |
| Hospitalisations personnes nécessitant des soins infirmiers sans domicile de secours. Hospitalisatieverplegingsk. behoeftigen zonder onderstandsdomicilie | | | | 95 070 076 | 154 369 284 | 122 978 796 | 124 257 871 |
| Total. Totaal | | | | 250 109 949 | 332 996 857 | 286 773 777 | 296 532 000 |
| Non-paiement cotisations mutualité. Niet-betaling bijdragen mutualiteit | | | | 43 368 810 | 54 919 950 | 54 654 929 | 51 386 775 |
| Total. Totaal | | | | 293 478 759 | 387 916 807 | 341 428 706 | 347 918 775 |
Effet positif de la réforme de l'assurabilité
La réforme de l'assurabilité entreprise par le gouvernement a incontestablement favorisé l'accès aux soins de santé.
Les effets de la réforme sont particulièrement perceptibles dans trois domaines :
1. L'accès à l'intervention majorée (VIPOMEX) pour les bénéficiaires du minimex et de l'aide sociale a permis une diminution sensible des tickets modérateurs.
L'accès aux prestations médicales est donc mieux assuré. Cela est particulièrement sensible pour les soins dentaires, les soins de kinésithérapie et les frais d'hospitalisation.
La confirmation de cette tendance est corroborée par la baisse du nombre de personnes pour lesquelles un remboursement est nécessaire dans le cadre de la franchise sociale. Peu de patients issus des catégories protégées atteignent encore le montant de 15 000 francs de tickets modérateurs pour les prestations médicales.
2. La réforme de l'assurabilité permet également de régulariser rapidement les situations en vue d'une ouverture du droit à l'assurance soins de santé.
Antérieurement, une condition de 6 mois de domiciliation et de 6 mois de stage était nécessaire pour obtenir l'accès à l'assurance soins de santé.
La suppression de cette condition rend possible la mise en ordre de mutuelle directement.
Cela est particulièrement utile pour des personnes qui doivent être hospitalisées et qui ne sont pas en ordre de mutuelle.
La confirmation de la diminution du nombre de personnes non assurées est corroborée par la diminution des dépenses en matière de frais d'hospitalisation dans le cadre de la loi du 2 avril 1965.
3. La suppression des cotisations d'assurance obligatoire facilite également l'accès à l'assurance.
Cela est particulièrement sensible pour les personnes bénéficiant d'une aide sociale équivalente au minimex, les handicapés et les pensionnés.
Les bénéficiaires du minimex étaient déjà exemptés du paiement de cette cotisation antérieurement.
Dorénavant, le simple fait de prouver que l'on appartient à une catégorie protégée permet une remise en ordre sans frais particuliers.
En cas de remise en ordre de mutuelle, la personne ne doit donc plus éponger les années de cotisations antérieures avant d'être en ordre de mutuelle.
D'une manière générale, cette réforme a également obligé les CPAS, les organismes assureurs et les hôpitaux à se rencontrer et à collaborer activement en vue d'une régularisation des droits lors d'une hospitalisation.
Cette collaboration entre les services sociaux des hôpitaux, des CPAS et des mutuelles devrait être encouragée par une information et devrait être instaurée d'une façon plus officielle et régulière.
Les lacunes de la réforme
M. Van Exter souscrit à l'exposé de l'orateur précédent, mais pense que la réforme comporte encore quelques lacunes. Ces lacunes risquent de créer une médecine à deux niveaux et il faut éviter à tout prix une telle situation.
Les lacunes se situent dans trois domaines :
· le remboursement des médicaments pour les patients chroniques et leur intégration dans la franchise sociale;
· les indépendants;
· les soins psychiatriques.
En ce qui concerne les patients chroniques, il importe de savoir qu'une corrélation est constatée, dans tout le pays, entre les ressources financières dont les personnes disposent et leur état de santé.
A. Les médicaments pour les malades chroniques
Les médicaments ne font pas partie de la franchise sociale. Pour les personnes à faibles revenus, cela constitue encore un frein important pour l'accès aux soins de santé.
Le coût des médicaments constitue notamment un obstacle difficilement franchissable pour les malades chroniques.
Les maladies graves ou les maladies chroniques visées sont :
Cancer :
certains analgésiques prescrits rentrent dans la catégorie D (sans intervention INAMI),
la nourriture entérale : les mutuelles, sur avis du médecin conseil interviennent pour un forfait de 120 francs/jour, ce qui ne couvre pas les frais réels.
Sida
Hépatite B : cela concerne essentiellement les populations toxicomanes et étrangères. Le coût des vaccinations reste très élevé.
Arthrose : il n'y a pas de remboursement préférentiel car les médicaments prescrits rentrent dans la catégorie B.
Bronchite chronique : pour qu'il y ait une intervention de l'INAMI dans les mucolytiques, il faut une décision du médecin conseil
Diabète : les médicaments liés à cette pathologie sont bien remboursés, mais les patients développent souvent des maladies « associées » qui nécessitent des soins onéreux (ulcères : nettoyants, désinfinctants, bandages, ...).
Maladies cardiovasculaires : (hypertention, angine de poitrine, ...) : le coût des prothèses reste très élevé.
Dépression : les antidépresseurs et les anxiolytiques ne sont pas remboursés par l'INAMI.
On ajoutera que certains médicaments constituent encore une charge financière importante pour les personnes les plus démunies :
les antibiotiques pour les grippes et bronchites;
les prothèses dentaires;
les frais de lunetterie.
Il est également important, pour ce qui est des médicaments, de ne pas se focaliser sur l'un ou l'autre remède pour une affection bien précise. L'expérience enseigne en effet que dans les groupes à risque, plusieurs affections apparaissent conjointement et c'est cette accumulation qui alourdit le coût pour le patient.
Enfin, il faut encore mettre l'accent sur les coûts des soins dentaires et les frais de lunetterie, qui sont très élevés dans les deux cas et qui sont remboursés dans une trop faible mesure. Au strict domaine de la santé s'ajoute ici l'aspect social. Le candidat à un emploi dont les dents sont mal soignées a, par ce seul fait, moins de chances d'être retenu. De manière indirecte, la personne dotée d'une mauvaise dentition est souvent mal dans sa peau et ne sait pas comment se comporter dans certaines situations, ce qui réduit à son tour les possibilités sociales.
B. Les indépendants
La réforme de l'assurabilité n'a pratiquement pas eu d'influence sur la situation des indépendants. La remise en ordre de mutuelle des indépendants représente encore une grosse charge pour les CPAS. Souvent ils sont obligés de payer des années de cotisations antérieures, ce qui exige d'énormes dépenses et rend particulièrement difficile la régularisation de ces situations.
Un autre problème est celui des indépendants hébergés en maisons de repos qui, au-delà de cinquante ans, ne peuvent plus être assurés pour les petits risques s'ils ne l'étaient pas encore. Il est nécessaire de mener une campagne auprès de ce groupe de personnes. De nombreux indépendants ignorent en effet qu'ils doivent s'assurer pour les petits risques avant l'âge de cinquante ans.
La réforme de l'assurabilité n'offre que des solutions partielles aux indépendants qui ont été déclarés en état de faillite par le tribunal.
C. Les soins psychiatriques
Les soins psychiatriques restent souvent très lourds.
L'État considère que les hôpitaux et les institutions psychiatriques ne constituent pas des établissements de soins au sens de la loi du 2 avril 1965 et, à ce titre, ne rembourse plus aux CPAS les frais de traitement.
Ce phénomène est accentué par le fait que les Régions flamande et wallonne ont supprimé le Fonds spécial d'assistance (FSA) et qu'en Région bruxelloise, son fonctionnement est bloqué pour des raisons institutionnelles.
Le FSA intervenait antérieurement pour couvrir une partie des frais de traitement des maladies psychiatriques.
Mme Wernette adhère, dans les grandes lignes, à ce qui précède. Les récentes mesures du gouvernement, et en particulier la réforme de l'assurabilité, ont considérablement amélioré l'accès aux soins de santé des plus démunis et donné une certaine marge de manoeuvre financière aux CPAS sur ce plan. Cette dernière mesure était plus que nécessaire, car dans une région comme celle de Charleroi, qui s'appauvrit à vive allure, un nombre de plus en plus grand de personnes qui n'ont pas droit au minimex viennent solliciter l'aide du CPAS pour pouvoir payer les soins de santé. Il s'agit de personnes qui bénéficient d'une prestation sociale ou d'un revenu trop bas pour couvrir les prestations médicales.
On constate en effet chez beaucoup de personnes démunies une accumulation d'affections (chroniques) qui sont la conséquence de leur situation sociale. Elles sont souvent isolées, ont perdu leur emploi, vivent dans un logement insalubre, et tout cela provoque des troubles psychiques.
Les CPAS ont légalement pour mission d'offrir à ces personnes une vie digne, ce qui implique également la possibilité de mourir dignement. Les cancéreux qui désirent être soignés à domicile doivent payer eux-mêmes un grand nombre de médicaments, alors que dans un hôpital ceux-ci sont fournis gratuitement. Certains médicaments qui sont administrés en phase terminale pour atténuer la douleur sont souvent inabordables pour les intéressés.
Les soins dentaires sont très chers. Les problèmes y afférents sont plus graves pour les démunis parce que ceux-ci ont souvent une conception différente de l'hygiène. Parmi la clientèle du CPAS, les personnes de 30 ans qui n'ont plus de dents ne sont pas l'exception. Ainsi, elle traite actuellement le dossier de deux jeunes femmes de 16 et 18 ans qui ont besoin d'une prothèse dentaire complète (coût : 54 000 francs). Elles vivent chez leur père qui touche une allocation de chômage.
Les frais de lunetterie ne sont pas forcément élevés. Pour une simple anomalie de la vision on peut s'en tirer avec 3 000 francs environ. Ce montant peut facilement grimper au-delà de 10 000 francs lorsque des verres plus puissants sont nécessaires. Pour les enfants, surtout, il est important de recevoir des soins adéquats sur ce plan, car les troubles de la vue se traduisent rapidement par un retard scolaire. Même si les frais de lunetterie ne sont pas élevés en soi, il y a souvent, en particulier chez les enfants, le problème qu'ils les cassent plus vite, ce qui accroît encore les dépenses.
M. Dumont remarque que pour les personnes qui perçoivent un minimex de 21 000 francs par mois, toute dépense pour soins de santé entraîne invariablement des problèmes.
La situation ne devient cependant vraiment dramatique, même pour ceux qui touchent plus que le minimex, que lorsqu'il y a accumulation de problèmes de santé, ce qui n'est pas inhabituel. Ce sont en effet les personnes à revenu modeste ou les allocataires sociaux qui viennent frapper sans cesse à la porte du CPAS pour le paiement de l'aide médicale.
À Liège, le CPAS a créé un « Centre médical préventif » qui visait dans un premier temps à dispenser des soins préventifs à la population allochtone. À présent le centre est toutefois également accessible à la populatio autochtone parce que l'on s'est rendu compte que certains groupes accordent beaucoup d'importance à ce type de soins. On constate que des femmes se présentent chez un médecin pour un accouchement sans avoir subi le moindre examen pendant toute la durée de la grossesse.
Un autre exemple est celui des soins dentaires, dont il a déjà été question. Le coût de ces soins, de même que les frais de lunetterie, pose effectivement d'énormes problèmes de remboursement.
Un orateur précédent avait déjà parlé des frais de la nourriture entérale. La personne qui se la fait administrer à domicile doit faire face à une dépense qui atteint facilement quelque 30 000 francs par mois. Après avis du médecin-conseil, l'INAMI rembourse 120 francs par jour, ce qui est absolument insuffisant. Certains CPAS peuvent se permettre d'intervenir dans ces fras, mais d'autres ne le peuvent simplement pas.
Dans ce contexte on ne peut sous-estimer l'influence néfaste du transfert aux régions, d'abord, et de la suppression du Fonds spécial d'assistance, ensuite. De ce fait, une énorme charge a été reportée sur les CPAS.
M. Emonts souligne qu'il est important, en cette matière, de ne pas toujours prendre des mesures linéaires et de tenir compte de la situation réelle dans les communes. Il y a une grande différence entre les petites communes, d'une part, et les centres de moyenne et de grande dimension, d'autre part, où les problèmes se concentrent. Liège par exemple a trois hôpitaux psychiatriques sur son territoire et cela accentue évidemment les problèmes.
M. Destoop remarque que les orateurs veulent proposer les solutions suivantes :
1. Établir un remboursement préférentiel pour tous les médicaments liés à ces pathologies graves ou chroniques en faveur des bénéficiaires de l'intervention proposée (VIPO).
Il serait également important de prévoir un remboursement à 100 % pour les antibiotiques et une intervention forfaitaire dans les prothèses dentaires et les frais de verres de lunettes.
2. Prévoir la possibilité de remettre les indépendants en ordre de mutuelle en les engageant dans un contrat de travail (ex. : art. 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976).
3. Rétablir le remboursement par l'État des frais de traitement liés à un hébergement dans un établissement psychiatrique.
M. Van Exter souhaite encore faire trois remarques en guise de conclusion.
On constate indéniablement, parmi la clientèle des CPAS, un accroissement des problèmes psychiques. On peut se demander si ceux-ci sont la conséquence de la situation difficile dans laquelle les intéressés se trouvent ou s'ils sont à l'origine de cette situation. Le plus important est toutefois que les problèmes de ce genre se posent de plus en plus fréquemment et que la politique devra en tenir compte.
Il y a incontestablement une corrélation entre pauvreté et santé. Plus les groupes sociaux sont démunis, plus les problèmes de santé sont grands, et ce pour diverses raisons.
En n'intervenant plus dans un certain nombre de matières, le pouvoir central a déplacé les problèmes au niveau local. Pour les communes de petite taille et bien situées, les difficultés qui en résultent ne sont pas insurmontables. Il faut cependant bien se rendre compte que cette politique peut avoir des conséquences désastreuses pour les centres plus grands et les communes pauvres. Confrontés à une concentration des problèmes de pauvreté, ceux-ci doivent supporter tout le poids des problèmes qui sont tranférés. Dans certains centres, une telle accumulation conduit à des situations intenables.
M. Dumont pense que les charges financières pour les plus démunis et les CPAS pourraient diminuer dans une importante mesure si les médecins prescrivaient plus de médicaments génériques à ces patients.
Un membre de la commission relève qu'il a été fait allusion à plusieurs reprises, au cours de ces auditions, au transfert des budgets des autorités centrales vers les autorités locales. A-t-on une idée de l'ampleur de ce mouvement ?
M. Van Exter répond que des chiffres généraux ne sont pas disponibles à ce sujet. Le secteur du chômage a fait l'objet d'une enquête dont les résultats seront transmis à la commission.
On ne peut cependant pas sous-estimer les transferts dans le secteur des soins de santé. L'augmentation du ticket modérateur de 1 000 francs par hospitalisation a entraîné pour le CPAS d'Uccle une dépense supplémentaire de 2 millions de francs, ce qui équivaut à 2 000 hospitalisations de personnes qui ont droit au minimex. Sachant que la commune d'Uccle est considérée comme une commune « riche », on peut imaginer quel impact bugétaire cette seule mesure a dans une ville comme Anvers ou Liège.
M. Lesiw ajoute qu'il est difficile de recueillir des chiffres généraux à ce sujet parce qu'il n'existe pas de données centralisées sur l'aide qui est dispensée par les CPAS eux-mêmes.
Il souhaite toutefois souligner que la tendance qui se manifeste sur ce plan conduit à des inégalités. Comme il a déjà été dit, la concentration actuelle des problèmes dans les grands centres et les communes moins riches en est renforcée. On en arrive à une solution où telle commune peut offrir plus que telle autre en matière d'assistance sociale, et une telle situation n'est pas saine.
M. Destoop précise que le CPAS de Courtrai intervient, dans de cas dignes d'intérêt, pour un pourcentage du ticket modérateur. Rien que pour les quelque 670 bénéficiaires du minimex de cette ville, cela représente une dépense annuelle de 2,3 millions de francs. En appliquant ce chiffre à l'ensemble du pays et à d'autres sortes de dépenses, on obtient des montants considérables.
M. Emonts souhaite revenir sur la situation des indépendants qui, souvent après une faillite, s'adressent à un CPAS. Il plaide pour que soient prises, à l'égard de ce groupe, des mesures spécifiques en matière d'emploi, dans le cadre ou le prolongement de l'article 60 de la loi relative aux CPAS. Cela permettrait d'écarter ces personnes de la clientèle des CPAS. Un grand nombre d'entre elles pourraient ainsi s'insérer rapidement dans le marché du travail et leurs capacités seraient à nouveau utilisées au profit de la collectivité.
Bien qu'il soit déjà fait un usage maximal de l'article 60 à l'égard de ces personnes, les possibilités sont souvent trop limitées pour établir un pont, avec les moyens actuels, vers le marché du travail pour ce groupe.
Un membre de la commission observe que l'article 60 peut effectivement, dans certains cas, offrir une solution au problème très délicat de ces indépendants qui ont fait faillite et n'ont absolument aucun moyen d'existence. La mesure ne peut toutefois être appliquée qu'à l'égard des personnes en dessous d'un certain âge, pour qui il y a encore une place sur le marché de l'emploi. Les indépendants plus âgés qui s'adressent au CPAS se trouvent cependant dans une situation sans issue.
Elle revient ensuite sur la remarque d'un orateur, disant que la charge des soins de santé pour les plus démunis diminuerait si les médecins prescrivaient plus rapidement des médicaments génériques à ces patients. Indépendamment de la question de savoir s'il est en pratique possible, pour le médecin, d'opérer une sélection parmi ses patients, on peut se demander s'il ne se crée pas, de la sorte, une médecine à deux niveaux.
Un autre orateur rappelle la remarque selon laquelle les patients psychiatriques sont purement et simplement oubliés par la loi du 2 avril 1965. Personnellement il pensait que ces problèmes avaient été en grande partie résolus par de récentes modification de la loi. Quelle est la situation à cet égard dans une ville comme Courtrai et qu'est-ce que cela représente en termes budgétaires ?
Divers orateurs ont signalé que de plus en plus de charges sont déplacées du pouvoir central au niveau local. Une variante en est l'augmentation progressive des tickets modérateurs au cours des dernières années, ce qui correspond à un tranfert des charges de la sécurité sociale vers le patient. Lors d'auditions antérieures, un montant de 11 millions de francs a été mentionné à ce titre pour les cinq dernières années. Dans quelle mesure cela a-t-il un impact pour les CPAS ?
Un orateur a souligné les différences dans le mode d'intervention des CPAS et les discriminations qui peuvent en découler. Ce phénomène est connu de longue date et est d'ailleurs l'objet d'une enquête. De telles différences ne sont-elles cependant pas, en partie, inhérentes à notre système ? Le législateur a délibérément choisi, à travers les CPAS, de rapprocher le plus possible les services d'assistance des plus démunis pour pouvoir répondre aux situations locales. Cela suppose presque automatiquement une approche différente par les CPAS qui ont une grande autonomie.
Il peut en effet en résulter des situations difficiles dans les grands centres présentant un haut degré de pauvreté, mais est-il pour autant souhaitable de procéder à une modification de loi en vue de ramener davantage la politique au niveau central ?
À la deuxième question de Mme Nelis, M. Van Exter répond que les premières données de Pharmanet sur le comportement prescripteur des médecins sont disponibles depuis peu. Il en ressort que la prescription de médicaments génériques par le corps médical dans son ensemble est pratiquement inexistante.
Il y a sur ce point une énorme lacune dans l'enseignement de la médecine qui, jusqu'il y a quelques années du moins, n'abordait pas la question des prix des médicaments. Les choses semblent changer ces derniers temps, mais cela ne se traduit pas dans la pratique. Il s'y ajoute un manque criant d'information. Les firmes qui approchent les médecins au moyen de campagnes publicitaires ou par l'entremise de représentants (parfois très agressifs) n'ont naturellement aucun intérêt à recommander des médicaments génériques qui ne coûtent qu'une fraction du prix qu'il faut débourser pour une spécialité.
Il ne s'agit donc pas d'un problème social, à savoir si les patients sont ou non approchés de manière différente, mais d'un problème général de formation et d'information dans le chef du corps médical.
À l'ultime question du dernier orateur il souhaite apporter quelques éléments de réponse, sans prétendre à l'exhaustivité. Lorsqu'il est question de l'accès aux soins de santé, on parle d'un secteur où les tarifs sont identiques dans tout le pays. Une intervention accrue ou réduite des pouvoirs publics a les mêmes implications pour tous les CPAS. À cela s'opposent d'autres formes d'assistance où ce n'est pas le cas. Le loyer d'une habitation à Schaerbeek représente par exemple le tiers de celui d'Uccle. Alors que dans la première commune le minimex suffit pour payer ce loyer, dans la seconde ce ne sera pas possible et le CPAS devra accorder une allocation de logement dans le cadre de l'assistance. Il est évident que les CPAS doivent en l'occurrence faire valoir pleinement leur autonomie et mener une politique adaptée à la situation locale. Dans ce domaine, une politique différente des CPAS est par conséquent parfaitement justifiée parce que la situation locale est différente. Dans le cas des soins de santé, une politique divergente des CPAS est beaucoup moins évidente.
À la question concernant les indépendants, M. Lesiw répond que les problèmes y afférents doivent être réglés d'urgence. Les CPAS n'ont souvent pas d'autre choix que d'acquitter toutes les dettes envers la sécurité sociale, accumulées durant des années.
En ce qui concerne les mesures de politique, la première question qui se pose est de savoir s'il n'est pas possible d'éviter que la situation ne se produise. Visiblement, les intéressés peuvent accumuler un retard de plusieurs années dans le paiement de leurs cotisations sociales sans que l'on n'intervienne. Personne, l'indépendant compris, ne tire avantage d'une telle situation.
Au cours des dernières années, l'assurabilité à l'assurance soins de santé a été étendue à toute une série de groupes qui n'étaient pas en règle de cotisations sociales. Pour la régularisation, il suffit parfois de payer les cotisations pour le trimestre en cours. Ces mesures ne s'appliquent pas aux indépendants faillis et on peut se demander si elles ne doivent pas être étendues à ce groupe.
On peut demander une dispense de cotisations à la commission compétente de l'INAMI, mais celle-ci est souveraine dans son appréciation et ne base pas sa décision sur des considérations sociales. En le faisant, il serait pourtant possible de remédier à toute une série de problèmes.
En ce qui concerne les soins psychiatriques, les problèmes sont loin d'être résolus. Les établissements psychiatriques ne constituent pas des établissements de soins au sens de l'article 1er de la loi du 2 avril 1965, de sorte qu'un certain nombre de dépenses pour les soins qui y sont dispensés étaient auparavant prises en charge par l'Etat mais doivent à présent être supportées par les CPAS eux-mêmes dans le cadre de l'assistance.
Les différences que l'on voit apparaître dans la politique des CPAS en matière de soins de santé se manifestent principalement sur le plan de l'aide préventive. Pour ce qui est de la dispensation des soins proprement dits, les pouvoirs publics ont choisi la bonne voie en travaillant au niveau de la sécurité sociale par le biais de l'extension de l'assurabilité. Cette voie comporte la meilleure garantie pour le maintien de l'égalité d'accès aux soins.
Dans le domaine de la médecine préventive, on constate que certains CPAS sont plus dynamiques que d'autres (par exemple en ce qui concerne le remboursement de soins dentaires préventifs). Cela tient à des choix de politique mais aussi, de toute évidence, aux moyens disponibles.
À la question relative aux tickets modérateurs, M. Destoop répond qu'il est difficile d'évaluer avec précision les effets de leur augmentation. Ces effets sont cependant indéniables. À l'hôpital CPAS de Courtrai, qui compte environ 300 lits, les montants non récupérables sont passés en quatre ans de quelque 1,5 million de francs à plus de 5 millions de francs. Il s'agit en grande partie de patients qui ne paient pas le prix de base de 1 500 francs, ce qui est quand même l'indice d'un problème de pauvreté. À côté de ces personnes qui se sont adressées à l'hôpital, il en est probablement d'autres qui n'ont pas osé franchir le pas.
M. Van Exter relève à cet égard que, dans la région bruxelloise, on observe une tendance des patients à ne plus se présenter dans les polycliniques ou aux consultations ordinaires mais dans les services des urgences et à disparaître ensuite sans laisser de traces.
À la question d'un membre, M. Dumont répond que les établissements psychiatriques sont mentionnés à l'article 2 de la loi de 1965, spécifiant quel CPAS doit supporter les frais de ces patients. À l'article 1er de cette loi, il est cependant expressément stipulé que ces établissements ne peuvent pas être considérés comme des établissements de soins. Il s'ensuit que l'État n'intervient plus dans les frais de certaines catégories de patients de ces établissements et que ces frais sont désormais supportés par les CPAS eux-mêmes. Rien qu'à Liège, la dépense supplémentaire qui en résulte pour le CPAS est estimée entre 2 et 2,5 millions de francs.
Un membre demande quelle est la proportion des indépendants ou ex-indépendants dans l'ensemble du groupe des personnes qui s'adressent au CPAS.
M. Van Exter répond que cette proportion peut varier sensiblement d'après les CPAS et il peut être admis que la part de ce groupe dans le total des demandeurs d'aide est en général relativement réduite. Mais il faut savoir que pour chaque demandeur, il faut payer des arriérés de 400 000 à 500 000 francs pour la remise en ordre d'assurance soins de santé.
M. Lesiw ajoute que ces dernières années ont vu un accroissement du nombre d'indépendants faillis qui viennent frapper à la porte du CPAS. L'explication tient probablement, en bonne partie, au phénomène des « faux indépendants », c'est-à-dire des personnes qui travaillent dans des liens de subordination mais qui ont le statut d'indépendant. Lorsque ces personnes sont licenciées, elles ne bénéficient évidemment pas de la même protection sociale que les travailleurs salariés.
M. Aerts présente d'abord le Conseil supérieur national des handicapés. Le Conseil supérieur est un organe consultatif officiel qui a été institué par arrêté royal du 9 juillet 1981. Son activité recouvre les domaines de compétence fédéraux relatifs aux soins des personnes handicapées. Le Conseil émet des avis à la demande de l'autorité de tutelle, le secrétaire d'État à l'Intégration sociale, mais il a aussi un droit d'initiative en matière d'avis.
Le Conseil comprend vingt membres, le président inclus, et est composé de manière équilibrée, tant au niveau des communautés qu'en ce qui concerne les organisations de handicapés oeuvrant dans notre pays.
M. Aerts esquisse ensuite en termes généraux les problèmes auxquels les handicapés doivent faire face sur le plan de l'accès aux soins de santé.
Si l'on veut favoriser l'intégration des personnes atteintes d'un handicap, il faudra mettre à leur disposition des moyens suffisants afin de leur donner les mêmes possibilités financières qu'aux autres citoyens.
Le fait d'être handicapé s'accompagne presque toujours de dépenses supplémentaires :
notes élevées de médecins;
dispensateurs de soins;
transport adapté pour les consultations;
médicaments;
moyens de communication;
fauteuils roulants;
aménagement du logement.
En outre : l'acquisition d'un revenu du travail n'est pas une évidence !
Par ailleurs, il ne faut pas oublier qu'un handicap comporte souvent aussi toute une série de frais indirects. Certains handicapés sont confrontés à une usure plus rapide de leurs vêtements et doivent, pour certains travaux domestiques simples peindre, tapisser , recourir à des tiers.
Le système de soins de santé et le régime d'assurance maladie en Belgique comptent parmi les meilleurs du monde (études OCDE). Au cours des dernières années ont en outre été prises quelques mesures visant à optimiser l'accessibilité du système :
mesures pour les maladies chroniques;
franchise sociale et fiscale;
élargissement du nombre d'ayants droit à la franchise sociale et fiscale.
Un certain nombre de problèmes se posent cependant pour plusieurs groupes cibles spécifiques :
En ce qui concerne le groupe cible des personnes handicapées, les points suivants peuvent être soulignés :
1. Certaines dépenses de santé peuvent encore atteindre un montant très élevé.
2. Le fait de travailler ou non a des conséquences non négligeables sur la situation sociale (et financière) de la personne handicapée.
3. L'accès aux soins de santé peut encore être amélioré pour certaines catégories de handicapés.
4. La répercussion du vieillissement de la population sur le secteur de la politique des handicapés.
5. Le traitement différent du handicap selon la législation ou la réglementation concernée.
Ces cinq points seront approfondis dans les exposés qui suivent.
B. Exposé de Mme Maes,
vice-présidente du Conseil supérieur
Mme Maes fait remarquer qu'elle veut aborder dans son exposé deux thèmes : le coût des soins de santé pour les handicapés et les problèmes qu'ils ont quant à l'accès au marché du travail.
1. Coût des soins
Pour certaines catégories de la population, le coût des soins reste un problème. Pour bien le mesurer, il faut le mettre en correspondance avec le revenu dont disposent les personnes et la capacité à couvrir l'ensemble des dépenses d'un ménage.
Pour ces personnes, la prise en charge d'une facture d'hospitalisation, de frais pharmaceutiques, d'orthodontie, de logopédie, de lunettes, d'aide à la mobilité, etc., devient très vite insupportable car elles ne disposent d'aucune marge de manoeuvre financière.
Les personnes en précarité financière ont en outre tendance à retarder la prise en charge d'un problème de santé en évitant la consultation de première ligne chez le médecin généraliste, en évitant les examens médicaux complémentaires. Elles rentrent dans le cercle vicieux de la sous-consommation médicale. Ceci aggrave leur état de santé et introduit en fin de compte une surconsommation. Cela est particulièrement vrai pour les personnes malades de longue durée et les personnes handicapées.
En vue d'améliorer leur situation, plusieurs mesures d'aide devraient être prises en considération :
Les médicaments génériques, meilleur marché et de qualité égale, sont insuffisamment utilisés en Belgique.
L'information des prestataires et des patients devrait être renforcée. En effet, la meilleure utilisation des médicaments génériques amènerait des réductions, tant pour les patients que pour la sécurité sociale.
Le coût des médicaments B devrait être pris en considération dans la franchise sociale ou fiscale. En effet, l'analyse de la situation de nombreuses personnes handicapées laisse apparaître des coûts importants en médicaments (environ 3 000 francs/mois) pesant sur des budgets mensuels peu élevés.
Vu la tendance à réduire les séjours à l'hôpital, la prise en charge des soins à domicile tant en termes financiers que sur le plan de la qualité de la vie et de l'accompagnement du malade et de l'entourage doit être assuré.
Perte du régime préférentiel en soins de santé
Dans le cadre du remboursement des soins de santé prévu par l'assurance maladie invalidité, une intervention majorée (souvent appelée régime préférentiel) est accordée aux personnes handicapées qui perçoivent effectivement une allocation (remplacement de revenus, allocation d'intégration, allocation de tierce personne ou allocation d'aide à la personne âgée handicapée).
Ce régime préférentiel est octroyé sans stage et sans enquête sur les revenus, quels qu'ils soient (travail, chômage, indemnité de mutuelle... perçus par la personne handicapée et/ou par la personne qui cohabite avec elle).
Si la personne handicapée perçoit un revenu professionnel supérieur au RMMIG (540 816 francs/brut) majoré du montant de l'allocation d'intégration (à laquelle elle pourrait théoriquement prétendre en fonction de son handicap), cette allocation d'intégration ne lui sera en conséquence plus octroyable.
Ne disposant plus comme ressources financières que de ses seuls revenus professionnels, cette personne ne bénéficiera plus d'un statut susceptible de lui ouvrir le droit au bénéfice de l'intervention majorée pour le remboursement des soins de santé.
Si en acceptant un travail, la personne handicapée ne touche plus aucune allocation de handicapé, elle perdra le bénéfice du régime préférentiel en soins de santé.
Pratiquement, un bénéficiaire de l'allocation d'intégration catégorie II perdra rapidement ce statut.
Or les coûts en soins de santé, liés au handicap ou à la maladie restent présents, malgré l'emploi obtenu. Sans vouloir libéraliser totalement le régime, il faut pouvoir éviter que l'accès à l'emploi soit pénalisé par une augmentation du coût des soins de santé.
2. Mesures favorisant l'emploi
En juillet 1993, une série de dispositions ont été prises afin de favoriser l'intégration sociale des personnes handicapées. Ces dispositions portent principalement sur :
la révision du système d'indexation;
la suppression de la révision d'office lors de la mise au travail de la personne handicapée pour une période de 6 mois ou moins.
le relèvement de l'abattement prévu sur les revenus professionnels de la personne handicapée.
À ce jour, nous constatons que ces mesures sont trop timides et n'encouragent pas la mise au travail. Nous pourrions dire que les personnes ont peur de prendre le risque de travailler et ainsi de perdre, selon eux, le droit à l'allocation. Il est vrai que le marché du travail a complètement évolué et qu'il n'est plus possible d'envisager de réaliser une carrière complète au même endroit.
Pourtant, la possibilité de trouver des travaux à temps partiel et/ou à durée déterminée existe. Il nous paraît important que les personnes handicapées la saisissent.
Pour encourager le travail, il serait souhaitable que lorsqu'un bénéficiaire de l'allocation travaille, les règles de cumuls restent identiques à celles en vigueur aujourd'hui. Toutefois, en cas de perte ou de cessation de travail, l'ancien bénéficiaire devrait retrouver immédiatement le même montant d'allocation que celui qu'il percevait le mois avant sa mise au travail. Ensuite la mise en ordre de sa situation aurait lieu. Cette proposition aurait pour effet de sécuriser la personne handicapée en lui démontrant qu'elle ne perd pas le droit à l'allocation.
Toujours dans une optique de promotion du travail, nous constatons aussi que les différentes autorités du pays (l'État fédéral, les communautés, les régions) prennent des mesures importantes concernant l'emploi. Ces mesures s'adressent en priorité aux chômeurs de longue durée et aux bénéficiaires du minimum de moyens d'existence. Dans l'allocation aux handicapés, la partie remplacement de revenus est équivalente au montant du minimex. Par assimilation, il serait utile que les bénéficiaires de l'allocation aux handicapés aient aussi accès à ces emplois.
M. Janssens aborde dans son exposé le problème de l'intervention majorée et celui de l'allocation aux handicapés.
1. L'intervention majorée (IM) dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité
Les personnes qui relèvent du régime IM bénéficient, en comparaison d'autres assurés AMI, d'un taux de remboursement majoré des frais exposés pour prestations médicales. Les catégories qui peuvent bénéficier de ce statut ont été étendues le 1er juillet 1997.
Avant cette extension, seuls les VIPO veuves, invalides, pensionnés et orphelins étaient admis au bénéfice de l'intervention majorée. Le terme « invalides » recouvrait uniquement les handicapés ayant droit aux allocations de l'AMI.
Les bénéficiaires des régimes d'allocations aux personnes handicapées ainsi que les enfants qui donnent droit aux allocations familiales majorées en raison d'un handicap étaient exclues.
La récente extension des catégories leur ouvre cependant le droit à l'intervention majorée. Cette intervention en faveur des personnes handicapées est largement justifiée parce que les coûts supplémentaires en soins de santé sont en général considérables.
L'intervention majorée ne s'applique cependant pas encore à toutes les personnes handicapées. Bon nombre de ces personnes, du fait qu'elles-mêmes ou leur partenaire perçoit des revenus professionnels, n'ont plus droit à l'allocation aux handicapés. Les coûts supplémentaires en soins de santé restent toutefois présents. Ces handicapés paient donc beaucoup plus pour les mêmes prestations médicales.
Un exemple :
Une femme ayant droit à une allocation de remplacement de revenus et à une allocation d'intégration catégorie 2 bénéficie d'une allocation totale de 361 099 francs par an. Elle a droit à l'intervention majorée dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité. Cette femme épouse un homme qui a un revenu net imposable de 450 000 francs par an. De ce fait, elle perd son droit à l'allocation aux handicapés et, par là, son revenu total. Elle perd en outre le droit à l'intervention majorée.
2. Allocations aux handicapés
Les problèmes qui ont été évoqués dans le cadre de l'intervention majorée de l'assurance maladie-invalidité trouvent leur origine dans le régime des allocations aux handicapés. Le régime décourage les efforts en matière d'emploi et de formation. Les handicapés qui perçoivent un revenu du travail ou qui forment un ménage avec une personne qui a un autre revenu perdent souvent leurs droits à l'allocation aux handicapés. De ce fait, ils perdent par exemple aussi leur droit à l'intervention majorée dans le cadre de l'AMI.
Ces dernières années, quelques efforts ont été accomplis pour améliorer la situation des handicapés sur le plan des revenus, mais ces efforts se situent principalement dans les allocations d'aide à la personne âgée handicapée.
Récemment est entrée en vigueur une règle en vertu de laquelle les personnes âgées isolées qui vont habiter chez leurs enfants sont encore considérées comme isolées. Cette mesure était dictée par le souci de ne pas pénaliser les personnes qui, en raison de la perte de leur autonomie, ont besoin de l'aide de leur famille. Cela signifie que le plafond de revenus, avant de toucher à l'allocation maximale, est maintenu à 261 565 francs par an, tandis que pour une personne habitant sous le même toit il correspond à 173 632 francs.
On peut néanmoins considérer qu'une personne non âgée a tout autant de raisons d'aller vivre avec ses enfants. La perte d'autonomie ne touche pas seulement les personnes âgées. Songeons par exemple aux personnes ayant un handicap progressif. En allant habiter chez leurs enfants ou parents, elles perdent d'emblée environ 87 000 francs par an sur leur revenu.
Il y a peu, une catégorie s'est ajoutée pour les personnes de plus de 65 ans. Cela représentait pour un certain nombre de personnes âgées handicapées une augmentation de l'allocation de quelque 36 000 francs par an. Cette mesure est louable. Mais pourquoi n'y a-t-il pas de budget pour prendre des mesures énergiques en faveur des handicapés d'âge actif ?
Lors des récentes discussions budgétaires, le gouvernement a prévu dans le cadre des corrections sociales une hausse de 5 % des plafonds de revenus. Ces plafonds sont cependant les mêmes depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1987. De plus, ils ne sont pas indexés. Une hausse de 5 % est par conséquent insuffisante.
Le Conseil national supérieur des handicapés estime que pour le calcul de l'allocation d'intégration, aucun autre revenu ne doit être porté en compte. Ni celui du handicapé ni celui de la personne avec laquelle il forme un ménage. L'allocation d'intégration est en effet une indemnité pour les coûts supplémentaires non chiffrables qu'une personne handicapée doit supporter. Ces coûts ne diminuent en effet pas lorsqu'on bénéficie d'un revenu du travail ou d'une autre prestation sociale.
Si aucun autre revenu n'était pris en compte pour l'octroi de l'allocation d'intégration, cela favoriserait aussi l'accessibilité des soins de santé. On aurait encore droit à un certain nombre de prestations, comme l'intervention majorée pour soins de santé, et quelques coûts supplémentaires en soins de santé des handicapés seraient en outre payés par cette intervention.
D. Exposé de M. Degodenne
membre du Conseil supérieur
M. Degodenne fait quelques réflexions sur les inégalités de traitement selon l'origine de la prise en charge du handicap.
Origines possibles des prises en charge du handicap
les allocations familiales majorées pour enfant handicapé;
le ministère de Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement;
l'INAMI;
le chômage;
les fonds communautaires (AWIPH, Fonds bruxellois, Fonds germanophone, Vlaams fonds);
le Fonds des maladies professionnelles;
le Fonds des accidents de travail;
les assurances privées.
1. Problème d'expertises ou d'évaluation du handicap
Chaque institution subsidiante a créé des critères d'évaluation médicale qui lui sont spécifiques.
En allocations familiales majorées l'enfant doit être reconnu à 66 % et/ou de 0 à 9 points de dépendance.
Il existe une liste de handicaps qui sert de guide au médecin inspecteur.
Un nombre important de familles sont « pénalisées » parce qu'elles soignent leur enfant et que les symptômes s'en trouvent diminués (pourcentage non atteint), alors que si ce traitement n'est pas poursuivi, le handicap se manifeste plus lourdement.
Au ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, avant 65 ans, il faut que l'état physique ou psychique ait réduit la capacité de gain d'une personne handicapée à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure d'effectuer sur le marché de l'emploi et/ou atteindre une échelle de dépendance de 0 à 18 points.
À l'INAMI
- en matière d'indemnités, l'incapacité de travail doit atteindre 66 % (guide BOBBI) et une indemnité complémentaire peut être obtenue sur base d'une reconnaissance d'aide de tierce personne (critères différents de ceux du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement).
- en matière de soins de santé
· les forfaits infirmiers sont accordés sur base de critères dits « grille de Katz »
· l'intervention (dépendance) majorée en kiné est accordée, à condition d'être atteint d'une pathologie reprise sur une liste déterminée (13 pathologies).
Au chômage
L'exemption du pointage est basée sur une reconnaissance par le médecin inspecteur d'un handicap de 30 %.
Aux fonds communautaires
· Fonds bruxellois
· Fonds germanophone
L'on doit répondre au critère d'intégration sociale et professionnelle.
Au Fonds des maladies professionnelles
Le pourcentage est basé sur une reconnaissance d'incapacité à travailler de 0 % à 100 % compte tenu d'un handicap repris le plus souvent sur une liste officielle.
Un complément d'allocation peut être obtenu pour raison de reconnaissance de tierce personne.
Au Fonds des accidents du travail
Le pourcentage est basé sur une reconnaissance d'incapacité à travailler de 0 % à 100 %.
Un complément d'allocation peut être obtenu pour raison de reconnaissance de tierce personne.
Assurances privées
Reconnaissance médicale par un expert sur base d'un guide appelé le BOBBI.
2. Ampleur de la prise en charge selon l'origine du handicap
Handicap à la naissance ou survenu jusqu'à 18 ans
Prises en charge possibles :
allocation familiale majorée = allocation forfaitaire de 12 173 francs à 14 245 francs, quelle que soit l'ampleur du coût du handicap.
INAMI : remboursement légal selon le statut VIPO ou non et selon la reconnaissance officielle par l'INAMI du traitement.
fonds communautaires
· remboursement de l'accompagnement pédagogique (hors horaire scolaire)
· aides individuelles
a) plafonds instaurés par les fonds
b) non-prise en charge de la part non remboursée par l'INAMI
si responsabilité civile --> assurance
a) prise en charge des suppléments non couverts par l'INAMI
b) indemnisation du manque à gagner futur
fonds communautaires
· aides individuelles
a) plafonds instaurés par les fonds
b) non-prise en charge de la part non remboursée par l'INAMI
Ces fonds interviennent déduction faite des autres interventions, mais l'intervention est limitée au plafond INAMI de même que les aménagements voiture et logement sont pris en charge.
si responsabilité civile --> assurance
a) prise en charge des suppléments non couverts par l'INAMI
Indemnisation sur base de la presque totalité du dernier salaire, selon le pourcentage obtenu.
Dans ce cas, l'indemnisation INAMI n'existe pas ou est réduite et la part non prise en charge par l'INAMI en matière de soins de santé est couverte.
Un complément d'allocation peut être obtenu pour raison de reconnaissance de tierce personne.
Au Fonds des maladies professionnelles
Indemnisation sur base de la presque totalité du dernier salaire, selon le pourcentage obtenu.
Dans ce cas, l'indemnisation INAMI n'existe pas ou est réduite et la part non prise en charge par l'INAMI en matière de soins de santé est couverte.
Un complément d'allocation peut être obtenu pour raison de reconnaissance de tierce personne.
Au Fonds des accidents du travail
Indemnisation sur base de la presque totalité du dernier salaire, selon le pourcentage obtenu.
Dans ce cas, l'indemnisation INAMI n'existe pas ou est réduite et la part non prise en charge par l'INAMI en matière de soins de santé est couverte.
Un complément d'allocation peut être obtenu pour raison de reconnaissance de tierce personne.
M. Degodenne donne ensuite un exemple concret des problèmes et des inégalités de traitement que cette situation peut entraîner. Dans la commission sous-régionale de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées (AWIPH) est venu témoigner un jeune (A) d'environ 23 ans qui est handicapé à la suite d'un accident de la circulation. Une autre personnes (B) du même âge, également handicapée depuis l'âge de 16 ans environ à la suite d'un accident de la circulation, était présente.
La personne A avait été renversée avec son vélomoteur par une voiture dont le conducteur s'était rendu coupable de délit de fuite. L'affaire est encore en instance.
La personne B se trouvait comme passager dans une voiture qui est entrée en collision avec un véhicule agricole.
La personne B, qui devait être indemnisée par une assurance privée du propriétaire du véhicule agricole ou de la voiture dans laquelle elle se trouvait, a très vite pu bénéficier d'une indemnité pour l'aménagement de son logement (environ 3 000 000 de francs), du remboursement intégral du prix d'un fauteuil roulant prescrit par un médecin (environ 120 000 francs), d'une indemnité pour l'aménagement de sa voiture et, selon toute vraisemblance, d'une somme qui lui a permis de faire des études universitaires.
La personne A, dont l'affaire n'a pas encore reçu de solution, doit recourir à l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées en vue de l'aménagement de son logement et de sa voiture et de l'acquisition d'un fauteuil roulant. Pour celui-ci, elle a touché un forfait d'environ 30 000 francs, ce qui est absolument insuffisant pour les besoins que cette personne a sur ce plan à la suite de son handicap. En ce qui concerne sont logement, elle n'a pu apporter que quelques adaptations à sa salle de bains et l'aménagement de sa voiture s'est fait sur prescription médicale.
Cette inégalité de traitement de deux personnes ayant à peu près le même handicap est difficile à comprendre. On ne peut concevoir que le médecin qui délivre la prescription pour un fauteuil roulant dans le cadre d'une assurance privée, va distribuer des cadeaux.
Un membre fait remarquer que les tickets modérateurs sur les médicaments de B ont déjà été évoqués dans le cadre de ces auditions. Ainsi, certains orateurs ont plaidé pour que ces produits soient inclus dans la franchise sociale et fiscale.
Pendant ces exposés, on a plaidé pour que l'allocation aux handicapés, à laquelle est attachée l'intervention majorée pour soins de santé, soit accordée à tous les handicapés, indépendamment de la situation familiale ou du revenu. Le système actuel comporte en effet un piège social dans la mesure où des personnes risquent de perdre leurs allocations lorsqu'elles trouvent un emploi.
Si l'on opte pour un tel système, on peut supposer qu'il sera suffisant pour couvrir le coût réel des médicaments de la personne handicapée.
M. Aerts répond que le Conseil supérieur a, dès sa création, posé en principe que l'allocations d'intégration devrait être octroyée sans enquête sur les moyens d'existence. Ce souhait n'a pas encore été réalisé en raison de restrictions budgétaires.
Indéniablement, une telle généralisation serait un pas important vers une couverture complète des besoins en matière de médicaments, bien que beaucoup dépende en l'occurence de la question de savoir ce que l'allocation d'intégration englobe exactement.
Mme Maes pense à son tour qu'un octroi généralisé de l'allocation d'intégration constituerait un important pas en avant. Quant à savoir si tous les problèmes seront ainsi réglés, cela dépendra cependant dans une importante mesure de circonstances concrètes. L'allocation d'intégration est en effet supposée couvrir toute une série de services de secours et n'y suffit généralement pas, de sorte que le handicapé doit y suppléer par ses propres moyens.
Rien d'étonnant, dès lors, que les handicapés qui doivent pendant toute leur vie s'en sortir avec un revenu de remplacement égal au minimum de moyens d'existence complété par l'allocation d'intégration, rencontrent tôt ou tard des problèmes. Le minimum de moyens d'existence n'est en effet conçu que pour couvrir un manque de revenus durant une période limitée. Il est ainsi difficile de vivre d'un revenu aussi modeste pendant une longue période, et lorsqu'une fraction de ce revenu sert encore à couvrir les coûts du handicap parce que l'allocation d'intégration n'y suffit pas, l'intéressé se retrouve dans une situation intenable.
Un membre pense qu'une importante donnée de cette discussion est incontestablement le fait que le droit à une intervention majorée est lié à l'allocation d'intégration.
Un autre estime que la demande des organisations de handicapés de ne plus subordonner l'octroi de l'allocation d'intégration au revenu est extrêmement importante. Les coûts liés à un handicap restent en effet les mêmes. Dispose-t-on de données sur les conséquences budgétaires d'une telle généralisation ?
La répercussion financière de cette généralisation serait influencée dans une importante mesure par le fait qu'à l'allocation d'intégration est également attaché le droit au remboursement majoré de médicaments et de secours. La question est de savoir si les deux éléments ne doivent pas être séparés. Ou bien on opte pour un montant général qui doit couvrir les coûts supplémentaires du handicapé, ou bien on choisit un remboursement majoré, le cas échéant intégral, de toutes les prestations dont un handicapé a besoin.
M. Aerts trouve que les deux allocations doivent être combinées parce qu'elles se rapportent à des choses différentes. L'allocation d'intégration ne pourra jamais suffire à couvrir la totalité des coûts en médicaments et moyens auxiliaires. Elle s'élève actuellement à 369 000 francs et à 607 000 francs au maximum par an selon que les handicapés ont peu ou beaucoup de problèmes d'autonomie. Sachant que ce dernier groupe comprend les personnes qui sont totalement dépendantes d'aide, un tel montant ne pourra jamais couvrir tous les besoins en médicaments et en secours.
Un membre demande si le Conseil supérieur ou les organisations qui en font partie n'ont jamais calculé, pour des handicaps spécifiques, le coût réel des soins de santé qui s'y rattache. C'est important à savoir. D'auditions antérieures il résulte en effet que le gros des coûts personnels en soins de santé est concentré chez environ 5 % des patients. C'est évidemment dans ce groupe que les plus gros problèmes se manifestent et que les efforts devraient être dirigés.
M. Aerts déclare que le Conseil comme tel n'a jamais fait ce genre de calculs. Les organisations qui en font partie disposent toutefois, à ce sujet, de chiffres qui peuvent être communiqués à la commission.
Un membre de la commission souhaite savoir si les handicapés rencontrent des difficultés lors de la conclusion de polices d'assurances, par exemple parce que les compagnies d'assurances pratiquent une politique de sélection des risques.
M. Janssens répond que l'organisation qu'il représente au sein du Conseil supérieur a récemment organisé une journée d'étude sur ce thème. Il est en effet vrai que si les handicapés peuvent conclure une police, les risques inhérents au handicap sont exclus. Une femme handicapée qui souscrit une assurance complémentaire pour frais d'hospitalisation pourra recevoir dans le cadre de cette assurance une indemnité en cas d'accouchement, par exemple, mais non pour soigner des escarres. Celles-ci sont en effet mises en rapport avec le handicap, ce qui n'est pas le cas pour un accouchement.
Le législateur fixe toutefois des limites en la matière. Toute personne qui n'a pas été hospitalisée pour une anomalie déterminée pendant une période de cinq ans ne peut être exclue d'une police sur la base d'un handicap.
En ce qui concerne les assurances du solde restant dû, la nature du handicap jouera naturellement un rôle important. Toutefois, dès qu'il y a une présomption selon laquelle les probabilités de vie peuvent être influencées d'une manière ou d'une autre, les primes sont majorées ou de telles assurances sont tout bonnement refusées.
Mme Maes remarque que la situation des handicapés à l'égard des assurances privées est particulièrement complexe. Outre les problèmes qui se posent lors de la conclusion de la police, que l'orateur précédent a relevés, il y a les difficultés qui accompagnent l'utilisation de cette police. La pratique enseigne que lors d'un accident, certains assureurs feront l'impossible pour l'attribuer au handicap, ce qui les dispense dans certains cas de payer une indemnité.
C'est notamment pourquoi il est à ses yeux essentiel que les handicapés restent couverts de manière suffisante au sein de la sécurité sociale, pour être le moins possible dépendants des assureurs privés.
Un membre demande si les orateurs ont l'impression qu'à l'heure actuelle des personnes se privent elles-mêmes de l'aide dont elles ont besoin pour raisons financières.
M. Aerts pense que c'est certainement le cas. Dans une perspective internationale, la Belgique a indéniablement encore un solide système d'assurance contre la maladie et l'invalidité. L'apport personnel des patients dans le total des dépenses est estimé aux environs de 25 %. Les coûts des soins de santé sont cependant très fortement concentrés dans certains groupes qui, de ce fait, se trouvent aux prises avec d'immenses dépenses en termes absolus. Il n'est pas étonnant que ces patients, même avec les corrections qui sont apportées pour eux dans le système, ne peuvent couvrir eux-mêmes tous leurs coûts. La solution est alors le report des soins.
L'orateur précédent souhaite savoir si, selon les membres du Conseil supérieur, le transfert du secteur des handicapés à l'INAMI a eu pour conséquence une meilleure couverture des dépenses de santé.
M. Aerts approuve le transfert, au début des années nonante, des prestations pour la réadaptation fonctionnelle individuelle de l'ancien Fonds national pour le reclassement social à l'INAMI.
Ce transfert a, surtout au début, entraîné un certain nombre de complications. Par rapport au Fonds national, l'INAMI se fondait plus, dans son approche du handicapé, sur les syndromes ou les pathologies et faisait davantage abstraction du handicap en tant que tel. De plus, certains prestations étaient assorties de conditions trop étroitement liées à l'emploi. C'est ainsi par exemple qu'un personne ne pouvait obtenir une intervention pour un fauteuil électrique que si elle travaillait.
L'INAMI y a certainement travaillé au cours des dernières années. Il est à présent possible, par exemple, d'obtenir une intervention pour un fauteuil électrique au domicile.
M. Janssens ajoute que les interventions de l'INAMI sont principalement accordées sur une base forfaitaire, tandis que pour le Fonds national le critère était plutôt le prix de revient. Pour un fauteuil roulant, par exemple, cela signifie que l'on part d'un modèle de base qui est utilisé dans les hôpitaux mais qui est absolument inutilisable dans une situation de vie normale. Le handicapé devra par conséquent faire face à une dépense supplémentaire qui peut représenter plusieurs dizaines de milliers de francs.
Son fauteuil roulant a par exemple coûté 90 000 francs hors TVA et il a reçu pour cela 25 000 francs. S'il avait choisi un modèle qui aurait accru encore plus ses possibilités de mouvement, il aurait dû débourser un montant de 150 000 à 200 000 francs. Il va sans dire que sur cette toile de fond, la question du « report de dépenses pour raisons financières » acquiert un caractère plutôt théorique.
Il y a aussi des personnes qui, dans leur situation de travail ou de logement, ont besoin de deux fauteuils roulants ou plus et, pour ces personnes, le passage à l'INAMI n'a certainement pas constitué un progrès.
Un membre demande comment les orateurs évaluent les mesures que le gouvernement vient de prendre à l'égard des patients chroniques.
M. Aerts fait remarquer que ces mesures produisent certainement leurs fruits. Il mentionne en particulier le forfait de soins de 10 000 francs et les améliorations qui ont été apportées au système de l'aide de tiers aux chefs de famille handicapés.
Dans le même temps, il démontre comment ces mesures, prises avec les meilleures intentions, peuvent être contre-productives par suite de la complexité de la législation. Il se réfère à cet égard à la mesure par laquelle les chefs de famille ayant des problèmes d'autonomie peuvent recevoir dans le cadre de l'INAMI une allocation pour aide de tiers d'un montant de 2 500 francs en ce moment et de 5 000 francs à partir de l'an 2000. Une telle allocation existait déjà pour l'isolé et les handicapés cohabitants. Si ce supplément est toutefois ajouté au revenu imposable, certains chefs de famille y perdront. Ce problème est étudié aux Finances et trouvera probablement une solution. La situation est toutefois pire lorsque ce montant est pris en considération dans l'enquête sur les moyens d'existence dans le cadre de l'allocation d'intégration. Dans ce cas, il n'est pas impossible que des personnes perdent tout ou partie de leur allocation d'intégration à la suite de cette prime. La perte pourrait alors atteindre jusqu'à 17 000 francs par an.
M. Hermesse déclare que ces dernières années, l'Alliance s'est en effet beaucoup intéressée, notamment dans le cadre de certaines études, aux problèmes de l'accès aux soins de santé, notamment pour les malades chroniques. Le travail qui a été réalisé à ce sujet n'a été possible que grâce à la collaboration des patients chroniques mêmes, lesquels sont régulièrement représentés au sein d'un groupe de travail national qui est chargé de ce problème au sein de l'Alliance.
M. Hermesse souligne que la situation des patients chroniques ne peut pas être examinée isolément, mais qu'il faut la situer dans le cadre de l'évolution générale du coût de l'assistance des patients, lequel comprend divers aspects, à savoir :
1. les coûts qui sont mis à charge des patients dans le cadre de l'assurance-maladie;
2. les différences importantes pour ce qui est de la santé et des frais de santé;
3. les corrections sociales qui ont déjà été réalisées, en faveur tant des personens démunies socialement que des malades chroniques;
4. la nécessité de tenir un débat public et de prendre des mesures supplémentaires;
5. la nécessité de s'intéresser à la qualité des soins et à la qualité de la vie.
Le problème de l'accès aux soins de santé n'est donc pas un simple problème de moyens financiers. La qualité de la vie des intéressés et l'assistance qui leur est offerte sont des facteurs tout aussi importants. La solitude, par exemple, qui s'aggrave dans notre société, et dont les malades chroniques en particulier souffrent de plus en plus, est un problème que l'on ne peut ignorer.
1. Le coût à charge du patient
1.1. Une contribution personnelle totale de 150 milliards
L'INAMI a remboursé un montant total de 442 milliards de francs en soins médicaux. (Avant 1999, ce montant était estimé à 478 milliards de francs.) Le tableau ci-dessous indique qu'en 1996, les dépenses médicales totales s'élevaient à 595,7 milliards de francs, dont le patient a donc supporté 153,7 milliards de francs qui sont répartis comme suit :
| Montant (en milliards de francs) |
% du total |
|
| Remboursement (INAMI) | 442 | 74,2 |
| Médicaments non remboursables | 64 | 10,7 |
| Ticket modérateur | 62 | 10,4 |
| Indépendants petits risques | 9,7 | 1,6 |
| Suppléments | 18 | 1,6 |
Total : 595,7 (dont 153,7 à charge du patient)
Les médicaments non remboursables ne représentent pas moins de 64 milliards, soit 10,7 % de l'ensemble du budget santé. C'est important. Si l'on réduisait le ticket modérateur pour les médicaments, cette mesure n'aurait aucune influence pour ce qui est des médicaments non remboursables, puisque il s'agit de médicaments dont le coût est entièrement supporté par le patient.
Les tickets modérateurs représentent une dépense de 62 milliards de francs pour les patients. Les cotisations personnelles pour les petits risques dans le secteur des indépendants représentent un montant de 9,7 milliards de francs et les patients payent finalement 18 milliards de francs de suppléments, qui ne concernent pas uniquement les chambres individuelles. C'est ainsi que les prothèses de la hanche sont remboursées sur une base forfaitaire, mais que la loi ne précise pas ce qui en sus de ce montant peut être facturé à la charge du patient. Par conséquent, une majoration des forfaits ne constituerait pas nécessairement un avantage pour le patient. Pour l'heure, l'on n'a aucune prise sur ce problème.
La structure de ce tableau est importante pour une autre raison. Si l'autorité prenait la décision de réduire les charges pour les patients, par l'intermédiaire de la franchise sociale ou fiscale ou en étendant le régime préférentiel, elle ne vaudrait pas pour ce qui est des 64 milliards que représentent les médicaments non remboursables ou les 18 milliards de supplément. Il n'y a aucun remboursement pour ce qui est du matériel distribué aux personnes incontinentes et, dès lors les mesures en question n'apporteraient aucune amélioration en ce qui les concerne.
Des 153 milliards qui tombent à charge des patients, 25 milliards peuvent être imputés à la médecine hospitalière. Le quart des patients hospitalisés payent plus de 10 000 francs de leur poche quel que soit le type de chambres qu'ils occupent. En moyenne, ils payent au total 23 000 francs.
1.2. Concentration élevée des coûts
L'on a découvert un deuxième élément important en constatant que les 153 milliards susvisés, lesquels représentent environ 25 % du total des dépenses de soins de santé qui sont à charge du patient, sont très concentrés, comme le montre la courbe de Lorenz concernant la répartition des dépenses en 1996 :
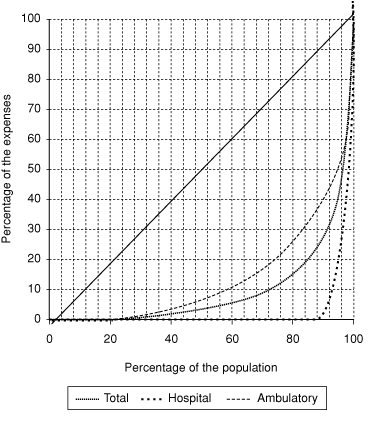
Cette courbe a été établie sur la base de données exhaustives concernant les 4,5 millions de membres de l'Alliance. 20 % de ces membres n'ont aucune dépense personnelle de soins de santé. Un groupe de 40 % représente 5 % des dépenses. Inversement, les 5 % de patients qui exposent les frais les plus élevés, représentent 55 % des dépenses. Cela indique qu'il y a une forte concentration des dépenses. Le phénomène prendrait encore plus de relief dans la courbe relative aux services comme les soins à domicile où la totalité des dépenses est exposée par 5 % des patients.
Du point de vue politique, cela signifie que l'incidence d'une augmentation ou d'un allégement du ticket modérateur est répercutée de manière uniforme à charge de l'ensemble de la population.
1.3. Forte augmentation de l'intervention personnelle des patients au cours des années 90.
Toute une série de mesures distinctes, qui ont été prises dans le courant des années 90, ont entraîné une augmentation de 11 613 milliards de francs de la part des patients dans les dépenses de sécurité sociale. La majoration du forfait en biologie clinique de 150 francs par prescription a eu un impact global de 540 millions de francs. La mesure la plus radicale a été l'augmentation du ticket modérateur à payer en cas de consultation ou de visite à domicile des médecins généralistes et des spécialistes, laquelle a entraîné, pour les patients, une charge supplémentaire de 3 315 milliards de francs.
Autrement dit, les pouvoirs publics ont déplacé petit à petit le poids des charges vers les patients, et ce, au moyen de mesures globales. En partant du souci d'assurer l'accès aux soins de santé à certains groupes de patients, l'on peut se demander s'il n'eût pas été préférable de poser des choix clairs, comme certains pays l'ont fait, en axant les mesures d'économie sur des prestations spécifiques.
Modifications du ticket modérateur depuis 1993
1er octobre 1993. Hausse du ticket modérateur pour honoraire de surveillance (sauf pour VIPO) de 0 à 133 francs pour les cinq premiers jours; de 0 à 66 francs du 6e au 12e jour et de 0 à 200 francs pour surveillance en médecine interne.
effet macro : 1 260 millions de francs
1er octobre 1993. Hausse des forfaits en biologie clinique par prescription de 300 à 450 francs (sauf VIPO).
effet macro : 540 millions de francs
1er octobre 1993. Hausse du ticket modérateur par consultation en radiologie ambulatoire de 200 à 300 francs.
effet macro : 120 millions de francs
1er octobre 1993. Introduction d'un ticket modérateur pour les prestations ambulatoires spéciales : 15 % avec un plafond de 350 francs.
effet macro : 1 770 millions de francs
1er octobre 1993. Introduction d'un forfait de 1 000 francs par hospitalisation (sauf VIPO).
effet macro : 1 000 millions de francs
1er octobre 1993. Hausse du forfait par hospitalisation pour la radiologie de 150 à 250 francs et pour la biologie clinique de 0 à 300 francs (sauf VIPO).
effet macro : 413 millions de francs
1er janvier 1994. Hausse du ticket modérateur pour :
consultation généraliste : 103 (39 = VIPO) à 156 (40);
visite généraliste : 166 (51) à 229 (52);
consultation spécialiste : 202 (69) à 330 (70);
consultation psychiatre : 253 (69) à 413 (70).
effet macro : 3 315 millions de francs
1er mai 1994. Hausse des plafonds des tickets modérateurs pour les médicaments remboursés (catégoire B : de 230 à 235 pour les VIPO et de 345 à 355 pour les TIP-catégorie C, respectivement de 345 à 355 et de 575 à 590).
effet macro : 50 millions de francs
1er janvier 1996. Hausse des plafonds des tickets modérateurs pour les médicaments remboursés (catégorie B : de 235 à 245 pour les VIPO et de 355 à 370 pour les TIP-catégorie C, respectivement de 355 à 370 et de 575 à 615).
effet macro : 50 millions de francs
1er janvier 1997. Majoration du ticket modérateur pour les prestations radiologiques 460703/460795, de 250 à 300 (sauf VIPO).
1er janvier 1997. Introduction d'un ticket modérateur pour les prestations relatives à l'imagerie médicale (ambulatoire) : 12 % des honoraires avec un maximum de 100 francs par acte (sauf VIPO).
1er janvier 1997. Introduction d'un forfait de 500 francs par admission dans un établissement pour prestations médicales spéciales visées au chapitre V (sauf pour VIPO).
effet macro des trois mesures : 1 200 millions de francs
1er avril 1997. Diminution de l'intervention de l'INAMI dans les honoraires de biologie clinique. Le ticket modérateur passe de 450 à 400, 450 ou 500 francs en fonction du numéro de nomenclature concerné.
effet macro : 292 millions de francs
1er janvier 1997. Réduction de l'intervention de l'INAMI dans les honoraires de biologie clinique. Le ticket modérateur passe de 450 à 380, 500 ou 600 francs selon le numéro de nomenclature concerné.
effet macro : 365 millions de francs
1er janvier 1997. Réduction de 450 francs par jour de l'intervention de l'INAMI dans l'hospitalisation. Réduction limitée à 150 francs pour les VIPO et les enfants à charge.
1er janvier 1997. Majoration du forfait payé par le patient pour une hospitalisation : de 1 000 à 1 100 francs (sauf VIPO).
effet macro des deux mesures : 1 500 millions de francs.
1er janvier 1997. Hausse des plafonds des tickets modérateurs pour les médicaments remboursés (catégoire B : de 245 à 250 pour les VIPO et de 370 à 375 pour les TIP-catégorie C, respectivement de 370 à 375 et de 615 à 625).
effet macro : 30 millions de francs
1er février 1997. Hausse des tickets modérateurs pour chaussures orthopédiques : catégorie A de 0 à 500 francs, catégorie B de 1 500 à 2 000 francs, catégorie C de 2 000 à 2 500 francs et catégorie D de 500 à 1 000 francs.
effet macro : 14,5 millions de francs
1er avril 1994. Diminution de l'intervention de l'INAMI en cas d'hospitalisation de 450 francs par jour [au lieu de 366 (du 1er jour au 8º jour)], 259 (du 9e au 90e jour) ou 490 (à partir du 91e jour). Réduction de 150 francs pour les titulaires de l'intervention majorée et les chômeurs de longue durée (au moins 12 mois) (au lieu de 156, 103 et 226) et pour les enfants ayant la qualité de personne à charge (au lieu de 156, 103 et 490).
1er avril 1994. Hausse du montant forfaitaire payé par le patient à l'admission dans un hôpital de 1 000 à 1 100 francs (sauf pour les bénéficiaires de l'intervention majorée).
effet macro des deux mesures : 1 045 millions de francs
effet macro total : 12 964,5 millions de francs
Il faut évidemment tenir compte du fait que ces mesures sont récurrentes et que l'effet financier d'une mesure décidée en 93 s'applique aux années 93, 94, 95, 96 ... On estime par exemple à 8 milliards la hausse de la participation du patient pour la seule année 94. Cela signifie qu'en 97, les patients débourseront au moins 8 milliards de tickets modérateurs en plus qu'en 1993. Cependant, à ces 8 milliards, il faut ajouter l'effet des mesures prises en 95, 96 et 97 : environ 2 630 millions.
On peut donc conclure que la charge qui incombe au patient en 1997 dépasse celle de 1993 de 10,5 à 11 milliards.
NB : Ces montants sont basés sur des estimations présentées par le gouvernement ou les services de l'INAMI. Une étude interne doit viser la détermination précise de la charge totale pour le patient.
1.4. L'étude de la l'ANMC sur le coût des soins de santé
Une étude réalisée par l'ANMC auprès de 1 150 patients atteints de maladies chroniques fournit encore une série de données relatives aux dépenses à charge de ce groupe.
1.4.1 La quote-part des diverses prestations de santé à charge des personnes atteintes d'une affection chronique et les dépenses de l'assurance maladie-invalidité afférentes à ces mêmes prestations
Il ressort du tableau ci-dessous que ces 1 150 patients atteints d'une maladie chronique ont payé un ticket modérateur moyen de 19 820 francs par an. En outre, ces patients ont dû prendre à leur charge une quote-part personnelle de 25 816 francs en moyenne, au titre des prestations non remboursables. L'assurance maladie a remboursé pour ces patients une moyenne de 702 023 francs par an. Ceci démontre une nouvelle fois la concentration des dépenses d'aide médicale chez certains groupes de patients.
Coût pour les malades chroniques (1)
(Moyenne des 1 150 malades
chroniques sondés)
| Ticket modérateur Remgeld |
Quote-part personnelle Pers. bijdrage |
Dépenses AMI Uitgaven ZIV |
|
| Kiné. Kine | 5 400 | 5 839 | 29 068 |
| Prix de la journée d'entretien. Ligdagprijs | 5 378 | 5 887 | 303 252 |
| Médecin de famille. Huisarts | 3 087 | 3 239 | 9 223 |
| Spécialiste Specialist | 1 578 | 2 328 | 3 555 |
| Soins dentaires. Tandzorg | 443 | 638 | 2 267 |
| Soins à domicile. Thuisverpleging | 437 | 441 | 42 573 |
| Revalidation. Revalidatie | 178 | 187 | 4 216 |
| Médicaments, hospitalisation. Medicatie, hospitalisatie | 52 | 1 139 | 62 740 |
| Chirurgie. Heelkunde | 55 | 829 | 15 364 |
| Rest. para-méd. Para-med. rest. | 16 | 1 439 | 11 312 |
| Total. Totaal | 19 820 | 25 816 | 702 023 |
(1) Statut-L 28 %, dialyse rénale 23 %, malades parkinson 25 % et malades ticket modérateur 2 × 15 000 francs 25 %.
+ Médicaments, ambulatoire : intervention pers. : 19 929; dépenses AMI : 65 270.
Ce tableau ne présente cependant que les moyennes. Il y a également d'importants écarts dans le schéma des dépenses au sein du groupe des patients atteints d'une affection chronique.
1.4.2. Coût annuel total des malades chroniques et répartition des malades chroniques en fonction de la hauteur des frais qu'ils engendrent
Coût annuel total des malades chroniques
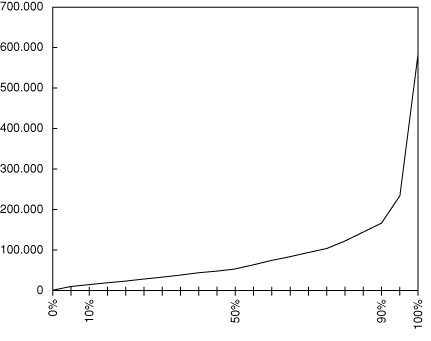
Moyenne : 77 272
Minimum : 1 092
Maximum : 606 008
0 % : 1 092
5 % : 10 400
10 % : 14 612
18 720
22 828
25 % : 26 988
32 032
37 076
42 120
47 164
50 % : 52 260
61 984
71 708
81 432
91 156
75 % : 100 932
121 992
143 052
90 % : 164 060
95 % : 228 332
100 % : 606 008
Ces données concernent les frais à charge des malades chroniques. On constate également des écarts importants au sein de ce groupe. Pour 5 % d'entre eux, les frais non pris en charge s'élèvent annuellement de 1 092 à 10 400 francs, mais pour les autres 5 %, les frais non pris en charge varient entre 228 332 et 606 008 francs par an. Il importe de connaître l'existence de ces écarts lorsque l'on veut mener une politique plus ciblée vis-à-vis de ce groupe.
1.4.3. Les 25 % de malades engendrent les frais les plus élevés
Le tableau suivant présente la répartition des frais non remboursables pour les 25 % de malades chroniques qui engendrent les frais les plus élevés.
25 % des malades engendrant les frais les plus élevés :
coût annuel moyen
(7)
| % | |||
| Traitement ambulatoire et avec hospitalisation. Ambulante en intramurale verzorging | 32 776 | 50 | |
| Médicaments. Medicatie | 33 254 | 50 | |
| Total des frais de soins de santé. Totale kost gezondheidszorg | 66 030 | 36 | 100 |
| Produits de soins. Verzorgingsprodukten | 24 486 | 21 | |
| Service à domicile. Dienstverlening aan huis | 56 336 | 48 | |
| Aides techniques. Hulpmiddelen | 9 890 | 8 | |
| Distribution de repas. Maaltijdbedeling | 8 283 | 7 | |
| Accueil hors domicile + transport. Opvang buitenshuis + vervoer | 18 386 | 16 | |
| Frais de dépendance. Afhankelijkheidskosten | 117 380 | 64 | 100 |
| Total. Totaal | 183 409 | 100 |
Le coût annuel moyen des soins de santé s'élève, pour ce groupe, à 66 030 francs. En ce qui concerne les médicaments, le montant de 33 254 francs comprend non seulement les tickets modérateurs mais aussi les médicaments non remboursables.
Les malades de ce groupe doivent toutefois payer en moyenne un total de 183 409 francs par an de leurs deniers. Ceci montre que les problèmes des malades chroniques vont bien au-delà de la seule aide médicale.
1.4.4. Malades chroniques avec ou sans indication de dépendance
Le tableau suivant isole tout d'abord au sein du groupe des 1 150 malades chroniques ceux qui, durant deux années consécutives, ont dépassé le montant de 15 000 francs en termes de ticket modérateur (= la franchise sociale). Alors que le coût moyen à charge du patient s'élève à 77 293 francs pour tous les malades chroniques, il atteint déjà 97 626 francs pour ce sous-groupe.
Si l'on forme un autre sous-groupe composé des patients fortement dépendants pour lesquels un infirmier reçoit le forfait B, la quote-part personnelle passe à 132 170 francs. Enfin, si l'on combine les deux sous-groupes, à savoir celui des patients dont la quote-part excède 15 000 francs pendant deux années consécutives et ceux qui donnent droit au forfait B, les frais non pris en charge s'élèvent à 150 309 francs par an.
Dépenses de santé
Malades chroniques avec et sans indication de dépendance
| 1 150 maladies chroniques 1 150 chronisch zieken |
2 × 15 000 francs par groupe 2 × 15 000 frank- groep |
Forfait-B par groupe Forfait-B- groep |
Forfait B+2 × 15 000 par groupe Forfait B+2 × 15 000 groep |
|
| Ticket modérateur hors médicaments. Remgeld buiten medicatie | 19 760 | 37 940 | 24 197 | 51 994 |
| Ticket modérateur médicaments. Remgeld medicatie | 18 928 | 17 872 | 24 176 | 21 504 |
| Total frais AMI. Totale ZIV-kosten | 38 688 (50 %) | 64 044 (65 %) | 53 494 (40 %) | 77 048 (51 %) |
| Frais de dépendance. Kosten afhankelijkheid | 38 631 (50 %) | 33 581 (35 %) | 78 676 (60 %) | 73 261 (49 %) |
| Total. Totaal | 77 293 | 97 626 | 132 170 | 150 309 |
À la lumière de ces données, l'union nationale a émis l'avis que les 10 000 francs mis à partir de cette année à la disposition d'une série de malades chroniques aillent en premier lieu à ce sous-groupe. En fin de compte, il ne s'agit d'ailleurs ici que d'un allégement très limité des frais à charge de ces patients.
1.5. La franchise sociale et la franchise fiscale en 1997 rapportées au groupe social
Le tableau suivant présente les montants des tickets modérateurs qui n'ont pas dû être payés en 1997 par les membres de l'ANMC du fait de l'application de la franchise sociale. Le surcoût pour l'INAMI s'élève à 263 025 777 francs pour 27 464 ménages, ce qui revient à 9 577 francs par ménage. Il s'agit d'un groupe représentant 5,10 % de tous les membres de l'ANMC.
La franchise sociale en 1997
Analyse par groupe social (affiliés ANMC)
| Groupe social Sociale groep |
Montant total Totaal bedrag |
Nombre de ménages mutualistes Aantal mutualistische gezinnen |
% du groupe social % van de sociale groep |
Moyenne par ménage mutualiste Gemiddeld per mutualistisch gezin |
| Minimum de moyens d'existence Bestaansminimum | 16 135 788 | 1 086 | 5,88 | 14 858 |
| Revenu garanti Gewaarborgd inkomen | 18 882 720 | 2 592 | 4,29 | 7 285 |
| Intervention handicapés Tegemoetkoming gehandicapten | 54 892 194 | 5 334 | 7,87 | 10 291 |
| Allocations familiales majorées Verhoogde kinderbijslag | 9 387 372 | 708 | 10,77 | 13 259 |
| Chômeurs complets Volledig werklozen | 85 917 000 | 9 750 | 8,69 | 8 812 |
| VIPO 100 WIGW 100 | 171 583 314 | 16 527 | 3,91 | 10 382 |
| Total Totaal | 263 025 777 | 27 464 | 5,10 | 9 577 |
Il ressort d'une analyse des données relatives à la franchise fiscale pour l'ensemble de la Belgique qu'en 1997, un montant de 2 226 909 405 francs a été remboursé pour l'année 1994, soit en moyenne 14 360 francs par ménage pour un total de 155 075 ménages. Le fait que cela ne concerne que 3,60 % du nombre total des ménages fiscaux de même revenu, est une fois encore révélateur de la concentration des dépenses en matière de soins de santé.
La franchise fiscale en 1997 : Belgique
Remboursements 1994
| Revenu en 1 000 BEF Inkomen in 1 000 BEF |
Montant total Totaal bedrag |
Nombre de ménages fiscaux Aantal fiscale gezinnen |
% de ménages fiscaux ayant le même revenu % van fiscale gezinnen met zelfde inkomen |
Moyenne par ménage fiscal Gemiddeld per fiscaal gezin |
| < 538 | 894 084 418 | 67 411 | 5,25 | 13 263 |
| 538-828,9 | 951 700 115 | 66 667 | 5,30 | 14 275 |
| 829-1 119,9 | 248 958 730 | 14 969 | 2,08 | 16 632 |
| 1 120-1 410,9 | 70 130 931 | 3 505 | 5,20 | 20 009 |
| >=1 411 | 62 035 211 | 2 523 | 4,10 | 24 588 |
| 2 226 909 405 | 155 075 | 3,60 | 14 360 |
Il faut d'ailleurs tenir compte dans tout ceci du fait que la franchise sociale et la franchise fiscale ne portent que sur les tickets modérateurs et n'entraînent donc aucun allégement des frais afférents par exemple aux prestations non remboursables.
2. Différences d'état de santé
et de frais de santé
Il ressort d'une étude réalisée voici plusieurs années par l'union nationale et publiée dans le « M-Informatiedossier » nº 25 sous le titre « Gezondheid en sociale ongelijkheid », que dans le domaine de la santé, tous les Belges ne sont pas égaux. Les classes socio-économiques inférieures vivent en moyenne cinq années de moins que les classes économiquement plus aisées et souffrent davantage de certaines affections. Cette problématique est très complexe et il serait illusoire d'espérer que ces écarts disparaîtront si l'on instaure la gratuité des soins de santé pour ces groupes. La politique en matière de logement, de protection de la jeunesse, etc., est tout aussi importante à cet égard.
Une enquête réalisée auprès de 10 000 personnes révèle, par exemple, des écarts importants dans la manière dont les gens évaluent leur état de santé, en fonction du niveau de formation. Sur les personnes du groupe cible qui n'ont suivi que l'enseignement primaire, 40 % jugent leur état de santé très mauvais, mauvais ou raisonnable, tandis que chez les diplômés de l'enseignement supérieur ce nombre n'est que de 12 %.
Perception de l'état de santé en fonction
du degré de formation
Très mauvais, mauvais ou raisonnable
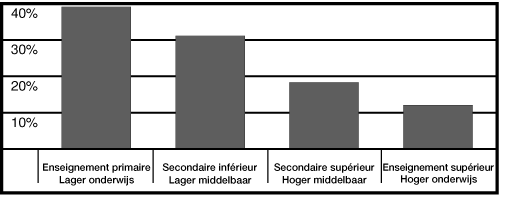
La situation est identique lorsque l'on examine l'état de santé en fonction du revenu du ménage. Plus le revenu diminue, plus la quote-part des personnes atteintes d'une ou plusieurs affections chroniques ou d'une ou plusieurs limitations fonctionnelles durables, augmente.
État de santé en fonction
du revenu net du ménage
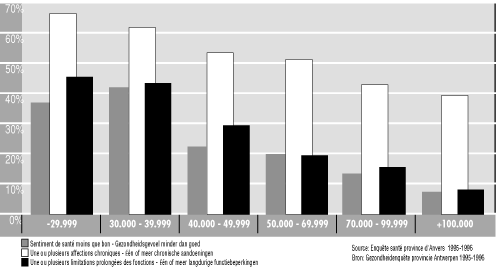
On retrouve le même schéma dans la consommation médicale.
Consommation médicale au cours de l'année écoulée,
en fonction du revenu net du ménage
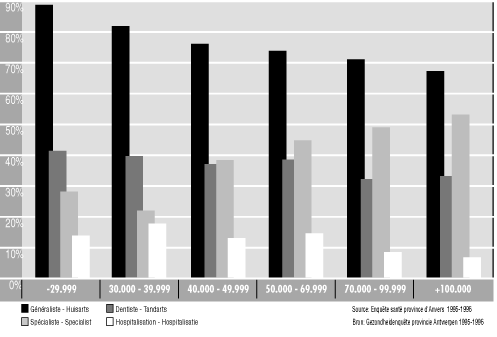
Il est frappant de constater qu'en ce qui concerne certaines affections, l'on note également d'importantes différences d'une région à l'autre. La carte montre qu'il y a de grandes différences régionales pour ce qui est du traitement de ces affections. Quant à la recherche des causes de ces différences, c'est un autre problème.
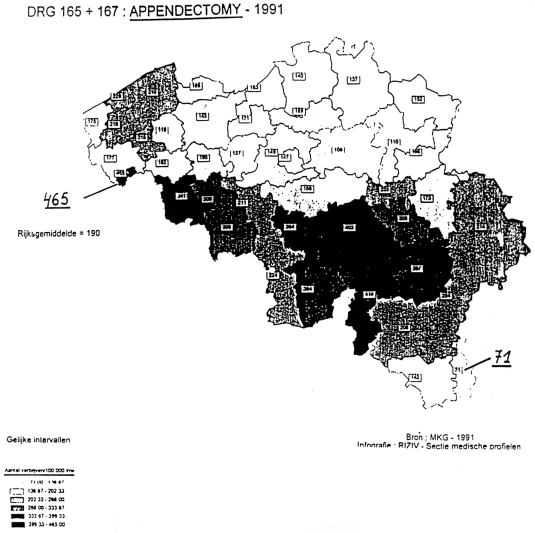
L'union nationale a réalisé une étude sur le taux de mortalité (corrigé en fonction de l'âge et du sexe) par mutualité; en l'espèce aussi certains écarts sont étonnamment marqués. La mortalité réelle a été comparée à la mortalité standardisée (c'est-à-dire la mortalité prévisible compte tenu de l'âge et du sexe des membres de ces mutualités). L'on constate que certaines mutualités se situent 15 % en-dessous de cette norme et d'autres, 15 % au-dessus. Un tel constat soulève pour le moins des questions. Il serait illusoire d'espérer pouvoir gommer ces écarts simplement en augmentant l'offre médicale dans les régions concernées ou en la rendant moins coûteuse. Les causes sont en effet plus profondes.
Taux de mortalité (pondéré en fonction de l'âge
et du sexe) par mutuelle (100 = moyenne ANMC)
Régime des salariés 1992-1993
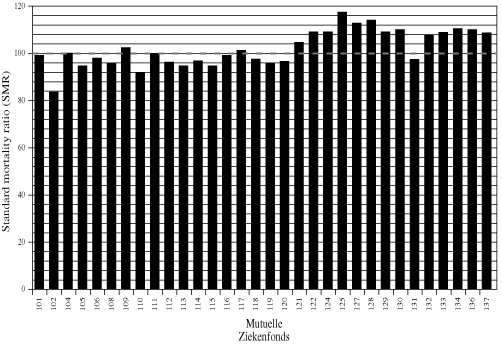
3. Corrections sociales déjà réalisées tant en faveur des défavorisés que des malades chroniques
3.1. La franchise sociale et fiscale en 1994
3.1.1. Franchise sociale
Bénéficiaires
Personnes percevant l'intervention majorée (indiquées comme « régime préférentiel », voir fiche concernée) + les chômeurs complets (si isolés ou chef de famille, à partir de 6 mois de chômage).
De façon plus concrète.
Le ticket modérateur maximum à payer pour les personnes concernées est fixé à 15 000 francs par ménage.
Au-delà de ce plafond, le ticket modérateur est entièrement remboursé par la mutualité.
3.1.2. Franchise fiscale
Bénéficiaires
Tous les bénéficiaires qui ne peuvent pas bénéficier de la franchise sociale.
Le ticket modérateur maximum à payer par les personnes concernées dépend de leur revenu familial net imposable.
Le ticket modérateur au-delà de ce plafond est entièrement remboursé par le biais du fisc.
Les plafonds sont fixés comme suit :
| Plafonds imposables | Revenus du ménage |
| 15 000 F | 0-537 999 F |
| 20 000 F | 538 000 à 828 999 F |
| 30 000 F | 829 000 à 1 119 999 F |
| 40 000 F | 1 120 000 à 1 410 999 F |
| 50 000 F | à partir de 1 411 000 F |
3.1.3. Franchise sociale et fiscale
· L'intervention personnelle pour les médicaments n'est pas encore intégrée dans la franchise.
· Intervention personnelle dans le prix de journée en cas d'hospitalisation.
Uniquement intégrée dans la franchise sociale.
Avec limitation aux 90 premiers jours pour les admissions dans un hôpital général et à la première année pour les admissions dans un hôpital psychiatrique.
· Ne sont pas intégrés non plus :
Les frais de séjour dans une maison de repos, une maison de repos et de soins, dans un logement protégé et lors de cures thermales.
Suppléments.
Soins à l'étranger.
3.2. L'intervention majorée en 1997
(Équivalent du « régime préférentiel »)
| Avantage Voordeel |
Bénéficiaires Rechthebbenden |
Conditions de revenus Inkomensvoorwaarden |
| Intervention personnelle réduite pour. Verlaagd persoonlijk aandeel voor :
· La plupart des prestations médicales. De meeste geneeskundige prestaties · Les médicaments de la catégorie B et C. Medicatie van de B- en C-categorie · Les hospitalisations. Ziekenhuisopnames |
1. VIPO. WIGW's :
· Veuves/veufs. Weduwen/weduwnaars · Invalides. Invaliden · Pensionnés. Gepensioneerden · Orphelins. Wezen 2. Anciens coloniaux, les ex-personnes non-protégées et les religieux (> 60/65 ans). Oud-kolonialen, de vroegere niet-beschermde personen en de kloosterlingen (> 60/65 jaar) 3. Allocations familiales majorées pour les enfants handicapés. Verhoogde kinderbijslag voor gehandicapte kinderen |
Revenus du ménage : inférieur à 465 211 francs brut + 86 123 francs par personne à charge. Gezinsinkomen : niet hoger dan 465 211 frank bruto + 86 123 frank per persoon ten laste (1) |
| Éventuellement droit à un certain nombre d'autres avantages sociaux tels que. Eventueel recht op een aantal voorzieningen, zoals :
· Tarif social pour le téléphone. Sociaal telefoontarief · Réducation sur les transports en commun. Reductie op het openbaar vervoer |
4. Ayants droit. Rechthebbenden op :
· Au revenu garanti pour personnes âgées. Het gewaarborgd inkomen voor bejaarden · À l'allocation pour handicapés. De tegemoetkoming aan gehandicapten |
Pas de conditions de revenus supplémentaires. Geen bijkomende inkomensvoorwaarden |
| 5. Minimum d'existence ou allocataires du CPAS. Bestaansminimum- of steuntrekkers van het OCMW | Pas de conditions de revenus supplémentaires. Geen bijkomende inkomensvoorwaarden | |
| 6. + les personnes à charge des groupes de personnes mentionnées ci-dessus. + de personen ten laste van de hogervermelde groepen personen | Pas de conditions de revenus supplémentaires. Geen bijkomende inkomensvoorwaarden |
(1) Montants au 1er octobre 1997.
3.3. L'extension de la possibilité d'application du régime du tiers payant en 1997
| Avantage Voordeel |
Bénéficiaires Rechthebbenden |
Conditions Voorwaarden |
| Possibilité d'application du régime du tiers payant notamment pour : Mogelijkheid tot toepassing van de derde betalende regeling onder andere voor :
· Conseils, consultations et visites des médecins. Adviezen, raadplegingen en bezoeken van geneesheren · Diverses prestations dentaires. Allerlei tandheelkundige prestaties |
1. Bénéficiaires de l'intervention majorée (« régime préférentiel », voir fiche concernée). Rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkomingen (tot voor kort aangeduid als « voorkeurregeling », zie de betreffende fiche) | Attestation du titulaire à la franchise sociale (à demander par le titulaire auprès de sa mutualité). Attest van gerechtigde op de sociale franchise (door de gerechtigde aan te vragen bij zijn/haar ziekenfonds) |
| 2. Chômeurs complets. Volledig werklozen :
· Si isolé ou chef de famille. Indien alleenstaand of gezinshoofd · À partir de 6 mois de chômage. Vanaf 6 maand werkloosheid |
Attestation du titulaire à la franchise sociale (à demander par le titulaire auprès de sa mutualité). Attest van gerechtigde op de sociale franchise (door de gerechtigde aan te vragen bij zijn/haar ziekenfonds) | |
| 3. Personnes séjournant dans des établissements spécialisés dans les soins pour enfants, personnes âgées ou handicapées. Residenten van inrichtingen, gespecialiseerd in de verzorging van kinderen, bejaarden of mindervaliden (1) | ||
| 4. Personnes dans le coma ou qui décèdent pendant le traitement. Personen in coma of die tijdens de behandeling overlijden | ||
| 5. Personnes se trouvant dans des situations de détresse financière. Personen in individuele financiële noodsituatie |
(1) Par exemple, IMP, maisons de repos, maisons de repos et de soins, centres de rééducations, ...
3.4. Mesures en faveur des malades chroniques
| Mesures | Budget à prévoir (en millions) |
| · Une indemnité globale de 10 000 francs par an pour couvrir les coûts liés à la santé en faveur des malades chroniques ayant des coûts élevés et multiples | 520 |
| · Un forfait de 10 000 francs par an pour les personnes souffrant d'incontinence pendant une longue période | 220 |
| · Un meilleur remboursement des tricycles électroniques ainsi que des chaises roulantes actives et électroniques | 120 |
| · Une intervention forfaitaire pour les chefs de famille en incapacité de travail ou invalides qui ont besoin de « l'aide d'une tierce personne » | 164 à 328 |
| · Une réduction sélective de la TVA sur les aides techniques achetées par une personne dépendante de soins | 20 |
| · Mesures spéciales pour des affections spécifiques | 100 à 220 |
| · Une intervention en faveur des personnes âgées isolées qui vont cohabiter avec des alliés au premier et deuxième degrés | 200 |
En ce qui concerne les mesures en faveur des malades chroniques, l'on peut relever que ceux d'entre eux qui sont sources de « coûts combinés élevés » constituent le groupe auquel il a déjà été fait référence, à savoir celui des patients qui ont payé pour plus de 15 000 francs de ticket modérateur pendant deux années successives et qui donnent droit au forfait B. L'intervention de 10 000 francs pour les personnes incontinentes pendant plus de trois mois est plus que justifiée. L'on peut en effet admettre que les frais à charge de ces patients sont d'environ 40 000 francs sur une base annuelle. Le but poursuivi est, en tout état de cause, d'étudier plus avant le groupe qui peut actuellement prétendre à cette intervention de 10 000 francs, afin de vérifier si ces moyens sont alloués aux bons patients.
Toutes ces mesures sont applicables actuellement, à l'exception des mesures spéciales concernant les affections chroniques spécifiques.
4. Nécessité d'un débat public Mesures générales et spécifiques complémentaires
Les mesures applicables aux patients chroniques n'ont une utilité que si elles sont prises dans un cadre général. Des interventions ponctuelles ou partielles ne permettent pas de répondre aux problèmes fondamentaux qui se manifestent.
Cela signifie qu'il faut faire des choix, en tenant compte du paradigme suivant :
Le progrès technologique (c'est-à-dire les nouveaux médicaments et les nouveaux équipements médicaux) dans le contexte d'un budget fixe et de chômage, sans débat organisé sur l'évaluation en termes de résultats et sur les priorités en soins de santé, conduit nécessairement à une réduction de l'accès aux soins et peut-être à une aggravation des inégalités face à la santé.
Qu'est-ce que cela signifie ?
L'on ne cesse de voir sortir des médicaments nouveaux, par exemple des médicaments à utiliser dans le cadre de la lutte contre le cancer et qui coûtent une fortune. Il en va évidemment de même pour ce qui est des nouvelles technologies et des nouveaux appareillages.
Cette évolution s'inscrit dans un cadre financier subordonnant l'augmentation des dépenses au respect d'une norme fixe.
Cette évolution se déroule également dans une situation de chômage endémique. L'argument avancé pour justifier le remboursement des nouvelles techniques coûteuses est souvent celui du gain qu'elles procurent en termes de journées d'hospitalisation. Le gain en journées d'hospitalisation entraîne, à une plus grande échelle, des suppressions de lits d'hôpitaux. Il y a bel et bien eu des suppressions, mais les effectifs des hôpitaux n'ont pas diminué dans la même mesure. L'on constate au contraire une augmentation des frais de personnel dans les hôpitaux.
Il n'y a actuellement aucun véritable débat en termes de résultats sur les objectifs prioritaires à atteindre. Le remboursement des médicaments ne s'effectue pas toujours sur une base rationnelle. Il arrive que des produits dont il est établi qu'ils n'ont aucun effet, soient remboursés sous la pression des médias qui sont manipulés par l'industrie pharmaceutique. Le remboursement du médicament « Zocor » destiné aux personnes de plus de 70 ans, en est un bel exemple.
Conclusion : pareille situation engendre une limitation de l'accessibilité des soins et peut-être une accentuation des inégalités dans le domaine de la santé. Pour le groupe des malades chroniques, cela signifie que, si l'on ne fait pas de choix clairs, ce seront en définitive les plus faibles de ce groupe qui payeront la facture. Dans le contexte actuel, si l'on attribue une indemnité de 10 000 francs à tous les malades chroniques, les moyens affectés à cette mesure ne peuvent pas être utilisés pour le remboursement de nouveaux médicaments coûteux qui risquent de peser plus lourd dans les finances d'un groupe limité de patients.
La nécessité de faire des choix clairs ressort également des résultats d'une étude néerlandaise qui compare la répartition des dépenses de soins de santé dans cinq pays européens. Cette étude montre par exemple que les dépenses liées aux prestations médicales représentent au Danemark 12,2 % du total des dépenses. En Belgique, elles représentent 22 %, ce qui est un pourcentage particulièrement élevé. En réduisant ce chiffre en Belgique jusqu'à concurrence du pourcentage danois, on dégagerait une grande quantité de moyens qui pourraient ensuite être consacrés, par exemple, aux soins intra-muros ou extra-muros.
Comparaison de la répartition des dépenses
en soins de santé (1995)
| Pays-Bas Nederland |
Danmark Denemarken |
France Frankrijk |
Suisse Zwitserland |
Belgique België |
|
| Soins intra-muros. Intramurale zorgverlening | 59,0 | 66 | 50,7 | 51,2 | 51,7 |
| Soins extra-muros. Extramurale zorgverlening | 17,2 | 16,8 | 23,1 | 28,2 | 20,6 |
| Prévention. Preventie | 3,3 | 4,0 | 2,0 | 1,9 | 2,0 |
| Biens médicaux. Medische hulpgoederen | 15,7 | 12,2 | 18,4 | 12,1 | 22,0 |
| Administration. Administratie | 4,8 | 1,0 | 5,8 | 6,6 | 3,7 |
| 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Si l'on étudie les comparaisons internationales relatives aux dépenses de médicaments par patient, on constate aussi qu'elles sont particulièrement élevées en Belgique, notamment en ce qui concerne les dépenses personnelles du patient. Cette constatation est d'ailleurs confirmée par les enquêtes effectuées auprès des malades chroniques, d'où il ressort que ces personnes ont des frais énormes en médicaments, dont une bonne partie est superflue. On ne résout pas ce problème par la voie financière, mais par l'information et la formation.
Un débat public sur les choix est donc plus qu'indispensable.
Il y a lieu tout d'abord de prendre un certain nombre de mesures à caractère général dont l'impact dépasse le groupe des malades chroniques. Ces mesures sont :
l'inclusion de certains médicaments de la catégorie B dans la franchise. Il faut toutefois faire preuve de prudence dans le choix de ces médicaments. L'exécution de Pharmanet est nécessaire pour collecter les données indispensables relatives à la consommation;
la forfaitarisation des médicaments non remboursables dans les hôpitaux. La base légale pour mutualiser ces médicaments existe déjà depuis 7 ans, mais on n'a encore pris aucune initiative dans ce domaine. Certains patients reçoivent pourtant des factures énormes pour ces médicaments;
la promotion de l'utilisation des produits génériques. La France a récemment introduit le droit de substitution pour les pharmaciens. En Belgique aussi, on dispose de la base légale à cet effet, mais on n'en a pas encore fait usage;
une meilleure couverture des prothèses et des implants;
la majoration des allocations de remplacement. Pour beaucoup de malades chroniques, notamment, ces allocations ne sont pas en rapport avec les frais élevés qu'entraîne leur maladie;
une exécution effective du droit au régime du tiers payant. Les quelque 1 300 000 patients qui, à l'heure actuelle, peuvent prétendre à la franchise sociale ont la possibilité de faire appel au tiers payant dans la mesure où le prestataire de soins donne son accord. Pourquoi ne pourrait-on pas en faire un droit pour ces gens ?
Une série de mesures spécifiques s'imposent par ailleurs pour le groupe des malades chroniques :
la prolongation du remboursement global des coûts à hauteur de 10 000 francs qui a été accordée récemment. Cette prolongation doit toutefois aller de pair avec une évaluation visant à déterminer clairement si ces moyens vont effectivement aux personnes qui en ont le plus besoin, car dans le groupe des malades chroniques, les dépenses sont fortement concentrées également;
l'installation de la commission des malades chroniques à l'INAMI. Cette commission permettrait de tenir constamment en éveil l'attention des autorités sur les problèmes du groupe concerné;
la création d'un centre de documentation et de consultation à l'instar de ce qui se fait dans certains autres pays. Les malades et leurs organisations pourraient s'y adresser pour de plus amples informations sur les médicaments. Le centre pourrait également faire office de forum pour des échanges d'idées;
le financement alternatif de soins expérimentaux pour les malades chroniques. Actuellement, le malade chronique s'adresse à différentes sortes de prestataires de soins, qui interviennent chacun dans leur domaine propre. Il en résulte un morcellement des soins et, dans certains cas, un manque de continuité de ceux-ci. Pourquoi ne pourrait-on pas expérimenter un système d'indemnisation axé sur des équipes assurant la totalité de l'assistance requise;
le renforcement de l'assertivité des malades chroniques. Dans le cadre d'une expérience qui est actuellement menée par les mutualités chrétiennes, les malades chroniques tiennent un journal qui leur appartient et dans lequel ils racontent leur histoire. Ils demandent également à leur généraliste et aux spécialistes qui les soignent d'y consigner toutes les données qu'ils jugent importantes. Les premiers résultats sont apparemment très positifs. Les patients apprennent à comprendre leur propre anamnèse et en parlent avec leurs médecins;
des mesures spéciales pour des affections spécifiques et rares. Des pétitions circulent actuellement en vue de réclamer une assistance plus importante pour les patients atteints de pathologies rares mais très lourdes. Ces patients, dont le nombre est par définition très réduit, doivent faire l'objet de mesures spéciales, qui ne peuvent toutefois se limiter au seul plan financier;
l'adaptation des forfaits pour les centres de santé de quartier et l'extension des prestations concernées;
l'interdiction de toute discrimination des malades chroniques dans les assurances facultatives. Les assureurs excluent de plus en plus les pathologies chroniques des polices d'assurance complémentaire. Le phénomène se constate non seulement en ce qui concerne les assurances complémentaires d'hospitalisation, mais aussi pour toutes sortes de polices, comme par exemple les assurances-vie.
5. La nécessité d'être attentif à la qualité des soins et à la qualité de la vie
Les malades chroniques n'ont pas que des problèmes financiers. Des études ont révélé qu'un malade sur trois éprouve des douleurs graves ou continues, qu'il est fatigué en permanence et/ou qu'il est sujet à des problèmes d'équilibre et de sommeil.
Plus d'un malade chronique sur trois se sent déprimé et plus d'un sur cinq souffre de devoir dépendre d'autrui et est apathique.
Moins d'un malade chronique sur trois appartenant à la population active est effectivement en activité professionnelle et dans un cas sur quatre, le malade chronique compte au moins un autre malade chronique dans sa famille.
Problèmes les plus courants, sur le plan personnel
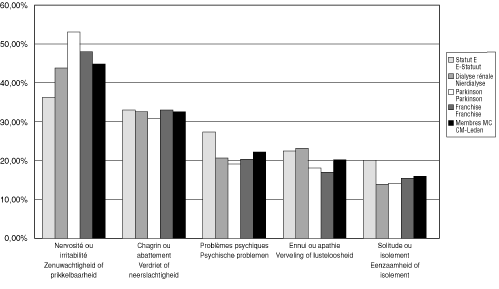
3.4. Problèmes de santé les plus courants
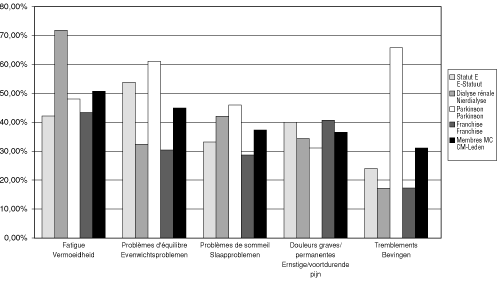
3.4. Problèmes les plus courants
des membres de la famille
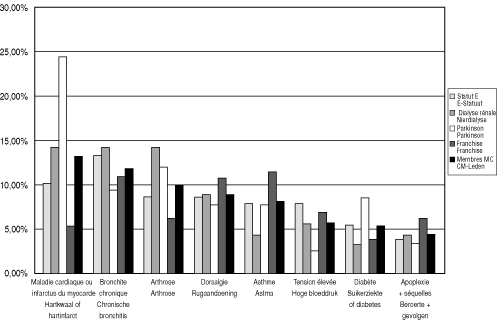
B. Échange de vues
Un membre fait observer que dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité, on peut certes contrôler si une aide déterminée a été dispensée, mais pas si elle l'a été opportunément.
À cet égard, des pas ont déjà été faits dans le sens de l'examen critique de confrères (peer review) . Qu'en est-il actuellement sur le terrain ? Des systèmes de peer review fonctionnent-ils déjà ? Les mutuelles prennent-elles des initiatives en ce sens ? Ne sont-elles pas les représentantes du patient; qui n'a aucun intérêt à des interventions inutiles ?
M. Wauters répond que les chiffres ou les profils qui montrent de grandes différences dans la consommation médicale entre les régions, les hôpitaux ou les dispensateurs de soins frappent vite l'imagination. Il est exact qu'il y a quelques années, l'INAMI a centré ses contrôles sur la réalité des prestations et leur conformité avec la nomenclature. On dispose à présent, depuis quelques années, de données plus performantes en matière de profils; elles sont examinées attentivement par les commissions concernées. On ne peut cependant pas en faire n'importe quoi. Si l'on constate des différences sur la base des profils et que l'on y rattache d'emblée une appréciation de l'opportunité des prestations (elles n'étaient pas nécessaires ou elles étaient inutilement onéreuses), on ne tardera pas à se retrouver plongés dans une querelle juridique.
On pourrait aborder le problème en plaçant les données selon une courbe de Gausse et en s'attaquant aux extrémités de cette courbe, qui peuvent être le signe d'abérrations. On obtiendra toutefois un meilleur résultat en s'efforçant d'infléchir toute la courbe dans l'une ou l'autre direction, et ce en mettant les données à la disposition des dispensateurs de soins, en les informant pour qu'ils s'interrogent eux-même sur les éventuelles différences, qu'ils y cherchent des explications et qu'ils adaptent leur comportement.
La Belgique n'a pas de grande tradition en matière de peer review , mais les choses changent rapidement. Au niveau de l'accréditation, des cercles locaux de généralistes et du fonctionnement des hôpitaux, notamment, on se montre de plus en plus disposé à se mettre en question et à chercher les causes de différences qui ont été constatées sur la base de données performantes.
Les mutuelles sont disposées, hors de toute prétention paternaliste, doctorale ou répressive, à prêter leurs concours en fournissant des données et en offrant des pistes de réflexion. Une telle approche serait en tout cas beaucoup plus efficace que celle consistant à jouer sur les extrêmités de la courbe de Gausse, que l'on trouvera toujours le moyen d'expliquer et dont l'incidence sur l'offre globale est limitée.
Un membre observe que pour l'instant, on s'intéresse particulièrement au problème de l'échelonnement. Que peut-on en attendre sur le plan de l'accessibilité des soins de santé ?
M. Hermesse répond que personne ne peut être contre l'échelonnement. Mais, en même temps, on peut se demander si un tel système permettrait de faire des économies significatives et s'il rendrait les soins de santé moins chers pour le patient. Certains estiment même que l'obligation pour le patient de passer d'abord par le médecin généraliste avant de faire appel à un spécialiste fera augmenter les dépenses. Tout dépendra des spécialités que l'on inclura dans le système (gynécologie, pédiatrie ...?).
Le débat est lancé et l'intervenant craint que l'on n'investisse beaucoup d'énergie dans une mesure qui, fondamentalement, n'améliorera pas beaucoup les soins de santé. Il y a pour l'instant des problèmes plus cruciaux à résoudre. Mais comme on l'a déjà dit, on ne peut pas être contre l'échelonnement et l'union nationale y collaborera certainement de manière positive.
M. Wauters ajoute qu'une grande confusion entoure cette notion d'échelonnement. Si on entend par là que les soins doivent toujours être dispensés au bon endroit et au bon niveau, il est évident que personne ne peut être opposé à pareille mesure. Par contre, une mesure que obligerait le patient à consulter le médecin généraliste avant de s'adresser au spécialiste n'aurait pas beaucoup de sens. On ne saurait réduire l'échelonnement à un exercice d'équilibre entre généralistes et spécialistes. La notion concerne tout autant l'organisation de la médecine spécialisée en tant que telle.
L'union nationale estime en revanche qu'il faut opter résolument pour une politique de la santé dans laquelle le médecin généraliste occupe une place centrale. L'instauration d'un dossier médical central est un instrument important pour réaliser une telle politique. Le dossier médical central peut-être un premier pas vers l'amélioration de la structure et de la coordination des soins de santé pour les patients en général et pour les malades chroniques en particulier.
L'intervenante suivante observe que dans l'exposé, on a nettement mis l'accent sur les dépenses que doivent consentir les patients chroniques. Un autre aspect du problème est le montant des allocations qu'ils reçoivent, une question qui mérite elle aussi d'être examinée.
Les représentants de l'INAMI ont estimé les dépenses consenties par le patient à environ 10 % du coût total de la prestation de soins. L'union nationale estime apparement que ce chiffre est nettement plus élevé et qu'il est d'environ un quart. Quelle a été l'évolution au cours des dernières années et disposet-on de chiffres comparatifs avec d'autres pays ?
On évalue l'effet macro-économique des récentes mesures concernant le ticket modérateur à quelque 12 milliards de francs. Ce montant, qui représente un sacrifice financier pour les patients, peut-il être mis en rapport avec d'autres économies dans les soins de santé ?
La franchise fiscale avait pour but d'éviter que les patients doivent consacrer plus d'un tiers de leurs revenus aux dépenses de santé. A-t-on pu atteindre cet objectif dans la pratique, ou est-il impossible de le dire sur la base des statistiques fiscales disponibles ?
Au cours de l'exposé, on a énuméré une série de mesures ponctuelles prises à l'égard des malades chroniques. On a aussi attiré l'attention à juste titre sur le fait que l'on ne saurait dissocier ce problème de l'augmentation du prix des soins de santé due à l'évolution technologique, alors que le financement se fait au moyen d'enveloppes budgétaires. Cette situation soulève des questions éthiques qui rendent également indispensable un débat sur les priorités générales dans les soins de santé.
On peut se demander dans quelle mesure la commission peut encore approfondir le sujet dans les quelques mois qui lui restent dans la présente législature. Si on ouvre le débat général, on s'engage sur un terrain très vaste et il faudra vraisemblablement plusieurs années pour en venir à bout. C'est la raison pour laquelle, il serait peut-être préférable d'attendre le début de la prochaine législature.
M. Hermesse n'est pas d'accord sur ce dernier point. Opérer des choix fondamentaux dans ce secteur n'est possible qu'à l'issue d'un processus de maturation qui peut durer très longtemps. Le congrès organisé en avril de cette année par l'Association internationale des mutualités a montré clairement que dans certains pays, le processus allant dans le sens d'une fixation de priorités générales est en route depuis plus de dix ans.
De plus, il s'agit d'un débat qui ne peut être mené uniquement par les médecins et les politiques. L'opinion publique aussi doit y être associée. L'exemple du remboursement du médicament « Zocor » pour les personnes de plus de septante ans, que l'on a déjà évoqué, démontre qu'il ne suffit pas que la politique fasse des choix. Ces choix ne peuvent être mis en pratique à la condition que le public soit convaincu de la justesse des priorités qui ont été arrêtées.
Sans débat général sur les priorités, les plus faibles resteront toujours défavorisés. Si l'on devait procéder à une évaluation approfondie de certaines technologies nouvelles, on s'apercevrait que leur coût est parfois très élevé en comparaison des avantages qu'elles offrent. Si, sur la base de cette constatation, on choisissait comme aux Pays-Bas de limiter ces technologies à quelques centres équipés de l'appareillage médical lourd, il s'ensuivrait des listes d'attente. Ce n'est pas agréable pour les intéressés, mais cela permet en même temps de dégager des moyens qui pourront, par exemple, être investis dans l'amélioration de l'accueil des personnes âgées, un secteur où le service laisse beaucoup à désirer en Belgique. Ce sont là des facteurs qu'il faudra mettre en balance dans le cadre d'un débat public.
Des pays comme la Norvège, la Suède, la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre ou l'État de l'Orégon aux États-Unis montrent qu'il est possible d'organiser ce genre de débats et de fixer des priorités claires.
La franchise fiscale, qui se situe entre 15 000 et 50 000 francs, visait effectivement à éviter que l'on ne doive consacrer plus d'un tiers de son revenu aux soins de santé. On peut présumer que ces sommes sont inférieures au tiers du revenu réel des intéressés. Mais, l'important, c'est que la franchise ne s'applique qu'aux tickets modérateurs. Toutes les prestations non remboursables, qui pour certains malades chroniques, peuvent atteindre plus de 180 000 francs, en sont intégralement exclus. Le seul moyen de connaître l'impact de ces dépenses sur le revenu des patients est d'organiser des enquêtes, comme cela a été proposé au cours de l'exposé.
La liste des interventions dans les tickets modérateurs qui a été donnée au cours de l'exposé est déjà largement dépassée par les faits et on peut considérer que l'incidence globale actuelle n'est pas de 12, mais plutôt de 18 milliards. La seule économie structurelle importante dans d'autres secteurs qui ait effectivement rapporté beaucoup d'argent est peut-être l'introduction du remboursement forfaitaire en biologie clinique. Dans le secteur des médicaments, certains produits ont été rayés de la nomenclature et on a introduit une taxe. On peut difficilement considérer cela comme une intervention structurelle.
Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si, ces dernières années, on s'est d'abord orienté vers les patients pour maintenir les budgets en équilibre. En effet, d'un point de vue strictement budgétaire, les interventions dans les tickets modérateurs sont très efficaces et les conséquences en sont visibles immédiatement.
En ce qui concerne l'évolution de l'intervention personnelle des patients dans l'ensemble des dépenses, on pourrait avoir l'impression qu'en pourcentage, cette quote-part est stable, ou même qu'elle a diminué légèrement. Ce n'est cependant que la simple conséquence de l'augmentation du coût global des soins de santé, de sorte qu'en valeur absolue, la charge supportée par les patients a bel et bien sensiblement augmenté. Cette augmentation est d'ailleurs nettement plus élevée que celle du coût de la vie.
Sur le plan international, l'intervention personnelle du patient est indéniablement plus importante en Belgique qu'aux Pays-Bas, en Allemagne et au Royaume-Uni, mais elle est moindre qu'en France. En France, le patient est d'ailleurs obligé de souscrire une assurance complémentaire pour être suffisamment couvert. On peut craindre qu'en Belgique, la situation n'évolue dans le même sens si des mesures sérieuses ne sont pas prises. Chez nous, l'hospitalisation a tendance à devenir un risque financier grave, non pas en raison des suppléments d'honoraires ou de chambre, mais à cause des médicaments et autres produits non remboursables et de l'augmentation des tickets modérateurs.
M. Wauters souligne que la nécessité de faire des choix bien précis ne doit pas avoir pour conséquence de limiter le débat à certains aspects partiels. Ainsi ne serait-il pas judicieux, en ce qui concerne le secteur des médicaments, de se braquer sur la surconsommation et sur le comportement prescripteur des médecins. C'est indéniablement un des aspects de la problématique, mais pas le seul. La fixation du prix des médicaments est un facteur tout aussi important, auquel on accorde trop peu d'attention actuellement. L'agrément et le remboursement des produits ne se font pas toujours rationnellement et sont souvent conditionnés par la pression des médias. Le problème se pose avec davantage d'acuité encore dans le secteur des accessoires. Ils sont commercialisés par des entreprises internationales et la fixation de leur prix n'est guère transparente.
Une membre croit avoir compris des exposés que les représentants de cette union estiment que la Belgique va vers un système généralisé d'assurances complémentaires. Que pensent-ils de cette évolution et quand estiment-ils que ce système sera introduit ?
M. Hermesse répond que l'union nationale qu'il représente n'est certainement pas favorable à une telle assurance. Mais, il faut oser voir la réalité en face. Les « trous » du régime légal deviennent de plus en plus importants et l'hospitalisation va représenter un risque financier pour les ménages. Les mutuelles aussi le ressentent directement, vu la demande croissante d'une assurance de type formulée par leurs membres. Cette demande est le fruit d'un sentiment d'inquiétude manifeste.
Dans ces conditions, on ne peut pas continuer à se voiler la face. Si la situation continue à évoluer comme actuellement, les assurances privées vont se répandre rapidement. Si ce type de couverture reste facultative, les assureurs sélectionneront les risques, avec la conséquence que ce seront précisément les plus faibles, comme les malades chroniques, qui seront totalement exclus. Au nom de cela, il est donc préférable de dire ce qu'il en est, à savoir qu'une couverture des risques de santé suffisante pour tous implique que l'assurance complémentaire soit obligatoire.
M. Wauters ajoute que le premier objectif de la politique doit être de fournir à tous l'accès à des soins de santé de haut niveau. La première et la meilleure manière de réaliser cet objectif est d'organiser une solidarité générale et obligatoire.
La question centrale qui se pose est celle de savoir ce que la communauté est prête à faire pour organiser cette solidarité. Pour l'heure, les dépenses publiques en matière de soins de santé ne sont pas plus élevées en Belgique que dans les pays connaissant une situation comparable. Le monde politique doit réfléchir à cette question et il faut espérer qu'il ne considérera pas que la généralisation de l'assurance complémentaire est inéluctable. Toutefois, au cas où les pouvoirs publics ne seraient pas disposés à aller plus loin dans l'affectation de ressources à l'organisation de la solidarité, les mutualités devraient en tirer leurs conclusions et suivre la tendance favorable aux assurances complémentaires.
Une membre dit tout d'abord qu'à son avis, les intervenants ont eu raison de souligner que la question de l'accès aux soins de santé n'est pas uniquement une question de moyens financiers et que d'importants aspects qualificatifs y sont liés. En ce qui concerne la maîtrise des dépenses, elle estime que les problèmes qui se posent à ce sujet ne peuvent pas être dissociés du fait que les prix sont fixés dans une large mesure par des personnes qui ont intérêt à ce que les produits et services soient le plus coûteux possible.
M. Wauters répond que les prestataires de soins qui offrent des services de qualité doivent être rémunérés correctement pour ce faire. Les secteurs dans lesquels les prestations de soins et les mutuelles se sont concertées sur les choix à faire et les priorités à fixer montrent qu'il est possible d'offrir cette rémunération tout en maîtrisant les coûts. Les problèmes de maîtrise des dépenses se situent toutefois dans les secteurs, comme celui des médicaments et des implants, dans lesquels la fixation des prix échappe aux autorités.
Un autre intervenant confirme que l'explosion des prix a lieu surtout dans le secteur des médicaments. Les intervenants estiment que les dépenses exposées par les patients pour les médicaments non remboursables s'élèvent à 64 milliards de francs. Dispose-t-on à ce sujet de données rendant possible une comparaison avec d'autres pays ? Les pays voisins parviennent-ils à maîtriser mieux que nous les dépenses en matière de médicaments ? Il semble bien que la part d'importance des médicaments constitue le plus grand problème dans le secteur des soins de santé en Belgique.
M. Hermesse fait référence au tableau qui indique la manière dont les coûts de soins de santé ont été répartis en 1995 dans cinq pays européens. Par rapport aux quatre autres pays avec lesquelles elle a été comparée, la Belgique consacre, d'après cette étude, une part exceptionnellement importante de ces dépenses aux médicaments. L'on peut citer plusieurs raisons. Outre la question de la fixation des prix, il y a le fait que la Belgique consomme exceptionnellement beaucoup de médicaments elle en consomme le plus, en Europe, après la France et que le réseau de distribution est particulièrement dense dans notre pays. Ce dernier fait résulte également, quant à lui, d'un choix politique. Il y a, en Belgique, 5 400 pharmacies contre 1 500 environ aux Pays-Bas. Le maintien d'un tel réseau nécessite des moyens qui ne peuvent pas être affectés à autre chose.
Les choix peuvent être dictés par toutes sortes de considérations. C'est ainsi que l'on peut évaluer à quelque 35 milliards de francs par an la dépense supplémentaire qui a résulté de l'accord social de 1989.
Les agréments sont un autre exemple. Dans une étude récente, qui a été publiée dans le magazine Science et Avenir , l'on a sélectionné, en France, en fonction de quatre interventions différentes, les 50 hôpitaux où le taux de mortalité était le plus élevé et les 50 hôpitaux où il était le plus faible. Dans certains cas, l'on a noté une différence entre les deux groupes qui atteignait un rapport de un à cinq. En Belgique, l'on connaît depuis des années, pour chaque prestation, le taux de mortalité relevé dans l'ensemble des hôpitaux du pays. L'on devrait oser en tirer les conclusions au niveau politique.
1. Énoncé du problème
La quasi-totalité de la population est assurée relativement correctement contre le risque de maladie et ce, pour un prix raisonnable. La Belgique consacre 8 % de son PIB (produit intérieur brut) aux soins de santé. Aux États-Unis, cette proportion est de 14,5 %, mais un Américain sur cinq n'est pas assuré.
Il reste qu'en dépit du fait que l'assurance maladie belge figure parmi les meilleures d'Europe, tous les citoyens belges ne sont pas encore égaux sur le plan des soins de santé.
D'importantes différences socio-culturelles subsistent sur les plans de la morbidité et de la mortalité. Les personnes appartenant aux groupes économiquement défavorisés sont plus souvent malades que les autres et leur espérance de vie est moins élevée. C'est là un constat qui continue à choquer.
Depuis le début des années 80, le secteur de l'assurance-maladie n'a pas pu échapper aux économies qui ont été opérées partout ailleurs. Il en va de même pour les années 90. Les mesures d'économie qui ont été prises sont de deux natures :
* d'une part, il s'agit de mesures structurelles destinées à mieux maîtriser les dépenses. Nous songeons au renforcement de l'orthodoxie budgétaire que l'on atteint en fixant des objectifs budgétaires globaux et des objectifs partiels, qui ne peuvent pas être dépassés. Le secteur même est d'ailleurs soumis à une norme de croissance maximale (hors inflation) de 1,5 %. Nous songeons également à la sensibilisation des médecins prescripteurs dans le domaine de la biologie clinique ambulatoire.
* si les mesures structurelles susvisées affectent peu le patient, du moins directement, il en va autrement pour toute une série de mesures d'économie supplémentaires. Le plus souvent, ces mesures consistaient à instaurer des tickets modérateurs nouveaux ou à augmenter les tickets existants. Nous songeons à l'augmentation des tickets modérateurs qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1994 pour les consultations et les visites des médecins généralistes et les consultations des spécialistes.
Actuellement, le patient paie lui-même 145 milliards par an en tickets modérateurs et suppléments. Cela représente environ 25 % de la facture totale pour les soins de santé (objectif budgétaire global de 452 milliards pour l'assurance maladie en 1998).
Les tickets modérateurs pratiqués en Belgique sont de loin les plus élevés d'Europe. Selon des indications sérieuses, le coût des soins de santé entraîne une sous-consommation et une consommation différée. « Si en Belgique le ticket modérateur est fixé à un niveau très social ou démocratique pour les revenus moyens, ce niveau décourage un ménage pauvre ou défavorisé dès lors que celui-ci ne satisfait pas aux conditions requises pour jouir du statut préférentiel VIPO » (Rapport général sur la pauvreté).
Bref, le niveau des tickets modérateurs et des suppléments a atteint une limite pour les patients en Belgique. On ne doit pas oublier non plus qu'une moyenne ne reflète pas fidèlement la réalité. En effet, le risque de maladie et donc le risque de dépenses de soins de santé sont répartis d'une manière très inégale au sein de la population. On sait que 2 % seulement de la population représente de 40 à 50 % des dépenses totales en matière de soins médicaux. Cette concentration est plus forte encore en ce qui concerne les soins aux malades chroniques : par exemple, 5 % de la population absorbent l'intégralité du budget des soins à domicile.
Il faut garantir à tous un système de soins de santé de qualité pour un prix abordable. Les groupes socialement défavorisés méritent une attention particulière dans ce contexte. Le régime des soins de santé doit être adapté en permanence pour tenir compte de l'accessibilité. Les mutuelles ont été à l'origine de diverses mesures qui ont été adoptées au cours des dernières années. Elles sont favorables à des corrections supplémentaires. Celles-ci sont décrites en détail dans les lignes qui suivent.
2. Réalisations par le biais de l'assurance obligatoire
2.1. Franchise sociale et fiscale
Les mutuelles sont à la base du système des franchises dans l'assurance maladie. Les 70 000 ménages qui sont affiliés à notre organisme assureur UNMS perçoivent chaque année 14 500 francs en moyenne au titre de remboursements. En effet, les franchises sociale et fiscale limitent la contribution personnelle du patient à ses dépenses de soins de santé sur une base annuelle.
Les mesures dites de sélectivité sont entrées en vigueur fin 1993-début 1994. Il s'agissait d'un ensemble de majorations des tickets modérateurs à hauteur de 7,5 milliards. Les principales majorations sont les suivantes :
majoration des tickets modérateurs en biologie clinique ambulatoire et en radiologie;
forfait par admission en hôpital;
augmentation des tickets modérateurs pour les consultations et les visites des médecins généralistes et des spécialistes.
Si l'on a chaque fois protégé les VIPO par des régimes préférentiels, les mesures susvisées ont accru malgré tout la charge financière pour le patient. C'est pourquoi les mutuelles ont insisté pour que l'on prenne des mesures sociales correctives lesquelles ont été concrétisées par l'instauration des franchises sociale et fiscale, entrées en vigueur le 1e janvier 1994. Dorénavant, le ticket modérateur que le patient même doit payer est limité à un certain plafond, préalablement déterminé sur une base annuelle. Une fois ce plafond dépassé, le patient bénéficie de soins de santé gratuits. Le système ne s'applique cependant pas aux médicaments.
Franchise sociale
La franchise sociale introduit une protection pour certaines catégories sociales en limitant les tickets modérateurs à 15 000 francs par an et par bénéficiaire et par personne à sa charge. Les catégories sociales visées sont :
les bénéficiaires d'un revenu garanti;
les VIPO bénéficiant d'un régime préférentiel;
les bénéficiaires d'une allocation pour handicapés;
les personnes qui sont au chômage depuis plus de six mois, ainsi que les personnes qui sont à leur charge.
Cette mesure a un impact direct sur l'accessibilité. Dans le cadre de la franchise sociale, les tickets modérateurs excédant 15 000 francs sont remboursés immédiatement.
En 1995, 94 000 personnes ont atteint ce seuil en matière de ticket modérateur. L'opération a coûté 1,3 milliard de francs. Si l'on ignore toujours ce que seront les chiffres précis des années à venir, on sait néanmoins qu'ils seront en augmentation surtout de par l'octroi de la franchise sociale aux personnes qui sont au chômage depuis au moins six mois.
Franchise fiscale
Par le biais de la franchise fiscale, on instaure une protection des « bas salaires » n'appartenant pas aux catégories sociales couvertes par la franchise sociale.
Dans le cadre de l'application de la franchise fiscale, les tickets modérateurs sont limités par ménage fiscal en fonction du revenu imposable :
Tableau 1
Franchise fiscale, échelles de revenus et compte-ticket modérateur
| Revenu imposable | Montant des tickets modérateurs |
|
| 0 | 537 999 | 15 000 |
| 538 000 | 828 999 | 20 000 |
| 829 000 | 1 119 999 | 30 000 |
| 1 120 000 | 1 410 999 | 40 000 |
| > 1 411 000 | 50 000 |
Tableau 2
Franchise fiscale, nombre de ménages qui ont été pris en considération
| Tranche de revenus | Nombre de ménages | |
| 1994 | 1995 | |
| 0 - 538 000 | 79 568 | 67 411 |
| 538 000 - 829 000 | 56 087 | 66 667 |
| 829 000 - 1 120 000 | 11 438 | 14 969 |
| 1 120 000 - 1 411 000 | 2 405 | 3 505 |
| > 1 411 000 | 1 401 | 2 523 |
| Total | 150 899 | 155 075 |
Données nationales, source : INAMI.
Le tableau ci-dessous indique les dépenses afférentes à la franchise fiscale en 1994 et 1995.
Tableau 3
Franchise fiscale, dépenses
| 1994 | 1995 | |
| Montant remboursé | 2,23 milliards | 2,36 milliards |
| Nombre de ménages | 151 000 | 155 000 |
| % des ménages | 3,56 | 3,60 |
| Remboursement moyen Régime général |
13 906 | 14 437 |
| Remboursement moyen Régime des indépendants |
10 297 | 13 142 |
Données nationales, source : INAMI.
Tableau 4
Remboursement par ménage et par tranche
de revenus (1995)
| Tranche de revenus | Remboursé | Ticket modérateur |
| 0-538 000 | 13 263 | 28 263 |
| 538 000-829 000 | 14 275 | 34 275 |
| 829 000-1 120 000 | 16 632 | 46 632 |
| 1 120 000-1 411 000 | 20 009 | 60 009 |
| > 1 411 000 | 24 588 | 74 588 |
Données nationales, source : INAMI.
Cette mesure a un effet indirect sur l'accessibilité. Les montants en tickets modérateurs payés en trop ne sont remboursés par le fisc qu'au bout de deux ans. Il serait préférable que les mutualités connaissent les plafonds de revenus de leurs affiliés car cela permettrait d'appliquer immédiatement la franchise fiscale. Mais pour qu'elles puissent en disposer, il convient toutefois de résoudre d'abord une série de problèmes, entre autres dans le domaine de la protection de la vie privée.
2.2. Extension des groupes cibles auxquels s'applique le régime préférentiel VIPO
Le régime préférentiel en faveur des veuves, des invalides, des pensionnés et des orphelins dont le revenu annuel est inférieur à 456 000 francs existe déjà depuis 1963. Le bénéficiaire de ce régime préférentiel doit payer un ticket modérateur beaucoup moins élevé, et pour les prestations médicales, et en cas d'hospitalisation, et pour les médicaments.
En étendant le régime préférentiel VIPO au 1er juillet 1997, l'on a nettement amélioré l'accessibilité financière aux soins de santé pour les groupes sociaux les plus vulnérables de notre société (plus de 140 000 personnes). Ainsi 38 000 familles supplémentaires affiliées aux mutualités socialistes bénéficient-elles d'un remboursement majoré de leurs dépenses de soins de santé.
À partir du 1er juillet 1997, le régime préférentiel VIPO a été étendu aux groupes cibles suivants :
1. les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence et les personnes à leur charge;
2. les personnes bénéficiant d'un revenu garanti aux personnes âgées et les personnes à leur charge;
3. les invalides bénéficiant d'une allocation et les personnes à leur charge;
4. les ayants droit bénéficiant d'une aide du CPAS entièrement ou partiellement à charge de l'État fédéral et les personnes à leur charge (c'est-à-dire l'équivalent du minimum de moyens d'existence pour les non-Belges;
5. les enfants moins-valides qui jouissent d'allocations familiales majorées.
Pour avoir droit au régime préférentiel, il faut également remplir des conditions de revenus. Le plafond de revenus (revenus imposables bruts du ménage) est resté inchangé, soit de 456 082 francs majoré de 84 433 francs par personne à charge (actuellement 465 211 francs majoré de 86 123 francs).
On tiendra certes aussi compte dorénavant des revenus de rentes et du revenu cadastral, dépassant 30 000 francs (majoré de 5 000 francs par personne à charge).
Pour l'UNMS (qui représente quelque 2,7 millions d'ayants droit), ce régime augmente de plus de 20 % le nombre d'ayants droit pouvant bénéficier du régime préférentiel.
Tableau 5
Augmentation du régime préférentiel
| Titulaires Titularissen |
Ayants droit Rechthebbenden |
|
| Au 30 juin 1996. Op 30 juni 1996 | 227 255 | 306 354 |
| Au 31 décembre 1997. Op 31 december 1997 | 264 900 | 375 694 |
| Accroissement. Toename | 37 645 | 69 340 |
| Accroissement en %. Toename % | 16,6 % | 22,6 % |
2.3. Quote-parts personnelles faibles en cas d'hospitalisation pour les chômeurs de longue durée
L'intervention personnelle en cas d'hospitalisation a été réduite pour les chômeurs de longue durée. Quelque 60 000 chômeurs de longue durée ont pu bénéficier de cette mesure.
À dater du 1er avril 1997, l'intervention forfaitaire en cas d'hospitalisation est passée à 1 100 francs (au lieu de 1 000 francs auparavant). Cette mesure ne s'applique ni aux VIPO ni aux personnes à leur charge. En plus de ce montant forfaitaire, il y a lieu de payer une quote-part personnelle journalière en fonction de la catégorie sociale à laquelle on appartient.
Les chômeurs de longue durée sont assimilés, à partir du 1er avril 1997, aux VIPO qui bénéficient du régime préférentiel (pas de forfait de 1 100 francs, 150 francs pour le premier jour au lieu de 450 francs, 150 francs pour le deuxième jour au lieu de 450 francs). Le montant de la quote-part personnelle ne diffère plus en fonction de la durée de l'hospitalisation sauf dans le cas d'une admission en hôpital psychiatrique se prolongeant au-delà de cinq ans (450 francs VIPO, 750 francs autres ayants droit à partir de la sixième année de psychiatrie).
2.4. Suppléments hospitaliers
Quiconque a déjà été hospitalisé peut en témoigner : les hôpitaux facturent parfois les suppléments les plus divers. Une loi interdisant de facturer des suppléments aux patients dans les chambres à deux lits ou plus entrera en vigueur. Des milliers d'hospitalisés n'auront plus la surprise de recevoir des factures élevées.
À partir du 1er décembre 1998, on ne pourra plus facturer aux patients en chambre à deux lits ou plus que les honoraires maximums, c'est-à-dire sans suppléments. Cette mesure s'applique aussi aux médecins non conventionnés. Pour les patients en chambre individuelle, les honoraires maximums et les suppléments d'honoraires maximums peuvent être fixés par arrêté royal.
2.5. Assouplissement de l'accès à l'assurance maladie
À partir du 1er janvier 1998, les règles (complexes) d'assurabilité sont assouplies.
Le Rapport général sur la pauvreté mentionnait déjà qu'il était opportun de garantir le droit aux soins de santé dans un système d'assurance sociale qui soit le plus accessible possible. C'est pourquoi il faut tendre à un accès généralisé aux soins de santé en étendant la couverture du risque en matière de soins de santé à toute personne habitant en Belgique.
Les freins administratifs et financiers à un accès généralisé aux soins de santé doivent donc être éliminés. L'accessibilité doit être garantie par un régime d'assurance « professionnel » (régime des travailleurs salariés ou régime des travailleurs indépendants), accessible sans trop de conditions préalables.
Cette question à première vue assez technique d'assurance, est cependant très importante. On sait que près de la moitié des ménages défavorisés n'ont plus été en règle en matière d'assurance maladie au cours des cinq dernières années. Le pourcentage de population à ne plus être en règle en matière d'assurance maladie, à un moment ou un autre, est estimé à 4 ou 5 %. Voilà pourquoi il était important, en vue d'une plus grande accessibilité de l'assurance, d'éliminer les seuils financiers et administratifs.
Depuis le 1er janvier 1998, on a procédé à une série de réformes dont les lignes de force sont les suivantes :
La suppression des régimes dits résiduaires, à dater du 1er janvier 1998. Les handicapés, les étudiants et les personnes non protégées ont été intégrés dans le régime général. Les autres ressortiront au régime des travailleurs indépendants.
Simplification et réduction des cotisations personnelles. Les cotisations mensuelles (par exemple des pensionnés à carrière imcomplète, des étudiants, etc.) sont converties en cotisations trimestrielles ou remplacées par de telles cotisations à partir du 1er janvier 1998. Les groupes sociaux les plus vulnérables sont dispensés du paiement de la cotisation de l'assurance obligatoire (revenu garanti aux personnes âgées, minimum de moyens d'existence, handicapés, ascendants).
La suppression du stage. À partir du 1er janvier 1998, bénéficier dès l'inscription d'un droit immédiat. En outre, on conserve ce droit jusqu'à la fin de l'année suivant celle de l'inscription. On obtient donc plus facilement un droit et on le conserve plus longtemps. Le stage de six mois devient, plus encore qu'auparavant, l'exception;
La période du droit annuel ne va plus du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante mais du 1er janvier au 31 décembre.
Tableau 6
Résultat de l'assouplissement des règles d'assurabilité (seulement UNMS)
| Période Periode |
Tit. ménages Tit. gezinnen |
Ayants droit Rechthebbenden |
| 1er trimestre 1997 dossiers à problèmes. 1e kwartaal 1997 probleemdossiers | 7 539 | 9 732 |
| 1er trimestre 1998 dossiers à problèmes. 1e kwartaal 1998 probleemdossiers | 2 968 | 3 730 |
| Accroissement en règle. Toename in regel | 4 571 | 6 002 |
| % accroissement en règle. Toename % in regel | 60,6 % | 61,7 % |
2.6. Malades chroniques
Afin d'alléger la facture pour les malades chroniques, le gouvernement a pris une série de mesures à la demande des mutualités. Ces mesures au profit des personnes qui sont longuement confrontées au paiement de frais de maladie élevés sont entrées en vigueur en juin 1998. Quelque 85 000 personnes en bénéficient (voir tableau 7).
En payant 145 milliards de francs de tickets modérateurs par an, le patient finance environ 25 % du coût total des soins de santé. Mais les frais de maladie sont répartis de manière inégale parmi la population.
Selon une étude des Mutualités chrétiennes, les dépenses personnelles moyennes annuelles sont les suivantes pour quatre groupes de patients :
patients suivant une dialyse rénale : 59 760 francs;
patients souffrant de la maladie de Parkinson : 62 153 francs;
patients ayant un statut E (9) : 79 248 francs;
2 × 15 000 francs de tickets modérateurs atteints en deux ou trois ans : 83 592 francs.
Il s'agit en l'occurrence de dépenses diverses, c'est-à-dire tant médicales que paramédicales (traitements et matériel) ainsi que de celles relevant de l'aide à domicile.
Il est clair qu'en raison de l'insuffisance des mécanismes de protection existants, un effort particulier en faveur des malades chroniques s'imposait.
Une série de mesures sont entrées en vigueur en juin 1998.
Indemnité forfaitaire en cas de dépenses de soins de santé élevées
Une allocation forfaitaire de 10 000 francs par an est accordée aux malades chroniques qui doivent faire face à d'importantes dépenses de soins de santé. Pour pouvoir en bénéficier, il faut remplir deux conditions :
1. Avoir soi-même en tant qu'ayant droit payé plus de 10 000 francs de tickets modérateurs au cours de deux années successives. Un ayant droit qui n'est pas personnellement malade chronique, mais qui compte un malade chronique parmi les membres de sa famille peut également bénéficier de cette mesure, pour autant que la totalité des tickets modérateurs du ménage atteignent 15 000 francs par an au cours de deux années successives.
2. L'ayant droit doit en outre se trouver dans une des situations suivantes :
bénéficier depuis trois mois d'un forfait B ou C dans le régime des soins à domicile (personne nécessitant des soins importants);
avoir droit depuis six mois à un remboursement majoré des frais de kinésithérapie (par exemple, les patients souffrant de sclérose en plaques ou autres personnes qui bénéficient du statut E);
bénéficier des allocations familiales majorées pour des enfants handicapés;
remplir les critères pour l'allocation d'intégration des personnes handicapées (catégories II, III ou IV, c'est-à-dire ayant d'importants ou de graves problèmes d'autonomie);
bénéficier d'une allocation d'aide de tiers dans l'ancien régime des allocations aux handicapés;
remplir les critères nécessaires pour avoir droit à une allocation d'aide aux personnes âgées, catégorie III ou IV;
bénéficier d'une allocation de maladie ou d'invalidité majorée pour l'aide de tiers;
bénéficier d'une allocation forfaitaire pour l'aide de tiers en faveur des chefs de famille ayants droit.
Allocation forfaitaire pour l'aide de tiers en faveur des chefs de famille handicapés
À l'heure actuelle, seuls les handicapés isolés et cohabitants qui nécessitent l'aide de tiers peuvent bénéficier d'une indemnité majorée d'incapacité de travail. À cet effet, ils doivent atteindre au moins 11 points sur l'échelle d'évaluation de l'autonomie.
Dorénavant, les chefs de famille handicapés avec une perte d'autonomie identique pourront aussi en bénéficier; ils auront droit à une allocation forfaitaire supplémentaire de 5 000 francs par mois. Cette mesure entrera en vigueur par phases.
Intervention forfaitaire dans les frais de matériel de traitement de l'incontinence
Une allocation mensuelle de 10 000 francs est prévue pour les personnes qui ont pu prétendre durant quatre mois à une intervention pour soins à domicile (forfait B ou C avec un score de 3 ou 4 pour le critère d'incontinence). Cette intervention est destinée à alléger les frais requis par le matériel.
Mesures afférentes à une maladie
Outre les mesures exposées ci-dessus, une série de mesures spécifiques ont également été prises pour trois pathologies.
Pour les personnes souffrant d'affections neuro-musculaires (2 000 patients), on s'efforce d'améliorer le remboursement de fauteuils roulants. Des centres de référence seront aussi créés pour veiller à la qualité des soins et des prescriptions.
De même, pour les personnes souffrant d'affections du métabolisme (1 000 patients), des centres de référence seront créés. Il y aura aussi une intervention dans les frais en cas d'alimentation spéciale.
Enfin des mesures ont été prises en faveur des patients souffrant de mucoviscidose (1 500 patients), une maladie héréditaire et parfois mortelle qui affecte les voies respiratoires. Des centres de référence sont également créés à cet égard. Parallèlement, une série de prestations particulières donneront lieu à une intervention comme le cas d'un traitement aux antibiotiques à suivre à domicile sur prescription médicale.
Fauteuils roulants
Un groupe de travail a élaboré une proposition détaillée visant à garantir une meilleure couverture par l'assurance maladie, dont les principaux bénéficiaires devraient être les malades chroniques et les handicapés. Cette proposition doit encore être affinée plus avant. À titre d'exemple, mentionnons les mesures suivantes :
aucun supplément pour les fauteuils roulants standard;
définition plus large des accessoires pour fauteuils roulants non standard;
assouplissement des conditions d'attribution de fauteuils roulants électroniques.
Médicaments
On propose de diminuer le ticket modérateur pour les médicaments de la catégorie B (médicaments à haute valeur thérapeutique) pour les malades chroniques. Cette mesure est toutefois reportée à 1999 pour des raisons techniques.
TVA sur le matériel médical
La TVA est réduite de 21 % à 6 % pour certains produits médicaux. Cette mesure concerne entre autres le matériel anti-escarres, les aérosols, les pompes anti-douleur et les accessoires pour malvoyants.
Tableau 7
Aperçu des mesures en faveur des malades chroniques
| Personnes | Montant ( en millions) |
|
| Forfait 10 000 (remboursement frais de soins de santé) |
52 000 | 520 |
| Forfait 5 000/mois (chefs de famille handicapés) |
5 100 | 310 |
| Forfait 10 000/an (personnes incontinentes) |
22 000 | 220 |
| Intervention fauteuils roulants | ? | 110 |
| Réduction du taux de TVA | ? | 60 |
| Affections spécifiques | 4 500 | 288 |
| Total | 83 600 | 1 508 |
Source : calculs UNMS, extrapolation nationale.
2.7. Combien de personnes sont-elles concernées ?
Tableau 8
Aperçu global de l'incidence des récentes mesures d'accessibilité au niveau national
| Personnes Personen |
Montant Bedrag |
Budget (en millions) Budget (in miljoenen) |
|
| Franchise sociale. Sociale franchise | 94 000 | 14 153 | 1 213 |
| Franchise fiscale. Fiscale franchise | 155 075 | 14 437 | 2 227 |
| Extension régime préférentiel. Uitbr. voorkeurregeling | 131 758 | 6 224 | 821 |
| Forfait remboursement des frais. Forfait kostenvergoeding | 52 000 | 10 000 | 520 |
| H3 invalides cdf. H3 invalide gzh | 5 100 | 5 000 | 310 |
| Forfait incontinence. Incontinentieforfait | 22 000 | 10 000 | 220 |
| Fauteuils roulants. Rolstoelen | 110 | ||
| Taux TVA. BTW-tarief | 60 | ||
| Affections spécifiques. Specifieke aandoeningen | 4 500 | ||
| Nouvelle assurabilité. Nieuwe verzekerbaarheid | 12 000 | ||
| Total. Totaal | 476 500 | 5 769 |
Source : évaluation UNMS, extrapolation nationale.
* Le calcul est vite fait : depuis 1994, les mesures sociales de correction évoquées ci-dessus ont, d'une manière ou d'une autre, procuré un avantage financier à environ 500 000 personnes.
* Rien qu'au niveau des franchises fiscale et sociale, les mutualités socialistes ont déjà couvert 70 000 ménages qui ont bénéficié d'un remboursement moyen de 14 500 francs par an. Les frais sont élevés surtout pour les personnes handicapées. Celles-ci retouchent en moyenne 28 167 francs par an. Mais il y a aussi des handicapés qui retouchent plus de 100 000 francs.
* 38 000 ménages affiliés aux Mutualités socialistes ont bénéficié d'un élargissement du régime préférentiel VIPO.
* Plusieurs milliers de ménages ont bénéficié d'un accès plus souple à l'assurance maladie.
* 30 000 malades de longue durée affiliés aux Mutualités socialistes peuvent bénéficier des nouvelles mesures visant à améliorer la situation d'assurance des malades chroniques.
Notre assurance maladie est l'une des meilleures du monde. Mais, comme de nombreuses mesures d'économie ont été prises ces dernières années, le patient a été mis à contribution, ce qui a engendré un problème du fait que les personnes qui sont confrontées à d'importantes dépenses de santé ne sont plus en mesure de payer. Autrement dit : l'accessibilité du système est compromise.
3. Quid pour l'avenir ?
Le gouvernement a fait savoir récemment qu'un crédit d'un milliard et demi de francs prélevé sur le budget 1999 de l'assurance maladie serait affecté aux initiatives nouvelles en matière d'accessibilité. Selon nous, ce montant doit être affecté en priorité à l'amélioration des interventions en faveur des malades chroniques. En outre, nous sommes partisans de l'attribution complète du régime préférentiel aux chômeurs de longue durée plus âgés (sans emploi depuis plus d'un an).
3.1. Augmentation du remboursement des médicaments B
Outre l'augmentation du remboursement des dépenses de santé des malades chroniques, l'on pourrait envisager une augmentation du remboursement des médicaments nécessaires (les médicaments de catégorie B).
Simulations :
1. Abaissement du coût des médicaments B :
ramener de 15 à 10 % le ticket modérateur pour les bénéficiaires du régime préférentiel;
ramener de 25 à 15 % le ticket modérateur pour les autres affiliés.
Tableau 9
Abaissement du ticket modérateur médicaments B
régime préférentiel autres
| Ticket modérateur médicaments B* Remgeld geneesmiddelen B* |
Nouveau ticket modérateur Nieuw remgeld |
Coût UNMS Kost NVSM |
Extrapolation Belgique entière Extrapolatie nationaal |
|
| Régime préférentiel. Voorkeurregeling | 699 114 179 | 466 076 119 | 233 038 060 | 832 278 785 |
| Autres affiliés. Niet-voorkeurregeling | 2 897 465 355 | 1 738 479 213 | 1 158 986 142 | 4 139 236 221 |
| Total. Totaal | 3 596 579 534 | 2 204 555 332 | 1 392 024 202 | 4 971 515 006 |
* Uniquement pour les membres UNMS, calcul basé sur les données Farmanet de juin 1997/juin 1998.
Cette mesure n'est pas réalisable sur le plan budgétaire, sauf si l'on se limite au régime préférentiel.
2. Abaissement du coût des médicaments B pour les patients dont la carte SIS les rattache à la notion de « franchise sociale » :
L'avantage est que le patient bénéficie de l'exonération du ticket modérateur directement chez le pharmacien. Des scénarios intermédiaires sont envisageables (dispense totale ou partielle).
Selon les calculs réalisés sur la base des données Farmanet, le ticket modérateur moyen sur les médicaments B s'élève à 1 904 francs pour les personnes bénéficiant du régime préférentiel et à 1 317 francs pour les autres. Le ticket modérateur moyen pour le patient bénéficiant de la « franchise sociale » est impossible à calculer parce que l'on ne dispose d'aucune donnée d'identification.
Tableau 10
Pas de ticket modérateur pour les médicaments B, patients franchise sociale
| Ticket modérateur* | Nombre en franchise** sociale |
Coût |
| 3 000 | 120 000 | 360 000 000 |
| 3 000 | 125 000 | 375 000 000 |
| 3 000 | 130 000 | 390 000 000 |
| 3 000 | 135 000 | 405 000 000 |
| 3 000 | 140 000 | 420 000 000 |
* Hypothèse dans laquelle un patient « franchise sociale » consomme en moyenne plus de médicaments B que les bénéficiaires du régime préférentiel, simulation avec ticket modérateur de 3 000 francs.
** En 1995 : 94 000 personnes au niveau national; ensuite, augmentation par l'incorporation des chômeurs > 6 mois.
3. Abaissement du coût des médicaments B pour les patients dont la carte SIS les rattache à la notion de « malade chronique ».
Bien que cette possibilité ne soit pas prévue au niveau réglementaire, il est théoriquement possible d'inscrire sur la carte SIS la notion de « malade chronique », telle que définie pour le forfait frais de santé. Selon cette définition, le nombre de forfaits frais de santé peut être estimé à 56 000 (au niveau national).
Tableau 10
Pas de ticket modérateur pour les médicaments B, malades chroniques
| Ticket modérateur* moyen |
Nombre de malades chroniques |
Coût |
| 5 000 | 56 000 | 280 000 000 |
| 10 000 | 56 000 | 560 000 000 |
| 15 000 | 56 000 | 840 000 000 |
* Ici encore, pas de données individualisées dans Farmanet.
4. Incorporation du ticket modérateur des médicaments B dans le montant de la franchise (franchise sociale et franchise fiscale).
L'impact budgétaire de cette mesure n'est pas encore connu. Les principales inconnues sont :
1. le ticket modérateur des médicaments par individu;
2. le nombre de personnes qui atteindront ainsi le seuil de 15 000 francs de ticket modérateur (franchise sociale) ou le seuil variable (franchise fiscale);
3. le ticket modérateur total que ces personnes paient.
Sans doute une telle mesure aura-t-elle une incidence budgétaire trop forte.
3.2. Octroi d'un statut préférentiel aux chômeurs de longue durée
Actuellement, les chômeurs chefs de ménage et les chômeurs isolés ont droit au régime préférentiel en cas d'hospitalisation. Selon les calculs de l'INAMI, l'extension du régime préférentiel aux soins ambulatoires engendrerait un coût de 1,1 milliard de francs pour 392 160 personnes concernées.
Si l'on se limite aux chômeurs âgés (> 50 ans, 49 532 chefs de ménage et personnes à charge, 29 458 isolés), ce coût supplémentaire retombe à 330 millions de francs, ce qui paraît entrer dans les faisabilités budgétaires.
Un membre demande à l'intervenant quels seront les effets éventuels de l'échelonnement des soins de santé sur l'accès à ceux-ci.
M. Van der Meeren répond que la médecine de famille est traditionnellement la porte d'accès aux soins de santé. En augmentant le capital de confiance du patient dans le médecin de famille et en garantissant des soins de qualité à ce niveau, on pourra éviter certains frais d'hôpitaux et, partant, les quote-parts personnelles y afférentes, ce qui abaissera le seuil financier d'accès aux soins de santé.
Par ailleurs, on constate que l'augmentation progressive du ticket modérateur élève le seuil d'accès à la médecine générale. En 1994 par exemple, le nombre des consultations des médecins traitants a baissé d'environ 0,5 million. Ce chiffre n'est cependant pas très parlant si on ne le ventile pas par groupes de patients.
De nombreuses questions ont été posées notamment au sujet des VIPO. Les VIPO bénéficiant du régime préférentiel voient leur médecin traitant environ 12 fois par an, dont 8 ou 9 fois à domicile. Les VIPO ne bénéficiant pas du régime préférentiel voient leur médecin traitant 8 fois par an, dont 5 ou 6 fois à domicile. Or, un examen de l'évolution de ces chiffres au cours des années 1988 à 1994 permet de constater pour ce dernier groupe, dont les moyens financiers sont quelque peu plus élevés, une légère augmentation du nombre des consultations. Pour les VIPO-100 par contre, on a constaté, pour la même période, une légère diminution. Bien que cette dernière évolution ne soit pas spectaculaire, il convient néanmoins de se poser la question de savoir s'il n'y a pas, dans ce groupe, une tendance à la sous-consommation.
À la question de savoir si un échelonnement complet bouleverserait l'accès aux soins de santé, il est impossible de répondre catégoriquement par l'affirmative. La plupart des problèmes en ce qui concerne l'accessibilité aux soins se situent dans des secteurs tels que les soins intra-muros, les technologies et les médicaments onéreux, les implants, les prothèses de la hanche, les stimulateurs cardiaques, etc. C'est dans ces secteurs que les interventions personnelles ne cessent de croître et ce n'est pas en valorisant les soins de première ligne, quelque louable que soit cette initiative en soi, que l'on résoudra le problème.
Une autre membre fait remarquer que M. Van der Meeren a suggéré dans son exposé de régler la franchise fiscale aux guichets. Pourtant, on a déjà souligné les problèmes qu'une telle façon de faire pourrait poser quant à la protection de la vie privée. On pourrait en outre objecter qu'au moment où le patient se présente au guichet, seul son revenu d'il y a deux ans est connu du fisc.
M. Van der Meeren répond que le même problème se pose pour contrôler le plafond de revenus de 456 000 francs dans le cadre du régime préférentiel. On utilise en l'occurrence une déclaration sur l'honneur pour les personnes qui, deux ans auparavant, remplissaient les conditions d'accès au régime. Cette déclaration peut être contrôlée ultérieurement. On peut supposer que le revenu du groupe qui entre en ligne de compte pour la franchise fiscale ne subit pas d'augmentation spectaculaire au fil des ans.
Quoi qu'il en soit, il reste d'avis que la franchise fiscale est un mécanisme de correction trop lent.
Un membre fait remarquer que l'offre en matière de soins à domicile reste actuellement limitée et ne propose qu'un éventail restreint de services. Étoffer cette offre permettrait de réduire les soins intra-muros . S'il est indéniable qu'une telle évolution servirait le bien-être des patients, serait-elle aussi génératrice d'une diminution des coûts ?
M. Van der Meeren estime que si une telle évolution permettrait effectivement de réaliser des économies, on doit néanmoins se garder de les exagérer. On constate que du fait de la réduction de la durée des hospitalisations, les situations que l'on rencontre dans le secteur des soins à domicile sont de plus en plus graves. Dans certains cas, on pourrait même parler d'hospitalisations à domicile. Actuellement, ces soins sont toujours indemnisés aux tarifs ordinaires des soins infirmiers à domicile, mais si cette tendance perdure, on devra aussi octroyer des indemnités majorées dans ce secteur pour certaines prestations.
Il estime personnellement que le développement des soins à domicile sera largement conditionné par deux phénomènes : la multiplication des services et l'extension de l'assurance dépendance. Les soins à domicile restent en effet largement ciblés sur le groupe des personnes âgées.
Un autre intervenant constate que, selon le préopinant, il est possible de fixer un coût moyen pour certaines affections chroniques, étant donné que les besoins de toutes les personnes qui en souffrent sont plus ou moins identiques. Par ailleurs, il considère comme malades chroniques les patients qui dépassent la franchise sociale pendant deux années d'affilée. Reste à savoir si ces deux critères permettent de cibler tous les malades chroniques ou s'il faut en prévoir d'autres.
M. Van der Meeren convient qu'il y a en l'espèce un problème, dont l'INAMI reconnaît d'ailleurs l'existence. En ce qui concerne la définition de la notion de maladie chronique, on n'en est qu'au stade initial. Un groupe de travail aura précisément pour mission d'affiner les définitions à cet égard.
Un membre note qu'à cause de l'informatisation croissante de l'assurance maladie, les personnes sont de moins en moins nombreuses à se présenter aux guichets des mutualités. Il devient par conséquent beaucoup plus difficile de cerner ces personnes et leurs besoins.
On en arrive ainsi à des situations où des collectes d'argent sont organisées à l'occasion de kermesses au profit des patients souffrant de pathologies graves. Ils pourraient peut-être faire appel au Fonds spécial de solidarité, mais comme la mutualité ignore leur problème, ils ne savent pas comment bénéficier de l'aide de ce fonds.
M. Van der Meeren confirme que les contacts entre les mutualités et leurs affiliés sont devenus impersonnels. Le rôle de détection du guichetier est passé au second plan, mais a été repris en partie par les centres d'aide sociale. Par contre, cette évolution a ceci de positif que l'on s'attaque aux problèmes d'une manière plus professionnelle et moins caritative.
Un membre fait remarquer qu'une des principales évolutions que connaît actuellement le secteur des hôpitaux est la tendance à coopérer ou à fusionner. Il s'ensuit des fermetures de départements, voire parfois d'hôpitaux tout entiers, ce qui fait que le patient doit aller plus loin pour trouver un dispensateur de soins. A-t-on déjà étudié l'incidence de ce phénomène sur certains groupes de patients, comme les personnes âgées ?
M. Van der Meeren répond qu'aucune étude spécifique n'a été réalisée sur la question. Les affiliés des mutualités socialistes sont en majorité des citadins, pour qui la disparition d'un département ou d'un hôpital ne constitue pas un problème insurmontable quant à la distance les séparant du dispensateur de soins. S'il devait y avoir des difficultés sur ce plan c'est surtout à la campagne qu'elles devraient se poser.
L'intervenant précédent acquiesce sur ce dernier point, d'autant plus que ce sont avant tout les petits hôpitaux en dehors des centres urbains qui sont les premières victimes des fusions. On peut par ailleurs se poser la question de savoir quelles économies ces fusions permettront de réaliser. En pratique, les institutions tentent à cet égard, d'une manière assez compréhensible, d'obtenir le régime financier le plus avantageux possible, avec les prix de la journée d'entretien de l'hôpital coopérant le plus cher et avec l' indemnité de reconversion la plus élevée possible. Ce sont les petits hôpitaux, dont les prix de la journée d'entretien sont bas, qui sont supprimés.
M. Hanon remarque que les conceptions des diverses fédérations nationales, qui se rencontrent assez régulièrement dans le collège des médecins-directeurs au sein de l'INAMI, sont assez similaires. Il est évident que plus la consommation médicale augmente, plus le coût pour la collectivité est élevé. Il faut dès lors veiller en permanence à ce que le groupe relativement restreint de patients qui ont les plus grands besoins reste couvert d'une manière adéquate. Ces patients ne peuvent être les victimes du système tel qu'il fonctionne aujourd'hui.
On ne peut en effet nier, en toute honnêteté, que, dans la structure actuelle de l'INAMI, il est très difficile de définir des concepts globaux comme celui de malade chronique. Étant donné que l'on travaille avec des budgets fermés, tous les intéressés cherchent dans une certaine mesure à garder pour eux les ressources propres au détriment d'une approche plus générale. La « sectarisation » au niveau de l'INAMI rend particulièrement difficile une politique globale.
M. Wouters admet que, alors que le patient devrait être l'élément central des soins de santé, les discussions au sein des diverses commissions de l'INAMI sont souvent dominées par des préoccupations financières et budgétaires qui ne répondent pas toujours aux besoins des patients. Une gestion globale consisterait à inventorier tous les besoins, à fixer des priorités et à partager les budgets en fonction de cela. Ce n'est que de cette façon que l'on peut mener une bonne politique de santé.
Depuis 1994, la Belgique connaît le système de la franchise sociale et de la franchise fiscale, ayant pour but d'aider les personnes qui sont confrontées à une consommation médicale élevée. La question peut être posée de savoir si les deux mesures touchent les patients nécessitant des soins lourds. On constate en effet dans la pratique que les personnes qui ont de grands besoins et ne disposent que de revenus limités ne se font pas ou pas suffisamment soigner parce que le seuil financier de l'aide est trop élevé pour elles. Ici aussi, il faudrait par conséquent vérifier en profondeur où se situent les besoins et axer les incitations financières là-dessus.
Deux ans à peine après l'adoption des deux mesures, les pouvoirs publics ont d'ailleurs déjà prévu des restrictions pour en limiter l'impact budgétaire, qui s'élevait à 1,5 milliard de francs.
L'année dernière, un nouveau système a été instauré pour répondre aux besoins de quelques catégories spécifiques de patients nécessitant des soins lourds. En soi, ce n'est pas une mauvaise chose, mais il faut bien être conscient que plus on se montre sélectif, plus d'autres groupes de patients sont délaissés.
C'est pourquoi l'Union nationale des mutualités libérales plaide pour une approche globale dans laquelle toute personne qui a besoin de soins est soumise à un ticket modérateur suivant sa capacité financière. Lorsque le budget n'est pas suffisant, on doit pouvoir accepter que des charges un peu plus lourdes soient imposées aux patients qui peuvent les supporter, de manière à dégager une plus grande marge de manoeuvre financière pour d'autres qui ont plus de difficultés. Un moyen de le faire pourrait consister à créer un nouveau statut qui tiendrait le milieu entre le statut VIPO et le ticket modérateur normal.
Un membre ne peut en principe approuver l'idée de faire supporter les charges des soins de santé suivant la capacité financière. Quelle est cependant la voie la plus adéquate pour y parvenir dans la pratique ?
M. Wouters répond que notre système connaît actuellement, grosso modo , deux « tarifs » : le statut VIPO et le tarif normal. À côté de cela, il y a la franchise sociale et fiscale. La personne qui rentre dans la bonne catégorie va recevoir une allocation supplémentaire lorsque les tickets modérateurs dépassent 15 000 francs par an. On pourrait mieux moduler ce montant en fonction du revenu et des besoins.
Par ailleurs, on pourrait adapter l'ensemble des secours sur lesquels la franchise est appliquée. À l'heure actuelle, les médicaments B ne sont pas inclus dans la franchise, bien qu'ils représentent pour beaucoup de patients la majeure partie de leurs dépenses médicales. Les patients ayant besoin de soins lourds pourraient tirer avantage de l'intégration de ces médicaments dans l'ensemble. Afin de préserver l'équilibre du système, cela devrait probablement coïncider avec une révision des montants limites. En procédant de la sorte, le système serait toutefois plus en prise sur les besoins médicaux réels.
Un membre est en principe d'accord avec l'orateur précédent qui plaide pour l'intégration des médicaments B dans la franchise. Il est moins d'accord avec l'affirmation selon laquelle la franchise sociale ne toucherait pas le groupe qui a le plus de besoins. La franchise de tickets modérateurs n'est accordée qu'après le paiement de 15 000 francs à ce titre, ce qui n'est pas peu en termes de consultations de médecins.
M. Wouters est du même avis. On ne peut toutefois se former une idée des besoins réels que lorsque les médicaments sont également inclus dans la franchise. Celui qui dépense 15 000 francs en visites doit dans la plupart des cas débourser un multiple de ce montant en médicaments et moyens auxiliaires et c'est principalement dans ce domaine que les problèmes de l'accès aux soins de santé se posent. Le système répondrait par conséquent mieux à ses objectifs si les médicaments B étaient pris en compte, en y ajoutant une révision des plafonds.
Un orateur constate que les deux orateurs plaident pour une plus grande sélectivité, en axant davantage les interventions financières sur les groupes qui en ont vraiment besoin, au détriment de ceux qui peuvent supporter les charges personnellement. Ne craignent-ils pas qu'une sélectivité trop poussée puisse saper la base du système ? Les personnes qui, d'une part, contribuent au financement de l'assurance maladie mais qui, d'autre part, voient augmenter démesurément leur part personnelle dans les coûts ne vont-elles pas décrocher et chercher d'autres formes de couverture ? En d'autres mots, ne faut-il pas maintenir, dans un tel système, un équilibre entre la solidarité obligatoire et le principe de l'assurance ?
M. Hanon peut comprendre cette préoccupation. L'Union nationale des mutualités libérales, comme du reste toutes les mutualités, continue de croire fermement en une solidarité générale, indépendamment du revenu. Cette solidarité n'est cependant pas nécessairement affectée en dirigeant davantage les efforts vers certains groupes ayant des besoins plus grands, qu'ils ne peuvent satisfaire eux-mêmes. De plus, une évaluation et une correction du système s'imposent en permanence. Le transfert des handicapés du Fonds national à l'INAMI est par exemple perçu par les intéressés, sur certains points, comme un pas en arrière et de telles affaires doivent pour le moins être examinées.
Un membre constate que, selon les orateurs, les conventions sont de nos jours excessivement négociées sur la base de budgets historiques, si bien qu'il y a une marge insuffisante pour procéder à une redistribution des moyens, qui serait mieux réglée sur la prise en charge des maladies chroniques.
M. Hanon peut se rallier à cette constatation. À titre d'exemple, il se réfère à l'accord conclu avec les centres de réadaptation fonctionnelle pour la prise en charge de la réadaptation multidisciplinaire de patients entre la phase aiguë et la fin de la phase chronique. Ces prestations peuvent également être prescrites par la voie monodisciplinaire, par prestation, par le biais de la nomenclature. Il semble impossible de réunir toutes les parties autour de la table pour trouver une solution globale, centrée sur les besoins du patient et non sur les intérêts financiers des prestataires. Chaque type de prestataire souhaite préserver son propre budget et choisit la solution qui lui est la plus favorable.
Un membre remarque qu'un des principaux problèmes pour le patient présentant une pathologie lourde est l'augmentation des dépenses pour les médicaments non remboursables et partiellement remboursables. Plusieurs raisons sont avancées : surconsommation, comportement prescripteur, formation des prix, mauvais accords avec l'industrie pharmaceutique, etc.
Comment les mutualités libérales voient-elles cette explosion des coûts ?
M. Wouters répond que tous les éléments cités par l'orateur précédent ont une influence sur l'augmentation des coûts des médicaments. La reconnaissance des médicaments et la formation des prix échappent en majeure partie au contrôle de l'INAMI. On voit ici aussi que, dès que le pouvoir de décision dans une telle matière est partagé entre différents départements et organismes, il devient particulièrement difficile de définir une politique générale à l'égard du secteur.
Bien évidemment, la hausse du ticket modérateur ne peut pas non plus être dissociée de la limitation de l'enveloppe financière avec laquelle l'AMI doit travailler.
Un orateur pense que c'est précisément là que réside une des questions essentielles de ce débat. Les frais élevés des patients sont-ils provoqués par le fait qu'on dépense trop en soins de santé ou sont-ils dus au fait que les besoins réels ne sont plus couverts par l'enveloppe financière mise à la disposition par les pouvoirs publics ?
M. Wouters estime que si les choses restent en l'état, les moyens disponibles seront de toute façon insuffisants. Sans vouloir prétendre d'emblée qu'il n'y a pas le moindre problème de financement, il demeure persuadé que de nombreux problèmes pourraient être résolus si la politique était menée dans une optique plus globale. Aussi longtemps que chacun restera accroché à son budget, il y aura en tout cas des distorsions : certains recevront trop de moyens par rapport à leurs besoins, et d'autres devront s'accommoder de budgets trop restreints.
M. Hanon déclare, pour ce qui concerne les prix des médicaments, qu'ils sont certes fixés par le ministère des Affaires économiques, mais que l'INAMI décide s'ils seront remboursés ou non. Par cette voie, il est possible d'exercer une certaine influence sur la formation des prix. Lors de la décision relative au remboursement, des efforts sont effectivement accomplis pour commercialiser les produits à un prix aussi bas que possible.
Il faut toutefois admettre qu'à ce niveau aussi le phénomène du lobbying agit. Toute personne qui connaît le secteur sait qu'il existe des médicaments dont la valeur thérapeutique peut être mise en question, mais qui sont néanmoins remboursés parce que cela arrange le producteur. Parfois, on voit d'ailleurs que ces produits sont retirés sans problèmes de la nomenclature dès qu'ils sont devenus commercialement moins intéressants pour la firme en cause. On peut difficilement affirmer qu'une vision générale des besoins du patient est à la base des décisions de rembourser ou non les médicaments.
De tous les secteurs, l'industrie pharmaceutique est du reste la seule à tirer profit d'un prix élevé des médicaments. Les bénéfices que les pharmaciens font sur un produit sont en effet limités par la loi.
Au-delà de la formation des prix, la maîtrise des dépenses pour médicaments serait également servie par une vision plus globale du comportement des médecins en matière de prescriptions. Sur ce point, on peut à juste titre placer beaucoup d'espoirs dans les nouveaux instruments de politique, tels que Farmanet ou l'introduction d'un dossier médical général. Un meilleur enregistrement permettra de vérifier où ce comportement s'écarte des moyennes régionales et d'engager une discussion à ce sujet.
Comme il a déjà été dit, les hausses des dépenses dans le secteur des médicaments sont attribuables à plusieurs facteurs. Pour y remédier, il est dès lors nécessaire de travailler à différents niveaux. Même si l'influence de l'INAMI sur la formation des prix est limitée, l'institut peut contribuer à maintenir les dépenses sous contrôle.
Un membre se réfère à des auditions antérieures, au cours desquelles il est apparu que les dépenses pour tickets modérateurs s'élèvent à 62 milliards et celles pour médicaments non remboursables à 64 milliards. Cette dernière catégorie, qui est extrêmement lourde pour certains patients, n'est en fait soumise à aucun contrôle des prix et l'utilisation n'est pas non plus enregistrée par Farmanet. C'est une situation singulière. On peut même se demander si les producteurs de médicaments n'ont pas intérêt, quelquefois, à ce que certains produits soient classés dans la catégorie D. En théorie, il doit pourtant être possible d'enregistrer également l'utilisation de ces médicaments.
M. Hanon répond que la Belgique affiche un taux élevé d'utilisation de médicaments et que la surconsommation se situe probablement, en bonne partie, dans le secteur des médicaments non remboursables. Actuellement, l'INAMI n'a en effet aucune vue sur la vente de ces moyens par le biais des pharmacies.
Un orateur suivant demande quelle est l'attitude des mutualités libérales face aux médicaments génériques et aux préparations magistrales. Le gouvernement mène en ce domaine une politique assez contradictoire, et c'est un euphémisme. D'une part, on entend régulièrement dire qu'il faut promouvoir l'emploi des médicaments génériques, mais, d'autre part, il signe des traités internationaux portant prorogation des droits de brevet sur les médicaments. Il a aussi fait l'impossible pour retirer les préparations magistrales du marché.
M. Hanon répond que l'Union nationale est effectivement un partisan convaincu des médicaments génériques et des préparations magistrales, dans la mesure où ceux-ci sont moins chers que les spécialités. Dans ce contexte, il plaide aussi pour le droit de substitution du pharmacien, qui se heurte cependant à une forte résistance de la part du corps médical, entre autres. Néanmoins, il serait possible de faire beaucoup de choses par cette voie. Les mutualités socialistes, notamment, disposent de listes dont peuvent faire usage les médecins qui veulent prescrire les produits les moins coûteux à leurs patients.
Le membre déplore que l'autorité publique n'intervienne pas avec plus de sévérité en cette matière. Celui qui suit l'actualité sait en effet que le prix des spécialités pharmaceutiques est influencé par un grand nombre d'éléments qui n'ont pas grand-chose à voir avec les coûts de production. Les prix sont en effet déterminés la plupart du temps à partir d'une position monopolistique et les vastes campagnes de promotion doivent être imputées d'une manière ou d'une autre.
M. Hanon répète qu'on peut effectivement, dans un certain nombre de cas, s'interroger sur la façon dont les spécialités pharmaceutiques sont reconnues et leur prix est formé. Il arrive que des produits soient présentés au remboursement à un prix inacceptable et il est parfois difficile de résister à la pression que cela comporte.
Dans le même temps, on ne peut cependant pas faire du tort au secteur. Les campagnes publicitaires agressives, qui accordaient directement des avantages à des médecins, ont diminué dans de fortes proportions et les firmes qui s'y adonnent encore peuvent être considérées comme des exceptions. On ne peut toutefois pas perdre de vue que certains médicaments sont chers, il est vrai, mais qu'ils donnent aussi des résultats spectaculaires. Le coût des médicaments est par conséquent élevé, mais ils apportent également une énorme contribution à la santé et permettent souvent de faire des économies dans d'autres domaines.
Un membre accueille M. Van Oycke et le docteur Lefèvre, de la Fédération nationale des mutualités neutres.
M. Van Oycke remercie la commission de l'avoir invité à participer à ce débat. Étant donné que la commission a déjà entendu un exposé sur les cotisations des patients dans le secteur des soins de santé et sur les mesures qui ont déjà été prises à l'égard des malades chroniques, il ne s'y attardera pas.
En ce qui concerne l'accès aux soins de santé des groupes de patients en butte à des difficultés, les mutualités neutres pensent que la politique devrait se polariser sur trois aspects :
L'intégration des médicaments dans la franchise sociale. Ceux-ci représentent en effet une dépense de plus en plus lourde pour les patients et ne sont pas pris en compte pour la franchise des tickets modérateurs au-delà du montant fixé.
L'élaboration d'une assurance de dépendance. Il résulte des données statistiques que l'espérance de vie de la population belge croît d'un mois par an. Le groupe des personnes âgées, et des personnes âgées nécessitant des soins, continuera d'augmenter. Bien qu'il ne s'agisse pas nécessairement de patients chroniques, c'est un des groupes de patients socialement les plus faibles, qui ont un grand besoin de secours mais pour qui le seuil financier est souvent trop élevé. Quoique l'assurance soins de santé soit une matière très sensible sur le plan communautaire, une discussion sur ce thème devrait pour le moins être entamée sans retard.
Enfin, la politique devrait accorder plus d'attention et de moyens aux soins en fin de vie. Quelques expérimentations de soins palliatifs sont certes en cours, mais les mutualités neutres estiment que ce secteur doit encore être développé.
Mme Lefèvre ajoute qu'effectivement, beaucoup de patients ne comprennent pas pourquoi les médicaments n'entrent pas en ligne de compte pour la franchise sociale. Pour un malade chronique, en particulier, l'essentiel des dépenses va à une médication vitale.
Un membre demande s'il peut en conclure que l'organisation met en discussion la classification de certains médicaments.
Mme Lefèvre répond qu'un abaissement du coût des médicaments indispensables peut être atteint par plusieurs voies. Les médicaments peuvent être intégrés dans la franchise, on peut opter pour une réduction générale du ticket modérateur sur les médicaments de la catégorie B ou on pourrait, pour des produits spécifiques qui sont essentiels pour les malades, envisager un changement de catégorie.
Un membre signale que la consommation de médicaments est déjà exceptionnellement élevée en Belgique. Cette consommation ne sera-t-elle pas encore renforcée si les médicaments sont inclus dans la franchise sociale sans mesures d'accompagnement ?
M. Van Oycke répond que, pour ce qui est de la consommation de médicaments, une distinction doit être faite entre les pharmaciens d'hôpitaux et les pharmaciens indépendants. Dans les hôpitaux, on planche actuellement sur des systèmes, souvent forgés sur le modèle américain, permettant de mieux maîtriser et diriger l'utilisation des médicaments à travers la création de groupes structurés.
Dans le secteur ambulatoire, il est important que le corps médical soit sensibilisé aux problèmes. Au surplus, les mutualités ont sur ce plan une importante mission d'information et d'« éducation » à remplir vis-à-vis de leurs membres.
Il remarque enfin que les mutualités neutres sont très favorables à la promotion de la consommation de médicaments génériques.
Un membre signale que lors d'auditions antérieures, il est apparu qu'environ 25 % de la consommation de médicaments porte sur des produits non remboursables (catégorie D). À l'heure actuelle, le comportement prescripteur à l'égard de ces produits n'est manifestement pas enregistré et n'est donc pas contrôlable. Il n'est pas naïf, dans ce contexte, de s'attendre à ce que l'utilisation puisse être réduite de manière radicale par une action de sensibilisation des médecins. On n'a en effet aucun moyen de pression.
Un orateur suivant trouve qu'il est trop facile de se débarrasser de ces problèmes en dénonçant le comportement prescripteur injustifiable des médecins. Les causes de la consommation élevée sont probablement plus complexes que cela et il serait inouï de s'en tirer de cette façon.
Un membre demande quelle est, du point de vue de l'accessibilité des soins, la position des mutualités neutres en ce qui concerne les assurances complémentaires.
M. Van Oycke répond qu'il est clair pour tout le monde que le coût des soins de santé augmente d'une manière sensible pour diverses raisons. À cela s'oppose toutefois le fait que le financement s'effectue au moyen d'enveloppes fixes qui ne répondent pas aux hausses des coûts et qui ne peuvent pas être dépassées. Cette situation ne peut que conduire à un gonflement des dépenses mises à charge des patients, ce qui fait croître la demande d'assurances complémentaires. On constate qu'en ce moment, certains organismes mènent des négociations avec les hôpitaux sur les coûts qui excèdent les remboursements de l'INAMI, en vue de les couvrir par le biais d'assurances privées.
En tant que défenseur de l'assurance obligatoire, on ne peut que regretter que les négociations sur le coût des soins pour le patient sont, de la sorte, déplacées progressivement du lieu où elles devraient normalement avoir lieu, à savoir l'INAMI, vers d'autres cénacles. D'autre part, cette évolution est un signe des temps devant lequel on ne peut fermer les yeux.
Quoi qu'il en soit, les mutualités neutres restent absolument favorables à une assurance collective et obligatoire fortement développée. L'assurance complémentaire n'est, comme son nom l'indique, qu'un complément de l'assurance obligatoire.
M. Guillaume fait remarquer que l'exposé qui sera fait par ses collègues et lui-même comporte quatre volets :
1. l'utilisation ou la non-utilisation des instruments légaux existants pour garantir l'accessibilité des soins de santé et ses conséquences pour le patient;
2. la cohérence d'un certain nombre de mesures envisagées dans le régime des indépendants avec les mesures générales visant à améliorer l'accès aux soins de santé;
3. les soins infirmiers à domicile et, plus précisément, la question de savoir si le financement des structures y afférentes favorise l'accès des patients chroniques aux soins de santé;
4. la médicalisation de la gestion de l'assurance maladie en tant que clé du succès de la politique en matière d'accessibilité des soins de santé au profit du patient.
La (non-)utilisation des instruments légaux existants et ses conséquences pour le patient
a) La théorie
Sur le plan légal, les dernières années ont été marquées, dans le domaine de l'assurance maladie, par deux évolutions importantes qui ont donné aux pouvoirs publics les instruments nécessaires pour mener une politique volontariste : la loi Moureau de février 1993 et l'introduction de la norme de croissance réelle de 1,5 % dans le cadre du plan global de novembre 1993.
Cette norme de croissance signifie en effet de facto que l'autorité publique décide seule des moyens qui sont attribués à l'assurance soins de santé (droit de veto du Conseil général de l'INAMI). De son côté, la loi Moureau vise à responsabiliser toutes les parties concernées par l'assurance maladie : financiers, prestataires et mutualités.
b) La pratique
1. Manque de courage des autorités
Dans la pratique, on constate toutefois que les autorités n'ont pas le courage d'utiliser effectivement ces instruments.
En soi, l'instauration d'une norme de croissance ne doit pas être considérée comme négative. La santé n'est en effet qu'une mission de l'État, à côté d'autres comme l'enseignement, la justice, l'infrastructure, etc. Si l'État estime que, dans le cadre d'une politique générale, les dépenses de santé ne peuvent augmenter que de 1,5 % au-delà du taux d'inflation, cela peut être un choix politique justifiable.
Ce dont il s'agit cependant, c'est que l'État doit également, dans un tel cas, prendre les mesures d'accompagnement nécessaires pour atteindre cette norme de croissance. Celles-ci peuvent consister en mesures structurelles ou en solutions de facilité.
Les mesures structurelles exigent à l'évidence un certain courage politique. Elles nécessitent un débat social sur la question de savoir quelles formes de soins doivent encore être couvertes par l'assurance maladie-invalidité. Un tel débat doit être mené sur une large échelle, au-delà des acteurs sur le terrain; c'est notamment une tâche du Parlement.
Les mesures structurelles impliquent également qu'un certain nombre d'inefficacités du système soient abordées au moyen d'économies « intelligentes » qui ne touchent pas à l'accessibilité ou à la qualité des soins dispensés, mais à certains intérêts particuliers. Des exemples en sont le secteur des médicaments et la radiologie. Un examen radiologique des vertèbres, par exemple, n'a actuellement plus aucune fonctionnalité parce qu'on passe ensuite à d'autres techniques qui donnent de meilleurs résultats. Ces prestations coûtent cependant encore 1,9 milliard de francs par an à l'INAMI parce que personne ne souhaite porter atteinte aux intérêts du groupe professionnel en cause.
Les solutions de facilité sont des mesures qui frappent le groupe le plus faible et le groupe le moins organisé en ce qui concerne la pression politique, à savoir le patient, en limitant le caractère remboursable des secours. C'est cette dernière solution que les pouvoirs publics ont privilégiée depuis 1994.
2. Confusion d'intérêts dans l'assurance maladie
Les mutualités politiques sont à la fois assureurs et prestataires de soins, ce qui rend illusoire une répartition objective des moyens, qui sont limités.
Le tableau ci-dessous indique la croissance du budget de l'assurance maladie et de quelques secteurs distincts pour la période 1994-1999 :
| Médecins. Artsen | 21 % | ou/of 3,9 % par an/per jaar |
| Dentistes. Tandartsen | 23 % | 4,2 % par an/per jaar |
| Médicaments (1990-1997) Geneesmiddelen (1990-1997) | 65 % | 7,5 % par an/per jaar |
| Soins infirmiers Verpleegkunde | 40 % | 6,9 % par an/per jaar |
| MRS/MRPA (soins infirmiers à domicile/maisons de repos) MRS/MRPA (thuisverpleging/rustoorden) | 51 % | 8,6 % par an/per jaar |
| INAMI RIZIV | 26 % | 4,7 % par an/per jaar |
On constate que les budgets des trois secteurs qui sont liés à de puissants groupes de pression spécifiques comme les médecins, ou de ceux dans lesquels plusieurs mutualités sont actives, augmentent à un rythme nettement plus rapide que le budget total. Cela signifie qu'ils réclament une part de plus en plus large du gâteau. L'accroissement dans le secteur des soins infirmiers à domicile et dans les maisons de repos s'explique en partie par le vieillissement de la population, mais certainement pas dans une telles mesure. Le bureau du plan évalue l'effet net du vieillissement à 0,4 % par an.
3. Mesures pseudo-sociales en faveur du patient
Un exemple typique de solution artificielle d'un faux problème est la loi Vermassen. Pour les dispensateurs de soins en général et les hôpitaux en particulier, les revenus globaux sont importants. Les suppléments d'honoraires en constituent un élément. La plus facile de ces voies est l'assurance obligatoire, où l'on peut laisser tourner le moulin de la facturation.
Un système correct de facturation consiste à éviter les zones grises : les prestations pour lesquelles l'autorité décide qu'elles ne sont pas remboursables ne pourraient pas non plus être facturées dans l'assurance obligatoire. Un exemple est, à cet égard, la discussion sur le remboursement de matériel d'endoscopie et de viscérosynthèse. Alors que certains pensaient que ces frais étaient inclus dans le prix de la journée d'hospitalisation, d'autres, les prestataires, estimaient que ce n'était pas le cas puisque ces éléments n'existaient pas encore au moment de la définition de ce prix. On en arrive ainsi à une situation où le patient ne sait jamais à quoi s'en tenir.
c) Les conséquences pour le patient
L'attitude laxiste des pouvoirs publics a eu pour conséquence que depuis 1994, on assiste à un déplacement considérable des charges vers le patient, et ce à la suite de toute une série de mesures linéaires :
la sélectivité (1994), par laquelle les tickets modérateurs pour la consultation de généralistes et de spécialistes ont été sensiblement majorés;
le relèvement des parts personnelles pour les soins en milieu hospitalier et l'introduction de plusieurs forfaits pendant la période 1994-1996;
la diminution linéaire des honoraires de 2 à 3 % fin 1996-début 1997.
Cette politique est compensée quelque peu mais pas totalement, loin de là, par :
la franchise sociale et fiscale;
l'extension du statut VIPO;
l'extension de l'assurabilité;
les mesures en faveur des malades chroniques.
d) Conclusions
De ce qui précède, on peut conclure qu'il existe dès maintenant une panoplie d'instruments légaux permettant d'améliorer l'accessibilité des soins de santé, sans devoir prendre de mesures spécifiques à cet effet. Ces instruments ne sont cependant pas utilisés pour une double raison :
manque de courage politique;
confusion d'intérêts dans le chef des mutualités politiques.
M. Steylemans déclare que son exposé aborde un problème plus spécifique, mais néanmoins très actuel, parce qu'il fait l'objet de deux articles de la loi portant des dispositions sociales, examinée en ce moment au Parlement : la prise en charge, par l'assurance obligatoire, des médicaments qui sont administrés à des indépendants dans le cadre d'une hospitalisation de jour.
Ce problème, qui fait actuellement l'objet d'un différend entre les mutualités indépendantes et l'INAMI, concerne la question de savoir si les médicaments qui sont facturés à un indépendant dans le cadre d'une hospitalisation de jour doivent être pris en charge par l'assurance obligatoire des gros risques ou par le malade lui-même comme une dépense pour petits risques.
1. Point de vue de l'Union des mutualités indépendantes
L'Union des mutualités indépendantes estime que ces médicaments doivent être supportés par l'assurance obligatoire, aussi bien pour des raisons de nature réglementaire que dans l'intérêt de l'assurance maladie.
a) Sur le plan réglementaire
L'arrêté royal du 30 août 1964 dispose que les médicaments administrés pendant un séjour dans un établissement hospitalier rentrent dans la catégorie des prestations pour gros risques. La notion de « séjour » en hôpital est naturellement encore utilisée dans un grand nombre d'autres textes de loi et conventions. Il n'est pas spécifié, en l'occurrence, qu'il ne peut être question de séjour que lorsque le patient a passé une nuit à l'hôpital.
b) Intérêt pour l'assurance maladie
Du point de vue économique, les pouvoirs publics ont tout intérêt à ce que l'hospitalisation de jour soit encouragée au maximum.
Environ quarante pour cent des indépendants, et ce ne sont pas nécessairement les plus fortunés, ne sont pas assurés contre les petits risques. Lorsque les médicaments ne sont pas remboursés lors d'une hospitalisation de jour, ils sont obligés de passer une nuit à l'hôpital s'ils veulent éviter les charges supplémentaires des médicaments.
La conséquence en est que l'INAMI supporte finalement ces coûts mais doit payer en outre deux journées de séjour au lieu du forfait de l'hospitalisation de jour. En fin de compte, la mesure coûtera beaucoup plus.
2. Point de vue de l'INAMI
De l'avis de l'INAMI, la notion de « séjour » implique une nuitée à l'hôpital. À défaut, les médicaments administrés ressortissent au régime « petits risques », avec la conséquence qu'ils doivent être supportés par l'assurance complémentaire ou par l'assuré lui-même.
3. Point de vue des tribunaux
Le pouvoir judiciaire s'est prononcé clairement sur ce différend. Le tribunal du travail de Bruxelles (25 juin 1996) et la cour du travail de Bruxelles (3 novembre 1997) ont explicitement déclaré que seule l'inteprétation de l'Union nationale des mutualités indépendantes est conforme à la législation en vigueur.
4. Point de vue du Collège national intermutualiste et des différentes instances de l'INAMI
L'affaire a été soumise au Collège national intermutualiste qui, après un débat, s'est complètement rallié au point de vue déjà exposé par les mutualités indépendantes et a confirmé que ce point de vue préserve les intérêts du système.
Les instances de l'INAMI ont rejeté la proposition de l'INAMI de modifier la réglementation en sens opposé. Une large majorité s'est rangée à l'avis de l'Union nationale des mutualités indépendantes.
5. Dispositions du projet de loi portant des dispositions sociales
L'article 104 du projet de loi-programme, qui est actuellement à l'examen à la Chambre des représentants, prévoit que les médicaments administrés dans le cadre d'une hospitalisation de jour ne peuvent pas être mis à charge de l'assurance obligatoire. L'article 105 fixe la date d'entrée en vigueur de cet article au 1er juillet 1996.
Dans les développements de ces dispositions, il est dit qu'elles sont la confirmation de la réglementation existante. Rien n'est cependant moins vrai. Ce qu'elles font, c'est imposer de manière rétroactive l'interprétation de la réglementation, qui a été explicitement rejetée par les tribunaux.
Une importante question porte, à cet égard, sur les conséquences de ces dispositions, et en particulier sur leur caractère rétroactif, pour les assurés. Les montants qui, conformément à l'interprétation des tribunaux, ont été mis à charge de l'assurance obligatoire doivent en être soustraits et
si l'intéressé a une assurance complémentaire, sont pris en charge par cette dernière;
si l'intéressé n'a pas d'assurance complémentaire, et 60 % des indépendants sont dans ce cas, il devra les rembourser lui-même.
À noter, dans ce contexte, la remarque formulée par la ministre des Affaires sociales au sein de la commission compétente de la Chambre des représentants lors de la discussion de la loi-programme :
« La ministre affirme que les mesures proposées dans les articles 94 et 95 sont nécessaires pour éviter que les mutualités qui ont déjà remboursé de tels frais à partir du 1er juillet 1996, ne puissent les récupérer auprès de leurs membres. » (Doc. parl. Chambre, nº 1722/14, 97-98)
Ces propos sont totalement incompréhensibles puisque les deux articles visent exactement l'inverse.
M. Wautot déclare qu'il approfondira dans on exposé un certain nombre de problèmes relatifs aux soins à domicile et à leur financement.
Aupraravant, il souhaite souligner que l'Union nationale des mutualités indépendantes n'a aucun lien avec une organisation qui fournit des prestations dans ce secteur et se distingue en cela de quelques autres fédérations nationales de mutualités. L'Union n'a dès lors aucun a priori à l'égard de ces prestataires, quel que puisse être leur statut et indépendamment de la structure dans laquelle ils oeuvrent. En pratique, elle travaille du reste aussi bien avec des soignants indépendants qu'avec des structures plus petites et plus grandes qui dispensent des services dans ce secteur.
Dans le Brabant wallon, par exemple, où les mutualités indépendantes sont fortement représentées, les prestations sont fournies, dans le cadre d'un programme général de soins infirmiers à domicile, par la Croix Jaune et Blanche et par des infirmiers indépendants, à raison de 50 % environ chacun. La coopération se fait par voie d'accords avec les personnes et les structures concernées. Sur l'ensemble du pays, aucun prestataire n'est exclu de cette forme de service et l'Union n'aurait aucun intérêt à prononcer des exclusives sur ce plan.
Lorsque, par conséquent, des réflexions seront formulées dans l'exposé ci-après à l'égard du service structuré, ce n'est pas parce que l'Union aurait une préférence particulière pour une coopération avec des infirmiers indépendants, mais plutôt parce qu'elle s'inquiète d'un certain nombre d'évolutions en rapport avec le service organisé.
Evolutions récentes dans le secteur
Au cours des dernières années, le secteur des soins infirmiers à domicile s'est trouvé à plusieurs reprises au centre de l'actualité, en raison, notamment, des manifestations des infirmiers et infirmières qui protestaient contre la surcharge de travail. Ces derniers mois ont été marqués par deux faits déterminants pour l'avenir du secteur.
Le premier consiste dans les tables rondes organisées par le ministre de la Santé publique. Une des idées centrales formulées dans ce contexte concernait la révision des qualifications requises du personnel soignant, à savoir le remplacement progressif du brevet par une nouvelle spécialisation, et surtout l'instauration, par l'arrêté royal nº 78, d'une nouvelle catégorie de « soignants » qui travaillent sous la surveillance des infirmiers spécialisés.
La réforme proposée introduirait une logique hospitalière dans les soins à domicile. La grande différence entre les soins à domicile et les soins en hôpital ou maison de repos réside dans le fait que l'infirmier à domicile est plus ou moins seul. Il doit être préparé à affronter une situation imprévue et à réagir de manière rapide et indépendante, contrairement à l'infirmier en milieu hospitalier qui peut toujours s'en remettre au corps médical ou aux infirmiers ayant une qualification spéciale.
À cela s'ajoutaient les problèmes financiers des organisations de services. Ces problèmes, notamment, ont été à l'origine des plaintes du personnel concernant la charge élevée du travail et ont amené les syndicats et les organisateurs de services à alerter ensemble les pouvoirs publics. Résultat : la ministre des Affaires sociales a réuni autour de la table les représentants des mutualités, des syndicats et des organisations de services qui, après concertation, ont proposé toute une série de mesures destinées à assainir le secteur :
un budget supplémentaire de 300 millions de francs, étalé sur deux ans, pour les cas graves. La commission de convention qui devait décider de l'affectation de ce montant a, en ce qui concerne la première tranche de 150 millions libérée en juillet de cette année, opté pour une revalorisation du forfait C, une solution de facilité qui peut soulever des questions. L'échelle de Katz qui est utilisée pour la détermination d'un « cas grave », prend en compte plusieurs éléments mais ne mesure pas le temps qu'un infirmier passe au chevet d'un malade. Le manque de temps était précisément une des principales plaintes des acteurs sur le terrain. En appliquant cette échelle, certains malades qui nécessitent des soins plus longs restent encore sur la touche.
l'extension du « Maribel » social qui, à la suite d'une réduction des charges sociales devrait dégager plus de moyens pour l'embauche de personnel soignant. Le probléme est toutefois qu'il y a sur le marché trop peu de personnel soignant pour couvrir les besoins. D'où la proposition de recruter des aides infirmiers, quelque peu comparables aux « soignants » proposés par le ministre de la Santé publique. Ceux-ci travailleraient en équipes avec des infirmiers gradués, et ce dans le cadre des services de soins infirmiers à domicile. De tels services existent dès à présent mais ne sont pas formellement reconnus comme dispensateurs de soins de niveau de l'INAMI.
L'ensemble du dossier est actuellement bloqué par les difficultés concernant la définition précise du « soignant » ou de l'« aide infirmier » et la façon dont ils doivent travailler en équipe avec des infirmiers spécialisés. Du fait que la date limite pour le Maribel social approche, il a été décidé de laisser provisoirement le problème des soignants pour ce qu'il est et de prendre deux mesures : reconnaître formellement les « services de soins infirmiers à domicile » comme dispensateurs de soins et donner la possibilité au ministre d'accorder, sur proposition des instances ad hoc de l'INAMI, une subvention additionnelle à ses « services de soins infirmiers à domicile » dont la définition n'est pas encore connue pour rembourser un certain nombre de missions spécifiques pour ces services.
Tout cela est réglé par les articles 111 à 113 de la loi portant des dispositions sociales. En soi, ces dispositions ne sont pas une mauvaise chose, si ce n'est qu'elles s'accompagnent de quelques incertitudes et effets indésirables.
Récemment, l'INAMI a dégagé un montant de 300 millions de francs sur un bugdet extraordinaire de 1,5 milliard de francs que le gouvernement a mis à disposition pour de nouvelles initiatives. Sans le dire explicitement, cette somme devrait servir à financer les missions des services de soins infirmiers à domicile, pour lesquels des moyens ne sont pas alloués en ce moment.
On a par conséquent libéré un montant de 300 millions au profit de services pour lesquels il n'existe pas encore de critère de reconnaissance et dont les missions n'ont pas encore été définies. Du point de vue de l'accès aux soins de santé dans un secteur aussi important que les soins infirmiers à domicile, on peut se demander si l'affectation d'une telle somme n'aurait pas dû être précisée davantage.
Étant donné qu'il n'existe pas de définition légale de ces prestataires de services, on peut poser la question de savoir si chaque groupement d'infirmiers qui répond à des critères qualitatifs précis pourra être reconnu comme service de soins infirmiers à domicile. Des articles en question de la loi portant des dispositions sociales on ne peut rien en inférer. Si des groupement d'infirmiers indépendants ou des structures plus petites taille où on travaille dans les liens d'un contrat ne peuvent pas être reconnus comme prestataires, certaines régions où les grands services structurés ne sont que peu ou pas représentés risquent de ne pas pouvoir utiliser ces nouvelles formes de services, avec les subventions qui s'y rattachent.
On risque de commettre en cela une erreur qui se produit plus fréquemment lors de la création de nouveaux services. L'attribution des budgets est basée habituellement sur le service actuel des structures fixes opérant dans le domaine concerné, sans faire une évaluation approfondie de la plus-value qu'elles représentent pour le patient, ou d'autres besoins éventuels de ce patient qui ne sont pas satisfaits en ce moment.
En sachant en outre que dans un secteur où on travaille avec des forfaits, comme les soins infirmiers à domicile, la transparence est de toute manière un problème, on peut se demander si les moyens aboutissent effectivement chez les malades qui en ont le plus besoin et correspondent au volume de travail que représentent les soins dispensés à ces malades.
Cette situation soulève une série d'autres questions :
Si la reconnaissance de ces services n'est pas basée sur les besoins du patient, ne risque-t-on pas de porter atteinte à sa liberté de choix et d'intégrer des discriminations injustifiées dans le système ?
Bien que cela ne soit pas réalisé à l'heure actuelle, l'idée qui sous-tend les services de soins infirmiers et leur financement est qu'ils vont travailler dans un stade ultérieur avec des « aides infirmiers ». La sécurité et la qualité des services futurs ne seront-elles pas hypothéquées en reconnaissant dès à présent les prestataires et en mettant à leur disposition des moyens sans que l'on ait la moindre certitude sur les qualifications qui seront exigées d'eux ?
On voit déjà apparaître, en prélude au système, certaines pratiques qui peuvent être cataloguées comme « parasitisme » et « fausse activité d'indépendant ». Une des conditions de la reconnaissance des nouveaux services consisterait à pouvoir facturer sur le même numéro de tiers payant. Les prestataires, principalement indépendants, sont approchés par certains individus qui proposent que l'indépendant fournisse les services et les factures à l'intermédiaire. Ce dernier remet les factures sous un numéro de tiers payant à l'INAMI, en prélevant bien entendu un pourcentage sur les honoraires de l'indépendant. Tant en Flandre qu'en Wallonie, on voit émerger de tels individus qui essaient de tirer habituellement parti de la crainte qu'éprouvent certains prestataires indépendants d'être exclus du nouveau système de services de soins infirmiers à domicile.
Ces mesures ne sont-elles pas en quelque sorte une boîte de Pandore ? On va encourager la mise en place de nouvelles structures qui réclameront toutes de nouvelles missions, avec les moyens financiers y afférents, alors qu'ils s'agit souvent de nouvelles formes de services qui naîtront de toute façon. C'est ainsi qu'en Flandre, on planche actuellement sur un système d'assurance soins où c'est probablement la consommation qui sera subventionnée et non le prestataire, ce qui rend la création de nouveaux services plus facile que dans un système où l'apparition d'un nouveau prestataire a pour conséquence que les subventions sont partagées entre plusieurs prestataires. Par ailleurs, on constate que les entreprises de travail intérimaire et les organismes d'assurance examinent en ce moment la possibilité de créer leurs propres services de soins infirmiers à domicile.
Du fait que le pouvoir fédéral prévoit des moyens supplémentaires pour des missions qui ne sont pas totalement définies, ce sera un encouragement à la création d'autres services nouveaux qui réclameront le plus possible de ressources publiques additionnelles, sans avoir la moindre certitude que les critères auxquels ils doivent répondre donneront une plus-value en ce qui concerne l'offre de secours à ceux qui en ont besoin.
Un élément non négligeable est, à cet égard, la constatation que les dépenses pour le secteur des soins infirmiers à domicile sont passées de 12 milliards de frans en 1996 à 18 milliards de francs en 1998.
Solutions de remplacement
Dans tout cela, on peut se demander si les instruments actuellement disponibles pour faciliter l'accès aux soins infirmiers à domicile sont utilisés au maximum.
À qui le régime du tiers payant est-il réservé ?
La demande ou non d'un ticket modérateur n'a actuellement plus rien à voir avec les besoins du patient mais bien avec la concurrence entre les différents prestataires. Il faut oser se demander si le système ne serait pas plus honnête si les tickets modérateurs avaient un caractère obligatoire et si, en même temps, on faisait un usage maximal d'autres mesures comme la franchise sociale et la franchise fiscale.
Les problèmes des forfaits dans l'art infirmier doivent être abordés d'urgence. La ministre des Affaires sociales a promis de soumettre la nomenclature à une évaluation approfondie, mais jusqu'ici on n'a pas fait grand-chose.
Pour assurer un accès maximal à ce type de soins, il faut évoluer vers un système consistant à financer les soins dispensés et non les structures qui les dispensent. Si l'on s'en tient malgré tout à ce dernier système, le financement doit se faire sur la base de missions clairement définies et d'un audit externe, et les structures doivent satisfaire à des critères de reconnaissance précis dont il est prouvé qu'ils répondent à un besoin réel.
M. Draps déclare que le message qu'il veut apporter peut se résumer à une plaidoirie en faveur d'une approche médicalisée des affections chroniques dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité.
Lorsqu'un assureur ou l'autorité publique souhaite savoir quelles sont les dépenses pour des patients déterminés, il est essentiel de connaître avec précision la pathologie et son coût. On dispose des factures des prestations fournies et au moyen d'instruments tels que Farmanet on sait qui prescrit quoi et quel est le coût d'une pathologie.
Dans un tel système médicalisé, le point de départ est par conséquent le diagnostic. Il n'est guère sensé de partir des patients qui ont les coûts les plus élevés parce que même avec cette méthode il faut vérifier dans un deuxième temps de quelles pathologies ils souffrent et quelles dépenses celles-ci représentent.
Dès lors le coût d'une pathologie est connu, l'on peut déterminer quelle partie est à la charge de l'assurance obligatoire et quelle partie est supportée par le patient.
Actuellement, les mutualités disposent de données diagnostiques qui peuvent être utilisées. Tel est notamment le cas pour les décisions des médecins-conseils dans le contexte d'un diagnostic. Celles-ci comportent entre autres :
(chapitre IV) les médicaments qui sont prescrits
les codes de la nomenclature (chirurgie)
la fin de l'hospitalisation (727)
l'incapacité de travail primaire pendant les 12 premier mois
l'invalidité : ici aussi, il est parfaitement possible de représenter la diagnose sous forme codée. Ce codage a lieu au sein de l'INAMI, mais il est dépassé et n'est pas communiqué.
Il est réjouissant de constater que le gouvernement a pris récemment des mesures basées sur le même raisonnement. Ce sont :
les conventions spéciales relatives à certaines affections :
mucoviscidose
affections neuromusculaires
maladies métaboliques héréditaires rares
fauteuils roulants
le remboursement de certains produits alimentaires pour
le cas visés au chapitre IVbis
les maladies méthaboliques héréditaires rares
Il y a, par ailleurs, l'arrêté royal du 2 juin 1998 qui ne procède absolument pas d'une logistique médicale en instaurant deux forfaits pour incontinence et maladies chroniques. Un des critères qui y sont adoptés sont les forfaits de soins à domicile type B ou C ou, pour l'incontinence, type 3 ou 4. Ces typologies sont basées sur l'échelle de Katz qui cependant, comme l'a fait remarquer un orateur précédent, ne permet pas de mesurer le besoin en soins et, partant, le coût pour le malade.
En ce qui concerne l'incontinence, par exemple, un patient appartient au type 3 sur l'échelle de Katz s'il souffre régulièrement d'incontinence d'urine durant un jour. Cela ne dit toutefois rien sur son besoin de soins puisqu'un tel patient est généralement en mesure de se soigner lui-même et que le forfait de soins est inutile.
D'où les propositions qui sont actuellement débattues au sein du Collège national des médecins-conseils et de la commission de convention, en vue de définir un critère pour le besoin de soins.
Un autre problème, en matière d'incontinence, est que les patients qui ont besoin de sondes mais qui peuvent les placer eux-mêmes sont repris dans la catégorie 2. Il en résulte que dans le cadre de l'arrêté royal du 2 juin 1998 ils ne peuvent pas prétendre au forfait qui y est accordé, bien qu'ils doivent faire face à de grosses dépenses pour ces sondes.
L'Union des mutualités indépendantes a présenté au comité d'assurance une proposition pour le remboursement de ces sondes, mais ce dossier traîne depuis deux ans, alors qu'il n'implique pas un budget énorme.
Analyse du groupe de patients qui peuvent faire usage du forfait pour soins à domicile
M. Draps procède ensuite à une analyse du groupe de patients qui peuvent faire usage du forfait pour soins infirmiers à domicile (SID). Cette analyse est basée sur une enquête effectuée auprès de 1 657 288 assurés de l'Union. Sur ce nombre, 21 % ont plus de 60 ans et, dans ce groupe, 91 % ont entre 60 et 84 ans.
Dans le groupe total d'assurés de l'Union il y a 14 037 patients, soit 0,85 % de l'ensemble des personnes qui peuvent utiliser le forfait. L'âge moyen de ce groupe est de 77,4 ans. L'espérance de vie étant plus élevée chez les femmes, leur part dans ce groupe représente le double de celle des hommes.
Pour le forfait B (et C) l'âge moyen est de 74 ans. Conclusion : la mesure ne touche pas les patients chroniques mais bien le groupe des personnes âgées dépendantes.
En prenant dans ce groupe de 14 037 patients ceux qui ont plus de 60 ans, on obtient un nombre de 12 837 ou 91,5 %. L'âge moyen y est encore plus élevé, soit 80,4 ans. Dans ce cas aussi il ne s'agit pas nécessairement de malades chroniques, que le législateur a pourtant cherché à atteindre avec le forfait soins.
Si on analyse à présent le gourpe de moins de 60 ans, on constate qu'il comprend 1 200 patients (pour l'ensemble de la population cela fait 1 200 × 6,5 = 7 800) ayant un âge moyen de 45 ans. Parmi ce groupe, 42 % ont le forfait B, ce qui, par extrapolation pour toute la Belgique, correspond à 42 % de 7 800 = 3 200 patients âgés en moyenne de 46 ans.
L'arrêté royal du 23 mars 1982
Une autre approche des maladies chronique est celle de l'arrêté royal du 23 mars 1982, qui définit les « pathologies lourdes ». Le but de cet arrêté était de réduire les tickets modérateurs sur les prestations des kinésithérapeutes pour certaines affections graves qui n'étaient pas de nature chronique. Un certain nombre de pathologies ont cependant été exclues explicitement des avantages prévus par l'arrêté.
Cet arrêté royal prend comme seul point de départ le diagnostic et ne tient pas compte de l'atteinte fonctionnelle, dont il devrait en fait s'agir. Il offrait la possibilité d'aboutir, en fonction de la volonté du médecin-conseil, à un statut pour la vie. Il ne tenait pas davantage compte de l'utilité du traitement (par exemple les patients atteints de thrombose qui, après un certain temps, n'ont plus besoin de traitements lourds de kinésithérapie).
Exemples d'une approche médicale
M. Draps cite ensuite deux exemples d'une approche médicale de pathologies, au moyen de données qui sont disponibles auprès des organismes assureurs :
le coût d'un traitement SIDA
une approche médicalisée des pathologies lourdes.
1. Le coût d'un traitement SIDA
L'étude du coût d'un traitement contre le SIDA couvrait le dépistage, la biologie et le traitement chronique dont le patient a besoin.
Le coût par patient pouvait être estimé en 1994 à 150 000 francs par mois ou 1 800 000 francs par an. Pour 1 500 patients, cela équivaut à 225 000 000 francs par mois ou 2 700 000 000 francs par an.
Pour un patient qui est indépendant et n'est pas hospitalisé, cela signifie qu'il devra payer chaque mois entre 22 000 et 24 000 francs de médicaments. De la répartition des coûts pour la sécurité sociale, il résulte que le traitement par médicaments représentait 38 % de la dépense totale, l'hospitalisation environ la moitié. Grâce aux nouvelles méthodes de traitement, ce dernier coût a sans doute baissé de manière sensible récemment.
En se fondant sur ces données, l'Union des mutualités indépendantes a jadis proposé à la ministre des Affaires sociales d'intégrer ces patients dans une catégorie « pathologies de longue durée et graves », quelque peu comparable aux anciennes « maladies sociales », tombées en désuétude. La totalité des coûts pourrait ainsi être prise en charge par des centres et des prestataires reconnus. Aucun progrès n'a cependant été accompli sur ce plan.
2. Approche médicalisée des pathologies graves
D'une part, l'approche était basée sur les divers codes de la nomenclature et les accords des médecins-conseils. D'autre part, quelques pathologies ont été détectées à l'aide de médicaments soumis à l'accord des médecins-conseils, à savoir la maladie de Parkinson, les maladies métaboliques héréditaires, la tuberculose et les tumeurs malignes.
La méthode utilisée a l'avantage d'isoler un certain nombre de pathologies lourdes, mais elle a aussi plusieurs inconvénients, et notamment le fait que l'on part toujours d'une approche minimaliste.
L'étude a abouti à la conclusion que les patients détectés sur la base des codes de la nomenclature représenteraient une dépense de 728 408 594 francs pour 6 590 patients, ce qui constitue un montant considérable.
Les patients détectés sur la base des médicaments représentent une dépense de 33 762 445 francs pour 6 491 patients.
Ces chiffres concernent également les seuls assurés de l'Union. Pour se faire une idée à l'échelon de la Belgique, il faut les multiplier par 6,5. Entre les deux catégories, il y a toutefois une certaine interférence parce que, par exemple, les patients atteints d'un parkinson ou d'un cancer figurent dans les deux.
En conclusion générale de cette étude, on peut affirmer que pour aboutir à une approche médicalisée des patients chroniques en vue de leur prise en charge, il est absolument indispensable de connaître la morbidité des assurés et les coûts qu'entraîne la maladie et qui
sont à la charge de l'assurance obligatoire;
sont à la charge du patient.
Ces coûts sont connus des organismes assureurs et, à partir de là, le lien peut être établi entre les deux facteurs (morbidité et coûts).
La connaissance de la diagnose permet de déterminer exactement quels groupes de personnes ont besoin de moyens financiers et d'utiliser les budgets limités au profit de ces groupes.
Pour un fonctionnement efficace de ces dispositifs, il importe toutefois que la transmission de données par voie électronique soit améliorée, ce qui exige à son tour un meilleur codage dans plusieurs domaines (par exemple le formulaire 727 à la fin d'une hospitalisation). Cela suscite dans certains cas une opposition assez véhémente de la part des médecins, d'une part, pour des raisons de protection de la vie privée, d'autre part, parce qu'ils craignent que les mutualités, qui sont elles-mêmes prestataires de certaines formes de soins, utilisent ces données à leur propre profit.
Garantir à chacun des chances égales d'accès au médicament, implique de la part des pouvoirs publics de concilier, d'une part, les impératifs économiques et de santé publique et, d'autre part, les exigences budgétaires.
À la suite de l'ouverture du grand marché européen le 1er janvier 1993 et de l'entrée en vigueur de la loi relative à la concurrence le 1er avril 1993, la législation belge en matière de prix a été profondément modifiée en avril 1993.
Cette réforme a pour principe de base la libre fixation des prix des biens, produits et services. Elle ne s'applique toutefois pas au secteur du médicament en raison du manque de concurrence effective. Le libre-choix du patient ne peut y être garanti. En outre, le médicament n'est évidemment pas un bien comme un autre. Il est important que le prix de celui-ci le rende accessible à l'ensemble de la population.
La réglementation des prix relative aux médicaments repose en fait sur deux textes de lois. Le premier concerne les produits susceptibles d'être admis au remboursement dans le cadre de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
La base juridique est la loi-programme du 22 décembre 1989, et plus précisément le Titre VI. Cette loi transpose, en droit belge, la directive européenne 89/105/CEE concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance maladie.
L'arrêté ministériel d'exécution datant du 29 décembre 1989 détermine la procédure à suivre :
Les prix des nouveaux médicaments ainsi que les hausses de prix des médicaments existants sont soumis à l'approbation préalable du ministre de l'Économie.
Pour être recevable, la demande doit, entre autres, contenir :
la structure de prix proposée et, pour une demande de hausse, la structure de prix actuelle, c'est-à-dire une justification chiffrée précise du prix proposé;
pour un nouveau médicament, une copie de l'attestation d'enregistrement, de la notice scientifique et de la notice au public;
pour un médicament existant, la date d'application du prix actuel ainsi que les quantités vendues au cours de la dernière année;
les conditions de marché et de concurrence et notamment une comparaison avec les prix pratiqués dans les États membres de l'Union européenne;
une copie des comptes annuels des 3 dernières années et le cas échéant, de la division pharmaceutique;
lorsqu'une demande n'est pas complète, le demandeur en est aussitôt averti. Le délai d'examen est interrompu jusqu'à la réception des données manquantes;
avant de prendre une décision, le ministre est tenu de consulter la Commission des prix des spécialités pharmaceutiques, créée par l'arrêté royal du 8 août 1975 (modifié par l'arrêté royal du 4 janvier 1990). Il s'agit d'une commission où sont représentés l'industrie, la distribution (pharmaciens et grossistes), le syndicats, les mutuelles, les intérêts familiaux, les coopératives de consommation. Y participent également en tant qu'experts, un représentant du ministère de la Santé publique et un autre de l'INAMI;
le ministre dispose d'un délai de 90 jours pour prendre une décision. Celle-ci doit être motivée et reposer sur des critères à la fois objectifs et vérifiables. En l'absence d'une décision dans les 90 jours, le demandeur est habilité à appliquer le prix ou la hausse de prix demandés;
le prix ou la hausse de prix autorisés peuvent être appliqués dès réception de la décision du ministre;
toute décision de refus partiel ou total peut, dans les 60 jours de sa notification, faire l'objet d'un recours en annulation au Conseil d'État.
Le ministre est également compétent en matière de fixation de marges maxima. Pour la distribution en gros et la dispensation des médicaments vendues en officine, la marge du grossiste est fixée à 13,1 % de son prix de vente hors TVA, avec un maximum de 88 francs par présentation. Pour le pharmacien, la marge est de 31 % de son prix de vente hors TVA, avec un maximum de 300 francs par présentation. Ces dernières dispositions ne concernent toutefois pas les médicaments génériques, dont les marges de distribution sont actuellement libres.
Toutefois, lors de l'élaboration du budget de l'INAMI pour 1999, le gouvernement a décidé de promouvoir ce type de médicaments. Une proposition visant à assurer aux pharmaciens, pour les médicaments génériques, une marge identique en valeur absolue à celle dont ils disposent pour la spécialité originale, est actuellement à l'étude.
Des dispositions relatives aux marges en milieu hospitalier sont également prévues.
En ce qui concerne les médicaments non remboursables, la base juridique est la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix. Deux arrêtés d'exécution coexistent. Le premier (arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments non remboursabless) concerne les médicaments dont au moins une forme est soumise à prescription médicale. L'autre (arrêté ministériel eu 20 avril 1993 portant dispositions particulières en matière de prix) concerne les médicaments non remboursables à délivrance libre.
Par rapport à la procédure décrite ci-desus, quelques différences peuvent être relevées :
1. pour les nouveaux médicaments :
s'ils sont à délivrance libre, la firme introduit une simple notification de prix au plus tard 10 jours avant sa mise en application. Sauf rejet signifié par le ministre, le produit est admis comme nouveau et le prix accepté;
s'ils sont soumis à prescription médicale et pour autant que le principe actif et l'indication thérapeutique soient nouveaux, un système de notification est également en place avec cette fois un délai de 30 jours avant l'application du prix proposé.
2. Le ministre doit consulter la Commission pour la régulation des prix créée par l'arrêté royal du 3 juin 1969. Cette commission diffère de la précédente par sa composition moins spécifique. En effet, elle est chargée de rendre un avis non seulement sur les dossiers relatifs aux médicaments mais également sur tous les autres secteurs encore sous contrôle, par exemple les maisons de repos, la distribution d'eau, le pain, les assurances... Ainsi, les mutuelles, les pharmaciens, n'y sont pas représentés.
3. Le délai d'examen des dossiers est réduit à 60 jours pour les médicaments à délivrance libre.
Qu'il s'agisse de médicaments remboursables ou non remboursables, l'examen du dossier et la décision qui en découle restent fondamentalement basés sur des éléments identiques. Ces éléments doivent concilier les impératifs économiques développés par les firmes et ceux d'ordre budgétaires que ce soit dans le chef des patients ou de la Sécurité sociale.
De fait, l'industrie pharmaceutique en raison de l'internationalisation du marché, est soumise à un surcroît de pression concurrentielle. Les efforts des entreprises pour conserver un volume d'activité suffisant sont, dès lors, légitimes. Il s'agit toutefois d'un point sur lequel il faut être vigilant dans la mesure où cela a des conséquences au niveau du budget de l'INAMI. À l'heure actuelle, on doit constater que, dans ce budget, le secteur du médicament dépasse trop souvent l'objectif budgétaire qui lui est assigné.
Un autre élément que l'on ne peut ignorer est celui de l'emploi : le secteur pharmaceutique occupe, de façon directe ou indirecte, un nombre considérable de travailleurs. En 1996, 19 669 personnes étaient directement employées.
Enfin, il faut permettre aux firmes pharmaceutiques d'atteindre un niveau d'activité suffisant leur permettant d'accentuer l'investissement en faveur de la recherche.
Mais, dans le même temps, les médicaments, qu'ils soient ou non remboursables, doivent être accessibles à tous. Il est inacceptable de voir des personnes privées de soins ou insuffisamment prises en charge. Un médicament, vendu à un prix accessible et pris à temps, peut souvent éviter bien des drames.
Les médicaments génériques et les copies, moins chers et de qualité, peuvent en cela contribuer à une accessibilité la plus large possible.
La fixation des prix maxima des produits pharmaceutiques est une compétence du ministre des Affaires économiques. C'est un moyen d'atteindre une partie de l'objectif, tout en tenant compte des impératifs économiques des sociétés.
Dans le cadre de ressources limitées et d'une demande croissante, mais dans un souci de garantir l'acès aux traitements les plus efficaces et de créer un espace budgétaire pour les traitements nouveaux, diverses mesures ont été proposées. Certaines, portant directement sur le prix du médicament remboursable, sont déjà appliquées.
Il s'agit :
d'un blocage des prix mis en place depuis le 1er janvier 1996;
d'une réduction linéaire de 2 % intervenue en juin 1996;
d'une réduction de prix des médicaments dont chaque principe actif fait l'objet d'un remboursement depuis plus de 15 ans.
Une mesure relative à la conclusion de contrats « prix-volume » a été également discutée. Ces contrats concernaient les molécules inovatrices dont le remboursement serait accepté en fonction d'un chiffre d'affaires convenu entre la firme et les autorités publiques. À ce jour, cette mesure n'a pas fait l'objet d'une mise en application.
Il est donc raisonnable de penser que, dans l'avenir, la régulation des dépenses devrait être davantage axée sur les volumes consommés et l'évaluation de la qualité de leur utilisation.
Un membre demande si la loi relative à la concurrence s'applique au secteur du médicament.
Mme Pierlet répond négativement. La loi relative à la concurrence qui est entrée en vigueur le 1er avril 1993, repose sur le principe de la libre fixation des prix des biens, produits et services. Plusieurs secteurs dont celui du médicament, sont exclus de cette libre fixation des prix et sont soumis à un système de réglementation des prix.
L'intervenant précédent fait remarquer que le ministre ne peut prendre une décision sur le prix ou la hausse de prix qu'après que la Commission des prix des spécialités pharmaceutiques a émis un avis sur le dossier. Ce système repond-il aux attentes en ce qui concerne la maîtrise des prix des médicaments ? La Commission connaît-elle les prix de transfert ? Est-il possible de donner pour les trois dernières années un aperçu des décisions du ministre sur le prix d'un médicament qui s'écartent de la proposition de la firme en cause ?
Mme Pierlet pense que la Commission des prix fonctionne comme il convient. La firme qui introduit un dossier pour un nouveau produit doit exposer clairement la structure du prix et, pour une hausse de prix, communiquer la structure actuelle du prix du produit. Pour un produit belge, cela signifie que le prix fait l'objet d'une analyse approfondie et que la part des produits de base utilisés, les salaires, les frais de commercialisation, la marge bénéficiaire, etc. sont communiqués. Le prix auquel le produit est vendu à l'étranger est également précisé. Le dossier comprend également un rapport du ministère de la Santé publique sur la formation des prix de produits identiques ou comparables qui se trouvent sur le marché et sur la plus-value que le produit peut avoir sur les médicaments existants, etc.
Les prix de transfert sont régulièrement demandés par le biais des filiales belges des firmes étrangères, mais ils ne sont pas toujours fournis. La maison mère considère souvent ces données comme confidentielles, même à l'égard de ses propres filiales.
Par expérience, elle peut confirmer que le prix accordé par le ministre est rarement celui qui est demandé par la firme, parce que le dossier renferme généralement des données qui justifient une modification. Lorsque le prix n'est pas modifié, cela tient souvent à des situations spécifiques. Pour les médicaments génériques la firme propose par exemple un prix qui est de quelques pour-cent inférieur à celui de la spécialité pharmaceutique à laquelle il est fait référence. Pour les conditionnements de produits existants, les firmes s'alignent souvent sur les prix qui sont déjà adoptés pour le remboursement de l'INAMI, de sorte que le ministre donne la plupart du temps son accord.
Dans d'autres cas, l'évaluation s'effectue très sérieusement et des comparaisons sont par exemple faites avec des médicaments comparables existants, avec les prix pratiqués à l'étranger : le prix du jour par rapport à celui de produits similaires, etc.
Le membre croit savoir que, voici quelques années, l'utilité thérapeutique du médicament devait être indiquée dans le dossier introduit auprès des Affaires économiques. Cette obligation ne serait plus d'application.
Mme Pierlet répond que l'évaluation de l'utilité thérapeutique du médicament se fait lors de l'enregistrement par le ministère de la Santé publique, qui est naturellement l'instance la plus compétente en la matière. Le dossier qui est soumis aux Affaires économiques contient notamment l'attestation d'enregistrement et la notice scientifique. Si la Commision pour la transparence a rendu un avis, celui-ci est également joint au dossier, bien que la loi ne l'impose pas.
Un orateur suivant constate qu'en ce qui concerne la comparaison des prix avec l'étranger, on ne vérifie que le prix auquel le produit est commercialisé dans d'autres États membres de l'Union européenne. Ne serait-il pas intéressant, dans certains cas, d'aller voir ailleurs, par exemple les prix, pratiqués sur le marché américain, des médicaments qui y sont produits ?
Mme Pierlet répond que selon les dispositions de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989, une comparaison de prix avec les autres États membres de l'Union européenne suffit. En pratique, cependant, on vérifie également ce qu'un produit coûte par exemple en Suisse. Il arrive aussi que l'on s'informe du prix d'un produit sur le marché américain, mais il ne faut pas se faire d'illusions à ce sujet. Les prix des médicaments aux États-Unis sont sensiblement plus élevés qu'en Belgique.
Un membre relève que si les prix des médicaments en Belgique se trouvent effectivement à un niveau normal par comparaison avec l'étranger, la conclusion qui s'impose est que les dépenses substantielles consacrées aux médicaments dans notre pays sont attribuables à une consommation exceptionnellement élevée.
Mme Pierlet répond que pour les nouveaux produits qui arrivent sur le marché, les prix pratiqués en Belgique comptent parmi les plus bas d'Europe. Depuis le 1er janvier 1996, un blocage des prix est du reste mis en place pour les médicaments existants.
Une augmentation des dépenses n'est par conséquent imputable qu'à un accroissement de la consommation ou à un glissement dans les habitudes de consommation, des médicaments anciens et bon marché vers les médicaments nouveaux et plus chers.
Une autre intervenante demande si l'on peut du reste déduire des réponses qui ont déjà été fournies que, pour les nouveaux médicaments qui sont mis sur le marché, une politique plus stricte a été menée, ces dernières années, en matière de fixation des prix.
Mme Pierlet répond que pour les anciens médicaments aussi, lorsqu'ils étaient commercialisés, les prix appliqués en Belgique étaient comparables à ceux des pays environnants. S'il y a actuellement des différences, elles doivent être probablement attribuées à des baisses des prix à l'étranger, soit opérées par les firmes, soit imposées par les pouvoirs publics. Aux Pays-Bas par exemple, où les médicaments étaient nettement plus chers qu'en Belgique, une révision générale du système de fixation des prix a eu lieu il y a deux ans, en fonction des prix de quatre pays de référence dont le nôtre. Cela confirme que la Belgique n'est pas considérée comme un pays cher pour ce qui est des médicaments.
Un membre demande si on a une quelconque idée de la manière dont les frais de recherche sont incorporés dans les prix. Il n'est en effet pas inconcevable que, pour les médicaments qui soit sur le marché international, ces frais soient détournés en premier lieu sur les pays où des fonds sont disponibles dans le cadre d'un régime d'assurance.
Mme Pierlet répond que les frais de recherche pour les médicaments produits en Belgique sont généralement connus. Pour les médicaments fabriqués à l'étranger, par contre, ils font partie des prix de transfert, qui ne sont pas communiqués par la plupart des sociétés mères. Lorsqu'un dossier est examiné, on peut agir de différentes manières sur le prix. Si les frais de recherche sont détournés par exemple sur la Belgique au profit d'autres pays, et cela peut être une importante indication pour un avis de réduction du prix proposé.
Mme Van der Wildt observe que, comme il est apparu au cours des auditions précédentes, les médicaments couvrent une fraction importante des dépenses pour soins de santé. Il n'est dès lors que logique que les producteurs de médicaments apportent leur contribution au présent débat.
M. De Wever précise que l'Association générale de l'industrie du médicament représente 98 % des producteurs en Belgique.
Comme la commission l'a demandé, le débat sera axé sur la situation des patients chroniques et sera structuré de la manière suivante :
l'industrie pharmaceutique en Belgique;
l'importance des médicaments pour les affections chroniques;
l'accès aux fournitures pharmaceutiques en Belgique;
· dans une perspective historique;
· dans une perspective internationale (l'AGIM est membre de la Fédération européenne de l'industrie pharmaceutique, qui a fourni les données chiffrées à ce sujet);
les mesures d'économie à l'égard de l'industrie du médicament, qui ont des conséquences aussi bien sur les plans des prix que pour ce qui concerne l'offre de nouveaux produits;
le frein à l'innovation; celui-ci est peut-être avantageux du point de vue purement budgétaire, mais hypothèque lourdement l'avenir de la santé publique.
1. L'industrie pharmaceutique en Belgique
| 1995 | 1996 | 1997 | |
| Chiffre d'affaires marché intérieur (départ usine) (milliards de francs). Omzet binnenlandse markt (af-fabriek) (miljarden frank) | 80,0 | 85,5 | 88,9 |
| Exportations (milliards de francs). Uitvoer (miljarden frank) | 121,5 | 129,6 | 171,9 |
| Importations (milliards de francs). Invoer (miljarden frank) | 92,4 | 104,6 | 126,8 |
| Solde de la balance comerciale (milliards de francs). Saldo van de handelsbalans (miljarden frank) | + 29,1 | + 25,0 | + 45,1 |
| Emploi (personnes). Tewerkstelling (personen) | 19 038 | 19 669 | 20 117 |
| Investissements (milliards de francs) Investeringen (miljarden frank) | 10,3 | 11,2 | 12,7 |
| Dépenses R et D (milliards de francs) Uitgaven R en D (miljarden frank) | 13,7 | 16,3 | 24,0 |
M. Van Eeckhout fait remarquer que le chiffre d'affaires sur le marché national s'élevait à 88,9 milliards de francs en 1997. Il s'agit du chiffre « départ usine ». Le chiffre d'affaires en termes de distribution tourne autour de 133 milliards de francs. Ces chiffres comprennent à la fois le marché ambulatoire et le marché hospitalier. On constate que la croissance a été plus faible en 1997 qu'en 1996, conséquence principalement de la stabilisation ou même d'une légère régression sur le marché hospitalier.
En 1997, la balance commerciale a présenté un solde positif de 45,1 milliards de francs. La forte progression de ce chiffre par rapport à 1997 est attribuable aux excellents résultats de quelques grandes entreprises établies en Belgique.
Au cours de la même année, l'industrie pharmaceutique occupait 10 117 personnes. Il s'agit en l'occurrence de l'industrie proprement dite, à l'exclusion des entreprises de sous-traitance et de la distribution. L'emploi a du reste affiché un accroissement prononcé au cours des dernières années.
En 1997, les investissements totalisaient 12,7 milliards de francs et les dépenses de recherche et développement, 24 milliards de francs. Ce dernier chiffre est entièrement à mettre sur le compte des quatre entreprises qui font de la recherche fondamentale en Belgique.
Le tableau suivant indique la part de l'industrie pharmaceutique dans les dépenses de l'AMI (données de 1997).
L'industrie représente 11,7 % des dépenses
AMI (données 1997)
| Milliards de francs | % | |
| Dépenses totales | 429,9 | 100,0 |
| Fournitures pharmaceutiques | 76,6 | 17,8 |
| dont spécialités | 71,5 | 16,6 |
| Spécialités | 71,5 | 16,6 |
| Dont : | ||
| TVA | 4,0 | 0,9 |
| distribution | 17,2 | 4,0 |
| industrie | 50,3 | 11,7 |
Les dépenses totales de l'AMI s'élevaient en 1997 à un peu moins de 430 milliards de francs, dont 76,6 milliards pour fournitures pharmaceutiques. Ce chiffre comprend également les préparations magistrales et d'autres éléments comme les pochettes de sang, de sorte que les spécialités proprement dites représentaient 71,5 milliards de francs ou 16,6 % des dépenses totales AMI. L'INAMI rembourse toutefois sur la base du prix public. Une ventilation de ce montant entre ses composantes donne 4 milliards pour la TVA (les médicaments et les implants sont les seules fournitures AMI sur lesquelles la TVA est perçue), 17,2 milliards pour la distribution et 50,3 milliards pour la distribution et 50,3 milliards ou 11,7 % du budget AMI total pour l'industrie pharmaceutique.
Cette part est donc beaucoup plus limitée que ce que l'on veut parfois faire croire; en outre, les entreprises pharmaceutiques qui sont établies en Belgique génèrent également un montant d'environ 50 milliards de francs au titre d'impôts et de cotisations à la sécurité sociale.
2. L'importance des médicaments pour les affections chroniques
M. De Wever signale que les affections chroniques présentent une étroite corrélation avec l'âge. Une confirmation en est apportée par le graphique suivant, montrant que le nombre de diagnostics traités au moyen de médicaments augmente en raison directe de l'âge. Bien que les chiffres pour les femmes soient plus élevés que pour les hommes, une forte croissance est constatée pour les deux sexes à partir de 55 ans environ.
Utilisation de médicaments
en fonction de l'âge
Nombre de diagnostics traités avec
des médicaments par personne (1997)
(hors hôpital)
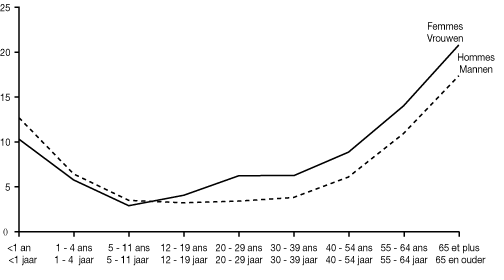
Un tel graphique ne dit cependant pas tout parce que les mêmes types de médicaments peuvent être utilisés aussi bien pour une maladie grave de nature non chronique que pour une affection chronique.
C'est pourquoi le tableau dresse une liste des médicaments qui sont importants pour l'usage chronique.
Ventes de spécialités (hors hôpital)
Importance usage chronique
Classes de médicaments prises en compte
Anti-inflammatoires intestinaux
Enzymes digestifs et eupeptiques
Insulines
Antidiabétiques oraux
Anticoagulants non injectables
Inhibiteurs agrégants plaquettaires
Facteurs de coagulation
Glycosides en cardiothérapie
Anti-arythmiques
Thérapie des coronaires
Nitrés
Antihypertenseurs seuls
Diurétiques
Bêtabloquants
Antagonistes du calcium
Antagonistes de l'angiotensine II
Anti-épileptiques
Anti-parkinsoniens
Anti-psychotiques
Antivertigineux
B2-stimulants
Réducteurs cholestérol et triglycérides
Produits antipsoriasis locaux
Oestrogènes, excluant G3A, G3E et G3F
Progestogènes, excluant G3A et G3F
Corticoïdes voie générale, seules
Produits thyroïdiens
Préparations antithyroïdiennes
Calcitonines
Hormones de croissance
Hormones antidiurétiques
Antiviraux du HIV
Antagonistes hormones cytostatiques
Interférons
Agents immunosuppresseurs
Anti-goutteux
Inhibiteurs résorption osseuse
Analgésiques narcotiques
Dérivés xanthiniques
Inhibiteurs de libération de médiateurs broncho-spasmodiques
Corticoïdes
Combinaisons de stimulants B2 et de anticholinériques
Myotiques et antiglaucomateux
Cette liste par catégorie permet de faire une estimation des dépenses totales pour médicaments à usage chronique au cours des deux dernières années.
Vente de spécialités (marché ambulatoire)
Importance usage chronique
(prix de vente départ usine hors TVA)
1997
| En millions de francs |
% | % | |
| Marché total | 64 793,4 | 100,0 | |
| Remboursables | 46 688,3 | 72,1 | 100,0 |
| Usage chronique | 23 689,3 | 50,7 |
| En millions de francs |
% | % | |
| Marché total | 70 078,8 | 100,0 | |
| Remboursables | 51 514,1 | 73,5 | 100,0 |
| Usage chronique | 26 769,2 | 52,0 |
Source : AGIM.
M. Van Eeckhout signale que ce tableau se rapporte aux médicaments vendus sur le marché ambulatoire à des prix départ usine. À prix publics, ce marché totalise environ 100 milliards de francs.
En 1997, les médicaments remboursables représentaient 72,1 % du marché, dont la moitié était destinée à un usage chronique. En 1998, on a noté une légère hausse, tant de la part totale des médicaments remboursables que de la part que les médicaments à usage chronique y représentent.
Le tableau porte uniquement sur le groupe de médicaments qui sont remboursables parce qu'il renferme la majeure partie des médicaments contre les affections chroniques. Néanmoins, il y a aussi des produits à usage chronique qui ne sont pas remboursables. Ainsi, certains patients cardiaques prennent régulièrement de faibles doses d'aspirine pendant une longue période.
En gros, on peut dire que les médicaments à usage chronique représentent la moitié de tous les produits remboursés. Les antibiotiques, par exemple, ne rentrent pas dans cette catégorie.
3. L'accessibilité des fournitures pharmaceutiques en Belgique
Évolution du ticket modérateur
M. Van Eeckhout examine ensuite l'évolution du ticket modérateur et l'évolution des prix des médicaments, en faisant entre autres une comparaison avec les autres pays. Les données y afférentes concernent tous les médicaments (remboursables) parce qu'il est difficile d'en isoler les produits à usage chronique. Étant donné que ces derniers représentent environ la moitié de l'ensemble, on peut supposer que les tendances relatives à l'ensemble se retrouvent ici aussi.
Le tableau ci-après donne l'évolution du ticket modérateur pour les bénéficiaires d'allocations primaires, les VIPO préférentiels et non préférentiels et la moyenne de ces trois catégories pour les spécialités remboursées.
Spécialités remboursées
Évolution du ticket modérateur (%)
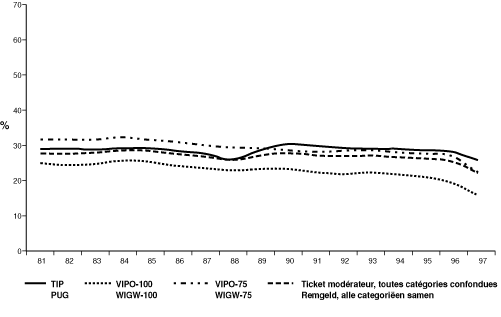
On constate qu'au fil des années le ticket modérateur, exprimé en pourcentage du coût des médicaments, a baissé légèrement en moyenne. C'est une conséquence du fait que les tickets modérateurs pour les médicaments des catégories B et C sont plafonnés, si bien qu'en cas de hausse du coût des produits, leur part dans ce coût diminue.
On note une hausse minime en 1984. Elle résulte de l'introduction, cette année-là, de la catégorie de médicaments CX, remboursés à hauteur de 40 %. (Auparavant, le remboursement était de 100 %, 75 % et 50 % respectivement pour les catégories A, B et C.) En 1989, les contraceptifs pris par voie orale ont été admis au remboursement, ce qui a provoqué une rupture dans la ligne des bénéficiaires d'allocations primaires. Les modifications de 1993 ne sont pas perceptibles parce que les effets se sont compensés mutuellement. En 1997, enfin, une baisse plus marquée peut être observée dans les trois lignes. La raison en est que, cette année-là, un certain nombre de médicaments de la catégorie CX n'ont plus été remboursés. Comme il s'agissait de produits au ticket modérateur le plus élevé, leur retrait a entraîné une diminution de la part moyenne du ticket modérateur dans les autres médicaments.
Le graphique suivant reprend les données du précédent, mais en y ajoutant la part du patient dans tous les médicaments, y compris ceux qui ne sont pas du tout remboursables. On y voit clairement la rupture résultant des mesures prises en 1993.
Bien qu'il y ait, en dehors du remboursement par le biais de l'INAMI, quelques autres mécanismes qui couvrent une partie des dépenses pour médicaments, ce graphique montre qu'en gros 50 % du coût total est à la charge du patient.
Spécialités remboursées
Évolution du ticket modérateur (%)
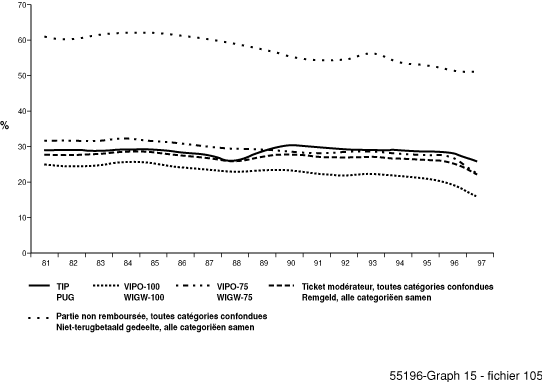
Comparaison avec d'autre pays
M. De Wever attire l'attention sur le tableau suivant, qui reprend les dépenses totales et les dépenses publiques pour soins de santé dans un certain nombre de pays de l'OCDE.
Dépenses soins de santé : dépenses totales
dépenses publiques
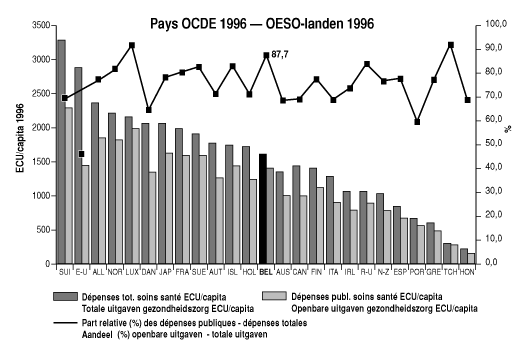
En ce qui concerne les dépenses totales par habitant, la Belgique occupe une position médiane. En revanche, pas moins de 87,7 % de ces dépenses sont prises en charge par les finances publiques, ce qui représente une fraction particulièrement élevée en regard de la plupart des autres pays.
En limitant ces données aux produits pharmaceutiques, on obtient cependant une tout autre situation.
Dépenses produits pharmaceutiques : dépenses
totales dépenses publiques
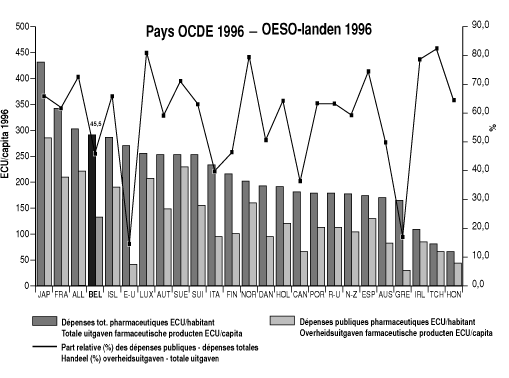
Les dépenses par habitant sont relativement élevées mais seule une toute petite portion est prise en charge par les pouvoirs publics. Seuls les États-Unis et la Grèce font encore moins bien que la Belgique sur ce plan.
En lisant les deux tableaux simultanément, on ne peut que conclure que la prise en charge de médicaments par les pouvoirs publics est particulièrement faible dans notre pays, comparativement à celle d'autres prestations médicales.
Importance dépenses publiques
Soins de santé Pharma
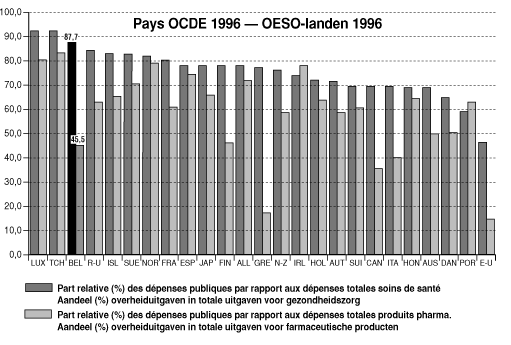
Une importante conclusion peut enfin être tirée du tableau qui suit. À mesure que la part des médicaments dans le total des dépenses pour soins de santé augmente, la part des dépenses de soins de santé totales dans le PIB diminue.
Corrélation dépenses pharmaceutiques
dépenses totales soins de santé
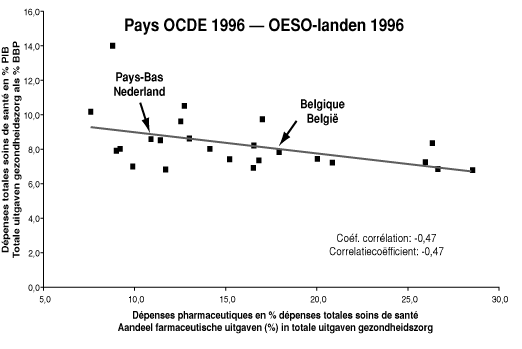
En Belgique, la part des médicaments dans les dépenses totales pour soins de santé est de 17,5 % environ. Aux Pays-Bas, cette part est beaucoup plus faible, mais les dépenses totales pour soins de santé rapportées au PIB sont nettement plus élevées qu'en Belgique.
M. Van Eeckhout fournit ensuite quelques données relatives aux prix des médicaments. Le tableau suivant compare le PIB par habitant dans plusieurs pays de l'OCDE. La Belgique se situe largement au-dessus de la moyenne et peut par conséquent être considérée comme un des pays les plus riches de ce groupe.
PIB/habitant
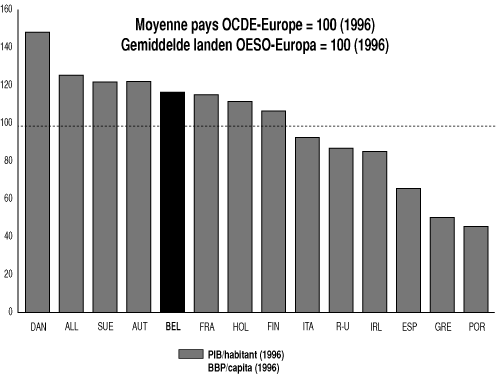
Le tableau suivant ajoute à ces données le prix moyen des médicaments. La Belgique occupe en cela une place médiane. En comparant cependant le prix avec la richesse des différents pays, le rapport entre les deux est particulièrement favorable pour notre pays. En Grande-Bretagne, en Espagne et en Grèce, les prix sont beaucoup plus bas qu'en Belgique, mais rapportés au PIB par habitant, ils sont sensiblement plus élevés. Un Portugais devra travailler plus longtemps qu'un Allemand pour acheter ses médicaments, même si les prix sont plus bas au Portugal qu'en Allemagne.
PIB/habitant et prix des médicaments
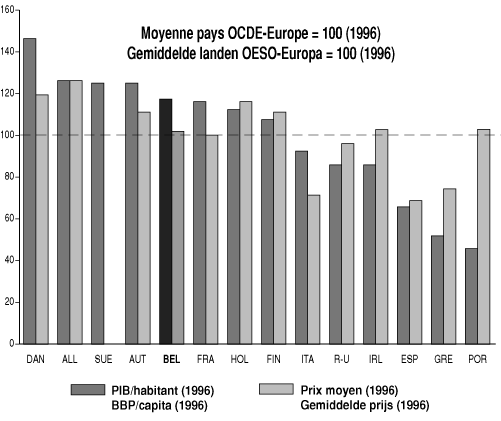
4. Mesures d'économie
M. Van Eeckhout attire l'attention sur le graphique suivant, où les prix des médicaments sont comparés avec l'indice des prix à la consommation.
Mesures d'économie : indice des prix
médicaments remboursables
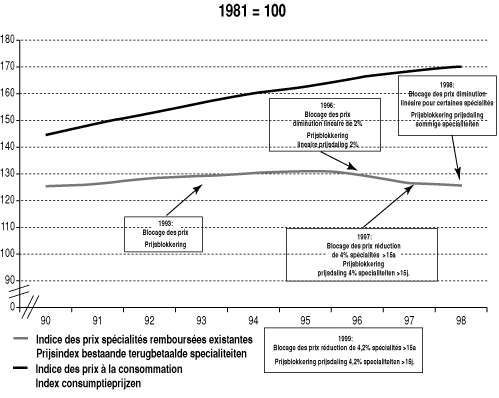
Il apparaît clairement que, dans les années nonante, les prix des médicaments n'ont pas évolué de la même manière que les prix à la consommation. On peut cependant en déduire quelques mesures adoptées récemment par les pouvoirs publics :
· en 1993 un blocage des prix des médicaments;
· en 1996 un blocage des prix et une baisse linéaire des prix de 2 %;
· en 1997 un blocage des prix et une baisse de 4 % des prix de spécialités de plus de 15 ans;
· en 1998 un blocage des prix et une baisse des prix de certaines spécialités;
· en 1999, nouveau blocage des prix et une baisse de 4,2 % des prix des spécialités de plus de 15 ans.
Les deux à trois dernières années, en particulier, sont marquées par une tendance à la baisse des prix des médicaments.
Le tableau suivant reprend toutes les mesures d'économie qui ont été effectivement prises depuis 1990. Au total, leur impact peut être estimé à un montant de 26,236 milliards de francs.
Mesures d'économie :
26 milliards de francs depuis 1990
| Mesures décidées et mises en oeuvre | Impact (Mio francs) |
| Impôts spéciaux 1990 | 991,6 |
| Impôts spéciaux 1991 | 842,5 |
| Impôts spéciaux 1992 | 919,5 |
| Mesures du conclave budgétaire avril 1992 | 4 282,0 |
| Impôts spéciaux 1993 | 1 105,8 |
| Mesures du conclavre budgétaire avril 1993 | 300,0 |
| Mesures du conclave budgétaire juillet 1993 | 355,0 |
| Impôts spéciaux 1994 | 1 169,0 |
| Mesures du conclave budgétaire juillet 1994 | 200,0 |
| Impôts spéciaux 1995 | 1 189,3 |
| Mesures du conclave budgétaire septembre 1995 | 1 650,0 |
| Impôts spéciaux 1996 | 1 889,3 |
| Mesures du conclave budgétaire septembre 1996 | 4 520,0 |
| Mesures du conclave budgétaire décembre 1996 | 100,0 |
| Impôts spéciaux 1997 | 2 622,0 |
| Mesures du conclave budgétaire septembre 1997 | 1 400,0 |
| Impôts spéciaux | 2 700,0 |
| Total | 26 236,0 |
5. Le frein à l'innovation
M. De Wever fait remarquer que la Belgique est actuellement considérée comme un pays où l'accès aux nouveaux médicaments est limité. Une première raison doit en être cherchée dans la longueur des délais d'enregistrement. Ceux-ci son fixés à 210 jours au niveau européen. Pour certaines molécules qui sont encore enregistrées en Belgique, on ne parvient pas à atteindre un délai d'enregistrement de moins de 500 jours.
Délais procédures (en jours) : enregistrement
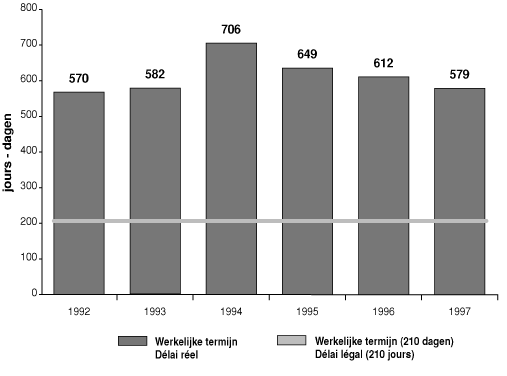
Depuis que la plupart des enregistrements se font au niveau européen, ce problème est relativement limité. La situation est plus grave en ce qui concerne les procédures de fixation des prix et de reconnaissance pour le remboursement. Ce dernier aspect doit précisément garantir l'accessibilité de chacun au produit.
Du tableau qui suit il résulte que le délai de 90 jours pour la fixation du prix a toujours été respecté au cours des dernières années. Il n'en va pas de même, loin de là, de la décision concernant l'admission au remboursement de l'INAMI, pour laquelle les délais suivent une ligne ascendante. En 1998, la fixation du prix et la décision de remboursement prenaient au total 506 jours.
Délais procédures (en jours) :
prix et remboursement
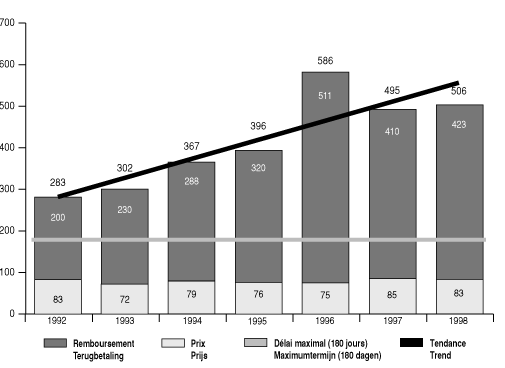
Ces données sont ventilées dans le tableau suivant.
Ici aussi, il apparaît que le problème se situe au niveau du remboursement. En 1998, 271 jours s'écoulaient avant que l'avis définitif de la Commission technique des spécialités pharmaceutiques soit connu. Il fallait encore y ajouter 90 jours pour l'avis du comité de l'assurance et 62 jours pour la publication au Moniteur belge . On en arrive évidemment à des délais qui sont fort éloignés de la limite européenne de 180 jours.
Délais procédures (en jours) :
prix et remboursement
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |
| Fixation prix. Vaststellen van de prijs | ||||
| Décision MAE. Besluit Min. Econ. Zaken | 76 | 75 | 85 | 83 |
| Délai européen max. Europese maximumtermijn | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Admission remboursement. Goedkeuring terugbetaling | ||||
| Avis définitif CTSP. Definitief advies TCFS | 139 | 300 | 207 | 271 |
| Avis Comité de l'assurance. Advies verzekeringscomité | 90 | 110 | 103 | 90 |
| Entrée en vigueur. Inwerkingtreding | 91 | 101 | 100 | 62 |
| Remboursement : total. Terugbetaling : totaal | 320 | 511 | 410 | 423 |
| Total général. Algemeen totaal | ||||
| Prix et remboursement. Prijs en terugbetaling | 396 | 586 | 495 | 506 |
| Délai européen max. Europese maximumtermijn | 180 | 180 | 180 | 180 |
Cette situation est évidemment très néfaste pour l'industrie pharmaceutique, mais aussi pour les patients qui n'ont pas accès aux nouveaux médicaments apparaissant sur le marché. Le délai de 180 jours a été inscrit dans une loi récente. L'AGIM est toutefois convaincue qu'avec les procédures actuelles, il est impossible de respecter ce délai. À cet effet, une réforme du processus décisionnel au sein du conseil technique des spécialistes pharmaceutiques est notamment requise. L'industrie pharmaceutique n'est d'ailleurs pas encore représentée dans ce conseil.
Un autre élément important, également du point de vue budgétaire, en ce qui concerne la distribution des nouveaux médicaments, est qu'ils peuvent prévenir l'intervention chirurgicale. Tel est actuellement le cas de certaines affections de la prostate qui, d'ici cinq ans, devraient pouvoir être guéries par médication dans une proportion de 90 %. Il en résulterait une économie non seulement en journées d'hospitalisation et honoraires de médecins, mais aussi en médicaments administrés en milieu hospitalier.
Un autre exemple sont les médicaments contre le sida. La maladie s'est propagée au début des années 80. Les premiers médicaments ont été développés en 1986 et sont arrivés sur le marché au début des années 90. La trithérapie qui est appliquée de nos jours est considérée comme très onéreuse. Néanmoins, son application a entraîné une diminution spectaculaire du coût des soins parce que le séjour en hôpital, qui se révélait très couteux pour ces patients, a été réduit au strict minimum.
Dans tout cela, il n'est pas encore tenu compte d'autres coûts sociaux, par exemple le fait que l'usage de médicaments permet de raccourcir sensiblement la période d'inactivité du patient par rapport à un traitement en hôpital.
Un membre conclut que la reconnaissance de nouveaux médicaments se fait dans des délais raisonnables dans notre pays, mais qu'il n'en va pas encore de même pour ce qui est de la décision de remboursement. Il ne faut cependant pas oublier qu'il s'agit de deux choses différentes. La reconnaissance est dans une importante mesure une question médico-technique. C'est aussi vrai, en partie, pour la demande de remboursement, mais un important aspect social y est également attaché. On ne peut concevoir que chaque produit mis sur le marché doit être remboursé d'emblée par la collectivité.
M. De Wever souscrit à ces propos. L'industrie pharmaceutique ne demande pas non plus que tous les médicaments soient systématiquement remboursés et c'est la collectivité qui doit décider ce qu'elle souhaite prendre en charge ou non.
Lorsque, cependant, un médicament est admis au remboursement, nul n'a intérêt à ce que la procédure y afférente dure plusieurs années. Pour le patient chronique qui doit faire face à de grosses dépenses, cela peut en effet signifier qu'il n'a pas accès aux nouveaux produits pour la simple raison qu'il ne peut pas les payer. Pour la collectivité, cela implique qu'il faut recourir plus longtemps à des traitements alternatifs également remboursables, et plus chers.
La situation devient encore plus difficile lorsqu'un trop grand écart se creuse, à l'échelon international, dans les délais de fixation des prix et de remboursement entre les différents pays. Cela favorise les mécanismes d'évasion et les importations parallèles.
Un membre demande s'il est possible de donner plus de précisions sur les chiffres du solde de la balance commerciale figurant au tableau « L'industrie pharmaceutique en Belgique ». En 1996, il y a une diminution de ce solde par rapport à 1995, mais en 1997, le surplus augmente brusquement de plus de 20 milliards de francs. Une différence aussi grande doit avoir une cause spécifique.
M. Van Eeckhout répond que les bons résultats de 1997, qui semblent du reste se confirmer en 1998, doivent s'expliquer par la hausse des exportations des médicaments produits en Belgique. Une importante donnée est, à cet égard, le développement de nouveaux vaccins par des firmes établies en Belgique. Il ne faut pas perdre de vue, dans ce contexte, que les exportations de certaines entreprises absorbent jusqu'à 97 % de la production dans notre pays.
L'orateur précédent fait remarquer que d'après les informations communiquées, les fournitures pharmaceutiques représentent 17,8 % des dépenses totales AMI. On peut déduire du tableau des dépenses pour produits pharmaceutiques par habitant que celles-ci sont assez élevées en Belgique et, par exemple, nettement supérieures à celles des Pays-Bas. Cela confirme une fois de plus l'allégation souvent entendue, selon laquelle on consomme beaucoup trop de médicaments chez nous. Jusqu'à présent, il est cependant difficile d'en donner une explication convaincante.
M. De Wever est d'avis que cela tient, dans une importante mesure, à une différence de culture. Des études montrent qu'aux Pays-Bas, la personne qui se rend chez son médecin avec une angine se voit prescrire huit à dix jours de repos. En Belgique, les médecins sont plus enclins à recourir à la médication dans de tels cas. Aux Pays-Bas, la dépense par habitant au titre de médicaments sera par conséquent plus modeste, mais elle s'accompagne d'autres frais (indemnité maladie) qui ne sont pas toujours portés en compte.
Bien que l'on ne puisse pas affirmer qu'une telle différence de culture soit totalement inexistante entre la Flandre et la Wallonie, elle est malgré tout minime. Les mêmes caractéristiques se retrouvent plus ou moins, sur ce plan, dans toute la Belgique.
M. Van Eeckhout y ajoute que les médecins généralistes néerlandais prescrivent effectivement moins de médicaments, mais qu'ils renvoient plus vite que leurs collègues belges à une aide de seconde ligne. Cela signifie du même coup que le patient doit recourir à une forme de traitement plus coûteuse.
M. De Wever ajoute que c'est précisément pour cette raison que les données relatives au rapport entre la consommation de médicaments et les dépenses totales pour soins de santé donnent des résultats intéressants. À mesure que la part des médicaments dans les dépenses totales pour soins de santé augmente, la part de ces dépenses totales dans le PIB diminue. Ce dernier point est une simple constatation et non une évaluation de la situation dans l'un ou l'autre pays.
Un membre constate qu'au cours de l'exposé, il a été souligné que les délais pour la fixation des prix par le ministère des Affaires économiques sont bien respectés, mais que ce n'est pas du tout le cas de la demande de remboursement introduite auprès des Affaires sociales.
Peut-être cette situation s'explique-t-elle d'une certaine manière par le fait que si le département des Affaires économiques fixe le prix des produits, il ne doit pas le payer lui-même. De plus, on peut se demander sur la base de quels éléments ce prix est fixé. D'auditions précédentes il est déjà résulté que l'on a en définitive peu de prise sur le processus de fixation des prix par les firmes. Pour les produits en provenance de l'étranger on ignore le plus souvent la composition des prix de transfert.
La décision des Affaires sociales a d'importantes conséquences budgétaires et il est dès lors logique qu'elle demande plus de temps.
M. Van Eeckhout répond que, dans ce contexte, un important élément joue aussi un rôle et qu'on ne doit pas le perdre de vue. Sur le plan de la fixation des prix, une sanction est prévue. En l'absence d'une décision des Affaires économiques dans un délai de 90 jours, la firme peut appliquer le prix qu'elle a proposé.
Cette sanction n'existe pas au niveau des Affaires sociales. Si les dossiers traînent auprès d'un des organes consultatifs, c'est bien dommage pour le patient, mais il n'y a formellement aucun moyen de forcer une décision.
Au demeurant, le contrôle des prix en Belgique n'est pas aussi lâche que l'a suggéré l'orateur précédent. Notre pays a en ce domaine une tradition qui remonte au moins jusqu'au milieu des années septante. Lors du contrôle des Affaires économiques, on procède non seulement à une analyse de la composition du prix de revient, mais aussi à une comparaison avec le prix de vente dans d'autres pays. Il suffit d'ailleurs de comparer les prix des médicaments en Europe pour constater que ceux-ci sont nettement plus bas dans les pays où un système de contrôle des prix est appliqué.
Un membre estime que les prix des médicaments sont tout compte fait peu transparents en Belgique. Les comparaisons avec l'étranger, auxquelles il est souvent fait référence, sont toujours relatives parce que la présentation et les conditionnements sont généralement très différents d'un pays à l'autre.
Il s'agit là d'une donnée importante si l'on envisage d'accroître la part des médicaments dans le total des prestations remboursables.
Par ailleurs, si le remboursement des médicaments était renforcé, cela ne doit pas nécessairement se faire de manière linéaire. Les problèmes concernant l'accessibilité des soins de santé sont concentrés dans une importante mesure dans certaines catégories sociales et certaines pathologies. Les données chiffrées en termes de moyennes ne disent par conséquent pas tout.
Cela vaut également pour la surconsommation. Il se peut que dans les différents pays une part élevée de médicaments dans les dépenses totales pour soins de santé s'accompagne d'une part modeste de ces dépenses totales dans le PIB. Il n'empêche que dans un pays comme la Belgique, il faut s'attaquer au problème de la surconsommation de certains produits comme les calmants.
Lorsque l'on plaide pour une plus grande part des médicaments dans le remboursement des soins de santé, il convient de tenir compte de ce type de paramètres.
M. De Wever souhaite revenir sur le problème des délais pour la fixation des prix et la demande de remboursement. Une des difficultés réside selon lui dans le fait qu'aux Affaires économiques, un prix est fixé en connaissance de cause, sur la base d'un dossier bien étoffé, mais que ce prix est souvent totalement remis en question lors des discussions sur le remboursement, en se fondant la plupart du temps sur des articles parus dans des journaux étrangers et d'autres éléments similaires, d'où il devrait résulter que les prix dans les pays voisins sont plus bas qu'en Belgique.
L'industrie pharmaceutique ne s'opposerait pas à un système de fixation des prix basé sur le prix moyen des produits dans les pays environnants.
Les organes consultatifs de l'INAMI pourraient travailler sur la base de ce prix incontestable. Personne, et certainement pas l'industrie pharmaceutique, ne conteste que dans leur appréciation concernant le remboursement dans le cadre de l'assurance soins de santé, ils se laissent guider par des considérations thérapeutiques et sociales. C'est en cela précisément que réside leur mission.
M. De Wever ne nie pas qu'il y a surconsommation pour certains produits, comme il y a sous-consommation pour d'autres. Avec la mise en place du système Farmanet, le débat sur ce thème pourra enfin être mené sur la base de données objectives. Chacun a intérêt à ce que les médicaments soient utilisés aussi correctement que possible et l'industrie est certainement disposée, à partir des données de Farmanet, à en discuter avec les médecins.
M. Van Eeckhout ajoute que par le biais de Farmanet, il serait également possible de répondre dans une importante mesure aux préoccupations d'une commissaire. Le système permet de préciser où se situent les dépenses élevées en matière de tickets modérateurs. La politique pourrait s'en inspirer, par exemple en incluant des médicaments bien précis dans la franchise sociale.
Le système donnera également aux médecins la possibilité de faire une auto-évaluation de leur comportement prescripteur et de le corriger.
Une membre relève qu'il est régulièrement fait référence aux médicaments génériques en tant qu'instrument de maîtrise des coûts des soins de santé, tant pour les pouvoirs publics que pour les patients. D'après certaines sources, l'usage de ces produits serait relativement faible en Belgique au regard de l'étranger.
M. De Wever déclare que l'industrie pharmaceutique comme telle n'est pas opposée à l'usage des médicaments génériques. Il faut cependant bien se rendre compte qu'un choix unilatéral de ces produits peut faire obstacle au développement de médicaments nouveaux et de meilleure qualité. À l'heure actuelle, 16 % en moyenne du chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique est affecté à la recherche. Ce chiffre ne peut être maintenu que si une certaine partie du marché des médicaments est constituée de spécialités.
M. Claessens ajoute que le débat sur les médicaments génériques est très complexe. Le fait que dans notre pays on prescrit moins ces produits est probablement en partie lié à des facteurs culturels. De par leur formation, nos médecins sont en effet profondément conscients de la nécessité de la recherche scientifique.
Sur cela se greffent cependant des facteurs de marché. Les prix des médicaments étant bas en Belgique, les marges sur les produits génériques sont devenues si étroites que les firmes qui en font leur spécialités émigrent vers d'autres pays. Il faut d'ailleurs tout voir dans sa juste proportion. En Belgique les prix des spécialités sont inférieurs à ceux des médicaments génériques aux États-Unis.
Comme il a déjà été dit, l'industrie pharmaceutique comme telle n'est pas opposée à l'usage des produits génériques. Elle s'inscrit toutefois en farouche adversaire de la substitution de médicaments parce que celle-ci constitue une atteinte à la relation de confiance entre le médecin et le patient. Les deux choses sont souvent confondues.
M. De Wever signale que les pays où les médicaments génériques absorbent une grande partie du marché, par exemple l'Allemagne, sont souvent aussi les pays où le prix moyen des médicaments est le plus élévé.
Un membre admet que le comportement prescripteur des médecins est sans doute déterminé en partie des facteurs culturels. Elle se demande si précisément l'industrie pharmaceutique ne joue pas en cela de son influence, en recommandant avec plus de conviction les spécialités que les produits génériques auprès du corps médical.
M. De Wever le nie catégoriquement. La promotion des deux types de médicaments obéit aux mêmes structures. Il y a d'ailleurs des firmes qui commercialisent uniquement des produits génériques.
M. Bailleux souligne que l'Association pharmaceutique belge représente 87 % des pharmacies de Belgique. Les cinq représentants ici présents sont en outre tous des pharmaciens indépendants. Les 13 % restants se composent de pharmacies coopératives réunies au sein de l'OPHACO.
L'on peut difficilement prétendre que l'accès aux soins de santé dans le secteur des médicaments ne pose aucun problème. À travers l'ensemble du pays, mais surtout dans les régions économiquement défavorisées, force est de constater que les patients demandent à leur pharmacien d'opérer une sélection parmi les médicaments prescrits parce qu'ils ne sont pas en mesure d'acheter l'ensemble de la prescription. Le pharmacien est ainsi placé devant un choix difficile. Dans une telle situation, le pharmacien n'a pas d'autre solution que de contacter le médecin traitant. Cette tendance s'accentue ces dernières années.
Autre phénomène que l'on constate dans tous les types de pharmacies : les comptes non honorés. En fonction de la situation économique de la région, ceux-ci peuvent atteindre, à la fin du mois, lorsque le minimex ou les allocations de remplacement sont versés, 100 000 à 150 000 francs pour une seule pharmacie.
Différentes causes expliquent cette évolution. L'une est incontestablement le prix des médicaments. Ces dernières années, ce prix a suivi la courbe ascendante, parfois de façon exponentielle, ce qui se traduit par une augmentation du chiffre d'affaires des pharmacies publiques. Pour la période 1995-1997, ce chiffre s'élevait à près de 10 milliards de francs. Parallèlement à cela, l'on constate pour la même période une diminution des revenus de ces pharmacies, qui devaient travailler avec des marges bénéficiaires légalement imposées, de quelque 700 millions de francs. Il va sans dire que cette augmentation du chiffre d'affaires n'a pas fait que du bien à l'INAMI. De son côté, le patient a vu sa participation aux frais réduite d'une infime partie seulement.
Autre évolution : les emballages sont de plus en plus grands. Des emballages suffisant pour deux à trois mois de consommation médicamenteuse ne favorisent assurément pas une consommation de médicaments plus responsable. Du point de vue financier, de tels emballages sont également préjudiciables. Depuis plusieurs années, les pharmacies-officines peuvent collecter les médicaments périmés. Parmi ceux-ci, il n'est pas rare de retrouver certains médicaments qui ont coûté 2 000 à 3 000 francs et dont une infime partie seulement a été consommée.
Pour ce qui est de l'évolution du ticket modérateur sur les médicaments, l'on constate que celui-ci représentait en 1996 un montant de 12 190 000 000 francs, par rapport à 11 258 000 000 francs en 1997. Face à cette diminution en chiffres absolus, on note également une diminution relative de 25,09 % des dépenses totales en 1996 pour arriver à 22,2 % en 1997. Les projections pour cette année confirment la supposition que le montant des tickets modérateurs, avec 11 268 000 000 de francs, restera plus ou moins stable par rapport à 1997. La quote-part des patients dans le prix de revient des médicaments n'a pas diminué de façon spectaculaire, mais elle n'a pas davantage augmenté.
Enfin, citons également le problème de la surconsommation de médicaments. Il est clair que la façon dont les prescriptions sont utilisées peut être améliorée. Le 11 novembre dernier, une table ronde de la pharmacie a été clôturée. Celle-ci avait été convoquée à l'initiative du ministre de la Santé publique. Les pharmaciens avaient pu y soumettre leur profession à une évaluation critique et approfondie. Les pharmaciens ont clairement affirmé qu'ils souhaitaient jouer un rôle de premier plan au niveau de l'utilisation responsable des médicaments. En effet, une enquête récente à mis en lumière que 27 % seulement des patients prenaient les médicaments prescrits de façon correcte.
Dans le cadre de cette mission, le protocole de la première délivrance est actuellement en cours d'élaboration. La première fois qu'un médicament est délivré pour une maladie chronique ou grave, le patient se voit remettre une note très claire contenant les explications requises pour une utilisation responsable, les indications ainsi que les éventuelles mesures de précaution qu'il est tenu de respecter. Ce n'est en aucune façon comparable au contenu de certaines notices, constituant une énumération horrible des contre-indications.
Par ailleurs, un protocole de renouvellement de prescription est également en préparation. Ce protocole explique aux patient comment l'utilisation prolongée d'un médicament doit se dérouler dans les meilleures conditions.
M. Broecks embraie ensuite sur la politique générale du gouvernement dans le secteur des médicaments. Selon ce dernier, un besoin cuisant de dialogue ouvert entre toutes les parties concernées, en ce compris le gouvernement, se fait sentir en la matière. Les pharmaciens en sont demandeurs depuis longtemps. Ils sont disposés à adopter une position constructive. C'est par ailleurs dans un tel esprit que l'APB a préparé la table ronde, avec un résultat positif à la clé.
Un évaluation de la politique gouvernementale dans le domaine des médicaments nous enseigne qu'elle est entre autres axée sur une diminution du prix des médicaments plus anciens. Cela entraîne paradoxalement une augmentation du prix moyen par médicament délivré de 2 % l'an dernier, et de près de 4 % cette année. C'est d'autant plus remarquable que l'ensemble des produits commercialisés sur le marché font l'objet d'un gel des prix.
Ce phénomène s'explique uniquement par le fait que la diminution tarifaire pour certains produits va de pair avec un glissement, au niveau du comportement prescriptif, vers des produits plus onéreux. Normalement, l'industrie n'a pas vraiment intérêt à promouvoir de plus belle des produits dont le prix est à la baisse alors qu'il existe des alternatives plus onéreuses sur le marché.
Autre option politique : la diminution tarifaire des nouveaux produits entraînant un chiffre d'affaires important. Sur ce plan, un départ constructif a été pris avec la réorganisation des Spécialistess du Conseil Technico-Pharmaceutique de l'INAMI. Ce départ a toutefois été particulièrement lent, et menace la faisabilité à court terme de cet objectif stratégique.
Troisième option stratégique : la promotion des médicaments génériques. Problème : les rumeurs les plus contradictoires circulent au sujet de la politique de l'an prochain. De nombreuses zones d'ombre planent sur :
· les marges dont bénéficieront les pharmaciens sur ces produits, celles-ci faisant de plus en plus l'objet de pressions;
· l'attitude qu'adoptera le gouvernement en matière de substitution des médicaments;
· la documentation portant sur les équivalences, demandée de longue date, ainsi que la définition des responsabilités.
Quoi qu'il en soit, les pharmaciens sont disposés à promouvoir en douceur ces produits à condition que vis-à-vis des patients, les médecins et les pharmaciens puissent se voir offrir la garantie que le système sera mené à bien.
Une substitution dure, dans laquelle le pharmacien modifie la prescription d'une spécialité en produit générique ne semble pas réalisable dans les conditions actuelles. Par contre, une sélection entre des produits de même nature lorsque le médecin prescrit un médicament générique ou une copie semble possible. Cela pourrait quoi qu'il en soit améliorer sensiblement la gestion des stocks de ce médicament ainsi que sa disponibilité.
Pour ce qui est du contrôle sur le comportement en matière de prescription, les rumeurs les plus folles circulent. Voici deux ans, l'APB avait formulé une proposition consistant en la délivrance d'un document 705 en lieu et place de la vignette détachable. Cette proposition implique que, lorsqu'un patient se présente avec une prescription pour un médicament dont il n'a normalement pas besoin directement, le pharmacien établit un document permettant au patient de s'en procurer ultérieurement une partie. Côté tarification, une facture n'est établie qu'au moment où le médicament est effectivement retiré. Un tel système serait non seulement efficace et applicable à court terme; il permettrait également aux pharmaciens de respecter la réglementation existante tout en tenant compte au maximum des besoins du patient. L'introduction de la vignette aurait pour conséquence que tous les stocks existants devraient d'abord être épuisés, les emballages étant adaptés par la suite. Il faut en outre tenir compte d'un délai de quatre à cinq ans avant que ce système puisse être opérationnel.
En ce qui concerne l'accès aux soins, M. Broecks tient à formuler deux observations :
· Les pharmaciens sont confrontés à des conditionnements de plus en plus grands, sur lesquels ils ont une marge plafonnée à 300 francs. Ce n'est pas suffisant pour assurer le préfinancement d'un système de tiers-payant pour les produits plus onéreux. Résultat : la disponibilité de ces produits est menacée. Pour éviter cela, l'organisation a élaboré une proposition constructive impliquant l'octroi d'une marge plafonnée : il s'agit d'une petite marge sur la partie du prix public excédant le plafond déterminé.
· Régulièrement, d'aucuns prétendent que les pharmaciens pourraient constituer un frein à l'élaboration de Farmanet. En réalité, les données statistiques, indispensables pour alimenter le système « Peer Review », sont communiquées par les officines depuis le 1er janvier 1996 déjà.
Elles recevront, par le biais des caisses d'assurance maladie et de l'INAMI, les tableaux de bord ainsi que le premier envoi pour le second semestre de 1996. Pour information, on peut affirmer que l'on dispose d'ores et déjà de chiffres jusqu'en 1998 par le biais de l'institut de pharmaco-épidémiologie. L'on pourrait dès lors accélérer l'ensemble du processus, moyennant un investissement limité.
M. Broecks évoque ensuite plusieurs pistes de réflexion méritant d'être suivies selon l'APB.
Tout d'abord, nous avons besoin d'un budget et de mesures réalistes. D'aucuns prétendent qu'une telle chose n'est possible que si toutes les parties impliquées d'une manière ou d'une autre dans les médicaments se mettent autour d'une table pour entamer des discussions. Une réunion de la « Commission Peers » s'est récemment tenu ici même. C'était la première fois depuis quatre à cinq ans que tous les intéressés étaient réunis à la même table. Ce fait a été considéré par la quasi-totalité des participants comme un signe intrinséquement positif. Il en est ressorti qu'un vaste consensus était possible sur toute une série de points.
L'un de ces points, et c'est la seconde option stratégique par ordre d'importance, c'est la revalorisation de l'ensemble des dispensateurs de soins dans leur mission visant l'utilisation rationnelle et optimale des moyens disponibles. Notre gouvernement s'efforce trop souvent d'atteindre cet objectif par le biais de mesures tarifaires. L'influence d'un petit pays comme la Belgique dans un marché organisé au niveau international demeurera toutefois toujours limitée. Voilà pourquoi une politique axée sur une plus grande responsabilisation des pharmaciens et des médecins, proches des patients, s'avérerait plus efficace qu'une simple politique tarifaire. Ceux-ci peuvent, rationnellement, déterminer si un médicament s'avère indispensable et, dans l'affirmative, ils peuvent optimalement veiller à ce que, au niveau de l'utilisation du médicament, la thérapie soit respectée.
Enfin, des objectifs clairs, concrets et mesurables s'imposent en matière de santé. Cela suppose une politique allant plus loin que les simples économies. Les dispensateurs de soins sur le terrain doivent avoir des responsabilités clairement définies et pouvoir travailler dans le cadre d'objectifs stratégiques précis, y compris sur le plan de la consommation de médicaments. La meilleure manière d'arriver à de tels objectifs consiste une fois encore à réunir l'ensemble des intéressés au niveau local et national afin d'amorcer un dialogue ouvert.
M. Broecks aborde ensuite la franchise sociale et fiscale. À ce jour, le médicament n'a pas été repris dans celle-ci, en raison du fait qu'il n'existe aucun système de collecte permettant de répertorier les sommes dépensées dans ce cadre. Lorsqu'on totalise l'ensemble des médicaments vendus, l'on constate que les catégories A et B constituent en valeur la plus grande partie. Les produits A sont gratuits pour le patient. L'APB a déjà proposé de séparer à court terme un groupe dans les produits B et de l'incorporer dans la franchise. Cela est d'ores et déjà possible.
À long terme, il sera indispensable que le Farmanet suive la voie des factures. Depuis des années, les pharmaciens insistent pour qu'on accélère le second volet du système. Toutefois, cela ne semble pas réussir pour différents raisons.
L'objectif initial de Farmanet consistait à alimenter l'évaluation par les pairs; en d'autres termes, contrôler le comportement des médecins individuels au niveau des prescriptions. Dans ce cadre, il n'était pas nécessaire de collecter des renseignements sur les patients.
En même temps, le gouvernement, mais aussi les caisses d'assurance-maladie, ont formulé le souhait que le système puisse être utilisé pour informatiser la facturation. Actuellement, cette facturation est encore entièrement réalisée sur papier.
Au début des années quatre-vingt-dix, un accord a été atteint en matière de passage aux supports magnétiques via un système à deux voies. La première voie est déjà opérationnelle. La seconde se compose de l'enregistrement du montant des médicaments délivrés par patient et de la catégorie de remboursement dans laquelle ils se situent. Pour protéger la vie privée du patient, le nom du médicament même n'est pas enregistré.
Des nouvelles questions sont apparues en ce qui concerne ce dernier point. Les pharmaciens sont d'avis que ce point doit être traité par la commission pour la protection de la vie privée. Pour le reste, ils ne voient aucune objection de principe à ce que toutes ces données soient réunies dans une facture.
Il est clair que ce n'est qu'au moment où toutes ces données seront disponibles que l'on disposera des moyens nécessaires pour incorporer les médicaments dans la franchise sociale. L'un des instruments techniques nécessaires est le contrôle de l'assurabilité. Celle-ci existe à présent sous la forme de la carte SIS, l'APB ayant joué un rôle constructif lors de sa mise en service. Un autre instrument actuellement à l'étude est le développement de mécanismes de contrôle adaptés aux techniques modernes du traitement et de la transmission des informations. Les négociations avec les caisses d'assurance-maladie vont bon train, mais l'INAMI semble parfois éprouver des difficultés à abandonner les procédures existantes.
À une question portant sur le groupe de travail de M. Peers, M. Broecks répond que celui-ci a été convoqué par le gouvernement dans le but de faire toute la lumière sur les soins de santé. Pour le secteur des médicaments, étaient représentés l'industrie pharmaceutique, les médecins, pharmaciens (APB et OPHACO), les pharmaciens d'hôpitaux et les fournisseurs de matériel médical (UNAMEC).
Toutes les parties ont été invitées à faire part de leur vision sur le secteur et sur les problèmes auxquels elles sont confrontées. Par ailleurs, elles ont été invitées à formuler des propositions sur les réformes possibles. Dans ce cadre, le plus détaillé, l'APB a tenu les propos qu'elle tient également devant cette commission. Elle eut pour une bonne partie des retombées dans les résultats de la conférence de la table ronde.
Un membre souligne que la tarification des médicaments est soumise à une réglementation, ce qui implique entre autres un avis de la commission tarifaire du département des Affaires économiques. A-t-on une idée, chez les pharmaciens, de la façon dont ces prix sont définis ? Il n'est pas rare d'entendre que les dossiers présentés à la commission tarifaire ne sont pas toujours particulièrement fournis sur le plan économique. Ainsi, n'a-t-on bien souvent aucune idée des prix de transfert, ce qui entrave toute évaluation économique réaliste.
M. Broecks répond que ce ne sont pas les pharmaciens qui « enjolivent » sur le plan économique les dossiers pour la commission tarifaire. Ils doivent certes donner leur avis et il est vrai que dans certains cas, les prix de transfert sont mentionnés de façon relativement opaque. D'autre part, l'on pourrait se demander, en tant qu'observateur, dans quelle mesure il est possible de rendre ces prix de transfert véritablement transparents. Ainsi, qui va décider, de l'extérieur, si les coûts portés en compte pour la recherche concernant effectivement les études spécifiques réalisées pour le médicament même et dans quelle mesure les recherches en cours ont été prises en compte ?
Le précedent intervenant fait observer que le contrôle tarifaire a pratiquement disparu pour l'ensemble des produits commercialisés sur le marché. Les médicaments sont l'une des rares exceptions en la matière. Au cas où l'on serait dans l'impossibilité d'obtenir une image correcte de tous les facteurs économiques déterminant les prix, ne vaudrait-il pas mieux laisser jouer la libre concurrence dans ce secteur au lieu de maintenir en place un système artificiel rendant impossible tout contrôle objectif ?
M. Bailleux observe tout d'abord que cette matière doit être abordée de façon nuancée. Les médicaments commercialisés sur le marché belge ne sont certainement pas onéreux comparés aux autres pays et leur prix de revient n'est pas plus élevé que la moyenne européenne. La presse publie parfois des articles qui ne correspondent pas toujours avec la réalité.
Il n'empêche que plusieurs éléments du prix des médicaments sont difficilement contrôlables. Outre les frais de recherche précités, l'on peut également mentionner les frais de commercialisation. L'on peut ainsi se poser certaines questions par rapport à d'autres produits. Le médicament « Zocor » par exemple est commercialisé sur le marché dans des emballages de 28 et 56 comprimés. Le prix du produit « ex-usine » serait deux fois plus élevè en grand conditionnement que dans un petit emballage. De telles situations suscitent des interrogations.
Pour un petit marché comme celui de la Belgique, il n'est pas été aisé d'imposer une politique tarifaire à des entreprises internationales actives dans ce secteur. Comme nous l'avons déjà affirmé, ces prix ne sont pas anormalement élevés, même si des cas concrets démontrent qu'il est bon de demander à l'industrie de se montrer responsable.
M. Broecks ajoute que les pharmaciens ne constituent qu'une partie du secteur des médicaments et que ce n'est pas à eux de déterminer si les prix doivent ou non être libéralisés. Pour rappel, le système belge n'a pas entraîné des prix supérieurs à ceux des autres pays européens et certainement pas supérieurs aux prix des États-Unis.
En outre, au cas où la tarification libre était introduite, elle devrait être appliquée à tous les échelons du secteur. Notre système de soins de santé est un compromis entre la médicine non conventionnée d'une part et la médecine conventionnée de l'autre. Entre une régulation tarifaire totale et un marché entièrement libre, de nombreux maillons sont encore possibles et il s'agit de trouver le bon équilibre.
L'économie médicale est un secteur à peine sorti des limbes qui progresse rapidement. Il serait toutefois bon que dans une telle optique, chacun se mette autour d'une table et évalue les moyens pouvant être acceptés pour procéder aux remboursements sur la base de la valeur du médicament pour le patient et pour le système des soins de santé. Une telle approche est davantage axée sur l'utilisation du médicament que sur son prix sur lequel la politique est peut-être trop axée à l'heure actuelle.
Un membre répond que la suppression de la réglementation tarifaire ne doit pas obligatoirement signifier que la tarification serait incontrôlable dans la pratique. Outre la piste de la réglementation tarifaire, la Belgique peut encore suivre celle du remboursement. On constate à présent que la réglementation tarifaire, qui se déroule selon des critères particulièrement opaques, est décisive pour le prix remboursé par l'INAMI. L'ensemble du système pourrait être un peu plus honnête si cette première étape était supprimée et que l'on confiait à la caisse d'assurance-maladie le soin de déterminer la valeur de remboursement d'un médicament.
M. Broecks souligne que l'on fait ici référence à l'un des facteurs modérateurs du système actuel, à savoir le fait que les négociations tarifaires ont lieu deux fois : au niveau des Affaires économiques et au sein de l'INAMI. Les procédures pourraient peut-être être accélérées si le prix déterminé à un seul niveau (les Affaires économiques), tandis que l'autre niveau (l'INAMI) pourrait déterminer sur le produit peut être remboursé à ce prix.
À une question portant sur l'enregistrement, M. Broecks répond que cette pratique est quasiment tombée en désuétude pour les produits novateurs diffusés à l'échelle internationale. En la matière, la Belgique est rarement une référence. En Belgique, seuls sont encore enregistrés les articles d'autogestion de la santé et autres produits de ce genre.
L'on constate en outre pour les produits enregistrés en Europe que les prix convergent dans les différents pays. En cas de différence, celle-ci peut s'expliquer de façon objective. Dans les pays au pouvoir d'achat moins élevé comme le Portugal ou la Grèce, les prix seront généralement moins élevés que dans les États membres plus nantis.
Une membre pense pouvoir conclure que les pays pouvant se prévaloir d'un système d'assurance sociale fortement développé font oeuvre de « coopération au développement » vis-à-vis des autres États membres, ce qui, en tant que tel, n'est peut-être pas une mauvaise chose.
Un autre membre est d'avis qu'une discussion sérieuse doit en tout état de cause être amorcée au sujet de la tarification des produits pharmaceutiques. Il appert que les dépenses en la matière dépassent les bornes. Pour les produits remboursés, le patient paie actuellement une partie des 64 milliards de francs par an. Pour les médicaments non remboursés, il convient encore d'ajouter 55 milliards de francs. S'ajoutent à cela les médicaments délivrés sans ordonnance.
Au cas où l'on ne stopperait pas la spirale des coûts, on peut craindre que l'on soit occupé à scier la branche sur laquelle nous sommes assis.
Une autre intervenante rappelle une audition antérieure, de laquelle il est apparu que le nombre d'officines en Belgique par tête d'habitant est très élevé en comparaison avec les autres pays européens. Chacun sait que les prix de rachat des pharmacies sont particulièrement élevés et que ces montants doivent être récupérés par le chiffre d'affaires. Ces deux phénomènes ne favoriseraient-ils pas la consommation élevée de médicaments dans notre pays ?
M. Bailleux souligne à cet égard que 70 à 75 % des ventes en officine se composent de spécialités délivrées sur ordonnance. Une diminution du nombre de pharmacies n'aurait aucune incidence.
M. Broecks souligne que la Belgique dispose, après la Grèce, du réseau de pharmacies le plus dense. En page 18 et suivantes du rapport de la table ronde, vous trouverez des exemples de ce que l'APB et l'OPHACO souhaitent réaliser en la matière.
L'on s'y base sur une norme standard qui, pour les communes de plus de 30 000 habitants, prévoit une pharmacie pour 3 000 habitants. Pour les plus petites communes, ce chiffre passe, en fonction du nombre d'habitants, à 1 pour 2 000. Pour les noyaux vraiment isolés, pratiquement disparus en Belgique, l'on peut se baser sur 1 pour 1 500 habitants. Sur la base de cette norme, on compte actuellement un nombre trop élevé d'officines dans les grands centres. Pour ramener ce chiffre à la norme établie sur une période de 10 à 15 ans, l'on propose une politique encourageant en douceur la fusion des officines.
La norme ici proposée correspond par hasard aux normes en vigueur en France. La répartition dans ce pays est généralement considérée comme une bonne moyenne, tant pour ce qui est de la qualité de vie que des stocks disponibles de médicaments et leur accessibilité.
M. Bailleux ajoute qu'il convient de faire preuve de prudence en ce qui concerne les comparaisons internationales. La Belgique compte en effet 5 200 pharmacies (1 pour 1 900 habitants) pour 1 500 aux Pays-Bas. Dans ce pays, près de 1 000 médecins délivrent des médicaments et 2 000 à 3 000 drogueries peuvent également vendre des médicaments. Lorsqu'on tient compte de tous ces éléments, on arrive à un total de près de 5 500 points de vente.
Un membre constate que les pharmaciens estiment que l'évolution vers les plus grands emballages est négative, en raison du fait qu'une bonne partie de ces médicaments est retrouvée lors des collectes de produits non consommés.
L'objectif de ces grands emballages était toutefois de diminuer le coût des médicaments pour les patients atteints de maladies chroniques. Ils évitent les consultations médicales et le prix moyen du produit devait normalement diminuer. Doit-on en conclure que les grands emballages n'aboutissent pas chez les patients pour lesquels ils sont destinés ou s'agit-il d'autres médicaments ?
M. Bailleux répond que l'on retrouve toutes sortes de médicaments lors de la collecte. Il existe certains médicaments consommés de façon chronique et néanmoins vendus dans des emballages de 15 comprimés. Lorsqu'on en retrouve 14, des questions se posent. La Belgique pourrait peut-être s'inspirer du système allemand, où les patients reçoivent d'abord des emballages pour une première utilisation. L'on prescrit d'abord aux patients atteints d'une maladie chronique une petite quantité de médicaments et ce n'est qu'après avoir constaté que le patient supporte le produit que l'on passe à la taille supérieure. L'évolution vers les grands emballaages telle qu'on la connaît actuellement en Belgique n'est certainement pas à l'avantage du budget de l'INAMI.
M. Broecks ajoute qu'en marge de l'aspect « première délivrance », il convient également de mentionner le suivi thérapeutique. Les patients auxquels on prescrit des médicaments contre l'hypertension ou des médicaments diminuant le taux de lipides ne sentiront pas directement une différence lorsqu'ils prennent ces produits. Bien souvent, ils sont par conséquent tentés de stopper la thérapie, même si cela n'est pas souhaitable d'un point de vue médical. Voilà pourquoi d'aucuns plaident pour qu'on ne délivre plus de quantité de médicaments dépassant un mois de consommation. Cela oblige également le patient à contacter régulièrement son médecin ou son pharmacien, ce qui permet également d'évaluer la thérapie.
Voilà pourquoi, au risque de se répéter, en plus du protocole de première délivrance, l'on travaille actuellement à un protocole de « répétition », dans lequel on pose au patient d'autres questions et où ce dernier est invité à fournir d'autres informations (effets secondaires, la façon dont le patient supporte le produit et autres).
L'évolution vers les emballages plus grands est également favorisée par différents éléments. L'un d'entre eux est le plafonnement du ticket modérateur. Le fait que ce dernier soit le même sur un grand emballage et sur un petit peut inciter les médecins à prescrire d'emblée de grandes quantités.
Un membre souhaite savoir quel pourrait être le rôle du médicament magistral dans le cadre d'une gestion responsable de l'assurance maladie-invalidité. Dans un passé récent, plusieurs mesures ont été prises vis-à-vis de ces médicaments en causant pas mal de remous.
Voici plusieurs années déjà, lorsque l'actuel premier ministre était encore ministre des Affaires sociales, des études indiquaient que le remplacement des 20 spécialités les plus prescrites par des préparations magistrales auraient pu permettre de substantielles économies à la fois pour le malade et pour les assurances.
Tant que l'on est aux solutions de remplacement, il n'y a aucune raison de ne pas impliquer les préparations magistrales à ce niveau.
Un autre intervenant souligne que cette question porte également sur la revalorisation de la profession de pharmacien. Est-il un « vendeur de médicaments » ou a-t-il une fonction particulière et irreemplaçable dans le système des soins de santé ?
M. Bailleux fait référence en premier lieu aux résultats de la table ronde pour ce qui est de la revalorisation de la profession de pharmacien. Depuis un an environ, les représentants des pharmaciens entretiennent des contacts avec les organisations médicales de toutes tendances afin de déterminer la façon d'améliorer le rapport qualité-prix des soins de santé de base.
La responsabilité des pharmaciens se situe naturellement au niveau du médicament et ils ne peuvent pas intervenir dans les domaines relevant de la responsabilité du corps médical. Il n'empêche que l'on planche sur de nouvelles structures que l'on pourrait dénommer, par analogie avec les GLEM, les GLEP (groupes locaux d'évaluation pharmaceutique). Cela pourrait signifier que les médecins et les pharmaciens se réunissent une ou deux fois par an au niveau local pour se concerter. D'ici, peu, les données de Farmanet seront accessibles aux médecins. Le pharmacien pourrait jouer un rôle constructif là où cela s'avère nécessaire, rechercher des solutions alternatives de concert avec les médecins pour certaines formes de comportement prescriptif.
Pour ce qui est des préparations magistrales, il est indéniable que la façon dont elles ont été massacrées par le gouvernement est loin d'avoir été une bonne chose pour l'accessibilité des soins de santé. Pour bon nombre d'affections « anodines » (refroidissements, toux...), le patient est dans l'obligation d'acheter la totalité d'un sirop, alors qu'une préparation magistrale s'avère presque toujours moins onéreuse. Le coût des médicaments pour cette sorte d'affection sont bien souvent minimalisés, mais dans les familles avec enfants en bas âge et aux revenus limités, ils peuvent peser lourd dans le budget.
M. Bailleux explique enfin que l'APB s'est prononcée voici un an environ en faveur de la substitution-sélection et depuis, chacun ou presque en a pris pour son grade. L'industrie pharmaceutique a littéralement fulminé, tandis que les médecins aussi se montrent hypersensibles.
D'aucuns ont l'impression, dans le cadre de cette discussion, que certains souhaiteraient en effet positionner à l'avenir certains groupes de pharmaciens comme de simples distributeurs de médicaments. C'est loin d'être le cas. En marge de son rôle de conseiller du patient, le pharmacien doit également voir sa fonction reconnue dans l'économie médicale. On a déjà évoqué la flambée des dépenses pour les médicaments, mais l'on ne peut perdre de vue qu'en marge de cette flambée, nous assistons à une diminution du nombre d'unités vendues.
M. Broecks ajoute que les préparations magistrales réalisées avant la ronde d'économies de février 1997 ont représenté pour l'INAMI une dépense de 3,6 milliards de francs sur base annuelle. À présent que cette somme est réduite de moitié, passant ainsi en deçà de la masse critique indispensable pour maintenir le secteur. À force de négociations particulièrement âpres, le secteur est parvenu à permettre le remboursement in extremis de 16 nouvelles molécules qui devraient permettre des économies directes. On constate d'ores et déjà que l'Association générale de l'industrie du médicament, à l'exception d'une firme déterminée, a fait appel auprès du Conseil d'État sur des bases procédurielles.
D'autre part, il est vrai qu'au cours des prochaines années, une nouvelle série de molécules, pouvant être délivrées sous le forme de préparations magistrales, ne seront plus protégées par brevet. On peut d'ores et déjà affirmer que ces molécules, sous la forme de préparations magistrales, seront nettement meilleur marché que les spécialités correspondantes. Selon toute évidence, l'industrie pharmaceutique considère cela comme une menace sérieuse.
La politique de l'APB a toujours été de maintenir une quantité viable de préparations magistrales (6 à 7 % du total). Cela suffit pour accorder aux préparations magistrales une fonction d'indicateur tarifaire en marge de la spécialité.
La loi interdit expressément la substitution des spécialités par des préparations magistrales. Ces dernières ne peuvent par conséquent être prescrites que par un médecin en lieu et place d'un autre médicament. Malheureusement, la formation des médecins présente des lacunes sur ce plan et en la matière, des discussions sérieuses entre le gouvernement et les universités s'imposent.
Un membre explique que l'une des questions n'ayant pas encore reçu de réponse à l'issue de cette première série d'auditions est celle portant sur les répercussions des médicaments non remboursables sur les budgets familiaux. Les pharmaciens semblent les mieux placés pour pouvoir apporter une réponse.
M. Broecks répond que les totaux des médicaments remboursables et non remboursables correspondent à peu de choses près en valeur. Toutefois, en ce qui concerne le nombre de prestations, le rapport est de 1 pour 3. Près d'un quart des prestations sont remboursées. Pour les trois autres quarts, ce n'est pas le cas. Cela signifie grosso modo qu'un médicament non remboursable coûte en moyenne le tiers d'un produit remboursable. Il s'agit bien souvent de médicaments plus simples proposés dans de petits emballages répondant mieux aux besoins des patients.
Second aspect de cette matière : la supposition que pour un certain nombre de familles, le coût des médicaments est insupportablement élevé parce que certains de ces médicaments ne sont pas remboursés. Les conséquences peuvent être néfastes. De par le fait que les antitussifs ne sont plus remboursés, on a tendance à recourir à des antibiotiques remboursables pour de petites affections. Plus aucun anti-douleur simple n'entre en ligne de compte pour le remboursement. Résultat : pour des raisons financières, d'aucuns ont tendance à recourir inutilement à des médicaments plus lourds. Il est clair que, de ce fait, une partie de l'effet d'économie est neutralisée, mais qui plus est, cette situation est loin d'être idéale du point de vue de la santé publique.
Aussi, serait-il bon que l'on examine à nouveau la situation, certainement pour ce qui est des anti-douleurs, surtout du point de vue des patients plus démunis comme les VIPO. Les pharmaciens se battent pour cela, entre autres dans le cadre des discussions relatives aux préparations magistrales. Toutefois, dans ce dossier, l'INAMI et le gouvernement font preuve d'une parallélisme aveugle. Ce qui n'est pas remboursable en tant que spécialité ne peut également l'être en tant que préparation magistrale.
Un membre souhaite savoir dans quelle mesure la rumeur selon laquelle ce seraient les spécialistes qui prescrivent des médicaments non remboursables est conforme à la réalité.
M. Broecks ne voit pas de corrélation directe en la matière. Il est certes vrai que l'on retrouve des produits lourds, comme des tranquillisants par exemple, dans les médicaments non remboursables mais selon lui, rien ne permet d'affirmer que les spécialistes auraient plus recours aux médicaments non remboursables que les autres médecins.
Une autre intervenante explique que durant les auditions antérieures, d'aucuns ont plaidé pour une approche du remboursement davantage axée sur la pathologie, de façon un tant soit peu comparable avec les anciennes pathologies sociales. Les patients souffrant d'une maladie grave ou chronique reconnue comme telle devraient bénéficier du remboursement pour les produits pour lesquels les autres patients ne bénéficient pas du remboursement. La techonogie de la carte SIS devrait être un instrument important.
M. Broecks estime qu'il n'est pas souhaitable, dans les circonstances actuelles, de faire figurer des donnés médicales ou thérapeutiques sur la carte SIS. Il pourrait éventuellement être possible, à terme, d'affirmer les catégories sociales sur cette carte.
Un système de sélection existe déjà par le biais du système d'attestatations du chapitre IV, en vertu duquel les produits sont remboursés dans certaines circonstances. Le système est soumis à d'importantes tensions administratives. Les médecins conseils sont à ce point submergés par les demandes que l'on peut se demander comment ils peuvent encore remplir leur tâches de façon correcte.
Un troisième système pourrait exister sous la forme d'une franchise. On en revient au Farmanet. Si les discussions stériles relatives à la seconde piste Farmanet ne s'étaient pas éternisées, l'on aurait déjà disposé d'un instrument permettant de détecter les patients caractérisés par des coûts exceptionnellement élevés de médicaments, à l'exception des produits non remboursables, non enregistrés dans le système.
M. Sabaux souligne qu'il convient de faire preuve de prudence avec la notion de « maladies sociales », car l'on peut trop aisément établir le lien avec certains comportements à risque, ce qui va à l'encontre des principes de notre système de soins de santé. On pourrait ainsi y trouver un argument pour ne pas prendre en charge les patients du SIDA.
Un membre explique qu'un remboursement reposant sur la pathologie ne doit pas prendre comme critère les causes de cette pathologie, ce qui en effet serait inacceptable. Le critère pour un remboursement plus élevé serait naturellement les coûts pour le patient découlant de cette maladie.
En effet, il est apparu des auditions antérieures que 80 % à 90 % des dépenses totales pour les soins de santé étaient concentrées dans 5 % des patients lesquels sont naturellement confrontés à des coûts élevés. Il convient de détecter ce groupe et manifestement, ce n'est possible que sur la base de critères médicaux.
M. Denecker est d'avis que cette piste de réflexion mérite d'être suivie. C'est d'ailleurs ce que l'on a fait au niveau des soins palliatifs.
Ce que l'on ne peut perdre de vue dans le débat axé sur l'accès aux soins de santé, c'est que les problèmes financiers qui se présentent sont étroitement liés à plusieurs aspects qualitatifs. Dans des secteurs comme les soins palliatifs, les soins à domicile et la collaboration, cette corrélation est particulièrement forte. Les soins à domicile sont particulièrement onéreux pour le patient et pour peu qu'il préfère ce type de soins, il se verra dans l'obligation, pour des raisions financières, de recourir aux soins en milieu hospotalier, où les coûts sont à charge du gouvernement.
Ceci explique entre autres les résultats à première vue contradictoires des enquêtes, lesquelles font apparaître que 75 % des patients (plus âgés) souhaitent être soignés à domicile, tandis que 75 % se font soigner à l'hôpital.
Il est clair que d'autres facteurs jouent également un rôle, comme le fait que les familles dans lesquelles les deux parents travaillent peuvent difficilement prendre en charge un patient à la maison, la transparence limitée du système de soin pour les patients etc. Une fois le patient hospitalisé, il lui est difficile de passer au système de soins à domicile.
Quoi qu'il en soit, les personnes seront de plus en plus nombreuses, à l'avenir, à vouloir couler de vieux jours de façon digne et la société devra s'efforcer de formuler une réponse. Cette réponse devra entre autres comprendre le développement des équipes de soins à domicile, la réalisation d'un meilleur équilibre dans le financement des soins à domicile et en hôpital, ainsi qu'une description précise des tâches incombant aux différents dispensateurs de soins. En ce qui concerne ces derniers, la concurrence au sein d'un groupe professionnel peut s'avérer salutaire, comme c'est le cas pour les pharmaciens, mais la concurrence entre les différents groupes est, elle, néfaste pour le système des soins de santé.
Comment peut-on envisager le rôle du pharmacien sur ce plan ? D'un manière générale, les pharmaciens devraient être représentés dans l'ensemble des groupes de discussion ayant trait aux soins de santé étant donné qu'ils ont une mission spécifique à remplir à ce niveau. Pour ce qui est des soins à domicile, il est souhaitable que le pharmacien soit mis au fait de la fiche de médication. Dans les soins à domicile aussi, le patient est soumis à des changemnts de médicaments et le pharmacien peut à ce niveau remplir une fonction consultative.
Sur le plan des soins transmuraux, l'APB propose d'introduire la notion de « pharmacien de maison ». Il s'agit du pharmacien auquel le patient s'adresse le plus souvent et qui devrait être enregistré dans le dossier du patient lors de son admission et de sa sortie de l'hôpital. Cela permettrait un contact sérieux entre l'hôpital et le pharmacien ambulant.
Pour ce qui est de la procédure de sortie de l'hôpital, les pharmaciens souhaitent que pour les patients de catégorie C, à savoir les patients qui, après leur sortie de l'hôpital, doivent être suivis de près et de façon coordonnée, tous les prestataires de soins ambulants soient avertis deux jours avant la sortie du patient. Il s'agit entre autre des infirmiers, médecins traitants, pharmaciens, kinésithérapeutes etc.
Enfin, il convient encore d'améliorer le système des soins palliatifs à domicile. La concertation entre les dispensateurs de soins laisse beaucoup à désirer dans ce cadre. Le financement aussi doit être amélioré.
Un membre fait référence aux exposés liminaires desquels il est apparu que de nombreux pharmaciens avaient à faire face à des retards de paiement. Ont-ils une idée du groupe concerné ?
M. Denecker répond qu'il s'agit bien souvent des personnes plus faibles sur le plan social, ayant recours à la polypharmacie. Ce groupe présente les caractérises suivantes :
· femmes isolées avec enfants
· formation limitée
· personnes âgées (plus de 70 ans)
· personnes socialement isolées
· etc.
Les conditions économiques jouent également un rôle important. Le phénomène se présente avec plus d'intensité dans les régions caractérisées par un taux de chômage élevé.
Un autre intervenant se range à cet avis, mais tient également à attirer l'attention sur le danger de situer uniquement la problématique de l'accès financier aux soins de santé sous l'angle des personnes « marginalisées ».
Une famille disposant de revenus raisonnables avec plusieurs enfants peut connaître de graves difficultés lorsqu'elle est confrontée, pour une raison ou une autre, à des dépenses de 20 000 francs par mois pour des médicaments. Il en va de même pour un indépendant après une faillite ou pour les personnes se retrouvant sans revenus après un divorce. Ce sont bien souvent ces groupes qui hésitent à s'adresser directement au CPAS. L'on constate également que ces personnes, sachant qu'elles ne peuvent payer, envoient leurs enfants chez le pharmacien. Ce dernier est alors confronté à un choix délicat. Dans la majeure partie des cas toutefois, il s'efforcera de régler les choses à l'avantage de la famille.
Il est difficile de prétendre que le gouvernement n'a fourni aucun effort pour ces patients. Le problème majeur toutefois est que l'aide financière, la franchise sociale et fiscale, est accordée post factum . Il va sans dire qu'un contrôle s'impose, mais l'on devrait s'efforcer de jouer plus serré. Dès que l'on reconnaît qu'un patient a des problèmes que l'on qualifie cela de maladie sociale ou non il devrait pouvoir accéder plus facilement aux soins de santé et aux facilités de remboursement.
M. Broecks ajoute que les lois sont nécessaires, mais que tout ne peut être réglé par ce biais. Les pharmaciens et autres dispensateurs de soins sont bien souvent placés dans des situations sur le terrain dans lesquelles ils doivent donner priorité à leur fonction sociale. Ils sont assurément disposés à prendre en charge cette mission sociale, inhérente à la profession, mais souhaitent également qu'on les reconnaisse. Bien souvent, les médecins et les pharmaciens sont dépeints comme des profiteurs du système, dont le but principal est de ratisser le plus possible de deniers publics. Qui connaît la situation sur le terrain sait pertinemment que rien n'est moins vrai.
M. Denecker souligne que le pharmacien est bien placé pour détecter les difficultés financières en rapport avec les soins de santé et il n'est pas rare qu'il signale certains problèmes au CPAS. Toutefois, il va de soi que de telles choses doivent se passer avec la plus grande discrétion et avec l'approbation du patient. En effet, tous ne souhaitent pas frapper à la porte du CPAS.
Un membre est disposé à croire tout cela, mais d'autres constatations semblent dépeindre une situation différente. L'on constate ainsi que certains hôpitaux du CPAS refusent d'administrer des soins à certains patients en raison de factures non honorées.
Par ailleurs, il convient de mentionner l'aspect structurel. Pour un pharmacien situé dans un quartier mieux situé, jouer un rôle social ne pose vraisemblablement aucun problème. Un pharmacien déployant ses activités dans une région reculée, par contre, pourra éprouver des difficultés à remplir ce rôle. Ainsi, en dépit du rôle social incontestable des dispensateurs de soins, le gouvernement ne peut en aucun cas écarter le problème.
M. Broecks abonde dans ce sens. D'autre part, il est vrai que les problèmes sociaux sont davantage répartis. Les difficultés de paiement en matière de soins de santé ne sont assurément pas l'apanage des quartiers socialement défavorisés. L'on peut toutefois craindre que ce problème ne puisse se régler à coups de lois et de règles. Pour atteindre ce groupe-cible, l'on sera presque dans l'obligation d'examiner la problématique sociale des patients ou de leur famille au cas par cas et s'efforcer de déterminer une catégorie de ce qui a déjà été qualifié de « maladie sociale ». Pour ces personnes, on sera presque forcé d'imposer une responsabilité au médecin et au pharmacien. On mettra ainsi à leur disposition un système permettant de mettre à la charge de la société un montant supérieur à ce qui est normalement remboursable.
Comme il a déjà été affirmé, il est très difficile de régler ce problème à coups de règles rigides. Voilà pourquoi il conviendrait de confier au médecin un objectif général en vertu duquel le patient dans le besoin se verrait prescrire des médicament de la façon la plus rationnelle qui soit, étant entendu que les produits indispensables seraient remboursés au maximum.
Une membre répond qu'il faut à tout prix éviter un système dual de soins de santé dans lequel l'on prescrirait de façon « rationnelle » à certains patients et de façon « irrationnelle » aux patients plus nantis. On créerait ainsi un double circuit dans lequel certains patients recevraient des soins de moins bonne qualité que le reste de la société.
M. Broecks répond que son objectif n'est pas d'arriver à un comportement « rationnel » et « irrationnel » en matière de prescription. Même si c'est toutefois ce que l'on constate dans la pratique. Aucun texte de loi n'oblige un médecin à prescrire des médicaments de façon rationnelle. Le gouvernement établit toutefois une liste des médicaments remboursables. Cela a pour résultat que le médecin est forcé, vis-à-vis des patients plus démunis, à ne pas prescrire de la façon la plus rationnelle du point de vue médical. Il est principalement obligé de se laisser guider par ce qui est remboursable pour le patient.
La preuve est donc faite que, aussi regrettable que cela soit, il existe déjà une médecine à deux vitesses, dans laquelle seuls les plus nantis peuvent actuellement se voir prescrire des médicaments de la façon la plus rationnelle sur le plan médical. Il plaide également pour que, vis-à-vis des patients éprouvant des difficultés financières, le médecin puisse également prescrire, sur des critères purement médicaux, dans un système de remboursement plus large. Le médecin bénéficie alors d'une certaine liberté et n'est plus lié, au niveau des prescriptions, par les besoins financiers de son patient.
Dans un tel système, les plus démunis bénéficient ainsi d'une protection maximale.
Par ailleurs, plusieurs mesures gouvernementales récentes vont en ce sens, comme celles visant certaines maladies chroniques comme les affections héréditaires du métabolisme. Ce que les centres agréés estiment indispensable pour les patients est remboursé par les assurances-maladie, sans que des listes de ce qui est remboursable et non remboursable doivent être établies. Pour certains groupes, il pourrait bien s'agir de la politique de l'avenir.
Une question se pose d'emblée : comment contrôler et maîtriser un tel système généralisé ? Pour ce faire, il existe la technique de l'évaluation par les pairs. On confie à l'ensemble d'une profession la mission (et la responsabilité) de veiller à ce que les soins administrés aux patients individuels le soient dans un cadre de référence bien précis.
Un membre fait observer que le peer review surgit à tort et à travers ces dernières années, mais que ses résultats se font encore rares.
M. Broecks répond que tout est question de moyens disponibles. Le gouvernement confie aux médecins le soin de développer un tel système sans leur donner les instruments nécessaires. Concrètement, la commission d'évaluation en matière de comportement prescriptif de médicaments (la commission Farmanet) souhaite depuis deux à trois ans qu'on mette à sa disposition plusieurs dizaines de millions pour alimenter le peer review avec des chiffres actualisés et bien structurés. Ces structures existent, mais l'on manque d'argent pour faire fonctionner le système. Actuellement, on travaille avec des chiffres portant sur la situation d'il y a deux ans.
L'expérience dans les autres pays, où l'on travaille de façon concertée au niveau local, prouve que c'est la bonne voie à suivre.
1. Proposition de la profession
La profession de bandagiste, orthopédiste-bandagiste compte parmi les plus anciennes professions du monde. Il existe des illustrations datant de l'antiquité égyptienne sur lesquelles on aperçoit des personnes portant des prothèses. Par ailleurs, le tsar de Russie avait élaboré une nomenclature pour les amputations, principalement militaires.
La profession traite 80 % de maladies chroniques, à savoir des patients ayant constamment besoin de soins.
Le champ d'action englobe :
· les bandages et fauteuils roulants (colostomie, ceinture abdominale etc.);
· Orthèses : accompagnement du tronc ou des membres;
· Prothèses : remplacement des membres manquants.
Les fournitures ont également une incidence directe sur :
· la diminution des jours d'alitement;
· la diminution des soins à domicile et l'amélioration du confort;
· l'intégration sociale plus rapide;
· une reprise du travail plus rapide;
· la diminution du nombre de traitements médicaux et paramédicaux.
2. Gestion du budget
En 1993, une réactualisation complète de la nomenclature a été introduite. L'objectif de cette nouvelle nomenclature était :
Une plus grande transparence
Une description plus précise et plus ciblée des fournitures par le biais de la délimitation des topographies; en d'autres termes : quel appareil entre en ligne de compte pour telle affection.
Économique
En scindant les fournitures en préfabriqué, IMF et sur mesure :
Reflet d'une nécessité thérapeutique, une répartition de la nomenclature en fonction des besoins a été réalisée et divisée en quatre catégories : les fournitures d'une nécessité absolue, une nécessité sérieuse, une nécessité modérée et une nécessité relative.
Classe I : Indications absolues
ex. fracture cervicale, paraplégie, amputation
Classe II : Indications sérieuses
ex. névralgies paralytiques, instabilité du genou
Classe III : Indications modérées
ex. lumbago, torticolis
Classe IV : Indications relatives
ex. syndrome de douleur cervicale
Les fournitures en question ont à nouveau été calculées en fonction du prix. Ce calcul a été effectué par un bureau de réviseurs indépendant. Résultats :
a) en 1963 :
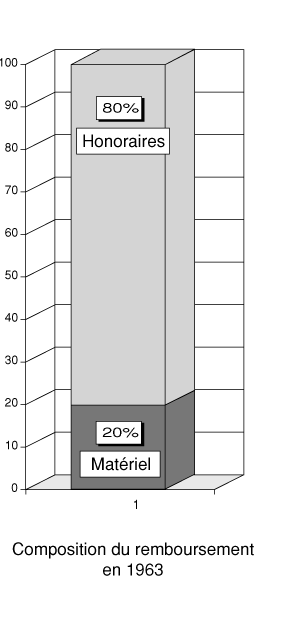
b) juste avant l'introduction de la nouvelle nomenclature le 1er février 1993 :
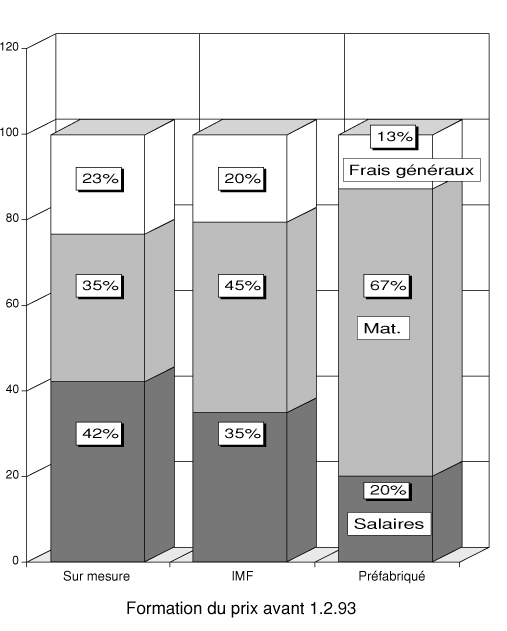
L'on constate d'importantes différences au niveau de la composition du prix de revient selon qu'il s'agit de sur-mesure, d'IMF ou de préfabriqué. Dans cette dernière catégorie par exemple, les coûts représentent une part nettement plus importante que dans le cas du sur-mesure, où les coûts de main-d'oeuvre sont naturellement plus élevés.
c) après l'introduction de la nouvelle nomenclature en 1993 :
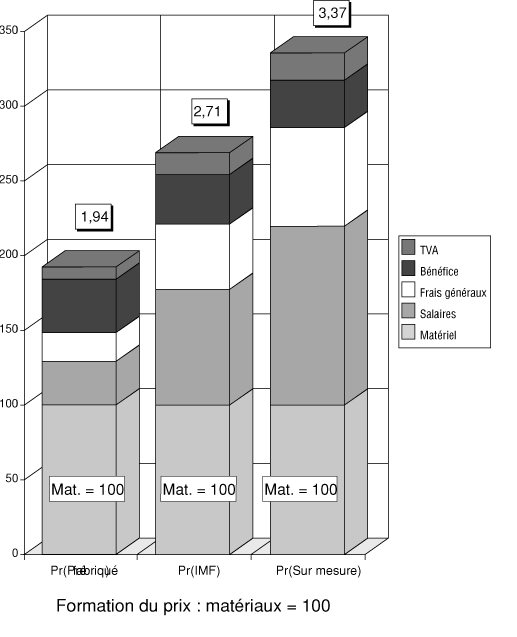
Le prix des fournitures est encore plus scindé et, dans l'illustration, l'on part du principe que le prix des matériaux équivaut à 100. Ce nouveau système présente le grand avantage qu'en cas de hausse soit des prix, soit des salaires, des matériaux ou autres, il faut uniquement agir sur la partie exprimée en pourcentage prévue dans le coefficient Walckiers. En cas de hausse des salaires de un pour cent par exemple, cela signifiera uniquement, en ce qui concerne le prix de revient, une hausse de un pour cent de la partie salaires, et non du prix total. Ce système est plus objectif que la méthode qui est trop souvent appliquée, malheureusement, dans les assurances maladie, et qui tient compte de toute une tendance. Une augmentation salariale de un pour cent entraîne bien souvent une augmentation de un pour cent du prix de revient total.
Il n'est pas étonnant que l'introduction de ce système ait permis de substantielles économies.
Par ailleurs, cette répartition de la nomenclature a permis de diversifier en fonction de l'opportunité des produits consommés. Le graphique suivant illustre la consommation des quatre types de produits dont il était question ci-avant.
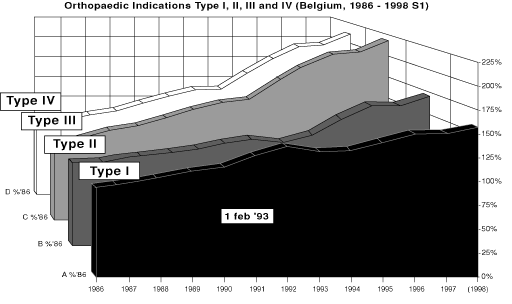
L'on note sur la base de ce graphique, principalement pour les catégories 3 et 4, une augmentation des dépenses en 1993. Cette augmentation n'est toutefois pas le résultat d'une augmentation de la consommation, mais résulte du fait que le secteur a été transféré du comité paritaire additionnel au comité paritaire de la transformation du cuir et de la cordonnerie (128.06), où les salaires sont plus élevés. Au sein de ce comité paritaire, une propre classification salariale a été instaurée pour le secteur.
Résultat : dans le budget, 0,75 % seulement des dépenses totales au niveau de l'assurance maladie, soit une progression de 365 millions de francs.
Cette nouvelle approche a toutefois bien vite fait apparaître un résultat non équivoque :
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | |
| BD orthopédie BD orthopedie | 1 521 700 000 | 1 625 600 000 | 1 755 300 000 | 2 195 800 000 | 2 154 000 000 |
| BD bandagisterie BD bandagisterie | 1 332 100 000 | 1 448 500 000 | 1 329 200 000 | 1 486 800 000 | 1 369 300 000 |
| 2 853 800 000 | 3 074 100 000 | 3 084 500 000 | 3 682 600 000 | 3 523 300 000 | |
| Dép. orthopédie Uitg. orthopedie | 1 587 439 617 | 1 274 085 757 | 1 985 847 241 | 2 118 433 636 | 2 047 831 643 |
| Dép. bandagisterie Uitg. bandagisterie | 1 233 375 393 | 1 755 765 466 | 1 344 741 342 | 1 427 089 457 | 1 331 386 601 |
| 2 820 815 010 | 3 029 851 223 | 3 330 588 583 | 3 545 523 093 | 3 379 218 244 | |
| Solde ORT Saldo ORT | 65 739 617 | -351 514 243 | 230 547 241 | -77 366 364 | -106 168 357 |
| Solde BAN Saldo BAN | -98 724 607 | 307 265 466 | 15 541 342 | -59 710 543 | -37 913 399 |
| Solde Saldo | -32 984 990 | -44 248 777 | 246 088 583 | -137 076 907 | -144 081 756 |
| % solde ORT % Saldo ORT | 2,3 % | -11,4 % | 7,5 % | -2,1 % | -3,0 % |
| % solde BAN % Saldo BAN | -3,5 % | 10,0 % | 0,5 % | -1,6 % | -1,1 % |
| % solde % Saldo | -1,2 % | -1,4 % | 8,0 % | -3,7 % | -4,1 % |
À partir de 1993, un excédent sur le budget estimé a été réalisé, à l'exception de l'année 1995, qui a eu pour résultat une surconsommation. Après enquête, il est toutefois apparu que la cause était uniquement imputable au glissement de la facturation par les compagnies d'assurance. En fait, il s'agissait de la rectification d'une situation indésirable. Jusqu'en 1993, les factures étaient enregistrées avec un retard d'environ 3 mois. Depuis cette année, la situation a été rectifiée, avec pour résultat que l'on a facturé beaucoup plus et que bon nombre de secteurs ont dépassé les budgets octroyés.
Pour les autres années, on constate toutefois que les excédents allaient de 32 984 990 francs à 144 081 756 francs. Sur la base des données déjà connues, l'on peut supposer que l'excédent en 1998 dépassera les 200 millions de francs.
Il est donc clair qu'un système dans lequel les dépenses sont évaluées sur la base des frais réels porte clairement ses fruits. Le point de départ selon lequel les honoraires sont revus à la baisse ou limités lorsque les budgets sont dépassés est un mauvais point de départ. En effet, dans un tel système, le dispensateur s'efforcera de compenser des pertes de revenus par un nombre accru de prestations. Chaque prestation supplémentaire ne signifie toutefois qu'un petit revenu supplémentaire pour le dispensateur, alors que toute une série d'autres coûts additionnels y sont systématiquement liés. Les revenus du dispensateur ne représentent en effet qu'une petite partie du prix de revient total de la fourniture.
On peut également constater que ce procédé permet de réaliser à la longue des économies de plus en plus importantes.
Dernière chose mais non des moindres: les bandagistes mènent une politique drastique, reposant exclusivement sur des arguments économiques, dans le secteur de la colo-incontinence, dont le budget total a suivi la courbe ascendante en raison de l'attitude monopolisatrice des sous-traitants.
« Ce graphique est disponible sur support papier et sur le site WWW du Sénat (http://www.senate.be) »
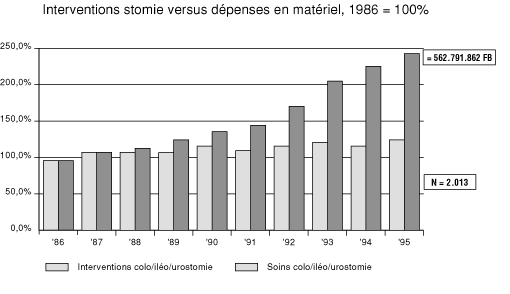
L'objectif était de réinvestir cet argent économisé dans des dossiers particulièrement importants sur le plan social dans le traitement des patients chroniques.
Malheureusement, la commission budgétaire de l'INAMI était d'un avis différent et a pénalisé le patient ainsi que ce modeste secteur en imposant des économies supplémentaires de l'ordre de 75 millions de francs. Comme nous le verrons, ce montant est indispensable pour l'amélioration du remboursement des prothèses mammaires. Ce n'est pas stimulant de devoir constater que les secteurs enregistrant de bons résultats voient leur budget amputé de 75 millions de francs au profit de secteurs moins performants.
La commission budgétaire refuse catégoriquement de traiter les secteurs avec leurs budgets bandagisterie et orthopédie respectifs comme un seul et même budget.
Néanmoins, il est clair qu'il s'agit des mêmes dispensateurs de soins. Qui plus est, dans environ 20 % des cas, les matières bandagisterie/orthopédie se chevauchent, de sorte que la procédure de feu clignotant se déclenchera par secteur partiel et que, par conséquent,
on se limite où la consommation est excédentaire;
on se limite à terme où la consommation est insuffisante, en oubliant que ces deux secteurs se complètent et sont complémentaires.
Cette arme est à double tranchant.
1. Le budget actuel
M. Duchesne aborde en premier lieu quelques chiffres en rapport avec l'évolution budgétaire.
Évolution des salaires durant la période allant d'octobre 1992 à 1994. On constate à ce niveau pour les trois catégories de travailleurs une augmentation de 5 % sur une période relativement courte.
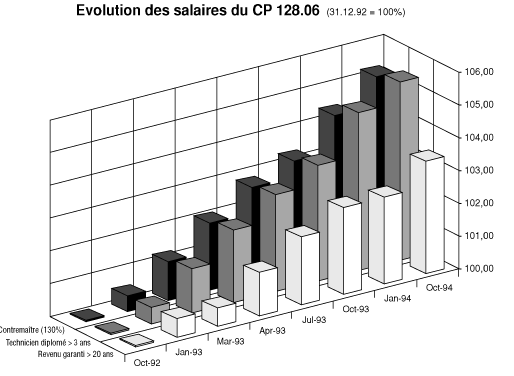
Évolution du budget orthopédie de 1986 à 1996. On note clairement une augmentation des produits bon marché IMF et Préfabriqués tandis que le sur mesure affiche une diminution marquée en chiffres relatifs.
Dépenses pour les soins de santé ambulatoires pour
les appareils orthopédiques en Belgique (1986-1996)
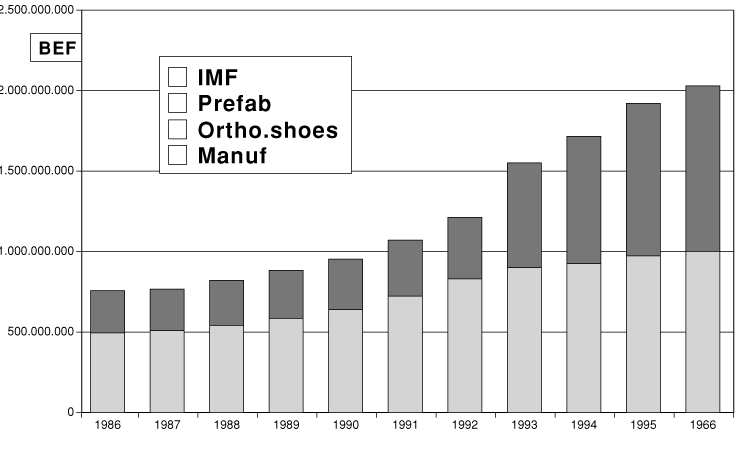
À partir de 1994, on note un affaiblissement très clair de la courbe de croissance du budget, une tendance qui se poursuit également après 1996. L'augmentation des dépenses est de ce fait mieux contrôlée.
Dépenses de soins de santé pour les appareils
orthopédiques en Belgique 1986-1996 (BEF 1996)
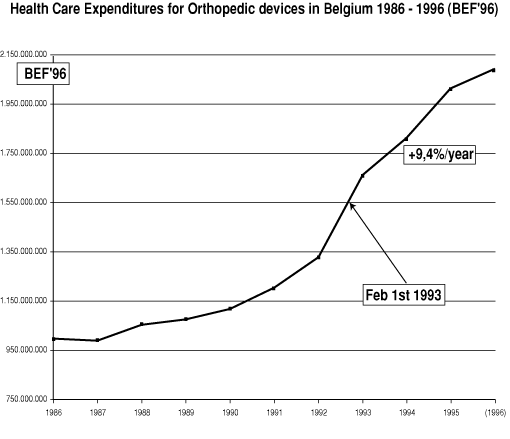
L'évolution des dépenses trimestrielles met en lumière un problème au niveau de la définition de la tendance, une tendance utilisée pour adapter les budgets. Le graphique suivant illustre les dépenses par trimestre pour la période 1991-1996. Prédire l'évolution des dépenses pour le quatrième trimestre de 1996 relève de la gageure.
Dépenses trimestrielles pour l'orthopédie
et la bandagisterie (INAMI 1991-1996 T3)
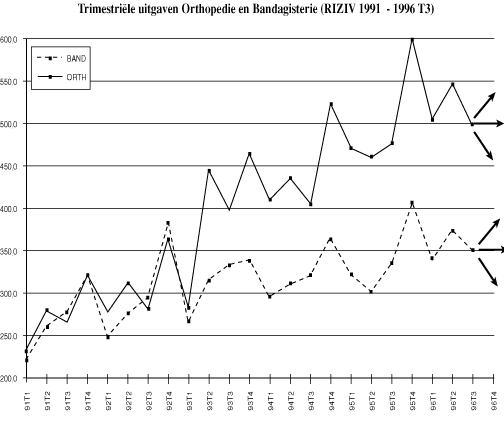
Il appert du graphique suivant qu'une importante augmentation s'est produite durant ce quatrième trimestre 1996. Toutefois, cette augmentation a d'emblée été suivie par une diminution aussi importante ou presque durant le premier trimestre 1997.
Dépenses trimestrielles pour l'orthopédie
et la bandagisterie (INAMI 1991-1998 T1)
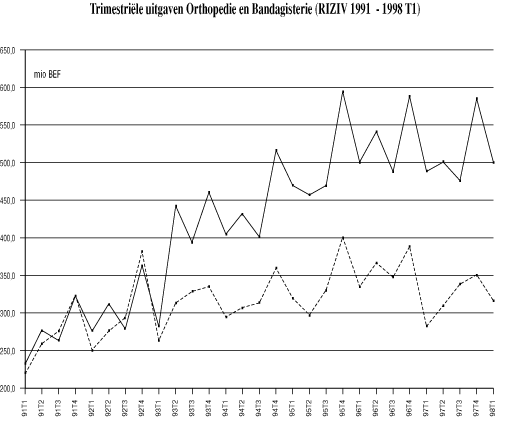
Cela confirme une fois de plus la difficulté de déterminer une tendance au niveau des dépenses. L'affaiblissement de la définition des besoins, calculé au moyen d'une tendance pouvant être définie par la commission budgétaire de l'INAMI, serait encore acceptable. L'imposition unilatérale au budget partiel badagisterie, au moyen d'un vote au sein du conseil des assurances, de la remise de 75 millions de francs, devant manifestement servir uniquement à compléter les secteurs plus importants, dépasse les bornes. Qui plus est, cette mesure remet en question le financement de la nouvelle nomenclature pour les prothèses mammaires.
2. Nouveaux dossiers
M. Weyn observe que l'association professionnelle avait caressé l'espoir que les moyens économisés auraient permis de financer de nouveaux dossiers. Il s'agit en l'occurrence de fournitures répondant absolument à une nécessité sociale, mais qui, en raison de l'abaissement imposé du budget, sont remises en question.
Pour inclusion immédiate
Il s'agit ici de dossiers déjà introduits ou prêts à l'être. Ils peuvent être financés sur la base du budget existant et déjà revu à la baisse pour cette année, exception faite des 75 millions de francs indûment prélevés sur le secteur.
a) Dossier prothèses mammaires
Ce dossier a été introduit l'an dernier avec la proposition suivante : si le gouvernement et la commission budgétaire étaient d'accord que le montant économisé en 1997 ne soit pas déduit du budget, cet argent pourrait être utilisé pour le financement de ces fournitures représentant une dépense de quelque 85 millions de francs sur une base annuelle. Toutefois, le budget a bel et bien été amputé de 75 millions de francs.
Il s'agit pourtant d'une dépense qui se justifie pleinement d'un point de vue social. Les remboursements aux patientes ayant une prothèse mammaire sont effectués suivant les tarifs déterminés voici 10 à 15 ans et ne tiennent nullement compte des développements technologiques du secteur. Les patientes souhaitant bénéficier des fournitures modernes doivent à présent payer la quasi-totalité du prix des prothèses de leur poche.
b) Dossiers décubitus matériels de prévention
L'association professionnelle est convaincue qu'une politique de prévention efficace permet de réaliser de substantielles économies sur les frais de traitement des patients en décubitus. Deux budgets ont été introduits à l'INAMI : un budget pour une utilisation permanente par les patients ayant un problème ou un risque continus et un second budget pour l'utilisation temporaire, lequel est naturellement moins élevé. Cette tendance au niveau des soins va dans le sens d'un raccourcissement des séjours hospitaliers accompagnés de soins à domicile plus intensifs. Pour ce faire, certains appareils doivent être temporairement loués. Dans le secteur des soins palliatifs aussi, ce besoin de mise à disposition de fournitures se fait sentir.
c) Dossier chaussures préfabriquées pour diabétiques avec semelles sur mesure
En travaillant de façon préventive au niveau des patients diabétiques, de nombreuses économies peuvent être réalisées, entre autres sur les chaussures orthopédiques sur mesure particulièrement onéreuses ou sur les amputations. Voilà pourquoi un dossier a été introduit en la matière auprès de l'INAMI. Partant de la supposition que 1 000 patients ont été indemnisés la première année, les répercussions budgétaires pourraient s'élever à 9 219 880 francs. L'association professionnelle est toutefois convaincue que cette dépense pourrait en fin de compte entraîner une économie de 10 millions de francs.
Ce dossier est bloqué depuis septembre de l'année dernière au sujet de la question : les médecins peuvent-ils prescrire de telles fournitures. Ces fournitures doivent-elles être intégrées dans le volet revalidation de l'hôpital ou l'endocrinologue, chargé de soigner le diabétique, peut-il prescrire la fourniture ? Il est particulièrement regrettable que ce soit le patient qui doive faire les frais de tels arguties. Par ailleurs, on constate en pratique que les patients sont dans l'obligation d'opter pour un volet revalidation afin de pouvoir obtenir gratuitement certaines fournitures. Il va sans dire qu'une telle situation est loin d'être avantageuse du point de vue financier pour l'INAMI.
d) Dossier oxygénothérapie
Ce dossier a été établi sur la base des réflexions suivantes :
augmentation du nombre d'affections respiratoires chroniques (ex. BPCO, etc.)
procédure relativement encombrante actuellement pour appliquer l'oxygénothérapie chez les patients : oxygène liquide stocké dans d'imposants conteneurs lourds, mobilité réduite, etc.
Les propositions suivantes ont été formulées :
* Aérosols : descriptions adaptées aux nouvelles technologies, adaptation des appareils actuellement repris.
* Oxygénoconcentrateur : appareil mobile et moderne concentrant l'oxygène de l'air ambiant pour atteindre le niveau souhaité de 95 % à 98 % d'oxygène pur. Résultat : économies sur les dépenses récurrentes pour l'oxygène liquide.
* Appareil NCPAP : appareil permettant de soulager ou de supprimer les problèmes respiratoires durant le sommeil.
En raison du nombre croissant de patients confrontés à cette problématique, nous serons en mesure d'éviter un nombre important de traitements externes par le biais des traitements à domicile. De la sorte, les patients pourront demeurer plus longtemps et surtout de façon plus confortable à domicile.
e) Dossier révision des prothèses
La révision du dossier des prothèses de la jambe a été entamée il y a deux ans.
Dans l'intervalle, la prothèse myo-électrique a été incluse dans la nomenclature.
Le dossier des prothèses de la jambe est en préparation depuis 1997 et sera introduit dans le courant de 1999. Ce dossier est fondé sur une approche nouvelle et révolutionnaire de la problématique en question : jusqu'ici, on offrait à tous les patients un éventail limité de possibilités, sans chercher à savoir si ceux-ci pouvaient ou non utiliser pleinement le produit final fourni.
Dans le nouveau concept, on procédera préalablement à une évaluation des possibilités thérapeutiques, de l'âge, des conditions de vie, de l'environnement, etc. Les patients seront répartis en quatre catégories et recevront une prothèse en fonction de l'usage prévu. Cette prothèse correspondra à l'une des quatre catégories, en fonction des possibilités physiques du patient.
On pourra ainsi économiser sur les prothèses suroptimalisées pour certains patients, ce qui dégagera des moyens à investir dans des prothèses plus optimalisées pour les patients dont le taux d'activité est plus élevé. De cette manière, l'utilisation de techniques plus modernes pour ceux des patients qui en ont besoin, pourra désormais être financée dans le cadre du budget, moyennant une légère adaptation.
Pour plus tard
a) Dossier bas thérapeutiques
En raison des restrictions budgétaires et de la demande des fonds nécessaires à cet effet, lesquels dépasseront largement les 500 millions (estimation effectuée en comparaison avec les Pays-Bas et l'Allemagne en fonction du nombre total d'habitants), nous avons placé cette matière sur la liste d'attente.
Néanmoins, dans tous les pays environnants, les bas thérapeutiques sont compris dans l'enveloppe de remboursement de l'assurance maladie.
Il convient de souligner que l'absence de remboursement en la matière constitue une carence sociale grave. Et ce, principalement envers les personnes financièrement assistées.
Les problèmes vasculaires et lymphoedématiques graves ne peuvent en effet être traités que par l'application conjuguée de ces bas thérapeutiques.
Le prix de ces bas oscille entre 2 000 francs et 8 000 francs, lorsque du travail sur mesure s'impose.
Par conséquent, nous constatons sur le terrain que de nombreux patients n'ont pas les moyens d'acquérir de tels bas. Une telle situation débouche sur des dépenses importantes au niveau tant des soins à domicile que des traitements médicaux et de l'hospitalisation.
On peut considérer qu'il est nécessaire, d'un point de vue social et médical, de prévoir une intervention pour ces bas thérapeutiques à partir de la classe II.
b) Dossier soins à domicile
Trois budgets ont été déposés en ce qui concerne ce dossier.
Le premier permet de satisfaire d'une manière optimale les besoins immédiats qui existent au sein du secteur des soins à domicile. Cela nécessite une dépense de 449 millions de francs.
Le deuxième concerne les fournitures secondaires et s'élève à 304 millions de francs.
Le troisième concerne les fournitures moins indispensables et s'élève à 380 millions de francs.
Il ressort de ces chiffres que, si l'on veut que le secteur des soins à domicile soit bien couvert, ce que tout le monde répète actuellement, les crédits affectés à ce secteur devront doubler. Aussi est-il impossible que le secteur lui-même génère ces moyens, comme c'est le cas en ce qui concerne les cinq dossiers précités.
M. Roex souligne qu'assurer l'accessibilité des soins médicaux constitue l'une des pierres angulaires des soins de santé accessibles pour tous. En effet, plus les obstacles entravant l'accès aux soins sont nombreux, plus les risques d'inégalité socio-économique dans la distribution des soins sont élevés. À son tour, cette inégalité entraînera par la suite des coûts plus élevés pour la communauté, en raison de l'apparition d'une pathologie plus lourde induite par un manque de soins.
L'accessibilité aux soins doit être une préoccupation constante des décideurs politiques et cette accessibilité devrait être réévaluée à chaque nouvelle mesure.
1. Obstacles administratifs
De nombreuses personnes sont empêtrées dans des procédures administratives et ne sont pas assurées. Quelques exemples :
lors du passage du chômage au travail à temps partiel, les formalités administratives concernant la mutualité et les allocations familiales ne sont pas négligeables;
le changement du statut d'indépendant à celui de salarié et vice-versa;
l'analphabétisme;
les cachets avec quelques interruptions;
la problématique des réfugiés;
une famille peut compter des personnes assurées et d'autres qui ne le sont pas.
Nous avons eu vent de personnes qui se laissaient mourir en appelant à l'aide trop tard par peur des conséquences !
Les mesures (la suppression du temps d'attente, l'élargissement du statut VIPO, et autres) prises par la ministre De Galan sont positives mais leur application était et demeure délicate. Les caisses d'assurance maladie attendent que les assurés font une demande active. À défaut de celle-ci, la loi n'est pas appliquée !
Par ailleurs, on n'insistera jamais assez sur le fait que les mesures administratives ne règlent qu'une partie seulement des problèmes. Si les tickets modérateurs continuent à augmenter dans d'autres domaines ou si le remboursement disparaît totalement (dentisterie ou médicaments), l'assurabilité ou le statut VIPO est un avantage négligeable.
2. Obstacles financiers
a) Le prix ou le prix supposé des soins de santé rebute les patients. Certains malades n'ont pas l'argent comptant demandé pour leurs soins et se contentent de les reporter. Il en va de même pour l'achat de médicaments ou les traitements de kinésithérapie et pour les prothèses et autres soins dentaires.
Il en va de même pour le report de l'aide familiale et de l'aide aux personnes âgées en raison du « prix de revient ». Ce phénomène entraîne également ultérieurement des frais pour la communauté.
b) En raison de l'incertitude au niveau du prix de revient d'une hospitalisation, de nombreuses personnes hésitent à recourir aux soins. Le patient n'a aucune emprise sur les actes qu'il aura à subir.
La majeure partie des patients ne comprend rien à la franchise sociale ou fiscale. On ne comprend pas ce à quoi on a droit et pourquoi l'on perd l'avantage. Le remboursement par la franchise fiscale n'intervient qu'au moment où le patient n'a plus besoin de l'avantage, à la suite de l'amélioration de son état ou en cas de décès. Le remboursement intervient au moment où le problème financier est réglé ou lorsque des ravages ont déjà eu lieu. En outre, les médicaments ne sont pas inclus dans la franchise sociale et fiscale. Ce sont précisément ces médicaments qui constituent une charge lourde pour les patients chroniques. Il n'est pas rare que les dépenses pour des médicaments représentent 10 % des revenus familiaux.
c) Les factures élevées des hôpitaux sont devenues un fléau pour les revenus modestes. Maladie = catastrophe ! Il faut se rendre compte qu'un pensionné ou un minimexé ayant un revenu de 32 000 francs doit économiser pendant deux ans sur tous les postes de dépense pour payer de sa poche 38 000 francs d'une facture d'hôpital par exemple.
Les jeunes familles devant hospitaliser leurs enfants à plusieurs reprises sont handicapées de nombreuses années durant sur le plan financier.
d) Le paiement comptant est, certainement dans les villes, une raison de l'affluence dans les services d'urgence, bien souvent utilisés comme dispensaire gratuits ouverts 24 heures sur 24. Le règlement actuel du tiers payant stimule parfois l'utilisation d'un soin plus onéreux au détriment d'un soin (de première ligne) meilleur marché, bien souvent plus proche des gens.
Le ticket modérateur, par exemple chez le médecin, freine bien souvent ce qu'il ne doit pas. Les soins nécessaires ne doivent pas être freinés. La politique actuelle en matière de ticket modérateur englobe souvent des mesures linéaires aveugles destinées à freiner la surconsommation sans toutefois qu'elles y parviennent. Le prix de ce ticket modérateur oblige un certain groupe à reporter les soins (nécessaires !) ce qui entraîne ultérieurement des coûts plus élevés.
e) Le remboursement différé des prestations, que de nombreuses caisses d'assurance maladie ont introduit pour des raisons de sécurité (après remise d'une attestation pour les soins prodigués, l'argent est versé ultérieurement sur le compte en banque), met les patients dans l'embarras et empêche certains patients d'acheter les médicaments nécessaires.
f) Les assurances additionnelles ou privées (des caisses d'assurance maladie ou autres) apportent aux patients et dispensateurs de soins une certaine sécurité et confiance mais affaiblissent la solidarité et excluent toute réflexion approfondie sur la nécessité des dépenses assurées et des réformes indispensables.
3. Obstacles psychologiques
Bien souvent, les gens ont un certain préjugé vis-à-vis d'une certaine forme de soin et n'y ont pas recours pour cette raison. Ils consultent une structure plus onéreuse ou non adaptée à leur problème. Le patient finit par perdre confiance dans les soins. Les expériences passées en ce qui concerne les conséquences des factures impayées (cf. agences de recouvrement, embargo sur les soins pour certains patients dans certains hôpitaux) en rebutent plus d'un. Nombreux sont ceux qui ne reviennent que lorsque des dommages irréparables ont été commis, avec, pour conséquence, des frais plus élevés pour la communauté.
Certains groupes de la population ne sont que trop peu familiarisés avec notre système de soins de santé pour en faire une bonne utilisation : comme dans certains pays, ils ont uniquement recours aux soins hospitaliers. Cette culture existe également dans certains quartiers.
4. Obstacles matériels
La distance qui sépare le patient de l'endroit où sont dispensés les soins peut inciter celui-ci à reporter les soins : accessibilité avec les transports en commun, à vélo, en voiture ...
Les heures d'ouverture des différents segments du soin doivent correspondre d'une manière suffisante aux besoins du groupe cible qu'on souhaite atteindre.
La disponibilité de certains services médicaux est insuffisamment connue de certains patients.
On peut également se demander si les services de garde opérant à travers le pays répondent suffisamment aux besoins et aux attentes de la population.
Propositions
Les formalités administratives doivent être réduites à un minimum compréhensible pour l'assuré, et ce, dans l'intérêt de l'assuré mais aussi de la communauté. Les intérêts des organismes d'assurance doivent venir en seconde position. Ne serait-il pas mieux que l'on soit automatiquement assuré dès que certaines conditions sont remplies ?
Les seuils financiers doivent être le plus possible abaissés. On pourrait se demander si un accès entièrement gratuit aux soins de première ligne n'abaisserait pas sensiblement l'accès aux soins sans pour autant faire exploser le coût total pour la communauté. Cet abaissement du seuil doit alors ouvrir la porte aux soins situés à un autre niveau (deuxième ou troisième ligne), dès que cela s'avère justifié. Ce seuil d'accès aux soins rabaissé avec renvoi justifié vers un autre type de soin est ce que le Cartel appelle échelonnement et pourra à coup sûr augmenter la confiance de ce groupe de patients, qui risquent à présent d'être exclus.
Des informations et une communication s'imposent à tous les niveaux et dans tous les domaines. Quand est-on assuré ? Qu'est-ce que la franchise sociale ? La franchise fiscale ?
Une nouvelle politique doit être menée : axée sur l'avenir et qui ne se contente plus de réagir aux problèmes qui se posent.
Les objectifs des soins de santé doivent être clairement formulés : quels soins seront prodigués, quels besoins seront comblés ? Où en est-on avec la définition des besoins ? On peut craindre que la responsabilité financière des caisses d'assurance maladie entraîne un glissement des caisses d'assurance maladie vers les assurances. Voilà pourquoi leur efficacité doit entre autres être jugée en contrôlant l'accessibilité aux soins pour les plus faibles.
Le règlement du tiers payant peut certes être affiné par la création de chèques circulaires pouvant être utilisés comme moyen de paiement pour les soins de santé ou l'intégration d'un tel droit dans la carte SIS.
Le dossier médical récemment introduit ouvre de nouvelles possibilités au niveau de la médecine générale, pour la quasi-totalité des obstacles évoqués. Ces initiatives doivent bénéficier d'un soutien suffisant.
M. Van De Meulebroeke ajoute que les médecins aussi ont quelques questions à poser au monde politique. L'une des principales d'entre elles porte sur l'avenir de l'assurabilité. Il n'est pas impensable que notre système devienne un système de soins de santé à deux vitesses. Les prothèses, par exemple, sont à ce point onéreuses pour les patients que certains groupes de la société ne peuvent se les payer.
M. Vermeylen rappelle qu'une vaste enquête sur la santé avait été réalisée en 1997, de laquelle il était apparu que 10 % de la population reportait les soins médicaux pour des raisons financières. À lui seul, ce chiffre prouve qu'une partie importante de la population se trouve dans une situation de précarité sur le plan de la santé.
Avant d'examiner l'avenir, il est peut-être bon de revenir sur l'évolution passée de la situation au moyen d'un exemple concret. Voici quatre ans, le comité d'assurance de l'INAMI avait prié le Collège des médecins-directeurs de bien vouloir composer un groupe d'experts. Ce groupe devrait étudier dans quelles conditions l'INAMI pouvait intervenir dans les frais de soins palliatifs à domicile, afin que ceux-ci ne soient pas plus chers pour les patients que les soins en hôpital.
Abaisser le prix des soins palliatifs à domicile pour les patients ne relève pas uniquement de préoccupations économiques. Il s'agit également d'un confort matériel et d'un réconfort moral pour le patient, lequel peut terminer sa vie auprès de ses proches.
Le groupe de travail s'est penché sur ce sujet durant trois ans et a présenté ses conclusions voici plus d'un an déjà. Depuis, le dossier est sur une voie de garage. Cela ne peut être dû à des obstacles de procédure, car les mesures qui s'imposent peuvent être prises par simple arrêté royal. On en est au même point qu'il y a quatre ans.
Du côté de l'INAMI, on semble éprouver des difficultés à comprendre qu'en cas de glissement du milieu hospitalier vers les soins à domicile, les budgets revêtiraient un caractère totalement différent. Alors qu'une hospitalisation coûte environ 10 000 francs par jour, le groupe de travail a estimé le coût des soins à domicile pour ces patients à 2 000 ou 3 000 francs la journée. Le remboursement de cette forme de soins à domicile serait donc avantageuse pour le patient mais aussi pour la communauté.
Le secteur semble certes pétri de bonnes intentions, mais les concrétiser sur le terrain semble poser de nombreuses difficultés en raison des nombreux obstacles de toute nature. L'ABSYM continuera quoi qu'il en soit à tout mettre en oeuvre pour mener à bien ce dossier.
M. Melis fait observer qu'un glissement des soins à l'hôpital aux soins à domicile entraîne également un glissement des budgets disponibles. Cela signifie que des choix politiques doivent être opérés et des priorités établies. Sur ce point, les visions des deux organisations ne coïncident pas toujours.
Le Cartel attache une grande importance à la médecine de première ligne. Au cas où celle-ci serait renforcée, des moyens doivent être débloqués ailleurs. Si tel n'est pas le cas, l'ensemble du système d'assurance risque de connaître des difficultés financières.
Lorsqu'un membre souhaite savoir où se situent les différences au niveau de l'approche des deux organisations, M. Vermeylen répond que pour ce qui est de la description de la problématique, les deux organisations sont, dans les grandes lignes, sur la même longueur d'onde.
On note toutefois plusieurs différences au niveau de l'approche. Ce n'est un secret pour personne que l'une de ces différences a trait à l'échelonnement des soins de santé. Pour l'ABSYM, nous trouvons en première ligne la médecine ambulante qui, entre autres mais de façon non limitative, est assurée par les généralistes. En seconde ligne, nous trouvons la médecine spécialisée, ambulante ou en hôpital, à laquelle les patients s'adressent à la suite de l'intervention de leur médecin traitant. Enfin, nous trouvons la médecine de troisième ligne, hyperspécialisée, administrée majoritairement en milieu hospitalier. À ce niveau, citons par exemple la médecine spécialisée, administrée dans les hôpitaux universitaires.
L'échelonnement des soins de santé est pour cette raison un peu plus compliqué. Il ne s'agit pas uniquement de déterminer si un patient doit en premier lieu consulter un médecin traitant avant de pouvoir consulter un spécialiste.
M. Roex souligne que chacun s'accorde à dire que le seuil d'accès aux soins de base doit être le plus bas possible. Une telle chose n'a toutefois de sens que s'il est parallèlement garanti que le système peut supporter l'afflux qui en résulte. Le Cartel ne s'est jamais prononcé pour une forme « militaire » d'échelonnement. Le concept doit être étoffé d'une manière positive. Cela implique que quiconque adhère au système y souscrit complètement et que le système ne contient aucun nouveau seuil. De nouvelles techniques, comme l'introduction d'un honoraire de référence distinct pour les spécialistes, peuvent y contribuer.
Dans le récent rapport de l'OCDE consacré aux soins de santé en Belgique, il est indiqué que notre système de soins de santé est particulièrement ouvert, mais que les filtres y sont insuffisants. Chaque patient peut être intégré dans le système à tous les niveaux, avec, pour conséquence, que la structure dispensant le soin n'est pas toujours adaptée au problème médical qui se présente. Il va de soi que cela augmente sensiblement les coûts. Chez nous, il est ainsi possible de se rendre dans une structure universitaire pour une simple bronchite. Il est clair que le coût est plus élevé que lorsque ce patient s'adresse à un établissement de base.
M. Vermeylen constate avec satisfaction que le représentant du Cartel ne plaide plus en faveur d'une forme militaire d'échelonnement. Chacun a en effet intérêt à ce que plusieurs filtres soient intégrés dans le système, pour assurer que les patients soient traités au niveau adéquat. L'ABSYM plaide à cet égard pour un système d'auto-évaluation et d'autorégulation par le corps médical. L'organisation s'oppose aux mesures imposées par la hiérarchie qui, à terme, pourraient avoir un effet opposé.
Un membre fait observer que l'accès aux soins de santé revêt une importante dimension financière comme en attestent les présents exposés. Les patients reportent les soins qu'ils ne sont pas en mesure de payer tandis que l'assurance ne parvient plus à rembourser certains services parce que les budgets sont limités.
Ce n'est toutefois qu'un côté de la médaille. L'autre est celui de la surconsommation, dans laquelle des moyens qui pourraient être mieux utilisés sont perdus. L'on montre bien souvent du doigt le comportement des médecins en matière de prescription. Ceux-ci seraient responsables des carences de l'assurance maladie. Ces carences doivent alors être apurées par d'autres voies, via l'augmentation du ticket modérateur et autres.
M. Vermeylen fait ici référence à l'exposé de M. Roex sur l'utilisation des services d'urgence en tant que « dispensaires 24 heures sur 24 ». Il connaît personnellement des situations dans lesquelles les patients rejoignent le service de garde d'un hôpital le soir venu au lieu de contacter leur médecin. Résultat : une structure plus onéreuse de soins est utilisée alors que cela ne s'avère pas indispensable. Il va de soi que de telles situations doivent être le plus possible évitées dans la mesure du possible.
En ce qui concerne la consommation médicale d'une manière générale, l'ABSYM a adopté une position très claire. Elle part du principe qu'il est insensé d'imposer ex cathedra certaines pratiques aux médecins. Par le passé, la pratique a déjà démontré que cela pouvait éventuellement déboucher sur des résultats dans un premier temps, mais que, par la suite, les conséquences négatives de telles mesures coercitives étaient plus importantes que le mal que l'on entendait combattre.
Une approche nettement plus efficace, y compris du point de vue économique, consiste à permettre aux praticiens d'évaluer mutuellement leur propre comportement et la qualité de leurs prestations. C'est d'ailleurs la logique qui sous-tend les Groupes locaux d'évaluation médicale (GLEM), dans lesquels les médecins sont invités à réfléchir et à se concerter entre autres sur leurs comportements en matière de prescription.
C'est également dans cette optique que Farmanet a été approché. Lorsque, en novembre dernier, les données relatives aux comportements en matière de prescription durant le premier trimestre de 1997 ont été envoyées aux médecins, ce n'était pas pour leur imposer certaines normes mais pour les inciter à se consulter et à consulter leurs pairs dans les GLEM.
M. Melis s'accorde à dire que les médecins doivent se consulter en permanence sur la qualité de leur aide et évaluer, dans un esprit de concertation, leur comportement en matière de prescription, à la lumière d'une éventuelle surconsommation. Le gouvernement ne peut toutefois pas jouer à l'autruche et partir du principe que tous les problèmes en matière de soins de santé sont ainsi résolus.
Qui connaît la situation dans une ville comme Bruxelles n'ignore pas que pour une certaine tranche de la population, même les soins de santé de base sont encore trop onéreux. Des familles dans lesquelles trois personnes sont atteintes par la grippe en même temps ne sont pas toujours en mesure de s'acheter les médicaments nécessaires. Même dans les quartiers mieux situés, les pharmaciens accueillent des personnes leur demandant d'opérer une sélection parmi les produits prescrits parce qu'ils ne peuvent se permettre d'acheter l'ensemble des médicaments. D'autres patients se contentent d'attendre que le mal passe. On imagine aisément les situations que cela peut entraîner. La situation en la matière commence à prendre des dimensions colossales et peut uniquement être réglée en abaissant les coûts pour ces groupes de patients.
M. Roex ajoute que les tickets modérateurs ne correspondent pas toujours à ce que leur nom laisse supposer. En fonction des revenus dont disposent les patients, les tickets modérateurs freinent la consommation. Pour les catégories de revenus supérieures, leur influence est pratiquement inexistante. Pour les revenus moyens, ils agissent jusqu'à un certain niveau mais on constate déjà qu'ils ont atteint un point critique dans certains cas. Pour les catégories de revenus les plus faibles, ils peuvent toutefois être néfastes. On constate à ce niveau que des patients négligent des soins vitaux parce qu'ils ne peuvent financièrement se les permettre. Il n'est pas exagéré d'affirmer que les tickets modérateurs, à leur niveau actuel, entravent fortement une bonne gestion du système des soins médicaux.
M. Vermeylen souligne que la Belgique est l'un des rares pays d'Europe dans lequel un ticket modérateur relativement élevé doit être payé pour une visite chez le médecin. On peut dès lors se poser des questions. D'autre part, la médecine gratuite existant dans certains pays est synonyme de médecine « de moins bonne qualité » administrée par le gouvernement. Il s'agit par conséquent de trouver un équilibre dans lequel la médecine est financièrement accessible pour tout un chacun sans que la qualité des soins ne soit altérée et où le même niveau (élevé) est appliqué pour tout le monde.
À la question portant sur les factures impayées dans les hôpitaux, M. Roex répond que de telles pratiques posent des problèmes réels à certains hôpitaux. Dans certaines institutions, les impayés représentent jusqu'à 10 % des montants facturés. L'on constate toutefois que certains hôpitaux font appel à des agences de recouvrement avec, pour résultat, que les dettes relativement faibles prennent des proportions énormes après quelques années. Ce genre de situation fait bien vite le tour des groupes de population en question et a pour résultat que les personnes qui tirent le diable par la queue n'osent même plus aller à l'hôpital lorsqu'elles en ont vraiment besoin.
Un membre fait observer que ces remarques confirment entre autres ce qui a été dit durant les auditions des représentants des CPAS. En marge de cela, l'on constate toutefois que la Belgique connaît une consommation élevée de médicaments par rapport aux autres pays. Jusqu'ici, la commission n'a trouvé aucune explication à ce phénomène. On évoque à chaque fois des différences culturelles. Il est cependant difficile de s'imaginer qu'il existerait en la matière un tempérament « belge » particulier chez les médecins et les patients, différant fondamentalement de la mentalité existant dans les pays voisins.
Pour le patient, force est de l'avouer, un bon médecin est bien souvent un médecin qui prescrit beaucoup de médicaments. Question : l'évaluation relative au comportement en matière de prescription dans les GLEM, aussi positive soit-elle, sera-t-elle suffisamment suivie d'effets et entraînera-t-elle un changement de mentalité dans le grand public ?
M. Vermeylen déclare qu'il ne s'est pas vraiment préparé à cette question, mais il peut apporter quelques éléments de réponse. Il est personnellement convaincu que, contrairement à ce que d'aucuns suggèrent, la consommation de médicaments en Belgique est inférieure à celle d'autres pays européens. Des différences importantes existent sur ce plan en Europe, mais celles-ci suivent une ligne clairement définie du Nord au Sud. Un médecin belge qui, au terme des vacances, reçoit des patients avec une prescription émise en France, en Espagne ou en Italie, ne peut que constater que l'on prescrit davantage dans ce pays. Il convient dès lors de relativiser.
D'autre part, force est de reconnaître qu'aux Pays-Bas par exemple, les prescriptions sont moins nombreuses que chez nous. On entrevoit ici les conséquences du fait que la Belgique s'est abstenue d'introduire un numerus clausus pour l'accès à la profession de médecin. Notre pays a à faire face à une pléthore de médecins. Cela se traduit naturellement au niveau des revenus de chaque médecin, qui se trouve dans l'obligation quasi naturelle de faire les quatre volontés des patients, a moins tendance à les diriger vers la médecine de deuxième ligne et préfère faire lui-même les prescriptions.
M. Van De Meulebroeke ajoute encore plusieurs autres éléments qui peuvent avoir une incidence sur la consommation de médicaments, comme l'influence des médias et des techniques de marketing de l'industrie pharmaceutique. S'ajoute à cela le fait qu'en Belgique, on prescrit moins de médicaments génériques, car la différence de prix par rapport aux spécialités est nettement plus petite que dans les autres pays.
Il convient de reconnaître que le comportement des médecins en matière de prescription est également déterminé par leur formation. La maîtrise du prix de revient dans les soins de santé ne figure généralement que peu au programme des formations. Les investissements en la matière par les universités devraient peut-être être remboursés.
M. Melis souligne que, lorsqu'on parle de dépenses élevées pour des médicaments en Belgique, il s'agit d'enveloppes financières. Celles-ci sont également déterminées par le prix des produits, plus élevé chez nous en moyenne que dans plusieurs pays d'Europe méridionale par exemple. Pour certains produits, le rapport en matière de prix est de 1 à 7. Cela soulève à tout le moins des questions sur la façon dont ces prix sont fixés.
Par ailleurs, on constate en pratique que des patients quittent l'hôpital avec d'interminables prescriptions pour des médicaments se contentant de lutter contre les symptômes, mais qui n'en sont pas moins onéreux. Lorsqu'on s'informe à ce sujet dans les hôpitaux, il s'avère que les spécialistes qui ont prescrit les produits ignorent bien souvent le prix desdits produits en pharmacie. Sur ce plan aussi, des informations s'imposent.
Pour les médicaments plus onéreux, il n'est pas rare qu'il faille négocier entre le spécialiste, le médecin et le patient pour arriver à une situation financièrement acceptable pour ce dernier. Il est trop simple d'affirmer que les médecins prescrivent trop. Bien souvent, ils sont dans l'obligation de suivre la prescription onéreuse d'un spécialiste.
M. Roex ajoute qu'aux Pays-Bas et au Danemark, la consommation de médicaments est moins élevée qu'en Belgique, mais ce n'est peut-être pas un hasard si la densité de pharmacies est moins importante qu'en Belgique. Les Pays-Bas comptent la moitié voire le tiers du nombre de pharmacies que compte la Belgique. Il y a par conséquent une surabondance de pharmacies chez nous qui pourrait expliquer une partie de la consommation élevée de médicaments.
S'ajoute à cela le fait que nos pharmacies doivent réaliser une bonne partie de leur chiffre d'affaires avec des produits pouvant être obtenus sans prescription. Reste à voir si une personne grippée qui se rend directement chez le pharmacien s'en sort toujours de façon plus avantageuse que si elle se rend d'abord chez le médecin pour avoir une ordonnance.
Il embraie ensuite sur les techniques de marketing de l'industrie pharmaceutique mettant les médecins sous pression de façon indirecte. Lorsqu'un nouveau produit est lancé sur le marché, le lancement est annoncé au grand public par le biais de campagnes dans la presse. Une fois que les patients connaissent l'existence du produit et ses effets supposés, il est difficile pour le médecin de ne pas suivre. Un patient ne comprendra pas pourquoi un médecin ne connaît pas ou refuse de prescrire un nouveau produit auquel la presse attribue une action spectaculaire.
Le bon fonctionnement de ce système se note également au fait que les patients achètent des produits à l'étranger, sur la base de communiqués de presse, car ceux-ci ne sont pas encore disponibles en Belgique.
M. Vermeylen indique qu'en Allemagne par exemple, l'on prescrit bien plus de médicaments génériques qu'en Belgique. Cela s'explique, entre autres, par le fait qu'un médecin dans ce pays perd automatiquement de ses honoraires lorsqu'il dépasse un montant déterminé de médicaments prescrits. En Belgique, un tel système ne peut pas fonctionner, pour la simple et bonne raison qu'un médecin belge gagne quatre fois moins que son confrère allemand. Il est toutefois possible que les médecins s'asseyent à une table et procèdent entre pairs à une évaluation de produits commercialisés sur le marché et de leurs produits de remplacement.
Selon lui, il est logique que l'industrie pharmaceutique annonce par voie de presse les produits qu'elle commercialise sur le marché. Personne ne peut en prendre ombrage. Parallèlement à cela, une commission scientifique est active au sein du département de la santé publique. Celle-ci développe actuellement des techniques visant à informer de façon correcte les prescripteurs de médicaments sur les produits présents sur le marché. D'aucuns proposent ainsi en premier lieu qu'en Flandre, les médecins soient visités par des personnes pouvant fournir des explications objectives sur certains produits. Par ailleurs, d'autres techniques d'information seront également utilisées pour transmettre des informations objectives de meilleure qualité sur les médicaments aux prescripteurs. Il va de soi que l'un des éléments importants de cette information est le prix des produits.
Personnellement, il est d'avis que cette approche est nettement plus positive que la confrontation entre les différents acteurs du secteur : médecins, spécialistes, pharmaciens, industrie du médicament... Si l'on souhaite obtenir des résultats positifs, il importe au contraire que tout le monde se réunisse autour d'une table et amorce la discussion.
M. Melis n'y voit aucune objection. Il convient toutefois de présenter les choses telles qu'elles sont. Pour certaines affections banales, la pénicilline demeure encore et toujours le meilleur médicament. Le problème est que la pénicilline ordinaire en comprimé, contrairement au Luxembourg, n'est plus disponible sur le marché belge. On utilise dès lors des produits plus onéreux qui ne sont guère plus efficaces. Ce n'est pas le seul exemple d'un produit retiré du marché, pour la simple raison qu'il est trop bon marché.
Un membre fait observer que le prix des médicaments a déjà été abordé à plusieurs reprises lors des précédentes auditions. Il continue à se poser des questions au niveau de la procédure présentement suivie. On a l'impression que les instances qui doivent trancher ne comprennent pas suffisamment comment le prix de revient des médicaments est calculé.
M. Vermeylen est d'avis que l'un des problèmes en la matière réside dans le caractère comparatif du système de remboursement. Lorsqu'un nouveau produit est lancé sur le marché contre l'hypertension par exemple, il sera presque automatiquement remboursé au tarif du précédent médicament.
M. Melis précise que le prix du marché d'un médicament est déterminé en bonne partie par une estimation des possibilités financières des différents pays dans lesquels il est commercialisé. Lorsque les firmes supposent qu'un médicament suscitera un intérêt marqué dans un pays déterminé et que l'on est disposé à y mettre le prix, le prix du médicament dans ledit pays sera plus élevé.
Cela explique également les différences de prix importantes entre la Belgique et un pays comme le Portugal, où le niveau de vie est plus faible. L'on peut également supposer que dans ce dernier pays aussi, les médicaments génèrent des bénéfices. L'expérience en Afrique nous enseigne que l'on y vend les produits en vrac et que l'on calcule en centimes. Le prix exigé chez nous pour un médicament est plus en rapport avec la valeur marchande du produit qu'avec son prix de revient réel.
M. Roex convient que pour les nouveaux médicaments lancés sur le marché, les firmes s'efforcent de prévoir la plus-value économique des produits. Pour les molécules existantes qui sont remplacées, le prix de l'ancien produit est indicatif comme l'a déjà souligné M. Vermeylen. Il est rare que le prix d'un nouveau produit soit moins élevé que celui de l'ancien.
Un membre conclut que tout cela ne fait que confirmer ses suppositions, à savoir que le dossier de base introduit auprès du ministère des Affaires économiques repose davantage sur une plus-value potentielle que sur une structure de coûts réelle du produit pharmaceutique.
M. Vermeylen souligne enfin que dans cet échange d'idées, un secteur n'a pas été abordé, à savoir celui des compagnies d'assurance. Il a récemment reçu de sa caisse d'assurance maladie un dépliant dans lequel on lui proposait d'intervenir, par le biais de l'assurance complémentaire, dans ses frais d'homéopathie. Indépendamment de la question de savoir qui va définir ce qu'est l'homéopathie et dans quels cas elle doit être utilisée, il juge inqualifiable le fait qu'une caisse d'assurance maladie, qui a pour mission de défendre le bien-être (financier) des patients, s'immisce dans ce genre d'affaires. D'après ce qu'il a pu entendre, sa caisse d'assurance maladie ne serait pas la seule à suivre cette voie.
La présidente répond que la commission sera probablement confrontée sous peu à cette problématique. Elle remercie les intervenants pour leur franchise.
Depuis cinq ans environ, l'accessibilité à l'assurance-soins de santé est un thème qui retient souvent l'attention.
D'une façon générale, l'accessibilité à l'assurance-soins de santé est influencée par deux facteurs :
· les conditions stipulées dans le cadre de l'assurabilité, qui sont d'un grand intérêt, notamment pour les personnes sans activité professionnelle;
· le taux de la prise en charge des honoraires et des tarifs des prestations prévues par l'assurance.
Il peut être utile d'examiner brièvement les mesures qui ont été prises dans ces domaines dans un passé récent.
1. L'accès à l'assurance soins de santé
L'article 11 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions a habilité le Roi à apporter toutes les modifications nécessaires aux dispositions de la loi du 14 juillet 1994, afin de généraliser et d'assouplir l'accès au régime de l'assurance soins de santé, en particulier pour les groupes socio-économiques défavorisés.
L'arrêté royal du 25 avril 1997 (Moniteur belge du 19 juin 1997) a porté exécution de cet article; ainsi, à partir du 1er janvier 1998, les catégories suivantes d'assurés ont été incluses dans le régime général :
les anciens fonctionnaires coloniaux;
les étudiants de l'enseignement du troisième niveau;
les handicapés;
les personnes inscrites dans le Registre national des personnes physiques.
Les travailleurs indépendants handicapés et les membres des communautés religieuses ont été intégrés dans le régime des travailleurs indépendants.
Auparavant, ces personnes étaient assurées sur la base des régimes dits résiduaires.
Le caractère résiduaire de ces régimes ne permettait aux intéressés de faire appel à ceux-ci que lorsqu'ils ne remplissaient pas les conditions voulues pour prétendre aux prestations de santé en vertu d'un régime d'assurance obligatoire.
Le régime des personnes non protégées réunissait souvent les bénéficiaires du minimex, les personnes sans abri, les personnes divorcées. L'intégration des groupes précités dans le régime général ou dans le régime des travailleurs indépendants donne lieu à une simplification considérable des situations complexes, observées antérieurement et engendrées par le passage d'un régime à l'autre.
Ces groupes sont en principe redevables de cotisations personnelles. Pour un certain nombre de situations, des dispenses ont été prévues. On a également aménagé les dispositions concernant le stage d'attente et les règles en matière de paiement d'un droit d'entrée (cotisations personnelles dues pendant la période se situant entre la perte de la qualité antérieure et l'obtention d'une nouvelle qualité d'assuré).
Ces modifications sont résumées dans le schéma ci-après.
| Avant le 1er
janvier 1998 Voor 1 januari 1998 |
Après le 1er
janvier 1998 Na 1 januari 1998 |
|||||
| Stage d'attente Wachttijd |
Cotisation personnelle (mensuelle) Persoonlijke bijdrage (per maand) |
Droit d'entrée Intrederecht |
Stage d'attente Wachttijd |
Cotisation personnelle (trimestrielle) Persoonlijke bijdrage (per trimester) |
Droit d'entrée Intrederecht |
|
| Régime général. Algemene regeling | ||||||
| Handicapés. Mindervaliden | Non. Neen | 560 fr. | Oui, si (**). Ja, indien (**) |
Non. Neen | 0 fr. | Pas après le 1.1.1998. Geen na 1.1.1998 |
| Étudiants. Studenten | Oui, 6 mois (*). Ja, 6 maand (*) | 413 fr. | Oui, si (**). Ja, indien (**) | Non. Neen | 1 702 fr. | Pas après le 1.1.1998. Geen na 1.1.1998 |
| (x) | 579 fr. (TT + PAC). |
(xx) | ||||
| OSSOM. DOSZ | Non. Neen | 381 fr. | Oui, si. Ja, indien | Non. Neen | 1 158 fr. | Pas après le 1.1.1998. Geen na 1.1.1998 |
| Personnes inscrites dans le registre national. Personen ingeschreven in ht Rijksregister | Oui, 6 mois. Ja, 6 maand | 3 303 fr. | Oui, si. Ja, indien | Non. Neen | 20 077 fr. | Pas après le 1.1.1998. Geen na 1.1.1998 |
| (x) | (xx) | |||||
| 2 064 fr. | 10 038 fr. | |||||
| (< plafond VIPO). (< wigw plafond) | (<1 000 000) | |||||
| 620 fr. (< 25 ans). 620 fr. (< 25 jaar) | 1 702 fr. (< plafond VIPO). 1 702 fr. (< wigwplafond) | |||||
| Régime des travailleurs indépendants. Regeling zelfstandigen | ||||||
| Communautés religieuses. Klooster gemeenschappen | Oui, 6 mois. Ja, 6 maand | 846 fr. | Oui, si. Ja, indien | Non. Neen | 2 571 fr. | Pas après le 1.1.1998. Geen na 1.1.1998 |
| (*) | (**) | (< 65 a.). (< 65 j.) | ||||
| 242 fr. | 735 | |||||
| (+ 60/65 a). (+ 60/65 j) | (> 65 a). (> 65 j) | |||||
| Handicapés. Mindervaliden | Non. Neen | 373 fr. | Oui, si. Ja, indien | Non. Neen | 0 fr. | Pas après le 1.1.1998. Geen na 1.1.1998 |
| (**) | ||||||
(*) C'est-à-dire, si au cours des six mois précédant l'inscription, il n'y avait plus de droit aux remboursements.
(**) Droit d'entrée : avant le 1er janvier 1998, la cotisation pour le premier mois de l'inscription dans le régime résiduaire était augmentée d'une cotisation pour chaque mois écoulé depuis la perte de la qualité précédente de titulaire ou de personnes à charge.
Le même arrêté a modifié également les dispositions en matière de droit dit annuel.
Désormais, l'assurabilité est maintenue jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle le droit s'est ouvert (auparavant c'était jusqu'au 30 juin). Par ailleurs, les titulaires peuvent continuer à bénéficier des prestations pendant une période de droit annuel, du 1er janvier au 31 décembre de la même année, s'ils sont en règle en ce qui concerne les cotisations pour la deuxième année civile qui précède le début de cette période, dénommée année de référence.
Les règles précitées ont été précisées davantage dans deux arrêtés royaux du 29 décembre 1997 (Moniteur belge du 31 décembre 1997, 2e éd.).
2. Le taux de la prise en charge des prestations de santé
Il va de soi que l'accessibilité financière à l'assurance soins de santé est influencée par les frais que les assurés doivent supporter. Dans certains cas, une partie du coût des soins de santé reste à charge des bénéficiaires.
D'une façon générale, nous pouvons affirmer que les tickets modérateurs au sens strict représentent en 1996 un montant de 48 milliards de francs, comme mentionné dans le tableau 1 ci-annexé.
Il peut en être déduit que la quote-part personnelle dans les prestations prévues par l'assurance représente les pourcentages suivants des honoraires ou des tarifs :
Honoraires des médecins : 10,6 %
Prestations pharmaceutiques : 18,9 %
Prix de la journée d'entretien : 5,2 %
Autres prestations : 6,4 %
Ces quotes-parts personnelles repésentent globalement environ 10 % du montant des honoraires et des tarifs, mais le pourcentage est plus élevé dans le secteur des patients ambulatoires (15 %) que dans le secteur des patients hospitalisés (4 %).
L'assurance prévoit toutefois, une modulation et des corrections de ces quotes-parts personnelles en fonction des facteurs suivants :
le statut social de l'assuré et ses revenus, le statut dit VIPO;
le montant des quotes-parts personnelles que le bénéficiaire à déjà supportées, dans le cadre de la franchise sociale et fiscale;
a. Modulation de la quote-part personnelle dans le cadre dudit statut VIPO
la gravité de la pathologie et sa durée, dans le cadre des mesures prises en faveur des maladies chroniques.
Dans les conclusions du rapport établi en 1961 par le groupe de travail parlementaire, chargé de l'étude des problèmes en matière d'assurance maladie-invalidité, il est écrit que parmi les personnes auxquelles s'adresse le régime d'assurance-soins de santé, les pensionnés, les invalides et les veuves constituent des groupes sociaux pour lesquels des dispositions particulières devraient permettre un accès pratiquement gratuit aux prestations dont ils ont besoin.
Ce principe de l'intervention majorée pour les VIPO a été inséré en 1963 dans la loi AMI et est encore appliqué à ce jour. Le droit à l'intervention majorée est octroyé à la condition que les revenus bruts imposables de ménage des VIPO ne dépassent pas un montant déterminé (465 211 francs par an majorés d'un montant de 86 123 francs par personne à charge).
Pour une bonne compréhension du sujet, il est indiqué de s'attarder un moment sur les données suivantes, mentionnées dans les tableaux 2, 3, 4 et 5.
On peut en déduire que le nombre global de VIPO s'élevait en 1982 à 23,5 % du nombre total de bénéficiaires et qu'il s'élève actuellement à 25,7 %. La quote-part des VIPO bénéficiant du tarif préférentiel a diminué au cours de la même période et est passée de 14,5 % à 10,6 %.
En ce qui concerne les dépenses, la quote-part des VIPO au cours de la période précitée de 15 ans, a évolué de 50,2 % à 61 %. La part des VIPO bénéficiant du tarif préférentiel dans les dépenses totales a diminué et est passée de 37,4 % à 32,6 %.
Le coût moyen pour les différentes catégories a évolué de la manière suivante, de 1990 a 1997 (en francs)
| TIP | VIPO sans tarif préférentiel |
VIPO avec tarif préférentiel |
|
| 1990 | 18 150 | 57 109 | 86 428 |
| 1997 | 23 628 | 84 891 | 139 018 |
| en % | + 30,2 | + 48,6 | + 60,8 |
À l'aide du tableau 5, on peut comparer les dépenses pour les VIPO, relatives à certaines prestations, à celles d'un TIP. Cette comparaison fait apparaître qu'en ce qui concerne les soins à domicile, les dépenses engagées pour les invalides sont 16 fois et celles pour les pensionnés 25 fois supérieures à celles engagées pour les assurés ordinaires.
Par arrêté royal du 16 avril 1997 (Moniteur belge du 30 avril 1997 - 3e éd.), le statut VIPO a été étendu aux 5 catégories suivantes :
les titulaires auxquels est accordé le droit minimum de moyens d'existence et les personnes qui sont inscrites à leur charge;
les titulaires auxquels un centre public d'aide sociale accorde un secours partiellement ou totalement pris en charge par l'État fédéral et les personnes inscrites à leur charge;
les titulaires qui bénéficient d'un revenu garanti aux personnes âgées et les personnes à leur charge;
les titulaires auxquels est accordée une allocation de handicapé et les personnes à leur charge;
les titulaires qui sont enfants bénéficiaires d'allocations majorées pour enfants handicapés.
Il s'agit d'environ 170 000 personnes, d'après le tableau 6 ci-joint.
b. Modulation dans le cadre de la franchise sociale et fiscale
L'origine du système de la franchise sociale et fiscale se situe dans la mesure dite de sélectivité, décidée par le gouvernement dans le cadre du budget 1994. La mesure visait une adaptation sélective du remboursement de l'assurance soins de santé, tenant compte, d'une part, de la capacité contributive des assurés et, d'autre part, de la nécessité de sauvegarder l'accès aux prestations de base du régime.
La base légale était constituée par la loi du 6 août 1993.
Le Conseil général du service des soins de santé de l'INAMI a émis un avis circonstancié au sujet de l'instauration de la mesure de sélectivité, qui contenait les éléments suivants.
Le Conseil général estimait que la mesure de sélectivité devait être un facteur d'amélioration de la politique de la santé qui fait régner une solidarité entre tous les bénéficiaires de l'assurance.
Selon le Conseil, cela impliquait :
que cette mesure devait se rapporter aux prestations largement répandues parmi la population;
qu'elle ne pouvait pas constituer un frein à l'accès à certaines prestations, entre autres en cas de maladies chroniques et de maladies sociales;
qu'elle devait au contraire favoriser une meilleure couverture des soins de santé en cas de maladies chroniques et sociales pour toutes les catégories de bénéficiaires, en tenant compte de leurs revenus;
que l'on encourage le recours optimal à l'offre existante, tant en ce qui concerne les prestations que l'infrastructure, et que l'on décourage la multiplication des actes thérapeutiques superflus.
En outre, le Conseil général stipulait que la mesure de sélectivité devait aller de pair avec d'autres mesures visant à garantir une sécurité tarifaire aux bénéficiaires de l'assurance.
Enfin, le Conseil général estimait que la mesure de sélectivité devait être adaptée pour tenir compte au maximum de la capacité contributive des assurés et de la composition du ménage. Les formules les plus différenciées sont certes beaucoup plus difficiles à appliquer administrativement.
Pour pouvoir suivre autant que possible le problème des conséquences sociales pour certaines catégories de patients, le Conseil général avait suggéré d'appliquer diverses modalités, qui peuvent être résumées de la façon suivante :
exclusion de certaines catégories de bénéficiaires du champ d'application de la mesure (par exemple : les VIPO bénéficiant du remboursement préférentiel, les chômeurs qui perçoivent une allocation, les personnes qui bénéficient du droit au minimum de moyens d'existence et les personnes qui bénéficient d'un revenu garanti aux personnes âgées);
exclusion de certaines catégories de bénéficiaires, en tenant compte de leurs revenus;
modulation de la majoration du ticket modérateur, suivant les revenus;
exclusion de certains types de maladies, comme les maladies chroniques et les maladies sociales, du champ d'application de la mesure;
instauration d'un montant plafonné du ticket modérateur, modulable éventuellement selon les catégories de revenus, montant au-dessus duquel le ticket modérateur actuel pouvait être soit diminué, soit même supprimé.
La majoration des quotes-parts personnelles, à raison de 7,5 milliards de francs, a été compensée par deux mesures :
la franchise sociale et fiscale
Par arrêté royal du 3 novembre 1993 (adapté ultérieurement par les arrêtés des 24 janvier 1994, 15 mai 1995, 17 janvier 1997 et 17 avril 1997), une immunisation de la participation personnelle pour une année déterminée a été prévue pour certaines catégories socio-économiques d'assurés dignes d'intérêt, dès le moment où l'ensemble des interventions personnelles effectivement prises en charge par le bénéficiaire et les éventuelles personnes à sa charge, atteint 15 000 francs (l'assurance prend alors à sa charge pendant le reste de l'année, le coût total des frais tarifés relatifs aux soins de santé).
(Cette mesure est habituellement dénommée, la « franchise sociale ».)
Les catégories suivantes font partie du champ d'application de la franchise sociale :
les bénéficiaires de l'assurance qui ont droit au revenu garanti aux personnes âgées, au minimum de moyens d'existence ou à un secours similaire accordé par le CPAS, ainsi que les personnes qui sont à leur charge;
les personnes qui ont droit à l'intervention majorée de l'assurance, ainsi que les personnes qui sont à leur charge;
les bénéficiaires handicapés auxquels est accordée une des allocations de handicapés, en application de la loi du 27 février 1987, ainsi que les personnes qui sont à leur charge;
les titulaires qui ont depuis six mois au moins la qualité de chômeur (et qui ont droit à une allocation de chômage en qualité de travailleur en chômage, ayant charge de famille, ou en qualité d'isolé) ainsi que les personnes qui sont à leur charge;
les bénéficiaires d'une allocation familiale majorée et les personnes qui sont à leur charge.
Les frais de médicaments, les frais d'hospitalisation, à partir du 91e jour d'hospitalisation dans un hôpital général et à partir du 366e jour dans un hôpital psychiatrique ainsi que les frais d'hébergement dans une maison de repos pour personnes âgées et dans une maison de repos et de soins n'entrent toutefois pas en ligne de compte pour l'application de la franchise sociale.
De même, les suppléments et les frais à charge des assurés qui ne constituent pas une « intervention personnelle », au sens de la législation en matière de soins de santé, ne sont pas pris en considération.
En application de l'article 43 de la loi-programme du 24 décembre 1993, pour tous les assurés, un plafond des interventions personnelles est fixé par an et par ménage, variant en fonction du revenu imposable net total du ménage (revenu brut après déduction des cotisations de sécurité sociale) :
pour un revenu de ménage jusqu'à 537 999 francs, un plafond de 15 000 francs;
pour un revenu de ménage de 538 000 francs à 829 999 francs, un montant maximum de 20 000 francs;
pour un revenu de ménage de 829 000 francs à 1 119 999 francs, un plafond de 30 000 francs;
pour un revenu de ménage de 1 120 000 francs à 1 410 000 francs, un plafond de 40 000 francs;
pour un revenu de ménage de 1 411 000 francs, un montant maximum de 50 000 francs.
Si l'on constate pour ces assurés que le ménage a payé, pour une année déterminée, un montant total, à titre de quotes-parts personnelles ou de tickets modérateurs, supérieur au plafond fixé pour la catégorie de revenus dont il relève, le montant payé en trop leur est remboursé.
Ce remboursement n'est toutefois pas effectué par la mutualité mais par l'administration des contributions, soit en déduisant la somme à rembourser de l'impôt à suppléer pour les revenus de l'exercice en question, soit en la remboursant à l'assuré contribuable si celui-ci n'a pas de supplément d'impôt à payer.
Cette forme d'immunisation de la quote-part personnelle est dénommée « franchise fiscale ».
Les frais de soins de santé qui sont exclus de la franchise sociale le sont également de la franchise fiscale, à cette différence près que les frais relatifs aux hospitalisations ne sont absolument pas pris en compte.
Après quelques années, il sera possible de faire une première évaluation de ces mesures de correction.
En ce qui concerne la franchise sociale, les organismes assureurs ont comptabilisé les dépenses suivantes, qui se rapportent à 70 000 personnes environ :
Dépenses (en millions de francs)
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 (3T) | |
| Régime général. Algemene regeling | ||||
| TIP. PUG | 25,9 | 209,2 | 239,3 | 453,7 |
| PNP. NBP | 15,6 | 44,5 | 51,0 | 50,0 |
| VIPO 75 %. WIGW 75 % | 33,9 | 124,1 | 111,9 | 94,7 |
| VIPO 100 %. WIGW 100 % | 334,8 | 880,3 | 717,8 | 547,6 |
| Total. Totaal | 410,2 | 1 258,1 | 1 120,0 | 1 146,0 |
| Régime des travailleurs Indépendants. Zelfstandigen | ||||
| TIP. PUG | 2,2 | 8,1 | 7,1 | 3,9 |
| VIPO 75 %. WIGW 75 % | 5,0 | 16,9 | 14,1 | 12,4 |
| VIPO 100 %. WIGW 100 % | 39,2 | 85,5 | 71,9 | 56,3 |
| Total. Totaal | 46,3 | 110,5 | 93,1 | 74,3 |
| Total général. Algemene totaal | 456,6 | 1 368,6 | 1 213,1 | 1 220,4 |
En ce qui concerne la franchise fiscale, les données suivantes peuvent être communiquées concernant les années d'imposition 1995 et 1996. Cette mesure s'applique à 3,6 % des ménages fiscaux.
| Revenu imposable Belastbaar inkomen |
Année d'imposition 1995 (situation 31.12.97) Aanslagjaar 1995 (situatie 31.12.97) |
Année d'imposition 1996 (situation 30.06.97) Aanslagjaar 1996 (situatie 30.06.97) |
Année d'imposition 1997 (situation 30.06.98) Aanslagjaar 1997 (situatie 30.06.98) |
|||
| Nombre Aantal |
Montant décompté (en millions de francs) Verrekend bedrag (in miljoenen franken) |
Nombre Aantal |
Montant décompté (en millions de francs) Verrekend bedrag (in mijoenen franken) |
Nombre Aantal |
Montant décompté (en millions de francs) Verrekend bedrag (in miljoenen franken) |
|
| 0 - 537 999 | 80 053 | 1 037,7 | 67 411 | 894,1 | 39 236 | 309,7 |
| 538 000 - 828 999 | 56 046 | 757,2 | 66 667 | 951,7 | 42 967 | 411,9 |
| 829 000 - 1 119 999 | 11 473 | 177,8 | 14 969 | 249,0 | 7 722 | 86,9 |
| 1 120 000 - 1 410 999 | 2 415 | 45,3 | 3 505 | 70,1 | 1 422 | 19,6 |
| ==> 1 411 000 | 1 410 | 30,4 | 2 523 | 62,0 | 847 | 13,0 |
| 151 397 | 2 048,3 | 155 075 | 2 226,9 | 92 194 | 841,1 | |
c. Modulation pour les malades chroniques
Il a déjà été question ci-dessus du groupe de travail parlementaire qui, à l'époque, a contribué à l'élaboration de la loi du 9 août 1963. Dans son rapport de l'époque, ce groupe de travail a accordé beaucoup d'attention aux maladies dites sociales. Quelques extraits du rapport de ce groupe de travail méritent toujours d'être cités.
« Certaines affections, à savoir la tuberculose, le cancer, les maladies mentales et la poliomyélite présentent sur le plan social, une similitude en ce sens qu'elles sont généralement de longue durée et qu'elles nécessitent des soins coûteux susceptibles de ruiner les familles.
Les pouvoirs publics ne peuvent, par ailleurs, se désintéresser des mesures générales de prophylaxie, de prévention et d'harmonisation de l'armenent thérapeutique qu'il convient de mettre à la disposition des malades qui en sont atteints.
Sur le plan médical, une même similitude les réunit du fait de leur gravité et de la haute spécialisation des soins qu'elles nécessitent.
Ces mêmes considérations, tant sur le plan médical que social, seraient, selon certains, également valables pour le diabète, affection très répandue parmi la population et dont les complications graves et les conséquences sur la capacité de travail ne peuvent être évitées ou réduites que par une surveillance constante et un traitement continu.
Certains membres estiment que la liste des maladies sociales pourrait être précisée ou complétée en raison notamment des progrès constants de la médecine.
Le coût élevé du traitement de toutes ces maladies sociales rend indispensable la couverture complète des frais engagés par les malades qui en sont atteints.
Dans cette conception, le groupe de travail estime que ces frais devraient être pris en charge par l'État. »
Dans la loi du 9 août 1963, la notion de maladies sociales n'est utilisée qu'en vue du financement et de la détermination du montant des subventions de l'État.
À partir de 1991, la notion de diminution du ticket modérateur selon la pathologie est toutefois insérée dans la législation AMI, plus particulièrement dans le cadre de la kinésithérapie.
Les assurés souffrant d'une affection déterminée figurant sur une liste limitative spéciale, fixée par un arrêté royal, bénéficient d'une diminution du ticket modérateur. Par ailleurs, ils peuvent bénéficier plus largement des prestations de kinésithérapie que les autres assurés (la règle des 60 prestations n'est pas d'application). En 1996, les dépenses pour la kinésithérapie s'élevaient à 13,5 milliards de francs. 30 % de celles-ci se rapportaient au traitement des pathologies lourdes.
Par la suite, l'article 11 de la loi du 20 décembre 1995 (Moniteur belge du 23 décembre 1995) a créé la base légale pour une adaption de la quote-part personnelle à la charge des bénéficiaires atteints d'une affection chronique. Cet article complète en l'occurrence les mesures de sélectivité antérieures. La disposition susmentionnée a été adaptée par les articles 103 à 105 de la loi du 22 février 1998 (Moniteur belge du 3 mars 1998).
À cet effet, on distingue les deux éléments suivants :
En premier lieu, la loi précitée introduit une nouvelle catégorie de prestations pour lesquelles une intervention de l'assurance soins de santé peut être accordée. Il s'agit en l'occurrence des matériels et des produits de soins nécessaires aux soins dispensés au domicile des bénéficiaires qui souffrent d'une affection grave.
Après avoir demandé l'avis du Comité de l'assurance, on fixera par un arrêté royal le libellé desdites prestations, la détermination de l'intervention de l'assurance sous la forme d'un forfait ou d'un montant maximum pour une période déterminée, ainsi que les conditions de remboursement.
Lors de la discussion au Parlement, il a été fait référence en la matière au matériel d'incontinence, à l'alimentation diététique spécifique et aux sondes.
Ensuite, la possibilité est créée soit de diminuer ou de supprimer la quote-part personnelle pour certaines prestations, soit d'octroyer une allocation forfaitaire aux bénéficiaires souffrant d'une maladie chronique.
Les bénéficiaires en question doivent répondre à un ou plusieurs des critères suivants :
souffrir d'une maladie qui figure sur une liste déterminée;
atteindre un taux déterminé de nécessité de soins;
avoir payé pendant une période déterminée des quotes-parts personnelles qui dépassent un montant plafond.
Sur cette base, les mesures suivantes ont été prises :
L'arrêté royal du 2 juin 1998 portant exécution de l'article 37, § 16bis , de la loi AMI coordonnée (Moniteur belge du 9 juillet 1998) par lequel une allocation forfaitaire de 10 000 francs est octroyée en 1998 pour certains groupes de malades chroniques.
Cette mesure s'applique à environ 50 000 personnes qui ont payé, pendant deux années consécutives, 10 000 francs à titre de tickets modérateurs et qui remplissent les critères de dépendance de soins. Les dépenses sont estimées à environ 500 millions de francs.
L'arrêté royal du 2 juin 1998 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé dans le coût du matériel d'incontinence, prévue à l'article 34, 14º, de la loi AMI (Moniteur belge du 9 juin 1998).
Cette mesure s'applique, à environ 22 000 personnes. La dépense s'élève à 220 millions de francs.
Dans ce même contexte, une série d'initiatives spéciales ont été prises pour certains groupes cibles très spécifiques.
En premier liieu, il peut être fait référence au groupe-cible des patients souffrant d'une maladie métabolique héréditaire rare, c'est-à-dire environ 1 000 concitoyens.
À ce sujet, le Comité de l'assurance a approuvé le 13 juillet dernier, une convention de rééducation type et, depuis lors, cinq conventions ont déjà été conclues, ce qui permettra d'assurer une prise en charge spécialisée favorisant un bon encadrement. L'arrêté royal relatif au remboursement de l'alimentation spéciale des patients en question a aussi déjà reçu entretemps un avis positif.
Des mesures spécifiques ont également été concrétisées pour les patients souffrant de mucoviscidose (1 000 à 1 500 patients) et d'affections neuromusculaires (5 000 à 10 000 patients, dont environ 2 000 dépendent d'une politique de moyens d'aide adaptés et d'une thérapie symptomatique complexe). C'est notamment pour ce dernier groupe cible que se marque l'importance de l'arrêté royal du 31 août 1998 modifiant la nomenclature des prestations de santé (Moniteur belge du 9 septembre 1998), étant donné qu'ainsi une extension importante de la nomenclature des voiturettes a été réalisée, en tenant compte des besoins objectifs de certains malades chroniques et handicapés.
Par ailleurs, l'INAMI a été invité par l'autorité de tutelle à créer un groupe de travail spécifique en matière de « rhumatisme invalidant, y compris les maladies des tissus conjonctifs ». Actuellement, ce groupe de travail prépare un rapport.
Enfin, l'attention est attirée sur l'arrêté royal du 11 octobre 1998 (Moniteur belge du 4 novembre 1998) par lequel a été créé, au sein de l'INAMI, un comité consultatif en matière de dispensation de soins pour des maladies chroniques et pour des pathologies spécifiques.
Ce comité a pour mission :
a) de formuler des recommandations en matière d'organisation de la dispensation des soins et d'intervention de l'assurance soins de santé au profit des malades chroniques;
b) d'évaluer les mesures prises en exécution des articles 35, § 1er , dernier alinéa et 37, § 16bis , de la loi coordonnée, entre autres par l'organisation d'enquêtes et l'analyse de données fournies par les organismes assureurs;
c) d'évaluer les mesures prises en exécution de l'article 37, § 18, de la loi coordonnée;
d) d'organiser des contacts avec les représentants des associations de patients atteints de maladies chroniques et de pathologies spécifiques;
e) d'émettre des avis à la demande des autorités, conseils et comités visés à l'article 19, dernier alinéa, de la loi coordonnée.
Tout ceci ne doit pas faire perdre de vue que ces initiatives récentes s'ajoutent à des initiatives déjà existantes, dont il faut souligner l'importance.
Je songe plus particulièrement au secteur de la rééducation fonctionnelle et de la réadaptation professionnelle. D'après les données de l'INAMI, 100 000 personnes environ ont suivi, en 1996, un programme de rééducation. En arrondissant quelque peu, cela représente 2 % des dépenses en soins de santé.
Le tableau de l'annexe 7 indique dans quels domaines il y a intervention.
En outre, il y a le Collège des médecins-directeurs, dont la compétence se situe à trois niveaux : l'octroi d'interventions dans le cadre de la nomenclature (environ 13 000 dossiers en 1997), le traitement de demandes individuelles dans le cadre de la rééducation (environ 20 000 dossiers en 1997) et la prise de décisions concernant le fonds spécial de solidarité (environ 3 500 dossiers en 1997). Ce fonds a été créé en 1989 et il vise à prévoir des interventions de l'assurance pour des prestations médicales exceptionnelles qui répondent aux critères de l'article 25 de la loi coordonnée.
À ce niveau, des mesures ont été prises pour simplifier considérablement les procédures administratives.
Tableau 1
Évolution des dépenses pour prestations
Ambulant Hospitalisé
Régime général + indépendants
En millions de francs belges
Données sans SNCB
| 1995 Dépenses AMI 1995 Uitgaven ZIV |
1995 Ticket modérateur 1995 Remgeld |
1995 Honoraires 1995 Honoraria |
1996 Dépenses AMI 1996 Uitgaven ZIV |
1996 Ticket modérateur 1996 Remgeld |
1996 Honoraires 1996 Honoraria |
|
| Honoraires médicaux. Geneeskundige honoraria : | ||||||
| Ambulant. Ambulant | 79 542,5 | 14 644,8 | 94 187,3 | 85 809,5 | 15 886,4 | 101 695,9 |
| Hospitalisé. Gehospitaliseerd | 56 148,0 | 1 429,1 | 57 577,1 | 62 907,2 | 1 829,6 | 64 736,8 |
| Total. Totaal | 135 690,5 | 16 073,9 | 151 764,4 | 148 716,7 | 17 716,0 | 166 432,7 |
| Prestations pharmaceutiques. Farmaceutische verstrekkingen | ||||||
| Ambulant. Ambulant | 51 576,2 | 16 224,2 | 67 800,4 | 57 998,1 | 17 508,8 | 75 506,9 |
| Hospitalisé. Gehospitaliseerd | 15 492,2 | 1,9 | 15 494,1 | 17 269,1 | 0,3 | 17 269,4 |
| Total. Totaal | 67 068,4 | 16 226,1 | 83 294,5 | 75 267,2 | 17 509,1 | 92 776,3 |
| Prix de la journée d'entretien. Verpleegdagprijs : | ||||||
| Ambulant. Ambulant | | | | | | |
| Hospitalisé. Gehospitaliseerd | 98 682,6 | 5 973,1 | 104 655,7 | 109 912,9 | 5 968,7 | 115 881,6 |
| Total. Totaal | 98 682,6 | 5 973,1 | 104 655,7 | 109 912,9 | 5 968,7 | 115 881,6 |
| Forfait pour journée d'entretien. Forfait per verpleegdag : | ||||||
| Ambulant. Ambulant | 6 100,9 | | 6 100,9 | 6 438,0 | | 6 438,0 |
| Hospitalisé. Gehospitaliseerd | | | | | | |
| Total. Totaal | 6 100,9 | | 6 100,9 | 6 438,0 | | 6 438,0 |
| Maisons de repos et de soins. Rust- en verzorgingstehuizen : | ||||||
| Ambulant. Ambulant | 10 569,4 | | 10 569,4 | 11 381,2 | | 11 381,2 |
| Hospitalisé. Gehospitaliseerd | | | | | | |
| Total. Totaal | 10 569,4 | | 10 569,4 | 11 381,2 | | 11 381,2 |
| Maisons de soins psychiatriques. Psychiatrische verzorgingstehuizen : | ||||||
| Ambulant. Ambulant | 1 904,8 | | 1 904,8 | 1 888,1 | | 1 888,1 |
| Hospitalisé. Gehospitaliseerd | | | | | | |
| Total. Totaal | 1 904,8 | | 1 904,8 | 1 888,1 | | 1 888,1 |
| Initiatives d'habitation protégée. Initiatieven beschut wonen : | ||||||
| Ambulant. Ambulant | 503,1 | | 503,1 | 455,2 | | 455,2 |
| Hospitalisé. Gehospitaliseerd | | | | | | |
| Total. Totaal | 503,1 | | 503,1 | 455,2 | | 455,2 |
| Maisons de repos pour personnes âgées : forfait. Rustoorden voor bejaarden : forfait : | ||||||
| Ambulant. Ambulant | 12 304,9 | | 12 304,9 | 13 750,2 | | 13 750,2 |
| Hospitalisé. Gehospitaliseerd | | | | | | |
| Total. Totaal | 12 304,9 | | 12 304,9 | 13 750,2 | | 13 750,2 |
| Autres prestations. Andere verstrekkingen : | ||||||
| Ambulant. Ambulant | 49 618,0 | 6 177,9 | 55 795,9 | 54 189,9 | 6 385,3 | 60 575,2 |
| Hospitalisé. Gehospitaliseerd | 10 662,8 | 360,9 | 11 023,7 | 11 344,1 | 440,2 | 11 784,3 |
| Total. Totaal | 60 280,8 | 6 538,8 | 66 819,6 | 65 534,0 | 6 825,5 | 72 359,5 |
| Total prestations. Totaal verstrekkingen : | ||||||
| Ambulant. Ambulant | 212 119,8 | 37 046,9 | 249 166,7 | 231 910,2 | 39 780,5 | 271 690,7 |
| Hospitalisé. Gehospitaliseerd | 180 985,6 | 7 765,0 | 188 750,6 | 201 433,3 | 8 238,8 | 209 672,1 |
| Total. Totaal | 393 105,4 | 44 811,9 | 437 917,3 | 433 343,5 | 48 019,3 | 481 362,8 |
| Dépenses non ventilables. Niet-uitsplitsbare uitgaven | - 756,7 | | - 756,7 | - 855,9 | | - 855,9 |
| Total général. Algemeen totaal | 392 348,7 | 44 811,9 | 437 160,6 | 432 487,6 | 48 019,3 | 480 506,9 |
Tableau 2
Assurance obligatoire
soins de santé
Nombre de bénéficiaires Évolution par état social
| Régime général Algemene regeling |
Régime travailleurs indépendants Regime voor de zelfstandigen |
RG + RTI AR + R Zelfst. |
|||||||
| TIP + PNP PUG + NBP |
VIPO 75 % WIGW 75 % |
VIPO 100 % WIGW 100 % |
VIPO WIGW |
Total Totaal |
TIP + CR PUG + KG |
VIPO WIGW |
Total Totaal |
||
| 1982 | 6 489 039 | 762 046 | 1 227 206 | 1 989 252 | 8 476 291 | 1 125 379 | 244 400 | 1 369 779 | 9 848 070 |
| 1983 | 6 454 365 | 830 043 | 1 160 065 | 1 990 108 | 8 444 473 | 1 078 236 | 252 516 | 1 330 752 | 9 775 225 |
| 1984 | 6 402 796 | 884 193 | 1 117 464 | 2 001 657 | 8 404 453 | 1 046 616 | 248 660 | 1 295 276 | 9 699 729 |
| 1985 | 6 385 710 | 933 283 | 1 093 395 | 2 026 678 | 8 412 388 | 1 021 966 | 246 042 | 1 268 008 | 9 680 396 |
| 1986 | 6 383 819 | 974 455 | 1 077 403 | 2 051 858 | 8 435 677 | 1 004 513 | 243 220 | 1 247 733 | 9 683 410 |
| 1987 | 6 371 702 | 1 010 200 | 1 065 738 | 2 075 938 | 8 447 640 | 993 736 | 241 851 | 1 235 587 | 9 683 227 |
| 1988 | 6 358 487 | 1 036 979 | 1 059 130 | 2 096 109 | 8 454 596 | 977 166 | 239 611 | 1 216 777 | 9 671 373 |
| 1989 | 6 376 977 | 1 052 540 | 1 046 566 | 2 099 108 | 8 476 085 | 954 278 | 236 517 | 1 190 795 | 9 666 880 |
| 1990 | 6 424 485 | 1 066 923 | 1 022 466 | 2 089 389 | 8 513 874 | 938 138 | 237 573 | 1 175 711 | 9 689 585 |
| 1991 (1) | 6 440 497 | 1 104 544 | 1 014 213 | 2 118 757 | 8 559 254 | 928 129 | 236 429 | 1 164 558 | 9 723 812 |
| 1992 (1) | 6 476 474 | 1 142 416 | 1 009 921 | 2 152 337 | 8 628 811 | 915 763 | 236 519 | 1 152 282 | 9 781 093 |
| 1993 (1) | 6 483 758 | 1 181 049 | 986 874 | 2 167 923 | 8 651 681 | 895 553 | 236 759 | 1 132 312 | 9 783 993 |
| 1994 (1) | 6 469 640 | 1 219 278 | 963 565 | 2 182 843 | 8 652 303 | 882 219 | 237 214 | 1 119 433 | 9 783 993 |
| 1995 (1) | 6 473 097 | 1 258 270 | 947 906 | 2 206 176 | 8 679 273 | 678 926 | 238 282 | 1 117 208 | 9 796 481 |
| 1996 (1) | 6 480 881 | 1 289 828 | 935 850 | 2 225 678 | 8 706 559 | 865 279 | 237 076 | 1 102 355 | 9 808 914 |
| 1997 (1) | 6 502 612 | 1 319 168 | 924 171 | 2 243 339 | 8 745 951 | 853 283 | 234 966 | 1 088 249 | 9 834 200 |
(1) SNCB non comprise.
Assurance obligatoire
soins de santé
Nombre de bénéficiaires Évolution par état social
| Régime général Algemene regeling |
Régime travailleurs indépendants Regeling voor de zelfstandigen |
RG + RTI AR + R Zelfst. |
|||||||
| TIP + PNP PUG + NPB |
VIPO 75 % WIGW 75 % |
VIPO 100 % WIGW 100 % |
VIPO WIGW |
Total Totaal |
TIP + CR PUG + KG |
VIPO WIGW |
Total Totaal |
||
| 1982 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1983 | 99,5 | 108,9 | 94,5 | 100,0 | 99,6 | 95,8 | 103,3 | 97,2 | 99,3 |
| 1984 | 98,7 | 116,0 | 91,1 | 100,6 | 99,1 | 93,0 | 101,7 | 94,6 | 98,5 |
| 1985 | 98,4 | 122,5 | 89,1 | 101,9 | 99,2 | 90,8 | 100,7 | 92,6 | 98,3 |
| 1986 | 98,4 | 127,9 | 87,8 | 103,1 | 99,5 | 89,3 | 99,5 | 91,1 | 98,3 |
| 1987 | 98,2 | 132,6 | 86,8 | 104,4 | 99,6 | 88,3 | 99,0 | 90,2 | 98,3 |
| 1988 | 98,0 | 136,1 | 86,3 | 105,4 | 99,7 | 86,8 | 98,0 | 88,8 | 98,2 |
| 1989 | 98,3 | 138,1 | 85,3 | 105,5 | 100,0 | 84,8 | 96,8 | 86,9 | 98,2 |
| 1990 | 99,0 | 140,0 | 83,3 | 105,0 | 100,4 | 83,4 | 97,2 | 85,8 | 98,4 |
| 1991 (1) | 99,3 | 144,9 | 82,6 | 106,5 | 101,0 | 82,5 | 96,7 | 85,0 | 98,7 |
| 1992 (1) | 99,8 | 149,9 | 82,3 | 108,2 | 101,8 | 81,4 | 96,8 | 84,1 | 99,3 |
| 1993 (1) | 99,9 | 155,0 | 80,4 | 109,0 | 102,0 | 79,6 | 96,9 | 82,7 | 99,3 |
| 1994 (1) | 99,7 | 160,0 | 78,5 | 109,7 | 102,1 | 78,4 | 97,1 | 81,7 | 99,2 |
| 1995 (1) | 99,8 | 165,1 | 77,2 | 110,9 | 102,4 | 78,1 | 97,5 | 81,6 | 99,5 |
| 1996 (1) | 99,9 | 169,3 | 76,3 | 111,9 | 102,7 | 76,9 | 97,0 | 80,5 | 99,6 |
| 1997 (1) | 100,2 | 173,1 | 75,3 | 112,8 | 103,2 | 75,8 | 96,1 | 79,4 | 99,9 |
(1) SNCB non comprise.
Tableau 3
Assurance obligatoire
soins de santé
Dépenses pour prestations
Évolution par état social
| Régime général Algemene regeling |
Régime travailleurs indépendants Regime voor de zelfstandigen |
RG + RTI AR + R Zelfst. |
|||||||
| TIP + PNP PUG + NPB |
VIPO 75 % WIGW 75 % |
VIPO 100 % WIGW 100 % |
VIPO WIGW |
Total Totaal |
TIP + CR PUG + KG |
VIPO WIGW |
Total Totaal |
||
| 1982 | 74 278,9 | 19 170,2 | 55 873,8 | 75 044,0 | 149 322,9 | 5 988,1 | 5 284,6 | 11 272,7 | 160 595,6 |
| 1983 | 79 360,1 | 25 262,5 | 59 522,1 | 84 784,6 | 164 144,7 | 6 552,7 | 6 006,5 | 12 559,2 | 176 703,9 |
| 1984 | 82 910,7 | 31 195,2 | 61 860,6 | 93 055,8 | 175 966,5 | 7 184,9 | 6 570,2 | 13 755,1 | 189 721,6 |
| 1985 | 83 828,8 | 34 152,0 | 61 458,4 | 95 610,4 | 179 439,2 | 7 016,7 | 6 687,8 | 13 704,5 | 193 143,7 |
| 1986 | 93 939,4 | 40 300,9 | 69 433,8 | 109 734,7 | 203 674,1 | 7 980,7 | 7 807,8 | 15 788,5 | 219 462,6 |
| 1987 | 100 995,6 | 47 256,0 | 75 776,4 | 123 032,4 | 224 028,0 | 8 465,8 | 8 348,5 | 16 814,3 | 240 842,3 |
| 1988 | 100 731,9 | 49 243,0 | 76 891,8 | 126 134,8 | 226 866,7 | 8 305,9 | 8 456,1 | 16 762,0 | 243 628,7 |
| 1989 | 108 073,3 | 54 183,4 | 82 172,5 | 136 355,9 | 244 429,2 | 8 848,8 | 9 219,2 | 18 068,0 | 262 497,2 |
| 1990 | 116 605,3 | 60 930,6 | 88 369,5 | 149 300,1 | 265 905,4 | 9 232,9 | 10 101,5 | 19 334,4 | 285 239,8 |
| 1991 (1) | 129 322,1 | 69 778,6 | 98 192,6 | 167 971,2 | 297 293,3 | 10 133,1 | 11 187,4 | 21 320,5 | 318 613,8 |
| 1992 (1) | 140 851,5 | 79 094,2 | 106 709,3 | 185 803,5 | 326 655,0 | 11 098,7 | 12 165,6 | 23 264,3 | 349 919,3 |
| 1993 (1) | 141 337,5 | 85 035,3 | 111 607,7 | 196 643,0 | 337 980,5 | 10 917,2 | 12 867,5 | 23 784,7 | 361 765,2 |
| 1994 (1) | 139 834,4 | 91 056,3 | 116 356,9 | 207 413,2 | 347 247,6 | 10 929,6 | 13 625,3 | 24 554,9 | 371 802,5 |
| 1995 (1) | 145 543,0 | 99 548,2 | 121 669,5 | 221 217,7 | 366 760,7 | 11 351,2 | 14 236,8 | 25 588,0 | 392 348,7 |
| 1996 (1) | 158 766,0 | 113 367,7 | 132 675,0 | 246 042,7 | 404 808,7 | 12 098,8 | 15 580,1 | 27 678,9 | 432 487,6 |
| 1997 (1) | 153 646,5 | 111 985,6 | 128 476,0 | 240 461,6 | 394 108,1 | 11 111,7 | 15 029,7 | 26 141,4 | 420 249,5 |
(1) SNCB non comprise.
Assurance obligatoire
soins de santé
Dépenses pour prestations
Évolution par état social
| Régime général Algemene regeling |
Régime travailleurs indépendants Regime voor de zelfstandigen |
RG + RTI AR + R Zelfst. |
|||||||
| TIP + PNP PUG + NPB |
VIPO 75 % WIGW 75 % |
VIPO 100 % WIGW 100 % |
VIPO WIGW |
Total Totaal |
TIP + CR PUG + KG |
VIPO WIGW |
Total Totaal |
||
| 1982 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1983 | 106,8 | 131,8 | 106,5 | 113,0 | 109,9 | 109,4 | 113,7 | 111,4 | 110,0 |
| 1984 | 111,6 | 162,7 | 110,7 | 124,0 | 117,8 | 120,0 | 124,3 | 122,0 | 118,1 |
| 1985 | 112,9 | 178,2 | 110,0 | 127,4 | 120,2 | 117,2 | 126,6 | 121,6 | 120,3 |
| 1986 | 126,5 | 210,2 | 124,3 | 146,2 | 136,4 | 133,3 | 147,7 | 140,1 | 136,7 |
| 1987 | 136,0 | 246,5 | 135,6 | 163,9 | 150,0 | 141,4 | 158,0 | 149,2 | 150,0 |
| 1988 | 135,6 | 256,9 | 137,6 | 168,1 | 151,9 | 138,7 | 160,0 | 148,7 | 151,7 |
| 1989 | 145,5 | 282,6 | 147,1 | 181,7 | 163,7 | 147,8 | 174,5 | 160,3 | 163,5 |
| 1990 | 157,0 | 317,8 | 158,2 | 199,0 | 178,1 | 154,2 | 191,1 | 171,5 | 177,6 |
| 1991 (1) | 174,1 | 364,0 | 175,7 | 223,8 | 199,1 | 169,2 | 211,7 | 189,1 | 198,4 |
| 1992 (1) | 189,6 | 412,6 | 191,0 | 247,6 | 218,8 | 185,3 | 230,2 | 206,4 | 217,9 |
| 1993 (1) | 190,3 | 443,6 | 199,7 | 262,0 | 226,3 | 182,3 | 243,5 | 211,0 | 225,3 |
| 1994 (1) | 188,3 | 475,0 | 208,2 | 276,4 | 232,5 | 182,5 | 257,8 | 217,8 | 231,5 |
| 1995 (1) | 195,9 | 519,3 | 217,8 | 294,8 | 245,6 | 189,6 | 269,4 | 227,0 | 244,3 |
| 1996 (1) | 213,7 | 591,4 | 237,5 | 327,9 | 271,1 | 202,0 | 294,8 | 245,5 | 269,3 |
| 1997 (1) | 206,9 | 584,2 | 229,9 | 320,4 | 263,9 | 185,6 | 284,4 | 231,9 | 261,7 |
(1) SNCB non comprise.
Tableau 4
Assurance obligatoire
soins de santé
Coût moyen par bénéficiaire
Montants en francs
| Régime général Algemene regeling |
Régime travailleurs indépendants Regime voor de zelfstandigen |
RG + RTI AR + R Zelfst. |
|||||||
| TIP + PNP PUG + NPB |
VIPO 75 % WIGW 75 % |
VIPO 100 % WIGW 100 % |
VIPO WIGW |
Total Totaal |
TIP + CR PUG + KG |
VIPO WIGW |
Total Totaal |
||
| 1982 | 11 447 | 25 156 | 45 529 | 37 725 | 17 612 | 5 321 | 21 623 | 8 230 | 16 307 |
| 1983 | 12 296 | 30 435 | 51 309 | 42 603 | 19 438 | 6 077 | 23 787 | 9 438 | 18 077 |
| 1984 | 12 949 | 35 281 | 55 358 | 46 489 | 20 937 | 6 865 | 26 422 | 10 619 | 19 559 |
| 1985 | 13 128 | 36 593 | 56 209 | 47 176 | 21 330 | 6 866 | 27 182 | 10 808 | 19 952 |
| 1986 | 14 715 | 41 357 | 64 446 | 53 481 | 24 144 | 7 945 | 32 102 | 12 654 | 22 664 |
| 1987 | 15 851 | 46 779 | 71 102 | 59 266 | 26 520 | 8 519 | 34 519 | 13 608 | 24 872 |
| 1988 | 15 842 | 47 487 | 72 599 | 60 176 | 26 834 | 8 500 | 35 291 | 13 776 | 25 191 |
| 1989 | 16 947 | 51 479 | 78 516 | 64 959 | 28 838 | 9 273 | 38 979 | 15 173 | 27 154 |
| 1990 | 18 150 | 57 109 | 86 428 | 71 456 | 31 232 | 9 842 | 42 520 | 16 445 | 29 438 |
| 1991 (1) | 20 080 | 63 174 | 96 817 | 79 278 | 34 734 | 10 918 | 47 318 | 18 308 | 32 766 |
| 1992 (1) | 21 748 | 69 234 | 105 661 | 86 326 | 37 856 | 12 120 | 51 436 | 20 190 | 35 775 |
| 1993 (1) | 21 799 | 72 000 | 113 092 | 90 706 | 39 065 | 12 190 | 54 349 | 21 005 | 36 975 |
| 1994 (1) | 21 615 | 74 681 | 120 757 | 95 020 | 40 134 | 12 389 | 57 439 | 21 935 | 38 049 |
| 1995 (1) | 22 484 | 79 115 | 128 356 | 100 272 | 42 257 | 12 915 | 59 748 | 22 904 | 40 050 |
| 1996 (1) | 24 498 | 87 894 | 141 770 | 110 547 | 46 495 | 13 983 | 65 718 | 25 109 | 44 091 |
| 1997 (1) | 23 628 | 84 891 | 139 018 | 107 189 | 45 062 | 13 022 | 63 965 | 24 022 | 42 733 |
(1) SNCB non comprise.
Assurance obligatoire
soins de santé
Coût moyen par bénéficiaire
Montants en francs
| Régime général Algemene regeling |
Régime travailleurs indépendants Regime voor de zelfstandigen |
RG + RTI AR + R Zelfst. |
|||||||
| TIP + PNP PUG + NPB |
VIPO 75 % WIGW 75 % |
VIPO 100 % WIGW 100 % |
VIPO WIGW |
Total Totaal |
TIP + CR PUG + KG |
VIPO WIGW |
Total Totaal |
||
| 1982 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1983 | 107,4 | 121,0 | 112,7 | 112,9 | 110,4 | 114,2 | 110,0 | 114,7 | 110,9 |
| 1984 | 113,1 | 140,2 | 121,6 | 123,2 | 118,9 | 129,0 | 122,2 | 129,0 | 119,9 |
| 1985 | 114,7 | 145,5 | 123,5 | 125,1 | 121,1 | 129,0 | 125,7 | 131,3 | 122,4 |
| 1986 | 128,5 | 164,4 | 141,5 | 141,8 | 137,1 | 149,3 | 148,5 | 153,8 | 139,0 |
| 1987 | 138,5 | 186,0 | 156,2 | 157,1 | 150,6 | 160,1 | 159,6 | 165,3 | 152,5 |
| 1988 | 138,4 | 188,8 | 159,5 | 159,5 | 152,4 | 159,7 | 163,2 | 167,4 | 154,5 |
| 1989 | 148,0 | 204,6 | 172,5 | 172,2 | 163,7 | 174,3 | 180,3 | 184,4 | 166,5 |
| 1990 | 158,6 | 227,0 | 189,8 | 189,4 | 177,3 | 185,0 | 196,6 | 199,8 | 180,5 |
| 1991 (1) | 175,4 | 251,1 | 212,6 | 210,1 | 197,2 | 205,2 | 218,8 | 222,5 | 200,9 |
| 1992 (1) | 190,0 | 275,2 | 232,1 | 228,8 | 214,9 | 227,8 | 237,9 | 245,3 | 219,4 |
| 1993 (1) | 190,4 | 286,2 | 248,4 | 240,4 | 221,8 | 229,1 | 251,3 | 255,2 | 226,7 |
| 1994 (1) | 188,8 | 296,9 | 265,2 | 251,9 | 227,9 | 232,8 | 265,6 | 266,5 | 233,3 |
| 1995 (1) | 196,4 | 314,5 | 281,9 | 265,8 | 239,9 | 242,7 | 276,3 | 278,3 | 245,6 |
| 1996 (1) | 214,0 | 349,4 | 311,4 | 293,0 | 264,0 | 262,8 | 303,9 | 305,1 | 270,4 |
| 1997 (1) | 206,4 | 337,5 | 305,3 | 284,1 | 255,9 | 244,7 | 295,8 | 291,9 | 262,1 |
(1) SNCB non comprise.
Tableau 5
Comparaison des dépenses moyennes par état social
pour certaines prestations (sans la SNCB)
1. Dépenses totales
| TIP PUG |
Inv. | Pensionnés Gepensioneerden |
Veuves Weduwen |
Total Totaal |
|
| Consultations et visites de médecins. Raadplegingen en bezoeken geneesheren | 17 187,4 | 2 176,8 | 9 566,1 | 3 491,5 | 32 421,8 |
| Praticiens de l'art infirmier. Verpleegkundigen | 1 418,3 | 1 106,7 | 8 692,1 | 4 519,4 | 15 736,5 |
| Prestations pharmaceutiques. Farmaceutische verstrekkingen | 29 392,3 | 6 505,4 | 29 983,6 | 8 086,4 | 73 967,7 |
| Prix de la journée d'entretien. Verpleegdagprijs | 31 477,3 | 12 852,6 | 38 036,3 | 13 100,8 | 95 467,0 |
| Implants, bandagistes et orthopédistes. Implantaten, bandagisten en orthopedisten | 2 825,2 | 757,2 | 4 703,2 | 1 215,5 | 9 501,1 |
2. Dépenses moyennes par assuré
| TIP PUG |
Inv. | Pensionnés Gepensioneerden |
Veuves Weduwen |
Total Totaal |
|
| Consultations et visites de médecins. Raadplegingen en bezoeken geneesheren | 2 659 | 7 062 | 6 259 | 8 585 | 3 723 |
| Praticiens de l'art infirmier. Verpleegkundigen | 219 | 3 590 | 5 687 | 11 112 | 1 807 |
| Prestations pharmaceutiques. Farmaceutische verstrekkingen | 4 547 | 21 105 | 19 618 | 19 883 | 8 494 |
| Prix de la journée d'entretien. Verpleegdagprijs | 4 869 | 41 696 | 24 887 | 32 212 | 10 963 |
| Implants, bandagistes et orthopédistes. Implantaten, bandagisten en orthopedisten | 437 | 2 456 | 3 077 | 2 989 | 1 091 |
3. Comparaison
| TIP PUG |
Inv. | Pensionnés Gepensioneerden |
Veuves Weduwen |
Total Totaal |
|
| Consultations et visites de médecins. Raadplegingen en bezoeken geneesheren | 1,0000 | 2,6559 | 2,3539 | 3,2287 | 1,4002 |
| Praticiens de l'art infirmier. Verpleegkundigen | 1,0000 | 16,3927 | 25,9680 | 50,7397 | 8,2511 |
| Prestations pharmaceutiques. Farmaceutische verstrekkingen | 1,0000 | 4,6415 | 4,3145 | 4,3728 | 1,8680 |
| Prix de la journée d'entretien. Verpleegdagprijs | 1,0000 | 8,5636 | 5,1113 | 6,6157 | 2,2516 |
| Implants, bandagistes et orthopédistes. Implantaten, bandagisten en orthopedisten | 1,0000 | 5,6201 | 7,0412 | 6,8398 | 2,4966 |
Tableau 6
Évolution des effectifs pour les quatre trimestres
de 1997 et deux trimestres de 1998
| I. Régime général I. Algemene regeling |
1-1997 | 2-1997 | 3-1997 | 4-1997 | 1-1998 | 2-1998 |
| TIP + fonctionnaires et assimilés. PUG + overheidspers. en gelijkgest. | 6 429 958 | 6 448 036 | 6 455 306 | 6 469 852 | 6 455 279 | 6 471 125 |
| 100 % | | | 52 384 | 64 657 | 70 853 | 74 549 |
| 75 % | 6 429 958 | 6 448 036 | 6 402 922 | 6 405 195 | 6 384 426 | 6 396 576 |
| Invalides. Invaliden | 284 506 | 282 727 | 282 451 | 282 549 | 283 109 | 283 261 |
| 100 % | 150 510 | 149 069 | 150 289 | 150 707 | 151 521 | 151 849 |
| 75 % | 133 996 | 133 658 | 132 162 | 131 842 | 131 588 | 131 412 |
| Total TI + fonctionnaires et assimilés. Totaal UG + overheidspers. en gelijkgest. | 6 714 464 | 6 730 763 | 6 737 757 | 6 752 401 | 6 738 388 | 6 754 386 |
| 100 % | 150 510 | 149 069 | 202 673 | 215 364 | 222 374 | 226 398 |
| 75 % | 6 563 954 | 6 581 694 | 6 535 084 | 6 537 037 | 6 516 014 | 6 527 988 |
| Handicapés. Minder-validen | 24 522 | 24 626 | 24 550 | 25 715 | 36 304 | 41 265 |
| 100 % | 21 276 | 21 351 | 23 234 | 24 256 | 33 973 | 39 176 |
| 75 % | 3 246 | 3 275 | 1 316 | 1 459 | 2 331 | 2 089 |
| Veuves et orphelins. Weduwen en wezen | 426 883 | 426 585 | 425 941 | 425 880 | 424 393 | 423 143 |
| 100 % | 246 961 | 245 242 | 244 272 | 243 127 | 240 805 | 239 182 |
| 75 % | 179 922 | 181 343 | 181 669 | 182 753 | 183 588 | 183 961 |
| Pensionnés. Gepensioneerden | 1 573 983 | 1 579 327 | 1 585 496 | 1 587 912 | 1 588 019 | 1 587 654 |
| 100 % | 518 073 | 515 600 | 520 034 | 518 607 | 511 030 | 507 768 |
| 75 % | 1 055 910 | 1 063 727 | 1 065 462 | 1 069 305 | 1 076 989 | 1 079 886 |
| Personnes non protégées (3). Niet-beschermde personen (3) | 106 130 | 107 524 | 105 416 | 109 958 | 127 167 | 134 380 |
| 100 % | | | 65 203 | 74 511 | 86 428 | 93 931 |
| 75 % | 106 130 | 107 524 | 40 213 | 35 447 | 40 739 | 40 449 |
| Total. Totaal | 8 845 982 | 8 868 825 | 8 879 160 | 8 901 866 | 8 914 271 | 8 940 828 |
| 100 % | 936 820 | 931 262 | 1 055 416 | 1 075 865 | 1 094 610 | 1 106 455 |
| 75 % | 7 909 162 | 7 937 563 | 7 823 744 | 7 826 001 | 7 819 661 | 7 834 373 |
| Titulaires non assurés. Niet-verzekerde gerechtigden | 43 624 | 37 591 | 32 265 | 22 158 | 39 921 | 34 917 |
| II. Régime travailleurs indépendants II. Regeling zelfstandigen |
1-1997 | 2-1997 | 3-1997 | 4-1997 | 1-1998 | 2-1998 |
| TIP (1). PUG (1) | 868 345 | 873 829 | 869 446 | 874 410 | 861 675 | 863 585 |
| 100 % | | | 2 590 | 2 998 | 3 133 | 3 125 |
| 75 % | 868 345 | 873 829 | 866 856 | 871 412 | 858 542 | 860 460 |
| Invalides (1). Invaliden (1) | 26 351 | 25 883 | 25 799 | 25 253 | 25 340 | 25 459 |
| 100 % | 13 358 | 13 037 | 13 419 | 13 060 | 13 121 | 13 170 |
| 75 % | 12 993 | 12 846 | 12 380 | 12 193 | 12 219 | 12 289 |
| Veuves et orphelins (1). Weduwen en wezen (1) | 38 097 | 37 858 | 37 519 | 37 436 | 37 305 | 36 931 |
| 100 % | 25 988 | 25 891 | 26 366 | 26 309 | 26 307 | 26 010 |
| 75 % | 12 109 | 11 967 | 11 153 | 11 127 | 10 998 | 10 921 |
| Pensionnés (1). Gepensioneerden (1) | 126 586 | 126 869 | 126 524 | 126 088 | 126 081 | 125 647 |
| 100 % | 70 010 | 70 179 | 69 989 | 69 855 | 71 075 | 70 949 |
| 75 % | 56 576 | 56 690 | 56 535 | 56 233 | 55 006 | 54 698 |
| Total (1) (2). Totaal (1) (2) | 1 059 379 | 1 064 439 | 1 059 288 | 1 063 187 | 1 050 401 | 1 051 622 |
| 100 % | 109 356 | 109 107 | 112 364 | 112 222 | 113 636 | 113 254 |
| 75 % | 950 023 | 955 332 | 946 924 | 950 965 | 936 765 | 938 368 |
| Communautés religieuses. Kloostergemeenschappen | 5 968 | 5 944 | 5 835 | 5 654 | 4 843 | 4 891 |
| Handicapés. Minder-validen | 46 271 | 46 327 | 46 084 | 45 463 | 53 908 | 53 865 |
| 100 % | 31 658 | 31 539 | 32 520 | 32 348 | 37 916 | 37 961 |
| 75 % | 14 613 | 14 788 | 13 564 | 13 115 | 15 992 | 15 904 |
| Titulaires non assurés. Niet-verzekerde gerechtigden | 25 382 | 20 114 | 15 508 | 10 513 | 26 222 | 23 578 |
(1) Y compris les handicapés.
(2) Travailleurs indépendants à activité unique.
(3) À partir du 1er janvier 1998 : « personnes inscrites au Registre national ».
Tableau 7
Principaux postes de dépenses en rééducation
fonctionnelle et professionnelle
(en millions de francs)
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | |
| Rééducation professionnelle. Herscholing : | |||||
| Programmes individuels. Individuele programma's | 10,7 | 46,9 | 27,8 | 57,9 | 52,7 |
| Conventions. Overeenkomsten | 144,6 | 185,8 | 150,8 | 159,1 | 176,7 |
| Total. Totaal | 155,3 | 232,7 | 178,6 | 217,0 | 229,4 |
| Nomenclature de la rééducation fonctionnelle. Revalidatienomenclatuur : | |||||
| Logopédie. Logopedie | 583,7 | 648,7 | 722,9 | 795,1 | 847,9 |
| Orthopédie. Orthopsie | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
| Appareils. Toestellen | 38,6 | 55,0 | 57,7 | 77,9 | 192,3 |
| Patients souffrants d'affectations cardiaques (1). Hartpatiënten (1) | | | | | 60,8 |
| Total. Totaal | 622,9 | 704,5 | 781,4 | 873,8 | 1 101,7 |
| Conventions types (2). Typeovereenkomsten (2) : | |||||
| Autosurveillance du diabète. Zelfcontrole diabetes | 427,1 | 510,0 | 598,8 | 744,2 | 814,4 |
| Oxygénothérapie à domicile. Zuurstoftherapie thuis | 125,1 | 159,2 | 201,3 | 235,7 | 243,9 |
| Mort subite du nourrisson. Wiegedood | 113,6 | 161,0 | 197,1 | 219,6 | 219,2 |
| Assistance ventilatoire mécanique chronique. Chronische mechanische ademhalingsondersteuning | 69,8 | 105,9 | 125,3 | 196,5 | 197,2 |
| Thérapie par perfusion continue d'insuline. Continue insuline infusietherapie | 17,7 | 20,7 | 21,4 | 30,8 | 28,7 |
| Total. Totaal | 753,3 | 956,8 | 1 143,9 | 1 427,1 | 1 503,4 |
| Conventions spécifiques. Specifieke overeenkomsten : | |||||
| Enfants et adolescents présentant des troubles de la parole, du langage et des troubles vocaux. Kinderen en adolescenten met spraak-, taal- en stemstoornissen | 800,3 | 954,1 | 878,2 | 1 185,9 | 1 286,2 |
| Enfants et adolescents présentant des troubles mentaux ou du comportement. Kinderen en adolescenten met mentale of gedragsstoornissen | 684,1 | 824,0 | 706,2 | 1 002,3 | 1 080,0 |
| Toxicomanes. Verslaafden | 380,2 | 515,5 | 469,5 | 518,1 | 658,0 |
| Psychotiques. Psychotici | 421,1 | 565,6 | 552,7 | 532,1 | 529,3 |
| Adultes psychiquement handicapés. Psychisch minder-valide volwassenen | 388,8 | 438,9 | 448,4 | 445,2 | 478,6 |
| Troubles neurologiques et moteurs. Neurologische en motorische stoornissen | 465,3 | 514,5 | 533,1 | 466,9 | 388,3 |
| Épileptiques. Epileptici | 331,4 | 498,3 | 355,2 | 264,9 | 269,3 |
| Mucoviscidose et autres affectations respiratoires. Mucoviscidose en andere respiratoire aandoeningen | 123,9 | 214,8 | 197,9 | 261,4 | 219,6 |
| Enfants présentant une affectation médico-psycho-sociale sévère. Kinderen met een ernstige medico-psychosociale aandoening | 92,6 | 115,7 | 101,5 | 97,3 | 98,9 |
| Malentendants. Slechthorenden | 60,0 | 83,9 | 83,1 | 95,6 | 92,5 |
| Paralysés cérébraux. Hersenverlamden | 50,0 | 57,1 | 54,4 | 49,2 | 61,7 |
| Soins palliatifs. Palliatieve zorgen | 50,8 | 53,9 | 40,2 | 54,9 | 26,9 |
| Malades atteints du sida. Aids-patiënten | | | | | 19,0 |
| Patients souffrant d'affectations cardiaques (1). Hartpatiënten (1) | 36,6 | 35,1 | 37,4 | 38,6 | 14,6 |
| Rééducation visuelle. Visuele revalidatie | 4,2 | 5,6 | 4,6 | 5,0 | 5,8 |
| Total. Totaal | 3 889,3 | 4 877,0 | 4 462,4 | 5 017,4 | 5 228,7 |
| Autres (3). Overige (3) | 549,6 | 334,8 | 176,6 | 227,8 | 232,4 |
| Total de la rééducation fonctionnelle et professionnelle. Totaal revalidatie en herscholing | 5 970,4 | 7 105,8 | 6 742,9 | 7 763,1 | 8 295,6 |
(1) Dans le courant de 1996, la rééducation fonctionnelle des patients présentant des affections cardiaques a été transférée des conventions dans la nomenclature des prestations de rééducation fonctionnelle.
(2) Les dépenses des conventions types relatives aux défibrillateurs cardiaques implantables ont été, depuis quelques années déjà, transférées dans les dépenses de la nomenclature des prestations de santé, en attendant le transfert des prestations elles-mêmes dans cette nomenclature.
(3) Les autres postes concernent entre autres les frais de déplacement (les bénéficiaires qui se rendent dans un centre de rééducation fonctionnelle et en reviennent, centre avec lequel le Comité de l'assurance des soins de santé a conclu une convention de rééducation fonctionnelle, et ce, en utilisant un véhicule adapté au transport des invalides en voiturette, peuvent sous certaines conditions aussi entrer en ligne de compte pour une intervention dans les frais de déplacement) et le dépassement de la capacité de facturation normale.
B. Discussion
Un membre constate que la politique sélective menée ces dernières années a eu pour objectif d'atténuer en faveur d'une série de groupes cibles les effets du rélèvement généralisé des quotes-parts restant à charge des assurés sociaux. Ainsi, la franchise fiscale a été introduite afin d'éviter que les dépenses en matière de santé ne dépassent un tiers du revenu disponible du ménage. Cette mesure atteint-elle son but ?
Sur base des tableaux communiqués, M. De Cock estime possible d'évaluer, en moyenne, le montant des tickets modérateurs (ce qui ne correspond pas à l'ensemble des dépenses de santé) pris en charge par catégorie de revenus. Ainsi, pour l'exercice d'imposition 1996, la moyenne des tickets modérateurs pour les 67 411 familles dont les revenus imposables ne dépassaient pas 537 999 francs et qui ont bénéficié de la franchise fiscale, s'est élevée à environ 28 000 francs. Étant donné la très large dispersion au niveau des dépenses, il est cependant délicat de tirer des conclusions générales. Afin d'affiner l'analyse, il a demandé à ces services d'effectuer le calcul par tranche de revenus de 50 000 francs. Pour être complet, il faut aussi rappeler que les bénéficiaires de la franchise sociale ou d'un régime préférentiel n'entrent pas en ligne de compte pour la franchise fiscale.
Franchise fiscale du ticket modérateur
Exercice d'imposition 1996 Revenus de 1995
Situation au 30 juin 1997
Source : Ministère des Finances Traitement : INS
A. Résultats par tranche de revenu
| Revenu imposable globalement Gezamenlijk belastbaar inkomen |
Nombre de ménages fiscaux Aantal fiscale gezinnen |
Montant total des remboursements Totaal bedrag terugbetalingen |
Montant moyen par ménage fiscal Gemiddelde bedrag per fiscaal gezin |
Seuil (approximatif) Drempel (bij benadering) |
|
| 0 | 50 000 | 538 | 9 209 463 | 17 118 | 15 000 |
| 50 000 | 100 000 | 1 797 | 24 696 667 | 13 743 | 15 000 |
| 100 000 | 150 000 | 1 550 | 19 928 172 | 12 857 | 15 000 |
| 150 000 | 200 000 | 2 228 | 28 474 006 | 12 780 | 15 000 |
| 200 000 | 250 000 | 3 312 | 44 273 748 | 13 368 | 15 000 |
| 250 000 | 300 000 | 4 411 | 58 544 388 | 13 272 | 15 000 |
| 300 000 | 350 000 | 5 738 | 78 526 494 | 13 685 | 15 000 |
| 350 000 | 400 000 | 7 864 | 92 567 705 | 11 771 | 15 000 |
| 400 000 | 450 000 | 12 304 | 156 587 859 | 12 727 | 15 000 |
| 450 000 | 500 000 | 17 829 | 250 173 011 | 14 032 | 15 000 |
| 500 000 | 550 000 | 16 899 | 232 215 120 | 13 741 | 15 000 |
| 550 000 | 600 000 | 13 483 | 200 396 185 | 14 863 | 20 000 |
| 600 000 | 650 000 | 12 882 | 193 509 617 | 15 022 | 20 000 |
| 650 000 | 700 000 | 12 212 | 178 205 058 | 14 593 | 20 000 |
| 700 000 | 750 000 | 10 916 | 150 220 075 | 13 761 | 20 000 |
| 750 000 | 800 000 | 10 414 | 140 521 197 | 13 493 | 20 000 |
| 800 000 | 850 000 | 7 279 | 100 986 569 | 13 874 | 20 000 |
| 850 000 | 900 000 | 3 222 | 56 342 708 | 17 487 | 30 000 |
| 900 000 | 950 000 | 2 874 | 47 924 687 | 16 675 | 30 000 |
| 950 000 | 1 000 000 | 2 632 | 41 410 216 | 15 733 | 30 000 |
| 1 000 000 | 1 250 000 | 7 137 | 124 368 836 | 17 426 | 30 000 |
| 1 250 000 | 1 500 000 | 2 109 | 43 020 292 | 20 398 | 40 000 |
| 1 500 000 | 2 000 000 | 1 236 | 29 726 728 | 24 051 | 50 000 |
| 2 000 000 | 3 000 000 | 719 | 17 436 368 | 24 251 | 50 000 |
| 3 000 000 | 4 000 000 | 176 | 4 671 752 | 26 544 | 50 000 |
| 4 000 000 | 5 000 000 | 40 | 945 015 | 23 625 | 50 000 |
| 5 000 000 | 7 500 000 | 52 | 1 362 153 | 26 195 | 50 000 |
| 7 500 000 | 10 000 000 | 11 | 439 741 | 39 976 | 50 000 |
| 10 000 000 | Et plus. En meer | 9 | 325 636 | 36 182 | 50 000 |
| Total. Totaal | 161 873 | 2 327 009 466 | 14 376 |
B. Résultats cumulés par tranche de revenus
| Revenu imposable globalement Gezamenlijk belastbaar inkomen |
Nombre de ménages fiscaux Aantal fiscale gezinnen |
Montant total des remboursements Totaal bedrag terugbetalingen |
Montant moyen par ménage fiscal Gemiddelde bedrag per fiscaal gezin |
|
| 0 | 50 000 | 538 | 9 209 463 | 17 118 |
| 0 | 100 000 | 2 335 | 33 906 130 | 14 521 |
| 0 | 150 000 | 3 885 | 53 834 302 | 13 857 |
| 0 | 200 000 | 6 113 | 82 308 308 | 13 464 |
| 0 | 250 000 | 9 425 | 126 582 056 | 13 430 |
| 0 | 300 000 | 13 836 | 185 126 444 | 13 380 |
| 0 | 350 000 | 19 574 | 263 652 938 | 13 470 |
| 0 | 400 000 | 27 438 | 356 229 643 | 12 983 |
| 0 | 450 000 | 39 742 | 512 808 502 | 12 903 |
| 0 | 500 000 | 57 571 | 762 981 513 | 13 253 |
| 0 | 550 000 | 74 470 | 995 196 633 | 13 364 |
| 0 | 600 000 | 87 953 | 1 1195 5922 818 | 13 594 |
| 0 | 650 000 | 100 835 | 1 389 102 435 | 13 776 |
| 0 | 700 000 | 113 047 | 1 567 307 493 | 13 864 |
| 0 | 750 000 | 123 963 | 1 717 527 568 | 13 855 |
| 0 | 800 000 | 134 377 | 1 858 048 765 | 13 827 |
| 0 | 850 000 | 141 656 | 1 959 035 334 | 13 830 |
| 0 | 900 000 | 144 878 | 2 015 378 042 | 13 911 |
| 0 | 950 000 | 147 752 | 2 063 302 729 | 13 965 |
| 0 | 1 000 000 | 150 384 | 2 104 712 945 | 13 996 |
| 0 | 1 250 000 | 157 521 | 2 229 081 781 | 14 151 |
| 0 | 1 500 000 | 159 630 | 2 272 102 073 | 14 234 |
| 0 | 2 000 000 | 160 866 | 2 301 828 801 | 14 309 |
| 0 | 3 000 000 | 161 585 | 2 319 2665 169 | 14 353 |
| 0 | 4 000 000 | 161 761 | 2 323 936 921 | 14 366 |
| 0 | 5 000 000 | 161 801 | 2 324 881 936 | 14 369 |
| 0 | 7 500 000 | 161 853 | 2 326 244 089 | 14 373 |
| 0 | 10 000 000 | 161 864 | 2 326 683 830 | 14 374 |
| 0 | > 10 000 000 | 161 873 | 2 327 009 466 | 14 376 |
C. Résultats cumulés par tranche de revenu (en pour cent)
| Revenu imposable globalement Gezamenlijk belastbaar inkomen |
Nombre de ménages fiscaux (en %) Aantal fiscale gezinnen (in %) |
Montant total des remboursements (en %) Totaal bedrag terugbetalingen (in %) |
|
| 0 | 50 000 | 0,33 | 0,40 |
| 0 | 100 000 | 1,44 | 1,46 |
| 0 | 150 000 | 2,40 | 2,31 |
| 0 | 200 000 | 3,78 | 3,54 |
| 0 | 250 000 | 5,82 | 5,44 |
| 0 | 300 000 | 8,55 | 7,96 |
| 0 | 350 000 | 12,09 | 11,33 |
| 0 | 400 000 | 16,95 | 15,31 |
| 0 | 450 000 | 24,55 | 22,04 |
| 0 | 500 000 | 35,57 | 32,79 |
| 0 | 550 000 | 46,01 | 42,77 |
| 0 | 600 000 | 54,33 | 51,38 |
| 0 | 650 000 | 62,29 | 59,69 |
| 0 | 700 000 | 69,84 | 67,35 |
| 0 | 750 000 | 76,58 | 73,81 |
| 0 | 800 000 | 83,01 | 79,85 |
| 0 | 850 000 | 87,51 | 84,19 |
| 0 | 900 000 | 89,50 | 86,61 |
| 0 | 950 000 | 91,28 | 88,67 |
| 0 | 1 000 000 | 92,90 | 90,45 |
| 0 | 1 250 000 | 97,31 | 95,79 |
| 0 | 1 500 000 | 98,61 | 97,64 |
| 0 | 2 000 000 | 99,38 | 98,92 |
| 0 | 3 000 000 | 99,82 | 99,67 |
| 0 | 4 000 000 | 99,93 | 99,87 |
| 0 | 5 000 000 | 99,96 | 99,91 |
| 0 | 7 500 000 | 99,99 | 99,97 |
| 0 | 10 000 000 | 99,99 | 99,99 |
| 0 | > 10 000 000 | 100,00 | 100,00 |
Un autre membre est frappé par l'énorme disparité existant entre les prestations pharmaceutiques dans le régime « ambulatoire » et « hospitalisé ». Il souligne l'importance des prestations pharmaceutiques dans la problématique de l'accès aux soins de santé, d'autant plus que ces postes sont exclus de la franchise fiscale et sociale. Le budget annuel pour les prestations pharmaceutiques avoisinait les 74 milliards en 1996, médicaments du groupe D non compris. L'INAMI dispose-t-il, grâce au système Pharmanet, de données plus précises concernant l'impact du coût des médicaments pour les assurés sociaux ? Quelles mesures peuvent-elles être envisagées pour abaisser le seuil d'accès ? Où se situe la Belgique par rapport à ses voisins ?
Le même orateur s'interroge sur l'impact budgétaire de la directive 93/42 relative aux accessoires médicaux. Cette réglementation prévoit l'utilisation unique desdits accessoires. La transposition de cette directive en droit belge engendrera un surcoût important pour tous les hôpitaux. Qui le prendra en charge ? Il est à craindre que ces coûts supplémentaires ne soient portés en compte au patient.
En réponse, M. De Cock signale que le système Pharmanet permet uniquement d'analyser le comportement des médecins en matière de prescription pour les produits remboursés en tout ou partie par l'INAMI. Aucune donnée concernant la consommation de médicaments par patient n'est actuellement disponible. La ministre des Affaires sociales a formulé certaines propositions en vue d'étendre le système Pharmanet à la collecte de telles données.
En ce qui concerne la disparité entre le montant des médicaments dans le régime ambulant et hospitalier, celle-ci est notamment la conséquence de la classification des médicaments en plusieurs groupes, avec un régime de ticket modérateur distinct par catégorie. Or, les médicaments de la catégorie A (sans ticket modérateur) sont le plus souvent administrés en milieu hospitalier, ce qui a pour conséquence d'alourdir très fortement les dépenses de l'AMI. Enfin, on a évalué le total des dépenses pour des médicaments non remboursés à 29 milliards de francs en 1995.
En ce qui concerne les accessoires médicaux, l'orateur nuance l'interprétation du membre quant à l'usage unique (one use ) de ces accessoires. Il appartient au producteur de spécifier sur l'emballage si le matériel peut être réutilisé ou non. Des discussions sont en cours au sein du département de la Santé publique pour veiller à ce que la transposition de la directive 93/42 n'engendre pas une explosion des dépenses dans le secteur des soins de santé.
Un intervenant rappelle également sa proposition de réduction de 21 % à 6 % du taux de TVA appliqué sur les accessoires médicaux. Selon lui, l'impact budgétaire devrait en être très réduit puisque la perte fiscale serait compensée par une baisse des remboursements pour les forfaits journaliers.
M. De Cock rappelle qu'en avril dernier, le comité d'assurance de l'INAMI a considéré que l'abaissement du taux de TVA sur les accessoires médicaux n'apportait pas de réponse satisfaisante à la problématique du coût desdits accessoires.
Une oratrice souhaite profiter de la présence de l'administrateur-général pour obtenir des informations concernant le dépassement de 8 milliards de francs annoncé dans le budget de l'INAMI, auquel la presse a fait largement écho. De même, a-t-on déjà pu évaluer l'impact de la cotisation complémentaire à charge de l'industrie pharmaceutique prévue par la loi-programme ? Par ailleurs, la membre s'étonne que le budget réservé aux soins palliatifs (tableau 7, accords spécifiques) soit en constante diminution entre 1993 (50,8 millions francs) et 1997 (26,9 millions francs). Comment expliquer cette évolution alors que la problématique des soins palliatifs mérite une attention toute particulière dans une perspective qualitative des soins de santé.
Pour M. De Cock le déficit de 8 milliards de francs est le résultat d'une extrapolation jusqu'à fin décembre des dépenses de la première moitié de l'année 1998. Sur base de ces prévisions, le total des dépenses atteindrait 461 milliards de francs par rapport à 453 milliards de francs budgétisés. L'intervenant estime qu'il est difficile de faire des projections précises mais qu'il est probable que le total des dépenses pour 1998 dépassera le budget initial. En ce qui concerne le poste « soins palliatifs » repris au tableau 7, l'orateur signale que le libellé couvre deux types de prestations : la rééducation de patients souffrant d'un cancer et une initiative en matière d'accompagnement de patients en phase terminale. Le montant de 26,9 millions de francs repris au tableau 7 pour l'année 1997 ne couvre pas toutes les dépenses ayant trait aux soins palliatifs. Une partie de celles-ci sont comptabilisées sous d'autres rubriques. À partir de l'année prochaine, l'enveloppe budgétaire pour les soins palliatifs sera portée à 120 millions de francs, auxquels il faut ajouter 90 millions de francs pour les accessoires médicaux.
Une autre intervenante aborde la question des groupes cibles. Quel est le seuil minimum de cas pour la reconnaissance par l'INAMI d'un groupe spécifique ? Un seul cas est-il suffisant dans des situations exceptionnelles ?
Le docteur Verrecken rappelle qu'il existe un fonds spécial de solidarité au sein de l'INAMI qui se penche sur des pathologies à caractère tout à fait spécifique. Il se réfère aux cas d'épidermiolise dont il a été question récemment dans la presse. De tels patients, moyennant l'introduction d'un dossier auprès du fonds de solidarité, peuvent être reconnus par l'INAMI et bénéficier ainsi d'une intervention majorée à charge de la collectivité. Cette procédure, qui reste cependant mal connue, se déroule comme suit : le médecin conseil de l'organisme assureur qui constate une pathologie répondant à certains critères (affection exceptionnelle, coût pour le patient...) prend l'initiative d'introduire un dossier devant le fonds de solidarité. Le collège des directeurs et médecins examine la demande avec possibilité de renvoi du dossier auprès de la mutualité, du dispensateur de soins ou du patient pour une mise un état complémentaire. Une fois le dossier complet, le fonds de solidarité prend sa décision. Celle-ci est notifiée à la mutualité qui doit ensuite en informer le patient. Il s'agit dès lors d'une procédure assez lourde et longue.
L'INAMI élabore actuellement un formulaire standard à l'attention des médecins conseils afin que les demandes soient complètes dès leur introduction. De même, une série d'avis légalement obligatoires et qui ralentissaient la procédure seront à l'avenir facultatifs. Ces améliorations devraient permettre de raccourcir la procédure.
Un membre regrette que l'existence du fonds de solidarité ne soit pas mieux connue dans le public. En ce qui concerne le cas d'épidermiolise passé à la télévision, il est choquant de voir que des collectes de fonds ont été organisées au mépris total du respect élémentaire de la vie privée du jeune patient concerné alors qu'il existe un système légal qui devrait permettre d'apporter une réponse au problème de santé rencontré.
Une autre intervenante insiste également pour que l'INAMI ne perde pas de vue le fait que les prestations de base du système de soins de santé (par exemple la visite chez le médecin généraliste) restent accessibles à tous. Le suivi de l'évolution technologique de la médecine, aussi important qu'il soit, ne peut nous détourner de ses missions de base.
M. De Cock fait état des discussions actuellement en cours au sein de la commission médico-mutualiste afin de garantir l'accessibilité au médecin généraliste. Dans cette même perspective, le comité de l'INAMI a émis une recommandation à l'autorité de tutelle en vue d'une réduction complémentaire du montant des tickets modérateurs.
Un membre enchaîne sur ce dernier point en faisant remarquer que les fusions entre hôpitaux vont réduire l'accessibilité géographique aux soins. Des mesures sont-elles envisagées pour compenser l'augmentation des frais de déplacement consécutifs à la fermeture de certains services ? Ce poste est d'autant plus lourd pour le patient qu'il est amené, dans le cadre de maladies chroniques, à devoir se déplacer fréquemment.
Enfin, le membre se demande si les économies d'échelle espérées au travers de fusions d'hôpitaux seront effectivement réalisées. Ne risque-t-on pas d'avoir une pression en vue d'appliquer le tarif le plus élevé ? Existe-t-il un suivi de ces fusions ?
En réponse, M. De Cock signale que le suivi administratif des fusions d'hôpitaux est de la compétence du ministère de la Santé publique. Il rappelle que les normes quant à la taille des hôpitaux (maximum 150 lits) sont connues depuis longtemps et que le but de ces rapprochements est de générer des économies.
En ce qui concerne l'éventuelle augmentation des frais de déplacement à la suite de la fermeture de certains centres hospitaliers, le Dr Verrecken estime que rien n'est prévu à ce sujet. Il fait état de l'expérience malheureuse des remboursements des frais de déplacement dans le cadre d'une rééducation. L'intervention de l'INAMI a dû être réduite aux seuls transports en taxi adaptés pour fauteuils roulants en raison de l'explosion des coûts.
Une dernière intervenante interroge sur la raison pour laquelle, dans le tableau 7, les dépenses pour les enfants et adolescents victimes de troubles mentaux et comportementaux passent de 706,2 millions francs en 1995 à 1 002,3 millions francs en 1996 et 1 080,0 millions francs en 1997.
Le Dr Verrecken fait remarquer que les dépenses pour les enfants victimes de troubles mentaux couvrent les frais des centres de rééducation pour enfants autistes ainsi que des centres émanant du Fonds national pour le reclassement des handicapés. Pour éviter toute discrimination salariale, les barèmes et avantages appliqués en faveur du personnel des hôpitaux privés ont été étendus au personnel des centres de reclassement.
Au 1er janvier 1998 est entrée en vigueur une réforme de l'assurabilité fondamentale. Elle concernait donc les règles administratives auxquelles tout assuré social doit se conformer pour exercer son droit aux soins de santé. L'objectif avoué de cette réforme était de garantir une accessibilité généralisée au droit aux soins de santé à tout un chacun et en particulier aux groupes socio-économiques défavorisés de la population du Royaume. La réalisation de cet objectif nécessitait évidemment un assouplissement des règles administratives en vigueur. Cependant, cette seule modification aurait été insuffisante, et en quelque sorte, la réforme aurait été vaine si elle ne s'était accompagnée de mesures visant à maintenir le coût des soins de santé à un niveau raisonnable pour chaque ménage. C'est pourquoi, d'une part, les conditions d'accès financières au droit aux soins de santé et il s'agit plus particulièrement de l'obligation de cotisation ont été fondamentalement revues et, d'autre part, des mesures ont été prises en vue de maintenir les tickets modérateurs c'est-à-dire la quote-part personnelle que doit réellement supporter tout assuré social dans la mesure où elle ne fait pas l'objet d'une prise en charge par l'assurance soins de santé à un niveau raisonnable par rapport aux moyens disponibles pour chaque ménage.
Cela concerne donc les mesures prises visant à assouplir les règles administratives subordonnant l'exercice effectif du droit aux soins de santé, qui sont entrées en vigueur au 1er janvier 1998.
Le Rapport général sur la pauvreté a mis en évidence que l'une des raisons expliquant les difficultés rencontrées par les assurés sociaux résidait dans la multiplicité des régimes dans le secteur des soins de santé, chaque régime ayant ses propres règles; les passages d'un régime à l'autre s'en trouvaient compliqués.
Pour rappel, avant le 1er janvier 1998, il existait à côté des deux régimes professionnels, que sont le régime général où se retrouvent les travailleurs salariés et assimilés, et le régime indépendant où se retrouvaient les personnes assujetties au statut social des travailleurs indépendants, cinq régimes résiduaires, à savoir : le régime relatif aux handicapés, le régime relatif aux étudiants de l'enseignement supérieur, le régime relatif aux membres des communautés religieuses, le régime relatif à certains anciens agents des services publics en Afrique et, enfin, le régime relatif aux personnes non encore protégées.
Depuis le 1er janvier 1998, il ne subsiste que deux régimes où, dans la mesure du possible, les mêmes règles sont applicables : le régime général et le régime indépendant. Dans le régime général se retrouvent, outre les personnes salariées et assimilées qui s'y trouvaient déjà auparavant, les anciens régimes résiduaires, à l'exception cependant des membres des communautés religieuses et des handicapés présentant un lien avec le secteur indépendant qui, eux, ont été intégrés dans le régime indépendant. Il importe de remarquer que cette intégration s'est faite dans le respect des droits des différents assurés.
Outre cette suppression des régimes résiduaires, la réforme s'est accompagnée de mesures supprimant toute condition de résidence préalable en Belgique, toute exigence de stage à l'inscription ainsi que de toute perception d'une première cotisation majorée qui, pour rappel, pouvait comprendre les cotisations se rapportant à cinq années civiles au maximum. De plus, une qualité de titulaire du droit aux soins de santé peut maintenant être acquise par toute personne ayant son inscription au Registre national des personnes physiques. De ce qui précède, il ressort que, depuis le 1er janvier 1998, toute personne ayant son inscription au registre national des personnes physiques peut donc, moyennant une affiliation auprès d'une mutualité, ouvrir un droit immédiat aux soins de santé jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle ce droit s'est ouvert.
Compte tenu de l'esprit des mesures qui viennent d'être rappelées, il a paru nécessaire de simplifier également les conditions d'inscription comme personne à charge : c'est ainsi que dans ce contexte également, les conditions relatives à une durée de résidence préalable (exigée par exemple pour une inscription en qualité d'ascendant) ont été supprimées. Tout en garantissant cette accessibilité plus aisée à la qualité de personne à charge, des mesures ont également été prises pour qu'un droit individuel aux soins de santé comme titulaire reste possible : cela permet, par exemple, à un enfant rencontrant des difficultés dans son milieu familial, d'avoir ce droit aux soins de santé à titre individuel.
Enfin, toujours dans ce contexte, des mesures ont été prises de façon à obtenir que l'obligation de cotisation soit proportionnelle aux capacités contributives du ménage concerné et tienne toujours compte de la situation sociale dans laquelle se trouve un assuré. Par exemple, une personne inscrite au Registre national des personnes physiques et ayant une activité salariée réduite tout en continuant à bénéficier du minimum de moyens d'existence, ne sera plus tenue au paiement d'une cotisation complémentaire importante comme auparavant.
Ainsi que souligné ci-dessus, la réforme de l'assurabilité serait, en quelque sorte, restée vaine si elle ne s'était accompagnée de mesures visant à maintenir dans des limites acceptables la quote-part personnelle exigée des assurés sociaux, tout particulièrement lorsqu'ils se trouvent dans une situation sociale difficile ou précaire.
Trois types de mesures ont été prises :
1º instauration d'une franchise sociale et fiscale;
2º élargissement du « statut VIPO »;
3º mesures en faveur des malades chroniques.
1º Instauration d'une franchise sociale et fiscale
a) La franchise sociale
I. Définition du concept
La franchise sociale est une mesure qui profite à certaines catégories d'assurés dignes d'intérêt sur le plan socio-économique et qui consiste en une réduction de l'intervention personnelle pour certaines prestations de santé.
Par intervention personnelle (appelée aussi ticket modérateur), on entend la partie des frais de soins de santé qui reste à charge de l'assuré et pour laquelle aucune intervention de l'assurance soins de santé ne peut être obtenue.
La franchise sociale signifie que l'on est dispensé (du paiement) de ladite intervention personnelle pendant une année civile déterminée dès que pour cette année, le bénéficiaire et les éventuelles personnes à sa charge supportent un total de 15 000 francs d'interventions personnelles. À partir du moment où le plafond de 15 000 francs de tickets modérateurs est atteint, l'assurance prend à son compte, pour le reste de l'année, les frais prévus dans l'assurance obligatoire soins de santé.
Il importe également de signaler que tant les bénéficiaires du régime général des soins de santé et indemnités que ceux du régime des travailleurs indépendants peuvent bénéficier de la franchise sociale. Toutefois, en ce qui concerne les travailleurs indépendants, mais uniquement pour ceux qui bénéficient de l'intervention majorée de l'assurance, il est tenu compte aussi de la partie du coût des soins de santé étant à leur charge dans le cadre de l'assurance libre (c'est-à-dire une assurance à laquelle souscrivent de nombreux travailleurs indépendants pour se prémunir contre les petits risques) afin de déterminer si le plafond de 15 000 francs est atteint ou non.
II. Bénéficiaires
Les catégories de personnes suivantes, ainsi que les personnes à leur charge, peuvent bénéficier de la franchise sociale :
les personnes qui ont droit au revenu garanti aux personnes âgées, au minimum de moyens d'existence ou à l'aide y assimilée, alloués par le CPAS;
les personnes qui ont droit à l'intervention majorée de l'assurance;
les bénéficiaires handicapés qui bénéficient d'une des interventions pour personnes handicapées en application de la loi du 27 février 1987;
les personnes qui sont sans emploi depuis six mois au moins et qui ont droit à une allocation de chômage en qualité de travailleur salarié chômeur avec charge de famille ou en qualité d'isolé;
les bénéficiaires d'allocations familiales majorées.
III. Quels frais de soins de santé ?
Il va de soi que seules entrent en considération les prestations de santé qui sont remboursables dans l'assurance maladie, à l'exception des prestations suivantes :
les frais de médicaments;
les frais de séjour à l'hôpital : à partir du 91e jour d'hospitalisation dans un hôpital général et à partir du 366e jour d'hospitalisation dans un hôpital psychiatrique;
les frais d'hébergement dans une maison de repos pour personnes âgées et dans une maison de repos et de soins.
Ensuite, il convient de remarquer qu'en ce qui concerne le groupe des travailleurs indépendants, la franchise sociale ne peut, en toute logique, s'appliquer qu'aux prestations pour lesquelles, dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, une intervention de l'assurance est prévue en leur faveur. (Autrement dit, pour le groupe de travailleurs indépendants, la franchise sociale ne peut s'appliquer qu'aux prestations de santé qui sont définies comme des gros risques).
IV. De quelle manière obtient-on le droit ?
L'organisme assureur examine lui-même si une personne a droit ou non à la franchise sociale. Aussi existe-t-il entre les organismes assureurs et certains autres organismes de paiement un système d'échange d'informations électronique par lequel l'organisme assureur entre automatiquement, à tout moment, en possession de données relatives à un assuré déterminé.
Dès que l'organisme assureur constate qu'un assuré déterminé a droit à la franchise sociale, il délivre une attestation au bénéficiaire. Cette attestation mentionne le jour à partir duquel le droit à la franchise sociale est ouvert.
L'organisme assureur est alors, à partir de la date mentionnée sur l'attestation précitée, redevable à l'assuré de l'intervention de l'assurance à 100 %. Il verse celle-ci soit sous la forme d'une dispense de l'intervention personnelle, soit sous la forme d'un remboursement pour le reste de l'année civile en cours.
Le fait que l'on ait droit ou non à la franchise sociale fait partie des données reprises sur la « carte SIS » (carte d'identité sociale). Ces données ne sont cependant pas lisibles sur la carte elle-même mais figurent de façon cryptée sur le support électronique de la carte.
b) Franchise fiscale
I. Définition du concept
On entend par franchise fiscale le remboursement par l'Administration des contributions directes du montant des tickets modérateurs qui, pour une année civile, dépasse un certain plafond en fonction du revenu imposable net du ménage.
Ce remboursement s'effectue soit en déduisant le montant à rembourser des impôts à payer en plus pour l'année de revenus concernée, soit en le versant au contribuable assuré, s'il ne doit pas payer d'impôts supplémentaires.
II. Bénéficiaires
La franchise fiscale est applicable à tous les assurés qui ne bénéficient pas de la franchise sociale :
pour des revenus du ménage de 0 à 537 999 francs, le plafond est de 15 000 francs,
pour des revenus du ménage de 538 000 francs à 828 999 francs, le plafond est de 20 000 francs,
pour des revenus du ménage de 829 000 francs à 1 119 999 francs, le plafond est de 30 000 francs,
pour des revenus du ménage de 1 120 000 francs à 1 410 999 francs, le plafond est de 40 000 francs,
pour des revenus du ménage à partir de 1 411 000 francs, le plafond est de 50 000 francs.
Si on constate, pour ces assurés, que, pour une année civile, leur ménage a payé un montant total de tickets modérateurs supérieur au plafond fixé pour leur catégorie de revenus, le montant de tickets modérateurs payé en trop leur est remboursé.
III. Quels frais de soins de santé ?
La restriction mentionnée ci-dessus en ce qui concerne la franchise sociale est également applicable sur le plan de la franchise fiscale.
Les frais de soins de santé exclus de la franchise sociale le sont également de la franchise fiscale, étant entendu que les frais de séjour à l'hôpital n'entrent aucunement en ligne de compte.
IV. De quelle manière obtient-on le droit ?
Comme il a été mentionné ci-dessus, ce n'est pas la mutualité qui effectue le remboursement, mais l'Administration des contributions. Ce remboursement consiste dans le reversement par l'Administration des contributions de l'intervention personnelle d'une année à titre d'immunisation fiscale ou dans l'imputation de celle-ci sur les impôts sur les revenus éventuellement dus par le bénéficiaire ou par le ménage fiscal (on entend par ce terme la personne ou l'ensemble des personnes à charge de laquelle ou desquelles une seule cotisation fiscale unique est établie en matière d'impôts des personnes physiques).
2º Élargissement du « statut VIPO »
L'intervention majorée de l'assurance (ce que l'on appelle le statut VIPO), qui consiste en une intervention de l'assurance plus importante, voire totale, dans le coût des prestations était, depuis de nombreuses années, octroyée aux personnes qui ont un certain statut (ces personnes sont inscrites auprès de leur mutualité en une des qualités suivantes :veuf ou veuve, invalide, orphelin ou pensionné) et dont les revenus du ménage n'atteignent pas un certain plafond (actuellement, ce plafond s'élève à 465 211 francs augmenté de 86 123 francs par personne à charge).
Depuis le 1er juillet 1997, ce statut a été élargi à certaines catégories de personnes se trouvant dans une situation sociale bien définie (que l'on retrouve d'ailleurs dans la franchise sociale où une adaptation similaire s'est produite) : il s'agit des personnes qui bénéficient du minimum de moyens d'existence ou d'une aide équivalente octroyée par les CPAS et prise en charge par l'État, du revenu garanti aux personnes âgées, d'une allocation de handicapé ou, enfin, des enfants handicapés bénéficiaires, de ce fait, d'allocations familiales majorées.
Une autre modification est envisagée et devrait sortir ses effets sous peu : il s'agit d'octroyer ce statut aux titulaires chômeurs, âgés de cinquante ans au moins et qui sont au chômage complet depuis un an au moins et qui, pour la réglementation relative aux allocations de chômage, ont la qualité de travailleur chef de famille ou d'isolé : dans la mesure où les revenus de leur ménage n'atteignent pas le plafond susvisé, le droit à l'intervention majorée de l'assurance pourrait également leur être octroyé.
3º Mesures en faveur de malades chroniques
En 1998, la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités a été modifiée, d'une part, de façon à permettre la prise en charge des matières et produits de soins pour les soins à domicile des bénéficiaires souffrant d'une affection grave et, d'autre part, pour permettre soit de supprimer totalement ou partiellement l'intervention personnelle en faveur des bénéficiaires atteints d'une maladie chronique, soit d'instaurer, à titre d'intervention supplémentaire dans le coût des soins, une allocation forfaitaire en faveur de ces malades dont le degré de dépendance par rapport aux soins est important.
Avec effet au 1er juin 1998, un forfait de 10 000 francs par an est octroyé sous certaines conditions en vue de couvrir le coût du matériel d'incontinence et, d'autre part, un forfait de 10 000 francs est octroyé aux personnes répondant au statut de malade chronique et qui satisfont aux deux conditions suivantes : se trouver dans une situation de dépendance et avoir supporté, pendant deux années civiles consécutives, des interventions personnelles d'un montant de 10 000 francs par an.
Les chefs de ménage invalides qui ont besoin de l'aide d'un tiers auront droit à une allocation mensuelle de 5 000 francs, comme c'est déjà le cas aujourd'hui pour les invalides isolés (2 500 francs à partir du 1er octobre 1998 et 5 000 francs à partir du 1er octobre 1999).
Des mesures spécifiques ont également été prises en 1998 en vue d'un meilleur remboursement de trois pathologies : la mucoviscidose, les maladies métaboliques et les affections neuro-musculaires.
De plus, pour ces trois groupes, des centres de référence ont été reconnus et financés.
La ministre conclut en rappelant que le gouvernement a dû consentir des efforts budgétaires considérables ces dernières années, non seulement pour atteindre les normes de Maastricht, mais aussi pour créer la marge financière nécessaire pour pouvoir relever les défis démographiques de demain.
Cela n'a pas empêché le gouvernement de prendre, dans le domaine de l'assurance soins de santé, un certain nombre de mesures radicales qui ont trait à l'assurabilité et aux tickets modérateurs.
L'OCDE, qui se montre généralement assez critique concernant les réformes opérées sur le plan social, a récemment fait une évaluation positive de l'assurabilité et du système dans son ensemble. Avec des dépenses qui représentent un pourcentage relativement limité du PIB, le système garantit des soins de santé d'un niveau qualitativement élevé à la quasi-totalité de la population. L'OCDE émet cependant quelques réserves au sujet de ce qu'elle considère comme une trop grande multiplicité de l'offre.
Un échantillon limité a montré que l'ensemble des mesures prises depuis 1997 en faveur d'un CPAS tel que celui de Molenbeek débouche sur une réduction des dépenses de l'ordre de 20 millions de francs contre environ 60 millions de francs pour une ville comme Bruxelles et ce, sur une période de neuf mois. Les pouvoirs locaux se voient ainsi délivrés d'un lourd fardeau qui pesait sur leurs épaules et les moyens ainsi dégagés peuvent être affectés à d'autres secteurs, tels que l'emploi.
Pour ce qui est des malades chroniques en particulier, trois affections donnent actuellement droit à un remboursement ou une intervention majorée pour des prestations qui ne sont normalement pas remboursables (par exemple, les fauteuils roulants pour enfants de moins de 6 ans atteints de myopathie). Il s'agit de la mucoviscidose, des maladies métaboliques et des affections neuro-musculaires. Des centres de référence ont été reconnus et financés pour ces trois groupes.
L'objectif futur est de poursuivre dans cette voie et d'augmenter le nombre de pathologies ouvrant le droit à une intervention majorée. Au lieu de partir du principe d'un remboursement en fonction de la prestation, on tend vers une approche plus globale des pathologies, dans laquelle le remboursement porte sur un éventail de soins donnés.
S'il est vrai que plusieurs de ces pathologies génèrent des frais élevés pour le patient, elles ne sont cependant guère fréquentes. D'autres pathologies par contre, comme le diabète, sont très répandues et en expansion. Il importe donc de mener en l'espèce une politique fortement axée sur la prévention et ce, pas uniquement en raison de considérations budgétaires. Le remboursement de certaines molécules doit être adapté en conséquence.
Il va de soi que la commission des maladies chroniques, qui est installée au sein de l'INAMI, jouera un rôle fondamental à cet égard.
Les médicaments B ne sont pas couverts par la franchise sociale. Étant donné que les frais y afférents sont ressentis par certains groupes de patients comme une charge fort lourde, une somme de 450 millions de francs a été dégagée pour financer une intervention majorée au profit des malades chroniques. En ce qui concerne l'application pratique de cette mesure, il reste quelques difficultés pratiques à résoudre. La carte SIS ne permet pas actuellement l'identification de ces patients par le pharmacien.
N'entrent pas non plus dans le cadre de la franchise sociale les hospitalisations à partir du 91e jour, chose assez rare, bien qu'existante, et les séjours en institut psychiatrique à partir de la 2e année. Les problèmes qui se posent sur ce dernier point sont plus nombreux.
Enfin, les frais de séjour en maison de repos ou en maison de repos et de soins n'entrent pas non plus dans le cadre de la franchise sociale. Nous arrivons actuellement à la fin de la deuxième phase d'un plan de reconversion qui vise à convertir, sur une période de cinq ans, 10 000 lits de maison de repos en lits de maison de repos et de soins. Cela signifie que les subventions passeront de 1 395 francs/jour à 1 900 francs/jour. Cette augmentation servira à améliorer l'encadrement.
À partir du 1er avril prochain, 67 000 seniors en situation de dépendance pourront bénéficier d'une majoration de l'allocation qu'ils touchent dans le cadre de l'aide aux personnes âgées. Cette mesure s'inscrit dans une réorganisation générale du système dans le cadre de laquelle l'attribution des points est revue et le plafond de revenus est relevé.
Un membre fait remarquer qu'en ce qui concerne la franchise fiscale, il y a lieu d'entendre par revenu net imposable le revenu net après déduction des cotisations à la sécurité sociale. Cette définition est fort différente de celle utilisée en droit fiscal. Comme le système est déjà assez confus pour les intéressés, il est à craindre que ce genre d'ambiguïté n'ajoute à son opacité.
La ministre répond que plusieurs questions ont effectivement été soulevées dans un passé récent au sujet de la franchise fiscale. Une des grandes objections est que l'avantage n'est accordé qu'après un à deux ans. Le régime ne résout donc pas le problème des personnes à revenus modestes au moment où elles doivent supporter les dépenses de santé. À l'inverse, leur situation financière peut s'être améliorée au moment où elles bénéficient de l'avantage.
En outre, le système est également très complexe sur le plan administratif. Les montants versés aux patients en raison de la franchise fiscale doivent être remboursés au ministère des Finances par le département des Affaires sociales. Il s'agit en effet d'un avantage social, non d'un avantage fiscal.
Le système fait l'objet d'une évaluation au sein d'un groupe de travail mixte des Finances et des Affaires sociales. Personnellement, la ministre est partisane d'une fusion des avantages des deux systèmes. On pourrait envisager de signaler au prestataire, au moyen de la carte SIS, que le patient a droit à la franchise. Il va de soi que, pour des raisons liées au respect de la vie privée, cette information devra être sévèrement protégée. En outre, pour les mêmes raisons, l'information fournie devra être aussi restreinte que possible; elle devra, par exemple, être limitée à l'indication que le patient a ou non dépassé un plafond de revenus convenu.
Ce système ne semble toutefois pas réalisable à bref délai, entre autres pour des raisons pratiques.
Un autre intervenant demande quelle est l'attitude de la ministre et de l'Inami vis-à-vis de l'organisation du traitement de la douleur. D'autres pays européens comme la France semblent être bien plus avancés dans la réflexion sur ce problème que la Belgique.
La ministre admet que sur ce plan, la Belgique accuse du retard par rapport à certains autres pays. Lorsqu'on considère la politique suivie par l'AMI dans le passé, on constate une certaine hésitation quant au remboursement des anti-douleurs pour les patients en phase terminale.
Malgré le fait que, par exemple, le « Centre des douleurs » à Liège fait oeuvre de pionnier en la matière, notre pays n'a pas de « culture » de la lutte contre la douleur. Cependant, une culture des soins palliatifs se met en place très progressivement et on peut espérer que, dans ce cadre, des moyens nouveaux de combattre la douleur seront mis au point. Cela pourrait également apporter une réponse partielle à certains problèmes qui se posent actuellement sur le plan éthique. La douleur est souvent un des facteurs étant à la base de la demande d'abrègement de la vie.
Une membre signale que l'intervention forfaitaire de 10 000 francs qui est octroyée depuis le 1er juin aux malades chroniques, répond indéniablement à une demande de la part des groupes concernés. Cette intervention est toutefois subordonnée à deux conditions : le patient doit se trouver dans un état de dépendance et il doit avoir payé en interventions personnelles un montant de 10 000 francs pendant deux années consécutives.
Le montant susvisé est relativement élevé, mais c'est surtout la première condition qui suscite l'étonnement. En effet, il est parfaitement possible que des patients atteints d'une maladie chronique aient des frais très élevés sans pour autant se trouver dans une situation de dépendance.
Le ministre répond qu'en ce qui concerne la prise en charge des malades chroniques, on peut distinguer deux écoles. La première approche, qui est celle appliquée en France, consiste à dresser une liste limitative des pathologies qui donnent lieu à un remboursement, qui sera soit intégral, soit plus élevé que la normale. Le grand désavantage d'une telle liste est précisément son caractère limitatif. C'est le système du tout ou rien. Les pathologies qui entraînent également des frais élevés mais qui ne figurent pas sur la liste ne peuvent bénéficier d'aucune forme de traitement préférentiel. La liste peut être revue, mais c'est un processus qui peut durer longtemps.
Reste à savoir ce qu'il faut entendre par « remboursement intégral ». Est-ce que cela signifie que l'assurance-maladie doit verser également une indemnité salariale au patient même ou au membre de sa famille qui quitte son emploi pour prendre soin de lui ? Ce dernier point est en tout cas une demande qui est exprimée par certains groupes de patients.
L'autre approche consiste à se baser sur les données disponibles dans les mutuelles pour répartir les moyens disponibles entre les patients dont les dépenses de maladie sont les plus élevées.
Le gouvernement a demandé au collège intermutualiste de faire une proposition relative à l'affectation du budget mis à la disposition des malades chroniques. Le collège a élaboré un catalogue des besoins auxquels il estime qu'on doit répondre de manière prioritaire. Ce catalogue comprend entre autres le forfait pour le matériel pour l'incontinence et le forfait général pour les malades chroniques qui peuvent être détectés sur la base des données financières dont l'assurance-maladie dispose.
L'expérience a montré que ces deux forfaits représentent une aide appréciable pour les patients concernés.
À l'époque où ces propositions ont été formulées, on a demandé si les ressources ne seraient pas mieux utilisées en assurant un meilleur remboursement des médicaments de la catégorie B. Cette proposition s'est cependant heurtée au même problème. Compte tenu du fait qu'il est budgétairement impossible d'assurer un meilleur remboursement pour tous les patients, cela aurait en effet voulu dire qu'il fallait malgré tout mettre à part un certain nombre de maladies chroniques.
L'introduction du forfait était donc largement motivée par le souci de ne pas laisser traîner les choses à cause de débats sur la question de savoir ce qu'est une maladie chronique.
Il sera ainsi possible, dans une phase ultérieure, lorsque l'on disposera de davantage de ressources, d'évoluer dans la direction qui a été indiquée précédemment, c'est-à-dire déterminer effectivement des éventails de soins pour certaines pathologies graves et maladies chroniques. Ces éventails comprendront également des médicaments à action préventive. Par ailleurs, le remboursement sera axé sur une meilleure utilisation des médicaments. La consommation belge de certains groupes de ceux-ci, comme les antidépresseurs, est trop élevée par comparaison à d'autres pays.
Ayant entendu des représentants ou porte-parole :
de la Fondation Roi Baudouin
de l'Institut scientifique de la Santé publique Louis Pasteur
des CPAS de Bruxelles, d'Anvers et de Roulers
de l'Association des villes et communes belges
du Conseil national supérieur des handicapés
du ministère des Affaires économiques
de l'Association générale de l'industrie des médicaments
des organismes assureurs :
l'Alliance nationale des mutualités chrétiennes
l'Union nationale des mutualités socialistes
l'Union nationale des mutualités libérales
l'Union nationale des mutualités neutres
l'Union nationale des mutualités libres
des dispensateurs de soins :
l'Association pharmaceutique belge
l'Union professionnelle des bandagistes et orthopédistes de Belgique
les organisations de médecins ABSYM et Le Cartel
de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité
la ministre des Affaires sociales.
1) que les dépenses en matière de soins de santé restent difficiles à maîtriser;
2) que par le passé, on a surtout tenté de remédier à cette situation en augmentant les contributions personnelles du patient;
3) que des correctifs sociaux ont certes été apportés face à la croissance des contributions personnelles, notamment par le biais de :
la franchise sociale et fiscale;
l'extension du régime préférentiel des VIPO;
l'extension de l'assurabilité;
4) que d'importantes différences sociales, économiques et culturelles subsistent néanmoins , y compris sur le plan de la mortalité et de la morbidité;
5) qu'une série d'obstacles financiers, administratifs, psychologiques et matériels constituent aussi une entrave à l'accessibilité des soins de santé pour beaucoup de patients;
6) que l'on risque de voir apparaître un système de soins de santé à deux vitesses aux conséquences difficilement acceptables.
En concertation avec le Parlement, d'être attentif, au cours de la prochaine législature, à l'accessibilité des soins de santé pour les patients atteints de pathologies graves et de maladies chroniques et de faire des propositions concrètes en la matière; il convient, à cet effet, de s'attaquer aux problèmes suivants :
1) la norme de croissance des dépenses de soins de santé, compte tenu de l'évolution démographique;
2) l'enregistrement, l'agrément, la formation des prix et le remboursement des médicaments;
3) les habitudes de prescription et la consommation de spécialités pharmaceutiques et de médicaments génériques;
4) l'introduction de possibilités techniques nouvelles et l'assurance de la qualité des soins;
5) les prestations médicales et les honoraires;
6) les frais hospitaliers;
7) l'accessibilité financière des prothèses et implants;
8) le régime préférentiel et le régime du tiers payant;
9) la coordination entre les divers échelons de la dispensation des soins;
10) la formation des médecins, des paramédicaux et autres dispensateurs de soins;
11) les problèmes des catégories de soins spécifiques :
patients souffrant de maladies chroniques;
patients psychiatriques;
handicapés;
patients en phase terminale;
patients nécessitant un traitement analgésique particulier.
Ces recommandations ont été adoptées à l'unanimité des 8 membres présents.
Le présent rapport a été approuvé par un vote identique.
| Le rapporteur,
Jacques D'HOOGHE. |
La présidente,
Francy VAN DER WILDT. |
(1) Audition de M. P.M. Neirinckx, le 16 décembre 1997.
(2) Audition du 17 novembre 1998 du professeur Herman Van Oyen, chef du Département d'épidémiologie.
(3) Audition du 8 décembre 1998.
Présents :
M. Mayeur, président du CPAS de Bruxelles
M. Decoene, secrétaire du CPAS de Roulers et Mme Deseger, travailleuse sociale principale de ce CPAS;
M. Windey, directeur des Affaires sociales au CPAS d'Anvers.
(4) Audition du 20 janvier 1999 :
M. Claude Emonts, président de la section CPAS de l'Union des villes et communes de Wallonie et président du CPAS de Liège;
M. C. Van Exter, président de la section CPAS de l'Association de la ville et des communes de la Région de Bruxelles-Capitale (AVCB) et président du CPAS d'Uccle;
M. Frans Destoop, président de la section Maatschappelijk Welzijn de la Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten et président du CPAS de Courtrai;
M. Th. Lesiw, secrétaire de la section CPAS de l'UVCB;
Mme Fabienne Wernette, chef du service social du CPAS de Charleroi;
M. J.-M. Rombeaux, secrétaire de la section CPAS de l'Association de la ville et des communes de la Région de Bruxelles-Capitale (AVCB);
Mme An Neels, chef de la section Maatschappelijk Werk VVSG, et
M. Jean Dumont, directeur de l'aide sociale du CPAS de Liège.
(5) Audition du 2 décembre 1998 de : M. Aerts, président, Mme Maes, vice-présidente, MM. Janssens et Degodenne, membres du Conseil national supérieur des handicapés.
(6) Audition du 10 novembre 1998 du Dr Etienne Wauters, de M. Jean Hermesse et de Mme Hilde Van Winckel.
(7) 25 % des malades chroniques sondés (statut E : 20 %, dialyse rénale : 18 %, parkinson : 14 % et groupe ticket modérateur 2 × 15 000 francs : 45 %). Sans modération pour la franchise sociale et fiscale.
(8) Audition du 10 novembre du docteur Ivan Van der Meeren.
(9) Personnes qui ont droit pendant six mois à un remboursement majoré pour des prestations de kinésithérapie, comme les patients souffrant de sclérose en plaques.
(10) Audition du 17 novembre 1998 du docteur André Hanon et de M. Gilbert Wouters.
(11) Audition du 10 novembre 1998 de M. Van Oycke et du docteur Lefèvre.
(12) Audition du 3 décembre 1998 de MM. Alexis Wautot, Thierry Steylemans, Joeri Guillaume et Philippe Draps, de l'Union des Mutualités indépendantes.
(13) Audition du 17 novembre 1998 de Mme Pierlet, de Mme P'Tito et de M. Wytmeur, collaborateurs du cabinet du ministre de l'Économie.
(14) Audition du 3 février 1999 de M. Pierre Claessens, administrateur délégué, de M. Herman Van Eeckout, et du professeur Alain De Wever, président-directeur général de l'Association générale de l'industrie du médicament (AGIM).
(15) Audition du 8 décembre 1998 avec MM. Bernard Bailleux, président, Jean-Marc Sabaux et Dirk Broecks, secrétaires généraux, Jan Denecker, vice-président, et Guiseppe Dal Mas, membre du comité de direction de l'Association pharmaceutique belge.
(16) Audition du 3 décembre 1998 de MM. Weyn, secrétaire général, et Duchesne, de l'Association professionnelle des bandagistes et orthopédistes de Belgique.
(17) Audition du 10 février 1999 de Milan Roex, Karel Van De Meulebroeke et Jean-Michel Melis du « Cartel » et de Michel Vermeylen, de l'Association belge des Syndicats médicaux.
(18) Audition du 10 novembre 1998 avec M. De Cock, administrateur général de l'INAMI, Mme Servotte et le docteur Verrecken.